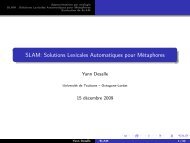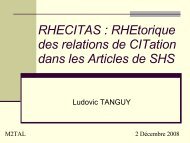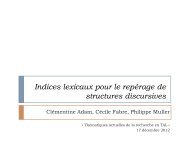Hathout, N. (2009) - ERSS - Université Toulouse II-Le Mirail
Hathout, N. (2009) - ERSS - Université Toulouse II-Le Mirail
Hathout, N. (2009) - ERSS - Université Toulouse II-Le Mirail
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
30 Un modèle théorique de la morphologie lexicale<br />
catégoriel ne sont pas directement en correspondance. Ils le sont seulement par l’intermédiaire<br />
du niveau lexical. Ces correspondances peuvent être représentées schématiquement<br />
comme en figure 2.1. L’objectif de la morphologie est de trouver les meilleures correspondances<br />
possibles entre ces quatre niveaux. Pour ce faire, les correspondances sont soumises<br />
à un système de contraintes permettant de sélectionner celles qui offrent la coïncidence<br />
optimale entre sens, positions lexicales, formes et catégories. <strong>Le</strong> niveau lexical est donc<br />
l’équivalent du niveau morphomique proposé par (Aronoff 1994:25).<br />
sémantique sens visé<br />
↕<br />
lexique position lexicale ↔ catégorie morphosyntaxe<br />
↕<br />
réalisation forme réalisée<br />
Figure 2.1 – Un modèle à quatre niveaux. <strong>Le</strong> niveau sémantique est composé de sens,<br />
le niveau formel de formes, le niveau catégoriel de traits morphosyntaxiques et le niveau<br />
lexical de positions lexicales. Chaque niveau possède sa propre structure. <strong>Le</strong>s structures des<br />
quatre niveaux sont relationnelles. <strong>Le</strong>s relations à chaque niveau définissent une mesure de<br />
proximité. La morphologie met en correspondance les objets qui composent les quatre<br />
niveaux en préservant au mieux les proximités qui existent au sein de chaque niveau. <strong>Le</strong>s<br />
positions lexicales servent d’interface entre les formes des mots (formes réalisées), leurs<br />
propriétés morphosyntaxiques (catégories) et les sens qui leur sont attribués (sens visés).<br />
La morphologie est utilisée en production et en reconnaissance. Dans le premier cas,<br />
elle est conçue comme un prestataire de service dont le rôle est d’exprimer un sens à l’aide<br />
d’un mot, lorsqu’il existe un moyen d’y parvenir. Pour être exprimé, ce sens, que j’appellerai<br />
sens visé, doit être apparié à une position p dans le lexique qui peut être soit occupée,<br />
soit encore vide, mais cette distinction n’est pas essentielle. La position p ne peut pas être<br />
située n’importe où dans l’espace lexical. Seuls les emplacements qui peuvent entrer dans<br />
les structures paradigmatiques existantes sont autorisés pour les sens construits. En conséquence,<br />
le lexique est un espace discret, ce qui distingue ce modèle de celui de Victorri<br />
(1994), Ploux et Victorri (1998). La morphologie détermine ensuite la forme la plus appropriée<br />
à l’identification de p, tout en tenant compte du contexte particulier dans lequel le<br />
mot est utilisé et notamment des propriétés morphosyntaxiques qu’il détermine. Lorsque<br />
p contient des mots mémorisés, elle exerce une attraction qui favorise la réutilisation de<br />
l’une des formes de ces mots (Burzio 2002). Si p est vide, la morphologie a le choix entre<br />
l’utilisation d’une forme existante, i.e. de la forme d’un mot mémorisé qui occupe une position<br />
proche de p, ou la création d’une forme nouvelle dont les propriétés définissent les<br />
mêmes proximités avec les formes des mots des positions proches de p que celles de ces<br />
positions avec p. En reconnaissance, les correspondances sont établies en sens inverse. La<br />
première étape consiste à apparier la forme réalisée et les propriétés morphosyntaxiques<br />
de l’occurrence avec une position p dans le lexique. Cette position peut être vide ou déjà