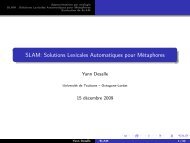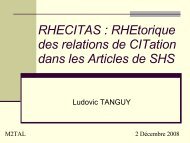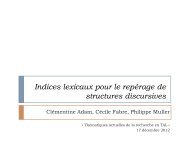Hathout, N. (2009) - ERSS - Université Toulouse II-Le Mirail
Hathout, N. (2009) - ERSS - Université Toulouse II-Le Mirail
Hathout, N. (2009) - ERSS - Université Toulouse II-Le Mirail
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
40 Un modèle théorique de la morphologie lexicale<br />
désignent des segments de la forme des mots, considérés comme de simples indices. Ce ne<br />
sont ni des objets lexicaux, ni des unités qui auraient une représentation dans la grammaire<br />
ou le lexique :<br />
– Par « radical », j’entends la partie de la forme partagée par un mot avec d’autres<br />
membres de sa famille morphologique.<br />
– Par « initiale » et « finale », j’entends la partie de la forme qui est partagée par les<br />
membres de la série morphologique du mot et qui permet de reconnaître cette dernière.<br />
<strong>Le</strong>s familles et les séries dérivationnelles induisent ainsi une segmentation approximative<br />
de la forme des mots qui dégage des signaux destinés à guider l’analyse.<br />
2.6.2 Analogie<br />
Parmi les nombreuses relations lexicales qui s’établissent entre les éléments des paradigmes<br />
présentés ci-dessus, les analogies 8 jouent un rôle particulier dans l’organisation<br />
morphologique du lexique. Elles sont présentes dans tous les paradigmes, flexionnels, dérivationnels,<br />
morphologiques ou lexicaux. Par exemple, dérivons et dérivait qui appartiennent<br />
au même lexème font partie d’analogies comme (12a). De même, au sein de la série<br />
flexionnelle de dérivons, le couple dérivons : évitons participe à un ensemble d’analogies<br />
qui contient (12b). De façon similaire, dérivation et dériver qui appartiennent à la même<br />
famille morphologique sont impliqués dans une série d’analogies telles que (13a). De la<br />
même manière, dérivation et variation qui se trouvent dans la même série dérivationnelle<br />
font partie d’analogies comme (13b).<br />
(12) a. dérivons : dérivait :: parlons : parlait<br />
dérivons : dérivait :: finissons : finissait<br />
dérivons : dérivait :: prenons : prenait<br />
dérivons : dérivait :: évitons : évitait<br />
b. dérivons : évitons :: dériver : éviter<br />
dérivons : évitons :: dériveras : éviteras<br />
(13) a. dérivation : dériver :: navigation : naviguer<br />
dérivation : dériver :: immersion : immerger<br />
b. dérivation : variation :: dériver : varier<br />
dérivation : variation :: dérivable : variable<br />
Il existe plusieurs types d’analogies. <strong>Le</strong>s plus contraintes sont les analogies formelles<br />
qui doivent être vérifiées par les formes elles-mêmes, par exemple par les graphies comme<br />
(12b) (<strong>Le</strong>page 2003, Stroppa 2005, Yvon 2006, Stroppa et Yvon 2006). Il existe d’autre part<br />
des analogies sémantiques comme (14) où la relation concerne le sens des lexèmes (Gentner<br />
1983). Entre ces deux extrémités, on trouve des analogies dérivationnelles morphologiques<br />
qui s’établissent entre des termes qui appartiennent aux mêmes familles morphologiques<br />
8. Pour une présentation générale de l’utilisation de l’analogie comme principe explicatif de faits morphologiques,<br />
voir Dal (2003a, 2008).