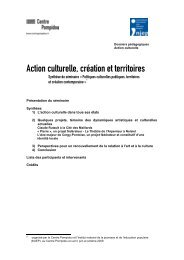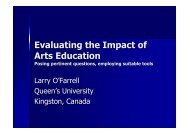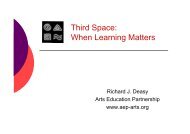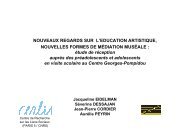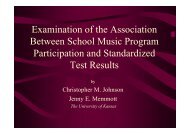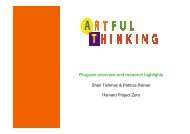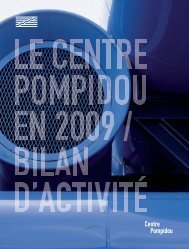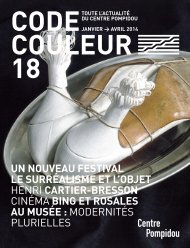Art et technique - Centre Pompidou
Art et technique - Centre Pompidou
Art et technique - Centre Pompidou
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Centre</strong> <strong>Pompidou</strong> / Dossiers pédagogiques / <strong>Art</strong> <strong>et</strong> philosophie : ART ET TECHNIQUE. CHOIX DE TEXTES ET PARCOURS<br />
ultramodernes, dédiés au culte du nouveau, le geste de Raysse recèle un caractère<br />
essentiellement primitif.<br />
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ses sculptures procèdent « d’un exorcisme »,<br />
visant à « chasser l’idée de mort ». Et, au-delà du seul concept d’appropriation de l’obj<strong>et</strong> par<br />
l’artiste, l’enjeu du rituel est de perm<strong>et</strong>tre à l’homme de se réapproprier le monde, ce<br />
monde, entièrement ravalé par l’industrie, où le caractère hétéroclite des obj<strong>et</strong>s produits<br />
exclut tout sentiment d’unité. Les excès du rationalisme industriel en appellent à<br />
l’intervention d’un sorcier pour redonner sa cohérence au monde, fut-ce dans le composite,<br />
<strong>et</strong> lui restituer son caractère magique.<br />
Les totems qu’il érige en assemblant les obj<strong>et</strong>s les plus incompatibles sur le plan visuel,<br />
associant le fluo au marron, l’image à l’obj<strong>et</strong>, la surface au volume, le mat au métallique,<br />
constituent comme un hymne au surplus, à l’indigeste, à la dissonance esthétique.<br />
Tableau métallique : portrait à géométrie convexe, de 1964, joue ainsi de la confrontation<br />
des matériaux, présentant, sur fond métallique, des aplats de feutre noir : le mat absolu<br />
côtoie le brillant le plus extrême pour faire émerger un visage féminin. Ce portrait de France,<br />
la femme de l’artiste, empreinte de l’esthétique des magazines de mode, devient image de la<br />
femme éternelle, ici volontairement exposée aux refl<strong>et</strong>s des spots qui l’éclairent. La<br />
distorsion que le peintre fait subir à la toile accentue la présence des refl<strong>et</strong>s. Quel que soit le<br />
point de vue qu’il adopte pour la regarder, le spectateur est dérangé <strong>et</strong> ne peut entièrement<br />
s’abîmer dans la contemplation de la beauté qui lui fait face. En donnant du volume à la<br />
surface de la toile, Raysse accentue la présence de l’obj<strong>et</strong> tableau <strong>et</strong> m<strong>et</strong> l’image à<br />
distance.<br />
Martial Raysse<br />
Février 1936, Golfe Juan (Alpes-Maritimes)<br />
Nationalité française<br />
LA COLONISATION TECHNIQUE<br />
HÉTÉROGÉNÉITÉ ET POÉTIQUE DE LA DÉMESURE<br />
Dans son ouvrage Culture <strong>et</strong> colonisation, Aimé Césaire explique que tout emprunt d’obj<strong>et</strong><br />
n’est réellement concevable par une société que lorsqu’elle « l’assimile en le faisant soi […]<br />
Lorsqu’une société emprunte, elle s’empare ; elle agit, elle ne subit pas. » Les individus qui<br />
s’approprient l’obj<strong>et</strong> le dépouillent de sa fonction première, de tout ce qui fait sa particularité<br />
pour lui donner un sens nouveau. Cependant, « le cas de la colonisation est tout différent. Il<br />
ne s’agit pas d’emprunt appelé par un besoin, d’éléments culturels s’intégrant spontanément<br />
dans le monde du suj<strong>et</strong>. » Le résultat, né de c<strong>et</strong>te absence de besoin, dans tous les pays<br />
coloniaux, est une mosaïque <strong>et</strong> une hétérogénéité d’éléments culturels. « Dans tous pays<br />
colonisés, nous constatons que la synthèse harmonieuse que constituait la culture indigène<br />
a été dissoute <strong>et</strong> que s’y est substitué un pêle-mêle de traits culturels d’origine différente se<br />
chevauchant sans s’harmoniser. Ce n’est pas forcément la barbarie par manque de culture.<br />
C’est la barbarie par l’anarchie culturelle. » 9<br />
Aimé Césaire précise alors que si l’hétérogénéité des productions d’une culture est<br />
inévitable, témoignant des multiples échanges avec les sociétés environnantes, elle n’est<br />
pas vécue en tant qu’hétérogénéité, il s’agit alors d’une hétérogénéité vécue<br />
intérieurement comme homogénéité. Or, entre les obj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> <strong>technique</strong>s importées dans les<br />
9 Aimé Césaire, Culture <strong>et</strong> colonisation, Premier Congrès des artistes <strong>et</strong> écrivains noirs, Sorbonne, 1956.<br />
……………………………………………………………………………………………………….. 44