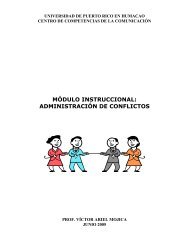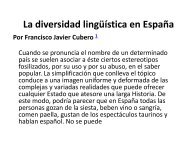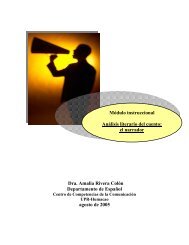GM Moutsopoulos
GM Moutsopoulos
GM Moutsopoulos
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Le modèle empédocléen de pureté élémentaire<br />
Evanghélos A. <strong>Moutsopoulos</strong><br />
LE MODÈLE EMPÉDOCLÉEN DE PURETÉ ÉLÉMENTAIRE<br />
ET SES FONCTIONS<br />
Giornale di Metafisica - Nuova Serie - XXI (1999), pp. 127-132.<br />
127<br />
La pensée d’Empédocle constitue une première tentative de<br />
synthèse des cosmologies ioniennes. La pensée d’Anaxagore lui<br />
fait pendant sur ce plan, la présuppose et la complète, pour<br />
ainsi␣ dire, bien que dans une perspective toute différente. Tout<br />
compte fait, la cosmologie empédocléenne se développe dans<br />
deux directions convergentes qui définissent deux domaines<br />
bien distincts, mais qui sont loin d’être indépendants l’un de<br />
l’autre, à savoir un domaine relatif à la statique universelle, qui a<br />
trait à l’étude du système complet des éléments; et un domaine<br />
relatif à la dynamique universelle, et qui a trait à l’étude du système<br />
des forces d’attraction et de répulsion exercées sur le système<br />
précédent.<br />
Il va de soi que c’est chez Empédocle que l’on trouve, exposée<br />
pour la première fois sous son aspect le plus intégral une<br />
théorie compréhensive et synthétique des quatre éléments, et<br />
aux termes de laquelle les noyaux des premières cosmologies<br />
sont repris et agencés selon une modalité rattachée à une formule<br />
de fonctionnalité combinatoire: ainsi, de principes fondamentaux<br />
qu’ils étaient dans les philosophies de Thalès, d’Anaximène<br />
et d’Héraclite, respectivement, l’eau, l’air et le feu, auxquels<br />
vient se joindre la terre, sont réduits à de simples éléments,<br />
importants, certes, mais tout de même tributaires l’un de<br />
l’autre, dans la mesure où ils sont susceptibles de se composer<br />
entre eux.<br />
Qu’il me soit permis de procéder ici à une digression. Les
128<br />
Evanghélos A. <strong>Moutsopoulos</strong><br />
hypothèses gratuites relatives à des considérations d’ordre historique<br />
n’ont certes pas manqué. Ainsi, un jeune penseur grec,<br />
disparu prématurément, et qui, il y a quelques années encore,<br />
enseignait dans une université de province, avait-il tenté, avec<br />
beaucoup d’imprudence, de compléter la série d’apparition des<br />
trois principes: eau, air, feu, moyennant la série d’apparition des<br />
cosmologies ioniennes, en interpolant, entre l’eau et l’air, l’apeiron<br />
d’Anaximandre. Il accomplissait ainsi un travail de réduction<br />
semblable à celui auquel Empédocle s’était livré, mais poussait,<br />
de la sorte, l’analogie jusqu’à identifier un principe à un élément:<br />
notamment, afin de justifier sa position plus que téméraire,<br />
il en était arrivé à une interprétation plus que fantaisiste,<br />
du genre de celles dont Platon se sert dans le Cratyle, du terme<br />
d’apeiron, qu’il envisageait comme la forme dorienne du terme<br />
d’épeiros (continent, terre ferme, par opposition à océan. Or, dans<br />
son enthousiasme, il avait oublié de noter, en l’occurrence, ce<br />
que, naguère encore, tout élève de troisième à l’école élémentaire<br />
était censé connaître, c’est-à-dire que l’alpha privatif<br />
d’apeiron est bref, et que, de ce seul fait, il ne saurait correspondre<br />
à l’éta long d’épeiros. Du coup, toute cette théorie, pour<br />
le moins séduisante, mais formaliste à l’extrême, et manifestement<br />
arbitraire, s’effondre, nous épargnant ainsi la peine de<br />
procéder à une critique plus substantielle de ses fondements.<br />
Tant qu’une interprétation définitivement satisfaisante de l’apeiron<br />
d’Anaximandre n’aura pas été avancée, on devra s’interdire<br />
tout rapprochement abusif de ce terme, d’un autre terme quelconque:<br />
l’apeiron demeure un principe irréductible à tout élément<br />
que ce soit.<br />
Pour en revenir à notre problématique initiale, signalons que,<br />
d’après Empédocle, les quatre éléments se combinent selon des<br />
rapports variées, sous le signe de l’activité attractive de la philotès,<br />
en un nombre illimité de corps, alors que ceux-ci se désagrègent<br />
en leurs éléments constitutifs sous le signe de l’activité répulsive<br />
du neikos. C’est notamment la variété des rapports de combinaison<br />
qui est, dans ce cas, responsable de la variété des corps obtenus.<br />
Dans cette fonction ils sont supplantés par les principes<br />
d’attraction et de répulsion, de composition et de désagrégation.<br />
D’où l’importance de l’existence des deux domaines distincts, signalée<br />
au début, à savoir d’un domaine d’équilibres, statique; et
Le modèle empédocléen de pureté élémentaire<br />
129<br />
d’un domaine de tendances, dynamique, dans lesquels la pensée<br />
empédocléenne se meut simultanément.<br />
Il existe toutefois une interprétation toute différente, et à laquelle<br />
je ne saurais me rallier: elle fait de philotès l’amour, bien<br />
entendu, mais de neikos, la haine. Ainsi neikos ne serait plus une<br />
répulsion, mais bien un accablement destructif d’un élément par<br />
un autre, avec toutes les conséquences que cela implique. Autrement<br />
dit, il serait question, dans ce cas, non plus de la mise au<br />
point d’une fonction cosmologique d’après un modèle, disons,<br />
mathématique, puis de la destruction, de l’anéantissement, de<br />
cette fonction par un procédé de destruction séparative, mais<br />
plutôt de l’essai de constitution d’une fonction impossible à<br />
constituer, car elle reposerait sur une situation contradictoire,<br />
donc impossible à réaliser.<br />
En ce sens, il me semble qu’on ne saurait concevoir neikos<br />
que comme un principe et comme un processus de séparation à la<br />
fois, non d’absorption anéantissante; sans quoi, si les éléments devaient<br />
s’anéantir les uns les autres, comment pourraient-ils se reconstituer<br />
au cours de la phase suivante? Quant à philotès, il s’agirait<br />
plutôt d’un rapprochement, d’un agrégat, d’un mélange,<br />
que d’une union complète, suivi, lui, d’une séparation qui rendrait<br />
aux éléments agrégés leur pureté première.<br />
Imitant le discours mythoplastique continu de Protagoras<br />
dans son dialogue homonyme, Platon procède à une mention<br />
anticipée de ce qui, dans ses dialogues dits “métaphysiques”, deviendra<br />
sa doctrine des mixtes: quand, fixé par le destin, le moment<br />
de la création des espèces mortelles fût arrivé, les dieux les<br />
auraient modelés à l’intérieur de la terre en mélangeant terre et<br />
feu entre eux et avec tout ce dont ceux-ci tolèrent le mélange.<br />
Rappelons au passage qu’à l’encontre de ce que Protagoras prétendrait,<br />
à savoir que ce sont les dieux qui façonnent le mélange<br />
dont les mortels sont issus, chez Empédocle les dieux eux-mêmes<br />
n’échappent pas au déterminisme qui régit l’Univers 1 . Devrait-on<br />
voir dans ce double mélange indiqué par Platon une<br />
préfiguration du processus de mélange, en deux phases, pour<br />
être plus complet, du Même et de l’Autre avec leur propre mé-<br />
1 ␣ Cf. E. <strong>Moutsopoulos</strong>, Les origines de l’homme, Univ. de Nice, Sophia-<br />
Antipolis 1998, pp. 125-132 (Publications de la Fac. des Lettres, Arts et<br />
Sciences Humaines de Nice, n.s. n° 48).
130<br />
Evanghélos A. <strong>Moutsopoulos</strong><br />
lange, préconisé dans le Timée? Des deux éléments nommément<br />
cités dans le Protagoras platonicien, l’un se présente comme le<br />
plus palpablement matériel; l’autre, comme le moins corporel:<br />
s’agirait-il des deux termes extrêmes d’une série d’éléments?<br />
Par ailleurs, ne devrait-on pas voir dans l’expression “tout ce<br />
qui est susceptible d’être mélangé à la terre et au feu” une indication<br />
littéraire compréhensive des deux autres éléments, l’air<br />
et l’eau? Cela paraît bien vraisemblable, du fait que nul autre<br />
élément pouvant participer dans ce genre de mélange n’est<br />
mentionné ailleurs par Platon. Le système des cinq corps respectivement<br />
représentés par les cinq solides géométriques réguliers<br />
dans le Timée semble constituer plus qu’un simple élargissement<br />
du système classique des quatre éléments, et procéder d’une<br />
conception cosmologique entièrement différente, influencée par<br />
la spéculation mathématique. En effet, chez Empédocle l’éther<br />
se présente comme une simple variation du feu, alors qu’à l’existence<br />
d’un cinquième solide régulier dans le Timée suppose<br />
l’existence d’un cinquième corps autonome.<br />
Dans la philosophie d’Empédocle toute existence représente,<br />
à des degrés divers, la composante de l’union des quatre éléments.<br />
Dans le même ordre d’idées, toute inexistence résulterait<br />
de leur décomposition. Existence et inexistence ne seraient nullement<br />
des états stables, définitifs et inaltérables, mais de simples<br />
éventualités qui passeraient sans cesse d’un état de latence à un<br />
état de réalisation, et vice-versa 2 . Il va sans dire que chacun des<br />
quatre éléments (dont le système est d’ailleurs fortement hiérarchisé,<br />
puisque le feu, par exemple, est considéré comme étant<br />
supérieur aux trois autres éléments qui, par conséquent, présentent<br />
des caractères communs, malgré les différences essentielles<br />
qui les séparent) ne s’unit aux autres que selon une faible partie<br />
de sa totalité, et qu’en définitive il demeure fondamentalement<br />
pur et homogène. Cette constatation entraîne deux conséquences:<br />
d’une part, le modèle de mélange préconisé par Empédocle<br />
n’est vraisemblablement pas étranger au modèle de base du processus<br />
d’incorporation tel qu’il est défini par les Atomistes;<br />
d’autre part, le modèle de pureté élémentaire appliqué à la<br />
2 ␣ Cf. E. <strong>Moutsopoulos</strong>, “Kairos et alternance: d’Empédocle à Platon”, in Id.,<br />
Philosophie de la culture grecque, Académie d’Athènes, Athènes 1998, pp. 49-56.
Le modèle empédocléen de pureté élémentaire<br />
131<br />
masse résiduelle de chaque élément est un modèle d’inspiration<br />
pour ainsi dire essentialiste.<br />
Ces deux constatations demeurent également valables du<br />
point de vue de la dynamique de la cosmologie empédocléenne,<br />
notamment du point de vue de la dialectique qui engendre l’alternance<br />
non point des états de mélange et de séparation, mais<br />
bien des principes de philotès et de neikos, dialectique applicable<br />
au niveau de la transcendance, et capable d’assurer, de par l’alternance<br />
de leur prédominance, une sorte d’équilibre de l’univers<br />
dans sa propre rotation. Philotès et neikos ne sont nullement<br />
des principes absolus quant à leurs natures et à leurs fonctions,<br />
respectives; ils agissent tous les deux, à la fois et alternativement,<br />
comme principes d’union plus que de désunion, et inversement.<br />
C’est ce double rôle qui assure l’existence de l’unité dans la diversité<br />
(comme, par exemple, dans le cas du corps vivant dont<br />
les parties sont à la fois semblables et dissemblables les unes par<br />
rapport aux autres), chacun continuant d’exercer sa fonction<br />
principale, bien que de façon atténuée, tout au long de la période<br />
de prédominance de l’autre.<br />
On retrouvera cette dialectique, au niveau du rapprochement<br />
des principes contraires, dans la théorie platonicienne exposée<br />
dans le Sophiste, où l’être et le non être, jugés auparavant irréductibles<br />
par Parménide, tendent à se réconcilier moyennant le<br />
développement de valeurs ontologiques intermédiaires, tel l’être<br />
non étant et le non être étant. On la retrouvera également au<br />
niveau du rapprochement des états contraires, dans la doctrine<br />
anaxagoréenne des homœoméries, aux termes de laquelle au désordre<br />
initial, après l’apparition du Noûs, principe décidément<br />
transcendant, succède un ordre où rien cependant ne s’unit totalement<br />
à ce qui lui est semblable, et où les parties homogènes<br />
coexistent et se côtoient sans fusionner pour autant, mais en formant<br />
des ensembles.<br />
L’existence d’un modèle de pureté élémentaire dans l’univers<br />
empédocléen suppose que la masse de chaque élément, qui ne<br />
se prête pas au processus de mélange, demeure imperturbable,<br />
et que, par contre, elle exerce une sorte d’attraction sur les particules<br />
de même nature qu’elle, en voie de se libérer du mélange<br />
qu’elles constituaient avec celles des autres éléments. Une fois<br />
dégagées, ces particules rejoignent précisément la totalité élé-
132<br />
Evanghélos A. <strong>Moutsopoulos</strong><br />
mentaire à laquelle elles n’ont cessé d’appartenir, du fait que<br />
leur mélange n’était que temporaire. Il en est, toute proportion<br />
gardée, de même dans l’univers anaxagoréen. Le modèle de<br />
pureté y est, en quelque sorte, à l’état latent, et c’est par l’action<br />
du Noûs qu’il se trouve être actualisé.<br />
Ce n’est donc qu’au niveau de la qualité que cette actualisation<br />
se différencie: chez Anaxagore elle est absolument kairique,<br />
puisqu’elle est unique, et n’intervient qu’à un moment extrêmement<br />
opportun; en revanche, chez Empédocle elle ne l’est que<br />
relativement; elle est périodique, puisqu’elle se manifeste dans<br />
le cadre du mouvement dialectique qui qualifie le rapport entre<br />
deux principes opposés. Le modèle de pureté élémentaire<br />
opère, à l’intérieur de ce schéma, comme un modèle catalytique.<br />
La nature de chaque élément est bien plus pure que celle de<br />
chacun des principes à l’action desquels elle obéit, ceux-ci étant<br />
opposés, mais nullement incompatibles. Toutefois, le modèle de<br />
pureté élémentaire, qui exprime cette nature, sert de facteur<br />
d’orientation lors de la dissolution d’un mélange.<br />
Ces constatations permettent de conclure que la structure statique<br />
de l’univers empédocléen se présente sous le signe de<br />
l’identité fondamentale, rigoureusement permanente, de chacune<br />
de ses composantes, alors que sa structure dynamique atteste<br />
une fonctionnalité dialectique, non seulement au niveau<br />
des rapports entre principes ou forces agissantes, mais aussi au<br />
niveau de l’action de ces dernières sur les composantes en question,<br />
et que la pureté de celles-ci agit, à son tour, d’une part<br />
comme entrave à leur union complète; d’autre part, comme soutien<br />
dans le processus de leur désagrégation: fonctions qui élèvent<br />
le modèle en cause lui même au rang de force agissante.