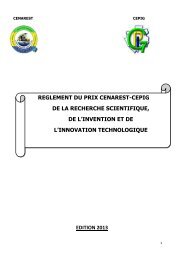- Page 1 and 2: THÈSE pour l’obtention du grade
- Page 3 and 4: AVANT PROPOS Plusieurs personnes se
- Page 5 and 6: vont également à l’endroit des
- Page 7 and 8: TRANSCRIPTION PHONETIQUE. e : eu br
- Page 9 and 10: LISTE DES FIGURES Figure 1 : Courbe
- Page 11 and 12: Photo 3 : Vue de la station de rech
- Page 13 and 14: Introduction Section I - Constats r
- Page 15 and 16: L’homme a depuis longtemps observ
- Page 17 and 18: En d’autres termes, nous affirmon
- Page 19 and 20: PREMIÈRE PARTIE Le Gabon, Pays exc
- Page 21 and 22: - de 1967 à nos jours, Albert Bern
- Page 23 and 24: Carte 1 : Localisation du Gabon en
- Page 25 and 26: I.1.5.1. Une diversité ethnique et
- Page 27 and 28: I.1.5.3. Population étrangère Dep
- Page 29 and 30: I.2.2. Les ressources forestières
- Page 31: d'importance décroissante : la ban
- Page 35 and 36: ne prend en compte que les revenus
- Page 37 and 38: Les parcs nationaux gabonais sont g
- Page 39 and 40: populations de grands Primates (Gor
- Page 41 and 42: III.3. L’enjeu social L’enjeu s
- Page 43 and 44: de 53.000.000 US$, qui seraient att
- Page 45 and 46: Chapitre II : Présentation du site
- Page 47 and 48: I.2. La forêt du nord-est du Gabon
- Page 49 and 50: I.3. La faune de la région de Mako
- Page 51 and 52: Carte 6 : Esquisse d’actualisatio
- Page 53 and 54: la ville de Mékambo dans le dépar
- Page 55 and 56: Makokou des revenus assez conséque
- Page 57 and 58: Pour le poisson pêché dans des vi
- Page 59 and 60: intégralement protégée, l’auto
- Page 61 and 62: III.4.6. L’exploitation forestiè
- Page 63 and 64: Photo 1 : Case pygmée Ba’Aka à
- Page 65 and 66: thèse. Parallèlement, cette anné
- Page 67 and 68: Photo 3 : Vue de la station de rech
- Page 69 and 70: Les retombées d’une réhabilitat
- Page 71 and 72: plantations aux alentours d’Ipass
- Page 73 and 74: Autrement dit que faire pour que la
- Page 75 and 76: Chapitre III : Le modèle et les m
- Page 77 and 78: La dentition a été déterminée p
- Page 79 and 80: sauf s’il s’agit de juvéniles
- Page 81 and 82: Les Potamochères sont très friand
- Page 83 and 84:
Figure 4 : Répartition des mises b
- Page 85 and 86:
Section III - Le choix de l’espè
- Page 87 and 88:
socioéconomique indéniable pour l
- Page 89 and 90:
Déroulement de l’enquête Certai
- Page 91 and 92:
étalages en béton et/ou sur des t
- Page 93 and 94:
Déroulement de l’enquête L’ac
- Page 95 and 96:
VI.1.1.3. L’enquête de consommat
- Page 97 and 98:
Dans la mesure du possible, le ques
- Page 99 and 100:
VI.1.3. Traitement et analyse des d
- Page 101 and 102:
Chapitre IV : État des connaissanc
- Page 103 and 104:
Depuis une quinzaine d’années en
- Page 105 and 106:
21 Bahuchet et al. 2000 De la forê
- Page 107 and 108:
La recherche scientifique va par la
- Page 109 and 110:
quelques siècles auparavant. Ainsi
- Page 111 and 112:
nouvelles dispositions et recommand
- Page 113 and 114:
prend guère en compte la dimension
- Page 115 and 116:
- La chasse constitue un important
- Page 117 and 118:
sont toutes aussi discutables que l
- Page 119 and 120:
Sur le plan méthodologique, nous r
- Page 121 and 122:
Section V - La filière viande de b
- Page 123 and 124:
Un des principaux résultats de ces
- Page 125 and 126:
devraient être prises afin de rég
- Page 127 and 128:
effectuer. Le volume de gibier cons
- Page 129 and 130:
l’enquêteur du WCS, un Gabonais
- Page 131 and 132:
VI.3.2. La chasse et l’exploitati
- Page 133 and 134:
Section VII - Le Groupe de travail
- Page 135 and 136:
Déclaration de Brazzaville 38 , et
- Page 137 and 138:
• Pour ce qui est du dialogue pol
- Page 139 and 140:
interactive, les phénomènes biolo
- Page 141 and 142:
- Congo : Aménagement de la Congol
- Page 143 and 144:
Pour atteindre ce résultat, la str
- Page 145 and 146:
arboricoles 46 , chasse au Gorille
- Page 147 and 148:
pas au premier abord comme la total
- Page 149 and 150:
aurifères, la chasse en Guyane dev
- Page 151 and 152:
- L’influence du relief sur la de
- Page 153 and 154:
les marchés urbains, privant ainsi
- Page 155 and 156:
DEUXIÈME PARTIE Caractérisation d
- Page 157 and 158:
loi sur le terrain. Mais dans tous
- Page 159 and 160:
par définition des chasseurs-cueil
- Page 161 and 162:
essentiellement des chasseurs d’
- Page 163 and 164:
(tendance à toujours se vautrer da
- Page 165 and 166:
intimidations, mais cette ethnie se
- Page 167 and 168:
IV.2. Moyens de transport utilisés
- Page 169 and 170:
passants qu’en tant que consommat
- Page 171 and 172:
l’avantage de contenir plusieurs
- Page 173 and 174:
V.4. La Chasse du Potamochère au f
- Page 175 and 176:
disparaissent assez rapidement, ell
- Page 177 and 178:
Photo 11 : Bauge fraîchement fréq
- Page 179 and 180:
se presse alors de faire un trou da
- Page 181 and 182:
V.7. Optimisation de la chasse au P
- Page 183 and 184:
des familles, sont les plus consomm
- Page 185 and 186:
Figure 5 : Importance relative moye
- Page 187 and 188:
la famille des Papilionacées en t
- Page 189 and 190:
La majorité des fruits, feuilles,
- Page 191 and 192:
C’est 25% des chasseurs questionn
- Page 193 and 194:
dans notre échantillon 8% des chas
- Page 195 and 196:
V.9.1. Les différents types de pi
- Page 197 and 198:
l’utilisation de fétiches ce qui
- Page 199 and 200:
En marge de la classification préc
- Page 201 and 202:
Tableau 15 : Liste des espèces ani
- Page 203 and 204:
Les chasseurs Kota sont formels sur
- Page 205 and 206:
C’est une partie du gibier géné
- Page 207 and 208:
Tableau 18: Chaque partie animale a
- Page 209 and 210:
F : Aboum Kt : To Kw : Bet Photo 19
- Page 211 and 212:
Tableau 19 : Les prix moyens fixés
- Page 213 and 214:
cette thèse, lors de la cérémoni
- Page 215 and 216:
Photo 21 : Plantation de manioc rav
- Page 217 and 218:
munis d’un certificat d’origine
- Page 219 and 220:
ceux qui la contrôlent le plus. No
- Page 221 and 222:
En moyenne 8 commerçantes de viand
- Page 223 and 224:
En effet, ces deux activités (comm
- Page 225 and 226:
Section III - Le commerce du gibier
- Page 227 and 228:
(1.000 FCFA la course sur Makokou)
- Page 229 and 230:
vendus par groupe taxonomique et l
- Page 231 and 232:
Ordre Famille Poids moyen Nom scien
- Page 233 and 234:
Le gibier est présent sur le march
- Page 235 and 236:
Figure 17 : Courbes de distribution
- Page 237 and 238:
- Le groupe des Rongeurs : Il est r
- Page 239 and 240:
commerçantes seront plus chers, le
- Page 241 and 242:
III.6. Provenance du gibier Il exis
- Page 243 and 244:
- L’axe de provenance Makokou-hau
- Page 245 and 246:
Figure 19: Esquisse de trafic de gi
- Page 247 and 248:
Tableau 25 : Evaluation des sommes
- Page 249 and 250:
Tableau 27 : Comparaison des prix d
- Page 251 and 252:
au tas (1000 FCFA /tas contre 550 F
- Page 253 and 254:
moyens confondues), le Chevrotain a
- Page 255 and 256:
Par ailleurs, la vente en paquet es
- Page 257 and 258:
Chapitre VII : La consommation du g
- Page 259 and 260:
Dans l’hypothèse que les croyanc
- Page 261 and 262:
le plus souvent fumé pour une meil
- Page 263 and 264:
consommateurs. Elles seront donc pl
- Page 265 and 266:
jaune, il serait le moins appréci
- Page 267 and 268:
seules quelques personnes du foyer
- Page 269 and 270:
Section II - Quelques spécificité
- Page 271 and 272:
quelle. En d’autres termes, il es
- Page 273 and 274:
qu’il ne faut plus ramasser les a
- Page 275 and 276:
d’être également très renferm
- Page 277 and 278:
Tableau 31: Récapitulatif des inte
- Page 279 and 280:
nous (les Ogivins 75 ) qui sommes r
- Page 281 and 282:
Potamochères en forêt n’est pas
- Page 283 and 284:
Photo J. Okouyi Figure 34: Pitchou
- Page 285 and 286:
Section II - Définitions, et bref
- Page 287 and 288:
produits de la forêt étaient comb
- Page 289 and 290:
le ronflement du cochon. Les hommes
- Page 291 and 292:
IV.4. Le Mikan ou la danse de la Pi
- Page 293 and 294:
spécifiquement adaptés à chaque
- Page 295 and 296:
En général, ce dernier est un ini
- Page 297 and 298:
La plume rouge du Perroquet gris du
- Page 299 and 300:
Tableau 32 : Liste non exhaustive d
- Page 301 and 302:
- Les Vipères cornues du Gabon (Bi
- Page 303 and 304:
Céphalophes sont généralement d
- Page 305 and 306:
Le prix de l’ivoire est en hausse
- Page 307 and 308:
féticheurs. Il s’agit de la Pant
- Page 309 and 310:
- L’Eléphant (Zokou en Kota et N
- Page 311 and 312:
Photo 39 : Hocheur en captivité au
- Page 313 and 314:
Les Singes ne sont pas les seuls an
- Page 315 and 316:
Tableau 34 : Exemples de contes (ti
- Page 317 and 318:
Chapitre IX : Les atouts potentiels
- Page 319 and 320:
qui plus est, travaillant pour la p
- Page 321 and 322:
voisinage d’une localité, elle f
- Page 323 and 324:
européens restent encore des conce
- Page 325 and 326:
esponsables de sa raréfaction. Par
- Page 327 and 328:
monde, cela suffit » aurait dit le
- Page 329 and 330:
un déséquilibre social qui facili
- Page 331 and 332:
tout pour que cela soit ainsi. Ce q
- Page 333 and 334:
Carte 11 : Localisation des campeme
- Page 335 and 336:
centrale, la zone tampon et l'aire
- Page 337 and 338:
Esquisse de zonage du Parc de l Ivi
- Page 339 and 340:
gibiers choisis et les chasseurs ad
- Page 341 and 342:
Cette sélectivité spécifique (pi
- Page 343 and 344:
I.2.3. Le partage du gibier Tous le
- Page 345 and 346:
Quant à la cueillette, elle est pr
- Page 347 and 348:
II.1. Le "pouvoir" des femmes où l
- Page 349 and 350:
Makokou sont des actrices de la fil
- Page 351 and 352:
Céphalophe bleu (26,33%), le Céph
- Page 353 and 354:
Tableau 29 : Comparaison des prix a
- Page 355 and 356:
Le gibier est vendu toute l’anné
- Page 357 and 358:
donne plusieurs possibilités de tr
- Page 359 and 360:
vis du caractère « chimique/artif
- Page 361 and 362:
L’expérience du projet DABAC sur
- Page 363 and 364:
font partie des gibiers les plus co
- Page 365 and 366:
Inséparable à tête rouge, Agapor
- Page 367 and 368:
Chapitre XI : La loi 1/82 déguisé
- Page 369 and 370:
l’est moins dans le nouveau code.
- Page 371 and 372:
décret n° 677/PR/MEFE du 28 Juill
- Page 373 and 374:
L’article 259 stipule que l’exe
- Page 375 and 376:
Il est également possible de favor
- Page 377 and 378:
qui se l’approprie. Ils font l’
- Page 379 and 380:
l’étude de la chasse), soit en f
- Page 381 and 382:
Chapitre XII : Le caractère nature
- Page 383 and 384:
(1987) cité par Takforyan (Takfory
- Page 385 and 386:
cynégétique. Les allochtones appa
- Page 387 and 388:
ésigne à croire qu’il est maudi
- Page 389 and 390:
Par ailleurs, le Potamochère comme
- Page 391 and 392:
suspens. Ce projet de recherche a
- Page 393 and 394:
ALVARD (M.S), 1993 - Testing the «
- Page 395 and 396:
CITES BWG, 2002 - Rapport d’activ
- Page 397 and 398:
GRENAND (P.), 1996 - « Des fruits,
- Page 399 and 400:
LAMBLARD (J. M. ), 2003 - L’oisea
- Page 401 and 402:
VIANO (M.), 2005 - Caractérisation
- Page 403 and 404:
VI.1.3. Traitement et analyse des d
- Page 405 and 406:
VI.2. Les différents interdits....