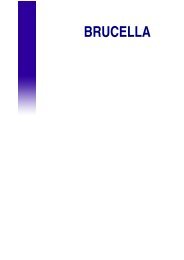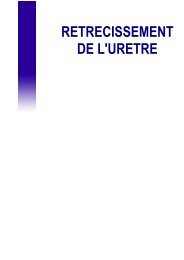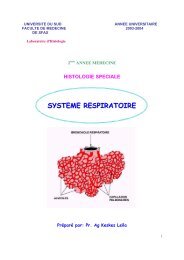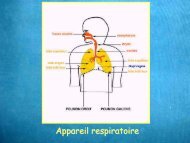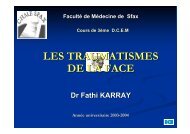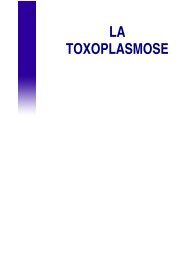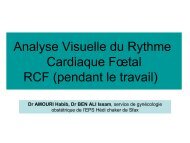LES TUMEURS DE LA VESSIE
LES TUMEURS DE LA VESSIE
LES TUMEURS DE LA VESSIE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>LES</strong> <strong>TUMEURS</strong> <strong>DE</strong><br />
<strong>LA</strong> <strong>VESSIE</strong>
Table des matières<br />
Table des matières 3<br />
I - Épidémiologie 9<br />
A. Fréquence........................................................................................9<br />
B. Facteurs de risque.............................................................................9<br />
1. Le tabac............................................................................................. 9<br />
2. L'exposition professionnelle.................................................................10<br />
3. Bilharziose urinaire, infection et irritation chroniques vésicales.................10<br />
4. Autres facteurs..................................................................................10<br />
II - Anatomo-Pathologie 11<br />
A. Macroscopie (sur les données de la cystoscopie)................................. 11<br />
B. Microscopie (étude histologique)....................................................... 11<br />
1. Types histologiques............................................................................11<br />
2. Grade histologique............................................................................. 12<br />
3. Stade............................................................................................... 12<br />
III - Diagnostic 13<br />
A. Signes cliniques..............................................................................13<br />
1. Signes directs....................................................................................13<br />
2. Signes indirects................................................................................. 13<br />
B. Examen clinique..............................................................................14<br />
IV - Bilan morphologique 15<br />
A. Échographie abdomino-pelvienne......................................................15<br />
B. Urographie intraveineuse (UIV).........................................................16<br />
C. Cytologie urinaire............................................................................16<br />
D. Endoscopie vésicale (cystoscopie).....................................................16<br />
V - Histoire naturelle d'une TV 19<br />
A. Les TV superficielles (TVS)............................................................... 19<br />
B. Les TV infiltrantes (TVI)...................................................................19<br />
VI - Facteurs pronostiques 21<br />
3
A. Facteurs cliniques............................................................................21<br />
B. Facteurs histopathologiques..............................................................21<br />
VII - Bilan d'extension 23<br />
A. Bilan locorégional............................................................................23<br />
B. Bilan général..................................................................................23<br />
VIII - Traitement 25<br />
A. Moyens..........................................................................................25<br />
1. Résection trans-urétrale de vessie (RTUV).............................................25<br />
2. Instillations endovésicales...................................................................26<br />
3. Chirurgie.......................................................................................... 26<br />
4. Radiothérapie....................................................................................27<br />
5. Chimiothérapie générale..................................................................... 27<br />
6. association radio-chimiothérapie.......................................................... 27<br />
B. Indications opératoires.....................................................................27<br />
C. Résultats........................................................................................28<br />
IX - QCM 29<br />
4
Objectifs<br />
1. Décrire les particularités épidémiologiques et les facteurs de risque des tumeurs<br />
vésicales.<br />
2. Décrire les particularités anatomopathologiques et le mode d'extension des tumeurs<br />
vésicales.<br />
3. Suspecter, devant des éléments cliniques, une tumeur vésicale.<br />
4. Confirmer, par des examens para-cliniques, le diagnostic de tumeur vésicale.<br />
5. Apprécier, sur des examens cliniques et para-cliniques, le degré d'extension locorégionale<br />
et générale d'une tumeur vésicale.<br />
6. Organiser la prise en charge thérapeutique d'une tumeur vésicale en fonction de son<br />
extension.<br />
7. Evaluer sur des éléments cliniques et para-cliniques, le pronostic des tumeurs<br />
vésicales après traitement approprié.<br />
8. Organiser la surveillance d'un malade traité pour tumeur vésicale en fonction du type<br />
de traitement conservateur ou radical.<br />
5
Introduction<br />
La tumeur de vessie (TV) est la tumeur la plus fréquente des voies excrétrices<br />
urinaires.<br />
Le terme de tumeurs de vessie regroupe un spectre de tumeurs ayant un potentiel<br />
d'agressivité extrêmement variable, d'où leur répartition en : TV superficielles (TVS)<br />
et TV infiltrantes (TVI).<br />
Le problème des TVS est d'apprécier leur potentiel agressif, c'est-à-dire leur risque<br />
de progression en stade et/ou en grade, afin d'adapter le traitement qui est souvent<br />
conservateur.<br />
Dans près de 70% des cas, les TV infiltrantes sont initialement des tumeurs<br />
superficielles qui ont évoluer vers l'infiltration. Leur meilleur traitement est la<br />
cystectomie totale.<br />
7
I - Épidémiologie<br />
A. Fréquence<br />
Fréquence 9<br />
Facteurs de risque 9<br />
Dans le monde :<br />
- Les TV représentent 3% de l'ensemble des cancers.<br />
- Elle occupe la 4ème position (après les cancers broncho-pulmonaires, du<br />
côlon, et de la prostate).<br />
- Age de survenue : à partir de 50 ans avec un maximum entre 60 et 70<br />
ans.<br />
- Prédominance masculine nette : Sex ratio 3/1 (entrain de diminuer ces<br />
dernières années / tabagisme plus important chez la femme, autres<br />
facteurs de risques...).<br />
En Tunisie : Sex ratio 7/1<br />
- Chez l'homme : c'est le 2ème cancer (11% de l'ensemble des cancers<br />
masculins) et le 1er cancer urologique, avec une incidence de<br />
10/100.000.<br />
- Chez la femme : c'est le 8ème cancer (2% de l'ensemble des cancers),<br />
avec une incidence de1,2 / 100.000.<br />
B. Facteurs de risque<br />
1. Le tabac<br />
C'est le carcinogène le plus important contribuant au développement des<br />
tumeurs urothéliales. Risque relatif multiplié par 4.<br />
Le risque de cancer de la vessie est élevé chez les fumeurs, car les<br />
substances toxiques du tabac (amines aromatiques, nitrosamines et<br />
hydrocarbures polycycliques), inhalées par les poumons, même<br />
passivement, sont éliminées par les reins et la vessie.<br />
Un effet dose a été mis en évidence dans plusieurs études. Environ 60% des<br />
patients qui ont un cancer de la vessie sont des fumeurs actifs ou des<br />
anciens fumeurs.<br />
I<br />
9
Épidémiologie<br />
10<br />
2. L'exposition professionnelle<br />
25% des tumeurs de vessie sont en relation avec des expositions<br />
professionnelles.<br />
Certaines substances carcinogènes utilisées dans l'industrie chimique<br />
sont incriminées, tels les amines aromatiques (dérivés de l'aniline) et des<br />
dérivés des hydrocarbures (benzidine) utilisées dans l'industrie de la<br />
teinture, du caoutchouc, de la métallurgie et ceux nécessitant l'usage de<br />
goudrons.<br />
Il s'agit d'une maladie professionnelle nécessitant une surveillance<br />
biannuelle des salariés exposés par une cytologie urinaire.<br />
3. Bilharziose urinaire, infection et irritation chroniques<br />
vésicales<br />
La bilharziose urinaire prédispose au cancer de vessie de type épidermoïde.<br />
Alors que ce type histologique ne représente que 3 à 7 % des cancers<br />
infiltrants de vessie dans le monde, il est retrouvé dans 70 % des cas de<br />
tumeurs de vessie en Egypte, où la prévalence de la bilharziose est de 45%.<br />
L'infection et l'irritation chronique vésicales (lithiase vésicale, sonde vésicale<br />
à demeure et cystite à répétition chez la femme) sont retenues comme<br />
facteurs favorisant le développement de tumeurs vésicales épidermoïdes.<br />
4. Autres facteurs<br />
Certains facteurs semblent augmenter le risque de cancer de vessie sans que leur<br />
rôle soit formellement prouvé, à savoir :<br />
L'irradiation pelvienne à forte dose.<br />
Virus oncogènes<br />
Les édulcorants (saccharine et cyclamate) et la consommation de café.
II - Anatomo-<br />
Pathologie<br />
II<br />
Macroscopie (sur les données de la cystoscopie) 11<br />
Microscopie (étude histologique) 11<br />
A. Macroscopie (sur les données de la cystoscopie)<br />
C'est la cystoscopie qui fournira la meilleure description macroscopique des<br />
lésions endovésicales. L'aspect, le nombre, la taille et la localisation des lésions<br />
peuvent être synthétisés sur un schéma pour réaliser une cartographie vésicale.<br />
On distingue trois aspects macroscopiques différents :<br />
Tumeurs papillaires de développement exophytique (dans la cavité<br />
vésicale) : peuvent être :<br />
- pédiculées.<br />
- sessiles (dépourvues de pédicule mais conservant une structure<br />
papillaire).<br />
- papillomatose vésicale diffuse (prolifération papillaire extensive<br />
intéressant la quasi totalité de la muqueuse vésicale).<br />
Tumeurs non papillaires ou solides (sans aucune structure papillaire) :<br />
ces tumeurs peuvent être bourgeonnantes et ulcérées mais le plus souvent à<br />
développement endophytique à l'intérieur de la paroi vésicale.<br />
Tumeurs planes : lésions tumorales intéressant la couche superficielle de<br />
la muqueuse vésicale (cis: carcinome in situ).<br />
B. Microscopie (étude histologique)<br />
1. Types histologiques<br />
a) Tumeurs épithéliales +++ :<br />
Les tumeurs épithéliales représentent la quasi-totalité des tumeurs vésicales (plus<br />
de 90%).<br />
Carcinome à cellules transitionnelles de la vessie (CCT) +++ : encore<br />
appelé carcinome urothélial ou carcinome para-malpighien : 75 à 90% des<br />
TV épithéliales. Ils se caractérisent par leur différenciation cellulaire (le<br />
grade histologique) et leur pénétration dans la paroi vésicale (stade).<br />
Plus rarement : Carcinome épidermoïde (5%), Adénocarcinome (1%),<br />
11
Anatomo-Pathologie<br />
12<br />
Caricno-sarcomes.<br />
b) Tumeurs non épithéliales : (rares)<br />
Tumeurs conjonctives bénignes.<br />
Tumeurs malignes : sarcomes, lymphomes.<br />
c) Tumeurs secondaires (rectum, ovaire, prostate...).<br />
2. Grade histologique<br />
Une classification regroupe les carcinomes urothéliaux en 3 grades selon la<br />
différenciation cellulaire, de gravité croissante.<br />
G0 : cellules normales.<br />
G 1 : très bien différenciées.<br />
G 2 : modérément différenciées.<br />
G 3 : peu ou pas différenciées.<br />
3. Stade<br />
Il correspond à la profondeur de la présentation dans la paroi vésicale.<br />
On isole essentiellement 2 grands groupes de TV selon le degré d'infiltration de la<br />
paroi vésicale :<br />
TV superficielles (atteinte uniquement de la muqueuse vésicale).<br />
et TV infiltrantes (franchissement membrane basale et infiltration de<br />
musculeuse).<br />
Image 1 : Figure 1 : Classification TNM des TV<br />
Cas particulier du carcinome in situ (CIS) :<br />
Il s'agit d'une lésion de haut grade, développée en muqueuse plane, ne<br />
comportant aucune structure végétante ni d'effraction de la membrane<br />
basale, pouvant apparaître, macroscopiquement, comme une lésion<br />
érythémateuse, plus ou moins disséminée dans la vessie. Dans 90 % des<br />
cas, le CIS accompagne une tumeur primitive (il est primitif dans seulement<br />
10 % des cas). Il se distingue des autres tumeurs superficielles par son<br />
caractère volontiers considéré comme péjoratif.
III - Diagnostic<br />
A. Signes cliniques<br />
1. Signes directs<br />
III<br />
Signes cliniques 13<br />
Examen clinique 14<br />
Hématurie +++ : Elle constitue le signe clinique le plus fréquent. Elle est<br />
présente chez près de 85% des patients. Elle est typiquement<br />
macroscopique, isolée, terminale ou à renforcement terminal et indolore.<br />
Elle oriente d'emblée vers une origine vésicale. Toute hématurie doit<br />
suspecter en premier une tumeur de vessie. Une hématurie microscopique<br />
n'est pas caractéristique de tumeur de vessie, mais elle peut la révéler<br />
surtout lorsqu'il existe des facteurs de risque tel que le tabac. Son<br />
importance est indépendante du stade tumoral et du grade cellulaire.<br />
Signes d'irritation vésicale : brûlures mictionnelles, pollakiurie, mictions<br />
impérieuses. Ils sont observés dans 20% des cas. En l'absence d'infection<br />
urinaire concomitante ou de lithiase vésicale ou de tumeur vésicale évidente,<br />
la persistance de symptômes irritatifs avec ou sans hématurie doit faire<br />
suspecter l'existence d'un CIS vésical.<br />
Cystite : une infection urinaire basse chez l'homme doit faire<br />
systématiquement rechercher une TV (cystite néoplasique), même avec un<br />
ECBU positif.<br />
2. Signes indirects<br />
dus à un envahissement locorégional ou métastatique. Il peut s'agir de :<br />
Signes d'obstacle urétéral (lombalgies, anurie).<br />
Rétention aiguë d'urine sur caillots sanguins.<br />
Signes de compression pelvienne (œdème des membres inférieurs,<br />
phlébite).<br />
13
Diagnostic<br />
B. Examen clinique<br />
14<br />
Il est le plus souvent normal pour une TV superficielle. En effet, il est rare que la<br />
tumeur soit aussi volumineuse qu'elle soit palpable par une palpation appuyée de<br />
l'hypogastre chez un patient maigre.<br />
Les touchers pelviens (toucher rectal chez l'homme et toucher vaginal chez la<br />
femme), sont systématiques. Ils recherchent une infiltration du plancher pelvien<br />
surtout lorsque la tumeur est de siège trigonal avec un envahissement locorégional<br />
important.<br />
Le reste de l'examen recherchera un globe vésical (sur caillots sanguins), un<br />
contact lombaire (hydronéphrose obstructive), ou des signes de métastases (nodule<br />
hépatique, ganglion, œdème des membres inférieurs).
IV - Bilan<br />
morphologique<br />
A. Échographie abdomino-pelvienne<br />
IV<br />
Échographie abdomino-pelvienne 15<br />
Urographie intraveineuse (UIV) 16<br />
Cytologie urinaire 16<br />
Endoscopie vésicale (cystoscopie) 16<br />
Examen anodin, réalisé par voie suspubienne et à vessie pleine. Elle peut montrer<br />
des végétations endo-luminales dont elle précise le siège, la taille, et le nombre.<br />
Elle précise également le degré de retentissement sur le haut appareil urinaire.<br />
Le diagnostic différentiel peut se poser avec les caillots sanguins. Une échographie<br />
négative ne permet pas d'éviter la cystoscopie lorsqu'une tumeur de vessie st<br />
suspectée<br />
Image 2 : Figure 2 : Echographie vésicale : lésion bourgeonnante pariétale<br />
15
Bilan morphologique<br />
B. Urographie intraveineuse (UIV)<br />
L'UIV montre la tumeur sous forme de lacune vésicale (image typique) au niveau<br />
d'une partie de la vessie. Elle peut montrer d'autres signes indirects en faveur<br />
d'une infiltration de la musculeuse vésicale / une amputation d'une corne vésicale,<br />
une rigidité pariétale, ou une obstruction urétérale avec une dilatation unilatérale<br />
du haut appareil urinaire.<br />
Mais, cet examen a une sensibilité faible puisqu'une petite TV est parfois invisible.<br />
Elle reste cependant l'examen de référence pour la détection d'une tumeur du haut<br />
appareil au cours de l'évolution des tumeurs de vessie.<br />
C. Cytologie urinaire<br />
La cytologie urinaire est un outil simple, rapide et peu coûteux qui permet de<br />
détecter la présence de cellules tumorales de haut grade dans les urines avec<br />
une très grande sensibilité. Cet examen est devenu de routine dans le suivi des<br />
tumeurs de vessie traitées.<br />
D. Endoscopie vésicale (cystoscopie)<br />
16<br />
Image 3 : Figure 3 : UIV : Lacunes intravésicales<br />
La cystoscopie est l'examen de référence qui permet le diagnostic<br />
macroscopique et de réaliser des biopsies de la tumeur et des zones suspectes.<br />
L'endoscopie diagnostique précise les caractères de la tumeur : siège, nombre<br />
(unique ou multiple), taille, aspect macroscopique, et type d'implantation. Elle<br />
précise également l'état de la muqueuse avoisinante.<br />
Cette exploration constitue souvent le premier temps de la résection de la tumeur<br />
(RTUV : résection trans-urétrale de vessie).<br />
Une fois on a individualisé une tumeur vésicale, une résection complète et profonde<br />
de la tumeur doit être réalisée. Cette résection a plusieurs intérêts :
Intérêt diagnostique : elle apporte le matériel pour une preuve histologique.<br />
Intérêt thérapeutique : en cas de TSV, une résection complète et profonde<br />
(jusqu'au muscle) peut être suffisante pour le traitement initial.<br />
Stadification tumorale pour la conduite à tenir ultérieure (grade et stade de<br />
la tumeur).<br />
Image 4 : Figure 4 : Aspect endoscopique d'une TV<br />
Bilan morphologique<br />
17
V - Histoire naturelle<br />
d'une TV<br />
V<br />
Les TV superficielles (TVS) 19<br />
Les TV infiltrantes (TVI) 19<br />
La TV est une maladie de tout l'urothélium. Elle est caractérisée par sa multifocalité<br />
et sa grande tendance à récidiver sur l'ensemble de l'urothélium. D'où la nécessité<br />
d'une surveillance régulière et prolongée.<br />
A. Les TV superficielles (TVS)<br />
Les TVS posent 2 problèmes majeurs : le risque de récidive et le risque de<br />
progression.<br />
Récidive : récurrence sur un même mode (même grade et même stade) :<br />
50% des tumeurs Ta-T1.<br />
Progression : récurrence en un stade ou un grade plus élevé (10% Ta, 30%<br />
T1).<br />
La fréquence de ces deux risques dépend surtout du grade et du stade de la TV<br />
initiale. Ainsi, les TVS sont réparties en trois sous groupes en fonction de ces<br />
risques évolutifs.<br />
Remarque<br />
Classification des tumeurs superficielles de vessie en fonction du pronostic<br />
:<br />
Faible risque : tumeur Ta grade 1 unique de moins de 3 cm non récidivée.<br />
Risque intermédiaire : Ta grade 1-2 multifocale et/ou récidivante, T1 grade<br />
1-2.<br />
Haut risque : Ta grade 3, T1 récidivante, T1 grade 3, CIS.<br />
B. Les TV infiltrantes (TVI)<br />
Le risque de métastase et de décès est important, ce qui justifie un traitement<br />
locorégional radical.<br />
19
VI - Facteurs<br />
pronostiques<br />
A. Facteurs cliniques<br />
VI<br />
Facteurs cliniques 21<br />
Facteurs histopathologiques 21<br />
a) Les métastases ganglionnaires : elles influencent beaucoup la survie à<br />
5 ans qui varie de 0 à 20% en cas de métastase ganglionnaire régionale.<br />
b) Les caractéristiques de la tumeur : une tumeur multifocale ou<br />
volumineuse ou d'accès difficile à la résection est de plus mauvais pronostic<br />
qu'une tumeur unifocale, de petite taille et d'accès facile.<br />
c) La réponse aux instillations endovésicale de BCG : une récidive<br />
précoce (dans moins de 3 mois) après les instillations annonce une seconde<br />
récidive et une progression du stade dans plus de la moitié des cas.<br />
B. Facteurs histopathologiques<br />
a) Le type histologique : tous les carcinomes rares de la vessie<br />
(sarcomatoïdes, épidermoïdes, neuroendocrines...) ont un plus mauvais<br />
pronostic que les carcinomes urothéliaux à cellules transitionnelles.<br />
b) Le stade tumoral : les TVS sont de meilleur pronostic que les tumeurs<br />
infiltrantes. En effet, la survie à 5 ans est de 90% pour les T1, 80% pour les<br />
T2a, et moins de 20% pour les T3 et T4.<br />
c) La progression en stade : c'est un signe péjoratif. Elle est liée au<br />
caractère invasif de la tumeur et au grade histologique de la tumeur.<br />
d) Le grade : le haut grade est un signe de progression et de récidive.<br />
e) Lésions associées : la présence de CIS est un signe de mauvais<br />
pronostic puisque le risque de récidive et/ou de progression est amplifié.<br />
21
VII - Bilan d'extension<br />
VII<br />
Bilan locorégional<br />
23<br />
Bilan général<br />
23<br />
Il s'impose devant une TVI avant tout traitement curatif radical.<br />
A. Bilan locorégional<br />
Examen clinique : TR (recherche d'une infiltration du plancher vésical),<br />
examen des aires ganglionnaires, recherche d'un œdème des membres<br />
inférieurs... .<br />
TDM abdomino-pelvienne ++ : C'est l'examen recommandé pour le bilan<br />
d'extension des tumeurs infiltrantes. Elle détermine avec certaine netteté<br />
l'extension locale par l'infiltration à la graisse péri-vésicale et<br />
l'envahissement prostatique. La TDM peut visualiser une éventuelle<br />
extension aux vésicules séminales ou à la graisse péri-rectale. En matière<br />
d'adénopathie, cet examen ne peut détecter des ganglions métastatiques<br />
que si celles-ci mesurent plus de 1,5 cm.<br />
Curage ganglionnaire ilio-obturateur bilatéral : C'est le premier temps<br />
du traitement chirurgical radical (cystectomie) à réaliser systématiquement.<br />
Il précise avec certitude l'extension ganglionnaire locorégionale.<br />
B. Bilan général<br />
Il recherche des au niveau des ganglions, l'os, les poumons et le foie.<br />
Os : scintigraphie osseuse : indiquée en cas de symptômes évocateurs<br />
(douleurs osseuses), elle montre des images d'hyperfixation. En cas de<br />
doute, l'imagerie par résonance magnétique (IRM) centrée sur les<br />
régions suspectes est très utile. Enfin, si le doute persiste une biopsie<br />
osseuse de la région suspecte avec une analyse histologique permettra de<br />
confirmer le diagnostic.<br />
Foie : l'échographie abdominale montre la métastase hépatique sous<br />
forme d'une image en cocarde.<br />
Poumons : radiothorax, et en cas de doute un scanner thoracique.<br />
23
VIII - Traitement<br />
VIII<br />
Moyens 25<br />
Indications opératoires 27<br />
Résultats 28<br />
Le traitement dépend étroitement de la classification de la tumeur en superficielle<br />
(TVS) ou infiltrante (TVI). Dans tous les cas, la RTUV constitue le premier temps du<br />
traitement de toute tumeur de vessie.<br />
A. Moyens<br />
1. Résection trans-urétrale de vessie (RTUV)<br />
Acte diagnostique essentiel permettant de déterminer le stade et le grade<br />
tumoraux. Elle constitue également le premier acte thérapeutique.<br />
Elle s'effectue sous anesthésie générale ou locorégionale.<br />
La profondeur de la résection dépend des caractères macroscopiques de la ou des<br />
tumeurs :<br />
En cas de tumeur manifestement non invasive, une résection superficielle<br />
associée à une coagulation de la base d'implantation tumorale peut suffire.<br />
Dans les autres cas, il est nécessaire que l'anatomo-pathologiste dispose de<br />
fragments tumoraux profonds, musculaires avec base d'implantation<br />
tumorale.<br />
La résection tumorale peut être complétée par des biopsies de zone muqueuse<br />
suspecte (CIS) ou éventuellement par des biopsies systématiques en zone<br />
muqueuse optiquement saine.<br />
Les complications peropératoires sont rares : perforations de vessie et<br />
hémorragies.<br />
Les résultats de la résection sont d'autant meilleurs que la tumeur est superficielle<br />
et de bas grade : globalement, chez 80% des patients, la maladie est contrôlée par<br />
résection trans-urétrale seule (TVS à faible risque) ou associée à des instillations<br />
endovésicales (TVS à risque intermédiaire majeur de progression). Dans 20% des<br />
cas, un traitement chirurgical plus agressif deviendra nécessaire du fait de<br />
récidives.<br />
25
Traitement<br />
26<br />
2. Instillations endovésicales<br />
Les instillations endovésicales sont utilisées en prophylaxie après résection<br />
complète d'une TV superficielle pour diminuer les risques de récidive et de<br />
progression.<br />
Deux types principaux de produits sont utilisés :<br />
La chimiothérapie utilisant la l'amétycine (mitomycine C) : qui agit<br />
par effet local cytotoxique sur l'urothélium vésical. Elle est indiquée devant<br />
les TVS à risque intermédiaire. Le schéma habituel est de une instillation<br />
endovésicale de 40 mg de mitomycine C par semaine pendant 8 semaines.<br />
Ce traitement est bien toléré et comporte peu d'effets secondaires.<br />
L'immunothérapie par le bacille de Calmette et Guérin (BCG) : qui<br />
provoque une réaction immunitaire et inflammatoire locale et, par la suite,<br />
une cytotoxicité anti-tumorale. Elle est indiquée devant une TVS à haut<br />
risque et le CIS ++. Les instillations se font à raison d'une fois/semaine<br />
durant 6 semaines pour constituer un cycle de BCG thérapie d'attaque. Un<br />
traitement prolongé d'entretien peut être efficace.<br />
La BCGthérapie endovésicale n'est pas un traitement anodin. Elle comporte des<br />
effets secondaires de gravité variable :<br />
Mineurs très fréquents (fièvre < 48h, pollakiurie, brûlures mictionnelles)<br />
résolutifs sous traitement symptomatique ± antibiotique.<br />
Sévères (BCGite urogénitale) : épididymite, prostatite granulomateuse.<br />
Majeurs dus au passage systémique du BCG dans la circulation sanguine<br />
(BCGite généralisée avec défaillance multiviscérale gravissime), imposant<br />
l'arrêt du traitement.<br />
3. Chirurgie<br />
a. Cystectomie radicale<br />
C'est le traitement de référence des TV infiltrantes. Elle peut être proposée<br />
également aux tumeurs superficielles non contrôlées par le traitement conservateur<br />
(TVS multi-récidivantes, de papillomatose diffuse).<br />
Elle consiste à réaliser une cystectomie totale à ciel ouvert associée à un curage<br />
ganglionnaire ilio-obturateur premier dans un but de staging.<br />
Chez l'homme, la cystectomie emporte aussi la prostate et les vésicules<br />
séminales (cystoprostatectomie totale).<br />
Chez la femme, la cystectomie emporte, le plus souvent, l'utérus en totalité<br />
(pelvectomie antérieure).<br />
Certaines techniques permettent de préserver les bandelettes nerveuses latéroprostatiques<br />
permettant au patient d'espérer retrouver des érections satisfaisantes.<br />
Une urétrectomie complémentaire est indispensable si la recoupe urétrale se révèle<br />
positive à l'examen extemporané.<br />
b. Modes de dérivations urinaires<br />
Après cystectomie totale, il est possible de réaliser un remplacement vésical<br />
à partir du grêle ou du colon en créant un réservoir à basse pression. Une<br />
conservation sphinctérienne en aval de l'anastomose néovéssie-urètre,<br />
permet au patient d'être continent et d'uriner par les voies naturelles. Cette<br />
continence est assurée, dans plus de 90 % des cas la journée.<br />
Les autres méthodes :<br />
- Dérivations non continentes :
Urétérostomie cutanée directe.<br />
Urétérostomie cutanée trans-iléale (Bricker).<br />
- Dérivations continentes :<br />
urétéro-sigmoïdostomie (Coffey) :<br />
dérivation urinaire externe continente (Mitrofanoff).<br />
4. Radiothérapie<br />
Une radiothérapie externe seule peut être proposée, après résection endoscopique<br />
de la lésion, aux patients en mauvais état général pour lesquels une chirurgie<br />
lourde est contre-indiquée.<br />
5. Chimiothérapie générale<br />
De nombreux essais thérapeutiques sont actuellement réalisés afin de déterminer<br />
son efficacité et sa place exacte dans le traitement des tumeurs de vessie.<br />
Les protocoles les plus efficaces utilisent la Gemcitabine et le cisplatine.<br />
Cette chimiothérapie est indiquée en cas de tumeur infiltrante, en tant que<br />
traitement adjuvant (après cystectomie) en cas de dissémination extra-vésicale de<br />
la maladie.<br />
6. association radio-chimiothérapie<br />
L'association Radiothérapie (65 à 70 Gy en 7 semaines) et Chimiothérapie<br />
concomitante est une alternative à la chirurgie d'exérèse pour les patients<br />
inopérables ou en cas de choix du patient prévenu des résultats et inconvénients de<br />
la chirurgie. Elle peut-être proposée devant une lésion unifocale, de petite taille,<br />
limitée à la vessie (pT2), complètement réséquée.<br />
B. Indications opératoires<br />
L'attitude thérapeutique est à moduler en fonction du stade et du grade tumoraux,<br />
de l'âge et de l'état général du patient ainsi que de la symptomatologie présentée.<br />
En pratique, les tumeurs superficielles bénéficient généralement d'un traitement<br />
conservateur, et les tumeurs infiltrantes nécessitent un traitement radical.<br />
Schématiquement, on peut proposer :<br />
Traitement<br />
TVS à risque faible : RTUV + surveillance par cystoscopie à 3 mois, puis à<br />
6 mois, puis de manière annuelle. En cas de récidives, des instillations endovésicales<br />
par Mytomycine C ou BCG peuvent être envisagées.<br />
TVS à risque intermédiaire : RTUV + chimiothérapie intra-vésicale<br />
(Mitomycine C), suivi d'une surveillance étroite.<br />
TVS à risque majeur, CIS : RTUV + immunothérapie endovésicale (BCG),<br />
suivi d'une surveillance étroite et prolongée. En cas de récidives<br />
rapprochées, une cystectomie radicale peut s'imposer.<br />
Tumeurs infiltrantes de stade >= pT2 N0M0 : Cystectomie radicale ++.<br />
Selon l'âge du patient et les symptômes présentés, il n'existe pas de<br />
conduite à tenir absolue. On admet que pour les tumeurs infiltrantes du<br />
sujet âgé de plus de 75 ans, se discute une cystectomie ou une association<br />
27
Traitement<br />
C. Résultats<br />
28<br />
radio-chimiothérapie après résection complète. En cas de cystite néoplasique<br />
avec hématurie incontrôlable et rétention répétée par caillotage vésical, une<br />
cystectomie dite de confort doit être envisagée.<br />
Tumeurs infiltrantes N+ ou M+ : Chimiothérapie première puis<br />
cystectomie de rattrapage si réponse complète. Cystectomie puis<br />
chimiothérapie adjuvante pour N+.<br />
TVS (RTUV ± BCG) :<br />
- Plus la tumeur est superficielle et de bas grade plus les résultats sont<br />
meilleurs. La maladie est contrôlée dans 80% des cas.<br />
- Nécessité de chirurgie agressive (cystectomie) dans 20% des cas.<br />
TV infiltrantes :<br />
- Chirurgie : résultats dépendent du stade et du grade. Survie à 5 ans des<br />
cystectomies : T1 : 80%, T2 : 50%, T3 : 20%, T4 : 5% N+ : 0%<br />
- Radiothérapie : survie à 5 ans : 20 à 50% (TVI localisées).<br />
- Chimiothérapie : réponse courte (3 à 4 mois).
IX - QCM<br />
Exercice 1<br />
IX<br />
Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui présentent un facteur de<br />
risque de développement d'une tumeur de vessie ?<br />
Tabagisme passif prolongé.<br />
Des antécédents de bilharziose urinaire.<br />
Des antécédents de tuberculose urinaire.<br />
Une exposition professionnelle prolongée aux hydrocarbures<br />
Une exposition professionnelle prolongée au plomb.<br />
Exercice 2<br />
Le type histologique le plus fréquent de l'ensemble des tumeurs vésicales est :<br />
Adénocarcinome.<br />
Carcinome épidermoïde.<br />
Carcinome à cellules transitionnelles.<br />
Sarcome.<br />
Lymphome.<br />
Exercice 3<br />
Une tumeur vésicale qui envahit le muscle vésical profond (moitié externe)<br />
correspond, selon la classification TNM 1997, à un stade :<br />
pT1.<br />
pT2a<br />
pT2b<br />
pT3a<br />
pT3b.<br />
Exercice 4<br />
29
QCM<br />
30<br />
Quel est l'examen qui permet de confirmer une tumeur vésicale ?<br />
Echographie vésicale.<br />
Cytologie urinaire.<br />
Urographie intraveineuse.<br />
Uro-scanner.<br />
Cystoscopie + biopsie.<br />
Exercice 5<br />
Quel traitement proposeriez vous devant une tumeur vésicale infiltrante classée G2<br />
pT2 sur l'examen anatomopathologique des copeaux de résection chez un homme<br />
de 40 ans ?<br />
Résection endoscopique de la tumeur vésicale seule<br />
Résection endoscopique de la tumeur vésicale + BCG<br />
Cystoprostatectomie radicale<br />
Chimiothérapie<br />
Radiothérapie seule