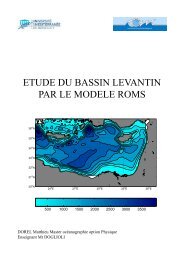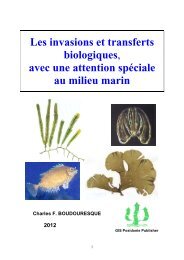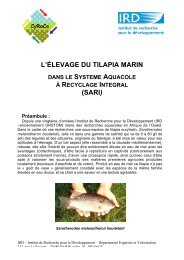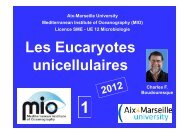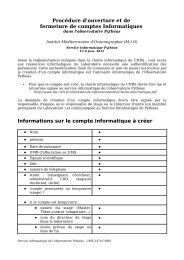Implications de l'IRD (ex ORSTOM) - Centre d'Océanologie de ...
Implications de l'IRD (ex ORSTOM) - Centre d'Océanologie de ...
Implications de l'IRD (ex ORSTOM) - Centre d'Océanologie de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
développement <strong>de</strong> petites pêcheries familiales ou<br />
communautaires. Les poissons sont capturés par <strong>de</strong>s<br />
parcs à poissons dans tous les atolls <strong>de</strong> Polynésie<br />
(Blanchet, 1985).. La commercialisation <strong>de</strong>s poissons<br />
intéresse essentiellement les marchés <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s îles<br />
les plus proches et les plus peuplées. Il apparaît<br />
cependant que la plupart <strong>de</strong>s individus capturés le<br />
soient lors <strong>de</strong> leurs migrations pour la reproduction<br />
(Blanchet, 1999). La saisonnalité marquée <strong>de</strong>s<br />
captures, et les étu<strong>de</strong>s relatives à la taille à la première<br />
reproduction le confirment.<br />
Une étu<strong>de</strong> socio-économique a montré que Les atolls<br />
peuvent, avec le développement certes timi<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
nouvelles zones comme les Tuamotu Est et Nord-Est,<br />
tenter à l'échelle du Territoire une spécialisation sur la<br />
pêche lagonaire par opposition au marché hauturier.<br />
Cette distinction qualitative <strong>de</strong>s captures, éviterait toute<br />
concurrence, l'un étant voué au marché intérieur, l'autre<br />
à l'<strong>ex</strong>portation internationale. Les atolls bénéficient pour<br />
cela <strong>de</strong> l'immense potentiel d'<strong>ex</strong>ploitation <strong>de</strong> ses 72 îles<br />
et d'un marché fort d'une population supérieure à 200<br />
000 habitants en pleine croissance. Cette perspective<br />
techniquement moins coûteuse permettrait <strong>de</strong> se<br />
réaliser à court terme. Par ailleurs, l'archipel <strong>de</strong>s<br />
Tuamotu-Gambier peut envisager <strong>de</strong> manière<br />
complémentaire, le développement d'une pêche côtière<br />
voire hauturière autour <strong>de</strong> ports équipés comme celui <strong>de</strong><br />
Rangiroa aux Tuamotu Ouest, Hao aux Tuamotu<br />
<strong>Centre</strong>. Le secteur profiterait <strong>de</strong> l'établissement <strong>de</strong><br />
bases arrières à proximité <strong>de</strong> nouvelles zones <strong>de</strong> pêche<br />
contribuant ainsi à accroître la production et à<br />
uniformiser l'<strong>ex</strong>ploitation <strong>de</strong> son immense ZEE<br />
jusqu'alors dans cette partie, délaissée aux navires<br />
coréens (Borel, 1999).<br />
La perliculture<br />
Les étu<strong>de</strong>s réalisées sur la qualité et la productivité <strong>de</strong>s<br />
eaux du lagon <strong>de</strong> l’atoll <strong>de</strong> Takapoto et sur les besoins<br />
nutritionnels <strong>de</strong> l’huître perlière, ont montré que la<br />
production primaire du lagon permettait <strong>de</strong> nourrir<br />
largement les huîtres en élevage. Même si celles-ci sont<br />
incapables d’utiliser directement le phytoplancton en<br />
raison <strong>de</strong> sa très petite taille et doivent s’alimenter à<br />
partir <strong>de</strong>s protistes (Loret et al 2000).<br />
Une analyse <strong>de</strong> la vente <strong>de</strong>s perles noires a montré que<br />
corrélativement à l’augmentation <strong>de</strong> la production, les<br />
ventes <strong>de</strong> produits perliers se sont considérablement<br />
accrues <strong>de</strong>puis 1990. Malheureusement, cette<br />
croissance <strong>de</strong>s ventes n’a pas été suivie d’une<br />
organisation commerciale efficace (Blanchet, 2000).<br />
Ainsi, la Perle Noire <strong>de</strong> Tahiti, dont la simple évocation<br />
rappelle qu’elle appartient à la haute joaillerie, n’en finit<br />
pas <strong>de</strong> perdre <strong>de</strong> sa valeur.<br />
3.1.5 Anthropisation <strong>de</strong>s lagons<br />
Bien que l’essentiel <strong>de</strong>s écosystèmes lagonaires soient<br />
encore très largement in<strong>de</strong>mnes <strong>de</strong>s altérations liées<br />
aux apports anthropiques, la concentration <strong>de</strong> la<br />
population autour <strong>de</strong> centres urbains favorise<br />
l’émergence rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> problèmes environnementaux<br />
localisés mais pouvant être sévères. Les travaux<br />
conduits sur le site atelier du lagon <strong>de</strong> Papeete ont<br />
permis <strong>de</strong> montrer que l’eutrophisation du milieu et les<br />
conséquences <strong>de</strong> l’érosion liée à l’urbanisation<br />
pouvaient affecter <strong>de</strong> façon majeure l’équilibre <strong>de</strong>s<br />
lagons d’îles hautes dont la superficie est souvent très<br />
limitée. Une approche basée sur l’analyse <strong>de</strong>s archives<br />
historiques sédimentaires (Fichez et al., 1997 ; Harris,<br />
1998 ; Harris et al., 2001) a démontré que l’écosystème<br />
13<br />
lagonaire avait été très largement altéré à partir <strong>de</strong> 1966<br />
suite à la construction <strong>de</strong>s digues <strong>de</strong> protection du port<br />
et <strong>de</strong> l’apport additionnel d’éléments d’origine terrigène<br />
ou anthropique dans le lagon.<br />
3.1.6 Influence <strong>de</strong> la variabilité environnementale<br />
sur la croissance récifale <strong>de</strong>puis 20.000 ans<br />
Ce programme a permis d'établir la courbe <strong>de</strong> remontée<br />
du niveau marin <strong>de</strong>puis les <strong>de</strong>rniers 14.000 ans (Bard et<br />
al., 1996), <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce la plus importante<br />
croissance récifale postglaciaire continue, c'est à dire 90<br />
m <strong>de</strong> croissance, <strong>de</strong>puis 14.000 ans (Montaggioni et al.,<br />
1997). De plus, l'évolution <strong>de</strong> la croissance <strong>de</strong> ce récif<br />
en fonction <strong>de</strong>s paramètres environnementaux locaux<br />
(hydrodynamisme, luminosité, etc…) et globaux<br />
(remontée du niveau marin) a été reconstituée grâce<br />
aux étu<strong>de</strong>s sédimentologiques et paléoécologiques<br />
(Cabioch et al., 1999).<br />
Ces résultats ont montré également que le récif barrière<br />
<strong>de</strong> Tahiti s'est caractérisé par un fort taux <strong>de</strong> croissance<br />
(6 mm par an en moyenne) et par la présence <strong>de</strong><br />
microbialithes (Camoin et al., 1999).<br />
Enfin, l’étu<strong>de</strong> et la datation <strong>de</strong>s échantillons ont permis<br />
<strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce le caractère récifal <strong>de</strong> la plateforme<br />
à -90 m entourant les îles <strong>de</strong>s Marquises<br />
(Cabioch et al., 2000) et l’<strong>ex</strong>istence <strong>de</strong> plusieurs niveaux<br />
récifaux ou coralliens fossiles.<br />
3.2 Sur la Nouvelle Calédonie<br />
Les travaux sur la Nouvelle-Calédonie ont porté sur la<br />
<strong>de</strong>scription et la compréhension du fonctionnement <strong>de</strong>s<br />
lagons et <strong>de</strong> leurs systèmes adjacents. Les principales<br />
avancées répon<strong>de</strong>nt aux questions suivantes :<br />
• Quelles sont la nature et la distribution <strong>de</strong>s<br />
sédiments dans les lagons ?<br />
• Quelle est la diversité <strong>de</strong>s organismes<br />
macrobenthiques et comment sont-ils répartis ?<br />
• Comment se répartissent spatialement et<br />
temporellement les flux d’énergie en environnement<br />
sédimentaire ?<br />
• Comment l’hydrodynamisme influence-t-elle les flux<br />
<strong>de</strong> matière et d’énergie ?<br />
• Quelle influence les apports anthropiques,<br />
notamment ceux <strong>de</strong> métaux, <strong>ex</strong>ercent-ils sur les<br />
systèmes biologiques ?<br />
• Est-il possible à partir <strong>de</strong>s connaissances acquises<br />
<strong>de</strong> formaliser <strong>de</strong>s indicateurs du milieu et <strong>de</strong>s<br />
ressources ?<br />
3.2.1 La <strong>de</strong>scription globale du milieu lagonaire.<br />
Les eaux<br />
Les caractéristiques physico-chimiques <strong>de</strong>s eaux sont<br />
influencées à plus <strong>de</strong> 70 % par un gradient d’influence<br />
terrigène qui affecte l’ensemble <strong>de</strong>s stations lagonaires<br />
et une eutrophisation artificielle qui affecte un nombre<br />
limité <strong>de</strong> stations côtières. On observe un net gradient<br />
d’enrichissement en chlorophylle a avec la profon<strong>de</strong>ur<br />
lié au recyclage <strong>de</strong> la matière organique dans le<br />
compartiment benthique.<br />
La biomasse du phytoplancton est très variable en<br />
raison du déplacement <strong>de</strong> masses d’eaux <strong>de</strong><br />
caractéristiques différentes. Elle est maximale en<br />
pério<strong>de</strong> hivernale (juin)