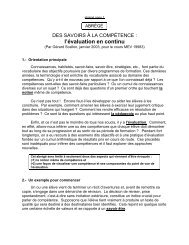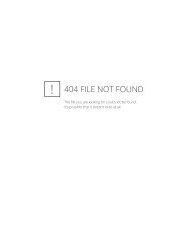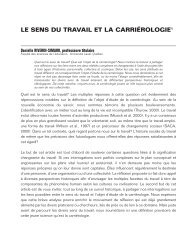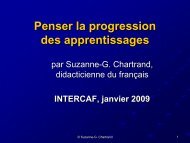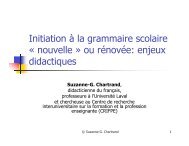Sonia Ben Nejma - Faculté des sciences de l'éducation
Sonia Ben Nejma - Faculté des sciences de l'éducation
Sonia Ben Nejma - Faculté des sciences de l'éducation
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
travail algébrique. La répartition <strong><strong>de</strong>s</strong> rôles entre enseignant et élève vis-à-vis <strong><strong>de</strong>s</strong> savoirs<br />
engagés est toujours la même : le topos <strong>de</strong> l’élève se résume a maxima à la mobilisation <strong>de</strong><br />
techniques algébriques déjà étudiées suivant un découpage prédéterminée par l’enseignante.<br />
Ce qui est loin <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> visiblement attendue par les auteurs du manuel<br />
officiel, qui sous-entendait un important déplacement topogénétique « vers l’élève » au fil <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
activités proposées.<br />
L’analyse <strong><strong>de</strong>s</strong> pratiques <strong>de</strong> p1, l’année 2 montrent certaines évolutions notamment en ce qui<br />
les dialectiques entre algébrique et numérique ou graphique. Cette évolution va dans le sens<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> organisations mathématiques attendues et peuvent s’interpréter comme une qui vient<br />
répondre à <strong><strong>de</strong>s</strong> épiso<strong><strong>de</strong>s</strong> à résonance forte <strong>de</strong> l’année 2005-2006. L’analyse <strong><strong>de</strong>s</strong> entretiens<br />
menés à chaud révèlent entre autres que les difficultés rencontrées par l’enseignante à<br />
l’occasion <strong><strong>de</strong>s</strong> activités précitées (l’activité 1 sur les équations à <strong>de</strong>ux inconnues, l’activité sur<br />
la résolution graphique d’un système) l’année précé<strong>de</strong>nte, ont été suffisamment sensibles et<br />
l’ont incité à modifier fortement sa gestion didactique autour <strong>de</strong> ces activités. Toutefois si cet<br />
ajustement <strong>de</strong> la pratique va dans le sens d’un rapprochement à la réforme, ce n’est pas le cas<br />
<strong>de</strong> la dimension ostensive. Là encore, on peut interpréter cette évolution <strong><strong>de</strong>s</strong> pratiques <strong>de</strong> P1<br />
comme en réponse aux difficultés rencontrées par les élèves, observables en situation <strong>de</strong><br />
classe l’année précé<strong>de</strong>nte.<br />
Pour le reste, les pratiques <strong>de</strong> P1 apparaissent d’une remarquable stabilité d’une année à<br />
l’autre, les techniques <strong>de</strong> mise en équation restent masquées par sa gestion<br />
didactique .L’enseignante semble en effet disposer <strong>de</strong> peu d’éléments concernant par exemple<br />
le manque <strong>de</strong> visibilité <strong><strong>de</strong>s</strong> techniques <strong>de</strong> mise en équation pour les élèves : les tâches qui s’y<br />
rapportent n’étant que peu représentées au sein <strong><strong>de</strong>s</strong> évaluations proposées par l’enseignante.<br />
L’analyse menées sur l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> protocoles révèle par ailleurs, une régularité <strong>de</strong><br />
l’organisation didactique qui laisse très peu <strong>de</strong> place à l’élève dans la réalisation autonome<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> activités d’étu<strong>de</strong> et <strong>de</strong> recherche 6 .Le topos <strong>de</strong> l’élève reste globalement faible sauf en ce<br />
qui concerne la mise en œuvre <strong>de</strong> techniques algébriques plus ou moins anciennes.Selon les<br />
travaux <strong>de</strong> A. Robert la stabilité <strong>de</strong> la composante méditative <strong><strong>de</strong>s</strong> pratiques peut en effet être<br />
à l’origine <strong>de</strong> difficultés pour l’enseignante à adopter <strong><strong>de</strong>s</strong> exercices différents <strong>de</strong> ceux dont<br />
elle a l’habitu<strong>de</strong> et à déstabiliser <strong><strong>de</strong>s</strong> routines bien installées.<br />
III. Conclusion<br />
La recherche engagée dans le cadre <strong>de</strong> la thèse <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième auteure soulève <strong>de</strong> nombreuses<br />
questions sur la perméabilité ou l’imperméabilité <strong><strong>de</strong>s</strong> pratiques enseignantes à une réforme<br />
donnée.<br />
On voit bien dans le cas <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas présentée ici : comment tout en calquant son<br />
enseignement sur les organisations mathématiques et didactiques mises en texte dans le<br />
manuel officiel, une enseignante « détourne » une part importante <strong>de</strong> ces praxéologies <strong>de</strong><br />
référence. Soit parce qu’elles semblent prendre pied sur <strong><strong>de</strong>s</strong> routines <strong>de</strong> travail qui pèsent<br />
fortement sur l’organisation <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> : comme celles visiblement liées à la topogenèse dans<br />
le cas <strong>de</strong> l’enseignante P1. Soit parce que le professeur ne semble pas percevoir le projet<br />
didactique global ou épistémologique qui sous-tend ces organisations mathématiques ou<br />
6 Ce constat se rapproche d’ailleurs <strong>de</strong> ce qui a été mis en avant dans le contexte français par le projet<br />
AMPERES(Apprentissages mathématiques et parcours d’étu<strong>de</strong> et <strong>de</strong> recherche dans l’enseignement<br />
secondaire)(2007) « la majorité <strong><strong>de</strong>s</strong> « activités introductives » <strong><strong>de</strong>s</strong> manuels, massivement reprises par les<br />
professeurs dans les classes, suivant en cela la forme dominante d’un enseignement sous forme d’ostension<br />
déguisée, « oublient » les questions fondatrices motivant les mathématiques et leur étu<strong>de</strong>. Cet état <strong>de</strong> fait est<br />
conséquence <strong>de</strong> problèmes profonds qui trouvent leurs fon<strong>de</strong>ments dans la société pensant son école, la<br />
pédagogie qu’elle entend y voir pratiquée et la formation <strong><strong>de</strong>s</strong> professeurs. »<br />
12