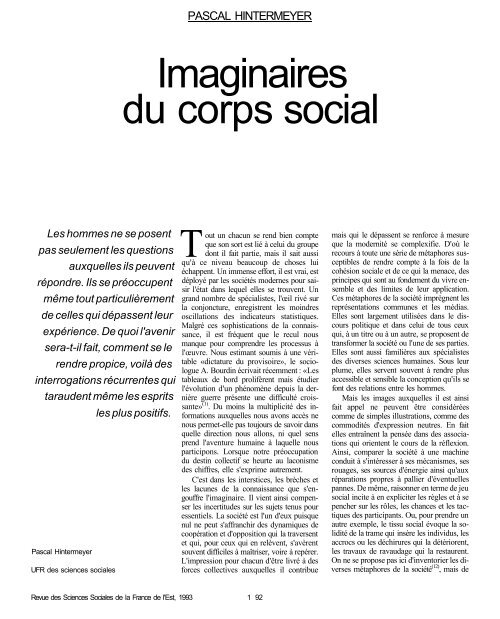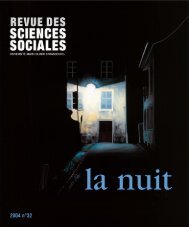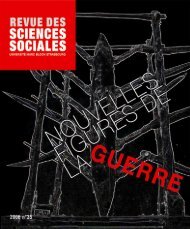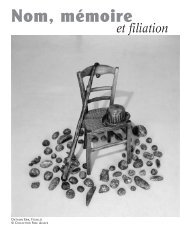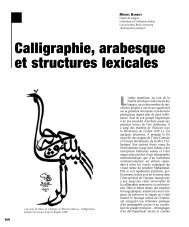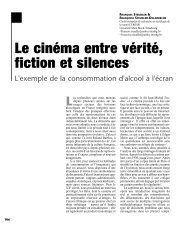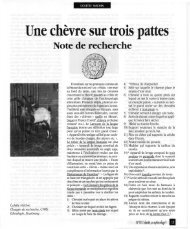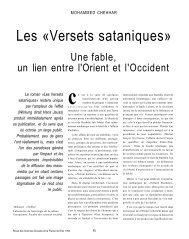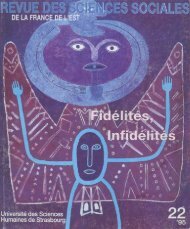Imaginaires du corps social - Revue des sciences sociales
Imaginaires du corps social - Revue des sciences sociales
Imaginaires du corps social - Revue des sciences sociales
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PASCAL HINTERMEYER<br />
<strong>Imaginaires</strong><br />
<strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong><br />
Les hommes ne se posent<br />
pas seulement les questions<br />
auxquelles ils peuvent<br />
répondre. Ils se préoccupent<br />
même tout particulièrement<br />
de celles qui dépassent leur<br />
expérience. De quoi l'avenir<br />
sera-t-il fait, comment se le<br />
rendre propice, voilà <strong>des</strong><br />
interrogations récurrentes qui<br />
taraudent même les esprits<br />
les plus positifs.<br />
Pascal Hintermeyer<br />
UFR <strong>des</strong> <strong>sciences</strong> <strong>social</strong>es<br />
Tout un chacun se rend bien compte<br />
que son sort est lié à celui <strong>du</strong> groupe<br />
dont il fait partie, mais il sait aussi<br />
qu'à ce niveau beaucoup de choses lui<br />
échappent. Un immense effort, il est vrai, est<br />
déployé par les sociétés modernes pour saisir<br />
l'état dans lequel elles se trouvent. Un<br />
grand nombre de spécialistes, l'œil rivé sur<br />
la conjoncture, enregistrent les moindres<br />
oscillations <strong>des</strong> indicateurs statistiques.<br />
Malgré ces sophistications de la connaissance,<br />
il est fréquent que le recul nous<br />
manque pour comprendre les processus à<br />
l'œuvre. Nous estimant soumis à une véritable<br />
«dictature <strong>du</strong> provisoire», le sociologue<br />
A. Bourdin écrivait récemment : «Les<br />
tableaux de bord prolifèrent mais étudier<br />
l'évolution d'un phénomène depuis la dernière<br />
guerre présente une difficulté croissante»<br />
(1) . Du moins la multiplicité <strong>des</strong> informations<br />
auxquelles nous avons accès ne<br />
nous permet-elle pas toujours de savoir dans<br />
quelle direction nous allons, ni quel sens<br />
prend l'aventure humaine à laquelle nous<br />
participons. Lorsque notre préoccupation<br />
<strong>du</strong> <strong>des</strong>tin collectif se heurte au laconisme<br />
<strong>des</strong> chiffres, elle s'exprime autrement.<br />
C'est dans les interstices, les brèches et<br />
les lacunes de la connaissance que s'engouffre<br />
l'imaginaire. Il vient ainsi compenser<br />
les incertitu<strong>des</strong> sur les sujets tenus pour<br />
essentiels. La société est l'un d'eux puisque<br />
nul ne peut s'affranchir <strong>des</strong> dynamiques de<br />
coopération et d'opposition qui la traversent<br />
et qui, pour ceux qui en relèvent, s'avèrent<br />
souvent difficiles à maîtriser, voire à repérer.<br />
L'impression pour chacun d'être livré à <strong>des</strong><br />
forces collectives auxquelles il contribue<br />
mais qui le dépassent se renforce à mesure<br />
que la modernité se complexifie. D'où le<br />
recours à toute une série de métaphores susceptibles<br />
de rendre compte à la fois de la<br />
cohésion <strong>social</strong>e et de ce qui la menace, <strong>des</strong><br />
principes qui sont au fondement <strong>du</strong> vivre ensemble<br />
et <strong>des</strong> limites de leur application.<br />
Ces métaphores de la société imprègnent les<br />
représentations communes et les médias.<br />
Elles sont largement utilisées dans le discours<br />
politique et dans celui de tous ceux<br />
qui, à un titre ou à un autre, se proposent de<br />
transformer la société ou l'une de ses parties.<br />
Elles sont aussi familières aux spécialistes<br />
<strong>des</strong> diverses <strong>sciences</strong> humaines. Sous leur<br />
plume, elles servent souvent à rendre plus<br />
accessible et sensible la conception qu'ils se<br />
font <strong>des</strong> relations entre les hommes.<br />
Mais les images auxquelles il est ainsi<br />
fait appel ne peuvent être considérées<br />
comme de simples illustrations, comme <strong>des</strong><br />
commodités d'expression neutres. En fait<br />
elles entraînent la pensée dans <strong>des</strong> associations<br />
qui orientent le cours de la réflexion.<br />
Ainsi, comparer la société à une machine<br />
con<strong>du</strong>it à s'intéresser à ses mécanismes, ses<br />
rouages, ses sources d'énergie ainsi qu'aux<br />
réparations propres à pallier d'éventuelles<br />
pannes. De même, raisonner en terme de jeu<br />
<strong>social</strong> incite à en expliciter les règles et à se<br />
pencher sur les rôles, les chances et les tactiques<br />
<strong>des</strong> participants. Ou, pour prendre un<br />
autre exemple, le tissu <strong>social</strong> évoque la solidité<br />
de la trame qui insère les indivi<strong>du</strong>s, les<br />
accrocs ou les déchirures qui la détériorent,<br />
les travaux de ravaudage qui la restaurent.<br />
On ne se propose pas ici d'inventorier les diverses<br />
métaphores de la société (12) , mais de<br />
<strong>Revue</strong> <strong>des</strong> Sciences Sociales de la France de l'Est, 1993 1 92
s'attarder quelque peu sur l'une d'entre<br />
elles, peut-être la plus répan<strong>du</strong>e, celle <strong>du</strong><br />
<strong>corps</strong> <strong>social</strong>. Cette expression, dérivée de<br />
celle de <strong>corps</strong> politique par laquelle les auteurs<br />
de l'Antiquité se représentaient volontiers<br />
la cité, a connu une faveur croissante<br />
lorsqu'au XVII e siècle les hommes se sont<br />
attachés à organiser leur collaboration de<br />
manière plus satisfaisante. Dans les discussions<br />
sans cesse renouvelées depuis à ce<br />
sujet, elle est fréquemment employée par les<br />
publicistes, les législateurs effectifs ou potentiels<br />
et ceux qui s'adonnent à l'étude <strong>des</strong><br />
sociétés. De là elle est tombée dans le domaine<br />
public où son succès ne s'est pas démenti.<br />
Pour expliquer une faveur aussi unanime,<br />
on peut relever que la métaphore <strong>du</strong><br />
<strong>corps</strong> <strong>social</strong> concilie <strong>des</strong> significations imaginaires<br />
opposées : elle exprime aussi bien<br />
l'espoir d'un fondement solide à l'existence<br />
collective que la crainte <strong>des</strong> dangers qui la<br />
menacent. Tenir compte de ses contrastes<br />
permet d'apprécier son intérêt pour la<br />
connaissance et l'action sur la société.<br />
Les avantages<br />
de la métaphore biologique<br />
Face aux désaccords, aux rivalités, aux<br />
dissensions qui séparent les hommes, face<br />
au gigantisme de bien <strong>des</strong> institutions dont<br />
ils relèvent, la métaphore <strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong><br />
offre l'image rassurante d'une unité fondamentale<br />
faite de complémentarité, d'équilibre<br />
et d'idéal. Elle enracine la recherche<br />
sur la société dans une consistance naturelle<br />
en l'envisageant comme le prolongement<br />
d'une physique qui bénéficierait de surcroît<br />
<strong>des</strong> avancées et <strong>du</strong> prestige <strong>des</strong> <strong>sciences</strong><br />
biologiques et médicales. La parenté ainsi<br />
invoquée avec les <strong>sciences</strong> de la matière autorise<br />
à appliquer l'esprit d'analyse qui s'est<br />
révélé si fécond dans leur domaine. De<br />
même que tout organisme est composé par<br />
un grand nombre de cellules, de même la famille,<br />
selon Rousseau, peut-elle être considérée<br />
comme la cellule de base de la<br />
société (3) . Le passage de la première à la seconde<br />
et le changement progressif d'échelle<br />
s'effectuent de proche en proche à la faveur<br />
de l'image <strong>du</strong> tissu qui, préalablement à la<br />
connotation textile évoquée ci-<strong>des</strong>sus, était<br />
utilisée par les sociologues dans son acception<br />
histologique d'un ensemble homogène<br />
de cellules.<br />
En fait les perspectives analytiques <strong>des</strong><br />
rapprochements avec les <strong>sciences</strong> physiques<br />
demeurent limitées par rapport aux ouvertures<br />
liées à l'approche plus spécifiquement<br />
biologique de la vie comme phénomène<br />
global qui ne se ré<strong>du</strong>it pas à la somme de ses<br />
composantes. Dans cette optique, un <strong>corps</strong><br />
est un tout dont les parties sont nécessairement<br />
et intrinsèquement liées. Il est constitué<br />
de membres et d'organes dont chacun, à<br />
sa place, contribue à l'intégrité et à la puissance<br />
de l'ensemble qu'ils forment. Aucun<br />
d'entre eux ne pourrait subsister isolément et<br />
indépendamment parce qu'il se trouve dans<br />
une situation d'interdépendance où il est tributaire<br />
<strong>des</strong> autres qui le sont pareillement de<br />
lui. Le <strong>corps</strong> véhicule l'image d'une entité<br />
indissociable composée d'éléments complémentaires.<br />
C'est précisément la conception<br />
que se fait Durkheim de la solidarité organique<br />
qui prévaut dans les sociétés modernes<br />
caractérisées par la spécialisation <strong>des</strong><br />
tâches et la différenciation <strong>des</strong> types humains<br />
qui dépendent davantage les uns <strong>des</strong><br />
autres à mesure qu'ils se spécifient* 4 '. Une<br />
telle interprétation répond à sa manière à la<br />
volonté qu'avait Auguste Comte de mettre<br />
l'accent sur «le sentiment intime de la solidarité<br />
<strong>social</strong>e » (5) mais cette insistance, qui<br />
n'est pas propre à la sociologie française, se<br />
retrouve chez bien <strong>des</strong> auteurs issus de la<br />
tradition allemande ou anglo-saxonne, eux<br />
aussi sensibles aux attraits de la métaphore<br />
<strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong>.<br />
L'un <strong>des</strong> problèmes qu'elle résout est<br />
celui de la conjonction entre compétences<br />
diversifiées. Pour ordonner, hiérarchiser et<br />
intégrer les activités partielles, il suffit de<br />
décliner les opérations caractéristiques de<br />
l'organisme. Les organes relèvent d'appareils<br />
(circulatoire, respiratoire, digestif, repro<strong>du</strong>cteur)<br />
qui assurent chacun une fonction<br />
nécessaire à la survie de l'ensemble.<br />
Ces fonctions en interaction organisent les<br />
rapports <strong>du</strong> <strong>corps</strong> avec son environnement<br />
en déterminant ses besoins, ses niveaux de<br />
dépendance et son autonomie relative.<br />
Celle-ci est d'autant plus marquée que l'organisme<br />
met en œuvre les régulations appropriées<br />
au maintien de son équilibre à travers<br />
les variations auxquelles il est soumis.<br />
Par ces processus homéostatiques, il préserve<br />
la régularité de son fonctionnement<br />
face aux aléas <strong>des</strong> perturbations extérieures.<br />
Il est même capable, dans certaines limites,<br />
de s'adapter aux modifications <strong>des</strong> conditions<br />
dans lesquelles il se trouve placé et de<br />
transmettre à sa <strong>des</strong>cendance ces ajustements<br />
structurels.<br />
Ces prodigieuses facultés, peu à peu expliquées<br />
par les <strong>sciences</strong> de la vie, ne pouvaient<br />
laisser indifférents ceux qui ont entrepris<br />
de faire advenir celles de la société.<br />
Depuis deux siècles ils les ont eues constamment<br />
présentes à l'esprit et cette proximité<br />
délibérée a marqué bien <strong>des</strong> élaborations<br />
théoriques comme le fonctionnalisme, le<br />
structuralisme, la théorie <strong>des</strong> systèmes. Elle<br />
a aussi con<strong>du</strong>it à <strong>des</strong> interprétations critiquables,<br />
par exemple l'organicisme, le darwinisme<br />
<strong>social</strong>, plus récemment la sociobiologie.<br />
Mais il est remarquable que les<br />
réserves quant à de telles orientations n'ont<br />
nullement entamé le crédit de la référence<br />
biologique. C'est sans doute qu'elle permettait<br />
de concevoir un ordre qui ne soit ni<br />
général, ni figé, ni mécanique et qui combine<br />
souplesse et permanence, un ordre qui<br />
dérive d'une aptitude spontanée à générer un<br />
équilibre autonome et <strong>du</strong>rable par la maîtrise<br />
de sa complexité interne et la sélection,<br />
dans l'immensité <strong>du</strong> monde, <strong>des</strong> facteurs<br />
propices à son propre développement.<br />
Une représentation<br />
rassurante de la société<br />
Un tel modèle est bien sé<strong>du</strong>isant mais il<br />
ne doit pas trop faire illusion. Il suppose<br />
imaginairement résolu le problème qui se<br />
pose aux sociétés et à leurs réformateurs les<br />
mieux intentionnés, celui d'une harmonie<br />
défectueuse. Les groupes humains ne<br />
connaissent pas forcément l'équilibre. Leur<br />
existence est bien souvent perturbée et chaotique,<br />
en proie aux turbulences, aux revirements,<br />
aux déchirements, parfois à l'éclatement<br />
et à la disparition. Elle traverse ainsi<br />
toute sorte de démesures. Peut-être même la<br />
conscience de l'instabilité et <strong>du</strong> désordre, au<br />
moins sur un mode rési<strong>du</strong>el, la perspective<br />
d'une évolution imprévisible et dramatique,<br />
au moins au titre d'une éventualité, sontelles<br />
à l'origine de l'intérêt pour les relations<br />
entre les hommes. Il arrive en tout cas que<br />
celles-ci soient placées sous le signe <strong>du</strong><br />
conflit, voire de la confrontation. Face à de<br />
telles inquiétu<strong>des</strong>, la métaphore <strong>du</strong> <strong>corps</strong><br />
<strong>social</strong> a quelque chose de rassurant. Elle<br />
renoue avec la concorde et la cohérence.<br />
Elle substitue à la multiplicité <strong>des</strong> initiatives,<br />
<strong>des</strong> mouvements, <strong>des</strong> événements qui agitent<br />
la société, l'image d'une unité fidèle à<br />
193
elle-même à travers ses transformations<br />
maîtrisées.<br />
Elle présente un autre avantage : en elle<br />
se mêle ce qui est et ce qui devrait être. En<br />
contrepoint aux difficultés <strong>du</strong> présent, elle<br />
constitue un appel à l'idéal. Tout organisme<br />
tend à optimiser son propre fonctionnement.<br />
La société elle aussi doit stimuler les<br />
échanges et les communications entre ses<br />
parties afin que chacune remplisse le mieux<br />
possible son office en étant dépendante <strong>des</strong><br />
autres et en le devenant toujours davantage.<br />
La solidarité est ainsi à la fois un fait et une<br />
exigence. Conséquence de la division <strong>du</strong> travail,<br />
elle donne lieu dans tous les groupes<br />
humains à <strong>des</strong> transferts au profit <strong>des</strong> plus<br />
vulnérables et cette entraide doit se développer<br />
avec le procès de civilisation. Elle est<br />
une nécessité puisque dans un <strong>corps</strong> aucun<br />
membre, le plus vil soit-il, ne peut être<br />
abandonné sans secours aux difficultés dont<br />
il ne peut venir à bout. Un tel sacrifice n'affaiblirait<br />
pas seulement l'organisme en le<br />
privant de la contribution d'une de ses composantes,<br />
il compromettrait à terme son intégrité,<br />
sa santé et sa survie. La solidarité est<br />
le mouvement par lequel un groupe affermit<br />
son existence en renforçant sa cohésion. Le<br />
passage de la réalité à l'idéal est ici insensible.<br />
La solidarité organique de Durkheim<br />
est prolongée par le solidarisme de Léon<br />
Bourgeois. A qui répugnerait un tel mélange<br />
<strong>des</strong> genres on pourrait faire remarquer, avec<br />
Castoriadis, qu'un groupe ne définit pas<br />
seulement son identité par son fonctionnement,<br />
mais avant tout par un projet commun<br />
(6) . Certes cette visée collective est de<br />
l'ordre de l'imaginaire. Mais elle relève<br />
aussi <strong>du</strong> réel (qui ne se ré<strong>du</strong>it pas à ce que<br />
les esprits positifs entendent par ce terme)<br />
car elle donne sens et fait agir. Que le <strong>corps</strong><br />
<strong>social</strong> synthétise un ordre complexe et une<br />
orientation vers l'avenir, qu'il soit à la fois<br />
une nécessité et un choix, voilà qui explique<br />
sans doute une part de sa popularité.<br />
Les épreuves <strong>du</strong> temps<br />
La métaphore <strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong> se prête à<br />
la conjonction de ses éléments constitutifs<br />
ainsi qu'à celle <strong>du</strong> présent et de l'avenir,<br />
mais elle s'accommode aussi <strong>des</strong> hiatus et<br />
<strong>des</strong> imperfections. L'organisme diffère de la<br />
machine par ses possibilités supérieures<br />
d'autonomie, de régulation, d'adaptation,<br />
mais le revers de ces qualités est une indéniable<br />
fragilité. Il est vulnérable à toutes<br />
sortes d'agressions qui provoquent en lui <strong>des</strong><br />
altérations passagères ou <strong>du</strong>rables. Un <strong>corps</strong><br />
est sujet à quantité d'épreuves et de maladies<br />
qui entravent ou compromettent l'exercice<br />
de ses talents. Ses limites les plus rigoureuses<br />
ne sont pas celles qui viennent <strong>du</strong> dehors<br />
mais celles qui dérivent de son inscription<br />
dans le temps: tout ce qui vit se<br />
développe puis s'affaiblit. La société n'estelle<br />
pas condamnée à une telle évolution,<br />
certes plus lente que celle que connaissent<br />
les indivi<strong>du</strong>s, mais peut-être tout aussi inéluctable<br />
? Dès lors que la cité <strong>des</strong> hommes<br />
est déconnectée de l'ordre divin et que s'estompent<br />
ses garants méta-sociaux (7) , se ravivent<br />
les craintes quant à sa déchéance. La<br />
métaphore <strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong> a été une expression<br />
privilégiée <strong>des</strong> doutes, <strong>des</strong> désenchantements,<br />
<strong>des</strong> appréhensions à propos <strong>du</strong> <strong>des</strong>tin<br />
collectif.<br />
La conception cyclique est l'une <strong>des</strong> plus<br />
anciennes selon laquelle les hommes se représentent<br />
le devenir de leur société qui demeure<br />
insaisissable pour eux puisqu'il excède<br />
la <strong>du</strong>rée de leur existence indivi<strong>du</strong>elle.<br />
Cette croyance se réfère à un âge d'or mythique<br />
<strong>du</strong>quel on s'éloignerait gra<strong>du</strong>ellement<br />
par un processus de déperdition aboutissant<br />
à une disparition qui achève une<br />
phase de l'histoire et en annonce une nouvelle<br />
(8) . La métaphore <strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong> transporte<br />
ces significations ancestrales jusqu'à<br />
une époque que l'on caractérise généralement,<br />
<strong>du</strong> moins pour ce qui concerne<br />
l'Occident, par sa foi dans le progrès, la<br />
technique et le bonheur. S'agit-il d'une<br />
contrepartie nécessaire à un optimisme excessif<br />
et peut-être superficiel ? Toujours estil<br />
que bien <strong>des</strong> auteurs <strong>des</strong> XIX e et<br />
XX e siècles appliquent à la collectivité le<br />
cycle biologique qui va de la naissance à la<br />
mort en passant par la croissance, la jeunesse,<br />
la maturité, la vieillesse. Ils considèrent<br />
généralement leur propre société<br />
comme parvenue à une étape avancée de<br />
cette évolution et donc vouée à ses sta<strong>des</strong> ultérieurs.<br />
Les épreuves qui marquent leur<br />
temps ou le groupe <strong>social</strong> auquel ils appartiennent<br />
leur paraissent autant de confirmations<br />
d'un âge atteint par la sclérose.<br />
Cela fait plusieurs siècles que chaque génération<br />
s'imagine confrontée à <strong>des</strong> difficultés<br />
sans précédent. Cette impression renforce<br />
le sentiment d'une détérioration accrue<br />
de la vitalité collective qui paraît de plus<br />
conforme aux enseignements de l'histoire<br />
universelle. En particulier l'Europe a été<br />
hantée par l'exemple de la décadence romaine,<br />
invoquée comme la preuve que les<br />
empires les plus soli<strong>des</strong> sont inéluctablement<br />
voués à la décomposition et à la chute.<br />
Certains auteurs font commencer très tôt le<br />
processus de déclin <strong>du</strong> monde antique. Pour<br />
Toynbee il serait avéré dès l'époque hellénistique<br />
(9) . Les considérations sur le caractère<br />
éphémère <strong>des</strong> puissances passées suggèrent<br />
bien <strong>des</strong> parallèles avec le présent.<br />
Aujourd'hui notamment l'effondrement<br />
soudain de pouvoirs qui passaient pour redoutables<br />
peu auparavant incite à renouer<br />
avec les méditations sur la fragilité <strong>des</strong> institutions<br />
humaines. Sous le titre «Fins d'empires»,<br />
le quotidien Le Monde a proposé à<br />
ses lecteurs pendant l'été 1992 un feuilleton<br />
historique dont chaque épisode était marqué<br />
par la dissolution d'un ordre établi. Tant de<br />
cas de déclin incitent à guetter les signes<br />
d'atonie <strong>social</strong>e.<br />
Pathologie <strong>social</strong>e<br />
Bien <strong>des</strong> symptômes ont été invoqués<br />
pour justifier le diagnostic de sénilité collective:<br />
épuisement <strong>des</strong> ressources naturelles,<br />
dégradation irréversible de l'environnement,<br />
renoncement à la transmission<br />
de cultures ou de savoir-faire, montée de<br />
l'indivi<strong>du</strong>alisme, manie commémorative,<br />
etc. L'un d'eux a particulièrement frappé les<br />
esprits: la dégénérescence est devenue au<br />
XIX e siècle une angoisse qui a infléchi dans<br />
un sens biologique l'imaginaire traditionnel<br />
de la décadence. Elle désigne un état chronique<br />
de langueur et de débilité qui rend<br />
ceux qui en sont atteints inaptes ou nuisibles<br />
à toute œuvre collective. Max Nordau, qui<br />
lui consacre tout un ouvrage, considère<br />
qu'elle est <strong>du</strong>e aux conditions de la vie moderne<br />
et qu'elle prend une dimension épidémique<br />
à l'aube <strong>du</strong> XX e siècle. «Nous nous<br />
trouvons actuellement», écrit-il, «au plus<br />
fort d'une grave épidémie intellectuelle,<br />
d'une sorte de peste noire de dégénérescence<br />
et d'hystérie et il est naturel que l'on<br />
se demande de toutes parts avec angoisse :<br />
que va-t-il arriver?» (10) Ce pessimisme à<br />
connotation biologique se retrouve à la<br />
même époque, sous une forme atténuée,<br />
chez <strong>des</strong> auteurs qui trouvent un large public.<br />
Zola, par ailleurs attentif à décrire de<br />
façon méticuleuse les milieux sociaux dans<br />
lesquels ses personnages évoluent (11) ,<br />
194
Tentation de St Antoine (avec l'aimable autorisation <strong>du</strong> Musée d'Unterlinden, Colmar)<br />
raconte comment, chez les Rougon-<br />
Macquart, les tares se transmettent et se cumulent<br />
de génération en génération.<br />
Un organisme affaibli, délabré ou dégénéré<br />
pouvant contracter toutes sortes de maladies,<br />
il en irait de même d'une société parvenue<br />
au même état. C'est pourquoi, à la fin<br />
<strong>du</strong> XIX e siècle encore, le vice-président de<br />
l'Institut international de sociologie, Paul de<br />
Lilienfeld, suggère de consacrer à l'étude de<br />
ces situations malsaines toute une branche<br />
de la sociologie qu'il propose d'appeler<br />
«pathologie <strong>social</strong>e». Tout en filant la métaphore<br />
médicale, il estime être parvenu en<br />
ce domaine à un premier résultat, celui<br />
d'identifier dans le parasitisme «la cause de<br />
toute une série de maladies <strong>social</strong>es » (12) .<br />
Cette étiologie serait liée à <strong>des</strong> éléments<br />
exogènes en cas d'immigration incontrôlée,<br />
mais elle pourrait aussi bien revêtir un caractère<br />
endogène. En effet, «dans une société<br />
tout indivi<strong>du</strong> ou toute association agricole,<br />
in<strong>du</strong>strielle, commerciale, financière<br />
ou corporative peut acquérir un caractère parasitique.<br />
Cela arrivera chaque fois que les<br />
forces régulatrices de l'organisme se trouveront<br />
hors d'état de retenir l'action de ses<br />
parties dans les limites qui leur sont désignées<br />
par leur nature même et que l'équilibre<br />
<strong>des</strong> forces matérielles et morales de la<br />
communauté en sera rompu» (13) . Sous couvert<br />
de découvrir une loi générale, l'auteur<br />
se livre à une nouvelle apologie <strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong>,<br />
de son ordre naturel, harmonieux et régulateur.<br />
Lorsque la société s'écarte de cette<br />
félicité fonctionnaliste, elle se précipite dans<br />
le déséquilibre, le parasitisme et leur cortège<br />
de maladies. Bien sûr tout cela passe aujourd'hui<br />
pour une caricature <strong>du</strong>e à un esprit<br />
mineur. Mais il ne faut pas oublier que<br />
Durkheim lui aussi consacre tout un chapitre<br />
<strong>des</strong> Règles de la méthode sociologique à « la<br />
distinction <strong>du</strong> normal et <strong>du</strong> pathologique».<br />
Et la métaphore de la maladie <strong>social</strong>e n'a<br />
pas disparu depuis. Elle a simplement suivi<br />
l'évolution <strong>des</strong> pathologies, ou <strong>du</strong> moins ses<br />
répercussions sur les sensibilités <strong>des</strong><br />
contemporains. Celles-ci sont aujourd'hui<br />
particulièrement impressionnées par les<br />
maux que la médecine ne maîtrise pas, en<br />
particulier le cancer et le sida. Les sociétés<br />
ne connaissent-elles pas <strong>des</strong> perturbations<br />
analogues? Le cancer pose le problème<br />
d'une prolifération anarchique qui compromet<br />
les équilibres traditionnels et échappe à<br />
toute maîtrise. N'est-ce pas ce qui se passe<br />
dans certaines mégapoles <strong>du</strong> tiers monde qui<br />
s'agrandissent au-delà de toute mesure, se<br />
répandent en excroissances nauséabon<strong>des</strong>,<br />
se rapprochent dangereusement de la paralysie<br />
et de l'asphyxie? Sous l'effet <strong>du</strong> sida<br />
apparaît un imaginaire immunitaire de la société<br />
qui envisage l'identité d'un groupe à<br />
partir <strong>du</strong> système qui lui permet de préserver<br />
son intégrité en se défendant contre les<br />
agressions extérieures. Dans le cas de cette<br />
maladie comme dans celui <strong>des</strong> autres, le<br />
passage <strong>du</strong> sens propre à l'usage métaphorique<br />
est particulièrement aisé lorsqu'il est<br />
question <strong>des</strong> dispositifs censés la combattre.<br />
Dénonçant l'inertie qui a permis la contamination<br />
massive d'échantillons sanguins en<br />
1985, E. Morin écrit: «La présence de<br />
médecins dans l'administration de la santé<br />
procure à celle-ci une immunité particulière<br />
» (14) . Se livrant à une critique systématique<br />
de certaines tendances de la modernité,<br />
J. Baudrillard utilise abondamment<br />
les métaphores <strong>du</strong> cancer et <strong>du</strong> sida. Il écrit<br />
par exemple : « Le système <strong>social</strong>, comme le<br />
<strong>corps</strong> biologique, perd ses défenses naturelles<br />
à mesure de la sophistication de ses<br />
prothèses» (15) . On retrouve ici, dans le recours<br />
à l'imaginaire pathologique, une signification<br />
polémique qui prévaut lorsque P.<br />
Chaunu évoque la «cité cancéreuse»<br />
comme une preuve de décadence (16) ou<br />
195
lorsque L. Pauwels accuse la jeunesse d'être<br />
atteinte de « sida mental » dans <strong>des</strong> termes<br />
qui rappellent les diatribes contre la dégénérescence<br />
(17) . Ainsi se confirme la parenté<br />
entre les maladies <strong>social</strong>es d'hier et d'aujourd'hui<br />
et leur rapport avec la dénonciation<br />
de l'amenuisement de la vitalité <strong>social</strong>e.<br />
Le double <strong>corps</strong> de la société<br />
Si la modernité ne s'est pas affranchie<br />
<strong>des</strong> croyances traditionnelles au sujet <strong>du</strong><br />
<strong>des</strong>tin collectif, elle les a volontiers transcrites<br />
en un langage biologique. Celui-ci<br />
peut se déployer dans deux directions, selon<br />
que l'on considère la vie comme la forme la<br />
plus accomplie de l'ordre ou comme l'expression<br />
de toutes les limites de la condition<br />
humaine soumise aux atteintes imparables<br />
<strong>du</strong> temps et de la mort. L'image de l'organisme,<br />
appliquée au niveau collectif, donne<br />
lieu au double <strong>corps</strong> de la société : d'un côté,<br />
le <strong>corps</strong> glorieux, harmonieux, idéal, <strong>du</strong><br />
fonctionnalisme, où l'unité émane de la différenciation<br />
et la régulation de la maîtrise de<br />
la complexité ; de l'autre, un <strong>corps</strong> souffrant,<br />
déséquilibré, diminué par la maladie et le<br />
vieillissement; d'une part, une orientation<br />
homogénéisante qui prévaut notamment<br />
dans les tentatives de réforme globale et la<br />
logique administrative de hiérarchisation<br />
<strong>des</strong> <strong>corps</strong> professionnels; d'autre part, une<br />
rhétorique de la crise et de la sclérose. La coexistence<br />
de ces deux tendances contrastées<br />
témoigne d'une bipolarisation de l'imaginaire<br />
sur la société. Nos rêveries sur son devenir<br />
oscillent entre le registre de l'utopie et<br />
celui <strong>du</strong> cauchemar. L'expérience <strong>du</strong><br />
XX e siècle a incité la sensibilité contemporaine<br />
à les conjuguer plus systématiquement,<br />
selon un syncrétisme où la tonalité<br />
crépusculaire prend aisément le <strong>des</strong>sus<br />
puisque le meilleur <strong>des</strong> mon<strong>des</strong> peut s'avérer<br />
la forme accomplie <strong>du</strong> pire sans que la<br />
réciproque se vérifie.<br />
Le balancement entre l'idéal et l'épouvante<br />
ne caractérise pas uniquement la<br />
science-fiction, mais l'imaginaire en général.<br />
Celui-ci suit habituellement la pente de<br />
l'excès, ce qui l'empêche de se conformer à<br />
toutes les nuances de la réalité et l'a définitivement<br />
ren<strong>du</strong> suspect à la tradition rationaliste.<br />
Certes il simplifie, mais cela ne présente-t-il<br />
que <strong>des</strong> inconvénients? On se<br />
souvient que, d'après Bachelard, les<br />
connaissances, en se transmettant, se généralisent<br />
et se chargent d'images qui constituent<br />
autant d'obstacles au développement<br />
ultérieur <strong>du</strong> savoir (18) . L'imaginaire biologique<br />
est-il une entrave à l'étude et à l'amélioration<br />
de la société? Sans doute peut-il le<br />
devenir s'il provoque une assimilation pure<br />
et simple entre différents niveaux de réalité.<br />
Il se fige alors en associations obligées qui,<br />
sans cesse répétées, perdent la puissance<br />
heuristique propre aux métaphores qui établissent<br />
un rapprochement entre deux domaines<br />
de signification restant perçus<br />
comme distincts (19) . Sous réserve <strong>du</strong> maintien<br />
<strong>des</strong> différences entre ses références<br />
constitutives et de la préservation de ses<br />
contrastes fondamentaux, l'image <strong>du</strong> <strong>corps</strong><br />
<strong>social</strong> peut éviter de se transformer en métaphore<br />
morte. Tant qu'elle reste paradoxale,<br />
elle stimule la connaissance et l'action<br />
sur la société.<br />
Du point de vue de la connaissance, elle<br />
peut contribuer à faire prendre conscience<br />
que les phénomènes collectifs sont à la fois<br />
emprunts de stabilité et de fragilité. Cette<br />
double détermination est sans doute une<br />
condition de possibilité de leur compréhension.<br />
Elle dérive <strong>des</strong> relations d'interdépendance<br />
qui les constituent et qui expliquent<br />
que, si un groupe, une institution, une entreprise<br />
peuvent subsister indépendamment<br />
<strong>des</strong> dispositions à leur égard de tel indivi<strong>du</strong><br />
en faisant partie, en même temps ils sont<br />
vulnérables aux déperditions de sens susceptibles<br />
de les priver d'une part de leur raison<br />
d'être. La découverte concomitante de la<br />
stabilité et de la fragilité de la société semble<br />
même être à l'origine <strong>du</strong> projet de l'étudier<br />
pour elle-même. Ceux qui s'y consacrèrent<br />
furent à la fois frappés par sa résistance aux<br />
tentatives pour la façonner rationnellement,<br />
ce manque de plasticité révélant une irré<strong>du</strong>ctible<br />
spécificité, et par ses difficultés à<br />
retrouver son équilibre à la suite <strong>des</strong> bouleversements<br />
qui lui avaient été infligés et qui<br />
l'avaient précipitée dans <strong>des</strong> troubles impossibles<br />
à dissiper. Bien sûr, ces deux observations<br />
semblaient difficiles à concilier,<br />
de même qu'il était mal aisé de concevoir un<br />
ordre qui ne se dé<strong>du</strong>ise pas directement <strong>des</strong><br />
catégories de l'esprit humain. Mais ce sont<br />
précisément ces problèmes, rebelles à toute<br />
solution a priori, qui exigeaient d'entreprendre<br />
<strong>des</strong> recherches nouvelles et de les<br />
soutenir par <strong>des</strong> analogies avec le domaine<br />
<strong>du</strong> vivant où étaient attestés <strong>des</strong> processus<br />
d'organisation spécifiques ainsi que leur dérèglement<br />
éventuel ou nécessaire. Comme le<br />
fait remarquer judicieusement N. Elias, «si<br />
l'esprit utilise <strong>des</strong> images pour saisir la réalité<br />
ultime <strong>des</strong> choses, c'est justement parce<br />
que cette réalité se manifeste d'une manière<br />
contradictoire et par conséquent ne saurait<br />
être exprimée par <strong>des</strong> concepts » (20) . La métaphore<br />
biologique aide alors à reconnaître<br />
les contradictions au sein de la société.<br />
Du point de vue de l'action, la métaphore<br />
<strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong> a été peut-être plus indispensable<br />
encore. On sait que la politique<br />
moderne est censée se soumettre aux exigences<br />
de la représentation <strong>des</strong> citoyens et<br />
de la séparation <strong>des</strong> pouvoirs. Mais ce que<br />
cela in<strong>du</strong>it comme discordances et comme<br />
conflits est compensé par le recours à deux<br />
principes de légitimité très anciens et toujours<br />
efficaces. Le premier est l'appel à la<br />
concorde, à la cohésion, à la coopération,<br />
afin de faire prévaloir le bien commun (21) par<br />
la soumission de tous à une autorité qui, tel<br />
le cerveau dans l'organisme, coordonne<br />
l'activité <strong>des</strong> différentes parties. Le second<br />
est la justification <strong>du</strong> commandement et de<br />
l'obéissance par le danger réel ou potentiel<br />
que traverserait la société, qui la menacerait<br />
de déclin, de subordination, voire de disparition,<br />
et exigerait un effort concerté sous la<br />
direction de ceux qui sont capables d'affronter<br />
la mort et autorisés, en vue de la survie<br />
collective, à obtenir tous les sacrifices de<br />
ceux qu'ils gouvernent' 22 '. Ces deux principes<br />
se renforcent mutuellement et le second<br />
apporte au premier un appui parfois salutaire;<br />
C'est pourquoi, lorsque le débat<br />
politique devient plus âpre et incertain, il<br />
tend à se dramatiser. Ainsi, la consultation<br />
populaire sur le traité de Maastricht a-t-elle<br />
davantage intéressé l'opinion lorsqu'elle a<br />
quitté le terrain <strong>des</strong> dispositions techniques<br />
de l'Union économique et monétaire pour<br />
rejoindre celui de la vie et de la mort collective,<br />
les uns soutenant que le rejet <strong>du</strong><br />
texte condamnerait l'œuvre de construction<br />
européenne menée depuis près d'un demisiècle<br />
et isolerait le pays dans un monde<br />
plein de dangers, les autres s'opposant à la<br />
ratification pour préserver l'existence même<br />
de la nation, menacée de disparaître dans un<br />
ensemble plus large au profit <strong>du</strong>quel elle renoncerait<br />
à <strong>des</strong> dimensions essentielles de sa<br />
souveraineté. Cet exemple récent rappelle<br />
que dans les décisions importantes les<br />
craintes l'emportent souvent sur les projets.<br />
Si la proportion entre ces deux éléments<br />
varie, l'essentiel est leur <strong>du</strong>alité, la politique<br />
se présentant à la fois comme une mise en<br />
196
ordre de la société en vue d'une organisation<br />
plus élaborée et comme la défense de l'intégrité<br />
collective face à la violence interne et<br />
externe. En jouant sur les deux sens de la<br />
métaphore <strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong>, elle retrouve le<br />
rythme cyclique qui l'a toujours caractérisée<br />
: aux phases de corruption, de division,<br />
de dissolution, doivent succéder <strong>des</strong> moments<br />
d'harmonie, de solidarité et de régénération.<br />
L'aspiration à une telle alternance<br />
et le découragement lorsqu'elle semble hors<br />
de portée sont <strong>des</strong> facteurs essentiels de<br />
l'énergie politique.<br />
Impasses et fécondité<br />
de l'imaginaire <strong>du</strong> <strong>corps</strong><br />
<strong>social</strong><br />
L'imaginaire biologique appliqué à la<br />
politique a aussi basculé dans la démesure.<br />
La volonté de cohésion et de protection se<br />
justifie par la poursuite de l'intérêt général,<br />
au-delà de la représentation <strong>des</strong> intérêts particuliers.<br />
Mais là où ces deux principes se<br />
systématisent, ils acquièrent une efficacité<br />
redoutable. L'obsession de l'unité a con<strong>du</strong>it<br />
bien <strong>des</strong> sociétés européennes à un refus <strong>des</strong><br />
disparités qui leur sont pourtant essentielles.<br />
L'imaginaire de l'organisme, en se radicalisant,<br />
a inspiré le passage à un ordre totalitaire<br />
où le pouvoir ne peut plus être récusé<br />
puisqu'il est censé être l'incarnation même<br />
de la collectivité, où les indivi<strong>du</strong>s sont sommés<br />
en permanence de faire la preuve de<br />
leur utilité <strong>social</strong>e, où une attitude critique,<br />
voire l'expression de la subjectivité, passent<br />
pour révélateurs de présomption, d'insubordination,<br />
de trahison. En écho à cette unification<br />
forcée, l'ordre technocratique tra<strong>du</strong>it<br />
l'intention de prévoir ce qui doit arriver,<br />
d'uniformiser les comportements, de planifier<br />
ce qu'il faut faire. La fixation sur la dimension<br />
tragique, elle aussi, peut devenir<br />
dévastatrice. Elle risque de hâter l'avènement<br />
de ses plus sombres prophéties et de<br />
précipiter les catastrophes qu'elle prétend<br />
prévenir. Lorsqu'elle exagère les périls, elle<br />
incite à réagir par une attitude agressive qui<br />
participe d'ordinaire à une escalade presque<br />
impossible à enrayer. La hantise de la défaillance<br />
est allée jusqu'à la mise en cause,<br />
l'élimination même, de ceux à qui il était<br />
reproché d'affaiblir la collectivité.<br />
L'exacerbation de ces deux dimensions<br />
et leur association ont entraîné le XX e siècle<br />
dans les pires régressions. Elles ont donné<br />
lieu à un délire de l'unité, de l'homogénéité,<br />
de la pureté. Aujourd'hui encore, lorsque les<br />
problèmes entre les hommes paraissent inextricables,<br />
la tentation est forte d'en appeler<br />
au repli sur un ordre communautaire.<br />
Mais en privilégiant ainsi le retour nostalgique<br />
à l'organique (au sens restreint que lui<br />
donnait Tönnies), on tourne le dos à la société<br />
et aux prodigieuses possibilités qu'elle<br />
acquiert en suscitant l'expression de ses différences.<br />
Rabattre la dynamique collective<br />
sur la célébration répétitive <strong>du</strong> même revient<br />
à une forme d'auto-condamnation. Narcisse<br />
est tellement fasciné par la contemplation de<br />
son propre <strong>corps</strong> qu'il finit par s'y abîmer et<br />
par en périr. Ce <strong>des</strong>tin funeste guette ceux<br />
qu'obnubile l'image de leur perfection.<br />
De telles dérives se sont révélées particulièrement<br />
dangereuses à notre époque<br />
mais elles ne représentent qu'une direction,<br />
à vrai dire sans issue, de l'imaginaire <strong>du</strong><br />
<strong>corps</strong> <strong>social</strong> qui, à mesure qu'il se développe,<br />
est amené à tenir compte de l'hétérogénéité<br />
interne et externe. Alors que l'unité<br />
intégrale fusionne, fige et stérilise, la diversité<br />
et l'inachèvement stimulent la créativité.<br />
Aucun organisme ne peut <strong>du</strong>rablement se<br />
renfermer sur lui-même, il lui faut s'ouvrir<br />
aux autres et au monde. D'abord pour<br />
s'adapter à son environnement. Mais aussi<br />
parce que le désir ne se confine pas à l'identique<br />
et à l'immédiat, qu'il se porte vers<br />
l'autre et le lointain. Toutes les civilisations<br />
se sont animées par la quête d'un ailleurs auquel<br />
elles ont allègrement sacrifié leurs certitu<strong>des</strong><br />
trop familières, donc trop peu attrayantes.<br />
« Je est un autre », disait Rimbaud.<br />
C'est vrai <strong>des</strong> indivi<strong>du</strong>s comme <strong>des</strong> groupes.<br />
Ceux-ci ne cherchent pas seulement à ré<strong>du</strong>ire<br />
l'inconnu au connu mais à ménager la<br />
part de l'imprévu et <strong>du</strong> mystère. Eux aussi<br />
aspirent à d'autres rivages. D'ailleurs, l'imaginaire<br />
n'est-il pas avant tout ce qui leur permet<br />
de s'affranchir de l'ici et <strong>du</strong> maintenant?<br />
Ce qui leur suggère d'autres<br />
perspectives ? En ce sens il répugne à l'uniformisation<br />
comme à un appauvrissement de<br />
l'humain.<br />
L'imaginaire <strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong>, on le voit,<br />
est susceptible de diverses orientations. Les<br />
références biologiques et médicales sont<br />
suffisamment riches pour se prêter à <strong>des</strong> significations<br />
multiples et souvent opposées.<br />
Elles attirent l'attention aussi bien sur les facultés<br />
d'adaptation les plus élaborées que<br />
sur leurs dérèglements possibles et leurs limites<br />
essentielles. Ces contrastes, loin de les<br />
disqualifier, font leur intérêt. De même que<br />
la vie est à la fois exubérance et finitude, de<br />
même la société apparaît puissante et fragile<br />
à qui veut la connaître ou la transformer. Si<br />
l'imagination passe aujourd'hui pour un instrument<br />
de recherche, c'est précisément que<br />
sa souplesse lui permet de comprendre la coexistence<br />
<strong>des</strong> contraires. Il arrive aussi<br />
qu'elle se fige en devenant unilatérale. Elle<br />
bascule alors dans un vertige de l'unité<br />
qu'elle ne surmonte que par le sens de l'altérité.<br />
Ainsi l'imaginaire <strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong> ne<br />
saurait rester univoque. Sa fécondité tient à<br />
sa pluralité qui, en lui conférant ouverture et<br />
mobilité, le rend apte à saisir les différences,<br />
les paradoxes et les complexités liés à l'existence<br />
<strong>des</strong> groupes humains.<br />
Notes<br />
1 A. Bourdin, «La dictature <strong>du</strong> provisoire», Le<br />
Monde, 12 janvier 1987.<br />
2 P. Hintermeyer, « Le lien <strong>social</strong>, cet obscur objet<br />
de la sociologie», Actions et recherches <strong>social</strong>es,<br />
avril 1989.<br />
3 J.-J. Rousseau, Contrat <strong>social</strong>, 1766.<br />
4 E. Durkheim, De la division <strong>du</strong> travail <strong>social</strong>,<br />
F. Alcan, 1893.<br />
5 A. Comte, Discours sur l'esprit positif, 1844.<br />
6 C. Castoriadis, L'institution imaginaire de la<br />
société, Seuil, 1975.<br />
7 A. Touraine, Pro<strong>du</strong>ction de la société, Seuil,<br />
1973.<br />
8 M. Eliade, Le mythe de l'éternel retour,<br />
Gallimard, éd. augmentée, 1989.<br />
9 A J. Toynbee, A study of history, London, 1934-<br />
1954.<br />
10 M. Nordau, Dégénérescence, trad. fr. Alcan,<br />
1903.<br />
11 E. Zola, Carnets d'enquête, Pion 1986.<br />
12 P. de Lilienfeld, « La pathologie <strong>social</strong>e », <strong>Revue</strong><br />
internationale de sociologie, 1894.<br />
13 Id.<br />
14 E. Morin, «Cherchez l'irresponsable», Le<br />
Monde, 8 novembre 1992.<br />
15 J. Baudrillard, La transparence <strong>du</strong> mal, Galilée,<br />
1990.<br />
16 P. Chaunu, Histoire et décadence, Perrin, 1981.<br />
17 L. Pauwels, «Le monôme <strong>des</strong> zombis», Figaro<br />
Magazine, 6 décembre 1986.<br />
18 G. Bachelard, La formation de l'esprit scientifique,<br />
P.U.F. 1930.<br />
19 E.R. Mac Cormac, «Metaphor revisited»,<br />
Journal of aesthetics and art criticism, 1971.<br />
20 N. Elias, Qu 'est-ce que la sociologie, trad. fr.<br />
Pandore 1981.<br />
21 J. Freund, L'essence <strong>du</strong> politique, Syrey.<br />
22 P. Hintermeyer, Politiques de la mort, Payot,<br />
1981.<br />
197