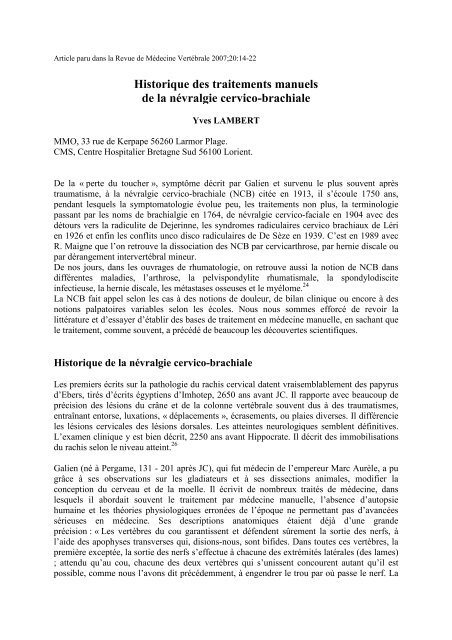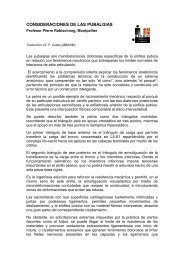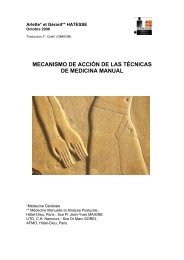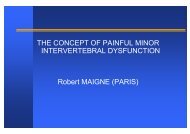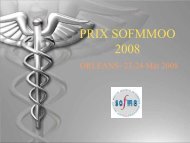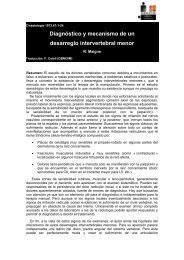NCB - sofmmoo
NCB - sofmmoo
NCB - sofmmoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Article paru dans la Revue de Médecine Vertébrale 2007;20:14-22<br />
Historique des traitements manuels<br />
de la névralgie cervico-brachiale<br />
Yves LAMBERT<br />
MMO, 33 rue de Kerpape 56260 Larmor Plage.<br />
CMS, Centre Hospitalier Bretagne Sud 56100 Lorient.<br />
De la « perte du toucher », symptôme décrit par Galien et survenu le plus souvent après<br />
traumatisme, à la névralgie cervico-brachiale (<strong>NCB</strong>) citée en 1913, il s’écoule 1750 ans,<br />
pendant lesquels la symptomatologie évolue peu, les traitements non plus, la terminologie<br />
passant par les noms de brachialgie en 1764, de névralgie cervico-faciale en 1904 avec des<br />
détours vers la radiculite de Dejerinne, les syndromes radiculaires cervico brachiaux de Léri<br />
en 1926 et enfin les conflits unco disco radiculaires de De Sèze en 1939. C’est en 1989 avec<br />
R. Maigne que l’on retrouve la dissociation des <strong>NCB</strong> par cervicarthrose, par hernie discale ou<br />
par dérangement intervertébral mineur.<br />
De nos jours, dans les ouvrages de rhumatologie, on retrouve aussi la notion de <strong>NCB</strong> dans<br />
différentes maladies, l’arthrose, la pelvispondylite rhumatismale, la spondylodiscite<br />
infectieuse, la hernie discale, les métastases osseuses et le myélome. 24<br />
La <strong>NCB</strong> fait appel selon les cas à des notions de douleur, de bilan clinique ou encore à des<br />
notions palpatoires variables selon les écoles. Nous nous sommes efforcé de revoir la<br />
littérature et d’essayer d’établir des bases de traitement en médecine manuelle, en sachant que<br />
le traitement, comme souvent, a précédé de beaucoup les découvertes scientifiques.<br />
Historique de la névralgie cervico-brachiale<br />
Les premiers écrits sur la pathologie du rachis cervical datent vraisemblablement des papyrus<br />
d’Ebers, tirés d’écrits égyptiens d’Imhotep, 2650 ans avant JC. Il rapporte avec beaucoup de<br />
précision des lésions du crâne et de la colonne vertébrale souvent dus à des traumatismes,<br />
entraînant entorse, luxations, « déplacements », écrasements, ou plaies diverses. Il différencie<br />
les lésions cervicales des lésions dorsales. Les atteintes neurologiques semblent définitives.<br />
L’examen clinique y est bien décrit, 2250 ans avant Hippocrate. Il décrit des immobilisations<br />
du rachis selon le niveau atteint. 26<br />
Galien (né à Pergame, 131 - 201 après JC), qui fut médecin de l’empereur Marc Aurèle, a pu<br />
grâce à ses observations sur les gladiateurs et à ses dissections animales, modifier la<br />
conception du cerveau et de la moelle. Il écrivit de nombreux traités de médecine, dans<br />
lesquels il abordait souvent le traitement par médecine manuelle, l’absence d’autopsie<br />
humaine et les théories physiologiques erronées de l’époque ne permettant pas d’avancées<br />
sérieuses en médecine. Ses descriptions anatomiques étaient déjà d’une grande<br />
précision : « Les vertèbres du cou garantissent et défendent sûrement la sortie des nerfs, à<br />
l’aide des apophyses transverses qui, disions-nous, sont bifides. Dans toutes ces vertèbres, la<br />
première exceptée, la sortie des nerfs s’effectue à chacune des extrémités latérales (des lames)<br />
; attendu qu’au cou, chacune des deux vertèbres qui s’unissent concourent autant qu’il est<br />
possible, comme nous l’avons dit précédemment, à engendrer le trou par où passe le nerf. La
nature a creusé une sorte de demi cercle ; mais elle s’est bien gardée de perforer la vertèbre<br />
elle-même, dans la crainte de les exposer, elles sont si minces, à une trop forte épreuve et de<br />
mettre leur extrême faiblesse en évidence. » 8 1750 ans plus tard, les idées sur le sujet n’ont<br />
pas beaucoup avancé.<br />
Pendant la Renaissance, des deux versions des ouvrages de Galien, l’une en Grec, l’autre en<br />
Arabe, ce sont finalement les médecins Arabes, parmi lesquels l’illustre Avicenne, qui vont<br />
réintroduire la médecine en Europe. Avicenne (980-1037), médecin et philosophe d’origine<br />
Iranienne, dans son « canon de la médecine » traduit par la suite en latin, évoquait l’origine<br />
nerveuse de la symptomatologie sciatique, mais n’identifiait pas le siège exact de la lésion ni<br />
l’origine du conflit. Il faudra attendre la Renaissance pour que l’ouverture des esprits et la<br />
possibilité d’effectuer des dissections permettent une avancée franche. Les artistes tels Michel<br />
Ange ou Léonard de Vinci participeront à cette évolution.<br />
Ce n’est que vers la fin du 15 ème siècle que l’anatomie sur le cadavre est officiellement<br />
autorisée par le pape Sixte IV (1471-1484) puis par Clément VII (1523-1534), « en 1477-<br />
1478, dix huit sous sont payés au bourreau pour avoir transporté un pendu au lieu<br />
d’anatomie ».<br />
Vésale décrivit en 1648 la structure anatomique du disque intervertébral et Domenico<br />
Cotugno, Napolitain, décrivit la névralgie sciatique en 1764, dans « De ischiade nervosa<br />
commentarius ». 30 Il fut le premier à séparer la sciatique des maladies articulaires des<br />
membres inférieurs et à la rapprocher des brachialgies, en particulier de la souffrance du nerf<br />
cubital. Il proposait une pathogénie mettant en cause les racines et le liquide cérébro-spinal<br />
qu’il venait de découvrir et qui, hypertendu, viendrait irriter la racine.<br />
En 1867 les dénervations périphériques furent très précisément étudiées par Duchenne de<br />
Boulogne 4 mais aucune ne fait allusion à une origine cervicale possible (fig. 1). Par ailleurs, la<br />
pathologie discale a été décrite à plusieurs reprises, en 1857 par Virchow, en 1896 par<br />
Kocher, en 1911 par Middleton et Teacher, en 1922 par Adson. Entre 1925 et 1931, Schmorl<br />
décrivit les diverses altérations discales.<br />
Fig 1 : Paralysie périphérique des muscles fléchisseurs de l’avant bras (nf médian) et du muscle triceps (nf<br />
radial), avec conservation du muscle long supinateur (nf radial) étudiée par Duchenne de Boulogne.
André Léri en 1926 relate plusieurs observations de « douleurs dans le cou et dans la région<br />
scapulaire, associées à une atrophie très prononcée de tout le membre supérieur », décrit<br />
l’hypoesthésie, l’abolition du réflexe radial et parfois du cubito-pronateur, et l’atteinte qui est<br />
sensitive et motrice. Il note que tous les muscles atteints sont excitables par le courant<br />
galvanique et faradique, que l’examen du LCR ne montre pas d’anomalie, note parfois la<br />
diminution de hauteur du disque intervertébral qui paraît écrasé, il parle bien de « syndromes<br />
radiculaires cervico-brachiaux ». La syphilis ne paraît pas en cause et il adopte la<br />
dénomination de « radiculite » du Pr Déjérine concernant cette pathologie, mais apporte une<br />
précision lorsqu’il parle de radiculite intravertébrale, transvertébrale ou extravertébrale. Il<br />
conclue en pensant que « Ce syndrome est sans doute dû à la compression ou à<br />
l’inflammation des racines cervicales dans leur portion extra méningée et dans le traversée du<br />
trou de conjugaison, sous l’influence de l’ostéo-arthropathie vertébrale rhumatismale », et<br />
parle de radiculite transvertébrale ou transversaire. 14<br />
G. Mauric en 1933 décrivit le disque intervertébral dans un ouvrage complet. 21 Il y reprenait<br />
de nombreuses descriptions cliniques, chirurgicales et histologiques de « nodules fibrocartilagineux<br />
et de chondromes du disque ». Il pensait qu’Andrae et Schmorl avaient<br />
« observé les premiers stades de l’énucléation postérieure du disque ». Il faisait état d’un<br />
grand nombre d’observations, toutes ayant pour site le rachis lombaire sauf trois, une<br />
observation d’un cas rapporté par Stookey avec paresthésie radiale exagérée par la toux et<br />
l’éternuement et ablation chirurgicale d’un « petit chondrome qui ne comprimait que la<br />
racine », un autre cas du même auteur en 1928, avec parésie du membre supérieur gauche, et<br />
ablation d’un petit chondrome antérieur et latéral gauche au niveau de C5-C6 et enfin une<br />
autre observation d’Elsberg en 1931 avec atrophie des muscles de la main due à un<br />
chondrome solidement fixé à la face postérieure du corps des vertèbres C5-C6.<br />
L’histologie, souvent après chirurgie ou décès, faisait état de fibrocartilage ou de tissu<br />
cartilagineux formant parfois un prolongement du disque intervertébral, et Mauric parle<br />
franchement de compression par le disque, mais la découverte de la hernie discale sera<br />
attribuée en 1934, à Barr et Mixter qui décrivirent la hernie discale, en faisant le lien entre les<br />
lésions de Schmorl, la compression radiculaire et la rupture des disques intervertébraux. 24 Les<br />
patients étant améliorés par une intervention chirurgicale, ils pensèrent avoir trouvé<br />
l’explication à toutes les sciatiques. Ceci peut s’appliquer au rachis cervical.<br />
En 1939, S. de Sèze étudia et précisa cette pathologie qu’il exposa avec D. Petit-Dutaillis en<br />
1945. Il introduisit le terme de « conflit disco-radiculaire » au niveau lombaire et de conflit<br />
unco-disco-radiculaire au niveau cervical. 6 Il aborda le traitement orthopédique et chirurgical,<br />
préconisant le repos voire le « sur-repos », associé aux thérapeutiques antalgiques habituelles.<br />
Il mettait en garde contre les manœuvres brusques, qui pouvaient avoir des conséquences<br />
dangereuses.<br />
Le traitement manuel de la <strong>NCB</strong> en Chine<br />
Comme souvent, le traitement a précédé la découverte scientifique, souvent avec bonheur. En<br />
chine, vers 500 av J-C, du premier ouvrage de médecine chinoise le Nei Jing, il ne restait que<br />
des morceaux écrits sur carapace de tortue. Il portait sur les connaissances médicales<br />
fondamentales. Le Wai Jing lui a fait suite, portant sur les connaissances techniques. Les<br />
ouvrages qui viendront ensuite décrivaient l’art du massage, révèlant l’existence de Médecins<br />
masseurs, à côté des herboristes et des acupuncteurs. Le massage et la gymnastique étaient<br />
prescrits pour « favoriser l’harmonie entre les facultés intellectuelles et les différentes parties
du corps afin que l’âme ait un serviteur puissant et fidèle ». Le Dr Yang Jwing-Ming dans son<br />
ouvrage « Massage Chi-kung » 31 nous révèle ceci : « Durant la période printemps et automne<br />
(722-481 avant J-C), le Nei Jing, nous livre en détail des méthodes de traitement des<br />
traumatismes externes, ainsi que l’utilisation thérapeutique des plantes. Le massage y figure<br />
comme la part la plus importante du traitement. Durant la dynastie des Han (206 avant J-C,<br />
221 après J-C), le Dr Hua Tuo utilisait l’acupuncture, les plantes et les thérapies manuelles,<br />
c'est-à-dire les techniques de massage et de réalignement des os cassés et disloqués. Il fut le<br />
premier médecin connu à valoriser la combinaison de l’acupuncture et du massage. »<br />
« Tous les médecins traditionnels étaient formés au traitement des traumatismes. En effet,<br />
sous la dynastie des Song (960-1126 après J-C), une partie de l’enseignement médical que<br />
recevaient les futurs médecins concernait le réalignement des os. Cette discipline avait pour<br />
nom zheng gu ke ou système d’alignement des os. En Chine du Sud, à Taiwan et dans la<br />
province de Fu Jian, le massage Tui Na est communément appelé Cao Jie, ce qui signifie<br />
manipuler pour connecter. Tout ceci montre la difficulté que l’on peut avoir à déterminer avec<br />
précision quel terme se rapporte à quoi, et la multitude des techniques de massage qu’il<br />
englobe. » Le diagnostic est porté après l’étude du pouls, et par l’interrogatoire, le craquement<br />
articulaire ou vertébral fait partie du massage de tout temps, il est global et imprécis mais<br />
garde une fonction de libération.<br />
Le traitement manuel de la <strong>NCB</strong> dans l’antiquité<br />
A la même époque, 4 à 500 ans avant J-C, Hérodicos de Sélymbrie, maître d’Hippocrate,<br />
enseignait des techniques de massage et de mouvements de gymnastique dans les palestres,<br />
sorte de collèges municipaux. Puis vers 400 avant J-C, Hippocrate (460-317 av J-C), le « père<br />
de la Médecine », fut le plus grand médecin de l’antiquité. Avec les moyens de l’époque, il<br />
jeta les bases d’une médecine réfléchie, faite d’observation, qu’il va enseigner et reporter dans<br />
un ouvrage « l’art de guérir ». Ses notions anatomiques étaient réduites à quelques os. Quant<br />
aux traitements, ils se limitaient à la saignée dans les maladies aiguës et fortement<br />
inflammatoires, les purgatifs et vomitifs dans certains autres cas, en particulier vers la fin des<br />
maladies, ou à la respiration de certaines odeurs fétides ou aromatiques. Cependant, il décrivit<br />
18 sortes de massages. Il traita du déplacement des vertèbres en arrière. L’appareil qu’il<br />
employait pour y remédier était un appareil d’extension et de contre extension, combinées<br />
avec la pression sur la vertèbre déplacée, pression que l’on opérait soit avec la main, soit avec<br />
le talon, soit avec une planche. « Quand au déplacement des vertèbres en avant, non<br />
seulement il est plus grave en soi que le déplacement en arrière, mais encore la réduction est<br />
fort chanceuse, attendu que l’on n’a à sa disposition que l’extension, sans pouvoir y joindre<br />
une pression sur la vertèbre déplacée. » (fig. 2). Il écrivit par ailleurs : « Lorsque en tombant,<br />
ou par l’effet de la chute d’un corps pesant, on éprouve une déviation du rachis en avant,<br />
généralement aucune vertèbre ne se déplace beaucoup (un grand déplacement d’une ou de<br />
plusieurs cause la mort), mais, comme il a été dit auparavant dans ce cas aussi, le déplacement<br />
est réparti sur la courbure, et non angulaire. Chez les blessés, l’urine et les selles se<br />
suppriment plus souvent, les pieds et les membres inférieurs en entier sont plus refroidis, et la<br />
mort est plus fréquente que chez ceux qui ont une déviation en arrière ; et, s’ils échappent, ils<br />
sont plus exposés à l’incontinence d’urine et ont des membres inférieurs plus frappés<br />
d’impuissance et de stupeur. » Il s’efforça de découvrir et de décrire des traitements<br />
orthopédiques de traumatologie du squelette, qu’il s’agisse de fractures et de luxations (fig.<br />
3).
Fig. 2 : bas relief du IV ème ou du V ème siècle avant J-C, montrant la manipulation de vertèbres cervicales telle que<br />
la pratiquait Hippocrate, à côté du praticien se trouve Esculape, Dieu de la médecine, et en dessous l’inscription<br />
[AN] EOHKE ASKAHII « offert à Esculape ».<br />
Fig. 3 : Machine pour réduction des luxations d’épaule imaginée par Hippocrate.<br />
Galien lui aussi pratiquait la médecine manuelle. Il raconte l’histoire d’un de ses patients, un<br />
Syrien nommé Pausanias, dont il reprend l’observation : « Le malade se plaignait que,<br />
pendant trente jours au moins, les sensations du toucher avaient été perdues dans les trois<br />
derniers doigts, bien que ceux-ci aient gardé leur habileté motrice normale. Il expliqua les<br />
symptômes précédant son état de paralysie. Il n’avait jamais eu d’inflammation, ni de<br />
refroidissement, ni de blessures d’aucune sorte. La perte des sensations était venue<br />
progressivement. Je lui demandai s’il n’avait pas été blessé à un endroit quelconque dans les
parties plus hautes. Il me répondit qu’il n’avait jamais eu aucune blessure à la main, mais<br />
qu’il avait été blessé dans la région de l’épine dorsale, en étant renversé de son char, pendant<br />
qu’il allait à Rome. Sachant par l’anatomie que les nerfs émergent du même endroit que les<br />
veines et que chaque paire de nerfs suit le même chemin que les veines, je conclus que la<br />
première paire de nerfs, après la septième cervicale était affectée. La blessure avait causé une<br />
inflammation locale et une diathèse sciorrhotique des parties adjacentes, et les nerfs ayant leur<br />
origine dans les méninges vont directement aux derniers petits doigts et atteignent la peau qui<br />
couvre ces doigts. Le fait qui semblait le plus étonnant aux médecins était que seulement la<br />
moitié du doigt du milieu était affectée, mais c’est cette particularité qui m’aida à faire mon<br />
diagnostic. La partie du nerf affecté allait jusqu’au poignet ainsi que les petits nerfs des<br />
doigts, nommés ci-dessus. Cependant j’ordonnai au malade d’enlever son cataplasme<br />
appliqué à cet endroit et je traitai la partie du rachis qui était à l’origine de la cause des<br />
douleurs des doigts. Ainsi arriva le résultat merveilleux et extraordinaire que les doigts<br />
douloureux furent guéris par l’application d’un traitement du rachis.»<br />
Le traitement manuel de la <strong>NCB</strong> en France<br />
Les rebouteux<br />
En France, le destin de la chirurgie et celui de la médecine manuelle fut souvent confronté aux<br />
même sort et aux mêmes interdits, l’une parce qu’elle verse le sang, l’autre parce qu’elle<br />
utilise le toucher. Entre le Moyen Age et le 17 ème siècle sévit la période très religieuse de<br />
l’Inquisition, où toute parole et tout geste malencontreux pouvaient être interprétés comme de<br />
la magie ou d’inspiration satanique et mener au bûcher. L’Inquisition ne fut interdite qu’en<br />
1808 par Napoléon 1 er . A la suite de cette période, les chirurgiens n’ont pas retrouvé la place<br />
qu’ils avaient acquis avec Ambroise Paré, et la médecine n’a pas encore évolué. Ainsi dans<br />
les campagnes, ce sont les rebouteux qui sont les premiers consultés pour remettre à sa place<br />
ou dans le bon sens, un os, une vertèbre, un muscle, un tendon ou encore un autre organe,<br />
qu’il soit cassé, luxé ou simplement déplacé. On les appelle rebouteux car ils remettent bout à<br />
bout les os ou les articulations cassées ou luxées. Ici ou là on les appelle aussi rhabilleurs (fig.<br />
4). Ils sont consultés autant pour les problèmes de leurs congénères que pour ceux des<br />
animaux ; sans doute même un animal représente beaucoup plus, puisqu’il vaut une certaine<br />
somme, alors que la vie d’un paysan ne vaut pas grand chose.<br />
Fig 3 : rebouteux du Morbihan (Bretagne) en train de « remettre en place »<br />
une vertèbre.
Robert Maigne en parle lui-même presque avec reconnaissance : « Ceux que j’ai vu avaient<br />
apparemment un certain bon sens et un certain flair pour éviter les cas à risque. Comme vous<br />
le savez c’est loin d’être général. Les pratiques sont très diverses, certains sur de faux<br />
diagnostics font avec habileté des gestes parfois utiles, comme celui qui me montrait une<br />
entorse tibio-tarsienne où il prétendait que le péroné était déplacé de deux centimètres en<br />
arrière! Mais sa manoeuvre ultrarapide soulageait visiblement le sujet... d’autres font des<br />
mouvements qui s’apparentent avec un registre évidemment limité à certaines techniques<br />
manipulatives ou à des gestes orthopédiques, d’autres, apparemment plus rares, emploient des<br />
manoeuvres non traumatisantes portant sur les muscles ou les tendons. Certains font ainsi<br />
avec le pouce des frictions lentes, et peu répétées sur les muscles fessiers, les ischio-jambiers<br />
et les muscles du mollet, pour des sciatiques, ou des étirements bref des muscles para<br />
vertébraux pour des douleurs cervicales ou lombaires. Nous avons d’autres moyens de faire<br />
aussi bien et même mieux, mais cela amène à réfléchir sur le mécanisme de certaines de ces<br />
douleurs vertébrales courantes.» « De père en fils les secrets du reboutage se sont transmis,<br />
mais tellement enrobés de pratiques mystérieuses que l’exécutant ne sait plus discerner dans<br />
ce qu’il fait, l’acte utile. A vrai dire les rebouteux de tradition ne font pas de manipulations,<br />
au sens où nous l’entendons dans ce livre ; ils font des frictions, des pressions sur les muscles<br />
ou les tendons. Ces procédés curieux sont parfois d’une remarquable efficacité. On trouve<br />
dans les vieux traités certaines manœuvres qui ressemblent d’assez près à nos manipulations.<br />
Mais leur première utilisation systématique date des environs de 1840, où certains élèves de<br />
Ling, en Suède, poussant jusqu’au bout l’étude du mouvement analytique, étaient arrivés à<br />
pratiquer quelques mobilisations forcées du rachis. La manœuvre en Y de Tissié, par exemple,<br />
est une manipulation qui permet d’obtenir chez certains sujets un déblocage costo-vertébral<br />
donnant instantanément un gain de plusieurs centimètres d’ampliation thoracique.».<br />
Le Dr Pécunia lui aussi décrit cette profession : « jeune médecin, j’ai eu la chance d’exercer<br />
dans le périmètre d’un rebouteux célèbre. Célèbre à juste titre, il faut bien l’avouer car il<br />
reboutait si bien les entorses, foulures et traumatismes bénins, que les malades s’adressaient<br />
presque uniquement à lui pour ces sortes de lésions… et me le disaient. Après avoir vu courir<br />
le jour même plusieurs entorses sérieuses que j’avais « arrêtées » le jour même pour quinze<br />
jours, je suis allé lui rendre visite. N’attendez pas de description de l’homme ni de son antre.<br />
Sachez seulement qu’il m’appris que le corps humain est symétrique. Cet homme connaissait<br />
(il est mort maintenant) d’anatomie tout ce que le palper peut en laisser connaître. C’est<br />
énorme. Et il ignorait le nom de la styloïde radiale ou d’une malléole, il en connaissait bien le<br />
relief et le creux des vallées qui les entourent et c’est par comparaison palpatoire qu’il<br />
établissait ses diagnostics. Pour le traitement c’était d’un empirisme particulièrement simple :<br />
il forçait là ou les articulations jouxtant le segment intéressé jusqu’à ce qu’il puisse rétablir la<br />
symétrie. Ainsi ne faut-il pas s’étonner si une fois, une fois seulement à ma connaissance, il a<br />
fracturé un humérus en réduisant une luxation de l’épaule. La plupart du temps il rétablissait<br />
la symétrie et il rétablissait du même coup la fonction ». 20<br />
Ainsi, l’histoire des rebouteux a la vie dure. Tout l’esprit de la rebouterie se retrouve dans le<br />
parcours et le travail de Moneyron, qui de pharmacien devint rebouteux, puis entreprit ses<br />
études de kinésithérapeute.<br />
Ce n’est qu’au 19 ème siècle, avec les écrits de Claude Bernard, père de la médecine moderne,<br />
et les découvertes de Louis Pasteur, que la médecine scientifique va progressivement prendre<br />
le pas sur la rebouterie. Ils instaurent les règles de la médecine expérimentale ayant pour base<br />
la physiologie. Magendie avait coutume de dire : « j’ai des yeux, je n’ai pas d’oreilles » ; il<br />
disait aussi : « si nous chassions les médecins de l’Hôtel-Dieu, la mortalité serait peut-être<br />
moindre. »
Naissance des traitements manuels<br />
Le Dr Still, en 1870, insistait sur le fait que « les liquides étaient en perpétuel mouvement<br />
dans le corps, que leur mouvement était la condition sine qua non de notre existence et que les<br />
structures dures du corps pouvaient, à la suite d’un choc, venir gêner cet écoulement. La<br />
thérapeutique, pour Still, se devra donc de remettre à sa place, à la main, ce qui gêne, ce qui a<br />
été déplacé.» Il n’y a pas de descriptions précises de techniques dans ses écrits. Il invente la<br />
notion de lésion ostéopathique, comme un « déplacement plus ou moins marqué, souvent<br />
minime d’une vertèbre ». En 1895, Palmer se démarque en inventant sa propre interprétation<br />
et créé la chiropraxie.<br />
En 1904, Le Dr De Frumerie traite de la névralgie cervico-faciale. Le traitement repose sur<br />
des massages, sa spécialité, et peut se terminer par une « circumduction prudente et torsion de<br />
la tête ». 5 En 1913, le Dr L. Moutin expose dans son ouvrage, les éléments qu’il a tirés de<br />
l’école d’ostéopathie de Still qu’il a suivie. 25 Il écrit son manuel à l’usage des étudiants, avant<br />
de disparaître. Il décrit le traitement du torticolis : « Appliquez la main sur le muscle sternocléido-mastoïdien,<br />
au point d’intersection des nerfs crâniens de la onzième paire. Tournez le<br />
cou aussi loin que possible de chaque côté. Tendez le cou en l’inclinant et pliez brusquement<br />
la tête dans le même sens. Ce traitement guérira les cas relativement récents. Dans les cas très<br />
anciens, il n’y a pas grand-chose à faire». Il agrémente son ouvrage de planches décrivant des<br />
manœuvres provenant directement de l’école de Kirksville, certaines portant sur le cou, le<br />
relâchement des muscles du cou, l’extension du cou, et la réduction de la déviation latérale<br />
d’une vertèbre cervicale (fig. 5) : « Le patient est couché sur le dos. Déterminez<br />
soigneusement et exactement le glissement. Les muscles et les ligaments du cou doivent être<br />
complètement relâchés, par une série de manipulations. Courbez la tête fortement du côté vers<br />
lequel le glissement s’est produit. Avec le bout des doigts de la main placée de l’autre côté du<br />
cou, pressez fermement sur les apophyses transverses des deux vertèbres situées juste au<br />
dessus de la vertèbre considérée, si possible. Ce procédé relâche les ligaments du côté opposé<br />
à la déviation et resserre ceux de l’autre côté. Pendant que la tête est ainsi fortement inclinée,<br />
faites-la tourner doucement jusqu’à ce que la tension soit suffisamment prononcée. En<br />
imprimant alors subitement une torsion supplémentaire de peut-être 1 ou 2 degrés, la vertèbre<br />
glissera à sa place. ».<br />
Fig 5 : Manipulations cervicales de L Moutin en 1913, étudiées à l’école d’ostéopathie du Dr Still à Kirksville.<br />
En 1913 également, le Dr L. Colombani dans son ouvrage « techniques de massage » parle de<br />
la névralgie cervico-brachiale qui « peut être radiale, cubitale, musculo-cutanée ou médiane.
Elle donne lieu à des élancements, depuis l’extrémité supérieure du membre jusqu’à<br />
l’extrémité inférieure. » Le traitement qu’il décrit repose sur les massages du bras, pétrissage,<br />
percussion et par des pressions et des percussions du nerf affecté, qui sont efficaces en peu de<br />
temps sur les atrophies. Il ne parle pas du cou dans ce chapitre, le torticolis est traité dans un<br />
autre chapitre, lui aussi par massage. 2<br />
En 1949, le Dr Albert Leprince nous enseigne la manœuvre cervicale décrite précédemment<br />
par Moutin : « Le médius gauche est appliqué sur l’apophyse transverse de la vertèbre à<br />
réajuster, tandis que le menton et la joue du malade reposent dans la main droite. Lorsque le<br />
relâchement musculaire est obtenu, un brusque mouvement remet en place la vertèbre. Cette<br />
manœuvre est indiquée dans les subluxations cervicales, qu’on rencontre dans la névralgie ou<br />
la névrite cervico-faciale ». Par ailleurs il nous décrit le recoil, technique purement<br />
chiropractique utilisée par Palmer, le créateur de la chiropraxie (fig. 6). 15 C’est la première<br />
description de cette technique en France. Signalons que la technique décrite s’accompagne<br />
d’un thrust, alors que plus tard le recoil sera une manœuvre de rebond.<br />
Fig 6 : Le « recoil » du Dr Palmer<br />
Ni en 1949 ni en 1964, dans la 1 ère et la 3 ème édition de son ouvrage, le Dr Robert Lavezzari<br />
n’aborde la <strong>NCB</strong>. 12,13 Lorsqu’il aborde le rachis cervical, les lésions touchant l’atlas et l’axis<br />
sont prépondérantes sur ce sujet, et lorsqu’il aborde les hernies discales, seules les formes<br />
lombaires sont l’objet de ses écrits. La <strong>NCB</strong> ne semble pas exister pour lui.<br />
Les auteurs modernes<br />
Dès 1960, où il dit que les manipulations sont rarement indiquées dans les <strong>NCB</strong>, 18 puis en<br />
1984, 19 Robert Maigne avant tout traitement nous demande de prendre en considération ses
critères de manipulation dans le sens de la « non douleur et du mouvement contraire ». Il<br />
propose de façon schématique « une manipulation en flexion, puis une manœuvre en rotation<br />
du côté opposé à l’algie avec flexion et légère latéro-flexion sur le sujet couché sur le dos, et<br />
enfin une manœuvre en latéro-flexion-rotation, manoeuvre essentielle de la névralgie cervicobrachiale<br />
». En 1989, il différencie la <strong>NCB</strong> par cervicarthrose, par hernie discale et par DIM<br />
et des formes aiguës avec douleur intense et des formes moyennes. 20 Les manipulations, dans<br />
certains cas, peuvent apporter un soulagement rapide au patient. Elles ne sont généralement<br />
pas utilisables en aigu, la règle de la non douleur et du mouvement contraire étant<br />
inapplicable. Leur indication la meilleure est la forme subaiguë. Les tractions ont leurs<br />
indications, ainsi que les manipulations sous traction, mais toute manœuvre doit faire<br />
référence au schéma de Maigne et Lesage». Dans ses trois ouvrages, il préconise de une à<br />
trois manipulations dans le cas d’une amélioration même légère.<br />
Fig 7 : Olivier Troisier, traction cervicale dans la hernie discale en 1962.<br />
O. Troisier, dans son ouvrage de 1962, 28 aborda le traitement de la névralgie cervicobrachiale<br />
: « la tentation logique serait de réduire la hernie discale et de supprimer ainsi la<br />
cause de la douleur ; cependant la réduction peut être difficile. Si les manipulations<br />
vertébrales n’en viennent pas à bout après trois ou quatre essais, mieux vaut abandonner. »<br />
(fig. 7) Il préconisait les tractions « en cas de très forte douleur et de compression très forte<br />
avec parésies », en association avec des anti-inflammatoires, et pensait que les tractions<br />
étaient inutiles si l’apparition des paresthésies avaient été de pair avec une diminution de la
douleur. En cas de compression occasionnelle, partielle ou modeste, la nécessité de<br />
manipulation vertébrale était impérieuse. Dans son ouvrage de 1973, les indications sont plus<br />
nuancées. 29 « En cas de cervicalgie avec attitude vicieuse, la manipulations sera effectuée<br />
sous forte traction … S’il existe une hyperalgie, la manipulation est généralement<br />
inefficace… Lorsque la douleur brachiale a disparu, en cas de douleur scapulaire, la<br />
manipulation est peu efficace, alors qu’en cas de douleur cervicale, elle peut l’être. »<br />
On trouve les mêmes manoeuvres de manipulations chez J. Cyriax, et pour cause, Troisier<br />
avait été son élève, mais le livre de Cyriax fut postérieur. 3 En matière de manipulations<br />
cervicales pour lésions discales, il associait une forte traction axiale en se faisant aider de<br />
deux voire trois aides (fig. 8). Il décrivit deux contre indications formelles, l’atteinte<br />
pyramidale évidente et l’insuffisance vertébro-basilaire.<br />
Fig 8 : James CYRIAX : Manipulation cervicale pour hernie discale en 1976.<br />
Tous les auteurs sont d’accord pour privilégier la position de décubitus. Celle-ci a l’avantage<br />
de mettre au repos les muscles agonistes et antagonistes du rachis. On en connaît<br />
l’importance. 4<br />
En 1994, on cherche toujours une explication à l’action des manipulations sur le disque<br />
intervertébral et sur la pression intra-discale. J.Y. Maigne publie que « les manipulations ont<br />
une action brève sur la pression intra discale. Nous l’avons montré au niveau lombaire avec<br />
des capteurs de pression insérés dans les disques. On observe de façon concomitante une<br />
élévation puis une nette baisse de pression intra-discale de courte durée. Ces brusques<br />
variations pourraient bien avoir un effet thérapeutique ». 17 Une interrogation se pose pour<br />
l’action des manipulations sur les articulaires postérieures et l’effet prédominant de leur<br />
écartement, de la rotation lombaire ou de l’impulsion manipulative. Cependant il a été montré<br />
que l’étirement brusque des capsules articulaires postérieures avait aussi un effet inhibiteur<br />
sur la contracture musculaire para vertébrale. 10
Complications du traitement manuel<br />
Les complications sont rares. Il peut s’agir de réaction hyperalgique, d’exclusion de la hernie<br />
avec possibilité de névrite paralysante ou plus grave encore, d’un syndrome médullaire ou<br />
vertébro-basilaire. En matière de manipulations du rachis cervical il convient d’être<br />
extrêmement prudent, après bilan radiographique, pratiquées par des mains expertes, en<br />
sachant qu’il vaut mieux s’abstenir que de prendre le moindre risque.<br />
En matière de sciatique, on a décrit de très rares cas de complication sur pathologie maligne<br />
ou de paraplégie sur os porotique, mais pour Tamalet « les études concernant les<br />
manipulations vertébrales sur hernie discale prouvée ne font pratiquement jamais état de<br />
complication ». 27 Cela ne peut s’appliquer pour la <strong>NCB</strong> qui peut être l’objet de réactions<br />
hyperalgiques, d’aggravation de l’état clinique ou de syndrome de Wallenberg.<br />
Discussion<br />
Lorsqu’on reprend l’enquête de G. Berlinson en 2004 sur les sciatiques discales, on constate<br />
une absence totale de consensus au niveau lombaire, et on peut imaginer encore pire au<br />
niveau cervical. Avant toute chose, en matière de rachis cervical, il est établi (selon les<br />
recommandations de la SOFMMOO) que toute manipulation, voire traction, ne pourra<br />
s’effectuer avant la réalisation d’un bilan radiographique du rachis cervical (fig. 9). Par<br />
ailleurs le traitement de la <strong>NCB</strong> par médecine manuelle doit répondre à certaines règles. Il est<br />
possible et même recommandé de pratiquer un réchauffement, des massages, des manœuvres<br />
de détente, des étirements, directs ou par techniques myotensives voire des techniques<br />
d’ostéopathie fonctionnelle dans toute pathologie responsable de <strong>NCB</strong>. Cependant, il n’en<br />
sera pas de même en matière de manipulations vertébrales. On en limitera la réalisation à<br />
certaines indications bien précises et en des mains expertes. Il faudra s’efforcer de faire la part<br />
des choses entre une contracture, une cervicarthrose, une hernie discale, une malformation et<br />
un dérangement.<br />
Fig 10 : Radiographie cervicale d’un confrère venu consulter pour manipulation cervicale, pathologie méconnue<br />
jusqu’alors.
La cervicarthrose est visible sur les radiographies, les douleurs évoluent par poussées, elle est<br />
généralement sensible aux traitements médicamenteux, elle est majorée au lever et impose un<br />
dérouillage matinal. Elle est précisée par le scanner. Elle peut faire l’objet de manipulations.<br />
La <strong>NCB</strong> par hernie discale survient en général après traumatisme ou effort, l’attitude<br />
antalgique est souvent irréductible, les radiographies peuvent montrer une discopathie ou un<br />
bâillement, la confirmation se fait par scanner ou IRM. Pour certains, les indications de<br />
manipulations dans la <strong>NCB</strong> par hernie discale pourraient se limiter aux patients<br />
hyperalgiques, pour lesquels il est licite de tenter quelque chose étant donné l’importance de<br />
la douleur avec quelque chance d’amélioration, ou chez des patients qui ont programmé leur<br />
intervention, pour lesquels on ne risque guère d’aggravation et chez qui au pire cela ne<br />
changerait pas grand chose, avec une indication chirurgicale déjà posée. Pour d’autres, elles<br />
auraient les meilleures chances de succès à la phase de décroissance des douleurs. 18,28 Il<br />
semble logique pour ces auteurs, de proposer de une à trois manipulations dans la <strong>NCB</strong>.<br />
Les <strong>NCB</strong> par dérangement et par contractures se différencient par une douleur élective<br />
segmentaire, un point paravertébral cervical postérieur, et en général une douleur projetée<br />
avec cellulomyalgie. N’ayant pas toujours d’IRM, loin s’en faut, on gardera toujours à l’esprit<br />
cette éventualité de hernie discale.<br />
Si l’indication d’une manipulation est posée, après un travail des tissus mous, elle peut être<br />
effectuée ici selon les critères de l’examen segmentaire et de la non douleur en latéro flexion<br />
modérée et rotation très limitée, afin d’en limiter les amplitudes, si possible en maintenant la<br />
traction, ailleurs on propose une mise en traction progressive en latéroflexion du côté opposé<br />
à la <strong>NCB</strong>. De manière à ouvrir le foramen pour ne pas pincer la hernie, certains proposent une<br />
accentuation progressive de la latéro-flexion durant 90 secondes, d’autres une manipulation<br />
en latéro-flexion pure.<br />
Quant à la rotation, elle a été évaluée à 150° par plusieurs auteurs, au total et pour l’ensemble<br />
du rachis cervical, soit environ 15° par étage environ en sachant que la rotation de C1-C2 est<br />
de 45°. Cette rotation n’a pas de frein, n’ayant pas d’articulaires postérieures verticales et<br />
sagittales constituant une butée comme pour les vertèbres lombaires, le mouvement de<br />
rotation n’est stoppé que par les structures ligamentaires et capsulaires. D’autre part, pour Roy<br />
Camille « la fixation manuelle d’un niveau est illusoire, chaque mouvement est effectué par<br />
l’ensemble du rachis cervical », 28 et enfin une mise en rotation des structures ligamentaires ne<br />
peut que diminuer la hauteur du disque (fig. 10). Par conséquent, les techniques en rotation<br />
complète resteront proscrites du moins en ce qui concerne les <strong>NCB</strong> par hernie discale et<br />
discutables en cas de cervicarthrose.<br />
Fig. 10
Par ailleurs, on propose aussi systématiquement que possible, et l’on rejoint là le Dr Robert<br />
Maigne, 18,19,20 de libérer le segment dorsal haut, de T3 à T5, en pratiquant un déroulé en<br />
position de vrille (fig. 11), ce qui n’expose à aucune complication, et contribuera à détendre la<br />
musculature cervico-dorsale postérieure de manière importante, que Robert Maigne met sur le<br />
compte du traitement d’une « sympathalgie » plus que d’une <strong>NCB</strong>, à ne pas confondre avec<br />
l’algie inter-scapulaire d’origine cervicale du même auteur. 18,20 Cette manœuvre est même<br />
souvent en ce qui nous concerne la seule manipulation possible dans de nombreux cas. Elle a<br />
une efficacité sur la douleur, et assure une détente musculaire, qui permet alors une<br />
mobilisation voir une manipulation. Pour nous, cette manipulation est le plus souvent réalisée<br />
d’emblée et ne rencontre que très rarement de contre indication. On peut la comparer au<br />
déroulé dorsal de la jonction thoraco-lombaire dans la sciatique discale lombaire.<br />
Fig 11 : manipulation en déroulé des dorsales supérieures<br />
Conclusion<br />
Etre en présence d’une <strong>NCB</strong> typique reste un cas de conscience pour la médecine manuelle,<br />
certains considérant qu’il s’agit là d’une contre-indication absolue à toute manipulation. Il est<br />
temps de démystifier la hernie discale, d’autant que les chirurgiens sont de plus en plus<br />
passifs devant cette affection, mais aucun consensus ne reprend de façon simple et<br />
synthétique les règles qui permettent de manipuler une hernie discale avec un minimum de<br />
risque. C’est ce que nous avons tenté de faire, en faisant référence aux plus grands auteurs en<br />
la matière. Les maîtres de la Médecine Manuelle Ostéopathie savaient cultiver la discrétion,<br />
on sait pourquoi. Certaines règles sont à respecter, et nous tentons ici de poser les éléments de<br />
base à la réflexion en sachant que cela est possible et peut donner d’excellents résultats que<br />
l’on retrouve cités ici ou là dans la littérature.<br />
Bibliographie<br />
1. Boigey M. Manuel de massage. Masson 4 ème édition 1965.<br />
2. Colombani L. Le massage théorique et pratique. La méthode indirecte. E Amédée Legrand 1913.<br />
3. Cyriax J. Manuel de médecine orthopédique, manipulations, massages et injections. Masson 1976.<br />
4. Duchenne (de Boulogne) G.B. Physiologie des mouvements démontrée à l’aide de l’expérimentation électrique et de l’observation<br />
clinique et applicable à l’étude des paralysies et des déformations. J.B.Baillière et fils, Paris 1867.<br />
5. De Frumerie M. Le massage pour tous, indications et technique du massage général. Vigot frères, 1917.<br />
6. De Sèze S.- La sciatique banale et le disque lombo-sacré. Rev Rhum 1939;10:986.<br />
7. Fryette H. H. - Principles of osteopathic technic. Frison Roche, 1978, 1983.<br />
8. Galien. Utilité des parties du corps. Livre treizième : De la structure du rachis. Oeuvres anatomiques, physiologiques et médicales de<br />
Galien / vol. 2. Paris : J.-B. Baillière édition de Charles Daremberg.
9. Hoffa A. Technique du massage. Payot Paris, 1930.<br />
10. Indahl A. Kaigle A. Reikeras O.et al. Interaction between the porcine lumbar intervertebral disc, zygapophysial joints and paraspinal<br />
muscles. Spine, 1997;22:2834-40.<br />
11. Lambert Y. La dorsalgie haute, une traumatologie aiguë chez le navigateur dans le défi français pour la coupe América (1999 – 2000). J<br />
Traumato Sport 2000;17:29-32.<br />
12. Lavezzari R. Une nouvelle méthode clinique et thérapeutique l’Ostéopathie. Doin, 3ème édition, 1949.<br />
13. Lavezzari R. Une nouvelle méthode clinique et thérapeutique l’Ostéopathie. Doin, 3ème édition, 1964.<br />
14. Léri A. Les affections de la colonne vertébrale. Masson. 1926.<br />
15. Leprince A. Traité pratique de vertébrothérapie, thérapeutique des subluxations. Dangles Paris 1949.<br />
16. Maigne J.Y. Soulager le mal de dos. Masson, 2001.<br />
17. Maigne J.Y., Guillon F. Effet des manipulations sur le segment mobile lombaire. Réflexions sur leur mode d’action. Les manipulations<br />
vertébrales, collection pathologie locomotrice, Masson, Paris, 1994.<br />
18. Maigne R. Les manipulations vertébrales. Expansion scientifique Française – 1960.<br />
19. Maigne R. Douleurs d’origine vertébrale et traitement par manipulations. 3 ème édition. Expansion scientifique Française 1977.<br />
20. Maigne R. Diagnostic et traitement des douleurs communes d’origine rachidiennes, une nouvelle approche. - Edition scientifique<br />
Française 1989.<br />
21. Mauric G. Le disque intervertébral. Masson. 1933.<br />
22. Mixter W.J., Barr J.G. Rupture of the intervertebral disc with involvement of the spinal canal. New England J. Med. 1984. 210-211.<br />
23. Moutin L, Mann G.A. Manuel d’Ostéopathie pratique Théorie et procédés à l’usage des élèves de l’école d’ostéopathie.Librairie<br />
internationale de la pensée nouvelle. Mann, 1913.<br />
24. Pavlowlotsky Y. Rhumatologie, diagnostic et conduite thérapeutique. Ellipses 1988.<br />
25. Pecunia A.L.Reboutement chirosomatothérapie.- Maloine 1966.<br />
26. Roy-Camille R., Saillant G., Antonietti P., Gilardeau C. Le rachis. Masson 1995.<br />
27. Tamalet B. Que risque-t-on à manipuler une sciatique ? Revue de Médecine Vertébrale. 2004;14;22-26.<br />
28. Troisier O. Traitement non chirurgical des lésions des disques intervertébraux. Masson 1962.<br />
29. Troisier O. : Sémiologie et traitement des algies discales et ligamentaires du rachis. Masson et éditeurs, 1973.<br />
30. Vander Elst E. Histoire de l’orthopédie et de la traumatologie. Société française médicale et scientifique. In : Histoire de la médecine.<br />
Albin Michel, Laffont, Tchou, Paris, 1979.<br />
31. Yang Jwing-Ming : Massage Chi-kung. Budo 1992-2003.