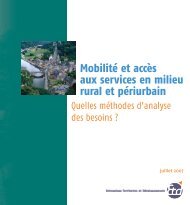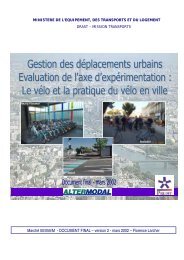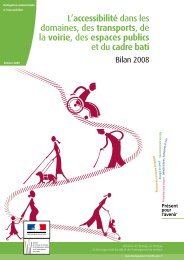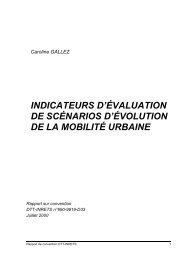Changer de comportement? Enquête sur nos façons de faire avec ...
Changer de comportement? Enquête sur nos façons de faire avec ...
Changer de comportement? Enquête sur nos façons de faire avec ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
halshs-00193116, version 1 - 30 Nov 2007<br />
lorsque nous faisons, pensons ou ressentons quelque chose : mais justement, au lieu <strong>de</strong> tenir<br />
cela comme acquis, et cette détermination comme une explication, ne faut-il pas mieux se<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si tel est bien le cas – et comment, <strong>avec</strong> quelle marge <strong>de</strong> déterminisme, quelles<br />
mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> composition d’influences souvent tout à fait contradictoires ? Au <strong>de</strong>là, et <strong>de</strong> façon<br />
plus radicale, peut-on réduire l’action à <strong>de</strong>s déterminants, comme s’il appartenait au chercheur<br />
<strong>de</strong> l’expliquer <strong>de</strong> l’extérieur ?<br />
Sur le plan théorique, d’abord, c’est <strong>faire</strong> bien peu <strong>de</strong> cas <strong>de</strong> sa nature intentionnelle, du<br />
fait qu’elle passe par une mobilisation <strong>de</strong> soi qui fait elle-même appel, <strong>de</strong> façon réflexe ou <strong>de</strong><br />
façon réflexive, à ce à quoi l’on tient : autrement dit, les <strong>façons</strong> <strong>de</strong> se déterminer sont un objet<br />
<strong>de</strong> la recherche, elles font partie d’une analyse <strong>de</strong> l’action, elles n’en sont pas un facteur<br />
explicatif, une ressource <strong>de</strong> l’analyse.<br />
Et plus concrètement, une analyse sérieuse <strong>de</strong> l’action peut-elle se contenter <strong>de</strong> <strong>faire</strong> ellemême<br />
le départ entre <strong>de</strong>s facteurs déterminants, culturels et sociaux, et <strong>de</strong>s facteurs<br />
contingents, laissés aux aléas <strong>de</strong> la vie ? Au nom <strong>de</strong> quoi se dispenserait-elle d’envisager,<br />
dans les <strong>comportement</strong>s, non seulement les facteurs déterminant les personnes, issus <strong>de</strong> leur<br />
milieu, <strong>de</strong> leur passé, <strong>de</strong> leurs habitus, mais aussi ce qui tient à la situation - aux interactions<br />
<strong>avec</strong> les autres, <strong>avec</strong> les objets et les dispositifs présents, aux événements qui se déroulent,<br />
etc. ? Surtout, poser ainsi le problème, c’est aussitôt le décaler vers le problème plus large <strong>de</strong>s<br />
appuis du <strong>comportement</strong>, ou encore <strong>de</strong>s <strong>façons</strong> <strong>de</strong> <strong>faire</strong> <strong>avec</strong> soi. C’est comprendre qu’il faut<br />
s’interroger non pas <strong>sur</strong> tel ou tel <strong>de</strong> ces facteurs, mais bien <strong>sur</strong> leur mobilisation sélective ou<br />
leur exclusion, <strong>sur</strong> leur composition, ou encore <strong>sur</strong> les passages entre eux, il faut soumettre à<br />
la question la variété infinie <strong>de</strong>s modalités selon lesquelles, dans tel ou tel cas, ils sont ou non<br />
pris en compte, combinés, réfléchis ou négligés – et ainsi, chaque fois, écartés ou réintégrés<br />
<strong>de</strong> façon spécifique à l’action elle-même.<br />
Dépasser ainsi l’opposition entre représentations et action, cela suppose peut-être d’abord<br />
<strong>de</strong> se dé<strong>faire</strong> <strong>de</strong> cette curieuse obsession <strong>de</strong>s sciences humaines pour les représentations : c’est<br />
elle qui fait glisser l’intérêt du chercheur, qui le détourne <strong>de</strong> l’action elle-même, <strong>de</strong>s<br />
<strong>comportement</strong>s effectifs en situation, pour le <strong>faire</strong> unilatéralement s’intéresser à <strong>de</strong>s variantes<br />
infinies <strong>de</strong> la justification et <strong>de</strong>s décalages <strong>de</strong> soi-même à un idéal supposé (même minimal,<br />
comme paraître humain et respectable). L’image <strong>de</strong> soi <strong>de</strong> la psychanalyse a fait <strong>de</strong>s petits :<br />
l’action ensemble n’est par exemple plus, pour les interactionnistes, qu’un guet perpétuel du<br />
regard <strong>de</strong> l’autre et un souci <strong>de</strong> ne pas perdre la face – mais, sous une apparence opposée, elle<br />
obéit aussi à une variante <strong>de</strong> ce modèle, lorsqu’elle se réduit à une quête indéfinie <strong>de</strong><br />
légitimité, pour la sociologie critique. Notre pari est simple : si on remet les choses à l’endroit<br />
en se <strong>de</strong>mandant comment on se représente (soi, les autres, la situation), mais entre autres<br />
choses, et pour <strong>faire</strong> quelque chose (au sens large : se conduire, choisir ceci ou cela, déci<strong>de</strong>r,<br />
se laisser aller, prendre une me<strong>sur</strong>e radicale, se renseigner, etc.), on n’escamote nullement<br />
l’importance <strong>de</strong>s représentations et leur rôle décisif dans l’action. Au contraire, on les<br />
comprend à nouveaux frais, mais comme <strong>de</strong>s <strong>façons</strong> <strong>de</strong> <strong>faire</strong> - et non <strong>de</strong>s <strong>façons</strong> <strong>de</strong> se voir et<br />
d’être vu, ce qu’elles sont aussi… mais notamment et <strong>sur</strong>tout si cela ai<strong>de</strong> à se comporter !<br />
Aspect méthodologique<br />
Sur le plan <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong>, cette posture a <strong>de</strong>s conséquences immédiates, tout<br />
particulièrement <strong>sur</strong> <strong>de</strong>s sujets délicats comme l’alcool ou la conduite dangereuse. Au lieu <strong>de</strong><br />
n’interroger la relation enquêté-enquêteur que <strong>sur</strong> le registre <strong>de</strong> la suspicion, comme effort<br />
pour paraître conforme, pour le premier, et biais à contrôler et danger d’imposer <strong>de</strong>s<br />
catégories, pour le second, on peut la centrer <strong>sur</strong> la mise à plat <strong>de</strong>s appuis qui font que les<br />
gens se comportent comme ils le font : <strong>de</strong>s raisons bonnes ou mauvaises, certes, mais aussi<br />
<strong>de</strong>s « tenants » et <strong>de</strong>s aboutissants, comme on dit joliment, c’est-à-dire un jeu, plus ou moins<br />
actif ou passif selon les cas, <strong>avec</strong> ce qu’on se sait être - en bien ou en mal - et <strong>avec</strong> ce qu’on