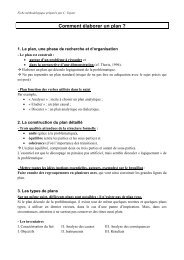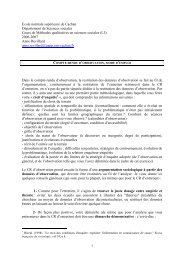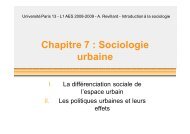Diapos Chap 8 - Melissa
Diapos Chap 8 - Melissa
Diapos Chap 8 - Melissa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Université Paris 13 - L1 AES 2008-2009 - A. Revillard - Introduction à la sociologie<br />
<strong>Chap</strong>itre 8 : Sociologie des<br />
organisations<br />
I. De la bureaucratisation à l’analyse<br />
stratégique<br />
II.<br />
Culture et identité dans les<br />
organisations
Introduction<br />
• Diversité des organisations :<br />
Administrations publiques<br />
Entreprises<br />
Associations<br />
Partis politiques…<br />
• Point commun<br />
« des ensembles humains ordonnés et hiérarchisés en vue<br />
d’assurer la coopération et la coordination de leurs membres<br />
pour des buts donnés ».<br />
Problème : comment assurer la « coopération entre des acteurs<br />
gardant chacun un minimum d’autonomie et dont les intérêts<br />
ne sont pas forcément convergents »<br />
(E.Friedberg)
Introduction<br />
• Une solide assise empirique : méthodologie qualitative<br />
études de cas.<br />
• Des analyses théoriques multiples, une<br />
conceptualisation parfois ésotérique.<br />
• Dimension appliquée : la sociologie des organisations<br />
tente de « donner des clés de compréhension et d’action<br />
aux acteurs engagés dans des situations<br />
organisationnelles » (Amblard et al., 2005, p.7).
Bibliographie : principales références<br />
utilisées<br />
ALPE, Y., LAMBERT, J.-R., BEITONE, A., DOLLO, C., et PARAYRE,<br />
S. (2007). Lexique de sociologie, Paris: Dalloz.<br />
AMBLARD, H., BERNOUX, P., HERREROS, G., et LIVIAN, Y.-F. (2005<br />
[1996]). Les nouvelles approches sociologiques des organisations,<br />
Paris: Seuil. <strong>Chap</strong>itre 1 « Les fondements : contingence, stratégie,<br />
règles, identités et cultures ».<br />
BOUDON, R., BESNARD, P., CHERKAOUI, M., et LÉCUYER, B.-<br />
P.(dir.) (2005). Dictionnaire de sociologie, Paris: Larousse, articles «<br />
Bureaucratie » et « Organisation » (par E.Friedberg)<br />
CROZIER, M. et FRIEDBERG, E. (1977). L'acteur et le système: les<br />
contraintes de l'action collective, Paris: Seuil.<br />
SAINSAULIEU, R. (1987). Sociologie de l'organisation et de<br />
l'entreprise, Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences<br />
politiques & Dalloz.
Plan du chapitre<br />
I. De la bureaucratisation à l’analyse<br />
stratégique<br />
A. L’organisation bureaucratique<br />
B. L’analyse stratégique<br />
II. Culture et identité dans les<br />
organisations<br />
A. Des cultures organisationnelles nationales?<br />
B. Organisations et identités
I.A. L’organisation bureaucratique<br />
M.Weber (1922), Economie et société : analyse de la bureaucratie<br />
comme mode d’organisation typique de la modernité, associé à une<br />
domination de type rationnel-légal (cf chap.2):<br />
Inscription dans un ordre légal<br />
Le détenteur de l’autorité hiérarchique ne fait qu’appliquer la loi.<br />
Prédominance d’une procédure écrite<br />
Les sphères de compétences et les droits et devoirs de chacun<br />
sont définis par des règles impersonnelles<br />
Hiérarchie clairement définie et indépendante des personnes<br />
Indépendance des fonctions par rapport aux personnes<br />
Accès aux postes sur examens et concours, qualifications<br />
clairement formalisées de façon impersonnelle
I.A. L’organisation bureaucratique<br />
M.Weber (1922), Economie et société : analyse de<br />
la bureaucratie (suite):<br />
• Effets sur l’organisation:<br />
Limitation de l’arbitraire<br />
Séparation des fonctions, qualifications, positions<br />
hiérarchiques, etc., par rapport aux personnes<br />
Prévisibilité<br />
Continuité des procédures indépendamment des<br />
personnes<br />
Cf définition de la bureaucratie dans « les notions clés »
I.A. L’organisation bureaucratique<br />
M.Weber (1922), Economie et société : analyse de<br />
la bureaucratie (suite):<br />
• Bilan : un fonctionnement plus prévisible et plus<br />
régulier un mode d’organisation plus<br />
efficace que les organisations traditionnelles…<br />
• … cependant, des dysfonctionnements sont<br />
possibles.
I.A. L’organisation bureaucratique<br />
• Les dysfonctionnements de la<br />
bureaucratie : ex. du « cas de l’hôpital »<br />
(annexe 1), illustration d’un cercle vicieux<br />
bureaucratique
I.B. L’analyse stratégique<br />
• Le comportement des acteurs dans<br />
l’organisation n’est pas entièrement dicté<br />
par l’organigramme et les procédures<br />
formelles; ils ont une marge de<br />
manœuvre, une autonomie, et des<br />
intérêts propres<br />
• Entre les acteurs se développent des<br />
relations de pouvoir
I.B. L’analyse stratégique<br />
• Cadre théorique/principaux concepts :<br />
Stratégie des acteurs<br />
Conception relationnelle du pouvoir<br />
Zone d’incertitude<br />
Système d’action concret<br />
• Méthodologie : importance du recours à<br />
l’entretien (cf annexe 2)<br />
Sources : Crozier et Fridberg (1977), Amblard et al. (2005)
I.B. L’analyse stratégique<br />
• Stratégie des acteurs :<br />
Non pas un plan conscient défini une fois pour toutes<br />
en fonction d’objectifs clairs et de contraintes fixes<br />
Plutôt une adaptation du comportement en fonction :<br />
Des opportunités qui se présentent,<br />
Des atouts dont les acteurs disposent<br />
Des relations dans lesquelles ils sont insérés<br />
De leur perception du comportement possible des autres<br />
Dimension évolutive et interactive du concept de<br />
stratégie
I.B. L’analyse stratégique<br />
• Stratégie défensive/offensive:<br />
Défensive : préserver sa marge de<br />
manoeuvre<br />
Offensive : améliorer sa capacité d’action
I.B. L’analyse stratégique<br />
• Conception relationnelle du pouvoir :<br />
« le pouvoir est […] une relation, et non pas un<br />
attribut des acteurs »<br />
Possibilité d’un individu ou groupe d’agir sur<br />
un autre.<br />
Or « agir sur » suppose d’entrer en relation<br />
avec conception relationnelle<br />
« L’autre » n’est jamais totalement démuni<br />
(relation de pouvoir ≠ domination)
I.B. L’analyse stratégique<br />
• Zone d’incertitude : dans une organisation, espace de<br />
pouvoir caractérisé par l’absence de règles formelles. 4<br />
sources possibles de pouvoir :<br />
Possession d’une compétence difficilement<br />
remplaçable<br />
Relations entre l’organisation et son environnement<br />
Maîtrise des flux d’information entre les membres<br />
de l’organisation<br />
Utilisation des règles organisationnelles : plus les<br />
règles sont précises, plus elles créent des situations<br />
nouvelles et imprévisibles
I.B. L’analyse stratégique<br />
• Système d’action concret : par opposition à<br />
l’organigramme et aux règles formelles de<br />
fonctionnement de l’organisation, le système d’action<br />
concret désigne la structure réelle qui résulte des<br />
relations, rapports de pouvoirs et règles informelles mis<br />
en place par les acteurs.<br />
Donc la réalité concrète vs le discours officiel<br />
Une approche fondée sur le recours à l’investigation<br />
empirique Importance de la méthodologie.
I.B. L’analyse stratégique<br />
• Méthodologie (cf annexe 2) :<br />
Importance accordée au « vécu des participants » <br />
recours à l’entretien<br />
Types d’informations recueillies :<br />
Le « vécu quotidien » de l’acteur<br />
La dimension « implicite » de son travail<br />
Sa perception de la situation<br />
Ses objectifs<br />
Ses ressources et la marge de liberté disponible, et « de<br />
quelle façon, à quelles conditions et dans quelles limites il<br />
peut les utiliser »
I.B. L’analyse stratégique<br />
• Méthodologie (cf annexe 2, suite) :<br />
Dimension subjective du témoignage :<br />
• Le témoignage recueilli ne correspond pas<br />
à la « réalité objective », mais à la<br />
perception subjective qu’en a l’acteur.<br />
• Pas un problème pour le sociologue, car<br />
cette perception est ce qui détermine la<br />
stratégie de l’acteur.
II. Culture et identité<br />
dans les organisations<br />
A. Des cultures organisationnelles nationales?<br />
1) L’approche « sociétale » de Maurice, Sellier et<br />
Sylvestre (1892)<br />
2) L’influence des cultures nationales sur<br />
l’organisation selon d’Iribarne (1989)<br />
B. Organisations et identités<br />
Présentation des 4 modèles de « l’identité au travail »<br />
de Sainsaulieu (1977)
II.A. Des cultures organisationnelles<br />
nationales?<br />
1) L’approche « sociétale » de Maurice, Sellier et<br />
Sylvestre (1982)<br />
MAURICE, M., SELLIER, F., et SILVESTRE, J.-J. (1982). Politique<br />
d'éducation et organisation industrielle en France et en Allemagne:<br />
essai d'analyse sociétale, Paris: PUF. :<br />
<br />
<br />
<br />
Etude comparative France/Allemagne sur 9 entreprises,<br />
observées de 1975 à 1979<br />
Deux pays voisins, européens, industrialisés à la même<br />
époque…<br />
… mais des différences organisationnelles importantes
II.A. Des cultures organisationnelles<br />
nationales?<br />
1) L’approche « sociétale » de Maurice, Sellier et Sylvestre (1982)<br />
(suite): les différences organisationnelles constatées:
II.A. Des cultures organisationnelles<br />
nationales?<br />
• Maurice, Sellier, Sylvestre (1982) (suite)<br />
• Explication de ces différences organisationnelles par des<br />
différences dans les systèmes d’éducation et de promotion entre la<br />
France et l’Allemagne :
II.A. Des cultures organisationnelles<br />
nationales?<br />
2) L’influence des cultures nationales sur l’organisation selon<br />
d’Iribarne (1989)<br />
D’IRIBARNE, P. (1989). La logique de l'honneur: gestion des<br />
entreprises et traditions nationales, Paris: Éditions du Seuil.<br />
• Comparaison d’établissements de la même entreprise en France,<br />
aux Etats-Unis et aux Pays-Bas<br />
• Constat de différences organisationnelles que Ph. D’Iribarne<br />
explique par des différences de cultures nationales:<br />
France : logique de l’honneur<br />
Etats-Unis : logique du contrat<br />
Pays-Bas : logique de conciliation, recherche de consensualité
II.A. Des cultures organisationnelles<br />
nationales?<br />
• En France, la logique de l’honneur:<br />
Fierté du travail bien fait, relation affective au<br />
travail<br />
Le contrôle est mal supporté : idée que les<br />
seuls comptes à rendre le sont vis-à-vis de<br />
son honneur.<br />
Chaque échelon hiérarchique constitue un<br />
« état » aux frontières rigides
II.A. Des cultures organisationnelles<br />
nationales?<br />
• Aux Etats-Unis, la logique du contrat:<br />
Culture de l’échange libre et équitable entre<br />
égaux<br />
Reddition de comptes systématique au<br />
supérieur hiérarchique<br />
Relations de travail, droits et devoirs<br />
précisément définis sur une base<br />
contractuelle<br />
Valorisation de l’honnêteté
II.A. Des cultures organisationnelles<br />
nationales?<br />
• Aux Pays-Bas, la logique de consensus:<br />
Forte affirmation de l’individu, qui résiste aux<br />
pressions de la hiérarchie<br />
Formalisation des responsabilités à chaque niveau<br />
hiérarchique<br />
Écoute, négociation, discussion permanentes.<br />
Source : Fiche de lecture de la Chaire DSO (CNAM) sur D’Iribarne (1989):<br />
http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/diribarne2.html
II.B. Organisations et identités<br />
• Sainsaulieu : 4 modèles de « l’identité au<br />
travail » (1977) (cf Annexe 3) :<br />
Fusion<br />
Négociation<br />
Affinités<br />
Retrait
II.B. Organisations et identités<br />
• Modèle de la fusion:<br />
Contexte : tâches répétitives et travaux peu<br />
qualifiés<br />
Le collectif comme seule ressource fusion<br />
dans l’unité du groupe; le groupe fonctionne<br />
comme refuge, relations affectives fortes, peu<br />
de débat d’idées<br />
Importance du rapport au chef<br />
Au niveau collectif, tendance à l’action de<br />
masse spontanée
II.B. Organisations et identités<br />
• Modèle de la négociation:<br />
Contexte : accès possible aux positions<br />
hiérarchiques (ex. situation des ouvriers<br />
qualifiés)<br />
Relations interpersonnelles riches, débat<br />
d’idées important<br />
Valorisation du métier<br />
Au niveau collectif, recours à la négociation et<br />
au conflit
II.B. Organisations et identités<br />
• Modèle des affinités:<br />
Contexte : situations de mobilité professionnelle, de<br />
promotion évolution individuelle prime sur<br />
l’appartenance au groupe de travail. Ex. techniciens,<br />
ingénieurs et cadres.<br />
Rapports interpersonnels peu nombreux mais très<br />
forts (affinités sélectives)<br />
Importance du rapport au chef<br />
Importance des stratégies autour de la carrière
II.B. Organisations et identités<br />
• Modèle du retrait:<br />
Faible investissement dans les relations<br />
personnelles au travail<br />
Rapport au chef = fort et empreint de<br />
dépendance<br />
Travail comme nécessité économique