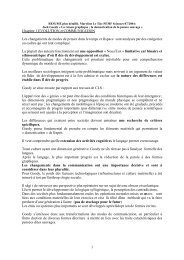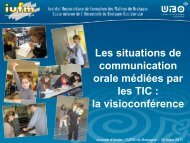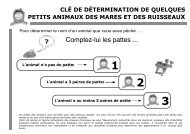Talbot, L. Les pratiques d'enseignement efficaces et équitables
Talbot, L. Les pratiques d'enseignement efficaces et équitables
Talbot, L. Les pratiques d'enseignement efficaces et équitables
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ces mêmes maîtres gèrent leur temps <strong>et</strong> celui de la classe de manière efficiente. Ils limitentles activités relatives à l’organisation des séquences pour réserver le plus de temps possibleaux activités relatives à l’apprentissage. Ils s’assurent qu’un maximum de temps de classe esteffectivement consacré à des tâches scolaires. Ce point recoupe celui déjà abordé au n° 3. Ilsrépartissent le temps de façon à ce que plus de périodes possible soient allouées aux activitésscolaires. Ils se montrent généralement très organisés. Ils pensent à une planification à moyen<strong>et</strong> long terme, savent avec précision ce qu’ils veulent faire <strong>et</strong> accomplir.La gestion temporelle est d’importance. Tout comme la tâche, les interactions <strong>et</strong> l’évaluation,elle constitue le dernier organisateur des <strong>pratiques</strong> d’enseignement repéré dans les travaux duGPE-CREFI (Maurice & Allègre, 2002) pour l’heure.1-7- Une clarté dans les interventions pédagogiques <strong>et</strong> didactiques<strong>Les</strong> professeurs <strong>efficaces</strong> <strong>et</strong> équitables sont clairs dans la présentation des consignes commedans l’explication des instructions à suivre. L’enseignement des concepts se fait de façonsimple <strong>et</strong> logique. Ils utilisent un langage d’un niveau approprié, avec une diction n<strong>et</strong>te <strong>et</strong> bienagencée. Leurs idées sont cohérentes, logiques. Ils ne répètent pas des explications ou desdirectives car ils sont entendus, leurs présentations ne prêtent pas à des demandes declarifications de la part des élèves. Ces enseignants sont invariablement bien organisés, ilsplanifient soigneusement les séquences d’enseignement, ils identifient <strong>et</strong> s’emploient à laréalisation des objectifs scolaires à moyen <strong>et</strong> à long termes <strong>et</strong> sont capables de modifier leursstratégies en fonction du progrès de leurs élèves.Avant de tenter d’opérationnaliser une partie de ces variables dégagées, nous avons essayé declarifier la notion de <strong>pratiques</strong> d’enseignement à travers quelques présupposés théoriques.2-Perspectives théoriquesNous considérons que les variables corrélées à un eff<strong>et</strong>-maître positif ainsi que lesorganisateurs des <strong>pratiques</strong> d’enseignement dégagés dans les travaux décrits ci-dessusconstituent des éléments essentiels à prendre en compte pour mieux décrire <strong>et</strong> comprendre les<strong>pratiques</strong> d’enseignement que nous définissons à partir de la théorie sociocognitivedéveloppée par A. Bandura (1986). L’auteur canadien caractérise les <strong>pratiques</strong> de tout acteurhumain par trois dimensions qui sont en constante interaction <strong>et</strong> qui s’influencentColloque Efficacité <strong>et</strong> équité en éducation5 / 17