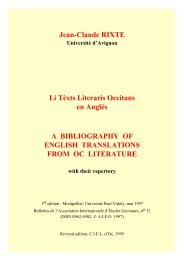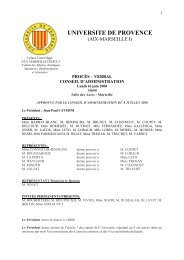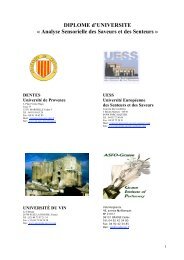BD2I : Normes sur l'identification de 274 images d'objets et leur mise ...
BD2I : Normes sur l'identification de 274 images d'objets et leur mise ...
BD2I : Normes sur l'identification de 274 images d'objets et leur mise ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
03_Cannard.fm Page 386 Mardi, 10. octobre 2006 4:33 16386 Christine Cannard • Françoise Bonthoux • Agnès Blaye •Nelly Scheuner • Anne-Caroline Schreiber • Jacques Trinquartjustifiées par un lien thématique (Blaye <strong>et</strong> al., 2000; Bonthoux & Blaye,1999; Lucariello <strong>et</strong> al., 1992; Sell, 1992; Walsh <strong>et</strong> al., 1993)Matériel Les 80 associations sélectionnées précé<strong>de</strong>mment pour l’épreuve <strong>de</strong>reconnaissance étaient proposées à un nouvel échantillon d’enfants. Les distracteursont été enlevés pour ne faire apparaître que <strong>de</strong>s paires d’obj<strong>et</strong>s : lacible <strong>et</strong> l’associé. Les <strong>de</strong>ux mêmes listes que précé<strong>de</strong>mment ont donc été constituées,sans les distracteurs.Procédure Chaque enfant n’était interrogé que <strong>sur</strong> une liste. Pour chaque paired’<strong>images</strong>, la consigne était la suivante : « tu vois, certaines personnes ont <strong>mise</strong>nsemble ces <strong>de</strong>ux obj<strong>et</strong>s, peux-tu me dire pourquoi ? ». Lorsque l’enfant ne répondaitpas, on lui <strong>de</strong>mandait <strong>de</strong> bien regar<strong>de</strong>r les <strong>de</strong>ux obj<strong>et</strong>s pour essayer <strong>de</strong> trouverle lien qu’ils entr<strong>et</strong>enaient. Toutes les réponses brutes <strong>de</strong>s enfants étaient recueillies.Critère d’analyse : pourcentage <strong>de</strong>s justifications catégorielles Les justifications verbalesont été classées en trois grands types : taxonomiques, thématiques <strong>et</strong> perceptives. Uneexplication est cotée perceptive si l’enfant a cité <strong>de</strong>s propriétés communes liées seulementà l’apparence physique comme la forme ou <strong>de</strong>s parties communes (pourpomme <strong>et</strong> gâteau : « les <strong>de</strong>ux sont ronds » ; pour voiture <strong>et</strong> vélo : « les <strong>de</strong>ux ont <strong>de</strong>sroues »). Il n’y a pas <strong>de</strong> difficulté particulière <strong>de</strong> cotation pour ce type <strong>de</strong> justification.Nous n’avons cependant pas pris en compte l’énoncé « c’est pareil », jugé insuffisantpour déterminer le type <strong>de</strong> catégorisation auquel il renvoyait.En revanche, les cotations <strong>de</strong>s explications comme thématiques ou taxonomiquessont plus délicates. Nous nous sommes basées <strong>sur</strong> celle préconisée par Lucariello <strong>et</strong>al. (1992) <strong>et</strong> Sell (1992), faisant référence aux travaux <strong>de</strong> Nelson. Selon ces auteurs,pour établir qu’une justification renvoie à une relation thématique, il faut que soitmentionné un lien spatial ou temporel entre les <strong>de</strong>ux obj<strong>et</strong>s ou encore une actioncommune incluant les <strong>de</strong>ux obj<strong>et</strong>s (pour gant <strong>et</strong> ski, « on m<strong>et</strong> <strong>de</strong>s gants, puis on vafaire du ski » ; pour ballon <strong>et</strong> vélo : « on va jouer au ballon en vélo »). Par ail<strong>leur</strong>s,pour établir qu’une justification sous-tend une relation taxonomique, il faut que lasubstituabilité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux obj<strong>et</strong>s <strong>de</strong> la paire soit clairement énoncée (pour chien/poule, « ce sont <strong>de</strong>ux animaux » ; pour carotte/fraise, « on les mange tous les<strong>de</strong>ux »). Il faut noter que le choix <strong>de</strong> ce critère implique que les associés taxonomiques<strong>sur</strong>ordonnés (« <strong>de</strong>ux vêtements ») <strong>et</strong> ceux limités à un script ne sont pasdifférenciés (« <strong>de</strong>ux vêtements pour aller à la neige »), <strong>et</strong> sont cotés tous les <strong>de</strong>uxselon une justification taxonomique.Une fois ces critères mis en place, une liste d’exemples types d’énoncés a été établie.Pour chaque relation, une centaine <strong>de</strong> protocoles <strong>de</strong> tous âges a été cotéeindépendamment par <strong>de</strong>ux participants au proj<strong>et</strong>. Le pourcentage d’accord étantsatisfaisant (97 %), le reste <strong>de</strong>s protocoles a été dépouillé <strong>et</strong> coté par une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>uxpersonnes seulement.Tâche d’évaluation <strong>de</strong> la force <strong>de</strong>s associationsentre obj<strong>et</strong>sUne étu<strong>de</strong> publiée par Scheuner, Bonthoux, Blaye & Cannard (2004) amis en évi<strong>de</strong>nce l’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> la force d’association <strong>sur</strong> les conduites d’appa-L’année psychologique, 2006, 106, 375-396