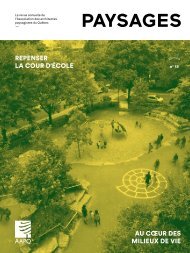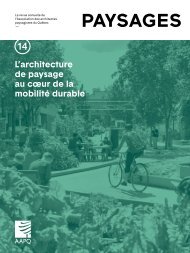PAYSAGES 2021
PAYSAGES est la revue annuelle de l'Association des architectes paysagistes du Québec. Cette 16e édition de la revue PAYSAGES est l’occasion de démontrer le rôle capital que jouent les architectes paysagistes dans l’atteinte et le maintien de la santé publique. Les collaborateurs de cette édition ont été invités à examiner et à mettre en lumière les façons dont la pratique de l’architecture de paysage contribue à la santé physique, protège la santé mentale et permet de créer des liens sociaux forts et égalitaires, trois piliers de la santé publique. Afin d’optimiser la portée de leurs propos, nous avons invité cette année le cardiologue François Reeves à porter un regard complémentaire sur les textes de la revue. En effet, en plus de signer le texte d’ouverture, le Dr Reeves commente et annote chacun des articles. Résultat : une édition 2021 dynamique sur laquelle nos professionnels peuvent s’appuyer et qui témoigne pleinement de la pertinence de leurs actions.
PAYSAGES est la revue annuelle de l'Association des architectes paysagistes du Québec.
Cette 16e édition de la revue PAYSAGES est l’occasion de démontrer le rôle capital que jouent les architectes paysagistes dans l’atteinte et le maintien de la santé publique. Les collaborateurs de cette édition ont été invités à examiner et à mettre en lumière les façons dont la pratique de l’architecture de paysage contribue à la santé physique, protège la santé mentale et permet de créer des liens sociaux forts et égalitaires, trois piliers de la santé publique.
Afin d’optimiser la portée de leurs propos, nous avons invité cette année le cardiologue François Reeves à porter un regard complémentaire sur les textes de la revue. En effet, en plus de signer le texte d’ouverture, le Dr Reeves commente et annote chacun des articles. Résultat : une édition 2021 dynamique sur laquelle nos professionnels peuvent s’appuyer et qui témoigne pleinement de la pertinence de leurs actions.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
à même de visiter ces espaces. La pandémie exacerbe toutefois les<br />
disparités en posant des barrières additionnelles à l’accès aux services<br />
et équipements situés hors des limites des quartiers de résidence.<br />
On remarque conséquemment un rétrécissement du territoire<br />
du quotidien alors que les populations délaissent de plus en plus<br />
l’espace public et tendent à côtoyer les ressources et équipements<br />
localisés à proximité de leur résidence 10 . L’accès équitable aux espaces<br />
verts constitue un enjeu d’actualité qui interpelle la notion<br />
de justice, et plus particulièrement de justice environnementale.<br />
référence au processus de redéveloppement initié par la recherche<br />
d’un mode de vie perçu comme écoresponsable 17 . On voit se développer<br />
de nouvelles installations au sein des quartiers touchés par<br />
ce phénomène (p. ex. pistes cyclables, jardins communautaires,<br />
parcs, etc.). Bien que ces équipements offrent d’importants bénéfices<br />
pour la santé, la hausse du coût de la vie pouvant découler de<br />
ces transformations urbaines conduit au déplacement des populations<br />
les plus démunies qui ne peuvent, dès lors, bénéficier des<br />
avantages liés à l’amélioration du cadre de vie 18 .<br />
La justice environnementale est à la fois un mouvement social et un<br />
champ d’études. Le mouvement prend son élan au début des années<br />
1980, en s’appuyant sur les luttes pour les droits civiques<br />
menées par les communautés noires, latino-américaines et autochtones<br />
aux États-Unis au cours des années 1950 et 1960 11 . Des<br />
communautés se mobilisent en opposition à l’implantation, au cœur<br />
de leur milieu de vie, d’infrastructures posant d’importants risques<br />
environnementaux (pensons aux dépotoirs de matières contaminées,<br />
aux autoroutes et aux industries polluantes) 12 .<br />
Les luttes citoyennes s’appuient sur des études qui commencent<br />
à émerger dès 1983, faisant la preuve d’une implantation disproportionnée<br />
des infrastructures polluantes au sein des communautés<br />
racisées et défavorisées 13 . Au fil du temps, la portée du champ<br />
d’études couvert par la justice environnementale s’est élargie. À<br />
l’heure actuelle, trois conceptions de la justice sont mises de l’avant,<br />
soit la justice distributive, la justice procédurale et la justice interactionnelle.<br />
La combinaison de ces approches évite de limiter l’analyse<br />
aux seuls enjeux spatiaux.<br />
QUEL RÔLE POUR LES ARCHITECTES PAYSAGISTES ?<br />
Les architectes paysagistes sont appelés à jouer un rôle dans la<br />
recherche d’une plus grande justice environnementale. Les différentes<br />
conceptions de la justice discutées précédemment peuvent<br />
guider l’analyse et les pratiques à cet égard.<br />
La justice distributive invite à réfléchir à la localisation des nouveaux<br />
espaces verts, en ciblant de manière prioritaire les emplacements<br />
situés dans des secteurs peu végétalisés. Dans les milieux<br />
densément peuplés comportant peu de sites pouvant accueillir<br />
de nouveaux parcs urbains, le verdissement des interstices et des<br />
surfaces verticales doit être pris en compte. La justice procédurale<br />
invite, quant à elle, à réfléchir à la gouvernance des espaces<br />
verts ainsi qu’à la participation des individus marginalisés au sein<br />
des structures décisionnelles 14 . Enfin, la justice interactionnelle<br />
doit servir de base à l’évaluation de la qualité des interactions se<br />
déroulant au coeur des espaces verts. Il s’agit, entre autres, de<br />
déterminer, de concert avec les professionnels de l’intervention<br />
sociale, si certains groupes sont la cible d’insultes, de harcèlement<br />
ou de discrimination pouvant contribuer à leur exclusion. À l’évidence,<br />
le design ne peut résoudre des enjeux sociétaux tels que le<br />
racisme et le sexisme. Par contre, lorsque les tensions découlent<br />
de conflits d’usage, le design peut faire partie de la solution 15 . Ces<br />
trois approches de la justice gagnent à être croisées afin d’enrichir<br />
l’analyse et l’intervention.<br />
Afin de promouvoir un accès juste et équitable aux espaces verts<br />
pour tous, une vigilance accrue devrait accompagner tout projet de<br />
verdissement en milieu défavorisé. Ceci est particulièrement vrai<br />
des aménagements situés au sein des quartiers centraux ainsi qu’à<br />
proximité de secteurs étant déjà en cours d’embourgeoisement 19 .<br />
L’intervention dans ces milieux plus vulnérables à l’écoembourgeoisement<br />
devrait inclure l’allocation de ressources additionnelles<br />
dédiées au logement social 20 .<br />
Les architectes paysagistes ont la capacité d’agir à titre d’agents<br />
mobilisateurs de changement afin de faire de l’accessibilité universelle<br />
aux espaces verts un objectif rassembleur. Pour l’avenir, des<br />
outils devront toutefois être développés afin de faciliter le travail des<br />
professionnels soucieux de la prise en compte des différents enjeux<br />
éthiques liés à l’intervention au sein des milieux défavorisés.<br />
Illustration : Aless Mc<br />
ÉCOEMBOURGEOISEMENT ET VERDISSEMENT<br />
Les projets de verdissement ne conduisent pas automatiquement à<br />
la réduction des inégalités de santé. Dans certains cas, ils peuvent<br />
mener à la fragilisation des populations les plus vulnérables par le<br />
biais du phénomène d’écoembourgeoisement 16 . Ce concept fait<br />
Accédez aux références de cet article :<br />
bit.ly/laaev<br />
ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU QUÉBEC<br />
27