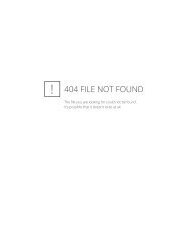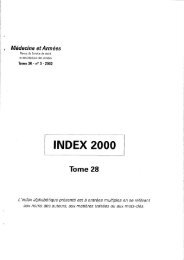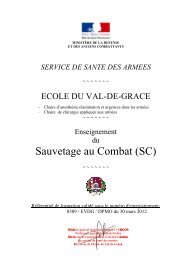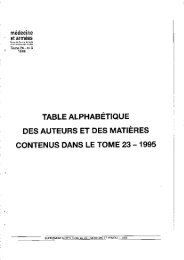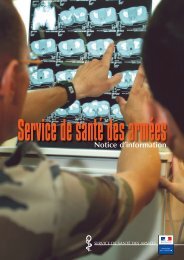&Armées
&Arm;ées - Ãcole du Val-de-Grâce
&Arm;ées - Ãcole du Val-de-Grâce
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
devant la Commission parlementaire le 22 mars 1878, est<br />
un morceau de bravoure, polémique et théâtral (2).<br />
Entre-temps, le corps s’était développé en Algérie où<br />
servait le tiers des ses effectifs (45 hôpitaux en 1881), et<br />
illustré avec tous les corps expéditionnaires : Morée,<br />
armée d’Afrique, Crimée, Italie, Chine, Syrie, Mexique,<br />
Tonkin, Tunisie et, plus tard, Madagascar et Maroc.<br />
De 1828 à 1895, on compte 73 officiers du corps, tués à<br />
l’ennemi ou victimes du devoir.<br />
L’École d’administration militaire avait été créée<br />
en 1875 à Vincennes. L’officier d’administration<br />
des hôpitaux Poulard, licencié en droit, y<br />
sera professeur et concevra le programme<br />
destiné aux futurs officiers du corps. Cette<br />
école formera les officiers d’administration<br />
des Services de santé jusqu’en 1939.<br />
IV. ÉVOLUTIONS AU SEIN DU SERVICE<br />
DE SANTÉ.<br />
De nouveaux règlements sont conçus: Service de<br />
santé à l’intérieur (1889), Service de santé<br />
de l’armée en campagne (1892). L’histoire a<br />
retenu le nom de l’OAP Picard parmi les<br />
membres de la commission chargée de la<br />
rédaction. Les officiers comptables deviennent<br />
alors gestionnaires.<br />
Deux faits importants marquent le début du XX e siècle :<br />
la correspondance des grades avec ceux de la hiérarchie<br />
militaire (1900), le grade le plus élevé étant celui<br />
d’officier d’administration principal (OAP) équivalent<br />
à commandant et la création du cadre d’officiers<br />
d’administration du Service de santé des troupes<br />
coloniales (1904).<br />
La guerre de 1914-1918 tissera des liens indéfectibles<br />
entre le corps médical et ses officiers d’administration<br />
d’active et de réserve (4900 au moment de l’armistice).<br />
Le corps aura 175 morts dont 149 réservistes. Ancien<br />
sous-secrétaire d’État du Service de santé militaire, Justin<br />
Godart a écrit : « Le jour où sera fait un ouvrage<br />
d’ensemble sur le rôle des officiers d’administration de<br />
1914 à 1918, on comprendra les services que ce corps a<br />
rendu au Pays… » (3).<br />
Pour distinguer deux d’entre eux, on peut citer l’OAP<br />
Raphal, choisi par le médecin inspecteur Toubert, aidemajor<br />
général du Service de santé au Grand quartier<br />
génral des forces (GQGF) en mars1918. Sa mission et ses<br />
responsabilités seront considérables (4): tout le matériel<br />
sanitaire, l’ensemble des ravitaillements et les formations<br />
de campagne. On peut citer aussi l’OAP Denain, servant<br />
volontairement à l’armée d’Orient. Il sera promu<br />
commandeur de la Légion d’honneur en avril 1918.<br />
Pendant la campagne du Maroc, l’officier d’administration<br />
de 2 e classe Teulé, gestionnaire de l’ambulance de<br />
colonne mobile n° 22 (1925-1926), sera cité à l’Ordre de<br />
l’armée. Son carnet de route servira de modèle (5).<br />
Un fait statutaire majeur est compris dans la loi des cadres<br />
et effectifs de l’armée du 28 mars 1928. Les appellations<br />
de classes pour tous les officiers du Service de santé<br />
sont remplacées par les grades militaires. Le grade<br />
de lieutenant-colonel d’administration est créé. À<br />
l’origine des mesures concernant le Service de santé : le<br />
sénateur Eugène Penancier, président des officiers<br />
d’administration de réserve du Service de santé. À<br />
cette époque, on compte près de 100 hôpitaux<br />
militaires (métropole et Afrique du Nord, sans compter<br />
l’Outre-Mer).<br />
Quelques chiffres pour la guerre 1939-1945 (active et<br />
réserve), 37 officiers dans la France Libre,<br />
54 morts pour la France, 2 Compagnons de la<br />
Libération: Amiot, active et Dehon, réserve, 43<br />
médailles de la Résistance dont 7 avec rosette.<br />
Parmi les morts, 16 tués à l’ennemi, 4 fusillés,<br />
10 en déportation dont le capitaine Salvat.<br />
Jean Baillou sera élevé à la dignité de grand<br />
officier de la Légion d’honneur (1973) comme<br />
commandant d’administration de réserve<br />
honoraire (déportés-résistants).<br />
Un nouvel acte de l’intégration effective du<br />
corps dans le Service de santé est la création<br />
d’une section administrative à l’École du Service<br />
de santé militaire (ESSM) de Lyon en juin 1946 sous<br />
l’impulsion du Médecin général inspecteur<br />
Debenedetti. Près de 600 officiers y seront formés<br />
avant de rejoindre les écoles d’application. Deux<br />
professeurs s’y distinguent : les lieutenants-colonels<br />
Deporcq, licencié en droit, à l’ESSM et Cluzel, docteur<br />
ès-lettres, à l’École d’application du Service de santé<br />
militaire (EASSM).<br />
Le corps participera aux guerres d’Indochine et<br />
d’Algérie, laissant sa trace en Allemagne, en Afrique<br />
du Nord et Outre-Mer.<br />
En 1965, la loi du 13 juillet réunit en un seul corps les<br />
officiers d’administration du Service de santé de<br />
l’armée de Terre et des troupes de Marine et intégra sur<br />
option ceux des branches « commissariat et santé » et<br />
« comptables matières » de l’armée de Mer.<br />
Enfin est créé le corps technique et administratif du<br />
Service de santé des armées (24 décembre 1976).<br />
Rompant avec les principes de 1882, le statut prévoit que<br />
ses officiers assurent des fonctions administratives ou<br />
techniques d’encadrement, qu’ils peuvent exercer des<br />
fonctions de commandement et participer à la direction<br />
des organismes de leur service et être appelés à faire partie<br />
d’organismes interarmées. Le nouveau statut offrait des<br />
perspectives nouvelles. François Ardhuin sera le premier<br />
officier Général de brigade nommé en 2 e section (1985)<br />
et Jean-Alain Le Corre, le premier en 1 re section (1993).<br />
L’École militaire du corps technique et administratif,<br />
créée le 1 er juillet 1977, forme désormais les élèves<br />
officiers du Corps technique et administratif du<br />
Service de santé des armées (CTASSA), qui effectuent<br />
ensuite une année à l’École du Val-de-Grâce où ils<br />
suivent un enseignement universitaire (Master II Pro en<br />
cohabilitation avec Paris VII). Le recrutement direct<br />
parmi des diplômés de l’enseignement supérieur,<br />
complétant le recrutement semi-direct, apporte la variété<br />
des formations universitaires initiales. Les spécialités<br />
le corps technique et administratif du service de santé des armées<br />
433