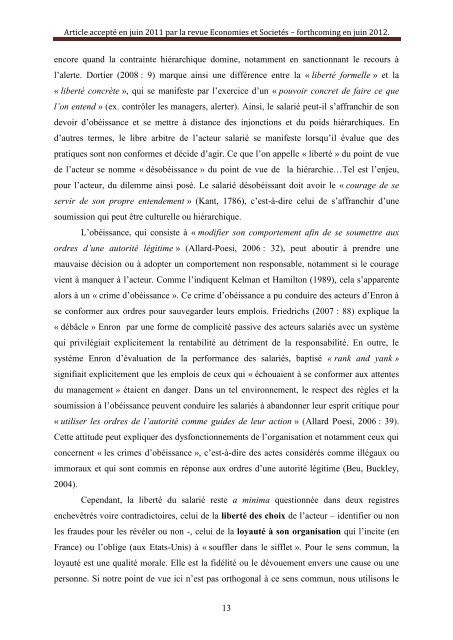Parler ou se taire ou le dilemme du salarié lanceur d'alerte. Analyse ...
Parler ou se taire ou le dilemme du salarié lanceur d'alerte. Analyse ...
Parler ou se taire ou le dilemme du salarié lanceur d'alerte. Analyse ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Artic<strong>le</strong> accepté en juin 2011 par la revue Economies et Societés – forthcoming en juin 2012.<br />
encore quand la contrainte hiérarchique domine, notamment en sanctionnant <strong>le</strong> rec<strong>ou</strong>rs à<br />
l’a<strong>le</strong>rte. Dortier (2008 : 9) marque ainsi une différence entre la « liberté formel<strong>le</strong> » et la<br />
« liberté concrète », qui <strong>se</strong> manifeste par l’exercice d’un « p<strong>ou</strong>voir concret de faire ce que<br />
l’on entend » (ex. contrô<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s managers, a<strong>le</strong>rter). Ainsi, <strong>le</strong> <strong>salarié</strong> peut-il s’affranchir de son<br />
devoir d’obéissance et <strong>se</strong> mettre à distance des injonctions et <strong>du</strong> poids hiérarchiques. En<br />
d’autres termes, <strong>le</strong> libre arbitre de l’acteur <strong>salarié</strong> <strong>se</strong> manifeste lorsqu’il évalue que des<br />
pratiques sont non conformes et décide d’agir. Ce que l’on appel<strong>le</strong> « liberté » <strong>du</strong> point de vue<br />
de l’acteur <strong>se</strong> nomme « désobéissance » <strong>du</strong> point de vue de la hiérarchie…Tel est l’enjeu,<br />
p<strong>ou</strong>r l’acteur, <strong>du</strong> di<strong>le</strong>mme ainsi posé. Le <strong>salarié</strong> désobéissant doit avoir <strong>le</strong> « c<strong>ou</strong>rage de <strong>se</strong><br />
<strong>se</strong>rvir de son propre entendement » (Kant, 1786), c’est-à-dire celui de s’affranchir d’une<br />
s<strong>ou</strong>mission qui peut être culturel<strong>le</strong> <strong>ou</strong> hiérarchique.<br />
L’obéissance, qui consiste à « modifier son comportement afin de <strong>se</strong> s<strong>ou</strong>mettre aux<br />
ordres d’une autorité légitime » (Allard-Poesi, 2006 : 32), peut ab<strong>ou</strong>tir à prendre une<br />
mauvai<strong>se</strong> décision <strong>ou</strong> à adopter un comportement non responsab<strong>le</strong>, notamment si <strong>le</strong> c<strong>ou</strong>rage<br />
vient à manquer à l’acteur. Comme l’indiquent Kelman et Hamilton (1989), cela s’apparente<br />
alors à un « crime d’obéissance ». Ce crime d’obéissance a pu con<strong>du</strong>ire des acteurs d’Enron à<br />
<strong>se</strong> conformer aux ordres p<strong>ou</strong>r sauvegarder <strong>le</strong>urs emplois. Friedrichs (2007 : 88) explique la<br />
« débâc<strong>le</strong> » Enron par une forme de complicité passive des acteurs <strong>salarié</strong>s avec un système<br />
qui privilégiait explicitement la rentabilité au détriment de la responsabilité. En <strong>ou</strong>tre, <strong>le</strong><br />
système Enron d’évaluation de la performance des <strong>salarié</strong>s, baptisé « rank and yank »<br />
signifiait explicitement que <strong>le</strong>s emplois de ceux qui « éch<strong>ou</strong>aient à <strong>se</strong> conformer aux attentes<br />
<strong>du</strong> management » étaient en danger. Dans un tel environnement, <strong>le</strong> respect des règ<strong>le</strong>s et la<br />
s<strong>ou</strong>mission à l’obéissance peuvent con<strong>du</strong>ire <strong>le</strong>s <strong>salarié</strong>s à abandonner <strong>le</strong>ur esprit critique p<strong>ou</strong>r<br />
« utili<strong>se</strong>r <strong>le</strong>s ordres de l’autorité comme guides de <strong>le</strong>ur action » (Allard Poesi, 2006 : 39).<br />
Cette attitude peut expliquer des dysfonctionnements de l’organisation et notamment ceux qui<br />
concernent « <strong>le</strong>s crimes d’obéissance », c’est-à-dire des actes considérés comme illégaux <strong>ou</strong><br />
immoraux et qui sont commis en répon<strong>se</strong> aux ordres d’une autorité légitime (Beu, Buck<strong>le</strong>y,<br />
2004).<br />
Cependant, la liberté <strong>du</strong> <strong>salarié</strong> reste a minima questionnée dans deux registres<br />
enchevêtrés voire contradictoires, celui de la liberté des choix de l’acteur – identifier <strong>ou</strong> non<br />
<strong>le</strong>s fraudes p<strong>ou</strong>r <strong>le</strong>s révé<strong>le</strong>r <strong>ou</strong> non -, celui de la loyauté à son organisation qui l’incite (en<br />
France) <strong>ou</strong> l’oblige (aux Etats-Unis) à « s<strong>ou</strong>ff<strong>le</strong>r dans <strong>le</strong> siff<strong>le</strong>t ». P<strong>ou</strong>r <strong>le</strong> <strong>se</strong>ns commun, la<br />
loyauté est une qualité mora<strong>le</strong>. El<strong>le</strong> est la fidélité <strong>ou</strong> <strong>le</strong> dév<strong>ou</strong>ement envers une cau<strong>se</strong> <strong>ou</strong> une<br />
personne. Si notre point de vue ici n’est pas orthogonal à ce <strong>se</strong>ns commun, n<strong>ou</strong>s utilisons <strong>le</strong><br />
13