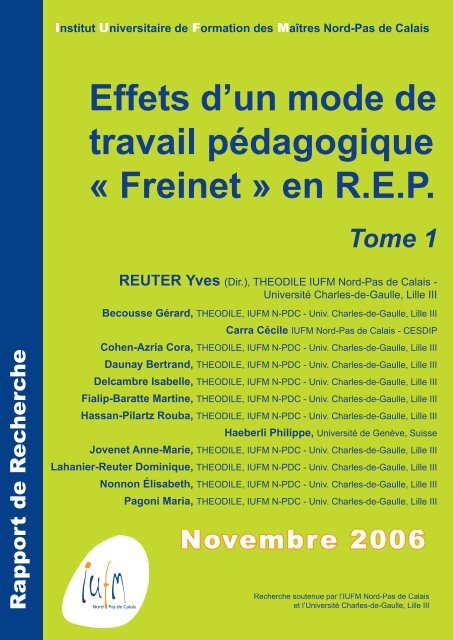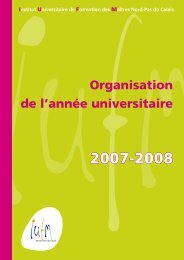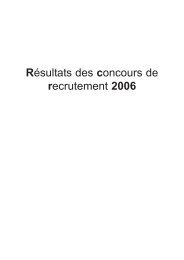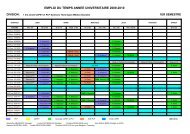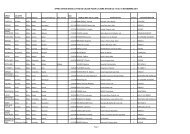Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Rapport de Recherche<br />
Institut Universitaire de Formation des Maîtres Nord-Pas de Calais<br />
Effets d’un mode de<br />
travail pédagogique<br />
« Freinet » en R.E.P.<br />
REUTER Yves (Dir.), THEODILE <strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais -<br />
Université Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />
Becousse Gérard, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />
Carra Céci<strong>le</strong> <strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais - CESDIP<br />
Cohen-Azria Cora, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />
Daunay Bertrand, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />
Delcambre Isabel<strong>le</strong>, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />
Fialip-Baratte Martine, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />
Hassan-Pilartz Rouba, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />
Haeberli Philippe, Université de Genève, Suisse<br />
Jovenet Anne-Marie, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />
Lahanier-Reuter Dominique, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />
Nonnon Élisabeth, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />
Pagoni Maria, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />
Novembre 2006<br />
Recherche soutenue par l’<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
et l’Université Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Tome 1
Sommaire<br />
Présentation de la recherche ................................................. 10<br />
1. Éléments d’histoire de la recherche ERTe .............................................................10<br />
2. Spécificités de cette recherche ............................................................................... 11<br />
3. Composition du rapport ...........................................................................................12<br />
4. Perspectives .............................................................................................................12<br />
Éléments bibliographiques ..........................................................................................13<br />
Les principes de fonctionnement de l’éco<strong>le</strong><br />
« Freinet » ....................................................................................................... 15<br />
1. L’éco<strong>le</strong> comme institution .......................................................................................15<br />
1.1. L’éco<strong>le</strong> est centrée sur <strong>le</strong>s apprentissages..............................................15<br />
1.2. L’éco<strong>le</strong> fait l’objet d’un travail d’institutionnalisation .............................16<br />
1.3. L’éco<strong>le</strong> est constituée comme une société ..............................................16<br />
1.4. Cette société s’appuie sur un idéal démocratique ..................................17<br />
1.5. Cette société se construit une culture commune....................................17<br />
1.6. Cette société ne vit pas en autarcie ..........................................................18<br />
1.7. Trois remarques et deux questions en suspens .....................................18<br />
2. Les élèves et <strong>le</strong>s apprentissages ............................................................................19<br />
2.1. Tout enfant peut apprendre, pourvu que <strong>le</strong> milieu soit favorab<strong>le</strong> ..........19<br />
2.2. L’enfant est à construire comme sujet apprenant ...................................19<br />
2.3. C’est l’élève qui apprend ...........................................................................20<br />
2.4. L’élève apprend à partir de ses questionnements ..................................20<br />
2.5. L’élève apprend en faisant .........................................................................21<br />
2.6. L’élève apprend aussi en se distanciant du faire ....................................21<br />
2.7. L’élève apprend au travers d’une multiplicité de rô<strong>le</strong>s ...........................22<br />
2.8. L’élève apprend en expérimentant différentes formes de pensée .........22<br />
2.9. L’élève apprend parce qu’il est sécurisé ..................................................23<br />
2.10. L’enfant apprend parce qu’il peut se situer dans une histoire.............24<br />
3. La part du maître ......................................................................................................24<br />
3.1. Chacun à sa place mais avec un maximum de coopération ..................24<br />
3.2. Des dispositifs essentiels ..........................................................................24<br />
3.3. Le maître comme garant ............................................................................25<br />
3.4. Le maître comme adjuvant ........................................................................25<br />
3.5. Le maître comme équilibriste ....................................................................25<br />
4. Questions et débats .................................................................................................26<br />
4.1. Précaution de <strong>le</strong>cture .................................................................................26<br />
4.2. Questions en suspens ...............................................................................26<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Références bibliographiques ......................................................................................28<br />
Univers de vio<strong>le</strong>nce des enseignants, systèmes<br />
de régulation et pratiques professionnel<strong>le</strong>s ........ 29<br />
1. Le vécu de vio<strong>le</strong>nce..................................................................................................30<br />
1.1. Le sentiment de vio<strong>le</strong>nce des enseignants : enquête de victimation....30<br />
1.2. Analyse d’incidents ...................................................................................34<br />
2. Les processus de régulation de la vie scolaire .....................................................40<br />
2.1. La gestion des conflits ...............................................................................40<br />
2.2. Le conseil d’enfants : un dispositif central<br />
de régulation de la vie scolaire ........................................................................42<br />
2.3. Ouverture aux parents et clôture symbolique de l’éco<strong>le</strong> ........................44<br />
2.4. Rituels, activités scolaires et chefs « d’œuvre » .....................................46<br />
3. Climat d’éco<strong>le</strong>, rapport aux élèves et rapport au métier.......................................48<br />
3.1. Les effets du fonctionnement d’éco<strong>le</strong> sur son climat et<br />
<strong>le</strong> sentiment de vio<strong>le</strong>nce des élèves ................................................................48<br />
3.2. Rapport aux élèves, rapport au métier .....................................................49<br />
bibliographie ................................................................................................................51<br />
Annexes ........................................................................................................................52<br />
Changement d’éco<strong>le</strong><br />
et pratiques pédagogiques ........................................................ 54<br />
1. Changement d’éco<strong>le</strong> : quel intérêt pour la recherche ? .......................................55<br />
1.1. Le changement comme révélateur de la construction du « soi » ..........56<br />
1.2. La stabilité du « soi » à l’éco<strong>le</strong> : trois positions d’élève .........................57<br />
2. Changement d’éco<strong>le</strong> : analyse comparative de cas..............................................59<br />
2.1. Justine et Inès .............................................................................................60<br />
2.2. Nas et Raïssa ..............................................................................................61<br />
2.3. Tom et Boris ................................................................................................63<br />
3. Comparaisons généra<strong>le</strong>s et modes de travail pédagogique ................................65<br />
3.1. Les activités scolaires................................................................................65<br />
3.2. Les relations élèves/adultes ......................................................................70<br />
3.3. Les relations entre pairs ............................................................................75<br />
4. Le cas particulier des élèves en souffrance ..........................................................80<br />
Références bibliographiques ......................................................................................83<br />
Protoco<strong>le</strong>s des évaluations nationa<strong>le</strong>s, CE2-6 e ,<br />
et évolution des résultats des élèves de l’éco<strong>le</strong><br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Hélène Boucher........................................................................................ 85<br />
1. Objectifs et méthode ................................................................................................85<br />
1.1. Objectifs généraux ....................................................................................85<br />
1.2. Précisions et restrictions ...........................................................................86<br />
1.3. Des difficultés techniques et méthodologiques<br />
qui imposent la prudence .................................................................................87<br />
2. Résultats globaux.....................................................................................................88<br />
2.1. Rappel des principaux résultats pour <strong>le</strong> CE2 jusqu’en 2004 .................88<br />
2.2 Rappel des principaux résultats pour la 6 e jusqu’en 2004 .......................89<br />
2.3. Les résultats de 2005 : comparaison des distributions<br />
des scores globaux et évolution entre 2002 et 2005 ......................................90<br />
2.4 À propos de l’effet de la variab<strong>le</strong> temporel<strong>le</strong> en français ........................94<br />
2.5. Fragilités et forces : scores dans certains types d’items .......................95<br />
2.6. Dispersion des élèves : homogénéité des résultats ...............................97<br />
Bibliographie .................................................................................................................99<br />
Annexes ........................................................................................................................99<br />
Annexe 1 : protoco<strong>le</strong>s d’évaluation .................................................................99<br />
Annexe 2 : taux de réussites à des items spécifiques à un domaine.........100<br />
Écrire en petite et moyenne sections ....................... 103<br />
1. L’écrit à l’éco<strong>le</strong> Freinet : état des lieux .................................................................103<br />
2. Des résultats convergents.....................................................................................104<br />
2.1. L’élément fédérateur : <strong>le</strong> travail et <strong>le</strong>s activités .....................................104<br />
2.2. Clarté cognitive .........................................................................................105<br />
2.3. Le rapport à l’écrit ....................................................................................105<br />
3. Cadrage théorique et méthodologique .................................................................106<br />
4. Ressemblances .....................................................................................................107<br />
4.1. Le rapport à l’écriture domestique..........................................................107<br />
5. Dissemblances .......................................................................................................108<br />
5.1. Le rapport à l’écriture domestique..........................................................108<br />
5.2. Le rapport à l’écriture scolaire ................................................................ 111<br />
5.3. La sérénité ................................................................................................. 113<br />
5.4. La clarté cognitive .................................................................................... 113<br />
Conclusion .................................................................................................................. 115<br />
Bibliographie ............................................................................................................... 116<br />
Annexe : questionnaire .............................................................................................. 117<br />
Langue et métalangage : comparaison des<br />
compétences dans deux éco<strong>le</strong>s aux modes de<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
travail pédagogique différents ........................................... 119<br />
1. Maîtrise de l’orthographe.......................................................................................120<br />
1.1. Principes d’analyse ..................................................................................120<br />
1.2. Résultats....................................................................................................121<br />
1.3. Conclusion ................................................................................................123<br />
2. Maîtrise métalinguistique ......................................................................................123<br />
2.1. Présentation des tests .............................................................................123<br />
2.2. Réponses aux questions .........................................................................125<br />
2.3. Justification des réponses .....................................................................126<br />
2.4. Conclusion ................................................................................................127<br />
Références ..................................................................................................................128<br />
Annexe 1 : principes théoriques et méthodologiques ............................................129<br />
1. Comptage des mots ...................................................................................129<br />
2. Gril<strong>le</strong> d’analyse des erreurs d’orthographe ..............................................129<br />
3. Comptage des mots erronés et des erreurs concernant l’orthographe .130<br />
Annexe 2 : re<strong>le</strong>vé des erreurs orthographiques ......................................................132<br />
1. Re<strong>le</strong>vé des erreurs dans <strong>le</strong>s évaluations CE2 ..........................................132<br />
2. Re<strong>le</strong>vé des erreurs dans <strong>le</strong>s évaluations 6 e .............................................133<br />
Annexe 3 : tests métalinguistiques ..........................................................................134<br />
La production textuel<strong>le</strong> :<br />
cinq ans d’analyse .............................................................................. 138<br />
1. Les principes méthodologiques adoptés .............................................................138<br />
1.1. Les catégories d’écrits .............................................................................138<br />
1.2. Les consignes et la passation .................................................................139<br />
1.3. Le corpus analysé ....................................................................................140<br />
1.4. Les critères appliqués ..............................................................................140<br />
2. Les récits sollicitant l’imaginaire (R.S.I.)..............................................................141<br />
2.1. L’analyse des R.S.I. ..................................................................................141<br />
2.2. Comparaison des résultats avec <strong>le</strong>s élèves de milieu équiva<strong>le</strong>nt .......142<br />
2.3. Comparaison des résultats avec <strong>le</strong>s élèves<br />
travaillant en pédagogie du projet .................................................................142<br />
2.4. Comparaison des résultats avec des élèves de milieu plus favorisé..143<br />
2.5. Éléments de synthèse sur <strong>le</strong>s R.S.I. .......................................................143<br />
3. Les récits sollicitant <strong>le</strong> vécu (R.S.V.) ....................................................................144<br />
3.1. L’analyse des R.V.S. .................................................................................144<br />
3.2. Comparaison des résultats......................................................................144<br />
3.3. Comparaison des résultats avec <strong>le</strong>s élèves<br />
travaillant en pédagogie du projet .................................................................145<br />
3.4. Comparaison des résultats avec des élèves de milieu plus favorisé..145<br />
3.5. Éléments de synthèse sur <strong>le</strong>s R.S.V. ......................................................146<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
4. Les descriptions .....................................................................................................147<br />
4.1. L’analyse des descriptions ......................................................................147<br />
4.2. Comparaison des résultats du CP au CM2 ............................................147<br />
4.3. La vision de l’éco<strong>le</strong> ...................................................................................148<br />
4.4. Éléments de synthèse sur <strong>le</strong>s descriptions ...........................................148<br />
5. Éléments de comparaison entre <strong>le</strong>s catégories d’écrits ....................................149<br />
6. Remarques sur la dimension diachronique ........................................................150<br />
6.1. Variations selon <strong>le</strong>s classes ....................................................................150<br />
6.2. Variations selon <strong>le</strong>s niveaux ....................................................................150<br />
6.3. Variations selon <strong>le</strong>s dimensions .............................................................151<br />
6.4. Variations selon <strong>le</strong>s années .....................................................................151<br />
6.5. Mais un bilan global net ...........................................................................151<br />
7. L’analyse des entretiens ........................................................................................151<br />
8. Les relations à l’univers de l’écrit .........................................................................153<br />
8.1. Un univers riche et co-construit ........................................................................154<br />
8.2. Des pratiques singulières ........................................................................154<br />
8.3. Six principes remarquab<strong>le</strong>s .....................................................................155<br />
8.4. Un univers de l’écrit solidement constitué ............................................156<br />
9. Retour sur la langue ...............................................................................................156<br />
Éléments bibliographiques ........................................................................................158<br />
Les entretiens du matin en maternel<strong>le</strong> :<br />
données complémentaires ...................................................... 161<br />
1. Caractérisation pédagogique des séances observées .......................................161<br />
1.1. L’entretien du matin, un genre scolaire ?...............................................162<br />
2. Structures de la communication scolaire ............................................................163<br />
2.1. Durée des séances ....................................................................................................<br />
2.2. Rapidité des échanges .............................................................................165<br />
2.3. Ritualisation des prises de paro<strong>le</strong> et construction de rô<strong>le</strong>s<br />
communicationnels .........................................................................................166<br />
2.4. Contrô<strong>le</strong> du dialogue col<strong>le</strong>ctif et productivité<br />
des échanges entre élèves .............................................................................168<br />
2.5. Que conclure ?..........................................................................................169<br />
3. Les formes de l’accompagnement langagier : la part du dialogue<br />
dans <strong>le</strong> polylogue .......................................................................................................170<br />
3.1. Fréquence et répartition des dilogues....................................................171<br />
3.2. Nombre d’élèves intervenant dans <strong>le</strong>s SD .............................................172<br />
3.3. La qualité interactionnel<strong>le</strong> des SD ..........................................................174<br />
3.4. Longueur des Séquences Dialoguées ....................................................176<br />
3.5. Trilogues ....................................................................................................177<br />
3.6. Vers une typologie des séquences dialoguées .....................................178<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
3.7. Conclusion ................................................................................................181<br />
Bibliographie ..............................................................................................................183<br />
Annexe 1 .....................................................................................................................184<br />
Conférences, comptes-rendus de <strong>le</strong>cture :<br />
compétences d’écoute et d’exposition .................. 185<br />
1. Les indicateurs liés à la prise en compte du langage dans sa fonction de<br />
socialisation ................................................................................................................187<br />
1. 1. Pour ceux qui exposent ..........................................................................187<br />
1. 2. Pour <strong>le</strong>s auditeurs ...................................................................................192<br />
2. Les indicateurs liés à la prise en compte du langage dans ses fonctions<br />
cognitives ....................................................................................................................194<br />
2. 1. Pour ceux qui exposent .........................................................................194<br />
2. 2. Pour ceux qui écoutent et questionnent ...............................................198<br />
3. Les indicateurs liés au langage dans ses aspects linguistiques et textuels....201<br />
Activités scientifiques et<br />
conduites langagières ................................................................... 205<br />
1. Conduites langagières et construction des activités .........................................205<br />
1.1. L’introduction de l’activité scientifique ..................................................205<br />
1.2. Les problèmes posés ..............................................................................206<br />
1.3. Les questions posées par l’enseignante<br />
et <strong>le</strong>ur rapport à la situation d’action .............................................................208<br />
1.4. Trois mises en œuvre différentes de l’activité scientifique ..................210<br />
2. Regards sur <strong>le</strong>s objets ..........................................................................................210<br />
2.1. Catégories d’objets ..................................................................................210<br />
2.2. Usages différenciés des objets selon <strong>le</strong>s classes.................................212<br />
3. Scénarios des activités scientifiques ...................................................................214<br />
4. Liens avec <strong>le</strong>s résultats précédents .....................................................................214<br />
Annexes ......................................................................................................................217<br />
Annexe 1 : Séance du 24/11/2003<br />
(classe des petits-moyens – F.) : activité EAU ..............................................217<br />
Annexe 2 : Séance du 02/02/2004<br />
(classe des petits-moyens – S.) : activité EAU .............................................219<br />
Annexe 3 : Séance du 02/02/2004<br />
(classe des petits-moyens – J.) : activité Ciseaux .......................................226<br />
Pratiques langagières dans <strong>le</strong>s classes de<br />
mathématiques ..................................................................................... 230<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
1. Objet d’étude et méthodologie ..............................................................................230<br />
2. Comparaison de productions d’élèves « suscitées » .........................................231<br />
2.1. Les prises en compte à l’écrit<br />
de la structure géométrique de la figure .......................................................232<br />
2.2. Les autres caractéristiques de l’écrit .....................................................236<br />
3. modes d’étude et pratiques langagières dans la classe ....................................240<br />
3.1. Les objets d’étude et <strong>le</strong>s modes d’études dans <strong>le</strong>s temps plutôt<br />
individuels ........................................................................................................240<br />
3.2. Les objets d’étude et <strong>le</strong>s modes d’étude col<strong>le</strong>ctifs ...............................243<br />
3.3. Énoncés et consignes, supports du travail col<strong>le</strong>ctif .............................248<br />
3.4. Analyse des interactions verba<strong>le</strong>s ..........................................................251<br />
3.5. Analyse des interventions ora<strong>le</strong>s de l’enseignant ................................252<br />
3.6. Analyse des interventions des élèves<br />
durant <strong>le</strong>s séquences observées ...................................................................258<br />
4. En guise de conclusion .........................................................................................264<br />
4.1. La cohérence des pratiques langagières dans <strong>le</strong>s classes de<br />
mathématiques ................................................................................................264<br />
4.2. L’adéquation aux analyses des compétences et des attitudes<br />
des élèves de cet établissement ....................................................................265<br />
4.3. La cohérence entre <strong>le</strong>s résultats apportés et ceux des autres<br />
membres de l’équipe .......................................................................................266<br />
Références bibliographiques ....................................................................................266<br />
Annexes.......................................................................................................................268<br />
Annexe 1 : Graphe implicatif des relations entre items<br />
décrivant <strong>le</strong>s positions d’écriture en géométrie ...........................................268<br />
Annexe 2 : Énoncés de la séquence « corrections » ...................................268<br />
Annexe 3 : Tab<strong>le</strong>aux supplémentaires ...........................................................269<br />
Regards sur <strong>le</strong>s contenus de savoirs<br />
en sciences à partir de productions écrites<br />
suscitées ........................................................................................................ 270<br />
1. Présentation de la recherche ................................................................................270<br />
2. Analyse des questionnaires sur <strong>le</strong> volcanisme ...................................................271<br />
2.1. Dessins, annotations, explications schématisées ................................272<br />
2.2. Types de volcans ......................................................................................274<br />
2.3. Explication du volcanisme.......................................................................277<br />
2.4. Sur <strong>le</strong> travail des chercheurs...................................................................279<br />
2.5. Ajout d’informations scientifiques ..........................................................280<br />
2.6. Formulation de questions par <strong>le</strong>s élèves ...............................................281<br />
2.7. Stratégies déclarées de documentation .................................................282<br />
2.8. Quantité d’écriture ....................................................................................287<br />
2.9. Spécificités des éco<strong>le</strong>s ............................................................................287<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
2.10. Une sous-population particulière .........................................................288<br />
3. Analyse des questionnaires sur la technologie ..................................................289<br />
3.1. Flotte, cou<strong>le</strong> ? éléments d’explications ..................................................289<br />
3.2. La pi<strong>le</strong> et son fonctionnement .................................................................290<br />
3.3. Déclarations des moyens d’auto-vérification ........................................292<br />
3.4. Souvenirs d’expériences .........................................................................293<br />
3.5. Spécificités des éco<strong>le</strong>s ............................................................................294<br />
4. Éléments de synthèse ............................................................................................295<br />
Bibliographie ...............................................................................................................296<br />
Annexes.......................................................................................................................297<br />
Annexe 1 Questionnaire sur <strong>le</strong>s volcans.......................................................297<br />
Annexe 2 Questionnaire sur la technologie ..................................................298<br />
Construire des apprentissages en éducation<br />
civique et mora<strong>le</strong> ................................................................................. 299<br />
1. Évaluation du jugement moral des élèves à partir de petites situations<br />
de conflit ......................................................................................................................300<br />
1.1. Précisions méthodologiques ...................................................................300<br />
1.2. Analyse des résultats ...............................................................................301<br />
1.3. Pour une synthèse....................................................................................312<br />
2. Les conseils d’élèves .............................................................................................313<br />
2.1. Définition de la gril<strong>le</strong> d’analyse ...............................................................313<br />
2.2. Présentation des résultats .......................................................................315<br />
Bibliographie ...............................................................................................................322<br />
Annexes.......................................................................................................................324<br />
Analyse des actes de langage des élèves- Éco<strong>le</strong> HB -<br />
Classe de CM1 (19/04/02) ................................................................................324<br />
Analyse des actes de langage des élèves – Éco<strong>le</strong> HB -<br />
CM2 (11/02/2003) ..............................................................................................326<br />
Éléments de synthèse :<br />
bilan et perspectives ...................................................................... 327<br />
1. Les intérêts de l’expérience menée ......................................................................327<br />
2. De quelques problèmes .........................................................................................329<br />
3. La diffici<strong>le</strong> question de la transférabilité ..............................................................330<br />
3.1. La transférabilité : hypothèses sur <strong>le</strong> possib<strong>le</strong> et <strong>le</strong> souhaitab<strong>le</strong> ........330<br />
3.2. La transférabilité : de quelques problèmes en suspens.......................331<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Présentation de la recherche<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Yves REUTER<br />
Professeur des universités<br />
Université de Lil<strong>le</strong> III<br />
Équipe THEODILE<br />
Ce rapport s’appuie sur la recherche subventionnée par l’lUFM du Nord-Pas-de-Calais,<br />
Effets d’un mode de travail pédagogique « Freinet » en REP (R / Riu / 0 /0 - 0 -0 - 00<br />
- - - 00 ) qui visait à approfondir et à spécifier certains résultats obtenus dans <strong>le</strong> cadre<br />
d’investigations antérieures (ERTe 0 : Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec<br />
scolaire) soutenues par la Direction de la Recherche du Ministère de l’Éducation Nationa<strong>le</strong><br />
et qui ont fait l’objet d’un rapport précédent (Y. Reuter, dir., 00 : Démarches pédagogiques<br />
et lutte contre l’échec scolaire - 00 - 00 , document tapuscrit, <strong>tome</strong>s). Il convient donc<br />
d’en rappe<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s éléments essentiels avant de présenter plus précisément <strong>le</strong>s principes de<br />
cette nouvel<strong>le</strong> recherche.<br />
1. Éléments d’histoire de la recherche ERTe 1<br />
Le groupe scolaire Concorde, situé dans <strong>le</strong> REP de Mons-en-Barœul, a été pris en charge<br />
par une nouvel<strong>le</strong> équipe d’enseignants se réclamant de la pédagogie Freinet à la rentrée<br />
scolaire 00 .<br />
Cette équipe est arrivée dans un groupe scolaire (éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> Anne Franck ; éco<strong>le</strong><br />
élémentaire Hélène Boucher) dont la réputation s’était cristallisée autour de résultats scolaires<br />
problématiques et d’un climat de relative vio<strong>le</strong>nce engendrant une baisse tendanciel<strong>le</strong> des<br />
inscriptions, qui risquait d’entraîner la fermeture de classes.<br />
Le projet alors mis en place a résulté de la convergence de deux logiques principa<strong>le</strong>s :<br />
cel<strong>le</strong> de certains membres de la « Régiona<strong>le</strong> » de l’ICEM (Institut Coopératif de l’Éco<strong>le</strong><br />
Moderne) qui souhaitaient pouvoir travail<strong>le</strong>r ensemb<strong>le</strong> afin d’élaborer et de mettre en œuvre<br />
un projet pédagogique commun, de la petite section au CM et cel<strong>le</strong> de l’inspecteur de la<br />
circonscription qui cherchait des moyens pour «remonter» ce groupe et lutter contre l’échec<br />
scolaire, dans un environnement social caractérisé par une grande précarité.<br />
De fait, la concrétisation de ce projet est attribuab<strong>le</strong>, en majeure partie, à la ténacité de cet<br />
IEN et à l’intelligence institutionnel<strong>le</strong> qu’il a déployée (montage du dossier, communication<br />
et négociation avec la hiérarchie, l’équipe pédagogique alors en place, <strong>le</strong>s syndicats, la<br />
municipalité...). Il a de surcroît souhaité que ces changements s’accompagnent de la mise<br />
en œuvre de deux principes : maintenir <strong>le</strong>s fonctionnements « ordinaires » d’une éco<strong>le</strong><br />
de quartier afin d’éviter l’instauration d’une expérimentation « vitrine » et de se donner <strong>le</strong>s<br />
moyens d’appréhender ce qui est attribuab<strong>le</strong> aux dispositifs installés, sans autre apport<br />
spécifique ; soumettre cette expérience - a- typique dans <strong>le</strong> paysage scolaire français - à<br />
une recherche évaluative afin de mieux en comprendre <strong>le</strong>s intérêts et <strong>le</strong>s limites.<br />
C’est dans ce cadre que des contacts ont été noués avec l’équipe de recherche THEODILE<br />
et que <strong>le</strong> projet de recherche a été élaboré au travers de réunions, formel<strong>le</strong>s et informel<strong>le</strong>s,<br />
Sur cette histoire et <strong>le</strong>s problèmes qu’el<strong>le</strong> soulève, ainsi que sur <strong>le</strong>s principes méthodologiques et<br />
<strong>le</strong>ur discussion, voir Reuter et Carra, 00 .
pendant plusieurs mois.<br />
Après diverses péripéties, <strong>le</strong> dossier de recherche a été présenté à la Direction de la<br />
Recherche du Ministère de L’Éducation Nationa<strong>le</strong> et retenu en tant qu’ERTe (Équipe de<br />
Recherche Technologique en Éducation) dans <strong>le</strong> cadre du contrat quadriennal ( 00 - 00 )<br />
de l’Université de Lil<strong>le</strong> .<br />
Cette ERTe s’est constituée autour de quatre questions principa<strong>le</strong>s :<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
cel<strong>le</strong> de la description du mode de travail pédagogique tel qu’il a été mis en place ;<br />
cel<strong>le</strong> de ses effets, de <strong>le</strong>ur nature, de <strong>le</strong>ur temporalité ;<br />
cel<strong>le</strong> des relations entre <strong>le</strong>s pratiques pédagogiques et ces effets ;<br />
cel<strong>le</strong> de la transférabilité éventuel<strong>le</strong> des dispositifs mis en œuvre.<br />
El<strong>le</strong> s’est en outre appuyée sur cinq principes méthodologiques essentiels :<br />
– une durée longue (au moins cinq années) afin de pouvoir suivre <strong>le</strong> devenir d’élèves<br />
ayant effectué toute <strong>le</strong>ur scolarité primaire au sein de ce mode de travail et de pouvoir<br />
appréhender la différenciation temporel<strong>le</strong> des effets éventuels ;<br />
– des investigations « non collaboratives » avec <strong>le</strong>s enseignants afin de ne pas influer<br />
sur <strong>le</strong>urs pratiques ;<br />
– un grand nombre de comparaisons, aussi bien diachroniques que synchroniques ,<br />
afin d’analyser <strong>le</strong> plus précisément possib<strong>le</strong> <strong>le</strong>s évolutions et <strong>le</strong>urs modalités ainsi que<br />
<strong>le</strong>s effets spécifiques dus à ce mode de travail pédagogique ;<br />
– l’étude de dimensions diversifiées (déviances, relations éco<strong>le</strong>-famil<strong>le</strong>s, construction<br />
des normes et des va<strong>le</strong>urs, rapports à l’éco<strong>le</strong> et aux savoirs, apprentissages dans <strong>le</strong>s<br />
différentes disciplines...) ;<br />
– la confrontation de cadres théoriques et de techniques de recueil et de traitement des<br />
données diversifiés.<br />
Ces deux dernières dimensions notamment justifient la composition pluri-disciplinaire de<br />
l’équipe réunie (sociologue, psychologues, didacticiens du français, des mathématiques,<br />
des sciences...). L’ensemb<strong>le</strong> de ces principes visait, outre à garantir certaines normes de<br />
scientificité, à nous prémunir contre des approches des pédagogies « alternatives » trop<br />
souvent très lacunaires (ne prenant en compte que des aspects très restreints de la réalité<br />
concernée) tout en émettant des jugements monolithiques et généralisants (qu’ils soient<br />
positifs ou négatifs).<br />
2. Spécificités de cette recherche<br />
En fonction des travaux effectués et des résultats provisoires, il nous a donc semblé<br />
indispensab<strong>le</strong> de mener une nouvel<strong>le</strong> recherche visant notamment à :<br />
– affiner nos analyses quant aux apprentissages disciplinaires dans <strong>le</strong>s diverses<br />
disciplines considérées en tenant compte de <strong>le</strong>urs différentes dimensions (savoirs,<br />
savoir-faire, réf<strong>le</strong>xivité, rapports à, conscience disciplinaire...) ;<br />
–<br />
préciser la différenciation temporel<strong>le</strong> des effets observés (rythme, effets seuil ou<br />
L’expression est reprise à Marcel Lesne, .<br />
Cela explique, entre autres, vu la durée restreinte accordée aux ERTe ( / ans), la nécessité d’une<br />
nouvel<strong>le</strong> recherche complétant et affinant la précédente.<br />
Cela s’est par exemp<strong>le</strong> concrétisé par des retours très rares des analyses menées par <strong>le</strong>s chercheurs<br />
pendant <strong>le</strong>s deux premières années, ce qui n’a pas été sans engendrer diverses tensions...<br />
Avec des élèves, de milieu équiva<strong>le</strong>nt ou plus favorisé, travaillant selon d’autres modes de travail<br />
pédagogique.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
plafond...) en relation avec la durée d’immersion dans cette pédagogie ;<br />
– mieux fonder d’éventuel<strong>le</strong>s possibilités de transférabilité de composantes du système<br />
mis en place ainsi que <strong>le</strong>urs limites.<br />
Cela s’est effectué en produisant et en traitant des données complémentaires dont la<br />
nécessité était apparue au cours des investigations précédentes et en accentuant <strong>le</strong>s<br />
confrontations méthodologiques et disciplinaires au sein de l’équipe de recherche.<br />
3. Composition du rapport<br />
Comme <strong>le</strong> précédent rapport, celui-ci comprend deux <strong>tome</strong>s. Le second regroupe <strong>le</strong>s artic<strong>le</strong>s<br />
et <strong>le</strong>s communications des membres de l’équipe liées à cette recherche (Cohen-Azria,<br />
Delcambre, Jovenet, Reuter, 00 ; Delcambre et Cohen-Azria, 00 ; Jovenet, 00 et<br />
00 ; Lahanier-Reuter, 00 a et b et à paraître ; Pagoni et Haeberli, 00 ; Reuter, 00 ;<br />
Reuter et Carra, 00 ). Ce premier <strong>tome</strong> s’organise autour de quatre temps :<br />
– un rappel des principes de fonctionnement instaurés qui sont susceptib<strong>le</strong>s d’éclairer,<br />
au moins en partie, <strong>le</strong>s analyses menées, quels que soient <strong>le</strong> domaine ou la dimension<br />
étudiés ;<br />
– un ensemb<strong>le</strong> d’analyses portant sur des dimensions non strictement disciplinaires<br />
tels <strong>le</strong>s « climats » de l’éco<strong>le</strong>, la prise en compte d’élèves en difficulté, <strong>le</strong> vécu d’enfants<br />
qui arrivent d’autres groupes scolaires...<br />
–<br />
des études spécifiant <strong>le</strong>s questions liées aux apprentissages disciplinaires , que ce<br />
soit au travers des évaluations institutionnel<strong>le</strong>s ou d’instruments propres à l’équipe de<br />
recherche, en ce qui concerne l’entrée dans l’écrit, <strong>le</strong>s maniements de la langue et du<br />
métalangage, <strong>le</strong>s entretiens du matin à l’éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s pratiques langagières et<br />
la construction des savoirs en sciences, mathématiques, éducation civique et mora<strong>le</strong>;<br />
– des éléments de synthèse référant aux questions principa<strong>le</strong>s (cf. ) à la source de<br />
cette recherche.<br />
4. Perspectives<br />
II me reste à préciser que cette recherche ne s’arrête pas avec ce rapport. En effet, nous<br />
continuons nos investigations autour de deux axes qui nous paraissent fondamentaux pour<br />
la compréhension de ce mode de travail pédagogique et des effets qu’il génère :<br />
–<br />
la spécificité du sujet apprenant qui est construit au sein d’une communauté<br />
pédagogique (ce qui pose donc la question des relations entre individu et col<strong>le</strong>ctif au<br />
travers des dispositifs et des modes de fonctionnement instaurés) ? avec <strong>le</strong>s modalités<br />
de prise en compte des élèves en grande difficulté et / ou en souffrance et la manière<br />
dont ceux-ci se vivent et vivent <strong>le</strong>urs apprentissages dans ce cadre ;<br />
–<br />
la manière dont <strong>le</strong>s disciplines sont reconfigurées de manière singulière au travers<br />
des conceptions des enseignants, des pratiques et des activités mises en place et <strong>le</strong>s<br />
effets que cela engendre tant sur <strong>le</strong>s représentations disciplinaires des élèves que <strong>le</strong>urs<br />
apprentissages.<br />
Ces investigations impliquent de nouveaux membres, parfois didacticiens d’autres disciplines<br />
Auxquels il convient d’ajouter trois mémoires de Master : Bridoux, 00 ; Rivault, 00 et Van Meenen,<br />
00 ).<br />
En raison de problèmes de santé d’un des membres de l’équipe (G. Bécousse), la contribution prévue<br />
sur <strong>le</strong> devenir des élèves en sixième n’a pas pu être réalisée dans <strong>le</strong>s délais impartis.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
(histoire et géographie, par exemp<strong>le</strong>) et associent des doctorants (E. Van Meenen sur<br />
la conscience disciplinaire, C. Humbert-Prudhomme sur <strong>le</strong>s récits...) et des étudiants de<br />
Master.<br />
La socialisation de ces recherches continue el<strong>le</strong>-aussi avec de multip<strong>le</strong>s communications<br />
et artic<strong>le</strong>s programmés, ainsi qu’avec la publication prévue d’un ouvrage aux éditions<br />
de l’Harmattan en 00 : Une éco<strong>le</strong> Freinet. Fonctionnements et effets d’une pédagogie<br />
alternative en milieu populaire. Cela permettra, sans nul doute, au-delà de la valorisation<br />
nécessaire, des échanges qui nous amèneront à enrichir nos analyses voire à attirer notre<br />
attention sur de nouvel<strong>le</strong>s pistes à explorer.<br />
Éléments bibliographiques<br />
Bridoux L. ( 00 ), La pédagogie Freinet : une autre manière de considérer l’élève ?, Mémoire<br />
de Master en Sciences de l’Éducation, Université Char<strong>le</strong>s de Gaul<strong>le</strong> - Lil<strong>le</strong> .<br />
Cohen-Azria C., Delcambre I., Jovenet A.M., Reuter y. ( 00 ), « La question de l’invariance<br />
dans des recherches menées sur des temps longs », Communication au second séminaire<br />
international « Méthodes de recherche en didactiques », Questions de temporalité, <strong>IUFM</strong> du<br />
Nord-Pas-de-Calais, novembre.<br />
Delcambre I., Cohen-Azria C., ( 00 ), «Toucher, observer, dire: conduites langagières et<br />
scientifiques en maternel<strong>le</strong>». Communication aux XVIIe journées internationa<strong>le</strong>s sur la<br />
communication, l’éducation et la culture scientifiques, techniques et industriel<strong>le</strong>s, Chamonix,<br />
- novembre.<br />
Jovenet A.M. ( 00 ) « Le «Je» de l’élève est-il contraint par <strong>le</strong> rapport pédagogique ? »,<br />
Communication au Colloque international L’élève et la pluralité des appartenances. Être<br />
enfant, être élève à travers <strong>le</strong>s activités langagières, Paris, Sorbonne, - novembre.<br />
Jovenet A.M. ( 00 ), « Une «didactique appropriée aux difficultés des élèves» est-el<strong>le</strong><br />
tributaire des modes d’appréhension de ces difficultés ? », La nouvel<strong>le</strong> revue de l’AIS, n°<br />
, Adaptation et intégration scolaire, p. - .<br />
Lahanier-Reuter D. ( 00 a), « Comparaison de groupes d’élèves et analyse implicative »,<br />
Communication au colloque international ASI (Analyse Statistique Implicative), Païenne, -<br />
- octobre.<br />
Lahanier-Reuter D. ( 00 b), « Enseignement et apprentissages mathématiques dans une<br />
éco<strong>le</strong> « Freinet », Revue Française de Pédagogie, n° , Décrire, analyser, évaluer <strong>le</strong>s<br />
pédagogies nouvel<strong>le</strong>s, octobre-novembre-décembre, p. - .<br />
Lahanier-Reuter D. (à paraître), « Didactic of mathematics and implicative statistic analysis »,<br />
Contribution à l’ouvrage col<strong>le</strong>ctif, Statistical Implicative Analysis : theory and applications.<br />
Lesne M. ( ), Travail pédagogique et formation d’adultes, Paris, Presses Universitaires<br />
de France.<br />
Pagoni M., Haeberli P. ( 00 ), « Conseils d’élèves et savoirs en éducation civique<br />
et mora<strong>le</strong> : une étude comparative de deux établissements scolaires et France et en<br />
Suisse », Communication au colloque international de l’AFEC : L’Eco<strong>le</strong>, lieu de tensions<br />
et de médiations ; quels effets sur <strong>le</strong>s pratiques scolaires ? Analyses et comparaisons<br />
internationa<strong>le</strong>s. Université Char<strong>le</strong>s de Gaul<strong>le</strong> - Lil<strong>le</strong> , - juin 00 .<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Reuter Y. ( 00 ), « Les récits sollicitant <strong>le</strong> vécu au CM . Éléments d’analyse et de<br />
comparaison », Repères, n° , Écriture de soi et enseignement du récit, décembre.<br />
Reuter Y Carra C ( 00 ), « Analyser un mode de travail pédagogique «alternatif» : l’exemp<strong>le</strong><br />
d’un groupe scolaire travaillant en pédagogie «Freinet» », Revue Française de Pédagogie,<br />
n° , Décrire, analyser, évaluer <strong>le</strong>s pédagogies nouvel<strong>le</strong>s, octobre-novembre-décembre,<br />
p. - .<br />
Rivault A.S. ( 00 ), Ce que disent <strong>le</strong>s élèves de maternel<strong>le</strong> au sujet des apprentissages<br />
effectués lors des entretiens du matin. Mémoire de Master en Sciences de l’Éducation,<br />
Université Char<strong>le</strong>s de Gaul<strong>le</strong> - Lil<strong>le</strong> .<br />
Van meenen E ( 00 ) La conscience disciplinaire des élèves de C.2. Étude auprès de deux<br />
classes aux modes de fonctionnement pédagogique différents. Mémoire de Master en<br />
Sciences de l’Éducation, Université Char<strong>le</strong>s de Gaul<strong>le</strong> - Lil<strong>le</strong> .<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Les principes de fonctionnement de l’éco<strong>le</strong><br />
« Freinet »<br />
Yves REUTER<br />
Professeur des universités<br />
Université de Lil<strong>le</strong> III<br />
Équipe THEODILE<br />
L’enjeu de ce chapitre est d’objectiver <strong>le</strong>s principes qui régissent <strong>le</strong>s fonctionnements de<br />
l’éco<strong>le</strong> « Freinet » de Mons en Barœul , d’une part pour mieux saisir <strong>le</strong> mode de travail<br />
pédagogique mis en place, d’autre part afin de servir de référent – parmi d’autres – pour la<br />
compréhension des effets observés , enfin pour donner certains moyens afin de réfléchir à<br />
la question de la transférabilité .<br />
Pour construire ces principes, j’ai pris <strong>le</strong> parti de m’appuyer sur différents matériaux<br />
que l’équipe a constitués : observations, analyses des discours des maîtres (entretiens,<br />
conversations informel<strong>le</strong>s, paro<strong>le</strong>s recueillies lors de <strong>le</strong>urs réunions internes ou lors de<br />
réunions avec <strong>le</strong>s membres de l’Erte…), échanges des membres de notre équipe sur <strong>le</strong>s<br />
matériaux recueillis, analyses de chacun d’entre nous … Cela signifie donc que j’ai choisi de<br />
ne pas me fonder a priori sur <strong>le</strong>s écrits de Cé<strong>le</strong>stin Freinet ou ceux du mouvement Freinet, ni<br />
sur <strong>le</strong>s discours de principe des maîtres de cette éco<strong>le</strong>, afin de ne pas confondre principes<br />
affichés et principes réalisés, effectivement mis en œuvre.<br />
J’ai enfin privilégié un mode d’exposition en quatre parties (L’éco<strong>le</strong> comme institution ; Les<br />
élèves et <strong>le</strong>s apprentissages ; La part du maître ; Quelques questions en suspens) qui,<br />
je l’espère, est susceptib<strong>le</strong> de faciliter la <strong>le</strong>cture même s’il n’évite pas deux écueils, celui<br />
des redites et celui de la décomposition d’un mode de travail qui se caractérise par une<br />
interaction forte entre ses différentes composantes.<br />
1. L’éco<strong>le</strong> comme institution<br />
Cet intertitre a été retenu afin d’insister sur <strong>le</strong> fait que rien n’est posé comme naturel, tout<br />
est à penser, à constituer, à instituer, dans l’esprit des maîtres et dans <strong>le</strong>urs pratiques.<br />
C’est donc ce que je vais tenter de préciser au travers de six principes qui me paraissent<br />
essentiels et de quelques remarques et questions.<br />
1.1. L’éco<strong>le</strong> est centrée sur <strong>le</strong>s apprentissages<br />
Ce principe est sans nul doute fondamental et sans cesse réaffirmé. Il justifie <strong>le</strong>s autres,<br />
<strong>le</strong>s dispositifs mis en place et <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s, voire <strong>le</strong>s sanctions : une bonne part de ce qui est<br />
Ce chapitre a été soumis à discussion, aussi bien avec <strong>le</strong>s membres de l’équipe de recherche qu’avec<br />
ceux de l’équipe pédagogique du groupe scolaire. Qu’ils soient ici remerciés pour <strong>le</strong>urs apports.<br />
Sans ignorer <strong>le</strong>s problèmes sou<strong>le</strong>vés par la mise en relation d’un mode de travail donné avec <strong>le</strong>s<br />
performances des élèves (voir, quant aux principes fédéraux, Bru, Altet, Blanchard-Lavil<strong>le</strong> 00 et, quant à<br />
cette recherche, Reuter et Carra, 00 ).<br />
Voir <strong>le</strong> dernier chapitre de ce rapport.<br />
Cela explique <strong>le</strong>s renvois, explicites ou implicites, aux autres contributions.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
prohibé l’est parce que cela nuit aux apprentissages ou, du moins, au travail.<br />
Les apprentissages – et non l’enfant – sont donc au cœur du système mis en place. L’éco<strong>le</strong><br />
est faite pour apprendre et cela ne se réalise qu’au travers d’un travail sérieux. Nombre<br />
de termes reviennent d’ail<strong>le</strong>urs très fréquemment dans <strong>le</strong> discours des maîtres, voire des<br />
élèves, tels travail ou métier(s) et, de fait, <strong>le</strong> ludisme mis en avant dans d’autres cadres<br />
pédagogiques est ici dominé (j’y reviendrai).<br />
Ces apprentissages concernent et relient indissociab<strong>le</strong>ment des savoirs, des savoir faire<br />
et des savoir être. De ce point de vue, instruction et éducation sont au service l’une de<br />
l’autre – toute la suite de ce chapitre l’exemplifiera – et constituent ainsi des objectifs<br />
fondamentaux.<br />
1.2. L’éco<strong>le</strong> fait l’objet d’un travail d’institutionnalisation<br />
L’éco<strong>le</strong>, en tant que communauté, a été instituée – et est constamment réinstituée – au<br />
travers de divers mécanismes, parmi <strong>le</strong>squels figurent en premier lieu :<br />
– un projet institutionnel – se constituer au sein d’une éco<strong>le</strong>, dans son ensemb<strong>le</strong>,<br />
comme modè<strong>le</strong> de la pédagogie « Freinet » – qui s’est articulé à un contrat de travail et<br />
d’expérimentation avec l’Inspection académique et à un contrat de recherche avec une<br />
équipe universitaire ;<br />
– un projet pédagogique, véritab<strong>le</strong> , évalué et réélaboré col<strong>le</strong>ctivement, charte et garant<br />
du travail mis en œuvre ;<br />
– la cooptation, au sein du mouvement Freinet, des membres fondateurs et de ceux qui<br />
prennent la relève de ceux qui s’en vont ;<br />
–<br />
<strong>le</strong>s conseils (de classe, d’éco<strong>le</strong>, de maîtres…) multip<strong>le</strong>s, fréquents et véritab<strong>le</strong>ment<br />
fonctionnalisés.<br />
1.3. L’éco<strong>le</strong> est constituée comme une société<br />
L’éco<strong>le</strong> est constituée comme une micro-société, relativement autonome. Cela se marque<br />
notamment par l’élaboration de ses propres lois et règ<strong>le</strong>ments, par la mise en place d’instances<br />
de décision spécifiques, par son activité laborieuse et ses métiers, par l’élaboration d’une<br />
culture commune (cf. . ) et par une véritab<strong>le</strong> structuration de ses loisirs (récréations, fêtes,<br />
ateliers du soir animés, en partie, par <strong>le</strong>s maîtres ou <strong>le</strong>s parents) qui sont, dès lors intégrés<br />
au projet éducatif et non posés comme de simp<strong>le</strong>s zones de détente, à l’écart du travail et<br />
des règ<strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctives .<br />
Conséquemment, ses membres – maîtres et élèves – sont institués, solidairement, comme<br />
des citoyens scolaires. Complémentairement encore, sociabilité et citoyenneté sont des<br />
principes centraux en ce qu’ils sont posés, constamment, comme objectifs, objets et<br />
Il est clair que la récurrence de ces termes n’est pas sans rapport avec des principes idéologicopolitiques<br />
en relation avec une solidarité affichée avec <strong>le</strong> monde ouvrier.<br />
Ces contrats ont été élaborés au sein de réunions préparatoires, en grande partie informel<strong>le</strong>s. Il est<br />
certain qu’ils sont entrés, en partie au moins, en tension avec <strong>le</strong> projet institutionnel initial. Ils ont donc été, en<br />
pratique, en constante (re) négociation.<br />
Projet « véritab<strong>le</strong> » car élaboré col<strong>le</strong>ctivement, détaillé, approprié et appliqué…<br />
Cela ne s’est produit qu’une seu<strong>le</strong> fois en trois ans pour rapprochement de conjoints.<br />
On pourrait ainsi par<strong>le</strong>r d’une « pédagogisation » généralisée de la vie scolaire et péri-scolaire.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
conditions d’apprentissage. Ce sont ainsi des principes à vivre et de vie et non des objets<br />
discursifs ponctuels, essentiel<strong>le</strong>ment convoqués lors de rappels à l’ordre ou de moments<br />
d’éducation civique.<br />
1.4. Cette société s’appuie sur un idéal démocratique<br />
Cette micro-société s’articu<strong>le</strong> à un idéal démocratique, certes référent du discours des<br />
maîtres, mais surtout mis à l’épreuve au quotidien, quel<strong>le</strong>s qu’en soient <strong>le</strong>s difficultés. Il ne<br />
s’agit donc de <strong>le</strong> poser / de l’imposer, seu<strong>le</strong>ment discursivement et pour un avenir plus ou<br />
moins éloigné, mais de tenter de <strong>le</strong> faire vivre au sein de l’éco<strong>le</strong> comme un bien commun.<br />
Dans cette perspective, de multip<strong>le</strong>s principes et dispositifs visent à étayer ce projet 0 :<br />
<strong>le</strong>s citoyens-élèves sont posés comme égaux quant aux droits et aux devoirs (avec<br />
des mécanismes de contrô<strong>le</strong> tels la rotation institutionnel<strong>le</strong> des tâches et des métiers,<br />
<strong>le</strong>s conseils de classe…) ;<br />
aucun destin d’élève n’est figé : <strong>le</strong>s droits peuvent se perdre mais aussi se<br />
récupérer ;<br />
<strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s sont élaborées col<strong>le</strong>ctivement – au sein des conseils de classe et d’éco<strong>le</strong> –<br />
el<strong>le</strong>s sont votées, mises à l’épreuve avant d’être retenues, socialisées (via <strong>le</strong>s multip<strong>le</strong>s<br />
affichages au sein de l’éco<strong>le</strong> et dans <strong>le</strong>s classes) afin que nul ne <strong>le</strong>s ignore et, el<strong>le</strong>s<br />
demeurent modifiab<strong>le</strong>s ;<br />
chacun y est soumis, maîtres et élèves11 –<br />
–<br />
–<br />
–<br />
, ce qui est sans nul doute fondamental pour<br />
<strong>le</strong> respect mutuel et la croyance des élèves en la va<strong>le</strong>ur des règ<strong>le</strong>s et des lois ;<br />
– la coopération et l’entraide – et non la compétition – constituent des principes de<br />
fonctionnement privilégiés au travers, par exemp<strong>le</strong>, du travail col<strong>le</strong>ctif, de la présence<br />
d’un matériel de prêt (avec un métier lié au prêt), des incitations du maître, de l’affichage<br />
au tab<strong>le</strong>au des demandes d’aide, de l’absence de stigmatisation des difficultés et des<br />
erreurs (cf. )… ;<br />
–<br />
<strong>le</strong>s problèmes qui apparaissent peuvent être débattus col<strong>le</strong>ctivement et rapidement<br />
au travers de moments et de dispositifs prévus à cet effet, ce qui – sans rég<strong>le</strong>r<br />
miracu<strong>le</strong>usement toutes <strong>le</strong>s difficultés – évite plusieurs écueils : <strong>le</strong>ur occultation, <strong>le</strong>ur<br />
traitement par <strong>le</strong> maître seul ou par <strong>le</strong>s élèves entre eux de manière expéditive, <strong>le</strong>ur<br />
traitement à chaud et sans recours aux règ<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>ur retour incessant dans <strong>le</strong>s mêmes<br />
formes…<br />
1.5. Cette société se construit une culture commune<br />
Il existe une volonté de construire un patrimoine commun, de cette société conscientisée en<br />
tant que tel<strong>le</strong>, au travers de la constitution et de la conservation des expériences vécues, des<br />
discours, des écrits, des dessins, des sculptures… au travers aussi de multip<strong>le</strong>s instruments<br />
(cahiers de classe, affichages, archivages …). Cette culture, susceptib<strong>le</strong> de forger des<br />
0 Ces dispositifs sont plus particulièrement détaillés dans <strong>le</strong>s contributions de Céci<strong>le</strong> Carra et de Maria<br />
Pagoni, dans ce rapport ainsi que dans <strong>le</strong> précédent (Reuter, dir. 00 b).<br />
Les maîtres veil<strong>le</strong>nt scrupu<strong>le</strong>usement à ce principe, y compris lors de la venue d’autres adultes dans<br />
<strong>le</strong>urs classes…<br />
La volonté d’archivage est parfois extraordinaire chez <strong>le</strong>s maîtres et devrait nécessiter à ce titre des<br />
études complémentaires. Volonté de garder une trace de <strong>le</strong>ur travail, émerveil<strong>le</strong>ment devant <strong>le</strong> parcours de<br />
certains élèves, illusions quant à la compréhension des apprentissages au travers d’un archivage à prétention<br />
exhaustive… ?<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
identités (d’éco<strong>le</strong>, de classe…), assume de multip<strong>le</strong>s fonctions : base de travail (par exemp<strong>le</strong><br />
pour la <strong>le</strong>cture au CP), trace d’une histoire col<strong>le</strong>ctive et individuel<strong>le</strong>, patrimoine assumé . El<strong>le</strong><br />
constitue sans doute une réponse spécifique à la tension entre culture scolaire et cultures<br />
extrascolaires (filtrées et reconstruites à des fins d’apprentissage), une médiation vers des<br />
formes estimées plus légitimes, un outil alternatif face aux prérequis souvent invoqués.<br />
1.6. Cette société ne vit pas en autarcie<br />
Cependant, même autonomisée et dotée de fonctionnements spécifiques, cette microsociété<br />
n’est nul<strong>le</strong>ment refermée sur el<strong>le</strong>-même. El<strong>le</strong> est, au contraire, largement ouverte sur <strong>le</strong><br />
monde extérieur. Ainsi, <strong>le</strong>s savoirs et <strong>le</strong>s savoir-faire enseignés sont constamment référés à<br />
<strong>le</strong>ur fonctionnalité dans <strong>le</strong> monde extrascolaire et la curiosité des élèves est incessamment<br />
stimulée. Chaque classe a des correspondants, avec une activité épistolaire intense. Le<br />
col<strong>le</strong>ctif des enseignants va au devant des famil<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>s constitue en soutiens scolaires<br />
(en parents d’élèves et non seu<strong>le</strong>ment d’enfants) : ils sont accueillis lors des fêtes ou des<br />
présentations des travaux d’élèves, <strong>le</strong> samedi matin ; régulièrement informés, via <strong>le</strong>s cahiers<br />
de liaison ou des affichages réguliers et explicites à l’entrée de l’éco<strong>le</strong> ; sollicités pour des<br />
entretiens avec <strong>le</strong> maître, même en l’absence de problèmes, invités pour des conférences<br />
ou incités à animer des ateliers du soir … De surcroît, des dispositifs comme <strong>le</strong>s textes<br />
libres ou <strong>le</strong>s entretiens et <strong>le</strong>s « quoi de neuf » du matin permettent de faire circu<strong>le</strong>r des<br />
expériences, des objets, des savoirs, du vécu… entre l’éco<strong>le</strong> et la famil<strong>le</strong> mais toujours de<br />
manière très codifiée et à des fins d’apprentissage …<br />
1.7. Trois remarques et deux questions en suspens<br />
Les fonctionnements décrits appel<strong>le</strong>nt au moins trois remarques. La première renvoie à<br />
l’autorité et au pouvoir, assumés, des maîtres, nécessaires pour garantir <strong>le</strong>s principes et<br />
<strong>le</strong>ur mise en œuvre, en tenant compte néanmoins du fait que cette autorité et ce pouvoir<br />
sont eux-mêmes soumis à des règ<strong>le</strong>s et des contrô<strong>le</strong>s internes (<strong>le</strong>s lois de l’éco<strong>le</strong> et <strong>le</strong>s<br />
conseils) et externes (<strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif des maîtres, <strong>le</strong>s principes du mouvement Freinet…). Cela<br />
instaure, en tout cas, une tension et des équilibres délicats à trouver entre construction de<br />
la démocratie et pouvoir du maître (puisque, par exemp<strong>le</strong>, à certains moments, <strong>le</strong> maître<br />
s’abstrait du fonctionnement des règ<strong>le</strong>s auquel il est lui-même norma<strong>le</strong>ment astreint, pour<br />
garantir <strong>le</strong>ur exercice…). La seconde remarque tient en un constat, interrogeant pour <strong>le</strong>s<br />
modalités scolaires dominantes. Dans ce système, pour un élève, la perte des droits équivaut<br />
De fait, <strong>le</strong>s maîtres s’en servent aussi comme repères pour évaluer des évolutions dans <strong>le</strong>s<br />
apprentissages.<br />
J’ajouterais volontiers deux remarques qui me paraissent importantes. En premier lieu, <strong>le</strong>s pratiques<br />
des élèves ou des parents ne font jamais l’objet de jugements publics négatifs de la part des maîtres, ce qui<br />
favorise sans doute <strong>le</strong>ur socialisation. El<strong>le</strong>s font, en revanche, parfois, l’objet de discussions, après avoir été<br />
reconstruites en tant qu’objet commun. En second lieu, cette implication sollicitée des parents d’élèves pour <strong>le</strong>s<br />
constituer en tant qu’adjuvants éducatifs s’accompagne d’un contrô<strong>le</strong> strict quant à <strong>le</strong>ur place, <strong>le</strong>urs fonctions<br />
ou certains fonctionnements (agressivité, pratiques estimées non éducatives dans <strong>le</strong>s fêtes, tentatives de<br />
déstabilisation pédagogique, maltraitance…).<br />
Par exemp<strong>le</strong>, <strong>le</strong> « quoi de neuf » est très fortement codifié par <strong>le</strong>s formes de paro<strong>le</strong> (inscription,<br />
gestion par un animateur, position debout face au groupe…) et par <strong>le</strong> temps limité (trois minutes, questions<br />
des autres comprises).<br />
J’y reviendrai en . Cela signifie en tout cas que ces relations sont pensées par rapport aux<br />
apprentissages et qu’il ne s’agit donc pas simp<strong>le</strong>ment de libération ou de socialisation des affects.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
à se retrouver, via la perte de l’autonomie, dans des fonctionnements scolaires traditionnels.<br />
La troisième remarque vise à souligner <strong>le</strong> mode de résolution original de la tension entre<br />
culture scolaire et cultures extrascolaires au travers de la construction d’une culture propre<br />
à la classe, culture de compromis, en perpétuel<strong>le</strong> réélaboration et à fonction de transition.<br />
Les deux questions en suspens que je retiendrai ici portent, pour la première, sur <strong>le</strong>s modes<br />
de structuration du groupe et, pour la seconde, sur <strong>le</strong>s cultures visées. Concernant <strong>le</strong>s<br />
modes de structuration du groupe, il me semb<strong>le</strong> qu’entre <strong>le</strong> sujet seul (ou parfois en binôme)<br />
et <strong>le</strong> groupe-classe, il n’existe pas de mode de structuration intermédiaire, de groupes plus<br />
ou moins restreints, sans qu’aucune explication n’éclaire véritab<strong>le</strong>ment ce phénomène .<br />
Concernant <strong>le</strong>s cultures visées, il me parait aussi intéressant de constater que la culture<br />
dite scolaire ou la culture dite légitime ne paraissent pas véritab<strong>le</strong>ment (fronta<strong>le</strong>ment,<br />
explicitement) interrogées .<br />
2. Les élèves et <strong>le</strong>s apprentissages<br />
Comme je l’ai déjà signalé précédemment, <strong>le</strong>s apprentissages sont absolument centraux.<br />
Par voie de conséquence, tout est mis en œuvre pour y parvenir à partir de quelques<br />
principes fondamentaux.<br />
2.1. Tout enfant peut apprendre, pourvu que <strong>le</strong> milieu soit favorab<strong>le</strong><br />
Fondamenta<strong>le</strong>ment, tout enfant est posé comme étant désireux et capab<strong>le</strong> d’apprendre pourvu<br />
que <strong>le</strong> milieu – pédagogique, en l’occurrence – lui permette et lui facilite ses apprentissages.<br />
Il s’agit là en quelque sorte d’un axiome qui, certes, construit en quelque sorte une nature<br />
de l’enfant mais qui impose conséquemment une responsabilité incontournab<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s<br />
maîtres.<br />
Dès lors – et cela peut même paraître parfois excessif aux yeux d’un observateur extérieur –<br />
tout échec d’un élève (ou même toute difficulté avec un parent) est vécu comme un échec<br />
du milieu pédagogique lui même ou, au moins, comme un questionnement fort du travail<br />
des maîtres. Dès lors encore, on comprend mieux la remise en cause permanente des<br />
modes de fonctionnement ainsi que la soif d’auto-formation et de co-formation des maîtres.<br />
La dynamique, <strong>le</strong> mouvement incessant caractérisent ainsi <strong>le</strong>ur fonctionnement.<br />
J’ajouterai enfin, sur ce point, que ce principe – l’enfant peut et doit apprendre pourvu que<br />
<strong>le</strong> milieu l’y aide – explique des dérogations autrement diffici<strong>le</strong>s à comprendre, aux règ<strong>le</strong>s<br />
établies afin d’accompagner des cas singuliers, particulièrement comp<strong>le</strong>xes à gérer. Cela<br />
d’autant plus que l’équipe pédagogique rechigne à orienter vers <strong>le</strong>s filières spécifiques des<br />
enfants dits à problèmes et a accueilli des élèves face auxquels d’autres éco<strong>le</strong>s s’étaient<br />
déclarées impuissantes.<br />
2.2. L’enfant est à construire comme sujet apprenant<br />
Le principe évoqué est toutefois accompagné – ce qui pondère son idéalisme possib<strong>le</strong> –<br />
Si ce n’est la constitution d’entités menaçant <strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif ?<br />
Si ce n’est sur <strong>le</strong> plan de sa dimension scolastique pour la première, et de sa difficulté d’accès pour<br />
la seconde.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
d’un second, selon <strong>le</strong>quel l’enfant est à constituer comme sujet apprenant (sujet scolaire<br />
et pédagogique), membre d’une communauté, astreint à des règ<strong>le</strong>s et à des modes de<br />
fonctionnement spécifiques (cf. ). Nombre de dispositifs peuvent ainsi être compris, au<br />
moins pour partie, dans cette perspective, comme étant chargés de construire et de maintenir<br />
l’adhésion et l’enrô<strong>le</strong>ment : conseils, élaboration des règ<strong>le</strong>s, métiers, mise au travail à partir<br />
du matériel et des questions apportés par <strong>le</strong>s élèves…<br />
Il convient en tout cas de noter que cela s’effectue avec un extrême souci, de la part<br />
des maîtres, de ne pas donner l’impression à l’élève qu’il rompt avec son milieu (voir <strong>le</strong>s<br />
passerel<strong>le</strong>s constituées par <strong>le</strong>s « quoi de neuf » qui font entrer <strong>le</strong> monde extrascolaire au<br />
sein de l’éco<strong>le</strong> et <strong>le</strong>s dispositifs pour faire connaître <strong>le</strong> monde scolaire aux famil<strong>le</strong>s et à<br />
l’extérieur…). Tout est ainsi fait pour éviter que <strong>le</strong> trajet scolaire ne soit vécu comme un<br />
reniement…<br />
Il convient encore de souligner que cela passe aussi, dans de nombreux cas, par une<br />
reconnaissance des rô<strong>le</strong>s tenus à l’extérieur de l’éco<strong>le</strong> par <strong>le</strong>s enfants (et <strong>le</strong>urs responsabilités<br />
ou fonctions sont souvent importantes en milieu populaire ), voire – et cela me semb<strong>le</strong><br />
très peu évoqué dans la littérature théorique sur <strong>le</strong> sujet – par une réinstauration du statut<br />
d’enfant, que l’on aide à se décharger de fardeaux extérieurs de « grands » ou d’adultes,<br />
souvent très lourds à porter (cf. . ). Ainsi, de manière paradoxa<strong>le</strong>, la constitution du sujet<br />
extrascolaire en élève passe parfois par la reconstitution, au moins provisoire, de son identité<br />
d’enfant…<br />
0<br />
2.3. C’est l’élève qui apprend<br />
Que ce soit l’élève qui apprenne, et nul autre à sa place, est sans doute devenu un<br />
lieu commun de certains discours sur l’éco<strong>le</strong>. Ce qui est en revanche frappant ici, c’est<br />
l’intégration véritab<strong>le</strong> de ce principe dans <strong>le</strong>s pratiques mises en œuvre. Cela induit – entre<br />
autres – deux principes conséquents.<br />
– En fonction de la diversité des élèves, il existe des rythmes et des chemins différents<br />
pour s’emparer des savoirs et des savoir-faire et <strong>le</strong>s maîtres sont donc particulièrement<br />
attentifs à faire fond sur <strong>le</strong>s modes de construction de chacun 0 et <strong>le</strong>ur temporalité spécifique<br />
(voir l’apprentissage de la <strong>le</strong>cture, <strong>le</strong>s recherches, <strong>le</strong>s créations, <strong>le</strong>s brevets, <strong>le</strong>s plans de<br />
travail…). Ainsi, un corps unifié de principes structurant ce mode de travail pédagogique,<br />
parfois présenté comme dogmatique, autorise et facilite en réalité, dans sa mise en œuvre<br />
pratique, une réel<strong>le</strong> soup<strong>le</strong>sse quant aux cheminements des élèves.<br />
– En second lieu, <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> central du maître – l’enseignement – n’est pas conçu selon la<br />
modalité dominante de la transmission mais essentiel<strong>le</strong>ment comme la conception, la mise<br />
en place et l’accompagnement de dispositifs et de situations permettant aux élèves de<br />
faciliter <strong>le</strong>urs apprentissages.<br />
2.4. L’élève apprend à partir de ses questionnements<br />
Si c’est l’élève qui apprend, il n’apprend cependant qu’à partir de ses questionnements qui<br />
Voir <strong>le</strong>s responsabilités des grands frères ou grandes sœurs par rapport aux plus jeunes, ou encore<br />
la prise en charge des documents administratifs dans des famil<strong>le</strong>s d’origine étrangère.<br />
0 Cela implique notamment de créer <strong>le</strong>s conditions (cf. . ) pour que ces modes de construction<br />
s’expriment et de grandes qualités d’attention pour pouvoir s’en emparer.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
motivent et fonctionnalisent <strong>le</strong>s savoirs et savoir-faire. Il s’agit donc ici, pour l’enseignant,<br />
de ne pas fournir de réponses toutes faites à des questions non posées mais de susciter<br />
<strong>le</strong>s questions, en s’appuyant sur <strong>le</strong> désir de savoir et de comprendre supposé partagé par<br />
tout enfant (cf. . ) ainsi que sur <strong>le</strong>s dispositifs construits ( . ) qui ont à éveil<strong>le</strong>r, à stimu<strong>le</strong>r,<br />
à entretenir et à approfondir ce désir. Ainsi, à partir des « quoi de neuf » ou des entretiens,<br />
<strong>le</strong>s élèves peuvent s’engager dans des recherches ou des préparations de conférences<br />
qui seront relancées vers des compléments au travers des phases de socialisation via des<br />
renvois et des interrogations des maîtres et / ou des pairs.<br />
Reste cependant que ce principe est relativisé par deux types de pratiques. Le premier consiste<br />
en la gestion des questions des élèves qui ne sont pas toutes traitées immédiatement. Cela<br />
renvoie sans nul doute à la part du maître (cf. ) dans sa gestion de la chronogenèse des<br />
savoirs et des rapports entre individus et col<strong>le</strong>ctif-classe. Cela nécessiterait certainement des<br />
études complémentaires. Le second type de pratiques consiste dans <strong>le</strong> travail « imposé »,<br />
sans relation immédiate avec <strong>le</strong>s questions de chacun (cf. <strong>le</strong>s fiches de travail), qui peut être<br />
vu comme nécessité d’entretenir un soc<strong>le</strong> commun référé aux programmes, comme mise<br />
en place d’autres modalités de structuration et / ou comme forme d’acculturation à la forme<br />
scolaire, excédant <strong>le</strong> mode de travail pédagogique. Mais cela aussi demeure à préciser.<br />
2.5. L’élève apprend en faisant<br />
Ce principe est celui qui est <strong>le</strong> plus souvent mis en avant dans la littérature théorique sur <strong>le</strong>s<br />
pédagogies alternatives. Il nécessite cependant plusieurs précisions, notamment en ce qui<br />
concerne son articulation avec des principes complémentaires (cf. . ; . ….).<br />
Il signifie, en tout cas, que <strong>le</strong>s élèves apprennent en faisant et parce qu’ils font l’expérience<br />
du travail, des projets, des recherches… En ce sens, et contrairement à d’autres démarches<br />
pédagogiques ou aux assertions de certains discours théoriques, <strong>le</strong> faire scolaire est un faire<br />
authentique qui est privilégié par rapport au faire semblant ou au faire simulacral. Apprendre<br />
est <strong>le</strong> métier principal des élèves et cela est constamment réaffirmé par <strong>le</strong>s maîtres. Il ne<br />
s’agit donc pas de faire comme si on apprenait par ou au travers de « situations de vie »<br />
mais de construire de véritab<strong>le</strong>s projets, recherches, correspondances… pour apprendre et<br />
parce que cela participe de l’apprendre.<br />
2.6. L’élève apprend aussi en se distanciant du faire<br />
Mais ce faire expérientiel n’est pas, au moins ici – contrairement à ce qui est fréquemment<br />
affirmé à propos des pédagogies alternatives – <strong>le</strong> seul pilier des apprentissages. Il s’articu<strong>le</strong><br />
très étroitement avec la construction d’une posture distanciée, réf<strong>le</strong>xive, au travers de<br />
moyens nombreux, diversifiés et fréquents :<br />
– <strong>le</strong>s situations de préparation à l’action (incluant, par exemp<strong>le</strong>, des plans ou des<br />
esquisses) ;<br />
– <strong>le</strong>s discussions col<strong>le</strong>ctives, en binômes ou avec <strong>le</strong> maître, autour des problèmes, des<br />
stratégies et des solutions possib<strong>le</strong>s ;<br />
–<br />
la coopération (cf. <strong>le</strong>s multip<strong>le</strong>s dispositifs d’aide ou de demandes d’aide ainsi que <strong>le</strong>s<br />
formes de dictée coopérative, où l’on peut signa<strong>le</strong>r ses problèmes, <strong>le</strong>s autres proposant<br />
des guidages : « c’est comme tel mot » ; « c’est la troisième personne du singulier »…<br />
mais pas la réponse précise) ;<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
– la relation réfléchie au faire constamment sollicitée par <strong>le</strong> maître pendant <strong>le</strong> travail ;<br />
– l’absence de stigmatisation des erreurs (cf. . ) ;<br />
– <strong>le</strong> temps accordé, rarement contraint, et qui peut être prolongé jusqu’à une évaluation<br />
satisfaisante partagée ;<br />
– la multiplicité des situations de socialisation et d’évaluation…<br />
–<br />
Ainsi, et il convient de <strong>le</strong> souligner tant cela a rarement été évoqué à propos de<br />
la pédagogie Freinet, <strong>le</strong>s deux piliers des apprentissages sont <strong>le</strong> faire et la distance<br />
réf<strong>le</strong>xive au faire, ce qui nécessite, ici encore, d’affiner <strong>le</strong>s formes concrètes de gestion<br />
de cette tension structurante.<br />
2.7. L’élève apprend au travers d’une multiplicité de rô<strong>le</strong>s<br />
Complémentairement, l’élève apprend encore au travers d’une multiplicité de rô<strong>le</strong>s et de<br />
positions par rapport aux savoirs et aux savoir-faire : travail<strong>le</strong>ur, usager, créateur, chercheur,<br />
exposant (conférencier), auditeur, discutant, critique, aide… De ce point de vue, il s’agit d’un<br />
agent protéïforme, aux rô<strong>le</strong>s et aux activités bien plus diversifiés, constamment et sur la<br />
durée, que ceux des élèves de modes de travail pédagogiques plus classiques. Ces rô<strong>le</strong>s et<br />
ces positions, mis en place très tôt (dès la maternel<strong>le</strong> et <strong>le</strong> CP), peuvent être appréhendés<br />
comme l’actualisation, au travers de situations concrètes, de multip<strong>le</strong>s modalités du faire<br />
et de la distance au faire. Complémentairement, ils mettent en place une conception selon<br />
laquel<strong>le</strong> c’est dans la variété des relations établies avec <strong>le</strong>s savoirs et dans la diversité de<br />
<strong>le</strong>urs modes de saisie que <strong>le</strong>s apprentissages se trouvent facilités.<br />
Dans une autre perspective encore, on pourrait considérer que ce principe n’est pas sans<br />
référer au moins implicitement, à des approches « institutionnel<strong>le</strong>s » des communautés<br />
scientifiques et de <strong>le</strong>urs modes de construction des savoirs et à des conceptions pédagogicodidactiques<br />
au sein desquel<strong>le</strong>s la constitution d’une « communauté scientifique scolaire »<br />
ou la constitution d’une multiplicité de rô<strong>le</strong>s sont fondamentaux .<br />
2.8. L’élève apprend en expérimentant différentes formes de pensée<br />
Cela signifie – en congruence avec <strong>le</strong>s principes précédents – que différentes formes de<br />
pensée, notamment convergente et divergente, sont constamment sollicitées et cela dans<br />
de nombreuses matières, remettant ainsi en cause certains fonctionnements scolaires<br />
classiques tels la domination des pratiques appelant la convergence et <strong>le</strong> cloisonnement<br />
disciplinaire.<br />
Dans ce cadre s’inscrit par exemp<strong>le</strong> la grande importance accordée à la créativité (y compris<br />
en mathématiques) et la valorisation des arts. On peut aussi noter que certains clivages<br />
opposant <strong>le</strong>s disciplines se voient remis en cause, via <strong>le</strong>s recherches ou <strong>le</strong>s créations<br />
en mathématiques – en s’interrogeant néanmoins sur <strong>le</strong> fait que certains domaines (par<br />
exemp<strong>le</strong> l’orthographe ou la grammaire) échappent à cette quête d’inventivité – ou via <strong>le</strong>s<br />
discussions critiques, la planification et la réf<strong>le</strong>xivité dans <strong>le</strong> domaine des arts.<br />
Dans ce cadre s’inscrit encore la place fondamenta<strong>le</strong> accordée à la production d’hypothèses<br />
Voir, par exemp<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s travaux de Bourdieu, Douglas, Latour…<br />
Voir, par exemp<strong>le</strong>, Jaubert, Rebière et Bernié 00 .<br />
Voir Ruellan 000 ou Reuter, dir. 00 a.<br />
Ce qui mérite d’ail<strong>le</strong>urs des études plus approfondies que nous sommes en train de mener.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
et à l’expérimentation ainsi que la gestion permanente de la tension entre rigueur et liberté<br />
et, de manière saisissante, en comparaison avec <strong>le</strong>s modes de fonctionnement scolaires<br />
fréquents ail<strong>le</strong>urs, l’accent systématiquement porté sur <strong>le</strong> fait qu’il existe, en général, de<br />
multip<strong>le</strong>s solutions à un problème, différents chemins pour atteindre un objectif… Dans ce<br />
cadre s’inscrit enfin <strong>le</strong> fait que, hors temps didactique stricto sensu, c’est-à-dire pendant <strong>le</strong>s<br />
récréations (et <strong>le</strong>s ateliers du soir), on peut lire, écrire, dessiner… (par exemp<strong>le</strong>, dans la<br />
cour, à l’aide du matériel mis à la disposition des élèves).<br />
2.9. L’élève apprend parce qu’il est sécurisé<br />
Ce principe me parait d’une extrême importance, d’autant plus dans un milieu où <strong>le</strong>s<br />
conditions de vie et <strong>le</strong> rapport à l’éco<strong>le</strong> sont souvent diffici<strong>le</strong>s. Il s’opérationnalise, ici encore,<br />
au travers de multip<strong>le</strong>s procédures qui renvoient, pour partie, à des mécanismes évoqués<br />
précédemment.<br />
Il s’agit, par exemp<strong>le</strong>, d’éviter <strong>le</strong>s clivages avec la vie extrascolaire tout en permettant<br />
aux élèves de se décharger, au moins en partie, de <strong>le</strong>urs préoccupations extérieures et,<br />
véritab<strong>le</strong>ment, de s’exprimer. À cette fin, divers dispositifs existent (« quoi de neuf », textes<br />
libres, conseils, créations…) qui structurent ce matériau dans des formes scolairement<br />
gérab<strong>le</strong>s et articulab<strong>le</strong>s aux apprentissages. Il s’agit encore de construire et de garantir<br />
un univers scolaire sécurisé, qui évite, autant que faire se peut, toute vio<strong>le</strong>nce ou toute<br />
crainte susceptib<strong>le</strong> de perturber <strong>le</strong> travail tout en autorisant la paro<strong>le</strong> des élèves ainsi que<br />
l’expression de <strong>le</strong>urs besoins d’enfants (boire en classe, bouger, se déplacer…).<br />
Il s’agit, enfin et surtout, de sécuriser <strong>le</strong>s apprentissages eux-mêmes, via :<br />
– <strong>le</strong> droit à l’erreur (non stigmatisée, avec maintien au tab<strong>le</strong>au pour pouvoir y réfléchir<br />
et y retravail<strong>le</strong>r, présente parfois dans <strong>le</strong>s textes affichés…) ;<br />
– un fonctionnement plus formateur de l’évaluation (absence de notes et de classements<br />
mais brevets, exposition des progressions, allégement du stress, ainsi pour la dictée,<br />
l’important est de faire de son mieux…) ;<br />
– des aides systématiques, des pairs et des maîtres, qu’el<strong>le</strong>s soient matériel<strong>le</strong>s (réserve<br />
d’instruments pour <strong>le</strong>s oublis, marquages accessib<strong>le</strong>s de tous <strong>le</strong>s objets disponib<strong>le</strong>s dans<br />
<strong>le</strong>s classes, plans-guides pour se servir soi-même des ordinateurs…) ou cognitives : en<br />
fonction du principe de coopération, l’aide est ainsi légitime, officiel<strong>le</strong> et, en aucun cas,<br />
stigmatisée ;<br />
– des cadres appropriab<strong>le</strong>s par tous : affichage public de l’organisation du travail dans<br />
la journée, plans individuels, routines de fonctionnement…<br />
– des phases répétées de mise en relation de ce qui se fait ou de ce qui vient de se<br />
faire avec ce qui s’était travaillé auparavant ;<br />
–<br />
<strong>le</strong> temps, ajusté aux nécessités de chacun, des discussions, de la recherche des<br />
solutions possib<strong>le</strong>s …<br />
De manière significative, nombre de « sanctions » sont justifiées non par des jugements plus ou<br />
moins moraux mais par <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong> comportement visé perturbe <strong>le</strong> travail col<strong>le</strong>ctif.<br />
Ces cadres et ces phases de mise en relation nous paraissent susceptib<strong>le</strong>s de participer à la clarté<br />
quant aux situations d’apprentissage, facteur important, à suivre <strong>le</strong>s travaux de Michel Brossard, dans la<br />
réussite ou dans l’échec scolaire.<br />
Le temps individuel est sans doute soumis aux règ<strong>le</strong>s du temps col<strong>le</strong>ctif mais <strong>le</strong>s formes de structuration<br />
de l’emploi du temps permettent à chacun de retrouver du temps, dans la journée ou dans la semaine, pour<br />
faire aboutir ses projets.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
C’est d’ail<strong>le</strong>urs sans doute parce que <strong>le</strong> cadre pédagogique est à un tel point sécurisé<br />
que l’imprévu peut être intégré sans destructurer l’ensemb<strong>le</strong> et que <strong>le</strong>s élèves peuvent<br />
apprendre en étant encouragés à prendre des risques, sans craindre un retour de bâton, et<br />
s’engager, très tôt, dans des recherches, des exposés ou des créations…<br />
2.10. L’enfant apprend parce qu’il peut se situer dans une histoire<br />
Le dernier principe, sur <strong>le</strong>quel je m’arrêterai ici, me parait très rarement revêtir une tel<strong>le</strong><br />
importance au sein de l’éco<strong>le</strong>. Il postu<strong>le</strong> que l’élève apprend parce qu’il peut se situer dans<br />
une histoire de ses apprentissages qui lui est rendu accessib<strong>le</strong> au travers de procédures<br />
ou de dispositifs tels ses plans de travail et ses brevets, <strong>le</strong>s étapes de ses projets, la<br />
conservation d’un maximum de documents <strong>le</strong> concernant, <strong>le</strong> livre de la classe, <strong>le</strong>s situations<br />
de mise en relation avec <strong>le</strong>s élèves des classes antérieures ou postérieures… On peut, peutêtre,<br />
envisager l’importance conférée à cette dimension diachronique comme une référence<br />
aux classes uniques ou s’interroger sur <strong>le</strong>s usages effectifs que font <strong>le</strong>s élèves de ces<br />
possibilités de relire <strong>le</strong>ur trajet… Il n’en demeure pas moins qu’il existe là une spécificité<br />
qu’on peut aussi comprendre comme un des multip<strong>le</strong>s moyens utilisés pour construire <strong>le</strong><br />
sujet scolaire, tisser des liens entre situations et savoirs, encourager en rendant compte du<br />
chemin accompli…<br />
3. La part du maître<br />
Dans <strong>le</strong> cadre qui vient d’être tracé, on comprend que la part du maître soit fondamenta<strong>le</strong>,<br />
notamment parce qu’il pose tout enfant comme étant capab<strong>le</strong> d’apprendre et parce qu’il<br />
revendique, quasi tota<strong>le</strong>ment, la responsabilité des apprentissages. En assumant certaines<br />
redites, je rappel<strong>le</strong>rai donc certaines dimensions essentiel<strong>le</strong>s de ses tâches dans ce mode<br />
de travail où, a priori, rien n’est considéré comme naturel, tout doit être construit sous la<br />
gouverne des enseignants.<br />
3.1. Chacun à sa place mais avec un maximum de coopération<br />
« Chacun à sa place » pourrait être la devise du système mis en place, avec des places<br />
et des rô<strong>le</strong>s constamment réaffirmés et reconstruits : adultes / enfants ; maîtres / élèves /<br />
parents d’élèves. Il s’agit donc d’une doub<strong>le</strong> structure, sans flottement, mais garantissant à<br />
chacun, un respect total et un maximum d’échanges de coopération.<br />
Cela impose – conformément à ce que j’avais déjà noté dans <strong>le</strong>s points précédents – un<br />
travail important en direction des parents d’élèves et un comportement modè<strong>le</strong> d’adulte de<br />
la part des maîtres, assumé en tant que tel.<br />
3.2. Des dispositifs essentiels<br />
La part du maître se réalise au travers des dispositifs mis en place et de <strong>le</strong>ur gestion. C’est<br />
un point essentiel souligné par tous ceux qui se sont penchés sur la pédagogie Freinet. Mais<br />
cela appel<strong>le</strong> peut-être quelques remarques complémentaires.<br />
Classes uniques qui demeurent un référent pour plusieurs maîtres de cette éco<strong>le</strong> et dont diverses<br />
études ont montré <strong>le</strong>s intérêts.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
S’il existe bien un héritage important des dispositifs et une confiance en ceux-ci, ils demeurent<br />
néanmoins en (re) création – modification constante, stab<strong>le</strong>s mais ouverts à l’imprévu,<br />
imposés mais soumis à la réappropriation. On est donc assez loin de l’image de techniques<br />
« Freinet », figées et dogmatiques, transmises dans une vulgate référée quasi-uniquement<br />
aux écrits de Cé<strong>le</strong>stin Freinet .<br />
De surcroît ces dispositifs assument sans doute une fonction non négligeab<strong>le</strong> de tiers,<br />
matériel et symbolique, entre enfants et élèves, entre élèves et maîtres, entre adultes et<br />
maîtres, entre univers scolaire et extrascolaire.<br />
3.3. Le maître comme garant<br />
Une part déterminante du travail du maître se réalise complémentairement dans son rô<strong>le</strong><br />
de garant, garant des apprentissages, de la sécurité, du fonctionnement des dispositifs, des<br />
règ<strong>le</strong>s élaborées col<strong>le</strong>ctivement…<br />
Ce rô<strong>le</strong> de garant, qui explique en partie son attention à être un modè<strong>le</strong> dans ses<br />
comportements, n’exclut d’ail<strong>le</strong>urs pas, de manière paradoxa<strong>le</strong>, des décrochages de sa<br />
place ou de son rô<strong>le</strong> dans certains dispositifs (quand il faut mieux faire respecter <strong>le</strong> temps<br />
lors du « quoi de neuf », lorsque des rappels à l’ordre s’imposent, pour réorienter certaines<br />
recherches dans l’intérêt col<strong>le</strong>ctif…).<br />
De surcroît, ce rô<strong>le</strong> de garant est lui-même contrôlé de diverses manières : par <strong>le</strong>s conseils<br />
(de classe et d’éco<strong>le</strong>) qu’il se doit de garantir et qui peuvent <strong>le</strong> remettre en question, par <strong>le</strong>s<br />
discussions avec ses pairs et <strong>le</strong> conseil des maîtres, par <strong>le</strong>s principes auxquels il souscrit<br />
(et qu’il rediscute au sein du mouvement), par <strong>le</strong> respect explicite des lois scolaires, par sa<br />
constante autoformation, par la coformation…<br />
3.4. Le maître comme adjuvant<br />
Fondamenta<strong>le</strong>ment encore, <strong>le</strong> maître se conçoit ici comme un aide, puisque c’est l’enfant<br />
qui apprend au travers de sa mise en activité. Cette fonction d’adjuvant se décline donc<br />
de multip<strong>le</strong>s manières : par la construction et la gestion des dispositifs mais aussi par ses<br />
stations fréquentes au bureau – dans un coin de la classe et non au centre – où il accueil<strong>le</strong> <strong>le</strong>s<br />
demandes ; par ses renvois individualisés (recherche de documents ou d’écrits qui peuvent<br />
faire écho aux textes libres ou aider tel élève dans sa recherche) ; par son attention aux<br />
cheminements col<strong>le</strong>ctifs et aux parcours de chacun auquel il renvoie très fréquemment (cf.<br />
. 0)… D’une certaine manière, dans ce cadre pédagogique, <strong>le</strong> maître se caractérise par une<br />
recherche presque obsessionnel<strong>le</strong> de ce qui pourrait aider chacun sans se substituer à son<br />
cheminement. Je dirais volontiers, qu’au travers des dispositifs et des formes d’intervention<br />
du maître, il existe une recherche constante d’articulation entre étayage et desétayage.<br />
3.5. Le maître comme équilibriste<br />
Fina<strong>le</strong>ment, l’image de l’équilibriste est peut-être la mieux à même de rendre compte de<br />
cette perpétuel<strong>le</strong> gestion des tensions qui caractérise <strong>le</strong> maître dans ce mode de travail, par<br />
exemp<strong>le</strong> entre :<br />
Il serait d’ail<strong>le</strong>urs très uti<strong>le</strong>, pour la communauté éducative, de réaliser un ouvrage sur ces techniques<br />
actuel<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>urs variations.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
– constitution d’une microsociété autonome et relations fortes à l’extrascolaire ;<br />
– mise en place d’un fonctionnement démocratique et respect des règ<strong>le</strong>s d’un côté et<br />
pouvoir du maître, voire contournement de certaines d’entre el<strong>le</strong>s (pour <strong>le</strong>s établir ou<br />
<strong>le</strong>s garantir) de l’autre ;<br />
– établissement de cadres forts et stab<strong>le</strong>s et mobilité, ouverture à l’imprévu ;<br />
– nécessité de respecter <strong>le</strong> besoin de mouvement des élèves et nécessité de construire<br />
<strong>le</strong>s conditions de l’étude et de la civilité (pouvoir par<strong>le</strong>r mais dans un « si<strong>le</strong>nce » col<strong>le</strong>ctif ;<br />
pouvoir jeter <strong>le</strong>s papiers par terre ou <strong>le</strong>s lancer à la corbeil<strong>le</strong> en cours d’activité mais<br />
tous <strong>le</strong>s ramasser à la fin…) ;<br />
– engagement dans <strong>le</strong> faire et construction d’une distance réf<strong>le</strong>xive ;<br />
– respect des cheminements et des spécificités singulières et construction d’une<br />
communauté de travail et d’apprentissage ;<br />
– respect des questionnements individuels et attachement à des apprentissages<br />
indispensab<strong>le</strong>s à l’avancée dans <strong>le</strong> cursus scolaire ;<br />
–<br />
guidage et autonomie<br />
4. Questions et débats<br />
Pour clore cette présentation des principes de fonctionnement mis en œuvre, qui sera donc<br />
largement reprise et exemplifiée dans <strong>le</strong>s chapitres suivants, j’aimerais poser une précaution<br />
de <strong>le</strong>cture et sou<strong>le</strong>ver quelques questions en débat au sein de l’équipe de recherche, à<br />
prendre comme autant de pistes de recherche ouvertes pour <strong>le</strong>s années à venir.<br />
4.1. Précaution de <strong>le</strong>cture<br />
La description que je viens de tracer correspond à ce que nous avons pu observer ou<br />
analyser. El<strong>le</strong> est donc discutab<strong>le</strong> comme tout travail de recherche et sans doute tributaire<br />
d’une perspective et d’outils de recueil et de traitement de données mais el<strong>le</strong> n’est nul<strong>le</strong>ment<br />
fictive ou enjolivée. De surcroît, même si des différences ont été soulignées avec <strong>le</strong>s modes<br />
de travail pédagogiques <strong>le</strong>s plus répandus, ces différences ne signifient pas valorisation ou<br />
adhésion de la part de notre équipe 0 . Enfin, cette description ne dit rien en el<strong>le</strong>-même et<br />
a priori des effets possib<strong>le</strong>s sur <strong>le</strong>s élèves. Cette question sera traitée dans <strong>le</strong>s chapitres<br />
suivants.<br />
4.2. Questions en suspens<br />
La première question renvoie au choix même de présenter <strong>le</strong> mode de travail pédagogique<br />
de manière unifiée. Il permet sans doute de souligner – ce qui n’est pas si fréquent – <strong>le</strong><br />
soc<strong>le</strong> commun très important de principes et de fonctionnements que partagent <strong>le</strong>s maîtres<br />
de cette éco<strong>le</strong>, ce que nous avons pu vérifier à de multip<strong>le</strong>s reprises. Il tend en revanche<br />
à réduire certaines différences entre <strong>le</strong>s maîtres dans l’adhésion à ces principes et des<br />
variations dans <strong>le</strong>s fonctionnements et la mise en œuvre des dispositifs (par exemp<strong>le</strong>, quant<br />
à la fonction de garant, à l’investissement dans <strong>le</strong>s recherches mathématiques, aux formes<br />
de retravail des textes…). Nous tentons donc d’approfondir cette question en décrivant<br />
0 À titre de rappel, nous avons mené des recherches sur d’autres modes de travail pédagogique,<br />
classiques ou « innovants » (cf. Reuter, dir. 00 ou Ruellan 000) et, nombre d’entre nous étant plutôt<br />
didacticiens, ont pu a priori être dans une distance critique par rapport à ce qui s’effectuait ici (cf. . .)…<br />
Précisons encore que l’expression « mode de travail pédagogique » est reprise à Lesne ( ).<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
précisément ces différences, en essayant d’analyser <strong>le</strong>urs effets possib<strong>le</strong>s sur <strong>le</strong>s élèves<br />
et en étudiant de manière plus fine <strong>le</strong>s statuts et <strong>le</strong>s rô<strong>le</strong>s au sein même de l’équipe des<br />
maîtres .<br />
La seconde question renvoie aux contours ou aux limites de ce mode de travail qui peuvent<br />
porter sur diverses dimensions : limites du dicib<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s entretiens ou <strong>le</strong>s « quoi de neuf »<br />
qui modifient ce qui entre de la vie extrascolaire et qui encadrent ce qui est considéré<br />
comme gérab<strong>le</strong> au sein de la classe ; limites des exceptions ou des entorses possib<strong>le</strong>s aux<br />
règ<strong>le</strong>s en fonction d’élèves plus ou moins particuliers ; limites quant à la responsabilité des<br />
apprentissages face à des élèves en grande difficulté suivis dans des dispositifs médicaux,<br />
paramédicaux ou sociaux et orientés, par exemp<strong>le</strong> en SEGPA… Sur ce point, bien des<br />
éléments demeurent à préciser à la fois quant aux principes et quant aux fonctionnements<br />
effectifs. Même si, comme je <strong>le</strong> signalais antérieurement, deux éléments au moins sont à<br />
conserver en mémoire : une volonté rare de la part des maîtres d’assumer <strong>le</strong>s responsabilités<br />
des apprentissages y compris face à des élèves envoyés par d’autres éco<strong>le</strong>s et en extrême<br />
difficulté familia<strong>le</strong>, socia<strong>le</strong> ou de santé ; une grande fermeté sur des principes stricts qui,<br />
paradoxa<strong>le</strong>ment, permettent une véritab<strong>le</strong> soup<strong>le</strong>sse et une diversité de stratégies, de<br />
dispositifs et de réactions…<br />
La troisième question concerne <strong>le</strong> sérieux de ces classes et de cette éco<strong>le</strong>. L’expression<br />
« atmosphère studieuse » semb<strong>le</strong> parfaitement convenir ici. On est là pour travail<strong>le</strong>r et on<br />
y travail<strong>le</strong> sans aucun doute, ce qui frappe tout visiteur. Et <strong>le</strong>s élèves n’ont l’air ni stressés,<br />
ni angoissés, rentrant, au moins pour certains d’entre eux, d’eux-mêmes dans la classe<br />
avant <strong>le</strong> début des cours et ne se précipitant pas pour quitter l’éco<strong>le</strong>. Mais, en même temps,<br />
certains observateurs ou visiteurs ont pu se demander si la part du jeu ou, du moins, du<br />
ludisme, n’était pas trop restreinte. De fait, la place du jeu, du rire ou des moments de<br />
détente est peut-être à interroger…<br />
La quatrième question réfère à l’appréhension du positionnement scolaire des élèves par<br />
eux-mêmes et par <strong>le</strong>urs parents. Jusqu’à quel point, un système qui présente autant de<br />
différences aussi bien dans <strong>le</strong> mode de présentation des matières que dans <strong>le</strong>s procédures<br />
évaluatives, permet aux élèves – et à <strong>le</strong>urs parents – de se représenter <strong>le</strong>ur positionnement<br />
par rapport aux exigences scolaires ?<br />
La cinquième question renvoie à la gestion de la tension entre deux logiques : cel<strong>le</strong> de<br />
l’implication interne de l’équipe des maîtres avec <strong>le</strong>urs élèves et cel<strong>le</strong> du positionnement<br />
militant qui entraîne l’affirmation extérieure de principes forts, de multip<strong>le</strong>s visites et des<br />
contacts plus importants que d’autres éco<strong>le</strong>s avec <strong>le</strong>s médias . Trois types de perturbations,<br />
au moins, en résultent : la première – qui pose d’ail<strong>le</strong>urs problème à certains maîtres –<br />
consiste en l’impression qu’ils ne peuvent être aussi attentifs qu’ils <strong>le</strong> souhaiteraient avec <strong>le</strong>s<br />
élèves ; la seconde réside en des rapports pas toujours aisés – en tout cas vécus de façon<br />
ambiva<strong>le</strong>nte – avec <strong>le</strong>s maîtres des autres éco<strong>le</strong>s de la circonscription ; la troisième tient en<br />
une transformation du statut de cette éco<strong>le</strong> qui, d’établissement « normal » de quartier, tend<br />
à s’ériger / être érigé en vitrine d’une expérience et, de ce fait, acquiert un statut atypique,<br />
quel<strong>le</strong>s que soient <strong>le</strong>s précautions prises par ail<strong>le</strong>urs.<br />
La sixième question concerne la fragilité du climat de travail instauré qui dépend, d’un côté,<br />
En fonction, notamment, de l’expérience, du capital symbolique au sein du mouvement Freinet, etc.<br />
En tout état de cause, il est cependant frappant de constater qu’une véritab<strong>le</strong> disparité ici n’empêche pas des<br />
discussions où chacun est entendu et admis, y compris dans des mises en cause parfois très critiques des<br />
principes et des « anciens ».<br />
Voir, par exemp<strong>le</strong>, la venue d’envoyés de médias étrangers…<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
du calme toujours précaire du quartier environnant et, d’un autre côté, de la présence forte<br />
des maîtres. Ainsi, des remplacements de l’équipe (en stage) sur une durée plus ou moins<br />
longue (une à trois semaines) entraînent fréquemment des comportements scolairement<br />
déviants de la part des élèves. Il est clair que cela n’est pas sans interroger la transférabilité<br />
(voir <strong>le</strong> chapitre final) même si, deux facteurs réduisent indéniab<strong>le</strong>ment ces problèmes :<br />
une expérience d’enseignement chez <strong>le</strong>s remplaçants et la reprise des mêmes règ<strong>le</strong>s de<br />
fonctionnement.<br />
La septième et dernière question que j’évoquerai ici porte sur <strong>le</strong> soc<strong>le</strong> de référence des<br />
principes et des modes de fonctionnement présentés. Il me semb<strong>le</strong> qu’il est essentiel<strong>le</strong>ment<br />
pédagogique, <strong>le</strong> pédagogique étant pensé en relation avec <strong>le</strong> politico-idéologique (aide aux<br />
enfants défavorisés, conceptions de la démocratie et du citoyen critique, volonté d’ouvrir<br />
l’univers culturel à tous…). Dans cette perspective, <strong>le</strong>s entrées didactiques, en tant que tel<strong>le</strong>s,<br />
sont secondarisées, même si une réf<strong>le</strong>xion digne de respect est menée sur l’enseignement<br />
des différentes disciplines. Il est évident que cette entrée, à dominante pédagogique, est tout<br />
à fait intéressante dans <strong>le</strong> cadre de l’enseignement primaire au sein duquel <strong>le</strong>s disciplines<br />
se constituent progressivement, dans la mesure aussi où el<strong>le</strong> permet de rendre congruents<br />
<strong>le</strong>s différents enseignements, dans la mesure encore où el<strong>le</strong> est essentiel<strong>le</strong>ment et sans<br />
ambiguïté au service de l’apprentissage des savoirs et des savoir-faire… Il reste cependant<br />
à analyser comment et jusqu’où el<strong>le</strong> peut s’articu<strong>le</strong>r avec des entrées didactiques, attentives<br />
à la spécificité des contenus en œuvre et à la manière dont ils peuvent / ils doivent structurer<br />
<strong>le</strong>s modes d’enseignement et d’apprentissage…<br />
Références bibliographiques<br />
Bru M., Altet M., Blanchard-Lavil<strong>le</strong> C. ( 00 ), « À la recherche des processus caractéristiques<br />
des pratiques enseignantes dans <strong>le</strong>urs rapports aux apprentissages », Revue Française de<br />
Pédagogie, n° , Évaluer et comprendre <strong>le</strong>s effets des pratiques pédagogiques, juil<strong>le</strong>taoût-septembre,<br />
p. - .<br />
Jaubert M., Rebière M., Bernié J.-P. ( 00 ), « L’hypothèse “communauté discursive” : d’où<br />
vient-el<strong>le</strong> ? Où va-t’el<strong>le</strong> ? », Les Cahiers THEODILE, n° , p. - 0.<br />
Reuter Y. ed. ( 00 ) : Pédagogie du projet et didactique du français, Vil<strong>le</strong>neuve d’Ascq,<br />
Presses Universitaires du Septentrion.<br />
Ruellan F. ( ) : Un mode de travail didactique pour l’enseignement-apprentissage de<br />
l’écriture au cyc<strong>le</strong> 3 de l’éco<strong>le</strong> primaire, Thèse de Doctorat, en Sciences de l’Éducation,<br />
Université Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong> – Lil<strong>le</strong> II<br />
Que l’on rencontre d’ail<strong>le</strong>urs fréquemment dans d’autres éco<strong>le</strong>s.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Univers de vio<strong>le</strong>nce des enseignants, systèmes<br />
de régulation et pratiques professionnel<strong>le</strong>s<br />
Céci<strong>le</strong> CARRA<br />
Maître de conférences<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
CESDIP<br />
Nous définissons comme vio<strong>le</strong>nces, ce qui est qualifié comme tel par <strong>le</strong>s enquêtés. Cette<br />
démarche permet de saisir sans <strong>le</strong>s dissocier une perception, un acte et son vécu par <strong>le</strong>s<br />
individus. Nous pensons en effet avec Michaud que « La vio<strong>le</strong>nce, ce sont non seu<strong>le</strong>ment<br />
des faits, mais aussi nos manières de <strong>le</strong>s appréhender, de <strong>le</strong>s juger, de <strong>le</strong>s voir – et de<br />
ne pas <strong>le</strong>s voir » (Michaud, 00 ). Si el<strong>le</strong> comporte <strong>le</strong> risque d’étendre la définition de la<br />
vio<strong>le</strong>nce à toute atteinte à un ordre normatif, une tel<strong>le</strong> approche permet de rendre compte<br />
de la dimension relative, subjective et contextuel<strong>le</strong> de la vio<strong>le</strong>nce . C’est ainsi en restituant<br />
<strong>le</strong> point de vue des acteurs concernés que nous tenterons d’appréhender ce que recouvre <strong>le</strong><br />
phénomène de vio<strong>le</strong>nce pour <strong>le</strong>s enseignants d’une éco<strong>le</strong> qui se réclament de la pédagogie<br />
Freinet .<br />
Plus précisément, il s’agit de traiter de trois grandes dimensions :<br />
– <strong>le</strong>s contours que prend la vio<strong>le</strong>nce pour <strong>le</strong>s maîtres Freinet et l’évolution qu’ils<br />
perçoivent du phénomène au sein de l’éco<strong>le</strong> (chapitre ) ;<br />
– <strong>le</strong>s processus de régulation mis en œuvre, <strong>le</strong>urs effets attendus mais aussi ce qu’ils<br />
révè<strong>le</strong>nt de l’appréhension de la vio<strong>le</strong>nce, tant l’expérience de la vio<strong>le</strong>nce scolaire<br />
semb<strong>le</strong> inséparab<strong>le</strong> des formes de gestion du problème qu’adoptent <strong>le</strong>s professionnels<br />
concernés (chapitre ) ;<br />
–<br />
<strong>le</strong>s effets observés sur <strong>le</strong> phénomène et tout particulièrement sur <strong>le</strong>s processus de<br />
construction-déconstruction du sentiment de vio<strong>le</strong>nce des enseignants (chapitre ).<br />
Pour ce faire, nous nous appuierons principa<strong>le</strong>ment sur <strong>le</strong> recueil de données effectué<br />
auprès des enseignants et des élèves depuis l’arrivée de la nouvel<strong>le</strong> équipe pédagogique<br />
(l’année , correspondant, dans <strong>le</strong> texte, à sa première année dans l’éco<strong>le</strong>). Ces données<br />
ont été recueillies selon une doub<strong>le</strong> entrée, qualitative d’abord, sur la base d’observations<br />
dans l’éco<strong>le</strong> durant et hors temps de classe et d’entretiens menés avec <strong>le</strong>s enseignants<br />
années et . Quantitative ensuite, avec l’administration d’un questionnaire aux élèves de<br />
l’éco<strong>le</strong> de l’année à l’année . L’année voit <strong>le</strong> dispositif s’articu<strong>le</strong>r avec celui d’une autre<br />
recherche sur la vio<strong>le</strong>nce en milieu scolaire (Carra dir., 00 ), <strong>le</strong>s questionnaires passés<br />
aux élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet sont aussi administrés à 000 autres élèves d’un échantillon<br />
représentatif des éco<strong>le</strong>s élémentaires du département du Nord (du CE au CM ) et à <strong>le</strong>ur<br />
enseignant (une petite centaine). Ces données permettront de mettre en perspective <strong>le</strong>s<br />
spécificités de l’éco<strong>le</strong> Freinet alors que <strong>le</strong>s entretiens favoriseront l’analyse de la dimension<br />
subjective de la vio<strong>le</strong>nce et son lien avec <strong>le</strong>s systèmes de régulation. Les extraits qui en<br />
seront tirés, se veu<strong>le</strong>nt significatifs de logiques récurrentes et dominantes donnant sens au<br />
vécu des maîtres Freinet et à l’action.<br />
La présentation, quant à el<strong>le</strong>, est structurée pour pouvoir aborder une question transversa<strong>le</strong>,<br />
Pour un développement de cette problématique, cf. Carra, 00 b.<br />
Par commodité, nous par<strong>le</strong>rons d’éco<strong>le</strong> Freinet et de maîtres Freinet.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
cel<strong>le</strong> de la transférabilité. Son intérêt apparaîtra en creux avec <strong>le</strong>s effets obtenus sur <strong>le</strong><br />
phénomène de vio<strong>le</strong>nce et <strong>le</strong> repérage de limites ; sa faisabilité sera abordée en posant <strong>le</strong>s<br />
conditions de possibilité du fonctionnement particulier qui émergera de cette analyse et en<br />
tentant de repérer des dimensions a priori transférab<strong>le</strong>s.<br />
1. Le vécu de vio<strong>le</strong>nce<br />
Dans cette première partie, nous étudierons tout d’abord <strong>le</strong>s contours de la vio<strong>le</strong>nce à partir<br />
des déclarations des enseignants de l’échantillon d’éco<strong>le</strong>s du département du Nord. Cette<br />
« toi<strong>le</strong> de fond » permettra de nous orienter vers des spécificités éventuel<strong>le</strong>s du sentiment<br />
de vio<strong>le</strong>nce chez <strong>le</strong>s maîtres Freinet. Les données statistiques s’y rapportant sont à<br />
considérer comme des indicateurs puisqu’ils ne représentent que quatre individus – sur <strong>le</strong>s<br />
cinq constituant l’équipe de l’éco<strong>le</strong> élémentaire – (CE , CE , CM et CM , <strong>le</strong>s CP ne faisant<br />
pas partie de l’enquête). Nous approfondirons ensuite ce que fait émerger cette première<br />
approche par une analyse d’incidents rapportés par chacun des maîtres Freinet lors des<br />
entretiens réalisés.<br />
0<br />
1.1. Le sentiment de vio<strong>le</strong>nce des enseignants : enquête de victimation<br />
Comparativement à l’échantillon, <strong>le</strong>s maîtres Freinet obtiennent un score vio<strong>le</strong>nce plus bas<br />
que la moyenne : . contre . (cf. tab<strong>le</strong>au et graphique ci-dessous). La moyenne des<br />
scores en éducation prioritaire (EP ) est de . . Ce score a été construit à partir de trois<br />
indicateurs : perception du niveau de vio<strong>le</strong>nce, victimation et vio<strong>le</strong>nce auto-reportée.<br />
Ordinaire<br />
EP<br />
ZV<br />
Le score vio<strong>le</strong>nce en fonction du classement social des éco<strong>le</strong>s<br />
Ordinaire<br />
catégorie éco<strong>le</strong><br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
EP<br />
ZV<br />
TOTAL<br />
Score<br />
vio<strong>le</strong>nce<br />
propre<br />
63 (4,30 )<br />
18 (4,59 )<br />
12 (5,65 )<br />
93 (4,53 )<br />
Il convient d’étudier <strong>le</strong> poids relatif de chacune de ces variab<strong>le</strong>s pour mettre en perspective<br />
ce qui peut distinguer cette éco<strong>le</strong> des autres. La perception des maîtres Freinet du niveau<br />
de vio<strong>le</strong>nce dans <strong>le</strong>ur éco<strong>le</strong> s’inscrit dans la tendance généra<strong>le</strong> (cf. graphique ci-dessous<br />
et tab<strong>le</strong>au en annexe) : si <strong>le</strong> directeur note qu’il y a « un peu » de vio<strong>le</strong>nce (« vio<strong>le</strong>nces<br />
légères, entre enfants… parfois « importées » de problèmes vécus à l’extérieur, dans <strong>le</strong><br />
quartier »), <strong>le</strong>s autres maîtres Freinet ont coché l’item « très peu » (« Vio<strong>le</strong>nces classiques<br />
de récréation, bousculades/disputes… mais rien de grave, rien qu’on ne puisse rég<strong>le</strong>r » pour<br />
l’enseignante de CE , « Verba<strong>le</strong>s entre enfants » pour <strong>le</strong> professeur de CE , « Réactions<br />
épidermiques » pour <strong>le</strong> maître de CM ).<br />
ZV correspond à zone vio<strong>le</strong>nce. Les éco<strong>le</strong>s dites ordinaires ne font l’objet d’aucun classement<br />
institutionnel.
Perception du niveau de vio<strong>le</strong>nce dans <strong>le</strong>ur éco<strong>le</strong> par <strong>le</strong>s enseignants<br />
, %<br />
beaucoup<br />
, %<br />
moyennem<br />
ent<br />
, %<br />
un peu<br />
, %<br />
très peu<br />
, %<br />
ne sait pas<br />
À l’instar des maîtres Freinet, <strong>le</strong>s vio<strong>le</strong>nces perçues par <strong>le</strong>s enquêtés se rapportent surtout<br />
aux comportements des élèves et, tout particulièrement, lorsqu’ils sont en récréation. Cette<br />
perception se construit essentiel<strong>le</strong>ment à partir de deux grandes catégories : <strong>le</strong>s vio<strong>le</strong>nces<br />
physiques et <strong>le</strong>s vio<strong>le</strong>nces verba<strong>le</strong>s (cf. histogramme ci-dessous et tab<strong>le</strong>au en annexe) :<br />
,0%<br />
physiques<br />
, %<br />
verba<strong>le</strong>s<br />
Types de vio<strong>le</strong>nces perçues par <strong>le</strong>s enseignants<br />
, %<br />
autres ou<br />
non<br />
précisées<br />
, %<br />
disputes,<br />
querel<strong>le</strong>s<br />
, %<br />
conflits/règl<br />
ements de<br />
compte<br />
, %<br />
bousculade<br />
s<br />
, %<br />
menaces<br />
, %<br />
racket<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
, %<br />
mora<strong>le</strong><br />
Les maîtres Freinet disent ne jamais avoir été auteurs de vio<strong>le</strong>nce depuis <strong>le</strong> début de l’année<br />
scolaire dans <strong>le</strong> cadre de l’exercice de <strong>le</strong>ur fonction. Les non-victimiseurs représentent près<br />
de % de l’échantillon. L’exaspération, l’épuisement sont <strong>le</strong>s principa<strong>le</strong>s raisons données<br />
par <strong>le</strong>s enseignants qui se sont déclarés auteurs de vio<strong>le</strong>nce. L’un d’entre eux explique ainsi<br />
par la « saturation » son comportement qu’il relate de la manière suivante : « j’ai attrapé<br />
un élève par <strong>le</strong>s vêtements et je l’ai jeté dehors avec force ». Certains estiment que <strong>le</strong>ur<br />
vio<strong>le</strong>nce est une réponse nécessaire à la vio<strong>le</strong>nce des enfants. Un professeur dit ainsi qu’il<br />
a « stoppé deux élèves qui se battent » parce que : « Il faut bien arrêter, <strong>le</strong>s petits boxeurs<br />
ou karateka qui veu<strong>le</strong>nt faire la loi comme chez eux ! ». Se sentir victimiseur contribue au<br />
construit du sentiment de vio<strong>le</strong>nce de l’enseignant dans l’ouverture sur un univers d’actions<br />
transgressant gravement normes professionnel<strong>le</strong>s et déontologie.<br />
Ce qui distingue <strong>le</strong> plus <strong>le</strong>s réponses des maîtres Freinet par rapport au reste de l’échantillon,<br />
c’est <strong>le</strong> dernier indicateur, celui de victimation : aucun ne déclare avoir été victime de vio<strong>le</strong>nce<br />
au sein de l’éco<strong>le</strong> depuis <strong>le</strong> début de l’année scolaire ; <strong>le</strong>s non-victimes représentent %<br />
de l’échantillon (cf. histogramme ci-dessous et tab<strong>le</strong>au en annexe).
, %<br />
plus de fois<br />
Victimation des enseignants<br />
,0%<br />
ou fois<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
, %<br />
ou fois<br />
,0%<br />
jamais<br />
À l’exception d’un cas de vio<strong>le</strong>nce physique déclaré (« Une élève qui ne voulait pas travail<strong>le</strong>r<br />
ni changer de place m’a frappée, pincée, insultée et menacée »), <strong>le</strong>s enseignants qui se<br />
sont déclarés victimes de vio<strong>le</strong>nce relatent des vio<strong>le</strong>nces verba<strong>le</strong>s provenant, pour la plus<br />
grande part, de parents d’élèves. Ces vio<strong>le</strong>nces prennent très largement la forme de relations<br />
conflictuel<strong>le</strong>s (« conflits avec un parent d’élève soutenant l’enfant <strong>le</strong> premier trimestre »).<br />
0,0%<br />
Les auteurs des vio<strong>le</strong>nces subies par <strong>le</strong>s enseignants<br />
, %<br />
, %<br />
, %<br />
élèves<br />
supérieur hiérarchique<br />
parents d'élèves<br />
amis d'élèves<br />
Lorsque <strong>le</strong>s victimes font référence aux élèves, <strong>le</strong>s vio<strong>le</strong>nces apparaissent majoritairement<br />
en réaction à une demande de l’enseignant : « un élève qui se débat fait des gestes vio<strong>le</strong>nts<br />
alors qu’il refuse de quitter la classe comme je <strong>le</strong> lui ai demandé (à cause de son intolérab<strong>le</strong><br />
comportement) » ou encore : « un élève a refusé catégoriquement de m’obéir, a créé un<br />
véritab<strong>le</strong> tapage à l’extérieur de la classe. J’ai été insulté deux fois par deux de mes élèves<br />
cette année ».<br />
Cet état des lieux montre ainsi une victimation touchant plus du tiers des enseignants enquêtés<br />
mais aucun maître Freinet. On peut d’abord l’expliquer par une vulnérabilité différentiel<strong>le</strong> à<br />
la vio<strong>le</strong>nce. Les caractéristiques des victimes montrent une sur représentation des jeunes,<br />
des femmes, et peu d’ancienneté dans <strong>le</strong> métier. Presque la moitié des enseignants de<br />
moins de 0 ans se déclarent ainsi victimes et <strong>le</strong>s deux tiers des enseignants entrant dans<br />
<strong>le</strong> métier affirment avoir subi au moins une vio<strong>le</strong>nce. Plus de 0 % des femmes disent avoir<br />
été victimes (cf. graphiques ci-dessous). Les taux de victimation déclinent avec l’ancienneté<br />
dans <strong>le</strong> métier. On pourrait avancer que l’expérience engrangée par <strong>le</strong>s années de classe<br />
amène <strong>le</strong>s enseignants à mieux gérer <strong>le</strong>s conflits et à éviter ainsi de se retrouver en position<br />
de victimation. Or l’équipe de l’éco<strong>le</strong> élémentaire Freinet se caractérise par une surreprésentation<br />
d’hommes et une ancienneté plus importante dans <strong>le</strong> métier.
Âge des enseignants victimes<br />
,<br />
moins de<br />
0 ans<br />
Jeune<br />
enseignant déclarant<br />
au moins une<br />
victimation<br />
,<br />
0- ans plus de 0<br />
ans<br />
* Proportion des enseignants avec la caractéristique<br />
mentionnée par l’item déclarant au moins une<br />
victimation. Ex : % des enseignantes femmes<br />
déclarent avoir été victime au moins une fois.<br />
Pourcentage en colonnes.<br />
,<br />
Femme<br />
Avec peu<br />
d’ancienneté<br />
dans <strong>le</strong> métier<br />
Sexe des enseignants victimes<br />
,<br />
masculin féminin<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
, *<br />
Ancienneté des enseignants victimes<br />
,<br />
an ou<br />
moins<br />
0,<br />
entre et<br />
0 ans<br />
,<br />
plus de 0<br />
ans
1.2. Analyse d’incidents<br />
Si <strong>le</strong>s maîtres Freinet, année , ne déclarent aucune victimation au moment de l’enquête, <strong>le</strong>s<br />
entretiens montrent que <strong>le</strong>s années scolaires sont cependant ponctuées d’incidents, incidents<br />
dont <strong>le</strong> nombre a diminué selon <strong>le</strong>s enseignants . Outre la vulnérabilité différentiel<strong>le</strong> à la<br />
vio<strong>le</strong>nce que nous venons d’exposer, il convient donc d’étudier deux autres hypothèses :<br />
– la vio<strong>le</strong>nce a diminué mais aussi changé de formes, ce qu’il en reste n’est plus<br />
considéré comme un problème endémique par <strong>le</strong>s enseignants ;<br />
–<br />
<strong>le</strong>s incidents ne sont pas lus comme des vio<strong>le</strong>nces car cette <strong>le</strong>cture implique un<br />
découpage victimes-auteurs qui ne correspond pas à la gril<strong>le</strong> d’analyse et de gestion<br />
des situations des maîtres Freinet.<br />
1.2.1. Une diminution du phénomène de vio<strong>le</strong>nce<br />
La vio<strong>le</strong>nce a diminué , ce qu’il en reste n’est plus considéré comme un problème endémique<br />
par <strong>le</strong>s maîtres Freinet, même si el<strong>le</strong> peut réapparaître sporadiquement. El<strong>le</strong> ne constitue<br />
plus un problème à partir du moment où el<strong>le</strong> n’est plus un obstac<strong>le</strong> au travail de la classe.<br />
« Quand on y est, moi je pense qu’il n’y a pas plus de vio<strong>le</strong>nce… comment je dirais ça…<br />
généra<strong>le</strong>, sous-jacente, d’un peu partout, de tous <strong>le</strong>s coins, ça non je trouve qu’il y en a<br />
plus. »<br />
« Quand on y est, moi je pense qu’il n’y a plus de vio<strong>le</strong>nce… comment je dirais ça… généra<strong>le</strong>,<br />
sous-jacente, d’un peu partout, de tous <strong>le</strong>s coins, ça non je trouve qu’il y en a plus. […] je trouve<br />
que dans l’éco<strong>le</strong> on n’a pas tant… on n’a pas beaucoup de problèmes de vio<strong>le</strong>nce. Par rapport<br />
à […] où j’étais avant, qui est quand même un quartier… c’est quand même pas un quartier<br />
extrêmement chaud. On a moins d’enfants qui reviennent en récréation avec des bosses ou…<br />
parce qu’ils se sont té<strong>le</strong>scopés, ou parce qu’ils se sont renversés ou… moi je trouve qu’on soigne<br />
relativement peu d’enfants par exemp<strong>le</strong> à la récréation. C’est quand même un signe, ça veut dire<br />
que, même hors <strong>le</strong> fait de se taper à coups de poing, quand tu as pas eu beaucoup d’accidents,<br />
c’est quand même <strong>le</strong> signe que t’as pas eu des jeux où on a passé son temps à courir comme<br />
des fous sans faire attention à personne autour de nous. Ça, moi, je trouve qu’on n’a pas trop […].<br />
Moi je trouve que c’est assez tranquil<strong>le</strong> » (CE , année ).<br />
« Il y a une dose norma<strong>le</strong> » [d’agressivité]<br />
« ils chahutent un peu, bon ils chahutent parce que après, il faut pas non plus que n’importe quel<br />
geste, <strong>le</strong> jour où il y aura plus un gamin qui enverra un coup de poing à un autre, je veux dire, il<br />
faut pas non plus en faire toujours des montagnes, tu sais, on va convoquer la police municipa<strong>le</strong>,<br />
<strong>le</strong> ministère de la justice, non mais c’est vrai […]. Ouais, c’est plus ça que <strong>le</strong> reste, et puis après,<br />
ceci-dit, <strong>le</strong>s gamins, c’est des gamins, moi si je vais à la piscine là, qu’on sort comme tout à<br />
l’heure, et je vois une flaque d’eau, et si je vois qu’il y en a pas un qui marche dans la flaque<br />
d’eau, j’arrête tout <strong>le</strong> monde et je <strong>le</strong>ur dis al<strong>le</strong>z hop chacun son tour on y va hein, ou alors c’est<br />
plus des gosses quoi, enfin je sais pas, faut pas non plus déconner quoi, donc qu’ils aient une<br />
agressivité à libérer, que ce soit à travers des choses et tout ça, moi je pense qu’il y a une dose<br />
norma<strong>le</strong> si tu veux » (CM , année ).<br />
La disparition des actions en direction de l’institution, du fonctionnement de l’éco<strong>le</strong> rendant<br />
improbab<strong>le</strong> <strong>le</strong> bascu<strong>le</strong>ment du quotidien dans <strong>le</strong> non lisib<strong>le</strong>, <strong>le</strong> non maîtrisab<strong>le</strong> (comme <strong>le</strong><br />
montre très directement <strong>le</strong> premier extrait) enterre une <strong>le</strong>cture socia<strong>le</strong> sur <strong>le</strong> registre de la<br />
vio<strong>le</strong>nce. Si <strong>le</strong>s problèmes diminuent, <strong>le</strong>s enseignants soulignent cependant qu’il reste des<br />
Leurs discours concordent avec <strong>le</strong>s observations réalisées au sein de l’éco<strong>le</strong> montrant une baisse<br />
manifeste des vio<strong>le</strong>nces au bout d’un mois de prise en main de l’équipe pédagogique (année ), cf. Carra,<br />
Faggianelli, 00 .<br />
cf. Carra, 00 a, qui expose tout particulièrement l’évolution du phénomène à partir des données<br />
élèves et parents.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
élèves « durs ». La vio<strong>le</strong>nce, comme <strong>le</strong> montrent <strong>le</strong>s extraits suivants, se définit alors par <strong>le</strong><br />
danger qu’el<strong>le</strong> représente pour l’intégrité physique des élèves qui pourraient la subir.<br />
« il reste quelques enfants qui ont une vio<strong>le</strong>nce en eux forte »<br />
« Ce que je trouve c’est qu’il reste quelques enfants qui ont une vio<strong>le</strong>nce en eux forte et qu’on<br />
n’arrive pas… enfin on arrive à <strong>le</strong>s empêcher de faire du mal aux autres ou etc. mais ces enfantslà,<br />
on n’arrive pas à <strong>le</strong>s faire changer eux, pour qu’ils ne soient plus vio<strong>le</strong>nts, moi je pense à…<br />
Dans ma classe, bon il y a Su. Qui est un peu brutal en récréation hein ! Mais je ne <strong>le</strong> mettrais pas<br />
dans <strong>le</strong>s enfants vio<strong>le</strong>nts dans <strong>le</strong> sty<strong>le</strong> où en récréation, ils auraient qu’une envie c’est d’être…<br />
d’al<strong>le</strong>r taper un autre, ou qu’il y aurait des règ<strong>le</strong>ments de compte […]. Moi je pense à quelques<br />
cas, Ya. ou à D. quelques enfants qui sont, dans <strong>le</strong>s classes, qui ont une espèce de vio<strong>le</strong>nce en<br />
eux, qu’on sait que si on ne <strong>le</strong>s a pas à l’œil, eux, une des premières choses qu’ils vont faire,<br />
c’est d’essayer de trouver un endroit où ils vont pouvoir taper sur quelqu’un ou etc. ils sont<br />
extrêmement… c’est comme si c’était <strong>le</strong>ur activité première quand ils sont libérés » (CE , année<br />
).<br />
« il y a des gosses » « qui risquent d’être dangereux »<br />
« après là où c’est pas, où il y a des gosses qui deviennent dangereux comme Q. par exemp<strong>le</strong><br />
chez S. […]. Il y a D. chez moi, Y. qui fait beaucoup plus de bruit en fait qu’il n’agit, mais c’est ces<br />
deux-là, si tu veux, qui risquent d’être dangereux, parce que eux, quand ils frappent, ils frappent<br />
hein, ils peuvent faire mal hein, c’est clair, eux on <strong>le</strong>s a à l’œil vraiment très fortement, parce que<br />
c’est plus fort qu’eux, c’est plus fort qu’eux, mais à la maison <strong>le</strong>s parents n’en viennent pas à bout<br />
hein… » (CM , année ).<br />
La vio<strong>le</strong>nce n’est plus cette agitation permanente, cette tension de tous <strong>le</strong>s instants donnant<br />
lieux à une multitude d’incidents dont par<strong>le</strong>nt <strong>le</strong>s enseignants en septembre de l’année<br />
et qui constitue un obstac<strong>le</strong> pour <strong>le</strong> travail des élèves ; el<strong>le</strong> n’est plus repérab<strong>le</strong> que chez<br />
certains élèves. Pour autant, lorsqu’ils sont remplacés, ces élèves s’engouffrent dans <strong>le</strong>s<br />
brèches qui s’ouvrent alors dans <strong>le</strong> fonctionnement scolaire, déstabilisant, plus ou moins<br />
profondément selon <strong>le</strong>s classes, ce qui avait été progressivement mis en place.<br />
« <strong>le</strong>s gosses tout de suite se sont engouffrés dans toutes <strong>le</strong>s brèches, c’était infernal »<br />
« pour el<strong>le</strong> [la stagiaire], ça a été l’enfer, tu peux pas savoir, tu peux pas savoir, moi je suis venue<br />
une fois, el<strong>le</strong> en avait un sous <strong>le</strong> bras et <strong>le</strong>s deux autres qui se battaient par terre et puis <strong>le</strong>s<br />
autres ils étaient en train de je sais pas quoi, il y avait une qui était, enfin je veux dire, on peut pas<br />
s’imaginer ce que la, ce que la fil<strong>le</strong> a vécu, el<strong>le</strong> avait caché toutes <strong>le</strong>s éponges, <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s et tout<br />
ça au-dessus des étagères, parce qu’ils se lançaient, ils se lançaient <strong>le</strong>s éponges, ils se lançaient<br />
<strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s, el<strong>le</strong> a pas pu travail<strong>le</strong>r du tout, la fil<strong>le</strong> pendant trois semaines, et je comprends pas ce<br />
qu’/el<strong>le</strong>/, ce qu’il s’est passé parce que quand el<strong>le</strong> est venue pendant, bon el<strong>le</strong> a vu une classe qui<br />
était relativement calme, ils étaient pas très calmes, il faut pas exagérer, ils étaient relativement<br />
calmes, on sentait bien que c’était une classe diffici<strong>le</strong> quand même d’abord, je <strong>le</strong> dis hein, c’est<br />
une classe diffici<strong>le</strong>, il y a beaucoup de caractères, il y a beaucoup de sa<strong>le</strong>s caractères, il y a<br />
beaucoup d’enfants, on voit qu’il y a (?) enfreindre toujours <strong>le</strong>s lois et tout ça, et el<strong>le</strong> me dit, ils ont<br />
l’air gentils et tout ça, je lui dis méfie-toi, je lui dis maîtrise tout bien ce que tu fais, maîtrise, ne fait<br />
pas […] et <strong>le</strong>s gosses tout de suite se sont engouffrés dans toutes <strong>le</strong>s brèches, c’était infernal,<br />
infernal, on était au-dessus donc au deuxième étage on était au-dessus, on entendait du bruit,<br />
c’était infernal mais infernal, je suis même venu plusieurs fois pour remettre un peu d’ordre parce<br />
que moi je pouvais plus… » (CP, année ).<br />
« il n’y avait aucun problème et après il y a eu cette attitude d’excitation permanente »<br />
« j’ai vu qu’après ben, il y a des attitudes qui sont marquées et que c’était dur de reprendre […].<br />
Alors qu’avant, ça roulait tout seul quoi, ça roulait tout seul, je prenais <strong>le</strong>s autres, ça roulait tout<br />
seul, il n’y avait aucun problème et après il y a eu cette attitude d’excitation permanente, je /t’ai<br />
expliqué/, qui était revenue en récurrence quoi, tout <strong>le</strong> temps, tu sais, comme ça, et là moi, je<br />
peux plus rien faire d’autre que de aussi faire comme j’ai dit à la fil<strong>le</strong> de… on va faire <strong>le</strong>s choses<br />
tous ensemb<strong>le</strong> et puis on va /obéir aux/ règ<strong>le</strong>s et puis on rappel<strong>le</strong> et tout ça » (CP, année ).<br />
L’ordre scolaire, comme <strong>le</strong> montrent ces discours, fait apparaître la place considérab<strong>le</strong> des<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
maîtres titulaires. Ils par<strong>le</strong>nt de « classe diffici<strong>le</strong>s » qu’il faut « maîtriser », « d’élèves durs »<br />
qu’il faut « canaliser ». L’instauration d’un ordre scolaire apparaît ainsi passer par un travail<br />
continu, de longue ha<strong>le</strong>ine, et une vigilance de tous <strong>le</strong>s instants.<br />
1.2.2. Des incidents aux formes similaires mais une <strong>le</strong>cture différente de la<br />
réalité<br />
À l’instar de <strong>le</strong>urs collègues du département du Nord, <strong>le</strong>s incidents qui apparaissent <strong>le</strong>s plus<br />
marquants, impliquent <strong>le</strong>s parents et ce, d’autant plus lorsque ces derniers font intrusion<br />
dans l’espace-temps classe. Là aussi, ils résultent souvent d’une sanction prise à l’encontre<br />
de <strong>le</strong>ur enfant que <strong>le</strong>s parents estiment non justifiée ou injuste.<br />
« Le papa est venu fâché <strong>le</strong> soir, pour récupérer <strong>le</strong> ballon »<br />
« j’aimerais que tu choisisses un incident qui t’as particulièrement touché depuis <strong>le</strong> début de<br />
l’aventure…<br />
– Qui m’aurait moi mis mal à l’aise ?<br />
– Même plus, meurtrie, ou heurtée ou…<br />
– Meurtrie moi. (si<strong>le</strong>nce) Un extrêmement grave mais un où j’ai eu un ressenti moi. C’est un<br />
enfant qui n’est plus là qui s’appel<strong>le</strong> N. Je sais pas si tu te rappel<strong>le</strong>s de lui, enfin bon, il était ici, il<br />
venait d’ail<strong>le</strong>urs et puis au bout de deux ou trois [semaines ou mois ?], il est reparti et où c’était<br />
aussi un enfant (rire) qui pouvait être très pénib<strong>le</strong> par certains moments et qui ne respectait<br />
aucune règ<strong>le</strong> qui est toujours à la limite de la règ<strong>le</strong>, qui essaye de la franchir et c’était juste pour<br />
une histoire de ballon, à qui j’avais pris son ballon. Le papa est venu fâché <strong>le</strong> soir, pour récupérer<br />
<strong>le</strong> ballon et en fait, on n’a pas… »<br />
« Et on n’a pas convoqué <strong>le</strong> parent dans la sal<strong>le</strong> des maîtres […] pour lui rappe<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s<br />
règ<strong>le</strong>s de fonctionnement »<br />
« À mon avis, là on n’a pas été bien jusqu’au bout, c’est-à-dire qu’on aurait dû faire comme on<br />
a fait après pour d’autres parents, parce qu’il est arrivé furieux, c’était pas méchant ce qu’il m’a<br />
dit mais il voulait récupérer absolument… son fils avait absolument raison quoi. Puisque Mme<br />
N. lui a pris, el<strong>le</strong> était méchante, discours classique dans ces cas là. Et on n’a pas convoqué <strong>le</strong><br />
parent dans la sal<strong>le</strong> des maîtres avec un ou deux enseignants pour lui rappe<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s de<br />
fonctionnement comme, on ne vient pas comme ça sans demander à être reçu, qu’on ne venait<br />
pas interrompre quelqu’un en train de travail<strong>le</strong>r ».<br />
« Tu vois, ça c’est peut-être la chose… »<br />
« Parce qu’il est venu à un moment où je… je sais plus ce qui se passait, c’était un jour où en<br />
plus mes élèves faisaient un spectac<strong>le</strong> dans la sal<strong>le</strong> de sport. C’était la dernière semaine des<br />
vacances de Noël. On faisait un petit truc et il est venu m’interrompre à un moment où on était<br />
en train de représenter, enfin <strong>le</strong>s gamins n’étaient pas encore ressortis du vestiaire, je sais plus.<br />
J’étais encore avec des élèves pour me raconter sur cette histoire du gamin qui ne me préoccupait<br />
vraiment pas et en… j’ai… où j’ai pas réagi à reporter et à <strong>le</strong> convoquer pour en par<strong>le</strong>r donc là,<br />
non… j’ai pas de souvenir. J’ai pas eu de conflit fort en face. Tu vois, ça c’est <strong>le</strong> plus grave de ce<br />
que j’ai pu avoir » (CE , année ). L’incident que relate l’enseignante s’est déroulé année .<br />
Ce qui fait vio<strong>le</strong>nce à l’enseignante, à l’instar de ses collègues, c’est l’intrusion dans son<br />
espace-temps de travail : « Tu vois c’est peut-être la chose »… la plus grave. Mais ce qui la<br />
différencie, c’est son analyse du traitement de l’incident : « on n’a pas convoqué <strong>le</strong> parent<br />
dans la sal<strong>le</strong> des maîtres […] pour lui rappe<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s de fonctionnement ». L’incident est<br />
en effet relaté par la majorité des enseignants qui se déclarent victimes de vio<strong>le</strong>nce comme<br />
s’ils ne pouvaient peser sur l’interaction et ses suites, comme si l’incident se construisait en<br />
dehors d’eux. La situation n’est pas interrogée, ni recontextualisée, tant el<strong>le</strong> désempare,<br />
déstabilise. El<strong>le</strong> échappe d’autant plus à une possib<strong>le</strong> gestion en dehors de la réaction à<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
chaud, se construisant sur la peur se mêlant parfois à d’autres émotions comme la colère,<br />
l’exaspération, la priorité étant de se sortir de la situation péril<strong>le</strong>use, au mieux, en sauvant<br />
la face, au pire en se protégeant tant bien que mal.<br />
Un autre incident (année ) a produit une forte activité de l’équipe pédagogique. Certains<br />
des éléments mis en avant dans <strong>le</strong> discours des maîtres Freinet sont similaires à ce qui<br />
apparaît comme constitutifs du ressenti de vio<strong>le</strong>nce dans <strong>le</strong>s incidents relatés par <strong>le</strong>s<br />
autres enquêtés : l’imprévisibilité et <strong>le</strong> profond fossé par rapport aux règ<strong>le</strong>s qui régissent <strong>le</strong>s<br />
situations, comme si l’imprévisibilité était <strong>le</strong> prémisse à l’entrée dans l’univers de la vio<strong>le</strong>nce<br />
alors que la vio<strong>le</strong>nce était assimilée à la suspension d’un ordre, cette suspension donnant<br />
<strong>le</strong> sentiment d’être vulnérab<strong>le</strong> à la personne qui la vit, la projetant dans un espace-temps<br />
hors normes. C’est ce qui explique <strong>le</strong> sentiment que la situation échappe au contrô<strong>le</strong>, autre<br />
élément qui contribue à vivre l’incident comme une vio<strong>le</strong>nce. Le discours ci-après fait aussi<br />
apparaître l’incrédulité de l’enseignant, l’incompréhension de l’incident et un comportement<br />
perçu d’abord comme inaccessib<strong>le</strong> à l’entendement.<br />
« c’était arrivé à un moment où on ne s’y attend pas »<br />
« Enfin moi, c’était la première année avec <strong>le</strong> père E., là, t’as entendu par<strong>le</strong>r ? Ouais, ouais,<br />
c’était assez délirant. Je crois que c’était déjà, ça avait déjà commencé là, là… j’étais pas encore<br />
arrivé, c’était <strong>le</strong> président de l’APE [association des parents d’élèves], c’est assez rigolo. C’est<br />
marrant c’était arrivé à un moment où on ne s’y attend pas. Et puis parce que c’est tel<strong>le</strong>ment aussi<br />
aberrant que, tu vois, tu vois que, enfin je sais pas trop comment répondre, on est dans l’absurde,<br />
<strong>le</strong> mensonge que je sais pas quoi dire, t’as du mal à trouver <strong>le</strong>s ficel<strong>le</strong>s. Alors <strong>le</strong> tout début, en<br />
fait c’était assez rigolo. C’est donc monsieur E. qui est venu râ<strong>le</strong>r à une heure et demi, à l’accueil,<br />
à h 0 parce qu’en fait j’avais mis son fils… Il était venu me voir personnel<strong>le</strong>ment quoi. Il avait<br />
dit : « vous avez mis mon fils sur <strong>le</strong> côté à la récréation, cinq minutes parce qu’il se battait, en fait<br />
il se battait pas, il essayait de défendre quelqu’un et donc c’est une preuve que la récré, el<strong>le</strong> est<br />
pas bien surveillée ». Enfin, « vous surveil<strong>le</strong>z pas bien la récré » et donc je sais pas, on sentait<br />
un peu l’agressivité chez lui, c’était <strong>le</strong> mec qui avait envie d’en découdre ou je sais pas, tu vois.<br />
Enfin moi je lui rappel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s faits, tu vois, ce qui s’est passé à la récré. Alors, au bout de la cour il<br />
y avait deux grands qui se battaient et son fils à lui qui essayait d’en chopper un par derrière, de<br />
<strong>le</strong> plaquer par terre (rire). Donc moi je <strong>le</strong>s ai séparés, je <strong>le</strong>s ai mis cinq minutes sur <strong>le</strong> côté, « bon<br />
vous vous calmez et vous irez jouer après ». Tu vois c’était ça (rire). » (CE , année ).<br />
« pourquoi ça prend de l’amp<strong>le</strong>ur cet incident ? »<br />
Suite de l’extrait précédent : « Donc, tu vois, déjà <strong>le</strong> type, c’était bizarre quoi, pourquoi ça prend<br />
de l’amp<strong>le</strong>ur cet incident ? Et M. [enseignant de CM ] était avec moi, M. s’est approché, tu vois,<br />
et <strong>le</strong> père qui est coincé dit « ben voilà, je vais al<strong>le</strong>r au rectorat porter plainte, que la récréation,<br />
<strong>le</strong>s récréations sont pas surveillées ». Enfin, tu vois, c’est ça, moi j’avais du mal à m’énerver. Par<br />
contre M., tu vois, il était énervé, il é<strong>le</strong>vait la voix, tu vois, il était sorti de ses gongs quoi, pis <strong>le</strong><br />
mec : « je vais al<strong>le</strong>r au rectorat, je vais al<strong>le</strong>r rectorat », tu vois. »<br />
« après, tout ça était monté en bou<strong>le</strong> de neige »<br />
Suite de l’extrait précédent : « Et tu vois, donc on savait pas trop. Et <strong>le</strong> père derrière a continué<br />
son histoire, il est allé dire, soit disant, moi j’avais pas d’enfant à lui dans ma classe hein ! Que moi<br />
j’avais traumatisé <strong>le</strong>s enfants parce que j’avais parlé, je sais plus, de la mort. Je parlais de la mort,<br />
voilà, je sais pas quoi, j’avais parlé de la mort. Je me souviens plus d’avoir parlé de la mort, alors<br />
c’est possib<strong>le</strong> qu’un enfant à l’entretien qui ait raconté un truc… Mais, tu vois, même moi j’avais<br />
pas souvenir de ça, donc tiens on a évoqué <strong>le</strong> sujet ou pas ? Donc soit disant voilà, moi j’avais<br />
traumatisé la classe en parlant de la mort. Donc j’apprenais par lui, oui c’est ça par lui ou je sais<br />
plus quoi, aucun parent de la classe n’était venu me voir, tu vois. Pis après, tout ça était monté<br />
en bou<strong>le</strong> de neige. Après il en voulait à D. [enseignante de CP], sa fil<strong>le</strong> était chez D. Il en voulait<br />
à D. parce que D. pff… je sais pas… qu’el<strong>le</strong> avait parlé de la sexualité ou des positions pour faire<br />
l’amour, enfin tu vois, bref tu vois, pis après S. [enseignant de CM et directeur] parce qu’il avait<br />
pas, il faisait pas Char<strong>le</strong>magne en histoire. Enfin, tu vois, après des trucs comme ça. »<br />
Une similitude encore avec <strong>le</strong> vécu des autres enquêtés réside dans <strong>le</strong>s conséquences.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
L’incident est marquant et <strong>le</strong> reste d’ail<strong>le</strong>urs longtemps après. On <strong>le</strong> repère extrêmement<br />
faci<strong>le</strong>ment dans <strong>le</strong>s discours pourtant tenus un an plus tard. La rupture de l’ordre des<br />
interactions quotidiennes a des répercussions sur <strong>le</strong>s relations qu’entretient l’enseignant<br />
avec la personne responsab<strong>le</strong> de cette rupture. Il y a un avant et un après et, dans cet<br />
après, il n’est pas concevab<strong>le</strong> de travail<strong>le</strong>r encore avec, ce qui aboutira à la démission de<br />
ce parent d’élève de son rô<strong>le</strong> au sein de l’APE. Les interactions portent par ail<strong>le</strong>urs la trace<br />
d’une crainte d’un nouveau bascu<strong>le</strong>ment :<br />
« parce que <strong>le</strong> gars quand il arrive, tu vois, je sais pas, je <strong>le</strong> regarde… même la mère, tu<br />
vois, je peux plus la regarder naturel<strong>le</strong>ment. »<br />
« On voulait plus être intermédiaire, enfin on s’était dit c’est plus possib<strong>le</strong> quoi qu’on ait à<br />
discuter avec lui, organiser des fêtes d’éco<strong>le</strong> et tout avec un gars comme ça, qui a une image<br />
des enseignants terrifiante, enfin, qui a pas confiance en nous, qui va dire des saloperies sur<br />
notre compte et tout. Enfin tu vois, on s’est dit c’est plus possib<strong>le</strong> quoi, ça peut plus être notre<br />
interlocuteur. Il est plus, en plus, représentatif des parents, quoi. Donc je sais plus trop comment<br />
ça s’est fait (si<strong>le</strong>nce) […] parce que <strong>le</strong> gars quand il arrive, tu vois, je sais pas, je <strong>le</strong> regarde…<br />
même la mère, tu vois, je peux plus la regarder naturel<strong>le</strong>ment » (CE , année ).<br />
« on sentait, tu vois déjà, qu’el<strong>le</strong> était prête à repartir »<br />
« Moi j’ai ses deux enfants à lui, cette année dans la classe, tu vois. Mais il vient plus jamais<br />
chercher ses enfants, il travail<strong>le</strong> maintenant, ça l’occupe, ça lui occupe l’esprit, il est peut-être un<br />
peu fatigué <strong>le</strong> soir quand il rentre chez lui, tu vois. Alors sa femme… mais c’est pareil, tu vois […]<br />
mais bon, la mère, el<strong>le</strong> a jamais rien dit, mais quand on était en stage (rire) je sais pas, on était<br />
encore ici dans l’éco<strong>le</strong>, au moment du stage, c’était <strong>le</strong>s premiers jours. El<strong>le</strong> était en bas, el<strong>le</strong> m’a<br />
dit « pourquoi A. el<strong>le</strong> a changé de place ? », enfin tu vois […], « alors pourquoi, el<strong>le</strong> a changé de<br />
place A. ? », il y a peut-être une raison, je suis allé voir la remplaçante à sa place, pour éviter <strong>le</strong>s<br />
vagues, tu vois, on sentait, tu vois déjà, qu’el<strong>le</strong> était prête à repartir, on y va quoi, tu vois c’est<br />
reparti à faire des histoires, tu vois » (CE , année ).<br />
C’est en recourrant au statut de l’APE que l’équipe obtiendra la démission de son<br />
président :<br />
« Euh il a démissionné, c’est-à-dire que nous on a dit que tant que ce monsieur tant que monsieur<br />
E., cette personne serait présidente de l’association de parents d’élèves euh, on ne travail<strong>le</strong>rait plus<br />
avec l’association de parents d’élèves parce que <strong>le</strong>s actes et ce qu’il a fait étaient contradictoires<br />
avec <strong>le</strong>s statuts de l’APE hein, puisqu’on a repris <strong>le</strong>s statuts qui sont la défense de l’éco<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s<br />
relations entre <strong>le</strong>s parents etc. donc on a repris <strong>le</strong>s choses <strong>le</strong> plus léga<strong>le</strong>ment possib<strong>le</strong> et puis<br />
après on a aussi posé des choses sur ce qui était diffamatoire et faux hein, donc là, par rapport<br />
au savoir qui était dispensé ou que, qui ne l’était pas hein » (directeur, année ).<br />
Dans l’échantillon, <strong>le</strong>s enseignants qui se sont déclarés victimes en soulignent aussi <strong>le</strong>s<br />
conséquences ; el<strong>le</strong>s sont d’ordre psychiques et professionnel<strong>le</strong>s . Sentiment d’être démuni,<br />
désarmé, impuissant, démotivés, découragés, déçus, écœurés, angoissés sont autant de<br />
termes utilisés par ces enseignants pour décrire <strong>le</strong>s répercussions de la vio<strong>le</strong>nce dont<br />
ils se déclarent victimes. Ce vécu est corrélé à un sentiment d’insécurité reposant sur <strong>le</strong><br />
sentiment que tout peut bascu<strong>le</strong>r à tout moment ; tout (et n’importe quoi) peut se produire.<br />
Si l’imprévisibilité est constitutive de la construction d’un sentiment de vio<strong>le</strong>nce, la menace<br />
de l’imprévisib<strong>le</strong> nourrit <strong>le</strong> sentiment d’insécurité. Pour autant, près de % de la population<br />
enquêtée se déclarent « toujours » en sécurité. Les maîtres Freinet s’inscrivent dans cette<br />
dernière tendance. Seul <strong>le</strong> directeur nuance en disant qu’il se dit « souvent » en sécurité et<br />
Les enseignants ne par<strong>le</strong>nt pas de conséquences physiques ni matériel<strong>le</strong>s. Les agressions physiques<br />
étant extrêmement rares expliquent qu’aucun enseignant ne fasse état de conséquences physiques. En<br />
revanche, <strong>le</strong>s vols <strong>le</strong> sont beaucoup moins, pour autant ils ne sont mentionnés ni à travers <strong>le</strong>s faits, ni à<br />
travers des répercussions. Autrement dit, <strong>le</strong> vol n’est pas considéré comme une vio<strong>le</strong>nce contrairement aux<br />
catégories institutionnel<strong>le</strong>s de recueil des vio<strong>le</strong>nces par <strong>le</strong> logiciel SIGNA. La gril<strong>le</strong> institutionnel<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture<br />
de la « réalité » de la vio<strong>le</strong>nce apparaît ainsi en décalage avec cel<strong>le</strong> des professionnels.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
non pas « toujours » en précisant : « Pas toujours, car sentiment de fragilité de ce qui a été<br />
mis en place, construit ».<br />
Si <strong>le</strong>s similitudes sont fortes dans <strong>le</strong> vécu des incidents marquants ainsi d’ail<strong>le</strong>urs que<br />
dans <strong>le</strong>s circonstances et <strong>le</strong>s protagonistes, <strong>le</strong>s maîtres Freinet ne se positionnent pas<br />
en tant que victimes individuel<strong>le</strong>s d’une agression impliquant la désignation d’un coupab<strong>le</strong><br />
même si, dans cette affaire, on peut entrevoir une dynamique en ce sens. La logique<br />
dominante, quoiqu’il en soit, donne lieu à une réponse col<strong>le</strong>ctive d’une équipe pédagogique<br />
qui rencontre un problème dans l’exercice de ses fonctions et non pas à l’adoption d’une<br />
posture victimaire :<br />
« la réponse el<strong>le</strong> peut plus ou el<strong>le</strong> peut diffici<strong>le</strong>ment être individuel<strong>le</strong>, c’est-à-dire que la réponse<br />
qu’on va donner à un conflit par rapport à une famil<strong>le</strong>, ça va être une réponse col<strong>le</strong>ctive et que<br />
la réponse individuel<strong>le</strong>, el<strong>le</strong> est, là, el<strong>le</strong> est compliquée ouais euh, c’est-à-dire que ouais, c’est<br />
ça quoi, enfin je ne sais pas comment <strong>le</strong> dire autrement hein, mais la réponse qu’on donne moi<br />
à mon avis el<strong>le</strong> devient forcément euh col<strong>le</strong>ctive […]. Bon là, il y a eu des discussions longues<br />
hein, entre nous sur comment réagir, individuel<strong>le</strong>ment, est-ce que il y a une plainte individuel<strong>le</strong> de<br />
l’enseignant agressé ou pas etc. donc on a eu des…<br />
– Parce que fina<strong>le</strong>ment il n’y a pas eu plainte là ? ou si ?<br />
– Euh non on n’a pas été jusqu’à la plainte […]. Par contre il y a eu, il y a eu convocation du<br />
conseil d’éco<strong>le</strong> euh, il y a eu, il y a eu avertissement officiel avec courrier de la part de l’inspecteur<br />
à la famil<strong>le</strong> en disant que s’il y avait, que c’était un avertissement officiel, et que ça pouvait ensuite<br />
euh, ça pouvait rendre nécessaire l’exclusion de la famil<strong>le</strong>, enfin l’exclusion des enfants, c’està-dire<br />
que la famil<strong>le</strong>, on pouvait on pourrait imposer à la famil<strong>le</strong> d’al<strong>le</strong>r inscrire ses enfants dans<br />
une autre éco<strong>le</strong>, c’est une mesure qui peut exister qui est prise par l’inspecteur d’académie hein,<br />
mais il y a pas eu de plainte individuel<strong>le</strong>, ç’aurait pu mais moi je <strong>le</strong> souhaite jamais. Sauf s’il y a<br />
agression, enfin je veux dire, s’il y a coup, enfin s’il y a des choses vraiment très personnel<strong>le</strong>s<br />
euh, mais euh, si possib<strong>le</strong>, des, si possib<strong>le</strong>, des réponses col<strong>le</strong>ctives, maintenant si on va jusqu’à<br />
une plainte, après c’est forcément individuel » (directeur de l’éco<strong>le</strong>, année ).<br />
L’équipe apparaît soudée, réunie autour d’un projet pédagogique fort, tendue vers un objectif<br />
commun : la réussite de la pédagogie Freinet dans une éco<strong>le</strong> en éducation prioritaire. Il<br />
en va de la reconnaissance d’un mouvement pédagogique. Cet atout peut cependant se<br />
transformer en faib<strong>le</strong>sse, la pression que se mettent <strong>le</strong>s maîtres Freinet pour parvenir à <strong>le</strong>urs<br />
fins <strong>le</strong>s ayant conduit à redouter que l’incident avec <strong>le</strong> président de l’APE <strong>le</strong>s conduisent à<br />
la mise en cause de <strong>le</strong>ur projet pédagogique et au départ de l’équipe :<br />
« on a cru que lui en tant que président de l’association, il avait une influence sur beaucoup<br />
de parents »<br />
« Tout <strong>le</strong> monde a eu son petit truc quoi. Tu vois ça a vraiment pris de l’importance quoi. Enfin, en<br />
fait, on a cru que ça prenait de l’importance, on a cru que lui en tant que président de l’association,<br />
il avait une influence sur beaucoup de parents. Bon enfin après tout, moi je m’aperçois qu’en fait<br />
non, je crois que c’était deux, trois parents, je crois que c’était… ils s’étaient bourrés <strong>le</strong> mou à trois<br />
et nous, tu vois, on avait l’impression, enfin moi, on pensait que ça allait avoir une répercussion<br />
sur l’ensemb<strong>le</strong> des parents, tu vois, que ça pouvait créer <strong>le</strong> désordre, enfin tu vois devenir un<br />
bazar pas possib<strong>le</strong> ici. Mais enfin après coup je crois pas. Parce qu’il y avait beaucoup de gens<br />
qui n’étaient absolument pas au courant de tout ça. Tu vois ? » (CE , année ).<br />
« ils allaient abattre l’éco<strong>le</strong>, ils allaient nous faire partir »<br />
« l’inspecteur a convoqué ces parents […] il <strong>le</strong>s a convoqués à l’Inspection donc ils ont (?) donc<br />
il a tout repris point par point parce que soit disant il y avait p<strong>le</strong>in de parents qui étaient avec<br />
eux d’accord donc ils avaient toute une troupe qui était d’accord (?) ils allaient abattre l’éco<strong>le</strong>, ils<br />
allaient nous faire partir » (CP, année ).<br />
Si l’on accepte que « La question présente à l’arrière plan de toutes ces questions [sur<br />
la définition de la vio<strong>le</strong>nce] est cel<strong>le</strong> des contours de la personne, qui ne se limite pas<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
à la seu<strong>le</strong> individualité physique et varie avec <strong>le</strong>s cultures » (Michaud, 00 , ), on peut<br />
alors faire l’hypothèse que <strong>le</strong>s contours de la personne sont mieux préservés lorsqu’il y a<br />
un positionnement d’équipe. C’est là un élément important à transférer pour la prévention<br />
de la victimation des enseignants. Mais ce positionnement d’équipe pose la question de<br />
l’équipe et de sa constitution dont nous traiterons plus tard. Son efficience, par ail<strong>le</strong>urs,<br />
tient à une <strong>le</strong>cture des incidents qui apparaît fonction des formes de gestion des problèmes<br />
adoptés par <strong>le</strong>s professionnels. Limitée à une sorte de navigation à vue, el<strong>le</strong> ne permet pas<br />
de déconstruire <strong>le</strong> sentiment de vio<strong>le</strong>nce attachée à <strong>le</strong>ur survenue. Pensée et construite<br />
col<strong>le</strong>ctivement, el<strong>le</strong> favorise une reprise du contrô<strong>le</strong> de la situation, une réintroduction de<br />
la prévisibilité dans l’imprévisibilité, de la rationalité dans l’irrationalité, des règ<strong>le</strong>s dans la<br />
rupture de règ<strong>le</strong>s. Ces éléments nous amènent à étudier de manière plus fine <strong>le</strong>s modalités<br />
de gestion des incidents et ce, d’autant plus que si <strong>le</strong>s maîtres Freinet par<strong>le</strong>nt peu de<br />
vio<strong>le</strong>nces, <strong>le</strong>s moyens de régulation sont longuement développés.<br />
2. Les processus de régulation de la vie scolaire<br />
L’analyse des entretiens avec <strong>le</strong>s maîtres Freinet fait apparaître quatre niveaux de<br />
régulation :<br />
0<br />
– la gestion des conflits : intervention immédiate dès <strong>le</strong> déc<strong>le</strong>nchement du conflit en<br />
séparant <strong>le</strong>s protagonistes et un règ<strong>le</strong>ment différé de l’affaire ;<br />
– <strong>le</strong>s dispositifs de régulation de la vie scolaire : <strong>le</strong>s « conseils d’enfants » en particulier,<br />
l’importance du cadre et de la loi en général ;<br />
– <strong>le</strong>s définitions des rapports aux parents et l’organisation des relations entre eux et<br />
l’institution : pour une compréhension mutuel<strong>le</strong> et un soutien des parents dans <strong>le</strong> travail<br />
de <strong>le</strong>ur(s) enfant(s) ;<br />
–<br />
<strong>le</strong>s rituels, <strong>le</strong>s activités scolaires et <strong>le</strong> travail des élèves : <strong>le</strong> travail et <strong>le</strong> groupe<br />
contribuent à la régulation des problèmes.<br />
2.1. La gestion des conflits<br />
La logique dominante de gestion des conflits se caractérise d’abord par une intervention<br />
immédiate « en cas de vio<strong>le</strong>nce avérée » pour séparer <strong>le</strong>s protagonistes, que ce soit<br />
d’ail<strong>le</strong>urs des élèves ou des parents. S’il s’agit d’élèves (cf. extraits d’entretien précédents),<br />
ils sont sanctionnés immédiatement d’une perte d’autonomie et doivent rester en présence<br />
d’un adulte qui décide de ce qu’ils peuvent ou pas faire. Le règ<strong>le</strong>ment du conflit est différé<br />
et s’effectue soit au sein du conseil d’enfants de classe ou d’éco<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s élèves, soit en<br />
présence d’autres enseignants dans la sal<strong>le</strong> des maîtres s’il s’agit de parents. La réponse<br />
apportée est alors une réponse col<strong>le</strong>ctive, du groupe classe ou de l’équipe pédagogique,<br />
en rapport avec <strong>le</strong> cadre institutionnel et la loi. El<strong>le</strong> consiste à la fois à énoncer ce qui va<br />
à l’encontre des règ<strong>le</strong>s et à prévenir d’autres incidents en établissant une sorte de contrat<br />
tacite.<br />
« <strong>le</strong> plus vite possib<strong>le</strong> c’est <strong>le</strong> <strong>le</strong>ndemain hein, c’est-à-dire que c’est pas tout de suite »<br />
« Ben un gamin, un gamin par exemp<strong>le</strong> qui a, qui a frappé une gamine à l’extérieur de l’éco<strong>le</strong> à<br />
quatre heures trente cinq hein, devant la mère de la gamine hein, qui s’est fait frapper parce que,<br />
avant de venir à l’éco<strong>le</strong> <strong>le</strong> matin, il s’était disputé, enfin, il y avait eu des trucs euh, il a gardé ça<br />
toute la journée, et puis en sortant il est allé à quatre heures et demie juste après la gril<strong>le</strong>, il est<br />
allé frapper vio<strong>le</strong>mment, et donc là il y a eu des altercations entre <strong>le</strong>s parents et donc là, je sépare<br />
physiquement <strong>le</strong>s parents quand c’est possib<strong>le</strong> et puis très vite je prends d’abord <strong>le</strong>s parents un<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
par un.<br />
– Donc juste après ? Juste après <strong>le</strong> différent ?<br />
– Le plus vite possib<strong>le</strong>, non, non, <strong>le</strong> plus vite possib<strong>le</strong>, en tout cas, enfin je veux dire euh pas, <strong>le</strong><br />
<strong>le</strong>ndemain, <strong>le</strong> plus vite possib<strong>le</strong> c’est <strong>le</strong> <strong>le</strong>ndemain hein, c’est-à-dire que c’est pas tout de suite.<br />
Enfin sauf si il y a séparation physique et donc <strong>le</strong> <strong>le</strong>ndemain j’essaye de voir <strong>le</strong>s deux parents et<br />
<strong>le</strong>s enfants […] » (CM , année ).<br />
« je veux pas que ce qui se passe à l’extérieur puisse re-rentrer ou être importé dans<br />
l’éco<strong>le</strong> »<br />
Suite de l’extrait précédent :<br />
« Et là dans ce cas-là tu as fait comment ?<br />
– Dans ce cas-là c’est <strong>le</strong>s parents, c’était <strong>le</strong>s parents du premier enfant, celui qui avait frappé, et<br />
<strong>le</strong>s parents de l’enfant qui avait été frappé<br />
– L’un après l’autre ou ensemb<strong>le</strong> ?<br />
– L’un après l’autre hein, après j’ai fait la même chose pour essayer de comprendre <strong>le</strong>, faire dire<br />
ce qui pour eux c’était passé, d’où ça venait et pourquoi c’était venu, et une fois que j’avais à<br />
peu près <strong>le</strong>, un certain nombre d’informations, j’ai réuni <strong>le</strong>s deux, alors <strong>le</strong>s deux enfants ont été<br />
réunis en dehors du conseil, puisque ça se passait pas pendant la classe, et <strong>le</strong>s deux parents,<br />
pour qu’au moins ils puissent après, sinon retrouver des relations entre eux, ou en tout cas, se<br />
mettre l’un à côté de l’autre sans se taper dessus en gros, parce que là après, après, ce fait-là<br />
il y avait des /conflits/ des vio<strong>le</strong>nces potentiel<strong>le</strong>s entre <strong>le</strong>s, entre <strong>le</strong>s deux famil<strong>le</strong>s hein, et donc<br />
ça, ça veut dire que après, si on retrouve des vio<strong>le</strong>nces entre <strong>le</strong>s deux famil<strong>le</strong>s, on va retrouver<br />
chez <strong>le</strong>s gamins une vio<strong>le</strong>nce qui va être ré-importée plus tard dans la classe, directement ou<br />
indirectement, par un biais ou, et c’est ça que je veux pas, je veux pas que ce qui se passe à<br />
l’extérieur puisse re-rentrer ou être importé dans l’éco<strong>le</strong> si c’est, quand c’est possib<strong>le</strong>, bon là, ça<br />
s’est à peu près, ça c’est bien terminé si on veut ».<br />
« c’est pas seu<strong>le</strong>ment de la discussion il y a aussi un rappel de lois »<br />
Suite de l’extrait précédent :<br />
« […] Alors il y a discussion, c’est-à-dire que, c’est pas seu<strong>le</strong>ment de la discussion, il y a aussi un<br />
rappel de lois, c’est-à-dire que je rappel<strong>le</strong> ce que c’est que l’éco<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s euh, <strong>le</strong>s pouvoirs<br />
que j’ai en tant que fonctionnaire, en tant que représentant d’un service public pour, <strong>le</strong> garant de,<br />
à la fois de l’image de l’éco<strong>le</strong>, de je veux dire, de ce qui se passe juste aux abords de l’éco<strong>le</strong>, ça<br />
me regarde aussi quelque part, après si il y a des volontés ou d’amener, je veux dire, des conflits<br />
sur, dans <strong>le</strong> registre judiciaire ou policier, ça, ça relève de, je dis aux parents que ça relève de<br />
<strong>le</strong>ur initiative propre, qu’ils peuvent porter plainte si ils veu<strong>le</strong>nt, je rappel<strong>le</strong> ce qui est possib<strong>le</strong> au<br />
niveau de la loi pour <strong>le</strong>s parents et je rappel<strong>le</strong> moi, ce que j’ai comme obligation par rapport à la loi<br />
vis-à-vis d’eux, pour que l’éco<strong>le</strong> soit un lieu de paix relative, de paix socia<strong>le</strong> et un lieu de respect<br />
mutuel, <strong>le</strong>s enfants doivent se respecter, je respecte <strong>le</strong>s enfants, <strong>le</strong>s enfants me respectent et<br />
puis <strong>le</strong>s parents me respectent et <strong>le</strong>s parents se respectent entre eux, donc si il y a conflit, ça ne<br />
doit pas se faire dans l’éco<strong>le</strong>, à côté de l’éco<strong>le</strong> ou autour de l’éco<strong>le</strong>, en dehors j’ai pas de pouvoir<br />
euh, mais, et je rappel<strong>le</strong>, je <strong>le</strong>ur dis souvent que l’éco<strong>le</strong> n’est pas un lieu public, c’est un service<br />
public mais c’est pas un lieu public, donc il y a des choses que je ne peux pas accepter. »<br />
« j’attendais au minimum une verbalisation des explications et si possib<strong>le</strong> un contrat »<br />
Suite de l’extrait précédent :<br />
« Et par rapport aux enfants quel<strong>le</strong> suite a été donnée alors ?<br />
– Ben là-dessus il y a pas eu de sanction à l’intérieur de la classe puisque ça s’est pas passé, ça<br />
s’est pas passé dans l’éco<strong>le</strong>, dans la récréation, euh mais j’ai, mais j’ai, enfin, j’ai tenu à ce que<br />
<strong>le</strong>s enfants, tant que je n’avais pas <strong>le</strong>s explications et un accord, un modus vivendi qui permettait<br />
de vivre en coopération dans la classe, je ne je ne pouvais pas me permettre de laisser <strong>le</strong>s deux<br />
enfants tout seul, entre eux, sans que je sois là, c’est-à-dire que ça nécessitait pour moi de<br />
nouveau la présence d’un adulte, donc ils perdaient, ils ne perdaient pas d’autonomie par rapport<br />
au travail, par rapport aux règ<strong>le</strong>s de classe, ou aux récréations, mais que tant que <strong>le</strong> conflit n’était<br />
pas au moins verbalisé, explicité et compris, je veux dire, ils pouvaient pas être euh laissés tout<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
seul, à deux, confrontés, avec cette histoire, donc moi j’attendais au minimum une verbalisation<br />
des explications et si possib<strong>le</strong>, un contrat qui était de dire ben à l’extérieur aussi on est encore,<br />
on est encore des êtres humains quoi donc ».<br />
Le cadre institutionnel, la cohésion d’équipe et <strong>le</strong> soutien de la hiérarchie contribuent à<br />
préserver <strong>le</strong>s « contours » de la personne enseignante comme <strong>le</strong> montrent <strong>le</strong>s extraits<br />
suivants sur l’incident avec <strong>le</strong> président de l’association des parents d’élèves.<br />
« Moi sur <strong>le</strong> devant de la scène, à mon avis quoi. Bon là c’était toute l’équipe »<br />
« Ouais, moi je me dis, on sent qu’on est dans une équipe parce que, si ça s’était passé dans une<br />
autre éco<strong>le</strong>, il y aurait eu des doutes ou des mises en cause personnel<strong>le</strong>s. L’enseignant aurait<br />
été… Moi par exemp<strong>le</strong> parce que j’avais traumatisé, ou c’est à cause de moi plus ou moins, qu’il<br />
y avait eu cet incident à la récréation, tout ça. Tu vois j’aurais été mis en cause, enfin tu vois à<br />
mon avis… prise de distance, enfin tu vois. Moi sur <strong>le</strong> devant de la scène, à mon avis quoi. Bon<br />
là c’était toute l’équipe » (CE , année ).<br />
« l’important, c’est de faire corps, tu vois »<br />
« Après c’était aussi avec l’inspecteur. L’inspecteur qui était aussi pareil, là aussi c’était un appui<br />
un peu solide, dans la mesure où ça avait été aussi un inspecteur étranger, je sais pas comment<br />
il aurait réagi. Là, l’inspecteur il connaît ici sur ce qui se passe. Ouais l’important, c’est de faire<br />
corps, tu vois »(CE , année ).<br />
« rappe<strong>le</strong>r <strong>le</strong> projet d’éco<strong>le</strong>, comment on fonctionnait, qu’est-ce qu’on devait faire ici à<br />
l’éco<strong>le</strong> »<br />
« Oui ça s’est étoffé parce qu’après l’inspecteur, il a rencontré <strong>le</strong>s parents, <strong>le</strong> coup<strong>le</strong> là, il a fait une<br />
réunion ici avec <strong>le</strong>s représentants des classes, <strong>le</strong>s parents d’élèves, <strong>le</strong> père en question et sans<br />
par<strong>le</strong>r de lui, sans par<strong>le</strong>r de l’incident, rappe<strong>le</strong>r <strong>le</strong> projet d’éco<strong>le</strong>, comment on fonctionnait, qu’estce<br />
qu’on devait faire ici à l’éco<strong>le</strong>, en plaçant toutes ces questions, tu vois, de sexualité, de la mort,<br />
tu vois que l’éco<strong>le</strong> s’interroge sur <strong>le</strong> vivant, la reproduction et sans stigmatiser <strong>le</strong> bonhomme, enfin<br />
pas en disant c’est lui qui a créé <strong>le</strong>s problèmes et en disant, voilà, que <strong>le</strong>s parents qui nuiraient<br />
au bon fonctionnement de l’éco<strong>le</strong>, au bon dérou<strong>le</strong>ment du projet, ben ils seraient déplacés quoi,<br />
tu vois. À ce moment là, il se référerait à un artic<strong>le</strong> du règ<strong>le</strong>ment qui donne droit, pouvoir à un<br />
inspecteur de déplacer un enfant de l’éco<strong>le</strong> parce que ça gêne au bon fonctionnement du service,<br />
tout ça quoi » (CE , année ).<br />
C’est ainsi sur l’affirmation col<strong>le</strong>ctive et hiérarchique d’un sens général, définissant <strong>le</strong>s<br />
modalités d’existence de l’institution et <strong>le</strong>s attitudes des acteurs, que reposent <strong>le</strong>s modalités<br />
de gestion des incidents. C’est en intégrant cette dimension dans la gestion col<strong>le</strong>ctive<br />
qu’une transférabilité pourrait être efficiente. El<strong>le</strong> ne se limite donc pas à un positionnement<br />
d’équipe, s’unissant face au danger, face à un environnement extérieur hosti<strong>le</strong> dont il faudrait<br />
se protéger.<br />
2.2. Le conseil d’enfants : un dispositif central de régulation de la vie scolaire<br />
À la question : « Existe-t-il des actions en direction de la vio<strong>le</strong>nce dans votre éco<strong>le</strong> », un peu<br />
moins de la moitié des enquêtés répond par l’affirmative dont <strong>le</strong>s maîtres Freinet.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
, %<br />
Présence ou absence d'actions contre la vio<strong>le</strong>nce au sein de l'éco<strong>le</strong><br />
, %<br />
, %<br />
NR et NSP<br />
Les maîtres Freinet estiment ces actions indispensab<strong>le</strong>s et font partie des % à <strong>le</strong> déclarer.<br />
Avec ceux qui disent qu’el<strong>le</strong>s sont importantes, ils représentent un peu plus de la moitié des<br />
enquêtés.<br />
Estimation des enseignants sur <strong>le</strong>s actions en direction de la vio<strong>le</strong>nce dans <strong>le</strong>ur éco<strong>le</strong><br />
, %<br />
, %<br />
, %<br />
,0%<br />
non<br />
oui<br />
accessoires<br />
importantes<br />
indispensab<strong>le</strong>s<br />
NR et pas d'action<br />
Lorsqu’on <strong>le</strong>ur demande de préciser <strong>le</strong>s types d’actions menées, <strong>le</strong>s maîtres Freinet citent<br />
tous <strong>le</strong>s conseils d’enfants qui permettent une « actualisation permanente des lois de la<br />
classe » (CM ). Ils <strong>le</strong>ur apparaissent indispensab<strong>le</strong>s parce qu’ils contribuent à « l’écoute<br />
de chacun » (CE ) et « assurent la cohésion socia<strong>le</strong> […] une cohérence (interne, externe)<br />
des réponses de l’équipe pédagogique » (CM ) dans un contexte où « rien n’est jamais<br />
gagné dans notre milieu dit diffici<strong>le</strong>. Il faut sans cesse être attentif » (CM ). C’est aussi une<br />
confiance qui peut se construire au sein de ce dispositif :<br />
« Et puis aussi pendant <strong>le</strong>s conseils on essaye aussi des fois de, qu’ils aient plus confiance en eux,<br />
il faut qu’ils se sentent protégés aussi donc il faut qu’ils sentent que quand ils ont un problème, ils<br />
peuvent <strong>le</strong> dire et que nous, on va <strong>le</strong> rég<strong>le</strong>r ou qu’on va essayer de rég<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s choses, il faut qu’ils<br />
aient ça aussi <strong>le</strong> /moyen/ d’exprimer <strong>le</strong>ur, un peu ce qu’ils pensent (?) dans la classe aussi (?), il<br />
faut qu’ils retrouvent un peu confiance en eux » (CP, année ).<br />
Nous avons montré ail<strong>le</strong>urs (Carra, 00 a) combien ces conseils d’enfants constituaient un<br />
laboratoire de construction de la norme et de la règ<strong>le</strong>. Il agit dans la mesure où <strong>le</strong>s décisions<br />
prises lors de ces conseils régu<strong>le</strong>nt effectivement l’ensemb<strong>le</strong> du quotidien scolaire, ce qui<br />
implique à la fois une vigilance de chaque enseignant et une cohésion d’équipe importante. Il<br />
repose sur des principes de démocratie directe induisant donc une redéfinition des rapports<br />
traditionnels de pouvoir au sein de la classe et de l’éco<strong>le</strong>. En ce sens il permet une autorégulation<br />
que souligne <strong>le</strong> directeur de l’éco<strong>le</strong> :<br />
« Par rapport à la classe je pense que, la part que je mets dans <strong>le</strong> rappel des règ<strong>le</strong>s, des lois je<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
veux dire, oui la question des droits, des devoirs, el<strong>le</strong> est plus, el<strong>le</strong> est moins forte maintenant,<br />
c’est-à-dire qu’il y a une auto-régulation une auto-organisation à ce niveau-là qui me paraît quand<br />
même assez sensib<strong>le</strong> à l’intérieur de la classe et du groupe classe euh, ça c’est relativement clair<br />
euh, ce qui a beaucoup bougé aussi c’est entre huit heures vingt et seize heures trente euh, <strong>le</strong><br />
nombre de situations de conflits enfin de choses qui sont générées dans <strong>le</strong> temps scolaire est<br />
devenu très très faib<strong>le</strong> » (CM , année ).<br />
On voit ici l’intérêt d’une transférabilité de tels dispositifs. Des conseils d’enfants sont mis<br />
en œuvre dans d’autres éco<strong>le</strong>s mais ils ne produisent pas une auto-régulation des conflits<br />
lorsqu’ils se réduisent à une pacification de la vie scolaire et qu’ils ne s’articu<strong>le</strong>nt pas aux<br />
apprentissages. Par ail<strong>le</strong>urs, si l’intérêt de ce type de dispositif est manifeste pour faire<br />
évoluer <strong>le</strong>s représentations de la vio<strong>le</strong>nce dans <strong>le</strong> sens d’une déqualification idéologique<br />
des formes que peut prendre ce phénomène à l’éco<strong>le</strong>, son fonctionnement a pour effet de<br />
rendre légitime la réaction socia<strong>le</strong> à des formes de plus en plus diversifiées de déviances qui<br />
tendront à être happées par cette catégorie de vio<strong>le</strong>nces. Aussi, si <strong>le</strong> sentiment de vio<strong>le</strong>nce<br />
des élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet baisse dans un premier temps avec la diminution des faits<br />
initia<strong>le</strong>ment appréhendés comme vio<strong>le</strong>nts, il tend ensuite à s’amplifier avec l’introduction<br />
dans cette catégorie d’une multiplicité de nouveaux faits tout en rendant insupportab<strong>le</strong> ce<br />
qu’il reste des anciennes formes de vio<strong>le</strong>nce. Les difficultés rencontrées par <strong>le</strong>s remplaçants<br />
des maîtres Freinet indiquent de surcroît qu’une formation semb<strong>le</strong> nécessaire pour maîtriser<br />
ce type de dispositif dans sa relation au savoir et au pouvoir.<br />
2.3. Ouverture aux parents et clôture symbolique de l’éco<strong>le</strong><br />
S’il existe des heurts avec certains parents, <strong>le</strong>s maîtres Freinet déclarent cependant avoir<br />
plutôt de bonnes relations dans l’ensemb<strong>le</strong>, à l’instar de <strong>le</strong>urs collègues de l’échantillon<br />
(« bonnes » : . % des enquêtés).<br />
Estimation par <strong>le</strong>s enseignants de la qualité des relations avec <strong>le</strong>s parents d'élèves<br />
, %<br />
, %<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
,0%<br />
Non réponse<br />
moyennes<br />
bonnes<br />
Les modalités de rencontres prennent plusieurs formes, des plus courantes et traditionnel<strong>le</strong>s<br />
(rendez-vous individuels, réunions des parents d’élèves sans oublier ce qui est <strong>le</strong> plus<br />
fréquemment évoqué : « à la gril<strong>le</strong>, avant ou après la classe ») à l’inscription dans des<br />
dispositifs plus rarement évoqués par <strong>le</strong>s autres enseignants (cf. graphique ci-dessous).<br />
« L’heure des parents » (cf. extraits qui suivent) et <strong>le</strong>s ateliers du soir animés par <strong>le</strong>s parents<br />
d’élèves sont mentionnés par chacun des maîtres Freinet. Ils signent l’une des spécificités<br />
de cette éco<strong>le</strong> qui se caractérise par la volonté d’une ouverture aux parents pendant <strong>le</strong><br />
temps scolaire et péri-scolaire.
Types de rencontres avec <strong>le</strong>s parents d'élèves<br />
à la gril<strong>le</strong>, avant ou après la classe , %<br />
RDV à mon initiative , %<br />
réunions parents d'élèves , %<br />
RDV à la demande des parents , %<br />
sorties scolaires , %<br />
présentation du travail des enfants (heures des parents...) , %<br />
participation à des activités au sein de la classe (présenter un métier, contes...) , %<br />
autres (précisez) : , %<br />
Ces différents types de rencontre contribuent, pour <strong>le</strong>s maîtres Freinet, à la diversification<br />
des échanges qui ne portent pas seu<strong>le</strong>ment sur <strong>le</strong>s problèmes rencontrés par <strong>le</strong>s enfants,<br />
ce qui est traditionnel<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> cas, mais aussi sur <strong>le</strong>urs productions et <strong>le</strong>s démarches<br />
utilisées présentées à l’occasion de « l’heure des parents » :<br />
« l’heure des parents, <strong>le</strong>s enfants présentent un texte, présentent des textes, des recherches, des,<br />
des exposés, <strong>le</strong> fait de vivre ça à un moment donné ensemb<strong>le</strong>, me permet de mettre des mots sur<br />
des choses qu’on a au moins vécu un peu ensemb<strong>le</strong>, même si on met pas forcément encore <strong>le</strong>s<br />
mêmes choses derrière, donc on s’assoit sur un tapis d’expériences qui va être commun, donc si<br />
on veut qu’il y ait un tapis d’expérience commun il faut que <strong>le</strong>s /enfants/, que <strong>le</strong>s parents soient<br />
informés sur la structure bon, macro-structure, micro-structure hein, de la classe, il faut qu’on<br />
puisse vivre à un moment donné des communications de travaux de, de création de productions<br />
d’enfants ensemb<strong>le</strong>, que, qu’on puisse avoir d’autres moments où on va être ensemb<strong>le</strong> à regarder<br />
/des travaux/ <strong>le</strong>s travaux de <strong>le</strong>ur enfant » (CM , année ).<br />
À l’instar des autres dispositifs, ce dispositif est diversement habité par chacun des<br />
enseignants :<br />
« Ben moi je <strong>le</strong> fais pas très souvent [l’heure des parents], beaucoup moins souvent parce qu’ici,<br />
il y a très peu de parents qui viennent, c’est toujours <strong>le</strong>s mêmes quoi. Donc, moi je me dis, c’est<br />
un peu frustrant pour <strong>le</strong>s enfants dont <strong>le</strong>s parents ne sont jamais là. Mais c’est pas pour ça<br />
que je ne <strong>le</strong> fais pas, je <strong>le</strong> fais seu<strong>le</strong>ment quand il y a un événement, quand on a fait un boulot<br />
exceptionnel quoi. À la suite d’un stage d’enfants parce qu’en fait, <strong>le</strong>s textes qu’on <strong>le</strong>ur présente<br />
aux parents. Bon ! Le cahier d’écrivain, <strong>le</strong>s parents <strong>le</strong> voient. Ils voient très bien <strong>le</strong>s textes qu’on<br />
écrit, qu’on fait écrire à l’enfant. Les exposés pareil, <strong>le</strong>s recherches de maths pareil. Les parents<br />
voient tout ça. Donc, je me dis ouais, on peut <strong>le</strong>ur présenter ça de temps en temps. Ouais bon,<br />
je sais pas… Les enfants <strong>le</strong> présentent déjà en classe. Donc moi je trouve que c’est bien quand<br />
vraiment il y a un truc exceptionnel comme là, on <strong>le</strong>ur avait fait un stage avec un écrivain, ils<br />
ont écrit un bouquin, ils ont fait une petite pièce de théâtre qui raconte l’histoire. Ils ont fait un<br />
spectac<strong>le</strong>, bon on a invité <strong>le</strong>s parents quoi, tu vois. On a… au début d’année on est allé une<br />
semaine à […] là, site archéologique, on a fait <strong>le</strong>s visites, des fouil<strong>le</strong>s, tout ça. Ha pis ils avaient<br />
fait un boulot là-dessus, un album, donc <strong>le</strong> samedi hop, on l’a présenté aux parents donc tu vois,<br />
c’est quelque chose d’exceptionnel. Voilà. Et je trouve que c’est bien trois quatre fois par an, c’est<br />
bien » (CE , année ).<br />
Ce qui apparaît aussi à travers cet extrait, c’est l’importance pour <strong>le</strong>s enseignants de<br />
« montrer » aux parents <strong>le</strong> travail des enfants, c’est certainement là aussi une spécificité de<br />
cette éco<strong>le</strong>. Cette logique répond à une quadrup<strong>le</strong> préoccupation :<br />
– prévenir <strong>le</strong>s conflits potentiels en <strong>le</strong>vant <strong>le</strong>s ma<strong>le</strong>ntendus ;<br />
– permettre une compréhension mutuel<strong>le</strong> ;<br />
– impliquer <strong>le</strong>s parents dans la scolarité de <strong>le</strong>ur(s) enfant(s), notamment dans l’aide aux<br />
<strong>le</strong>çons et devoirs à effectuer à la maison ;<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
– faire connaître la pédagogie Freinet et rassurer sur cette approche en termes d’acquisitions<br />
scolaires.<br />
Si chacun est convaincu de l’importance des parents dans la réussite de la scolarité de<br />
<strong>le</strong>ur(s) enfant(s), <strong>le</strong>s doutes sur <strong>le</strong>s effets des actions entreprises en <strong>le</strong>ur direction restent<br />
tenaces. Si une évolution concernant <strong>le</strong> rapport des parents à l’éco<strong>le</strong> est notée ainsi qu’une<br />
réduction des incompréhensions de départ sur la pédagogie de l’équipe, l’adhésion des<br />
parents au projet d’éco<strong>le</strong> reste une question entière alors que <strong>le</strong>s heurts avec certains<br />
d’entre eux donnent <strong>le</strong> sentiment d’une situation fragi<strong>le</strong>. Dans ce contexte, marqué par<br />
ail<strong>le</strong>urs de vio<strong>le</strong>nces urbaines, <strong>le</strong>s relations avec <strong>le</strong>s parents d’élèves se construisent dans la<br />
tension entre une ouverture de l’éco<strong>le</strong> et sa fermeture en dehors des espace-temps prévus<br />
à cet effet, l’objectif étant de faire comprendre l’existence d’une frontière symbolique entre<br />
l’intérieur et l’extérieur :<br />
« el<strong>le</strong> [mère d’élève] est rentrée à un moment où el<strong>le</strong> a pas à rentrer, donc là, c’est toujours <strong>le</strong><br />
rappel de, de rester sur un espace euh, qui, que l’on clôture d’une certaine manière volontaire,<br />
pour <strong>le</strong> protéger à un moment donné, on veut bien, il y a une ouverture sur la vie, <strong>le</strong> travail<br />
etc. mais il y a une clôture sur <strong>le</strong>s faits de vio<strong>le</strong>nce qu’on ne veut pas voir rentrer dans l’éco<strong>le</strong>,<br />
d’agression verba<strong>le</strong> ou physique hein » (CM année ).<br />
L’enquête réalisée auprès des parents montre cependant que ces derniers ont une image<br />
largement positive des enseignants, image qui se construit sur <strong>le</strong> travail réalisé et l’intérêt<br />
porté par <strong>le</strong>ur(s) enfant(s) à ce travail, <strong>le</strong>ur sécurité, ainsi que sur <strong>le</strong>s relations entretenues<br />
avec <strong>le</strong>s enseignants (Carra, 00 a). Cette éco<strong>le</strong> répond fina<strong>le</strong>ment à <strong>le</strong>urs attentes en<br />
préparant par <strong>le</strong> travail demandé à <strong>le</strong>ur(s) enfant(s), <strong>le</strong>ur avenir, et en particulier <strong>le</strong>ur insertion<br />
socioprofessionnel<strong>le</strong> dans des conditions qu’ils jugent bonnes en matière de sécurité mais<br />
aussi de justice et de bien-être. On peut estimer que <strong>le</strong> type de relations développé par <strong>le</strong>s<br />
maîtres Freinet serait intéressante à transférer, relations qui ne se réduisent pas, comme bien<br />
souvent, à porter sur <strong>le</strong> – mauvais – comportement de l’élève ou ses – mauvais résultats –<br />
mais sur son travail, ses productions, ses capacités de réalisation. La valorisation qu’il trouve<br />
dans <strong>le</strong> cadre du dispositif de « l’heure des parents » contribue aussi – indirectement – à la<br />
valorisation des parents.<br />
2.4. Rituels, activités scolaires et chefs « d’œuvre »<br />
Les observations montrent l’importance des rituels pour la régulation de la vie scolaire et des<br />
problèmes rencontrés, qu’ils s’inscrivent dans <strong>le</strong> registre comportemental ou dans celui de la<br />
construction des savoirs. Ces rituels, passant par un ensemb<strong>le</strong> de dispositifs et l’intégration<br />
de l’enfant dans un col<strong>le</strong>ctif, constituent là aussi une spécificité de l’éco<strong>le</strong>. Autrement dit, ce<br />
n’est pas seu<strong>le</strong>ment par <strong>le</strong> règ<strong>le</strong>ment et la sanction que passe la gestion de la vio<strong>le</strong>nce et<br />
des incidents, c’est aussi par un fonctionnement de l’éco<strong>le</strong> ritualisant fortement <strong>le</strong>s espacetemps<br />
de la journée scolaire :<br />
« <strong>le</strong> gamin dépose pas toutes ses valises parce qu’il est porteur de valises, de grosses valises<br />
quelquefois quand même et donc il arrive que des conflits rentrent en fait, alors ils sont, ils se<br />
découvrent je veux dire à l’intérieur de l’éco<strong>le</strong> par des biais qui sont des biais de disputes, de<br />
choses comme ça, […] l’enfant pose avec <strong>le</strong> poids de la famil<strong>le</strong> enfin <strong>le</strong>, <strong>le</strong>, il pose plus faci<strong>le</strong>ment<br />
ça avant de rentrer, avec un système de rentrer quoi, avec un système de sas, il peut y avoir un<br />
sas d’arrivée, <strong>le</strong> fait de pas, se ranger, <strong>le</strong> fait de monter au fur et à mesure, <strong>le</strong> fait de commencer<br />
par un « quoi de neuf », de commencer tous ensemb<strong>le</strong>, de terminer tous ensemb<strong>le</strong>, avec une<br />
régulation forte des modes de communication, des rituels de paro<strong>le</strong>s, des choses comme ça,<br />
ça fait que la valise, el<strong>le</strong> se, la valise de problèmes qui viendraient du quartier, de la maison, du<br />
palier de l’appartement etc., el<strong>le</strong> est euh, el<strong>le</strong> est plus faci<strong>le</strong>ment posée, on vit bien ici en gros et<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
puis on retrouvera peut-être <strong>le</strong>s problèmes à la maison ou à quatre heures et demie mais, mais<br />
bon » (CM , année ).<br />
C’est aussi et surtout par <strong>le</strong>s activités scolaires que se régu<strong>le</strong> cette vie scolaire, en particulier<br />
<strong>le</strong>s activités « d’expression » et de « création », activités pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s élèves montrent<br />
de l’intérêt et qui contribuent au bon fonctionnement de la classe :<br />
« il y a des moments où tu as l’impression qu’ils sont attachés à <strong>le</strong>ur boulot parce qu’ils ont envie<br />
de <strong>le</strong> présenter, ils ont envie de <strong>le</strong> faire, tu arrives dans la classe <strong>le</strong> matin ils viennent t’en par<strong>le</strong>r,<br />
ils te disent : « moi hier madame j’ai essayé de continuer ceci j’ai essayé de continuer cela », il y<br />
en a qui ramènent des textes de la maison, ils ont écrit des textes chez eux, alors bon, des fois tu<br />
te dis mince ils tiennent à des choses […] alors tu penses que tu arrives quand même à ce qu’il<br />
y ait des choses auxquel<strong>le</strong>s ils tiennent, présentation de textes, ils tiennent, présentation de livre,<br />
ils aiment aussi, ils tiennent, tu vois, à des choses qui sont plus des choses de création tout ça »<br />
(CP, année ).<br />
C’est par <strong>le</strong>ur travail que <strong>le</strong>s enfants « se transforment » pour <strong>le</strong>s maîtres Freinet, certaines<br />
de <strong>le</strong>urs réalisations, que l’enseignant du CM qualifie de « chefs d’œuvre », contribuant à<br />
<strong>le</strong>s « bou<strong>le</strong>verser » même s’ils craignent que <strong>le</strong>s effets reste limités à l’éco<strong>le</strong> :<br />
« on pourrait <strong>le</strong>ur faire faire des choses bou<strong>le</strong>versantes qui <strong>le</strong>s transformeraient »<br />
« Y. aussi […] c’est un des enfants très très diffici<strong>le</strong>s de l’éco<strong>le</strong> et tout ça, et euh Y. a inventé<br />
une façon de faire des divisions qui est tout à fait intéressante, qui marche euh, qui n’est pas<br />
la division traditionnel<strong>le</strong> et qui fonctionne et il l’a montré devant <strong>le</strong>s parents à une réunion de<br />
parents, alors Y. qui est très décrié par tout <strong>le</strong> monde, c’est <strong>le</strong> futur gangster tu vois c’est celui qui<br />
va tourner mal etc. etc. enfin c’est clair comme de l’eau de roche pour tout <strong>le</strong> monde, et donc dans<br />
ma communication avec lui, il sent que quelque part il y a cette division non mathématique hein,<br />
qui existe et qui fait euh, ça aussi c’est un événement alors moi j’y crois assez à ces choses-là<br />
euh on pourrait <strong>le</strong>ur faire faire des choses bou<strong>le</strong>versantes qui <strong>le</strong>s transformeraient » (CM , année<br />
).<br />
« il a changé, ça c’est clair, il s’est passé quelque chose, il s’est étonné lui-même »<br />
« on peut créer des circonstances favorab<strong>le</strong>s on va dire à l’expression, à certaines activités,<br />
parce que c’est eux, parce que c’est nous, parce que c’est ici quoi, et puis en dehors de ça, on<br />
va pas transformer hein <strong>le</strong>s choses, la seu<strong>le</strong> chose, c’est ce que je te disais l’autre jour, qui me<br />
semb<strong>le</strong> être une lueur d’espoir dans notre pédagogie, c’est qu’ils arrivent à des réalisations en<br />
expression suffisamment fortes pour <strong>le</strong>s bou<strong>le</strong>verser eux-mêmes. Donc ça, ça, s’est passé sur<br />
H., je t’avais montré son texte « ne me dis jamais » et ben il a changé, ça c’est clair, il s’est passé<br />
quelque chose, il s’est étonné lui-même, même s’il est pas <strong>le</strong> seul auteur de ce texte hein puisqu’il<br />
l’a fait avec K. et il s’est passé quelque chose, ça je l’ai senti dans son dans son comportement »<br />
(CM , année ).<br />
C’est aussi par <strong>le</strong> groupe que passe la régulation des difficultés, qu’el<strong>le</strong>s soient, là encore,<br />
d’ordre comportemental ou relatives aux apprentissages :<br />
« ceux qui ont des bonnes productions et tout ça A., C., A., ceux dont on ne par<strong>le</strong> jamais dans<br />
cette classe-là parce que c’est pas eux évidemment qui attirent <strong>le</strong> plus l’attention en termes de<br />
vio<strong>le</strong>nce ou de comportements anti-sociaux ou des choses comme ça, ont repris <strong>le</strong> dessus tu vois,<br />
ont repris toute <strong>le</strong>ur place dans la classe et là, la classe est remise à l’endroit hein, s’est remise<br />
à l’endroit, c’est-à-dire que <strong>le</strong>s créations musica<strong>le</strong>s ont repris <strong>le</strong> dessus, <strong>le</strong>s créations théâtra<strong>le</strong>s,<br />
<strong>le</strong>s conférences, <strong>le</strong>s recherches-maths, <strong>le</strong>s bons textes et tout ça tu vois ? Et donc <strong>le</strong>s enfants<br />
qui posent problèmes sont maintenant <strong>le</strong>s enfants qui vont aussi essayer de se mettre dans cette<br />
attitude-là, de produire des choses plutôt bien etc. mais une chose plutôt bien, c’est pas suffisant<br />
hein pour être bou<strong>le</strong>versé hein pour <strong>le</strong>s enfants à problèmes hein, je par<strong>le</strong> donc C., el<strong>le</strong>, el<strong>le</strong><br />
produit une chose bou<strong>le</strong>versante par jour el<strong>le</strong>, donc, ça avance donc, c’est des progressions, A.<br />
c’est pareil, et A., c’est pareil etc. ils produisent des trucs, ils y vont et tout ça, et L. qui est un de<br />
ceux qui se laissent entraîner un peu par <strong>le</strong> groupe des méchants, là hop il est parti dans <strong>le</strong>, dans<br />
<strong>le</strong>s productions tu vois, L. il demande à taper ses textes, à faire ses maths, à faire son français et<br />
à faire ses trucs, tu vois donc lui il est gagné quelque part » (CM , année ).<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
La régulation ne passe pas par un traitement individuel des élèves « diffici<strong>le</strong>s » qu’il<br />
conviendrait de socialiser pour pouvoir <strong>le</strong>s instruire (tendance qui s’affiche de plus en plus<br />
fortement dans <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s) mais par <strong>le</strong>s productions scolaires et la dynamique de groupe.<br />
C’est là une approche qui apparaît particulièrement intéressante à transférer tant <strong>le</strong>s liens<br />
sont forts entre difficultés scolaires et stigmatisation d’une part et vio<strong>le</strong>nces d’autre part.<br />
Mais el<strong>le</strong> n’apparaît efficiente que reposant sur certains principes cf. infra).<br />
3. Climat d’éco<strong>le</strong>, rapport aux élèves et rapport au métier<br />
Nous avons décrit ci-avant, ce que <strong>le</strong>s enseignants nous disent de <strong>le</strong>urs pratiques et ce que<br />
<strong>le</strong>ur discours révè<strong>le</strong>nt de <strong>le</strong>ur rapport à la vio<strong>le</strong>nce. Nous allons maintenant déplacer notre<br />
regard en nous basant sur <strong>le</strong> discours des élèves pour faire émerger <strong>le</strong>ur perception du<br />
climat d’éco<strong>le</strong>, questionner <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> qu’il joue sur <strong>le</strong> sentiment de vio<strong>le</strong>nce tout en mettant en<br />
perspective ce qu’il révè<strong>le</strong> du rapport des enseignants à <strong>le</strong>ur métier et aux élèves. Ce détour<br />
nous permettra d’interroger au bout du compte <strong>le</strong> lien entre pratiques professionnel<strong>le</strong>s et<br />
sentiment de vio<strong>le</strong>nce des enseignants. L’étude des processus à l’œuvre alimentera notre<br />
réf<strong>le</strong>xion sur la question de la transférabilité tout en re<strong>le</strong>vant certaines limites.<br />
3.1. Les effets du fonctionnement d’éco<strong>le</strong> sur son climat et <strong>le</strong> sentiment de<br />
vio<strong>le</strong>nce des élèves<br />
Pour tenter de faire émerger <strong>le</strong>s processus à l’œuvre dans la construction du sentiment<br />
de vio<strong>le</strong>nce des enquêtés et <strong>le</strong>s taux différentiels de vio<strong>le</strong>nce entre éco<strong>le</strong>s, nous avons<br />
étudié, dans notre dernière enquête (Carra dir., 00 ), <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> de l’environnement socioéducatif<br />
en distinguant effets contextuels subis (effectifs, recrutement social des élèves<br />
et caractéristiques du lieu d’implantation de l’éco<strong>le</strong>) et effets construits (<strong>le</strong> climat d’éco<strong>le</strong>,<br />
dépendant de son fonctionnement et de sa configuration normative). Les résultats montrent<br />
que <strong>le</strong> phénomène de vio<strong>le</strong>nce en primaire ne varie pas mécaniquement avec <strong>le</strong> classement<br />
social des éco<strong>le</strong>s. En comparant <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s qui présentent des profils analogues mais<br />
des phénomènes de vio<strong>le</strong>nce divergents, on peut faire ressortir l’importance du « climat<br />
d’éco<strong>le</strong> » dans trois de ses composantes : <strong>le</strong> « climat de travail », <strong>le</strong> « climat éducatif » et <strong>le</strong><br />
« climat de justice ». Nous pouvons schématiser cette configuration propice aux processus<br />
de construction-déconstruction du sentiment de vio<strong>le</strong>nce par la figure suivante :<br />
Une configuration éducative propice à un climat de vio<strong>le</strong>nce peu développé<br />
TRAVAIL<br />
VIOLENCE ÉDUCATIF<br />
JUSTICE<br />
La variation du climat de vio<strong>le</strong>nce est corrélée significativement avec <strong>le</strong>s trois composantes<br />
du climat d’éco<strong>le</strong> présentés ci-dessus – travail, éducatif, justice – qui eux-mêmes sont tous<br />
corrélés entre eux . Le « climat de travail » se mesure par la proportion d’élèves qui ont <strong>le</strong><br />
sentiment d’obtenir de bons résultats, qui pensent être dans une classe qui travail<strong>le</strong> bien,<br />
classe au sein de laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s élèves s’estiment aidés par l’enseignant. Le « climat éducatif »<br />
Construction d’indices synthétiques à partir des réponses de 0 élèves du CE au CM .<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
est mesuré, lui, par la proportion d’enfants ayant la perception d’un enseignant au traitement<br />
égalitaire (pas ou peu de « chouchous » et boucs émissaires), et qui distribue peu de<br />
sanctions négatives (que ce soit au niveau des résultats scolaires ou des comportements).<br />
Le « climat de justice », enfin, se mesure par la proportion d’élèves qui s’estiment traités<br />
de manière juste. Ces trois composantes sont corrélées de manière très significative avec<br />
un climat de vio<strong>le</strong>nce peu ou pas développé, tant au niveau de la perception de la vio<strong>le</strong>nce<br />
dans son éco<strong>le</strong> que de la victimation ou encore de la vio<strong>le</strong>nce auto-déclarée.<br />
L’éco<strong>le</strong> Freinet se caractérise par une tel<strong>le</strong> configuration. En revanche, el<strong>le</strong> se distingue par<br />
un climat relationnel entre élèves significativement moins bon, aucune autre composante<br />
du climat n’apparaissant significativement moins bonne dans <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s qui ont un climat<br />
de vio<strong>le</strong>nce significativement meil<strong>le</strong>ur comparativement à la moyenne de l’échantillon. C’est<br />
sans doute là l’une des limites des « conseils d’enfants » qui aboutit à une extension du<br />
champ de définition de la vio<strong>le</strong>nce et à une démultiplication de la réaction socia<strong>le</strong> tout en<br />
augmentant <strong>le</strong>s exigences des élèves <strong>le</strong>s uns par rapport aux autres dans un système de<br />
responsabilisation et d’autonomie (Carra, 00 a).<br />
3.2. Rapport aux élèves, rapport au métier<br />
L’instauration d’un tel climat repose sur des pratiques professionnel<strong>le</strong>s se structurant sur<br />
un rapport particulier aux élèves et au métier d’enseignant, deux dimensions corrélées à<br />
un sentiment de vio<strong>le</strong>nce significativement plus bas que la moyenne chez <strong>le</strong>s enseignants.<br />
Le rapport au métier, tout d’abord, se traduit par un fort investissement, un travail en<br />
équipe important, des formations fréquentes. Les pratiques professionnel<strong>le</strong>s tel<strong>le</strong>s qu’el<strong>le</strong>s<br />
apparaissent à travers <strong>le</strong> climat d’éco<strong>le</strong> manifeste plus encore une cohésion d’équipe sur <strong>le</strong><br />
plan éducatif. Cette cohésion d’équipe permet tout à la fois de mieux gérer <strong>le</strong>s incidents tout<br />
en préservant l’intégrité de l’individu et sa dignité professionnel<strong>le</strong> et de régu<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s interactions<br />
au sein de l’éco<strong>le</strong> grâce à un règ<strong>le</strong>ment auxquels adhèrent d’autant plus faci<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s<br />
élèves qu’ils ont participé à son élaboration et qu’ils trouvent que son application est juste.<br />
C’est d’ail<strong>le</strong>urs ce principe de justice qui apparaît déterminant dans <strong>le</strong> bon fonctionnement<br />
scolaire, justice qui semb<strong>le</strong> aussi constituer l’un des principes qui donne sens au travail<br />
d’équipe.<br />
Le rapport aux élèves, ensuite, se construit sur <strong>le</strong> principe que tout élève peut progresser,<br />
s’intégrer à une vie de classe et que l’enseignant peut contribuer à sa progression. C’est<br />
fina<strong>le</strong>ment une dimension éthique qui apparaît ici, éthique qui se fonde sur <strong>le</strong> postulat de<br />
l’éducabilité des apprenants. Cette croyance en l’éducabilité des apprenants contribue à<br />
l’investissement professionnel, investissement renforçant la compétence enseignante dans<br />
<strong>le</strong> travail quotidien avec la classe, au sein de l’éco<strong>le</strong> mais aussi grâce aux formations.<br />
Au delà, ce qui soude l’équipe et qui donne sens et cohérence à l’action, c’est son projet<br />
pédagogique construit à partir de principes forts, principes auxquels adhèrent chacun des<br />
maîtres Freinet : « Ses principes sont essentiel<strong>le</strong>ment constitués par des conceptions de<br />
l’enfant (sujet toujours-déjà social, acteur hors de et dans l’éco<strong>le</strong>, désireux de savoir et<br />
capab<strong>le</strong> d’apprendre pourvu qu’on lui crée un milieu favorab<strong>le</strong>), des apprentissages (chacun<br />
peut apprendre mais à partir d’un questionnement à susciter en relation avec son vécu,<br />
chacun apprend selon des modalités propres à respecter et à étayer ; <strong>le</strong>s apprentissages<br />
articu<strong>le</strong>nt des actions qui font sens pour l’élève et une réf<strong>le</strong>xion sur ces actions…), de la<br />
pédagogie (l’importance des dispositifs, communs à tous, qui favorisent l’entrée dans la<br />
tâche, son effectuation et l’appropriation du sens des activités ; l’enseignant comme garant<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
de la sécurité et de conditions d’études favorab<strong>le</strong>s, comme constructeur de situations<br />
favorab<strong>le</strong>s et comme recours…). Ces principes sont alliés à des va<strong>le</strong>urs éthico-politiques<br />
notamment autour de l’institution de la démocratie au sein de l’éco<strong>le</strong> (non comme discours<br />
ou objet de réf<strong>le</strong>xion mais comme règ<strong>le</strong>s à construire et à respecter – y compris par <strong>le</strong>s<br />
enseignants – et comme conseils à faire fonctionner), de la coopération et de l’entraide (et<br />
non de la compétition), du respect mutuel (entre pairs, entre professeurs et élèves, entre<br />
professeurs et parents…), de l’action éducative conçue comme moyen d’émancipation et<br />
contribution à une société meil<strong>le</strong>ure. De surcroît, ces éléments sont articulés sur un autre<br />
principe fondamental selon <strong>le</strong>quel ces conceptions n’ont de sens qu’actualisées au sein de<br />
pratiques qui permettent aux élèves de <strong>le</strong>s éprouver. » (Reuter & Carra, 00 ).<br />
La comparaison d’éco<strong>le</strong>s montre ainsi qu’il est possib<strong>le</strong> d’obtenir une configuration éducative<br />
empêchant <strong>le</strong> développement du phénomène de vio<strong>le</strong>nce. El<strong>le</strong> n’apparaît cependant<br />
transférab<strong>le</strong> qu’avec un travail d’équipe conséquent et <strong>le</strong> partage de deux principes forts :<br />
celui de justice et d’éducabilité. Les maîtres Freinet ont obtenu de pouvoir constituer une<br />
équipe en dérogeant aux règ<strong>le</strong>s du mouvement et en procédant par cooptation. Nous avons<br />
souligné, ail<strong>le</strong>urs (Reuter & Carra, 00 ), <strong>le</strong>s difficultés pour y parvenir et la nécessité d’appuis<br />
dans l’institution. Mais, remarquions-nous, si l’on voit l’intérêt de la constitution d’une équipe<br />
forte et soudée autour d’un projet pour « re<strong>le</strong>ver » une éco<strong>le</strong>, la systématisation d’un tel<br />
procédé comporte cependant des risques, notamment celui d’accroître <strong>le</strong>s inégalités entre<br />
éco<strong>le</strong>s.<br />
Le sentiment de vio<strong>le</strong>nce des maîtres Freinet apparaît moins é<strong>le</strong>vé que la moyenne de <strong>le</strong>urs<br />
collègues de l’échantillon. Depuis <strong>le</strong>ur arrivée, ce sentiment a évolué avec <strong>le</strong>s contours<br />
que prend, dans <strong>le</strong>ur discours, en concordance avec nos observations, ce phénomène<br />
aujourd’hui : la tension permanente donnant lieu à une multitude d’incidents et entravant <strong>le</strong><br />
bon fonctionnement de la classe a disparu tout comme ont fortement diminué « <strong>le</strong>s formes<br />
dures de vio<strong>le</strong>nce physique ». Les incidents restant sont sporadiques et ne constituent plus<br />
un obstac<strong>le</strong> pour <strong>le</strong> travail des élèves, se dégageant ainsi de <strong>le</strong>ur appréhension par <strong>le</strong><br />
registre de la vio<strong>le</strong>nce.<br />
Pour autant, et à l’instar de <strong>le</strong>urs collègues, <strong>le</strong>s parents apparaissent à l’origine d’incidents,<br />
incidents qui ont pu déstabiliser <strong>le</strong>s enseignants, voire l’équipe, ainsi qu’on l’a montré. La<br />
gestion de ces incidents – col<strong>le</strong>ctive, différée et en articulation avec <strong>le</strong>s missions de l’éco<strong>le</strong><br />
et <strong>le</strong> cadre institutionnel au sein desquel<strong>le</strong>s el<strong>le</strong>s s’inscrivent – favorise une déconstruction<br />
de <strong>le</strong>ur dimension pouvant être vécue dans un premier temps comme vio<strong>le</strong>nte par <strong>le</strong>s<br />
intéressés. Simultanément ce mode de régulation a un effet protecteur sur <strong>le</strong>s contours de<br />
la personne, en donnant une dimension col<strong>le</strong>ctive et professionnel<strong>le</strong> à l’incident, qui bien<br />
souvent, ail<strong>le</strong>urs, chez <strong>le</strong>s enseignants victimes, est lu comme un problème interpersonnel,<br />
relationnel voire inhérent à la nature vio<strong>le</strong>nte de l’auteur. D’une manière plus globa<strong>le</strong> c’est<br />
l’ensemb<strong>le</strong> de la vie scolaire qui est fortement régulée au sein de l’éco<strong>le</strong> et dans ses relations<br />
avec son environnement. Cette régulation s’actualise à travers des rituels et des dispositifs<br />
(<strong>le</strong> « conseil d’enfants », « l’heure des parents », « <strong>le</strong> quoi de neuf »…). Ces processus de<br />
régulation, opérant à différents niveaux, apparaissent fortement en cohérence, formant un<br />
système dont <strong>le</strong> soc<strong>le</strong> est constitué des principes de la pédagogie Freinet. Au centre, <strong>le</strong><br />
travail des élèves et la construction des savoirs donnent sens à ce fonctionnement alors que<br />
<strong>le</strong> pouvoir donné aux élèves dans la gestion de <strong>le</strong>ur vie scolaire contribue à l’adhésion de<br />
ces derniers (Carra, 00 ). Ce fonctionnement en système constitue une limite réel<strong>le</strong> pour<br />
sa transférabilité mais la comparaison avec d’autres éco<strong>le</strong>s nous a permis d’iso<strong>le</strong>r certaines<br />
dimensions, efficientes à certaines conditions, et, a priori, transférab<strong>le</strong>s.<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
La comparaison avec <strong>le</strong>s trente autres éco<strong>le</strong>s de l’échantillon fait ainsi apparaître la<br />
spécificité des effets de ce type de fonctionnement sur <strong>le</strong> climat d’éco<strong>le</strong> tel que perçu par <strong>le</strong>s<br />
élèves et <strong>le</strong>s liens avec <strong>le</strong> sentiment de vio<strong>le</strong>nce de ces derniers. Ce climat fait apparaître<br />
trois composantes discriminantes dans la variation du phénomène de vio<strong>le</strong>nce d’une éco<strong>le</strong><br />
à l’autre : <strong>le</strong> « climat de travail », <strong>le</strong> « climat éducatif » et <strong>le</strong> « climat de justice ». L’éco<strong>le</strong><br />
Freinet, à l’instar des éco<strong>le</strong>s qui se distingue par un climat de vio<strong>le</strong>nce significativement<br />
moins développé que la moyenne, se caractérise par de bons résultats sur ces trois<br />
composantes, participant ainsi d’une configuration éducative propice à un sentiment de<br />
vio<strong>le</strong>nce peu développé.<br />
Ce climat repose sur des pratiques professionnel<strong>le</strong>s révélant, dans <strong>le</strong> rapport des enseignants<br />
au métier et aux élèves, des conceptions spécifiques et des va<strong>le</strong>urs sous-jacentes : au<br />
centre, <strong>le</strong> principe de justice et d’éducabilité des apprenants. Le projet pédagogique soude<br />
l’équipe lui permettant de développer une dimension col<strong>le</strong>ctive du travail. Cette dimension<br />
contribue à déconstruire pour partie la vio<strong>le</strong>nce ressentie par une socialisation des incidents<br />
et une organisation institutionnel<strong>le</strong> des modalités de gestion et des relations socia<strong>le</strong>s entre<br />
élèves et, entre parents et éco<strong>le</strong>. Le projet d’éco<strong>le</strong>, s’il donne sens à l’action pédagogique,<br />
s’inscrit dans un projet politique : amener <strong>le</strong>s enfants de milieux populaires à s’émanciper<br />
par <strong>le</strong> savoir et à « devenir des citoyens éclairés », suscitant un engagement professionnel<br />
en dehors de la classe particulièrement conséquent.<br />
bibliographie<br />
Carra C., dir. ( 00 ), Vio<strong>le</strong>nces à l’éco<strong>le</strong> élémentaire, approche quantitative et comparative, <strong>le</strong><br />
cas du département du Nord, Rapport de recherche <strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais – CESDIP.<br />
Carra C. ( 00 a), « Déviances et régulations à l’éco<strong>le</strong> élémentaire. Le cas d’une éco<strong>le</strong><br />
Freinet en réseau d’éducation prioritaire », dans Y. Reuter, Dir., Démarches pédagogiques et<br />
lutte contre l’échec scolaire à l’éco<strong>le</strong> primaire, Rapport de recherche ERTe 0 , Vil<strong>le</strong>neuve<br />
d’Ascq, Université Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, p. -<br />
Carra C. ( 00 b), « Environnement socio-éducatif et vio<strong>le</strong>nces à l’éco<strong>le</strong> élémentaire : essai<br />
de conceptualisation », dans Gaillard B., Dir., Les vio<strong>le</strong>nces en milieu scolaire et éducatif.<br />
Connaître, prévenir, intervenir, Rennes, PUR, p. - .<br />
Carra C. ( 00 ), « Participation citoyenne et construction de normes. Quels effets sur <strong>le</strong>s<br />
vio<strong>le</strong>nces scolaires ? », Spira<strong>le</strong>, Revue de Recherches en Éducation, n° , p. - .<br />
Carra C., Faggianelli D. (mars 00 ), « Quand une éco<strong>le</strong> bouscu<strong>le</strong> <strong>le</strong>s normes… Étude<br />
d’une éco<strong>le</strong> expérimenta<strong>le</strong> Freinet en réseau d’éducation prioritaire », VEI Diversité, n° 0,<br />
p. - .<br />
Michaud Y. ( 00 ), La vio<strong>le</strong>nce, Paris, PUF<br />
Reuter Y., dir. ( 00 ), Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire à l’éco<strong>le</strong><br />
primaire, Rapport de recherche ERTe<br />
Gaul<strong>le</strong>.<br />
0 , Vil<strong>le</strong>neuve d’Ascq, Université Char<strong>le</strong>s-de-<br />
Reuter Y., CARRA C. (oct-nov-déc. 00 ), « Analyser un mode de travail pédagogique<br />
‘ alternatif ’. L’exemp<strong>le</strong> d’un groupe scolaire travaillant en pédagogie ‘ Freinet ’ », Revue<br />
française de pédagogie, n° , p. - .<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Annexes<br />
victimation<br />
oui<br />
non<br />
TOTAL<br />
estimation vio<strong>le</strong>nce<br />
beaucoup<br />
moyennement<br />
un peu<br />
très peu<br />
ne sait pas<br />
TOTAL OBS.<br />
physiques<br />
verba<strong>le</strong>s<br />
rectypesvio<strong>le</strong>nces<br />
autres ou non précisées<br />
disputes, querel<strong>le</strong>s<br />
conflits/règ<strong>le</strong>ments de compte<br />
bousculades<br />
menaces<br />
racket<br />
mora<strong>le</strong><br />
TOTAL CIT.<br />
victimation<br />
plus de fois<br />
ou fois<br />
ou fois<br />
jamais<br />
TOTAL CIT.<br />
sécurité<br />
moyennement<br />
souvent<br />
toujours<br />
sécurité<br />
TOTAL CIT.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Nb. cit. Fréq.<br />
93<br />
, %<br />
, %<br />
, %<br />
, %<br />
, %<br />
Nb. cit. Fréq.<br />
,0%<br />
, %<br />
, %<br />
0 , %<br />
, %<br />
, %<br />
, %<br />
, %<br />
, %<br />
137 100%<br />
Nb. cit. Fréq.<br />
, %<br />
,0%<br />
, %<br />
,0%<br />
86 100%<br />
Nb. cit. Fréq.<br />
, %<br />
0 0, %<br />
, %<br />
93 100%<br />
moyennement toujours TOTAL<br />
actions vio<strong>le</strong>nce<br />
NR et NSP<br />
non<br />
oui<br />
TOTAL CIT.<br />
, % ( 0) , % ( ) 100% (31)<br />
, % ( ) , % ( ) 100% (55)<br />
15,1% (13) 84,9% (73) 100% (86)<br />
Nb. cit. Fréq.<br />
, %<br />
, %<br />
, %<br />
93 100%
estimation action vio<strong>le</strong>nce<br />
accessoires<br />
importantes<br />
indispensab<strong>le</strong>s<br />
NR et pas d'action<br />
TOTAL CIT.<br />
relations parents d'élèves<br />
Non réponse<br />
moyennes<br />
bonnes<br />
TOTAL CIT.<br />
Nb. cit. Fréq.<br />
, %<br />
, %<br />
,0%<br />
, %<br />
93 100%<br />
Nb. cit. Fréq.<br />
, %<br />
,0%<br />
, %<br />
93 100%<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Changement d’éco<strong>le</strong> et pratiques pédagogiques<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Anne-Marie JOVENET<br />
Maître de conférences<br />
Université de Lil<strong>le</strong> III<br />
Équipe THÉODILE<br />
Le point de départ du travail était d’étudier l’effet d’un changement de pédagogie dans<br />
une éco<strong>le</strong> primaire (éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> et éco<strong>le</strong> élémentaire) de la banlieue lilloise classée<br />
REP dont <strong>le</strong>s résultats étaient bien inférieurs à la moyenne généra<strong>le</strong>. Or, il existe bien des<br />
manières d’étudier <strong>le</strong> changement et <strong>le</strong>s effets du changement, en fonction de l’objectif qu’on<br />
se donne, des éléments visés (changement dans <strong>le</strong>s résultats des élèves, dans la remontée<br />
des effectifs, changement dans l’image de l’éco<strong>le</strong>…), selon aussi que l’on considère <strong>le</strong><br />
changement comme un processus ou comme un résultat (« comment s’est mis en place du<br />
changement » vs « <strong>le</strong> climat de l’éco<strong>le</strong> a changé ») mais aussi selon <strong>le</strong>s cadres théoriques<br />
qui servent de référence.<br />
Ici il s’agit essentiel<strong>le</strong>ment de se référer à une approche clinique d’inspiration psychanalytique.<br />
De ce point de vue, la notion de changement n’est pas anodine. Le changement apparaît<br />
un révélateur intéressant de la construction psychique du sujet, c’est-à-dire de sa solidité<br />
interne, de son désir de nouer des relations satisfaisantes, de sa capacité à affronter<br />
l’inconnu, qu’il s’agisse du sujet élève ou du sujet enseignant d’ail<strong>le</strong>urs.<br />
De fait en étudiant à travers divers entretiens, comment <strong>le</strong>s professionnels intervenant<br />
habituel<strong>le</strong>ment (ADSEM, aide-éducateurs, personnels de cantine) ou ponctuel<strong>le</strong>ment dans<br />
l’éco<strong>le</strong> (infirmière scolaire, psychologue du RASED) avaient vécu ce changement, il était<br />
apparu deux dimensions essentiel<strong>le</strong>s à prendre en compte pour comprendre ce qu’engendrait<br />
pour eux cette nouvel<strong>le</strong> situation : l’importance que revêt ce qu’on peut appe<strong>le</strong>r « l’ambiance »<br />
du lieu et <strong>le</strong> sentiment d’être plus ou moins bien reconnu dans son identité professionnel<strong>le</strong>.<br />
L’analyse avait alors permis d’évoquer une variab<strong>le</strong> explicative autour du fait d’être dans la<br />
classe ou pas, c’est-à-dire de voir « se dérou<strong>le</strong>r la pédagogie sous ses yeux ».<br />
Pour comprendre ce qu’apportait ce changement de pédagogie (changement étant pris ici<br />
dans son sens de modification de pratique) par rapport à ce qui existait avant et continue<br />
à exister dans d’autres éco<strong>le</strong>s : la comparaison s’est imposée. Pour ma part j’ai comparé<br />
des élèves appartenant à toutes <strong>le</strong>s classes du primaire, dans deux éco<strong>le</strong>s ne pratiquant<br />
pas la même pédagogie, puis <strong>le</strong>s mêmes élèves de l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher sur plusieurs<br />
années (ces élèves réalisaient une tâche mathématique face à un adulte) et j’ai comparé<br />
aussi comment se déroulaient des séquences de mathématiques au CE dans deux éco<strong>le</strong>s<br />
différentes. Pour tenter de comprendre ce qui pouvait se jouer pour <strong>le</strong>s enseignants, j’ai<br />
comparé <strong>le</strong>s réponses de cinq maîtres de l’éco<strong>le</strong> en pédagogie Freinet et de cinq maîtres<br />
de l’autre éco<strong>le</strong>, à propos des élèves qui avaient réalisé ces tâches mathématiques. Mais<br />
revenant sur une définition plus clinique du changement, je me suis intéressée aux élèves<br />
qui arrivaient dans cette éco<strong>le</strong> au cours de <strong>le</strong>ur scolarité primaire pour voir comment ils<br />
vivaient <strong>le</strong> changement de l’intérieur, si l’on peut dire. C’est cette étude déjà présentée<br />
dans <strong>le</strong> rapport remis en 00 qui servira de base ici. En effet à travers ces entretiens<br />
construits autour d’une consigne qui s’adresse directement à l’enfant : « je sais que tu<br />
n’as pas toujours été dans cette éco<strong>le</strong>, peux-tu me raconter comment s’est passé pour<br />
toi <strong>le</strong> changement ? », on voit apparaître <strong>le</strong> sentiment général que <strong>le</strong>s enfants éprouvent
dans l’éco<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s comparaisons qu’ils établissent spontanément entre « l’éco<strong>le</strong> d’avant » et<br />
« l’éco<strong>le</strong> ici » souvent complétées d’une analyse de ces différences, mais aussi <strong>le</strong>s aspects<br />
de <strong>le</strong>ur vie personnel<strong>le</strong>, familia<strong>le</strong>, parfois cause de ce changement d’éco<strong>le</strong>. À travers cela se<br />
fait jour une mise en relation de différents faits de <strong>le</strong>ur vie et une prise de recul par rapport<br />
aux effets de cette pédagogie pour eux-mêmes.<br />
Faisant l’hypothèse qu’il y avait là, matière à dégager quelque chose de spécifique à la<br />
manière de vivre un changement d’éco<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s élèves, l’étude d’entretiens avec d’autres<br />
élèves qui ont aussi changé d’éco<strong>le</strong> au cours de la scolarité primaire constituera <strong>le</strong> cœur de<br />
ce rapport. La comparaison sera établie en deux temps.<br />
Dans un premier temps un parallè<strong>le</strong> établi entre des entretiens pris deux à deux feront ressortir<br />
des situations qui se ressemb<strong>le</strong>nt mais des manières très différentes de <strong>le</strong>s vivre. Pour Inès<br />
et Justine, toutes <strong>le</strong>s deux au CM , apparemment tout va bien, mais il y a quand même des<br />
zones d’ombre dans la vie personnel<strong>le</strong>, des motifs de frustration ou de rivalité. Toutefois on<br />
voit Inès par<strong>le</strong>r avec plaisir de sa classe, tandis que Justine revient sans cesse aux mêmes<br />
aspects qui semb<strong>le</strong>nt empoisonner sa vie. Entre Raïssa et Nas, toutes deux au CM et « en<br />
retard » pour <strong>le</strong>ur âge dans cette classe, il y a une similitude de problèmes familiaux. Nas<br />
ne peut pas « sortir de la séparation » pour aimer quoi que ce soit en classe. Si <strong>le</strong>s deux ont<br />
un fort sentiment d’être victime, Raïssa peut mettre des mots dessus et entendre quelques<br />
questions qui la concernent de près. Enfin Boris et Tom vivent un énorme rejet de « l’éco<strong>le</strong><br />
d’avant », avec probab<strong>le</strong>ment dans <strong>le</strong>s deux cas une emprise maternel<strong>le</strong> assez forte, et un<br />
sentiment d’être <strong>le</strong> bouc-émissaire des autres, de subir des choses dont ils ne comprennent<br />
pas <strong>le</strong> sens. Face au « symptôme » il y a eu une réponse : ils ont changé d’éco<strong>le</strong>, mais il<br />
semb<strong>le</strong> bien que Boris trouve à l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher <strong>le</strong>s moyens de chercher <strong>le</strong> sens du<br />
symptôme et donc de se reconstruire, alors que Tom ne peut que chercher à oublier, tout en<br />
manifestant dans l’entretien combien <strong>le</strong> malaise reste ancré en lui. Son histoire reste un cas<br />
à part, son cas… malheureux par rapport aux autres, tandis que l’histoire de Boris prend du<br />
sens parce que d’autres peuvent donner un sens à cette histoire. Ces histoires présentées<br />
en parallè<strong>le</strong> permettront alors d’examiner <strong>le</strong>s différences fondamenta<strong>le</strong>s exprimées par ces<br />
élèves et de s’interroger sur <strong>le</strong>s pratiques pédagogiques qui <strong>le</strong>s sous-tendent.<br />
À l’issue de ces comparaisons, on se posera la question plus large de l’intérêt d’un mode de<br />
travail pédagogique face aux souffrances des élèves à l’éco<strong>le</strong>.<br />
1. Changement d’éco<strong>le</strong> : quel intérêt pour la recherche ?<br />
Comme cela a été évoqué dans l’introduction, cet intérêt pour <strong>le</strong> « changement vécu »<br />
est issu des premiers entretiens menés par Yves Reuter ( 00 ) avec <strong>le</strong>s personnels de<br />
l’éco<strong>le</strong> qui étaient confrontés à la mise en place d’une nouvel<strong>le</strong> équipe pédagogique. Ce<br />
qui ressortait de <strong>le</strong>ur discours avait fortement trait à l’ambiance de l’éco<strong>le</strong> : ambiance de<br />
calme, de travail, parfois de si<strong>le</strong>nce étonnant « c’est vrai que il y a une ambiance là quand<br />
on arrive là à F qu’on ne retrouve pas dans <strong>le</strong>s autres éco<strong>le</strong>s ; c’est calme, <strong>le</strong>s enfants<br />
ils viennent vous accueillir, ils ont l’air très à l’aise… C’est vrai qu’il y a pas de bruit…<br />
l’ambiance c’est très, très particulier quand on rentre, on est surpris par ça » dit l’infirmière,<br />
pour ajouter un peu après : « quand je suis arrivée, c’est vraiment l’impression que j’ai<br />
eue, même moi je m’installais dans une sal<strong>le</strong> et on est venu me voir “qu’est-ce que c’était<br />
que tout ce bruit ?” ». À <strong>le</strong>ur arrivée d’autres personnels font <strong>le</strong>s mêmes remarques. Ainsi<br />
la psychologue scolaire constate « même <strong>le</strong>s sorties de classe quand ils sortent dans <strong>le</strong><br />
couloir, y a pas de bruit » et el<strong>le</strong> ajoute : « ail<strong>le</strong>urs c’est un brouhaha indescriptib<strong>le</strong> ». Une<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
personne de la cantine remarque éga<strong>le</strong>ment un changement : « nous on voit très bien, ils<br />
sont beaucoup plus agréab<strong>le</strong>s, ils sont terrib<strong>le</strong>s parfois, mais d’une gentil<strong>le</strong>sse… moi j’étais<br />
absente la semaine dernière “qu’est-ce que t’as eu ?” ils s’inquiètent, avant on n’était pas<br />
là, c’était pas grave. »<br />
Un sentiment de mystère semb<strong>le</strong> toutefois planer sur cette manière de faire. Quel pouvoir<br />
ont ces enseignants pour transformer <strong>le</strong>s enfants ? Ils ont présenté <strong>le</strong>ur pédagogie mais<br />
sans en dire plus… De quel mystère s’entourent-ils ? D’ail<strong>le</strong>urs une ADSEM réclamait plus<br />
de transparence dans ces termes là : « c’est, la seu<strong>le</strong> chose qui reste une petite barrière,<br />
je trouve, pour moi je trouve que c’est une petite barrière, je demande pas à avoir <strong>le</strong>urs<br />
secrets, hein, il en est hors de question », réf<strong>le</strong>xion qui trouve un écho dans une forme<br />
d’humour utilisée par un enseignant qui ressent sans doute diffici<strong>le</strong>ment sa position d’être<br />
« comparé » : « s’il y a un secret il faut me <strong>le</strong> dire ». Le maître E arrivant en 00 dira aussi :<br />
« <strong>le</strong>s enfants ne sont pas, on aurait tort de croire qu’ils seraient à la rigueur plus faci<strong>le</strong>s ».<br />
Beaucoup d’éléments interviennent dans ces remarques : l’ambiance est bien quelque<br />
chose de fondamental dans <strong>le</strong> rapport de ces professionnels à <strong>le</strong>ur travail : spontanément ils<br />
comparent l’ambiance « ici » et « ail<strong>le</strong>urs », ou l’ambiance actuel<strong>le</strong> à l’ambiance « avant ».<br />
L’ambiance est ancrée dans l’espace-temps, mais el<strong>le</strong> n’est pas extérieure au soi : dire<br />
comment on ressent cette ambiance, comment on la vit, et chercher à la comprendre, à<br />
l’expliquer est tout aussi spontané.<br />
1.1. Le changement comme révélateur de la construction du « soi »<br />
C’est alors que <strong>le</strong> concept d’image inconsciente du corps forgé par Dolto ( ) s’impose.<br />
Ce concept par<strong>le</strong> du ressenti du corps quand ce corps est actif et éprouve des sensations<br />
olfactives, auditives, tacti<strong>le</strong>s… en relation avec quelqu’un. El<strong>le</strong> est personnel<strong>le</strong> à chacun et<br />
se forge avec <strong>le</strong>s premières relations de l’enfant avant qu’il ne sache la dire et même avant<br />
qu’il ne reconnaisse son image dans <strong>le</strong> miroir. Selon Dolto il faudrait considérer trois famil<strong>le</strong>s<br />
d’images inconscientes du corps en relation dynamique l’une avec l’autre : l’image de base,<br />
l’image fonctionnel<strong>le</strong> et l’image érogène en rapport respectivement avec la stabilité du corps,<br />
<strong>le</strong> désir et <strong>le</strong> plaisir. L’image est dite inconsciente non seu<strong>le</strong>ment parce que l’enfant n’a pas<br />
de souvenir de sa construction mais surtout parce qu’el<strong>le</strong> prend <strong>le</strong>s qualités de l’inconscient :<br />
el<strong>le</strong> ne se révè<strong>le</strong> pas à la mémoire mais agit de façon déguisée. De fait cette image suit<br />
chacun de nous toute sa vie et se traduit par la façon que nous avons d’entrer en relation<br />
avec l’autre. Nasio commentant <strong>le</strong>s propos de Dolto, au congrès national des psychologues<br />
scolaires de ajoutait : « Comment entrer en relation avec un jeune patient dont <strong>le</strong>s<br />
mots, <strong>le</strong>s dessins et <strong>le</strong>s attitudes n’offrent aucune prise ? Nous postulons que, derrière <strong>le</strong>s<br />
mots, <strong>le</strong>s dessins et <strong>le</strong>s attitudes, il existe un langage très spécial grâce auquel l’enfant et<br />
l’analyste pourront communiquer… Nous croyons que <strong>le</strong>s sensations que cet enfant de la<br />
séance a vécues lorsqu’il était bébé, se sont imprimées dans son inconscient et organisées<br />
en un langage interne, corporel et muet que nous pouvons – nous analystes – capter, traduire<br />
et par<strong>le</strong>r. » Et Nasio de raconter à la fin de sa conférence l’histoire de Clara, « <strong>le</strong> bébé qui<br />
veillait sur sa mère » Clara n’avait pas régressé à un stade précédent, el<strong>le</strong> était projetée<br />
en avant pour protéger cette mère inconsolab<strong>le</strong> de la mort de sa sœur qui s’était suicidée<br />
quelques mois plus tôt. Nasio concluait : « En lui parlant la langue de l’image inconsciente<br />
du corps ‘je m’occupe de ta mère, tu peux dormir tranquil<strong>le</strong>‘ je lui ai redonné une base et lui<br />
ai signifié : ‘reviens à toi, retrouve ton état de nourrisson, repose-toi ».<br />
En effet, ici il ne s’agit pas de thérapie mais de recherche ; la demande et la finalité sont<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
différentes, il ne s’agit pas de répondre à une demande de soin, mais d’enrichir nos<br />
connaissances sur cet élève à l’éco<strong>le</strong>. Le concept nous paraît cependant tout aussi uti<strong>le</strong>.<br />
Si l’enfant n’a pas pu construire une bonne image de lui, une solidité en lui-même, <strong>le</strong><br />
changement peut <strong>le</strong> déstabiliser. Tout changement, comme l’arrivée dans une nouvel<strong>le</strong> éco<strong>le</strong><br />
en cours de scolarité ou plus tard <strong>le</strong> passage en sixième, est une période de fragilité. Le<br />
changement d’éco<strong>le</strong> peut s’inscrire dans un changement de vie : déménagement, séparation<br />
ou divorce des parents, deuil… Il peut aussi être voulu pour rompre avec un cadre scolaire<br />
non satisfaisant, mais n’en est pas pour autant faci<strong>le</strong>.<br />
Le changement d’éco<strong>le</strong>, inscrit dans ce concept d’image inconsciente du corps permettra<br />
d’explorer toutes sensations inscrites dans <strong>le</strong> corps par <strong>le</strong> biais des cinq sens ou de<br />
sensations cénesthésiques (la sensation interne d’être écrasé, étouffé, peut être forte sans<br />
qu’el<strong>le</strong> soit justifiée par des éléments réels…) et d’explorer ce que peut ressentir l’enfant par<br />
rapport aux déplacements dans l’espace ou aux rythmes du temps. Certains souvenirs forts<br />
vont revenir à la surface, ou plus exactement certaines sensations pourront faire rejaillir<br />
des souvenirs… à mettre en mots. Quelques questions vont orienter cette exploration :<br />
quel est l’endroit où tu te sens <strong>le</strong> mieux ? Y a-t-il un endroit où tu n’as pas envie d’al<strong>le</strong>r ?<br />
Où tu n’aimes pas rester ? Y a-t-il un moment que tu aimes bien ? Où tu voudrais que ça<br />
dure longtemps ? Où tu voudrais que ça passe tout de suite ? Le concept permet d’explorer<br />
comment ces sensations mises en place dans <strong>le</strong>s relations primordia<strong>le</strong>s rejaillissent dans<br />
<strong>le</strong>s relations futures, à travers <strong>le</strong>s relations à ceux qui l’aident, <strong>le</strong>s relations à ceux à qui<br />
l’élève se compare, à ceux avec qui il peut discuter du règ<strong>le</strong>ment ou des problèmes, ou<br />
encore à ceux qui lui imposent un mode d’être ou de faire… Sans que cela soit dit, certaines<br />
atmosphères, certaines ambiances vont réveil<strong>le</strong>r ce que l’enfant a emmagasiné dans ses<br />
premières années et faire qu’il éprouve son corps comme refuge solide, désirant et jouissant<br />
de la satisfaction dans l’échange, ou qu’à certains moments ce soit la peur, <strong>le</strong> repli, la<br />
frustration qui dominent. Le changement d’éco<strong>le</strong>, en convoquant la comparaison comme<br />
nous l’avons vu à l’œuvre chez <strong>le</strong>s adultes, va permettre à l’enfant de tisser des liens entre<br />
ce présent et son passé. Mais dans cette descente au psychisme, conscient et refoulé sont<br />
mêlés et <strong>le</strong> discours va traduire cette confusion ou cette émergence en cours. Nous serons à<br />
la recherche des manifestations de cet inconscient. Se dit-il dans cet entretien de recherche<br />
sous forme d’associations libres comme <strong>le</strong> veut la règ<strong>le</strong> fondamenta<strong>le</strong> de la thérapie, ou<br />
sous ces formes décrites par Freud et qui s’appliquent si bien à ce type d’entretien : lapsus,<br />
oublis, mots d’esprit, erreurs de langage, « actes et gestes que <strong>le</strong>s hommes accomplissent<br />
sans <strong>le</strong>s remarquer et, à plus forte raison, sans y attacher d’importance psychique : jouer<br />
machina<strong>le</strong>ment avec des objets, fredonner des mélodies, tripoter ses doigts, ses vêtements,<br />
etc. » (Freud, 0 ) ou bien sous des formes de contrô<strong>le</strong> imposé par <strong>le</strong> conscient qui tentent<br />
de tout justifier pour maintenir <strong>le</strong> « perturbateur » à la porte…<br />
Nous allons donc mê<strong>le</strong>r étude du discours et du contenu pour al<strong>le</strong>r à la recherche de ce<br />
que dit l’enfant de lui-même vivant avec son image inconsciente du corps dans cette éco<strong>le</strong>,<br />
dans l’éco<strong>le</strong> d’avant, de sa vie parascolaire… éventuel<strong>le</strong>ment de sa vie familia<strong>le</strong>, de ce qui<br />
lui permet d’être heureux mais aussi de ce qui <strong>le</strong> fait souffrir…<br />
1.2. La stabilité du « soi » à l’éco<strong>le</strong> : trois positions d’élève<br />
Nous rappelons ici brièvement ce qu’a permis de mettre en évidence l’analyse de dix<br />
entretiens menés avec des élèves arrivés dans cette éco<strong>le</strong> en pédagogie Freinet (désormais<br />
éco<strong>le</strong> Freinet)<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Un premier aspect s’était dégagé. Pour ces élèves arrivés à l’éco<strong>le</strong> Freinet, il s’agissait<br />
dans cet entretien de décrire ce qui se passait dans <strong>le</strong>ur éco<strong>le</strong>. Nous avons pu dire qu’ils<br />
cherchaient à la faire visiter par la pensée à <strong>le</strong>ur interlocuteur. Ils décrivent <strong>le</strong>s nombreuses<br />
sal<strong>le</strong>s qui « ne sont pas de classe », en expliquant ce qu’on y fait. Leurs activités de classe<br />
ne se déclinent pas selon « <strong>le</strong>s matières » mais selon <strong>le</strong>s manières de travail<strong>le</strong>r, <strong>le</strong>s supports<br />
(<strong>le</strong>ttres aux correspondants, textes libres, conférences…) étant liés aux techniques de<br />
travail (plan de travail, préparation, présentation ora<strong>le</strong>, affichage…). De plus el<strong>le</strong>s ne sont<br />
pas disjointes des relations qui s’établissent dans la classe, qu’il s’agisse de la gestion des<br />
prises de paro<strong>le</strong>s, des votes, des discussions au conseil. Les relations entre <strong>le</strong>s élèves se<br />
construisent aussi à travers <strong>le</strong>s modes d’organisations du travail et nous avions entendu<br />
comme tout à fait inhabituel<strong>le</strong> cette remarque d’une élève : « (<strong>le</strong>s autres personnes) on sait<br />
<strong>le</strong>urs recherches, <strong>le</strong>ur exposé, dans mon ancienne éco<strong>le</strong> on faisait pas de recherche, la<br />
maîtresse el<strong>le</strong> <strong>le</strong>s gardait pour el<strong>le</strong>, donc on connaissait pas plus que ça <strong>le</strong>s autres élèves…<br />
et puis ici on peut <strong>le</strong>s découvrir plus grâce aux textes et tout… » Les enfants apprennent <strong>le</strong><br />
savoir en même temps qu’ils apprennent à se connaître.<br />
Comme en témoigne cette appréciation, on avait aussi pu re<strong>le</strong>ver <strong>le</strong> nombre de comparaisons<br />
spontanées établies par <strong>le</strong>s élèves, comme si par<strong>le</strong>r de cette éco<strong>le</strong> <strong>le</strong>s invitait naturel<strong>le</strong>ment<br />
à montrer, peut-être pourrait-on dire argumenter, en quoi el<strong>le</strong> est particulière. De tous ces<br />
éléments rapportés sur l’éco<strong>le</strong> Freinet et de toutes comparaisons établies, il ressort un fort<br />
sentiment de liberté. L’éco<strong>le</strong> est un espace physique que l’on peut voir et parcourir avec<br />
plaisir, où l’on peut se déplacer quand on est autonome pour y faire différentes activités<br />
selon <strong>le</strong>s endroits, d’où l’on peut voir l’extérieur et d’où l’on peut sortir virtuel<strong>le</strong>ment par la<br />
correspondance et réel<strong>le</strong>ment par <strong>le</strong>s sorties organisées. Le travail est organisé comme<br />
un espace de liberté grâce au plan de travail et aux différentes méthodes d’échange entre<br />
maîtres et élèves. L’éco<strong>le</strong> est aussi un espace de relations libres où l’écoute, la disponibilité<br />
et la mise en va<strong>le</strong>ur de chacun sont valorisées.<br />
Partant de là nous avions aussi pu nous interroger sur <strong>le</strong>s enfants en souffrance et montrer<br />
que cette éco<strong>le</strong> <strong>le</strong>ur permettait de dépasser <strong>le</strong>s « pourquoi » et d’établir des liens. Nous avions<br />
conclu que l’enfant en souffrance pouvait trouver dans ce mode de relation pédagogique<br />
une certaine façon de se reconstruire. L’enfant a des moyens à sa disposition de savoir<br />
pourquoi tel<strong>le</strong> chose peut se faire, tel<strong>le</strong> chose ne peut pas se faire. C’est bien cette possibilité<br />
qui fait la différence avec ce que certains décrivent de <strong>le</strong>ur passage dans d’autres éco<strong>le</strong>s.<br />
Ainsi Boris raconte que dans la cour « il y avait des lignes, on n’a pas <strong>le</strong> droit de par<strong>le</strong>r<br />
aux parents en fait il y avait quand même un grillage mais on n’avait pas <strong>le</strong> droit, il y avait<br />
une ligne jaune, on n’avait pas <strong>le</strong> droit de la dépasser, je ne sais pas pourquoi ». Pour <strong>le</strong><br />
même élève, c’était la même chose dans <strong>le</strong> cadre de la classe : « (décamètre, hectomètre)<br />
je savais pas que ça existait, enfin une fois on avait fait ça avec ma maîtresse de CE2 mais<br />
el<strong>le</strong> nous avait jamais dit c’était quoi, on avait demandé, on avait demandé mais j’avais<br />
jamais su en fait ». Ces réponses apportées ici aux « pourquoi », amènent l’élève à l’idée<br />
qu’il n’est pas interdit d’avoir des réponses en ce qui concerne <strong>le</strong>s objets d’enseignement<br />
ou <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s de la classe ou de l’éco<strong>le</strong>. Nous faisons alors l’hypothèse que ce sentiment,<br />
installé dans sa vie quotidienne d’élève l’amène progressivement à penser qu’il est légitime<br />
de chercher à comprendre <strong>le</strong>s raisons d’être des événements, même douloureux et même<br />
quand on est enfant, et donc à ne plus s’enfermer derrière <strong>le</strong>s interdits de savoir. Unifier<br />
<strong>le</strong>s différents domaines de sa vie, l’amène à construire ou reconstruire son unité intérieure,<br />
c’est à dire à reconstruire son « moi » un moi libre qui peut s’engager dans <strong>le</strong> désir et <strong>le</strong><br />
plaisir de la relation à l’autre, c’est-à-dire à travail<strong>le</strong>r lui-même contre cette « dissociation »<br />
dont par<strong>le</strong> Winnicott ( ) et qu’illustre Blanchard-Lavil<strong>le</strong> ( 00 ) en présentant l’histoire de<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Jocelyne.<br />
Cette analyse s’était conclue en mettant en évidence trois positions d’enfants dans cette<br />
situation scolaire. Dans <strong>le</strong> discours de trois petites fil<strong>le</strong>s présentes depuis deux ans dans<br />
cette éco<strong>le</strong> nous avions pu déce<strong>le</strong>r à la fois des formes de prise en charge du discours, un<br />
grand nombre d’expression de liens explicites et certaines formes de recul par rapport aux<br />
questions posées.<br />
Ces trois aspects reliés montraient qu’il ne s’agissait pas de formes de justification qui<br />
agissent comme protection du soi, ni de refus déguisé par <strong>le</strong> glissement vers un autre<br />
sujet. On pouvait conclure à un certain plaisir à vivre et travail<strong>le</strong>r dans cette éco<strong>le</strong> ou, pour<br />
<strong>le</strong> dire autrement à un « je » disponib<strong>le</strong> à l’apprentissage et à la relation scolaire. Dans un<br />
deuxième cas il nous a semblé nous trouver face à une de ces positions intermédiaires<br />
toujours intéressantes à creuser quel que soit <strong>le</strong> domaine de recherche. Quatre élèves<br />
semblaient différents tour à tour : vantant avec autant de plaisir <strong>le</strong>s différentes activités<br />
scolaires que <strong>le</strong>s premières élèves citées, et apparaissant prisonniers à d’autres moments<br />
de situations personnel<strong>le</strong>s diffici<strong>le</strong>s à vivre. C’est dans ce groupe que nous avons pu re<strong>le</strong>ver<br />
des associations libres assez inattendues qui permettaient alors de nouer des fils de proche<br />
en proche et de livrer comme <strong>le</strong> dit Freud ( ), « ce que <strong>le</strong> sujet ne sait pas encore ». Ces<br />
quatre « je » là semblaient pris dans un conflit intense. Mais la pédagogie dont ils parlaient<br />
avec enthousiasme semblaient <strong>le</strong>ur donner la possibilité d’exister autrement et de donc de<br />
renforcer <strong>le</strong> désir de « je ». Dans un dernier cas la contrainte du milieu extérieur semblait<br />
peser très fortement sur trois élèves. Notre analyse du discours montre que l’enfant craint<br />
de se révé<strong>le</strong>r et tente de mettre fin à un discours qu’il perçoit dangereux, soit par des<br />
glissements dans un discours f<strong>le</strong>uve où se mê<strong>le</strong>nt réalité et fantasme, soit par l’insistance<br />
répétée des mots de fin « c’est tout », « voilà, », « j’ai pu rien à dire ». Là encore Freud<br />
( 0 ) éclaire cette situation : la méthode d’association libre « semb<strong>le</strong> échouer : <strong>le</strong> malade<br />
s’arrête brusquement, hésite et prétend n’avoir rien à dire, qu’il ne lui vient absolument<br />
rien à l’esprit. S’il en était ainsi, notre procédé serait inapplicab<strong>le</strong>. Mais une observation<br />
minutieuse montre qu’un tel arrêt des associations libres ne se présente jamais. El<strong>le</strong>s<br />
paraissent suspendues parce que <strong>le</strong> malade retient ou supprime l’idée qu’il vient d’avoir,<br />
sous l’influence de résistances revêtant la forme de jugements critiques. » Cette contrainte<br />
du milieu extérieur semb<strong>le</strong> résider dans une relation duel<strong>le</strong> forte qui enferme l’enfant. Le<br />
« je » apparaît trompeur et trompé puisqu’il peut exprimer ce que d’autres « je » proposent<br />
comme moi idéal, sans avoir la possibilité de s’en rendre compte. Toutefois, ce qui est<br />
surprenant ici, comme nous avons pu <strong>le</strong> montrer à travers l’analyse d’entretiens menés avec<br />
<strong>le</strong>s enseignants, l’évolution de ces enfants se fait dans un cadre qui ne répond pas à ce<br />
besoin légèrement forcené de relation duel<strong>le</strong>.<br />
2. Changement d’éco<strong>le</strong> : analyse comparative de cas<br />
La comparaison a pu être menée par l’intermédiaire d’entretiens réalisés par des étudiants<br />
dans <strong>le</strong> cadre d’un modu<strong>le</strong> de méthodologie de licence au cours de l’année 00 - 00 et<br />
00 - 00 . L’intérêt de cet échantillon est sa composition : il s’agit d’élèves qui ont changé<br />
d’éco<strong>le</strong> dans différents contextes. Pourtant l’analyse va révé<strong>le</strong>r des points communs entre<br />
eux et dans <strong>le</strong> même temps rendre évidentes des particularités de l’arrivée dans cette éco<strong>le</strong><br />
en pédagogie Freinet, qui sans cela seraient sans doute passées inaperçues.<br />
Il nous faut préciser ici que <strong>le</strong>s questions (ou <strong>le</strong>s fragments de questions) posés par <strong>le</strong><br />
chercheur seront parfois rappelés entre parenthèses par souci de fidélité au dérou<strong>le</strong>ment<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
de l’entretien.<br />
Pour aborder ces comparaisons, nous nous proposons de partir de comparaisons établies<br />
deux à deux entre deux élèves repérés pour <strong>le</strong>urs points communs.<br />
0<br />
2.1. Justine et Inès<br />
Justine et Inès ont changé d’éco<strong>le</strong> sans que des raisons dramatiques en soient <strong>le</strong> motif.<br />
Justine a changé de groupe scolaire, parce que <strong>le</strong>s classes de l’éco<strong>le</strong> élémentaire sont<br />
regroupées en trois lieux. Inès a déménagé, ses parents étaient intéressés par la pédagogie<br />
F et lui ont demandé son avis. Inès était « classée » dans <strong>le</strong> premier groupe des élèves dont<br />
<strong>le</strong> discours révè<strong>le</strong> des liens explicites et des formes de recul intéressantes.<br />
Toutefois <strong>le</strong> rapprochement va faire ressortir un certain nombre de fragilités. Toutes <strong>le</strong>s deux<br />
ont parfois une certaine manière de par<strong>le</strong>r de <strong>le</strong>urs difficultés. Justine rit beaucoup, Inès<br />
glisse rapidement d’un événement à un autre. On peut même dire qu’el<strong>le</strong>s ont en commun<br />
certaines façons de ne pas dire ouvertement ce qui est douloureux. Ainsi pour Justine « <strong>le</strong><br />
noir » semb<strong>le</strong> lié à un événement particulier dont el<strong>le</strong> ne par<strong>le</strong> pas. « Des fois, ça m’arrive<br />
d’al<strong>le</strong>r dans <strong>le</strong>s tracteurs avec papa… des fois ouais surtout pendant <strong>le</strong>s vacances parce<br />
qu’après l’éco<strong>le</strong> ça fait un peu tard et il fait noir (tu as peur du noir ?) hum, un peu, pas<br />
beaucoup ça dépend des fois… y a rien qui me fait peur, enfin rien de spécial, j’aime pas<br />
la cou<strong>le</strong>ur noire c’est tout ». Suit alors un si<strong>le</strong>nce, ce qui est très rare pour Justine qui <strong>le</strong>s<br />
« meub<strong>le</strong> » en riant, et el<strong>le</strong> ajoute « c’est surtout <strong>le</strong>s bruits que j’entends et que je vois pas<br />
qui me font peur ». Inès dit à propos du quoi de neuf : « j’adore ça parce que ben c’est <strong>le</strong><br />
moment où on peut raconter un peu notre vie… des événements importants comme, je sais<br />
pas, ta meil<strong>le</strong>ure copine qui a déménagé en Belgique ou bien des trucs comme ça (ça t’es<br />
arrivé que tu aies une bonne copine qui a déménagé en Belgique ?) non jamais mais il y a<br />
eu un autre événement mais c’est pas du tout la même chose (et tu as pu <strong>le</strong> raconter ?) de<br />
quoi ? (cet autre événement…) oui j’ai pu <strong>le</strong> raconter tandis qu’avant à mon ancienne éco<strong>le</strong><br />
ben il y avait aussi d’autres événements comme quand j’avais changé de voiture et tout ça<br />
ben je sais pas, ça je pouvais pas <strong>le</strong> dire directement à la classe ». On voit dans <strong>le</strong>s deux<br />
cas comment <strong>le</strong> discours recouvre de manière adroite l’événement douloureux non-dit.<br />
D’autres fragilités vont aussi être visib<strong>le</strong>s par la comparaison. Toutes deux voudraient « tout<br />
à la fois » : Pour Inès, être dans cette éco<strong>le</strong> mais participer à la classe de neige de l’autre<br />
éco<strong>le</strong> avec <strong>le</strong>s copines « qui ont de la chance » pour Justine, être grande et profiter des<br />
droits des petits : « quand on est grand, on peut pas se cacher sous une tab<strong>le</strong> alors que<br />
quand on est petit, on peut »… allusion aux droits selon Justine, dont jouit la petite sœur. La<br />
marque des événements douloureux, <strong>le</strong>s envies de tout à la fois, se spécifient aussi dans<br />
<strong>le</strong> refus de partir et la peur de perdre… ceux qu’on aime, surtout. Inès dira à propos d’une<br />
copine partie « je la revois pas, non c’est ça aussi qui est dommage quand il y a des gens<br />
qui partent au collège on <strong>le</strong>s revoit plus, on perd contact et puis après on se revoit plus du<br />
tout. » Justine livrera sans doute quelque chose de fort, à mots cachés sous une boutade,<br />
en disant d’abord<br />
« j’aime pas <strong>le</strong> déplacement même quand c’est pour partir en vacances… j’aime pas trop…<br />
surtout quand c’est loin… j’aime bien ma maison, alors je veux pas partir. On perd ses<br />
camarades, sa maîtresse, sa mamie et son pépère. Ah non je veux pas partir… parce que<br />
la campagne c’est mieux que la vil<strong>le</strong>, c’est moins pollué, on respire l’air frais ! »<br />
Toutefois des différences vont se marquer entre ces deux discours. El<strong>le</strong>s ont trait d’abord<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
à la façon donc chacune évoque <strong>le</strong>s activités scolaires. On a déjà pu remarquer que dans<br />
<strong>le</strong>s propos de Justine il était davantage question de vie familia<strong>le</strong> que de vie scolaire. En<br />
parcourant ce long entretien on sera frappé de la longueur du contenu famil<strong>le</strong> par rapport<br />
au contenu éco<strong>le</strong>. Mais une deuxième remarque s’impose : Justine va énumérer quelques<br />
matières pour dire qu’el<strong>le</strong> <strong>le</strong>s aime ou pas, se comparer aux autres. Ce qu’el<strong>le</strong> aime à<br />
l’éco<strong>le</strong>, ce sont « certaines matières que à peu près tout <strong>le</strong> monde aime ». En revanche el<strong>le</strong><br />
par<strong>le</strong> longuement du sport, en riant beaucoup pour dire sur <strong>le</strong> même plan <strong>le</strong> jugement qu’el<strong>le</strong><br />
et que <strong>le</strong>s autres portent sur el<strong>le</strong>-même : « j’suis pas très fortiche, j’ai eu sept sur dix quand<br />
même, c’est pas génial, pourrait faire mieux mais bon, parce que je suis pas nerveuse,<br />
nerveuse » dit-el<strong>le</strong> en riant. Par<strong>le</strong>r de l’éco<strong>le</strong> signifie donc être comparée aux autres élèves.<br />
Pour Inès ce sera comparer la méthode de résolution des divisions proposées en recherche<br />
mathématique : « je fais quelques exemp<strong>le</strong>s en montrant bien avec des flèches et tout,<br />
ça ce serait ça ma recherche enfin pour moi, pour d’autres élèves ça serait pas pareil »<br />
et apprécier cette méthode en la comparant à d’autres : « après on a regardé la méthode<br />
que <strong>le</strong>s autres éco<strong>le</strong>s el<strong>le</strong>s faisaient et puis c’était beaucoup plus faci<strong>le</strong> parce que moi<br />
franchement on avait quand même essayé de me l’expliquer j’avais rien compris ». Il est<br />
question de comparaison dans <strong>le</strong>s deux cas, mais Justine est comparée tandis que Inès<br />
compare…<br />
D’une façon plus généra<strong>le</strong> on peut remarquer que du côté de Justine dans l’éco<strong>le</strong> il est<br />
plutôt question de relation individuel<strong>le</strong> à la maîtresse ou d’ambiance alors que du coté<br />
d’Inès l’organisation de la paro<strong>le</strong> est liée à la possibilité de construire des liens aux autres.<br />
Justine aimait bien l’ancienne maîtresse « on l’entendait jamais crier… y’a une meil<strong>le</strong>ure<br />
ambiance dans la classe. Si ça crie, t’as pas envie de travail<strong>le</strong>r… Je l’ai eue pendant deux<br />
ans… J’aime bien garder la même maîtresse ». Inès apprécie <strong>le</strong> quoi-de-neuf qui permet<br />
de raconter à toute la classe contrairement aux autres éco<strong>le</strong>s où « on par<strong>le</strong> pas directement<br />
à toute la classe on par<strong>le</strong> juste à sa voisine, c’est plutôt la chose que je préfère ici parce<br />
qu’avant… ».<br />
De fait d’autres liens s’instal<strong>le</strong>nt, entre cette élève et <strong>le</strong>s autres élèves, via la part de<br />
l’enseignant. Deux petits récits de vie de classe par<strong>le</strong>nt d’eux-mêmes de ce point de vue :<br />
À la question de savoir s’il y a une pièce dans l’éco<strong>le</strong> qu’el<strong>le</strong> n’aime pas du tout, Justine<br />
répond « ce que je n’aime pas du tout, c’est al<strong>le</strong>r au tab<strong>le</strong>au… c’est pas que j’ai peur des<br />
autres, hein. Je suis pas à l’aise, c’est tout… c’est parce que je suis devant tout <strong>le</strong> monde.<br />
Un peu, ouais, ça, à cause de ça. J’aime pas quand <strong>le</strong>s autres me regardent… c’est un peu,<br />
heu, un peu gros… gros sur soi-même (c’est à dire ?) tous <strong>le</strong>s regards sont sur soi-même<br />
et puis ben, on se sent pas bien… ». Inès a raconté qu’el<strong>le</strong> était pipe<strong>le</strong>tte et agitée, et avait<br />
d’ail<strong>le</strong>urs <strong>le</strong> surnom de « gazel<strong>le</strong> agitée » quand el<strong>le</strong> était petite. À la fin de l’entretien el<strong>le</strong><br />
revient sur cette agitation : « je bouge quand même assez mais c’est surtout <strong>le</strong>s jambes et<br />
<strong>le</strong>s bras que je bouge, c’est pour ça que souvent mes stylos ils tombent (ah bon ! et alors<br />
c’est embêtant quand tes stylos ils tombent ? tu te fais crier ?) ben non, non, je <strong>le</strong> ramasse<br />
comme ça (el<strong>le</strong> disparaît sous la tab<strong>le</strong> pour faire <strong>le</strong> geste du pied) et puis après voilà,<br />
ou alors des fois quand mon stylo il rou<strong>le</strong>, il rou<strong>le</strong>, il rou<strong>le</strong>, ben c’est <strong>le</strong>s autres qui me <strong>le</strong><br />
ramassent et puis après je dis “merci” ». Il est ici évident que <strong>le</strong> rapport aux autres est vécu<br />
de manière très différente.<br />
2.2. Nas et Raïssa<br />
Ce qui rapproche Nas et Raïssa a trait à la fois aux événements douloureux qui <strong>le</strong>s<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
marquent en même temps qu’à la manière de vivre ces événements, à la manière de se<br />
vivre, pourrait-on dire. Le père de R est mort, el<strong>le</strong> a déménagé plusieurs fois, celui de Nas<br />
était très malade et c’est vraisemblab<strong>le</strong>ment pour cette raison qu’el<strong>le</strong> est partie dans <strong>le</strong> sud<br />
de la France. Au moment de l’entretien el<strong>le</strong> a retrouvé son « éco<strong>le</strong> d’avant ». El<strong>le</strong>s sont<br />
devant un événement qui <strong>le</strong>s affectent, dont el<strong>le</strong>s ne savent pas tout, mais subissent pour<br />
el<strong>le</strong>s-mêmes des souffrances à la fois physiques et mora<strong>le</strong>s. Nas dit de cette éco<strong>le</strong> « y’en<br />
a qui me tapaient… j’étais obligée de rester dans <strong>le</strong>s toi<strong>le</strong>ttes des fil<strong>le</strong>s parce que sinon ils<br />
me taperaient, <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s el<strong>le</strong>s étaient méchantes, el<strong>le</strong>s arrêtaient pas de me pousser dans<br />
<strong>le</strong>s escaliers ». Raïssa dit « j’ai pas envie qu’on me frappe, ça fait mal ». El<strong>le</strong>s sont l’objet<br />
de rail<strong>le</strong>ries. Nas raconte « y en a qui me tapaient parce que j’avais des grosses dents de<br />
lapin et p<strong>le</strong>in d’autres choses qu’ils n’aimaient pas comme des baskets, ils disaient “ils sont<br />
moches ces baskets” » Raïssa se sent menacée, el<strong>le</strong> craint aussi ce qu’on peut dire : « j’ai<br />
pas envie de me faire frapper, d’avoir tout ça, d’avoir par exemp<strong>le</strong> un œil au beurre noir et<br />
après qu’on dise que ma mère el<strong>le</strong> m’a frappé alors que ça sera pas vrai ». Nas se sent<br />
rejetée « j’étais toute seu<strong>le</strong> à une tab<strong>le</strong>… (et quand tu faisais de sorties ?) ben je me mettais<br />
toute seu<strong>le</strong> (tu t’es fait aucune copine ?) aucune » répond-el<strong>le</strong> tristement. En contraste el<strong>le</strong><br />
laisse éclater sa joie au retour. Raïssa p<strong>le</strong>ure dans l’entretien en parlant de la mort de son<br />
père et en évoquant ce qu’aurait dit un élève de sa classe à propos de son père… ce qui<br />
l’aurait amené à <strong>le</strong> dire, alors qu’avant el<strong>le</strong> n’en parlait à personne. Les émotions sont fortes<br />
et teintent <strong>le</strong>ur soi profond comme <strong>le</strong>urs rapports aux autres.<br />
Ce qui va <strong>le</strong>s différencier va tenir à la possibilité qu’el<strong>le</strong>s ont ou non de dire dans l’entretien<br />
ce qu’el<strong>le</strong>s vivent en classe. En effet Nas ne semb<strong>le</strong> pas en mesure de sortir de ces impacts<br />
émotionnels très forts : d’un côté la séparation et <strong>le</strong> rapport aux autres très diffici<strong>le</strong>, de<br />
l’autre <strong>le</strong> bonheur retrouvé. On serait tenté de penser à la bonne mère et la mauvaise mère<br />
introjectée (M. K<strong>le</strong>in, ) : « j’aime tout dans mon éco<strong>le</strong> (c’est pas la même chose que<br />
dans l’autre éco<strong>le</strong> où tu avais été ?) c’est pas la même chose que dans l’autre éco<strong>le</strong> ! j’ai<br />
regretté tel<strong>le</strong>ment d’être partie. » Tout se passe comme si par<strong>le</strong>r de l’éco<strong>le</strong> introduirait un<br />
élément tiers impossib<strong>le</strong> à supporter, ouvrir une brèche dans <strong>le</strong> « tout mauvais » ou dans <strong>le</strong><br />
« tout bon ». Tenter de l’aider à en par<strong>le</strong>r se heurte à un refus : « (et dans cette éco<strong>le</strong> quel<br />
endroit tu aimes bien ? j’aime bien tout (et ta classe tu aimes bien ?) el<strong>le</strong> est bien décorée,<br />
el<strong>le</strong> est grande et <strong>le</strong>s autres aussi el<strong>le</strong>s sont grandes et el<strong>le</strong>s sont bien décorées (et dans<br />
ton éco<strong>le</strong> y’ a un endroit que tu n’aime pas ?) » Suit un si<strong>le</strong>nce qui s’achève par une marque<br />
de possession et un regard sur la porte…« et pis après c’est tout, j’aime tout dans mon<br />
éco<strong>le</strong> ». C’est là que se situe la différence : ce n’est pas ail<strong>le</strong>urs que Raïssa vit des relations<br />
très diffici<strong>le</strong>s, c’est dans cette éco<strong>le</strong> Freinet et pourtant el<strong>le</strong> n’a pas l’attitude de Nas de tout<br />
rejeter en bloc. Bien au contraire c’est en parlant de ce qu’el<strong>le</strong> fait dans cette éco<strong>le</strong> qu’el<strong>le</strong> se<br />
reconstruit peu à peu dans l’entretien et arrivera à livrer des choses tout à fait imprévisib<strong>le</strong>s<br />
au début de l’entretien.<br />
Nas est prise dans des relations interpersonnel<strong>le</strong>s dont el<strong>le</strong> ne peut pas sortir. À un moment<br />
el<strong>le</strong> dira « oui <strong>le</strong>s enseignants ils me plaisaient mais <strong>le</strong>s enfants non ». Pourtant, enfermée<br />
dans <strong>le</strong>s toi<strong>le</strong>ttes pour éviter d’être tapée el<strong>le</strong> se sent aussi victime : « (tu <strong>le</strong> disais à ton<br />
enseignant ?) si, mais la maîtresse el<strong>le</strong> me disait rien du tout ». À un autre moment el<strong>le</strong> va<br />
par<strong>le</strong>r d’un enseignant « sport anglais » pour décrire essentiel<strong>le</strong>ment la relation enseignant/<br />
élève dans des termes de contrô<strong>le</strong> « il disait par contre en anglais si on pouvait sauter à<br />
pied, s’il disait quelque chose en anglais ça serait nous qui devions deviner, en fait si on a<br />
faux on serait éliminé… y a <strong>le</strong> groupe des fil<strong>le</strong>s, y a <strong>le</strong> groupe des garçons et pis si ils par<strong>le</strong>nt,<br />
ils seront éliminés ». L’autre éco<strong>le</strong> ne pouvait lui apporter que rejet, mise à l’écart. Revenir<br />
ici est synonyme d’être aimé : « (qu’est-ce que ça t’a fait de retrouver ton ancienne éco<strong>le</strong> ?)<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Ça m’a fait un plaisir ! ». El<strong>le</strong> ajoute, toute émue : « et puis j’ai retrouvé mes copines et ils<br />
se sont tous jetés sur moi ! ». Ce n’est pas <strong>le</strong> cas de Raïssa qui va exposer ce qu’el<strong>le</strong> vit en<br />
classe. À côté des menaces des autres, il y a <strong>le</strong>s endroits et <strong>le</strong>s jeux qu’el<strong>le</strong> aime (dont el<strong>le</strong><br />
dit pourquoi el<strong>le</strong> <strong>le</strong>s aime), <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s qui permettent d’être autonome et donc de se déplacer<br />
dans la classe, <strong>le</strong> choix possib<strong>le</strong> d’activités et d’activités à réaliser avec d’autres (« j’aime<br />
bien faire de la musique avec mes copains »), la liberté que donne <strong>le</strong> plan de travail, <strong>le</strong> choix<br />
de thèmes de conférences et <strong>le</strong> vote de l’appréciation par toute la classe, <strong>le</strong> respect des<br />
règ<strong>le</strong>s.<br />
L’organisation de la classe lui permet de vivre d’autres choses « à côté » de cel<strong>le</strong>s qui sont<br />
diffici<strong>le</strong>s, d’introduire ainsi peu à peu en el<strong>le</strong> <strong>le</strong> droit de vivre, <strong>le</strong> désir et <strong>le</strong> plaisir. On sent<br />
ce plaisir intense quand el<strong>le</strong> raconte la préparation de cette conférence sur <strong>le</strong>s dinosaures<br />
qui lui permet de glisser à ce qu’on pourrait appe<strong>le</strong>r une « nouvel<strong>le</strong> vie avec son père » ou<br />
un nouveau mode de relation : « j’aime bien tout ce qui est nature et tout ça, j’aime bien<br />
parce que mon père il m’a beaucoup emmené dans <strong>le</strong>s forêts et dans <strong>le</strong>s montagnes hein<br />
et puis il m’a appris p<strong>le</strong>in de choses mais j’ai pas retenu tout mais j’aime bien ». Se servir<br />
de ce qu’il lui a donné, <strong>le</strong> goût de la montagne et de la nature, pour vivre quelque chose par<br />
el<strong>le</strong>-même, est un élément fort de reconstruction après <strong>le</strong> deuil. Ce sont de tels propos qui<br />
nous ont permis d’écrire (Jovenet, 00 ) que « face à une relation individuel<strong>le</strong> privilégiée<br />
qui se donne comme but de restaurer (réconforter, soigner, traiter… la partie malade du soi,<br />
la pédagogie Freinet oppose <strong>le</strong> traitement égal pour tous et par tout, d’un individu pris dans<br />
sa totalité ».<br />
2.3. Tom et Boris<br />
Le rapprochement entre Tom et Boris se fait sur la base d’un changement d’éco<strong>le</strong> qui fait<br />
suite à une souffrance forte vécue dans l’éco<strong>le</strong> précédente, non évacuée à <strong>le</strong>ur arrivée dans<br />
la nouvel<strong>le</strong> éco<strong>le</strong>. Mais ce qui va <strong>le</strong>s différencier repose sur ce que Boris peut reconstruire<br />
de lui-même dans cette éco<strong>le</strong> en pédagogie Freinet alors que Tom cherche à évacuer <strong>le</strong>s<br />
mauvais souvenirs qui l’assail<strong>le</strong>nt continuel<strong>le</strong>ment.<br />
Ce vécu dans l’ancienne éco<strong>le</strong> est inscrit dans <strong>le</strong> corps. Il est diffici<strong>le</strong> à dire, <strong>le</strong>s mots qui<br />
viennent à l’esprit sont forts et s’entrechoquent. Boris dit : « dans cette éco<strong>le</strong> on était castré…<br />
un moment qui m’a choq-, une fois ça m’a beaucoup fait, ça m’a énervé et puis on m’avait<br />
puni, on m’avait mis sur un pneu qu’on mettait à côté des maîtres pour punir <strong>le</strong>s gens, on<br />
m’avait puni, on m’avait mis sur <strong>le</strong> pneu, ben moi, on était obligé… » et Tom : « on n’arrêtait<br />
pas de me frapper dans <strong>le</strong>s coins euh… on m’tapait tout <strong>le</strong> temps. A V, Mme D. el<strong>le</strong> tirait nos<br />
oreil<strong>le</strong>s ». Les auteurs de ces faits sont aussi bien <strong>le</strong>s adultes que <strong>le</strong>s enfants ; <strong>le</strong> présent<br />
et <strong>le</strong> passé se confondent. Tom entend <strong>le</strong>s questions sur l’éco<strong>le</strong> actuel<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> contexte<br />
précédent. Pour Boris, l’interlocuteur devient témoin : <strong>le</strong> tutoiement <strong>le</strong> rend auditeur et<br />
spectateur de ces scènes gravées dans sa mémoire : « avant moi c’était beaucoup, c’était<br />
sévère en fait, tu tombais par terre, c’était de ta faute ». De fait à ces aspects physiques se<br />
mê<strong>le</strong>nt humiliations verba<strong>le</strong>s auxquel<strong>le</strong>s participent aussi bien <strong>le</strong>s adultes que <strong>le</strong>s autres<br />
élèves. Boris <strong>le</strong> raconte en classe : « une fois on avait eu un texte, il y avait un mot, c’était<br />
‘solitaire’, il y a une fil<strong>le</strong> qui a demandé : “c’est quoi solitaire ?” et la maîtresse el<strong>le</strong> a dit<br />
“solitaire c’est quelqu’un qui reste tout <strong>le</strong> temps seul” et après el<strong>le</strong> nous a demandé “c’est<br />
qui dans la classe qui est solitaire ?”, ben moi j’ai <strong>le</strong>vé <strong>le</strong> doigt comme ça parce que je savais<br />
que personne ne voulait me par<strong>le</strong>r et puis après la maîtresse el<strong>le</strong> a dit “c’est parce que tu ne,<br />
tu ne, tu ne par<strong>le</strong>s pas aux autres gens, tu cherches pas à voir <strong>le</strong>s gens” et toute la classe<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
a dit “oui” ». Voilà une <strong>le</strong>çon de vocabulaire qui révè<strong>le</strong> à quel point <strong>le</strong> contexte scolaire peut<br />
provoquer un élève à intérioriser une réputation… Les autres élèves se montrent inf<strong>le</strong>xib<strong>le</strong>s :<br />
« je <strong>le</strong>ur donnais des gâteaux, des trucs bons pour eux, ils voulaient jamais me voir ». Un<br />
sentiment aussi fort ne peut que se transporter à l’arrivée dans la nouvel<strong>le</strong> éco<strong>le</strong>. Boris<br />
raconte s’être fait disputé par <strong>le</strong> maître parce qu’il n’avait pas compris la signification des<br />
rosaces en recherches mathématiques, il croyait que c’était de l’art plastique. Tom se sent<br />
toujours victime dans sa nouvel<strong>le</strong> éco<strong>le</strong> : « on n’arrête pas d’me marcher sur mon manteau<br />
et d’me faire des croche-pieds ».<br />
Une première brèche s’ouvre pour Boris quand il est en mesure de réutiliser <strong>le</strong>s mêmes<br />
mots pour établir des comparaisons « pour l’entretien aussi au début ça m’a choqué que <strong>le</strong><br />
matin on prenait un bout de temps pour expliquer la vie des autres comparé à ma classe<br />
avant que on n’avait aucun répit », alors que pour Tom c’est <strong>le</strong> seul ressenti qui s’impose. Il<br />
lui faut à tout prix empêcher cette sensation de remonter à la surface. Quand on lui demande<br />
s’il a encore du mal à s’habituer à certaines choses, il n’entend pas la question et répond<br />
« ouais… c’est euh… c’est à l’éco<strong>le</strong> à V ça m’énerve tel<strong>le</strong>ment puis j’lai encore dans la<br />
tête alors euh vaut mieux l’oublier hein ! ». N’ayant pas <strong>le</strong>s mots suffisants pour raconter,<br />
il ne peut que manifester physiquement l’émotion qui l’envahit : il tremb<strong>le</strong> et reprend son<br />
souff<strong>le</strong>.<br />
Les deux se ressemb<strong>le</strong>nt du point de vue de ce passé qui <strong>le</strong>s a meurtris. Ce qui va <strong>le</strong>s<br />
opposer c’est la pauvreté ou au contraire l’amp<strong>le</strong>ur des descriptions de ce qu’ils peuvent vivre<br />
maintenant dans <strong>le</strong>ur classe. Tom va se contenter de dire « euh ça fait du bien de changer<br />
d’éco<strong>le</strong>, par rapport à… », ce que pourrait dire aussi Boris. La différence c’est que lui, va<br />
pouvoir argumenter ce sentiment. Les mêmes questions provoquent des réponses verba<strong>le</strong>s<br />
très brèves, accompagnées de mimiques chez Tom. Donnons quelques exemp<strong>le</strong>s : « <strong>le</strong><br />
moment que tu préfères ?) hum arts plastiques (Ah oui ? t’es fort en arts plastiques ?) »Tom<br />
fait signe que oui de la tête avec un petit sourire et ne répond pas. « (T’aimes bien l’éco<strong>le</strong><br />
où t’es ?) ». Il fait signe oui de la tête en arborant un grand sourire. « Quel est ton meil<strong>le</strong>ur<br />
souvenir à l’éco<strong>le</strong> ?) Hum… à V. j’en ai pas ».<br />
Ces quelques lignes appuient bien ce qui a déjà été dit : il ne peut échapper au souvenir trop<br />
présent. Mais en même temps on peut se demander pourquoi <strong>le</strong> présent reste trop faib<strong>le</strong><br />
pour prendre <strong>le</strong> dessus. Ce qui n’est évidemment pas <strong>le</strong> cas pour Boris. Citons quelques<br />
éléments qui retiennent son attention : <strong>le</strong>s lieux comme la cour et la possibilité de voir à<br />
l’extérieur, <strong>le</strong>s dispositifs, qu’il appel<strong>le</strong> « procédés » (et là il range l’entretien, <strong>le</strong>s réunions de<br />
classe, la feuil<strong>le</strong> d’inscription pour <strong>le</strong>s ateliers du soir), <strong>le</strong>s activités proprement dites c’est<br />
à dire <strong>le</strong>s arts plastiques, <strong>le</strong>s ateliers et la possibilité d’apprendre de nouvel<strong>le</strong>s choses<br />
comme faire des masques vénitiens, la <strong>le</strong>cture aux petits, la présentation de conférence,<br />
<strong>le</strong>s recherches mathématiques, mais aussi ce qui se rapporte à la liberté de l’élève comme<br />
négocier avec <strong>le</strong> maître <strong>le</strong> fait de ne pas mettre dans <strong>le</strong> cahier ou de ne pas présenter à la<br />
classe un texte jugé personnel ou encore la possibilité de ne pas al<strong>le</strong>r en récréation.<br />
Une remarque apparaît tout à fait particulière. El<strong>le</strong> concerne la réaction du maître à propos<br />
des recherches mathématiques : « j’ai fait surtout des arbres de, toutes sortes d’arbres,<br />
des choses comme ça… la dernière fois j’ai fait, <strong>le</strong> maître il a bien apprécié ce que j’ai fait,<br />
c’est l’opération bonhomme ». On a peine à croire que c’est <strong>le</strong> même Boris « solitaire » qui<br />
puisse vivre une relation de cet ordre avec l’enseignant ! Notons toutefois que Boris ne l’a<br />
pas cherchée, il en paraît même étonné… De fait ce sont de tels éléments qu’il va mettre en<br />
évidence dans ses comparaisons spontanées :<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
« en arts plastiques aussi à chaque fois, dès qu’on lance un truc il nous dit “ah tu pourrais<br />
faire ça avec ça…” que ben avant en arts plastiques déjà on n’en faisait pas beaucoup et<br />
là maintenant j’aime bien », ou encore « on a toujours <strong>le</strong> choix, parce qu’avant à mon éco<strong>le</strong><br />
on faisait un truc on était obligé de <strong>le</strong> présenter… tu faisais un texte, t’étais obligé de <strong>le</strong><br />
présenter, il n’y avait pas d’ordre, on s’inscrivait pas, c’était “tu vas présenter aujourd’hui<br />
même si tu n’as pas fini, tu finiras demain”, euh, c’est comme ça ».<br />
Ces dernières remarques, comme <strong>le</strong>s comparaisons faites entre Nas et Raïssa, Justine et<br />
Inès laissent entrevoir toute une série de spécificités de cette éco<strong>le</strong> en pédagogie Freinet,<br />
qu’il faut à présent creuser.<br />
3. Comparaisons généra<strong>le</strong>s et modes de travail pédagogique<br />
Rappelons que notre dispositif d’entretien invite dix enfants à par<strong>le</strong>r de <strong>le</strong>ur changement<br />
d’éco<strong>le</strong> et dix enfants à par<strong>le</strong>r de <strong>le</strong>ur entrée à l’éco<strong>le</strong> Freinet. Dans un premier temps<br />
nous regrouperons <strong>le</strong>s remarques des élèves issus de ces éco<strong>le</strong>s différentes et pourtant<br />
empreintes de fortes similitudes, et dans un deuxième temps nous comparerons ces<br />
éléments à ceux qui étaient mis en évidence dès 00 à l’éco<strong>le</strong> en pédagogie Freinet, ceci<br />
en suivant trois axes : <strong>le</strong>s activités scolaires proprement dites, <strong>le</strong>s relations élèves/adultes,<br />
<strong>le</strong>s relations entre pairs.<br />
3.1. Les activités scolaires<br />
Dans <strong>le</strong>s autres éco<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s propos des élèves s’organisent surtout en listes : ils énumèrent<br />
<strong>le</strong>s matières, ou <strong>le</strong>s activités à l’intérieur d’une matière, ou encore <strong>le</strong>s sal<strong>le</strong>s. En utilisant <strong>le</strong><br />
mot liste, nous voulons souligner <strong>le</strong> fait qu’ils disent peu de choses de ces matières ou de<br />
ces types d’activités. La comparaison va laisser imaginer tout ce que ces élèves pourraient<br />
dire si cela <strong>le</strong>ur venait à l’esprit ! À l’éco<strong>le</strong> Freinet ils ne citent généra<strong>le</strong>ment pas une matière,<br />
ou un lieu sans dire ce qu’ils y font, comment ils <strong>le</strong> font et en ajoutant surtout ce qui <strong>le</strong>ur plaît<br />
ou déplaît. On pourrait dire que ces matières vivent : ils <strong>le</strong>s présentent dans <strong>le</strong>ur réalisation<br />
beaucoup plus que comme des produits tout faits, et dans une réalisation où l’acteur est<br />
présent.<br />
Dans cette présentation, nous indiquerons la classe où se trouve l’élève dont <strong>le</strong>s propos<br />
sont rapportés, ce qui rend évident que <strong>le</strong>ur brièveté ou <strong>le</strong>ur développement ne relève pas<br />
d’un niveau de classe.<br />
Certaines matières scolaires sont présentées sous forme anecdotique : « Là-bas la directrice<br />
quelquefois on faisait anglais parce qu’el<strong>le</strong> savait par<strong>le</strong>r anglais… là, cel<strong>le</strong> qui nous fait<br />
anglais eh ben je la comprend mieux que la directrice de là-bas parce que je la connais<br />
mieux… mais je préfère l’anglais que l’al<strong>le</strong>mand parce que on pouvait choisir soit l’anglais,<br />
soit l’al<strong>le</strong>mand » (Lucie, CM ). Quelques détails extérieurs peuvent être re<strong>le</strong>vés : « Des<br />
fois on fait de l’histoire, de la géographie, des sciences. On a fait des affiches Mercure,<br />
Jupiter, Mars et tout ça, <strong>le</strong>s neuf planètes et on <strong>le</strong>s a mis sur <strong>le</strong>s murs (si<strong>le</strong>nce) et puis il y<br />
a l’éducation civique. Y a p<strong>le</strong>in de décorations et y’a même l’art plastique, y’a aussi l’éveil<br />
à la foi… et puis c’est bien décoré » (Elsa en CM ). Ces énumérations de matières sont<br />
aussi mises en relations avec <strong>le</strong>s personnes : pour répondre à une question sur sa matière<br />
favorite, Marie (CE ) répond « ben j’ai l’histoire, <strong>le</strong> français, <strong>le</strong>s sciences et <strong>le</strong>s maths parfois<br />
y’a des choses que j’aime bien aussi dedans » Quand la même question est reposée el<strong>le</strong><br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
affirme « ben la science, euh <strong>le</strong>s sciences (pourquoi ?) ben mes parents, ils sont profs de<br />
sciences et puis c’est pas dur, c’est pas dur » Quant à se demander si el<strong>le</strong> préférerait une<br />
autre matière en fonction de ses parents el<strong>le</strong> répond « ben non, c’est aussi que, ils me<br />
disent p<strong>le</strong>in de trucs, p<strong>le</strong>in de choses, et après en classe quand on doit <strong>le</strong> faire, ben c’est moi<br />
qui lève <strong>le</strong> doigt car je <strong>le</strong> sais ! Par exemp<strong>le</strong>, euh, je rêvais que la maîtresse el<strong>le</strong> demandait<br />
“qu’est-ce que c’était qu’un tsunami”, ben, moi, ma mère el<strong>le</strong> me l’a déjà dit des, euh, des<br />
dizaines de fois ».<br />
Les matières sont aussi énumérées en fonction des jours et des heures : « à 9h 00… quand<br />
on a mis nos affaires on fait de la conjugaison. Comme <strong>le</strong> lundi on commence par l’histoire et<br />
la maîtresse nous fait réciter et moi j’aime bien parce que j’apprends toujours. La géographie<br />
c’est <strong>le</strong> mardi et <strong>le</strong> jeudi sciences c’est toujours comme ça ».<br />
À l’intérieur de ces matières, quelques élèves vont citer des activités mais cela reste très<br />
rapide. La même Elsa par<strong>le</strong> d’un exposé « et puis là j’ai un exposé à faire sur <strong>le</strong>s tigres et<br />
puis j’ai du travail aussi en conjugaisons, <strong>le</strong>s maths aussi, en maths j’ai <strong>le</strong>s plus, <strong>le</strong>s moins,<br />
<strong>le</strong>s multiplications, <strong>le</strong>s fractions… mais là aussi je suis un peu en vacances, je vais recopier<br />
mon exposé sur <strong>le</strong>s tigres ». À ce propos, el<strong>le</strong> développera plus longuement un film sur <strong>le</strong>s<br />
licornes regardé à la maison. Tom (CM ) dont il a déjà été question, dit « j’aime bien <strong>le</strong>s<br />
mathématiques, <strong>le</strong>s divisions, <strong>le</strong>s soustractions, <strong>le</strong>s multiplications, euh <strong>le</strong>s, la conjugaison,<br />
c’est tout », mais il ajoute peu après qu’il aimerait bien changer « <strong>le</strong>s maths… <strong>le</strong> périmètre »<br />
en expliquant « j’arrive pas à <strong>le</strong> faire ».<br />
De fait dans <strong>le</strong> discours de ces élèves, <strong>le</strong>s matières sont aussi associées aux difficultés ou<br />
aux résultats : Elsa (CM ) après avoir énuméré <strong>le</strong>s matières en fonction des jours ajoute<br />
« la maîtresse el<strong>le</strong> met des rouges, des verts ou des jaunes ou encore « j’aime bien tout<br />
sauf <strong>le</strong>s fractions, c’est dur ». Le travail en général peut faire peur. Marie (CE ) craint d’al<strong>le</strong>r<br />
dans la classe des grands en l’absence de sa maîtresse : « quand el<strong>le</strong> était en stage, ben tu<br />
devais al<strong>le</strong>r dans <strong>le</strong>s autres classes, donc on est encore avec des plus grands, ça, <strong>le</strong> travail<br />
qu’ils font, nous ça, on se dit “ben je vais pas savoir <strong>le</strong> faire” quoi ! ».<br />
Mélanie (CE ) est l’élève qui dit <strong>le</strong> plus de choses par rapport aux activités de son éco<strong>le</strong> « je<br />
faisais du foot dans l’autre éco<strong>le</strong> et il y avait aussi des cordes et des échasses et là il y en a<br />
aussi ». El<strong>le</strong> complète un peu plus loin mais ne dit pas pour autant ce qu’el<strong>le</strong> aime :<br />
« sinon avant on faisait du sport aussi, avant on allait dans un gymnase et on faisait des<br />
jeux, enfin dans une sal<strong>le</strong> on faisait des jeux, on faisait l’épervier par exemp<strong>le</strong> et dans une<br />
autre on faisait de la gym, on faisait de la poutre, on faisait p<strong>le</strong>in de choses, du trampoline<br />
aussi et maintenant c’est dans une sal<strong>le</strong>, on fait des jeux et dans l’autre on apprend à<br />
dribb<strong>le</strong>r, à faire du basket et tout ça ».<br />
El<strong>le</strong> décrit certaines activités en relation avec l’enseignant : « aussi on récite des poésies et<br />
la maîtresse el<strong>le</strong> nous en donne chaque semaine, dès fois el<strong>le</strong> nous dit de réviser la même<br />
parce qu’el<strong>le</strong> n’en a pas trouvé ». Une autre manière de présenter certaines activités est<br />
pour el<strong>le</strong>, de dire comment el<strong>le</strong>s sont organisées : « on reçoit un quotidien chaque jour et la<br />
maîtresse el<strong>le</strong> donne à un enfant et après il prépare pour <strong>le</strong> <strong>le</strong>ndemain pour <strong>le</strong> lire devant<br />
toute la classe. », « il y a aussi deux classes de CM2, et <strong>le</strong>s CM2 ils font une classe d’eau,<br />
ils étudient l’eau pendant toute l’année », « on a aussi un groupe pour <strong>le</strong>s livres de <strong>le</strong>cture, il<br />
y a un groupe qui a un livre et l’autre groupe qui en a un autre et quand un groupe est parti à<br />
l’informatique et ben avec l’autre on lit à voix haute avec la maîtresse », « sinon on fait des<br />
exposés et on emprunte des livres à la bibliothèque si on en a besoin ».<br />
Un deuxième groupe de remarques sur <strong>le</strong> travail scolaire s’organise autour des lieux. Les<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
activités scolaires sont présentées parfois comme un seul motif de par<strong>le</strong>r des sal<strong>le</strong>s ou de<br />
la décoration. C’était la seu<strong>le</strong> remarque de Nas par rapport à son éco<strong>le</strong> préférée. Nous<br />
avons vu Elsa associer art plastique et décoration Ce sera l’occasion pour Charlotte de dire<br />
que à l’éco<strong>le</strong> sur <strong>le</strong>s dessins « par exemp<strong>le</strong> on fait un cheval et en dessous on doit marquer<br />
cheval » mais que ses dessins el<strong>le</strong> ne <strong>le</strong>s accroche pas à l’éco<strong>le</strong> mais dans sa chambre.<br />
Il peut aussi être question des devoirs à la maison, des activités à l’extérieur de l’éco<strong>le</strong>, ou<br />
de cel<strong>le</strong>s qui peuvent avoir lieu <strong>le</strong> midi, mais aussi de ce qui se passe à la place de l’élève<br />
dans la classe. Cette dernière catégorie nous semb<strong>le</strong> intéressante dans <strong>le</strong> fait qu’el<strong>le</strong> n’a<br />
aucun équiva<strong>le</strong>nt à l’éco<strong>le</strong> F. Justine après avoir dit qu’el<strong>le</strong> n’aime pas al<strong>le</strong>r au tab<strong>le</strong>au ajoute<br />
« à l’éco<strong>le</strong> je préfère être à ma place ». Pour Flora (CM ) cette place prend une grande<br />
importance :<br />
« dans mon bureau y a des choses didd<strong>le</strong> 1 … et dans ma classe c’est mon monde c’est mon<br />
bureau, c’est mon monde parce que j’ai p<strong>le</strong>in de truc didd<strong>le</strong>… en plus j’ai un grand casier<br />
donc j’peux mettre mes affaires… si c’est mes pires ennemies, ben si y viennent à côté de<br />
moi y vont me traiter, y vont m’embêter y vont tricher sur moi… j’veux rester à ma place avec<br />
mes deux copines et puis c’est tout. ».<br />
Enfin quelques remarques mettent en relation travail et organisation de groupes d’élèves.<br />
Il s’agit des répartitions d’élèves par niveau. Mélanie explique : « et aussi il y a un CM2 qui<br />
vient lire avec <strong>le</strong>s CE1 parce que c’est un yougoslave et il apprend à lire, à par<strong>le</strong>r français<br />
et tout ça. Il y a aussi deux CE2 qui vont lire avec des CE1 parce qu’ils ont des difficultés<br />
aussi. » Tandis que Corentin (CE ) est lui-même concerné : « je suis en CE2 et je travail<strong>le</strong><br />
avec <strong>le</strong>s CE1 en math vu que j’ai des problèmes ». Cette situation à nouveau évoquée un<br />
peu après dans l’entretien est l’occasion pour lui de prendre un peu de recul par rapport à<br />
ses manières de faire certains types d’exercice – <strong>le</strong>s soustractions ici – qu’il serait prêt à<br />
expliquer immédiatement : « j’vais al<strong>le</strong>r en CM1 alors ça va être un petit peu dur à monter, à<br />
remonter à cause des difficultés de l’autre éco<strong>le</strong> et… mais j’arrive quand même à remonter<br />
avec <strong>le</strong>s maths en CE1, j’arrive quand même à faire <strong>le</strong>s maths en CE1… par exemp<strong>le</strong> j’peux<br />
al<strong>le</strong>r prendre une feuil<strong>le</strong> de papier pour al<strong>le</strong>r faire un… ».<br />
Il est intéressant de noter qu’il y a dans cet entretien la description plus complète de la<br />
manière de faire un exercice scolaire et qu’el<strong>le</strong> est en rapport avec la difficulté d’un élève.<br />
D’autres intérêts personnels entraîneront de la même manière des récits assez longs. Ainsi<br />
Elsa (CM ) semb<strong>le</strong> très heureuse de raconter <strong>le</strong> film vu avec sa mère et sa sœur sur <strong>le</strong>s<br />
licornes. Mais il n’est pas question de faire rentrer cette activité dans <strong>le</strong> cadre de la classe :<br />
« (tu as déjà dessiné des licornes en classe ?) non pas en classe on n’a pas <strong>le</strong> droit, j’ai<br />
dessiné chez moi (tu as déjà fait des dessins en classe ?) non jamais parce que la maîtresse<br />
el<strong>le</strong> va apprendre <strong>le</strong> dessin et l’arracher on n’a pas <strong>le</strong> droit ».<br />
Aucun de ces élèves ne raconte comme à l’éco<strong>le</strong> F des moments vécus par tous <strong>le</strong>s élèves<br />
ensemb<strong>le</strong> comme <strong>le</strong>s recherches math, <strong>le</strong>s présentations de textes, ou encore <strong>le</strong>s échanges<br />
dans l’entretien. L’élève est seul face à une activité prévue pour tous. Il n’est pas non plus<br />
question pour lui de pouvoir dire ce qu’il trouve bien ou ce qu’il voudrait voir changer.<br />
Si la présentation des activités scolaires par <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> en pédagogie F. peut être<br />
mise en relation avec <strong>le</strong> mode d’exister du « je », (<strong>le</strong>s trois positions d’élèves déjà évoquées<br />
dans <strong>le</strong> paragraphe ), il faut toutefois préciser au point de départ qu’aucun élève dans une<br />
position de souffrance assez marquée n’est toutefois pas dans la même position que Nas<br />
ou Tom, trop envahis par cette souffrance et incapab<strong>le</strong>s de dire quelque chose des activités<br />
Didd<strong>le</strong> est la marque d’une peluche.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
scolaires.<br />
Rosine, pour qui la contrainte familia<strong>le</strong> s’exprime fortement à travers <strong>le</strong> régime alimentaire<br />
en provoquant un sentiment d’être sans va<strong>le</strong>ur, par<strong>le</strong> de ces moments qui la rejoignent<br />
dans ce qu’el<strong>le</strong> aime : la <strong>le</strong>cture solitaire grâce à la bibliothèque qui devient <strong>le</strong>cture aux<br />
petits, et de son plaisir dans cette organisation scolaire qui permet d’être autonome. Habib<br />
énumère des dispositifs : l’entretien, <strong>le</strong>s <strong>le</strong>ttres aux correspondants, <strong>le</strong>s ateliers, <strong>le</strong>s sports<br />
pratiqués avec l’éco<strong>le</strong>. Toutefois ce qu’il dit à l’entretien : « je par<strong>le</strong> euh qu’est-ce que j’ai<br />
fait, où je suis parti… », ne reste pas uniquement dans <strong>le</strong> domaine d’un échange en classe<br />
mais s’inscrit dans <strong>le</strong> travail scolaire : « (ça tu aimes bien <strong>le</strong> raconter aux autres ?) oui et là<br />
je fais une conférence sur la Turquie ». Pour Noura très inquiète des exigences de réussite<br />
scolaire qui semb<strong>le</strong>nt peser sur el<strong>le</strong>, <strong>le</strong> choix de livres et la <strong>le</strong>cture aux petits, est aussi un<br />
atout : « là c’est <strong>le</strong>s maternel<strong>le</strong>s qui nous avaient choisi l’histoire qu’on allait présenter, mais<br />
là c’est nous… j’aime bien lire donc je me suis beaucoup entraînée à ça… et puis aussi<br />
<strong>le</strong>s conjugaisons ça m’a beaucoup aidé à lire parce qu’il y a quelquefois… des mots que je<br />
comprenais pas par exemp<strong>le</strong> ‘chantent’ avec e-n-t ». Comme Habib el<strong>le</strong> par<strong>le</strong> des activités<br />
qu’el<strong>le</strong> voit fortement en lien avec sa vie : <strong>le</strong>s <strong>le</strong>ttres aux correspondants et <strong>le</strong> désir qu’el<strong>le</strong><br />
aurait de participer – si sa mère voulait – aux classes de découverte, la conférence sur <strong>le</strong><br />
tsunami qui débouche sur l’idée d’organiser une quête dans <strong>le</strong> quartier.<br />
Le cas des élèves ressentant une contrainte externe mais pour qui la pédagogie ouvre une<br />
brèche de liberté, va permettre de comprendre comment il est possib<strong>le</strong> de lutter contre la<br />
contrainte extérieure grâce à l’éco<strong>le</strong>. Des élèves comme Clélia ou Louise vont commencer<br />
par énumérer des activités scolaires, éventuel<strong>le</strong>ment en rapport avec <strong>le</strong>s sal<strong>le</strong>s où el<strong>le</strong>s<br />
ont lieu, mais ce qui fait jour ici de façon inattendue c’est <strong>le</strong> fait de lier activités scolaires et<br />
rapports entre élèves. Ainsi Louise regrette que S engagé dans une conférence avec el<strong>le</strong><br />
passe beaucoup de temps à une autre activité en arts plastiques : « je lui ai dit “si tu veux<br />
faire la conférence, ben prépare la conférence” » et s’engage el<strong>le</strong>-même à aider G : « G<br />
tout à l’heure comme el<strong>le</strong> avait fini sa conférence, el<strong>le</strong> faisait toute seu<strong>le</strong>, sur <strong>le</strong>s perruches,<br />
alors el<strong>le</strong> avait pas d’idée, je lui ai donné une idée de faire sur <strong>le</strong>s dents, el<strong>le</strong> la fait tout<br />
à l’heure, je vais chercher des documents avec el<strong>le</strong> ». Il en est de même pour Raïssa et<br />
Boris dont nous avons déjà parlé. Avant de raconter sa conférence sur <strong>le</strong>s dinosaures et<br />
d’évoquer <strong>le</strong>s vacances avec son père, Raïssa dit d’abord « J’aime bien faire musique avec<br />
mes copains puis mes copines, ou des textes ou des conférences ou des trucs comme ça »<br />
puis el<strong>le</strong> expliquera comment fonctionne la préparation et la présentation : « on fait des<br />
paragraphes de paro<strong>le</strong>s… on présente… on pose des questions et après on vote… » On se<br />
souvient que Boris appréciait aussi la <strong>le</strong>cture aux petits « ça m’a fait du bien… ils cherchent<br />
à savoir… quand on lit une page des fois ils nous demandent quelque chose et j’aime bien<br />
quand on est curieux de savoir quelque chose » Mais cela n’est pas vrai que d’une relation<br />
dissymétrique : grands/petits puisque dans la classe cela peut aussi se produire : « là tu<br />
peux dire ce que tu penses du texte des autres pour améliorer par exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong> texte » Il est<br />
aussi important de noter qu’en présentant ce que j’ai appelé des comparaisons spontanées<br />
entre « l’éco<strong>le</strong> d’avant » et « l’éco<strong>le</strong> ici », ces élèves décrivent la manière de pratiquer ces<br />
activités scolaires, et l’apprentissage qui en résulte pour eux. Ainsi Boris souligne un mode<br />
d’apprentissage : « on sort, je trouve que c’est bien d’apprendre comme ça en fait… que<br />
comparé à avant… en regardant eu faux sur un tab<strong>le</strong>au noir », ce à quoi va aussi souscrire<br />
Rose d’une autre manière : « dans mon ancienne éco<strong>le</strong> on n’avait pas de correspondants<br />
et dans cette éco<strong>le</strong>-ci on en a… par exemp<strong>le</strong> on correspond même avec un autre pays,<br />
au Sénégal, l’éco<strong>le</strong> de Diaouar et je trouve que c’est bien comme ça on peut découvrir<br />
d’autres pays et d’autres régions et sans forcément étudier sur <strong>le</strong>s cartes et tout, dans <strong>le</strong>s<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
documents ». Boris montre encore comment <strong>le</strong>s recherches math permettent de comprendre<br />
<strong>le</strong>s choses en <strong>le</strong>s « découvrant » : « j’ai fait sur des kilomètres par exemp<strong>le</strong>, enfin sur <strong>le</strong>s<br />
mètres enfin <strong>le</strong>s longueurs… un kilomètre ça fait ça de mètres… et j’ai découvert maintenant<br />
qu’il y a <strong>le</strong> décamètre et <strong>le</strong> hectomètre ».<br />
Quant aux trois élèves présentées comme heureuses dans l’éco<strong>le</strong> F, même si cela n’empêche<br />
pas certaines ombres d’exister comme nous l’avons vu avec Inès, il est étonnant de constater<br />
qu’une grande majorité des énoncés concernant ces activités scolaires sont aussi reliés<br />
aux rapports aux autres, ceci englobant <strong>le</strong>s pairs mais aussi <strong>le</strong> maître. Un point commun<br />
<strong>le</strong>s rassemb<strong>le</strong> dans cette manière de présenter ces activités scolaires : toute présentation<br />
d’une activité scolaire met l’accent sur un mode de travail. Une activité scolaire ne peut être<br />
décrite seu<strong>le</strong>ment par son résultat (atteint ou à atteindre). El<strong>le</strong> ne peut être évoquée sans<br />
caractériser la méthode.<br />
Odi<strong>le</strong> par<strong>le</strong> d’abord de cette méthode en soi « j’aime mieux ici parce il y a moins de<br />
personnes… du coup on est moins gêné par <strong>le</strong> bruit,… je trouve qu’ici on est plus autonome<br />
je trouve ça bien parce que ça nous apprend à se repérer et puis on ne travail<strong>le</strong> pas de la<br />
même manière… on a un plan de travail ». À la question de savoir l’endroit où el<strong>le</strong> se sent<br />
<strong>le</strong> mieux, la réponse est nuancée : « ben ça dépend pour faire quoi aussi, quand on travail<strong>le</strong><br />
en individuel ou en col<strong>le</strong>ctif ? » Les précisions viennent : « quand je suis en individuel pour<br />
faire des conférences et qu’on va chercher des livres… ici en BCD c’est bien parce qu’il y a<br />
beaucoup de place, il y a des tab<strong>le</strong>s… sinon en col<strong>le</strong>ctif ben dans la classe c’est bien aussi…<br />
ou bien dans la sal<strong>le</strong> d’exposés parce qu’il y a un projecteur ». Pour Inès, la méthode est<br />
aussi évoquée dès <strong>le</strong> début de l’entretien « je me sens mieux qu’à mon ancienne éco<strong>le</strong> parce<br />
que la méthode déjà je préfère », la méthode ce sera <strong>le</strong> quoi de neuf qui permet de par<strong>le</strong>r<br />
« des événements importants sans se faire crier dessus » mais c’est surtout la méthode des<br />
recherches mathématiques qu’el<strong>le</strong> va d’abord opposer à ce que d’autres font, en s’appuyant<br />
sur ce que <strong>le</strong> maître dit : « je me suis quand même vite habituée à la méthode Freinet parce<br />
que comment dire, parce que déjà ça explique beaucoup mieux. Le maître il m’avait dit que<br />
avant, dans d’autres éco<strong>le</strong>s que la méthode F, ben pour apprendre <strong>le</strong>s divisions, ben <strong>le</strong>s<br />
élèves ils comprenaient pas du tout la méthode qu’ils faisaient ». Méthode pour apprendre,<br />
que Rose va résumer en disant « je dirais que c’est un très bon système et que ça permet<br />
d’apprendre en s’amusant ». Pour Odi<strong>le</strong> et Rose <strong>le</strong> plan de travail a l’avantage de ne pas<br />
devoir attendre <strong>le</strong>s autres. Or <strong>le</strong>s attendre exigeait de cette élève de grande section de<br />
maternel<strong>le</strong>, en avance, d’attendre des élèves de CP… plus grands sans rien faire et sans<br />
par<strong>le</strong>r… <strong>le</strong> discours d’Odi<strong>le</strong> révè<strong>le</strong> de manière cachée qu’il s’agit là d’un mauvais souvenir<br />
dont el<strong>le</strong> peut seu<strong>le</strong>ment dire : « ici je peux commencer un autre travail et tout, donc c’est<br />
mieux quoi ». Rose ajoute de manière plus enjouée « quand j’ai fini, j’ai encore du travail,<br />
on s’ennuie jamais en fait ici »<br />
À travers ce mode de travail, une relation particulière aux autres s’instal<strong>le</strong>, et ce que décrit<br />
Odi<strong>le</strong> est tout à fait différent de ce qu’ont pu raconter des élèves en difficultés dans <strong>le</strong>s<br />
autres éco<strong>le</strong>s :<br />
« on fait des créations maths en ce moment chacun en a inventé puis on <strong>le</strong> montre et puis<br />
on a <strong>le</strong> droit de rien dire et <strong>le</strong>s gens ils font des remarques sur ça, on dit “ah je sais pas,<br />
peut-être, peut-être pas” et puis au bout d’un moment et ben à la fin on doit dire et puis on<br />
montre et puis on peut bien expliquer et si il y a des enfants qui ne comprennent pas, ils<br />
disent – que à l’ancienne éco<strong>le</strong> c’était “tu comprends pas, ben fallait écouter” et c’est tout –<br />
alors que ici quelqu’un réexplique pour el<strong>le</strong> et voilà donc c’est mieux parce qu’on peut mieux<br />
comprendre, si on a, si on était de faire quelque chose d’autre, même si on n’aurait pas du,<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
et ben comme ça, on peut vraiment comprendre ce qui s’est passé ».<br />
Les relations qui s’établissent ainsi à travers <strong>le</strong>s activités scolaires n’excluent pas <strong>le</strong> maître<br />
sans pour autant lui donner une place de premier plan. On pourrait dire qu’il est lui aussi<br />
inclus dans <strong>le</strong> dispositif qui réorganise à la fois <strong>le</strong>s apprentissages et <strong>le</strong>s relations aux autres.<br />
C’est ce que décrit Rose à propos des mathématiques ou des textes : « en travail col<strong>le</strong>ctif<br />
avant on prenait dans des bouquins et tout, bon ici aussi mais ici aussi, moi par exemp<strong>le</strong> j’ai<br />
fait une recherche math <strong>le</strong> maître il va la prendre puis on va faire dessus on va faire un travail<br />
col<strong>le</strong>ctif sur ma recherche mathématique à moi, on peut découvrir <strong>le</strong>s autres personnes<br />
parce qu’on sait <strong>le</strong>ur recherche mathématique, <strong>le</strong>ur exposé… dans mon ancienne éco<strong>le</strong>…<br />
on ne connaissait pas plus que ça <strong>le</strong>s autres élèves, ici on peut <strong>le</strong>s découvrir plus grâce aux<br />
textes ».<br />
0<br />
3.2. Les relations élèves/adultes<br />
Dans <strong>le</strong>s autres éco<strong>le</strong>s par<strong>le</strong>r de sa relation à l’adulte consiste essentiel<strong>le</strong>ment à dire ce<br />
que l’élève aime ou n’aime pas dans cette relation. Cela peut al<strong>le</strong>r de l’adulte décevant<br />
à l’adulte fortement investi, que l’élève a du mal à quitter. Les relations adultes/enfants<br />
vont donc se présenter à l’inverse de la première catégorie constituée autour des activités<br />
scolaires, où <strong>le</strong>s élèves citaient ces activités sans s’attarder sur <strong>le</strong>urs propres sentiments,<br />
ce qui laisse prévoir de grandes différences entres <strong>le</strong>s élèves des autres éco<strong>le</strong>s et ceux de<br />
l’éco<strong>le</strong> Freinet.<br />
L’adulte dont il est question dans la plupart des cas est bien évidemment l’enseignant. Ce qui<br />
provoque cet investissement est parfois décrit en termes d’appréciation de la présentation<br />
de l’adulte. Flora passe sans transition de la sal<strong>le</strong> d’art plastique à la présentation d’une<br />
enseignante :<br />
« ben on a arrêté l’art plastique mais on revient quand même dans la sal<strong>le</strong> pour la bibliothèque.<br />
El<strong>le</strong> a des mèches un peu noires, et c’est une moderne. Une prof moderne (moderne ?) oui<br />
el<strong>le</strong> mettait des jupes et… el<strong>le</strong> mettait souvent des jupes avec des bottes à talons, el<strong>le</strong> avait<br />
<strong>le</strong>s cheveux tout <strong>le</strong> temps détachés. El<strong>le</strong> laissait tout <strong>le</strong> temps ses cheveux longs. Toi ça<br />
va, y sont courts ! Moi j’aime pas quand y sont détachés sinon, si y a des poux ou quelque<br />
chose comme ça… des fois on sait pas, y a des maîtres et des maîtresses y ont des poux…<br />
et puis à l’éco<strong>le</strong> avec son p’tit sac à main là ! et c’est vrai que ça fait bizarre parce que SC<br />
c’était pas des profs comme ça. C’était une prof bien habillée. El<strong>le</strong> avait tout <strong>le</strong> temps des<br />
pantalons, des bottes. Et puis <strong>le</strong>s cheveux tout <strong>le</strong> temps attachés… ».<br />
Faut-il y voir éléments en écho à un jugement porté par la famil<strong>le</strong> sans que cela soit dit<br />
explicitement, ou l’expression cachée d’un fort regret de la « maîtresse d’avant » ?<br />
Beaucoup de remarques d’élèves sont en rapport avec l’ambiance de la classe et notamment<br />
au fait de crier ou pas – <strong>le</strong> mot pouvant être entendu dans <strong>le</strong>s deux sens : crier consiste à<br />
faire du bruit ou crier est synonyme de reprocher quelque chose à l’élève… : « en classe<br />
el<strong>le</strong>, el<strong>le</strong>, el<strong>le</strong> nous, el<strong>le</strong> nous crie et euh par exemp<strong>le</strong> une fois el<strong>le</strong> avait crié ma copine »<br />
Lucie semb<strong>le</strong> très émue au souvenir de sa copine qui s’est mise à p<strong>le</strong>urer. De la même façon<br />
el<strong>le</strong> dit craindre <strong>le</strong> directeur : « des fois quand on, on court pas vraiment dans <strong>le</strong>s escaliers,<br />
on doub<strong>le</strong> <strong>le</strong>s marches et ben il crie » et la même remarque revient une troisième fois : « pis<br />
des fois je me fais crier euh parce que je demande à ma voisine mon, ses ciseaux alors<br />
que, alors je… » De la même façon Flora compare une maîtresse à une autre : « comme là<br />
avant el<strong>le</strong> nous criait dessus tout ça ». Il en est de même pour Justine : « F on l’entendait<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
jamais crier », qui en expose <strong>le</strong>s conséquences : « et moi j’aime pas quand ça crie, y a une<br />
meil<strong>le</strong>ure ambiance dans la classe. Si ça crie, t’as pas envie de travail<strong>le</strong>r. Moi je suis à côté<br />
de Julie en classe… en tout cas toutes <strong>le</strong>s deux on se dit que c’est nul quand ça crie car<br />
après ça nous énerve aussi ».<br />
Mais il est aussi question de ces nombreuses relations enseignant/élève qui organisent <strong>le</strong><br />
temps et l’espace. Là encore <strong>le</strong>s remarques à ce propos vont donner lieu à des jugements : <strong>le</strong><br />
maître est aimé ou pas en fonction de ses manières de distribuer <strong>le</strong> temps. Flora n’apprécie<br />
pas qu’il y ait eu un changement d’horaire, qui désorganise la régularité : « à SC c’était<br />
8h30-11h30 et l’après-midi 13h30-16h30 ». Pour Lucie cela semb<strong>le</strong> étrange : « une autre<br />
fois avec la maîtresse on avait cherché des informations sur Versail<strong>le</strong>s comme on avait<br />
été <strong>le</strong> visiter, <strong>le</strong> château. Et pis la maîtresse el<strong>le</strong> demande… si on peut rechercher des<br />
informations sur Versail<strong>le</strong>s. Moi j’en ai eu et puis euh je voulais lui, je voulais lui donner et<br />
puis el<strong>le</strong> m’a dit d’al<strong>le</strong>r m’asseoir alors, euh, j’ai pas eu <strong>le</strong> temps d’al<strong>le</strong>r lui donner ! »<br />
Le maître est celui qui peut choisir sa place dans l’espace et qui gère l’espace de l’élève. Pour<br />
Flora (CM ), cela semb<strong>le</strong> avoir beaucoup de conséquences : « y a tout p<strong>le</strong>in de chaises, y<br />
a des rangées de chaises. Devant y a un bureau où c’est la prof d’art plastique qui s’y met.<br />
Et y a des rangées de chaises… moi j’suis tout <strong>le</strong> temps au deuxième rang et c’est chiant<br />
parce que… j’aime pas parce qu’el<strong>le</strong> est petite déjà… el<strong>le</strong> est petite et y’a… <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au y<br />
fait la porte et… quand la maîtresse el<strong>le</strong> écrit, on voit pas trop bien ce qu’el<strong>le</strong> écrit et c’est<br />
beaucoup serré ».<br />
Le maître ou la maîtresse est aussi celui qui peut initier des activités particulières. Flora<br />
exprime encore ses regrets : « on faisait des trucs pour la fête des mamans… on faisait plus<br />
de trucs, on faisait des trucs… des machins… des… pots de sab<strong>le</strong> colorés, on faisait p<strong>le</strong>in<br />
de trucs. On apprenait plus que Q. Là Q el<strong>le</strong> est partie la dame et on n’apprenait presque<br />
rien, on n’a rien fait ».<br />
En définitive l’enseignant est celui qui exige. Il peut même exiger quelque chose qui n’est<br />
pas dans la continuité de la matière en cours, que l’élève n’aime pas faire ou ne sait pas<br />
faire. Ainsi en est-il pour Lucie :<br />
« c’était une maîtresse qui nous faisait biologie mais c’est parce qu’el<strong>le</strong> a eu un enfant donc<br />
maintenant c’est un maître, pis il est un peu plus sévère que la maîtresse… la dernière<br />
fois il, j’avais fini d’écrire euh <strong>le</strong> truc fin, <strong>le</strong>, la, la feuil<strong>le</strong> euh, fin ce qu’on devait écrire et<br />
euh comme j’avais fini, que je lui avais montré il m’a demandé si je savais pas quoi faire<br />
et pis il m’a donné des, des, hum divisions à faire alors que je savais pas <strong>le</strong>s faire quoi ».<br />
L’élève peut avoir une idée sur ce qui pousse l’enseignant à agir ainsi. Justine est envoyée<br />
au tab<strong>le</strong>au : « El<strong>le</strong> interroge toujours Julie ou moi parce qu’on est <strong>le</strong>s meil<strong>le</strong>ures pour al<strong>le</strong>r<br />
au tab<strong>le</strong>au mais el<strong>le</strong> sait que j’aime pas ». On a vu Elsa dire à propos des licornes que la<br />
maîtresse interdisait de dessiner et pourrait arracher <strong>le</strong>s dessins. Mais l’exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong> plus fort<br />
est donné par Corentin, pour qui <strong>le</strong> non-savoir devient objet public d’humiliations : « il disait<br />
à toute la classe que j’avais fait euh, que j’avais fait cette erreur là. Et ça fait que j’arrivais<br />
plus à travail<strong>le</strong>r et… et il continuait. En fait il criait à toute la classe que euh… j’ai fait cette<br />
erreur là… Il y avait un aussi, un autre euh… quiiii était comme ça, qui avait <strong>le</strong>s mêmes<br />
difficultés que… ben il faisait aussi, il faisait <strong>le</strong> même coup euh… à lui aussi… ben en fait à<br />
tous ceux qui avaient des problèmes et ben euh… il faisait ça… ça fait que toute la classe<br />
rigolait. »<br />
Corentin explique ici non seu<strong>le</strong>ment que <strong>le</strong> maître « disait à toute la classe » mais qu’il ne<br />
l’aidait pas, contrairement à ce qu’il va trouver dans la nouvel<strong>le</strong> éco<strong>le</strong>. Ce qu’il préfère dans<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
cette nouvel<strong>le</strong> éco<strong>le</strong> c’est « surtout <strong>le</strong>s maîtresses parce que euh… el<strong>le</strong>s aident au moins.<br />
Euh <strong>le</strong>s maîtresses… j’sais pas comment dire ça, euh… on est beaucoup aidé en fait, à ceux<br />
qui ont des difficultés… » Cette aide est donc la caractéristique de certains enseignants :<br />
« on avait une maîtresse, el<strong>le</strong> s’appelait F. el<strong>le</strong> était génia<strong>le</strong> parce qu’el<strong>le</strong> s’occupait de nous.<br />
Si on comprenait pas un exo, y suffisait de l’appe<strong>le</strong>r et el<strong>le</strong> te réexpliquait ». El<strong>le</strong> peut aussi<br />
être en rapport avec <strong>le</strong>s difficultés. Elsa (CM ) dit « j’aime tout sauf <strong>le</strong>s fractions c’est dur…<br />
par exemp<strong>le</strong> t’as un gâteau et tu <strong>le</strong> coupes en deux… ça, ça va mais après c’est dur…<br />
quand on décompose la fraction je sais pas <strong>le</strong> faire (comment tu fais alors ?) et ben quand<br />
on a faux la maîtresse el<strong>le</strong> explique el<strong>le</strong> fait un rond et el<strong>le</strong> dit “je vais t’aider”… y’a que<br />
moi qui sais pas faire <strong>le</strong>s fractions… mais c’est pas grave c’est comme <strong>le</strong>s divisions… mon<br />
père y m’a dit “on va <strong>le</strong> faire”… alors j’ai su <strong>le</strong> faire ». L’aide est donc un choix particulier de<br />
certains enseignants, sinon el<strong>le</strong> reste cantonnée dans <strong>le</strong> domaine privé : « (il y a que ton<br />
père et la maîtresse qui t’aident ?) j’ai aussi ma voisine Coralie, c’est une copine et el<strong>le</strong>, el<strong>le</strong><br />
m’aide aussi car el<strong>le</strong>, el<strong>le</strong> sait bien <strong>le</strong>s fractions ».<br />
Ainsi peut-on amorcer une autre façon de présenter <strong>le</strong>s relations enseignant/élèves. Le<br />
meil<strong>le</strong>ur souvenir de Marie est lié à la rencontre d’une nouvel<strong>le</strong> maîtresse :<br />
« quand on découvre une nouvel<strong>le</strong> maîtresse, on la découvre dans sa gentil<strong>le</strong>sse plutôt que<br />
dans sa sévérité. Les premiers jours, quoi, parce qu’à la fin, tu l’as découvert et donc euh,<br />
vivement que je découvre une autre ! (donc pour toi, <strong>le</strong>s maîtresses, el<strong>le</strong>s sont gentil<strong>le</strong>s<br />
au début mais méchantes à la fin ?) non, el<strong>le</strong>s sont toujours pareil<strong>le</strong>s, mais bon, pour <strong>le</strong>s<br />
méchants… enfin pour <strong>le</strong>s méchants, non pour <strong>le</strong>s enfants pas sages, qui sont embêtants<br />
et tout, ben pour eux, la maîtresse el<strong>le</strong> est oh el<strong>le</strong> est sévère, el<strong>le</strong> est sévère c’est sûr. Mais<br />
pour <strong>le</strong>s plus sages, ben el<strong>le</strong> est gentil<strong>le</strong> car el<strong>le</strong> a rien à dire ».<br />
Le rapport que fait Marie entre comportement des élèves et relation à la maîtresse a aussi<br />
à voir avec <strong>le</strong> résultat visib<strong>le</strong> du travail : « <strong>le</strong>s maîtresses, el<strong>le</strong>s sont gentil<strong>le</strong>s. El<strong>le</strong>s classent<br />
bien. (el<strong>le</strong>s… quoi ?) el<strong>le</strong>s classent bien et je ne dis pas ça parce que je suis première de la<br />
classe. El<strong>le</strong>s classent bien parce que par exemp<strong>le</strong> L, il avait un centième de moins que moi<br />
et donc, il était bien en dessous de moi ».<br />
On pourrait donc dire que l’enseignant a plusieurs cordes à son arc dans sa relation à<br />
l’élève, il peut exiger, aider ou rabaisser. Il peut établir des relations personnel<strong>le</strong>s à certains<br />
élèves. Presque tous <strong>le</strong>s élèves ont ainsi <strong>le</strong>ur souvenir de relations fortes : « j’aime bien ma<br />
nouvel<strong>le</strong> éco<strong>le</strong>, j’ai une gentil<strong>le</strong> maîtresse en plus, el<strong>le</strong> s’appel<strong>le</strong> Madame D. el<strong>le</strong> au moins,<br />
el<strong>le</strong> crie pas à toute la classe que Corentin a fait cette erreur ».<br />
Désir qui peut encombrer <strong>le</strong> conscient, voire l’inconscient : rêver que la maîtresse l’interroge<br />
sur <strong>le</strong> tsunami est-il de l’ordre du rêve ou du fantasme pour Marie dont <strong>le</strong>s parents sont<br />
professeurs de sciences ?… Dans d’autres cas, il peut être rassurant de se raccrocher<br />
à un élément rationnel : « À G2 quand on fêtait notre anniversaire la maîtresse el<strong>le</strong> nous<br />
donnait toujours une petite statuette ou n’importe quoi. Mais c’était que quand j’étais au<br />
CE1. Mais c’est pas grave parce qu’après on aura <strong>le</strong>s cadeaux par la famil<strong>le</strong> » (Mélanie). La<br />
maîtresse est gentil<strong>le</strong>, mais el<strong>le</strong> peut être à partager : « j’laime bien mais quelquefois quand<br />
el<strong>le</strong> s’énerve, el<strong>le</strong> est pas… très gentil<strong>le</strong> et pis el<strong>le</strong> a une fil<strong>le</strong> qui vient tous <strong>le</strong>s soirs dans,<br />
dans la classe quand el<strong>le</strong> a fini ses cours et euh ben el<strong>le</strong> fait ses devoirs quand on est à<br />
l’étude » (Lucie).<br />
Pour Elsa (CM ), ces relations personnel<strong>le</strong>s semb<strong>le</strong>nt prendre beaucoup de place : « (la<br />
maîtresse) el<strong>le</strong> vient à côté de moi c’est bien, el<strong>le</strong> vient m’aider et el<strong>le</strong> aide <strong>le</strong>s autres et<br />
après el<strong>le</strong> revient vers moi, c’est bien ». C’est aussi <strong>le</strong> cas pour la piscine : « tous <strong>le</strong>s jeudis<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
je fais de la piscine, je sais pas nager, alors madame m’apprend… avec Mme X. j’ai nagé et<br />
après j’ai failli me noyer mais el<strong>le</strong> m’a rattrapé… Après y a une bal<strong>le</strong> des fois on va dans <strong>le</strong><br />
petit bassin pour lancer la bal<strong>le</strong> au fond et il faut la rattraper au fond, moi je sais la rattraper<br />
au fond et madame est contente de moi ». La reconnaissance des dessins par la maîtresse<br />
<strong>le</strong>ur donne une grande va<strong>le</strong>ur : « on donne à la maîtresse et la maîtresse <strong>le</strong> met sur <strong>le</strong><br />
mur, je suis contente quand el<strong>le</strong> met mon dessin sur <strong>le</strong> mur ». La maîtresse est aussi cel<strong>le</strong><br />
qui peut comprendre <strong>le</strong>s problèmes de l’enfant. Ainsi Justine qui a peur du noir, sans dire<br />
exactement pourquoi dans l’entretien, par<strong>le</strong> de sa première maîtresse : « Une fois avec la<br />
maîtresse que j’aime bien, el<strong>le</strong> disait que c’était normal que tout <strong>le</strong> monde avait peur du noir<br />
alors je suis rassurée ». Justine garde <strong>le</strong> si<strong>le</strong>nce après cette remarque, contrairement à son<br />
habitude.<br />
En résumé l’enseignant est donc celui qui a la maîtrise des bonnes relations avec l’élève<br />
ou pas. Il est aimé en fonction de cela. Il est aussi celui qui aide ou pas. C’est dire que<br />
beaucoup de remarques vont s’inscrire dans ce registre du pouvoir. Le maître a du pouvoir<br />
sur l’élève… Il a <strong>le</strong> pouvoir de demander à l’élève quelque chose que celui-ci n’aime pas et<br />
même de l’exiger en sachant que cet élève n’aime pas. Il a aussi <strong>le</strong> pouvoir d’aider ou de<br />
« protéger » cet élève à condition que celui-ci <strong>le</strong> mérite.<br />
D’autres adultes apparaissent dans <strong>le</strong> cadre de l’éco<strong>le</strong>, assimilés plus ou moins par <strong>le</strong>s<br />
enfants au corps enseignant, ce sont <strong>le</strong>s personnels de cantine. Ainsi Lucie (CM ) : « où je<br />
me sens pas bien c’est à la cantine… je me sens pas bien parce que euh, des fois el<strong>le</strong> nous<br />
force à manger, là, cel<strong>le</strong>, euh la dame qui surveil<strong>le</strong> et pis ils nous obligent à goûter aussi<br />
quand on n’aime pas du tout et moi j’aime pas <strong>le</strong> fromage et pis euh une fois el<strong>le</strong> m’avait fait<br />
goûter et pis euh j’ai recraché dans mon assiette » Sont aussi évoquées de manière indirecte<br />
<strong>le</strong>s personnes qui sont responsab<strong>le</strong>s de la propreté des locaux. Les enfants paraissent très<br />
sensib<strong>le</strong>s à cet aspect comme re<strong>le</strong>vant d’une marque d’intérêt pour eux : « à SC c’était tout<br />
<strong>le</strong> temps nettoyé, y’avait beaucoup de femmes de ménages, nos tab<strong>le</strong>s c’était bien nettoyé,<br />
c’était nickel <strong>le</strong>s carreaux aussi et puis ben, à terre c’est tout cracra, y a p<strong>le</strong>in de tâches »<br />
(Flora).<br />
Qu’en est-il de ces relations de l’élève au maître, à l’éco<strong>le</strong> F ? Comment <strong>le</strong>s élèves par<strong>le</strong>nt-ils<br />
de <strong>le</strong>ur maître ? La première réponse qui s’impose est que ce maître tient peu de place dans<br />
l’entretien, et ce, quel<strong>le</strong>s que soient <strong>le</strong>s trois positions d’élèves par rapport aux contraintes<br />
extérieures.<br />
Certains élèves vont décrire « <strong>le</strong>s activités » du maître : « notre maître il a un projecteur…<br />
puis avec son ordinateur il montre… on a regardé <strong>le</strong> diaporama des correspondants » ou<br />
encore « <strong>le</strong> lundi il y a Mr, mon maître qui fait un truc pour faire <strong>le</strong>s devoirs du soir ». Il peut<br />
aussi être question de la répartition des élèves dans <strong>le</strong>s différentes activités, répartition<br />
soumise aux décisions col<strong>le</strong>ctives : « en fait on avait décidé de faire… Ils font quelque<br />
chose en terre et nous en arts plastiques, ça fait qu’il y aurait <strong>le</strong> maître en terre ou en arts<br />
plastiques et Maxime… ».<br />
Mais la relation est très particulière : <strong>le</strong> maître qui peut être « on » propose quelque chose à<br />
« on » ou à « nous », comme <strong>le</strong> raconte Odi<strong>le</strong> : « ici on nous <strong>le</strong> donne (devoirs à la maison),<br />
on nous demande si on a tout compris, est-ce qu’on a besoin d’aide en quelque chose et<br />
puis <strong>le</strong> lundi soir… on a une feuil<strong>le</strong> d’entraînement toutes <strong>le</strong>s semaines et pour commencer<br />
la feuil<strong>le</strong> et que <strong>le</strong> maître il nous mette un peu sur des pistes ensuite on finit chez nous ».<br />
Dans ce contexte l’évaluation s’adresse à tous : « on est en CM1, l’année prochaine on sera<br />
en CM2 et puis après on va au collège, donc <strong>le</strong> maître il nous a dit “il faut un petit peu monter<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
pour montrer <strong>le</strong>s bul<strong>le</strong>tins au directeur du collège”, voilà » (Noura).<br />
L’ordre col<strong>le</strong>ctif, autrement dit l’autonomie est une base de cette relation : « quand on sera<br />
autonome Monsieur a dit par exemp<strong>le</strong> “si vous vou<strong>le</strong>z faire art <strong>le</strong> matin et ben vous cochez<br />
dans art” », ou encore « dans mes anciennes éco<strong>le</strong>s il fallait se déplacer avec la classe<br />
et ici, tandis que non, on peut se déplacer si on a prévu ça, on demande au maître », à<br />
l’inverse « il y a des croix sur <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au là-bas et ben dès qu’on par<strong>le</strong> fort et tout, <strong>le</strong> maître<br />
il nous enlève une croix » ou encore d’après Lucie « quand ils sont rouges, c’est <strong>le</strong> maître<br />
qui <strong>le</strong>ur apporte <strong>le</strong>s fiches… ».<br />
Cela n’empêche pas une attention personnel<strong>le</strong> aux élèves comme on l’a déjà vu avec Boris :<br />
« <strong>le</strong> maître il nous explique… il nous explique un peu <strong>le</strong>s techniques… aussi il essaie à<br />
chaque fois qu’on lance un truc, il nous dit “ah tu pourrais faire ça en fait avec ça” », mais<br />
ce n’est qu’à l’intérieur de cette organisation que <strong>le</strong> « je » profite de l’aide. Odi<strong>le</strong> <strong>le</strong> confirme<br />
à propos de cette organisation des devoirs, mais el<strong>le</strong> ne se contente pas de décrire une<br />
organisation comme si el<strong>le</strong> était extérieure à el<strong>le</strong>-même : « moi ça m’aide bien parce que<br />
moi en fait je commence quelque chose et je <strong>le</strong> finis pas, à chaque fois c’est comme ça,<br />
donc ça, ça m’aide parce qu’il y a un ordre ».<br />
L’explication de ce type de relation entre <strong>le</strong> maître et <strong>le</strong>s élèves tient au mode de<br />
fonctionnement pédagogique. Pour <strong>le</strong> mettre en évidence, deux types de rapprochement<br />
sont possib<strong>le</strong>s. D’une part <strong>le</strong>s élèves par<strong>le</strong>nt de ce qui se passe ail<strong>le</strong>urs. Ainsi Mélanie est<br />
déçue de l’intervention de son ancienne maîtresse. Pourquoi ne pas continuer à correspondre<br />
avec son ancienne classe, puisque ici la correspondance est valorisée comme une tâche<br />
scolaire ? Mais d’après sa copine, la maîtresse aurait dit « maintenant c’est pas grave, t’es<br />
là-bas » et Odi<strong>le</strong> compare : « <strong>le</strong> premier jour directement quand on était installé <strong>le</strong> maître<br />
il a demandé qui veut présenter l’entretien… dans mon ancienne éco<strong>le</strong>, en fait il y avait la<br />
maîtresse et <strong>le</strong>s élèves et el<strong>le</strong> disait “alors qui veut raconter son week-end ?” et <strong>le</strong>s élèves<br />
ils <strong>le</strong>vaient <strong>le</strong> doigt et el<strong>le</strong> interrogeait <strong>le</strong>s élèves et c’est tout ». À propos de l’utilisation de<br />
la BCD, <strong>le</strong> système est comparé à ce que demandent certains professeurs « ils nous disent<br />
“ben faut chercher” ». Quant à la comparaison avec ce qui se passe au collège, el<strong>le</strong> se<br />
résume en termes de « rapports affectifs » avec <strong>le</strong>s élèves : « je vais al<strong>le</strong>r dans un collège<br />
où il y a une classe qui vient du mouvement Freinet j’ai une copine qui y est, el<strong>le</strong> dit que c’est<br />
bien, que <strong>le</strong>s professeurs sont gentils ».<br />
Il peut aussi être intéressant d’écouter <strong>le</strong>s élèves par<strong>le</strong>r des remplaçants : <strong>le</strong> rapport semb<strong>le</strong><br />
éga<strong>le</strong>ment glisser sur un fond de tonalité affective. Louise apprécie qu’il y ait des « visiteurs<br />
« c’est bien parce que aussi des fois <strong>le</strong> maître ou <strong>le</strong>s remplaçantes eh ben ils ont beaucoup<br />
de choses à corriger, alors ils peuvent <strong>le</strong>s aider » Avec cette remplaçante il semb<strong>le</strong> que <strong>le</strong><br />
« je » puisse refaire surface : « avec la remplaçante on a fait un jeu ce matin, deux jeux et<br />
c’était en travail col<strong>le</strong>ctif en mathématiques et j’ai réussi parce que c’était avec <strong>le</strong>s nombres<br />
en fait el<strong>le</strong> marquait un chiffre, si el<strong>le</strong> disait par exemp<strong>le</strong> quatre mil<strong>le</strong> cinq cents, je devais<br />
marquer, je mettais l’étiquette… ». Pour Rosine s’instal<strong>le</strong>nt des regrets : « nous on a bien<br />
aimé M. F. on voulait qu’il reste encore avec nous mais il était obligé de partir,… avec lui bon<br />
on a fait un livre on fabriqué un livre avec lui et lui il lisait à chaque fois, et ben voilà après<br />
<strong>le</strong> plan de travail on faisait pas ça ». Mais pour Raïssa c’est dur de voir <strong>le</strong>s élèves qui ne<br />
respectaient pas <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s établies dans la classe : « c’était son premier stage puis ben à<br />
la fin el<strong>le</strong> a craqué… ils faisaient <strong>le</strong> chantier c’est pas bien il faut pas j’ai pas aimé ces trois<br />
semaines, ben si j’ai bien aimé pour la connaître parce qu’el<strong>le</strong> était très gentil<strong>le</strong> mais j’ai pas<br />
aimé au rapport à cause des garçons… »<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
En fait, <strong>le</strong>s remplaçants n’ont pas à <strong>le</strong>ur disposition la maîtrise de tous <strong>le</strong>s outils de la<br />
pédagogie Freinet. Or il s’agit bien de toute une organisation pédagogique qui s’interca<strong>le</strong><br />
entre <strong>le</strong> maître et l’élève, et n’est pas appuyée sur une seu<strong>le</strong> relation personnel<strong>le</strong> maître/<br />
élève.<br />
Là encore quelques exemp<strong>le</strong>s sont probants. Dans l’entretien Raïssa semb<strong>le</strong> étonnée que<br />
je lui demande si el<strong>le</strong> a parlé de sa situation familia<strong>le</strong> avec son maître habituel : « (M. X, lui<br />
il te comprend ?) je sais pas (tu sais pas ?) non j’ai jamais parlé de ça avec lui » Inès est<br />
aussi étonnée d’une question portant sur la réaction du maître quand ses stylos tombent.<br />
« (tu te fais crier ?) <strong>le</strong>s autres, ils me <strong>le</strong>s ramassent et je dis “merci” ». Noura, quant à el<strong>le</strong>,<br />
peut par<strong>le</strong>r longuement de son envie de devenir maîtresse : « j’aimerais bien faire maîtresse<br />
et bien expliquer aux enfants la vie plus tard… quand j’arrive pas à dormir la nuit et ben je<br />
pense dans ma tête comment je serai, comment je <strong>le</strong>ur expliquerai et tout ça j’aime bien<br />
faire maîtresse », sans pour autant qu’on ne la voit à aucun moment solliciter l’approbation,<br />
ou l’encouragement du maître. El<strong>le</strong> n’apparaît pas l’élève que d’autres nommeraient « la<br />
chouchou ».<br />
Jamais en définitive nous ne voyons ces élèves dire qu’ils aiment ou n’aiment pas ce maître<br />
ou cette maîtresse dans l’éco<strong>le</strong> Freinet, pas plus que nous ne <strong>le</strong>s voyons être rejetés, ou<br />
pris à parti publiquement. En revanche nous allons souligner dans <strong>le</strong> paragraphe suivant à<br />
quel point relations au maître et aux pairs sont reliées, via <strong>le</strong> travail scolaire.<br />
3.3. Les relations entre pairs<br />
Il semb<strong>le</strong> de façon généra<strong>le</strong> que dans <strong>le</strong>s autres éco<strong>le</strong>s on soit en présence d’individus<br />
juxtaposés. On peut trouver beaucoup d’énonciations en « je » en ayant <strong>le</strong> sentiment que<br />
<strong>le</strong>s autres sont presque inexistants ou alors que <strong>le</strong> rapport aux autres est vécu aussi en<br />
termes de pouvoir : qui aura <strong>le</strong> pouvoir sur l’autre ? À l’éco<strong>le</strong> F <strong>le</strong>s rapports entre <strong>le</strong>s élèves<br />
sont explicités, qu’il s’agisse de bons ou de mauvais rapports. C’est un thème aussi très<br />
argumenté.<br />
Un certain nombre de réf<strong>le</strong>xions montrerait des individus juxtaposés, qui ne se connaissent<br />
pas vraiment, sauf quand il s’agit d’une copine proche. Que l’élève dise « je » ou « on »,<br />
cela ne semb<strong>le</strong> pas changer grand-chose : il s’agit d’individus qui font <strong>le</strong>s mêmes choses<br />
mais n’échangent pas entre eux. C’est ainsi que Mélanie (CE ) énumérait <strong>le</strong>s différentes<br />
activités pratiquées en sport. Mais el<strong>le</strong> décrit de la même façon impersonnel<strong>le</strong> des activités<br />
d’échange : « el<strong>le</strong> nous a donné un livre la maîtresse pendant deux semaines, ben pendant<br />
<strong>le</strong>s vacances et c’est nous qui devons faire <strong>le</strong>s questions et on va envoyer, on va écrire <strong>le</strong>s<br />
questions et mettre <strong>le</strong>s réponses et la maîtresse el<strong>le</strong> corrigera <strong>le</strong>s fautes d’orthographe,<br />
ensuite quelqu’un écrira au propre <strong>le</strong>s questions et on enverra à l’autre classe de CE2 et eux<br />
aussi ils nous enverront <strong>le</strong>s questions et ça se fait par groupe de cinq ou de quatre ».<br />
Un indicateur nous paraît intéressant de cette disposition d’esprit : on a <strong>le</strong> sentiment que<br />
l’élève suppose ce que <strong>le</strong>s autres pensent, sans <strong>le</strong> savoir exactement. : « on n’apprenait<br />
presque rien, on n’a rien fait… la première semaine qu’on avait travaillé avec el<strong>le</strong>, on avait<br />
travaillé sur <strong>le</strong>s chevaux et ça plaisait pas j’pense. Moi ça me plaisait pas mais j’pense que<br />
<strong>le</strong>s autres ça plaisait pas non plus ». Même réf<strong>le</strong>xion à propos de chaises dans une sal<strong>le</strong> :<br />
« y’avait des nouvel<strong>le</strong>s chaises, <strong>le</strong>s tab<strong>le</strong>s y étaient bien rangées et tout <strong>le</strong> monde j’pense<br />
que ça <strong>le</strong>ur plaît maintenant » (Flora, CM ). Dans <strong>le</strong> même registre, on pourrait par<strong>le</strong>r des<br />
relations individuel<strong>le</strong>s qui excluent l’ensemb<strong>le</strong> des autres élèves. C’est ainsi que Flora définit<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
sa place : « nous c’est des tab<strong>le</strong>s comme ça aussi et on est quatre, non on n’est pas quatre,<br />
on est trois, on est une, deux, trois parce que là y a nos affaires qu’on met. Et là c’est ma<br />
place parce que c’est là c’est, c’est bien. On peut travail<strong>le</strong>r à trois et el<strong>le</strong>s sont sympas mes<br />
copines ». Puis après avoir dit que son bureau était son monde dans la classe ajoute : « y a<br />
d’autres gens qui peuvent venir euh, ceux que j’ai déjà dit. J’aimerais bien rester avec Z et S<br />
mes deux copines que j’ai à côté de moi parce que sinon ça peut être que quelqu’un d’autre<br />
qui vient, ben, je serais avec des garçons ou des fil<strong>le</strong>s que j’aime pas parce que c’est des<br />
fil<strong>le</strong>s qui me traitent et ça me plaît pas d’al<strong>le</strong>r avec eux ».<br />
Mais comme cela vient d’être amorcé, <strong>le</strong> plus grand nombre de remarques ayant trait<br />
aux relations entre pairs s’organise autour des luttes, des rivalités pour une place, et fait<br />
apparaître <strong>le</strong>s vio<strong>le</strong>nces, <strong>le</strong>s exclusions dont certains se sentent victimes. Ces vio<strong>le</strong>nces<br />
sont souvent symboliques : l’élève se sent incompris, rejeté, on se moque de lui. Il a « mal<br />
à l’éco<strong>le</strong> », comme <strong>le</strong> disait Elsa de son autre éco<strong>le</strong>, à cause de cela. Là encore on peut<br />
conclure à des formes de pouvoir engendrant frustrations et souffrances.<br />
L’élève est seul. C’est la crainte qui revient <strong>le</strong> plus fréquemment quand <strong>le</strong>s élèves par<strong>le</strong>nt<br />
du moment de changement d’éco<strong>le</strong>. Pour certains l’iso<strong>le</strong>ment persiste. Nous avons vu <strong>le</strong><br />
cas de Nas, Elsa <strong>le</strong> dit dans <strong>le</strong>s mêmes termes : « à l’autre éco<strong>le</strong> j’avais pas de copine,<br />
j’étais toute seu<strong>le</strong> ». Pour Corentin qui se sentait humilié par <strong>le</strong> maître c’est la même chose.<br />
Certains vont utiliser des manières détournées de dire cette peur due au changement : « je<br />
me sens bien c’est dans la cour parce que euh je peux retrouver ma sœur qui est en CM2<br />
et pis ma copine depuis <strong>le</strong> CE1 » (Lucie).<br />
L’élève ne se sent pas compris même quand il veut « faire bien ». Ainsi Lucie raconte « el<strong>le</strong><br />
à chaque fois, à chaque fois je fais rien, par exemp<strong>le</strong> euh, j’lui, par exemp<strong>le</strong> son manteau<br />
il était par terre et euh je lui ramasse pour pas… et pis après el<strong>le</strong>, je sais pas pourquoi pis<br />
el<strong>le</strong> me tape ».<br />
Les élèves craignent ceux qui <strong>le</strong>s « embêtent », c’est à dire qui gênent <strong>le</strong> travail, qu’ils soient<br />
dans <strong>le</strong>ur classe : « et pis y a une fil<strong>le</strong> aussi dans ma classe qui nous embête à chaque<br />
fois parce qu’el<strong>le</strong> par<strong>le</strong> heu avec ses voisines de devant et en fait el<strong>le</strong> nous embête parce<br />
qu’à chaque fois el<strong>le</strong> par<strong>le</strong> pis euh un moment el<strong>le</strong> crie quand même et pis pendant que<br />
la maîtresse el<strong>le</strong> nous, el<strong>le</strong> est en train de nous expliquer quelque chose et pis nous on<br />
comprend pas », ou qu’ils viennent d’une autre classe : « ceux qui font al<strong>le</strong>mand ils nous<br />
embêtent parce que heu ils frappent à la porte parce qu’ils sont… parce qu’ils eux ils ont fini<br />
quand nous on n’a pas encore fini ». Ils sont parfois des élèves « particuliers » : « il y en a<br />
aussi de G2 2 qui viennent, ils sont en CLIS et je ne m’entend pas très bien avec eux ; faut<br />
dire aussi qu’ils n’écoutent pas très bien <strong>le</strong> professeur et parfois on perd du temps à cause<br />
d’eux » (Mélanie, CE ).<br />
Mais ils craignent surtout <strong>le</strong>s situations qui <strong>le</strong>s mettent dans des positions de fragilité, ou<br />
d’humiliation, comme pour Justine <strong>le</strong> fait d’al<strong>le</strong>r au tab<strong>le</strong>au. « Tous <strong>le</strong>s regards sont sur soimême<br />
et puis ben, on se sent pas bien… J’aime pas être au centre. Tout <strong>le</strong> monde regarde<br />
et quand on fait une faute au tab<strong>le</strong>au ils se moquent ». Corentin raconte <strong>le</strong> souvenir de ce<br />
maître qui criait <strong>le</strong>s erreurs à toute la classe avec un air triste : « En fait il, il <strong>le</strong> disait à toute<br />
la classe, à, à propos de tous ceux qui ont des problèmes, il <strong>le</strong> criait à toute la classe, ça fait<br />
que toute la classe rigolait ». Lucie montre comment ce genre de faits instal<strong>le</strong> un mauvais<br />
climat dans <strong>le</strong> groupe de la classe. En technologie, des élèves en la poussant, el<strong>le</strong> a fait<br />
bouger la tab<strong>le</strong>, ce qui a provoqué <strong>le</strong> mélange des produits que <strong>le</strong> maître avait préparé. Mais<br />
Il s’agit d’un regroupement de classes.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
el<strong>le</strong> raconte aussi avec une certaine émotion comment se mettent en place des moqueries<br />
col<strong>le</strong>ctives retournées sur l’ensemb<strong>le</strong> de la classe à propos d’un élève « Y a des fil<strong>le</strong>s qui<br />
aiment pas un garçon parce qu’il est petit et il a une maladie des os, et euh quand ils <strong>le</strong><br />
touchent, ils, quand ils <strong>le</strong> touchent après, ils heu, enfin M. ils <strong>le</strong> touchent c’est celui qui a<br />
la maladie, eh ben euh, après euh ils nous touchent et pis ils disent “t’as la maladie de M”,<br />
alors que ça, c’est pas gentil quoi ».<br />
Les élèves craignent aussi <strong>le</strong>s grands et <strong>le</strong>s menaces physiques qu’ils représentent. À<br />
la question de savoir l’endroit qu’el<strong>le</strong> aime bien dans l’éco<strong>le</strong>, Marie répond en termes de<br />
« camp » et de peur : « vers la droite c’est pour <strong>le</strong>s plus grands et vers la gauche c’est pour<br />
<strong>le</strong>s plus petits. Donc euh quand on va vers <strong>le</strong>s plus grands on se sent plus bousculé » mais<br />
ajoute « ben, euh <strong>le</strong>s grands, y s’foutent de nous ! Y font n’importe quoi, quoi ! Ils nous<br />
poussent, ils font “on est <strong>le</strong>s plus grands, on fait n’importe quoi !” ça ce qu’ils disent » et si<br />
quelqu’un la pousse el<strong>le</strong> n’ose rien dire. De fait <strong>le</strong>s actes physiques sont aussi bien présents<br />
dans <strong>le</strong> quotidien des élèves entre eux. Elsa raconte ainsi son changement d’éco<strong>le</strong> : « ils<br />
arrêtaient pas de m’embêter, ils m’ont pris pour me faire mal et moi je me suis sauvée parce<br />
que sinon et… et… un autre jour ils m’ont griffé là… après ils m’ont tenue et m’ont fait mal…<br />
ils ont recommencé parce qu’ils m’ont pas eue… après j’ai eu peur et euh… on m’a changé<br />
d’éco<strong>le</strong> ». Pour Lucie ces coups là s’ajoutent à des b<strong>le</strong>ssures anciennes : « il y a une fil<strong>le</strong> en<br />
CE2 qui m’a tapée parce qu’en fait j’ai trois points de suture à mon genou là et pis el<strong>le</strong> m’a<br />
donné un coup de pied et ça s’est ouvert un petit peu. »<br />
Les entretiens avec <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet montre qu’autour des mêmes thèmes :<br />
relations positives ou propos portant sur <strong>le</strong>s copains et copines, relations négatives comme<br />
la peur des brutalités des garçons, des bagarres, ou des moqueries s’ouvrent deux voies<br />
très différentes dans ce quotidien.<br />
D’une part <strong>le</strong>s relations positives qui se tissent dans <strong>le</strong>s jeux partagés en récréation, <strong>le</strong> sport<br />
ou <strong>le</strong>s liens de quartier, vont être alimentées par des moyens de se connaître mieux et de<br />
se respecter, à l’intérieur du travail scolaire. On a déjà cité des propos d’élèves insistant sur<br />
<strong>le</strong>s méthodes pédagogiques permettant de mieux connaître <strong>le</strong>s autres : <strong>le</strong>s présentations de<br />
textes, <strong>le</strong>s conférences, <strong>le</strong>s recherches. De tels moyens d’apprentissage qui favorisent <strong>le</strong>s<br />
liens entre <strong>le</strong>s élèves ne sont absolument mentionnés dans <strong>le</strong>s autres éco<strong>le</strong>s.<br />
Il n’est pas question ici de connaissance supposée des avis ou des opinions des autres. Rien<br />
ne reste dans <strong>le</strong> non-dit : on se souvient de Boris s’interrogeant sur cette ligne qui empêche<br />
de par<strong>le</strong>r aux parents de l’autre coté de la gril<strong>le</strong> et on peut être étonné de l’entendre tenir<br />
un « propos d’adulte » à propos des deux éco<strong>le</strong>s primaire et maternel<strong>le</strong> : « ce qui me fait<br />
plaisir aussi c’est l’union des deux éco<strong>le</strong>s… (<strong>le</strong>s petits) écoutent des fois des choses fait par<br />
<strong>le</strong>s grands et tout et que <strong>le</strong>s, rien que pour une chora<strong>le</strong> <strong>le</strong>s CM2 ils vont en mat- que moi<br />
avant… ». De même tout peut se dire aux moments prévus pour la discussion « il y a une<br />
chose aussi très, très bien, je trouve pour l’éco<strong>le</strong> c’est <strong>le</strong>s réunions de classe et d’éco<strong>le</strong>…<br />
des enfants à chaque classe… qui par<strong>le</strong>nt, qui discutent des choses qui sont bien ou qui ne<br />
sont pas bien pour eux, après on discute dessus pour voter pour changer <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s, en fait<br />
en classe c’est pareil mais sinon en classe c’est plutôt ce qu’il y a à l’intérieur de la classe…<br />
j’aime bien ce procédé-là ». Dans <strong>le</strong> même ordre d’idées, on a vu plusieurs élèves par<strong>le</strong>r de<br />
<strong>le</strong>ur choix de livres pour la <strong>le</strong>cture aux plus petits, mais aussi et surtout de <strong>le</strong>ur plaisir à faire<br />
cette activité de <strong>le</strong>cture dont ils disaient grand bien pour <strong>le</strong>ur propre apprentissage.<br />
En résumé il semb<strong>le</strong> bien que dans cette éco<strong>le</strong> <strong>le</strong> plaisir compte et qu’il peut se dire.<br />
D’autre part, tout comme dans <strong>le</strong>s autres éco<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s relations entre pairs sont aussi<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
marquées par <strong>le</strong>s conflits, <strong>le</strong>s bagarre, <strong>le</strong> sentiment de rejet de la part des autres. Trois<br />
élèves paraissent particulièrement sensib<strong>le</strong>s : Raïssa, Rosine et Habib. Disons d’entrée de<br />
jeu que pour chacun d’eux, une issue s’ouvre cependant, même si el<strong>le</strong> reste peu développée<br />
dans <strong>le</strong>ur discours. Nous avons vu ce qu’il en était pour Raïssa lors des présentations<br />
de conférences. Pour Rosine, fortement emprisonnée dans un sentiment de non-va<strong>le</strong>ur<br />
personnel<strong>le</strong> et qui semb<strong>le</strong> dépendre des autres pour une bonne part de sa vie… c’est <strong>le</strong> fait<br />
d’être autonome. El<strong>le</strong> décrit l’installation du système des croix, des cou<strong>le</strong>urs pour insister sur<br />
<strong>le</strong> fait de posséder pour el<strong>le</strong>-même ce statut : « ma mère el<strong>le</strong> m’a inscrite parce que j’ai des<br />
problèmes et tout, alors moi je trouve que c’est bien et tout l’éco<strong>le</strong> et que quand on travail<strong>le</strong><br />
bien, on est autonome ». El<strong>le</strong> qui a tant de mal à dire ouvertement ce qu’el<strong>le</strong> ressent : « ma<br />
plus pire de la classe c’est Odi<strong>le</strong>, j’aime pas trop Odi<strong>le</strong> el<strong>le</strong> par<strong>le</strong> à chaque fois à l’entretien<br />
et on n’a jamais <strong>le</strong> temps de par<strong>le</strong>r nous, alors voilà c’est pas ma meil<strong>le</strong>ure copine, je l’aime<br />
pas trop, c’est ma plus pire de mes meil<strong>le</strong>ures copines » se raccroche à cette possibilité qui<br />
lui est donnée : « et moi j’étais jamais, j’étais tout <strong>le</strong> temps autonome vert ».<br />
Habib, qui semb<strong>le</strong> diffici<strong>le</strong>ment vivre des relations de classe, habitué qu’il est à se défendre<br />
par la bagarre en apprenant avec « (son) frère des bagarres pour arrêter <strong>le</strong>s gens et <strong>le</strong>s<br />
attraper » même s’il affirme que « après quand on se bagarre, après ça fait p<strong>le</strong>in de vio<strong>le</strong>nce<br />
et c’est à cause de ça que je bagarre pas trop » apprend pourtant qu’on peut demander<br />
quelque chose par la paro<strong>le</strong> et l’obtenir… comme changer de place plusieurs fois dans<br />
l’année ou être aidé :<br />
« je voyais pas bien au tab<strong>le</strong>au et… il est plus grand… je voyais pas bien au tab<strong>le</strong>au… la<br />
première place que j’ai pris, la deuxième place, la troisième place… comme en CM1 j’en<br />
avais changé au moins cinq fois… j’ai changé parce que des fois quand ils écrivent au<br />
conseil d’enfants que nous ben la classe, ben ils nous critiquent… et des fois je prends des<br />
aides des fois d’une fil<strong>le</strong> ou d’un garçon… ».<br />
Au-delà de ces cas particuliers, des procédés généraux de la pédagogie Freinet sont mis en<br />
avant par <strong>le</strong>s élèves, pour lutter et même prévenir ces dérives qui paraissent inévitab<strong>le</strong>s à<br />
certains enseignants. Le premier d’entre eux décrit par <strong>le</strong>s élèves revient à cette « qualité »<br />
de gêneur attribué à l’élève, qui entraîne pour lui une certaine mise à l’écart. Louise en<br />
explique <strong>le</strong> principe : « <strong>le</strong>s nouvel<strong>le</strong>s c’est <strong>le</strong> matin à huit heures et demie, on rentre et après<br />
il y a <strong>le</strong> responsab<strong>le</strong> de la paro<strong>le</strong>, c’est lui qui donne la paro<strong>le</strong> aux gens, aux enfants et il fait<br />
<strong>le</strong>s gêneurs : par exemp<strong>le</strong> si moi je par<strong>le</strong> et que <strong>le</strong>s gens ils font du bruit, ils sont gêneurs<br />
une fois » et Raïssa complète : « si on est gêneur soit aux présentations de livres, soit aux<br />
présentations de textes ou présentations de conférences, si on est gêneur deux fois, on<br />
perd une croix » Autrement dit ce n’est pas X ou Y qui « embête »… il y a « un gêneur »<br />
pour l’instant qui est debout et reprendra sa place comme X ou Y après… L’individu n’est<br />
pas assimilé à son comportement.<br />
L’organisation même, décrite par un certain nombre d’élèves : être autonome, pouvoir se<br />
déplacer dans la classe, al<strong>le</strong>r dans une autre sal<strong>le</strong>, en fonction du matériel qui s’y trouve<br />
ou pour préparer à deux une présentation, disposer de matériel en cas d’oubli, n’est pas<br />
qu’une organisation de la liberté de l’élève. El<strong>le</strong> apparaît aussi comme une organisation qui<br />
« tue dans l’œuf » certaines manifestations de vio<strong>le</strong>nce, émergeant du bruit, des rivalités<br />
en ce qui concerne <strong>le</strong> matériel, du manque de place et des débordements sur la place du<br />
voisin… Odi<strong>le</strong> présente une bel<strong>le</strong> argumentation de ce système en supposant une situation<br />
de bagarre :<br />
« s’il y a des bagarres ça veut dire que <strong>le</strong>s gens ils se disputent donc ça veut dire que <strong>le</strong>s<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
gens ils s’entendent pas bien donc c’est aussi peut-être à cause de l’endroit, ils aiment<br />
pas trop l’endroit, ou je sais pas… à mon avis c’est l’endroit où ils sont tous <strong>le</strong>s deux par<br />
exemp<strong>le</strong> il y a quelqu’un et quelqu’un d’autre et ben ils sont au même endroit et puis ils<br />
jouent chacun de <strong>le</strong>ur côté et puis ils se poussent et peut-être qu’ils croient qu’il n’y a pas<br />
assez de place donc ils sont serrés donc ils se poussent et tout sans faire exprès et après<br />
ils vont commencer une bagarre généra<strong>le</strong> ».<br />
Mais il ne s’agit pas d’un seul raisonnement par hypothèse (!) puisque une question la<br />
replonge el<strong>le</strong>-même dans une réalité à laquel<strong>le</strong> el<strong>le</strong> participe : « ben en fait nous on est<br />
comme ça des fois et puis on se par<strong>le</strong>, on se crie un peu dessus quoi ».<br />
Un autre élément favorab<strong>le</strong> au respect des autres se développe à travers <strong>le</strong>s métiers que<br />
chacun remplit à tour de rô<strong>le</strong>, et du plan de travail qui n’oblige pas tout <strong>le</strong> monde à al<strong>le</strong>r<br />
au même rythme et surtout à avoir envie de faire <strong>le</strong>s mêmes choses en même temps.<br />
L’organisation de l’espace et du temps est une responsabilité partagée par tous.<br />
Enfin <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> de la paro<strong>le</strong> est aussi primordial. Mais avant tout ce qu’il faut souligner c’est<br />
qu’il ne s’agit pas ici d’une paro<strong>le</strong> qui règ<strong>le</strong>… ou règ<strong>le</strong>rait des conflits ayant eu lieu, comme<br />
on semb<strong>le</strong> <strong>le</strong> penser en évoquant <strong>le</strong> pouvoir de la paro<strong>le</strong> avec un certain adage issu d’une<br />
émergence « psy » qui amènerait à penser que si chacun peut donner son point de vue sur<br />
<strong>le</strong> litige… <strong>le</strong>s choses vont s’arranger parce que chacun se sera senti entendu ! À l’éco<strong>le</strong><br />
Freinet, la paro<strong>le</strong> est une paro<strong>le</strong> de construction plus que de réparation des dégâts…<br />
On peut dire que Rose cherche <strong>le</strong>s bons arguments pour décrire comment se tisse ce travail<br />
qui lutte contre l’exclusion, au prix de bagarres passagères… réalité dont el<strong>le</strong> n’est pas plus<br />
que Odi<strong>le</strong>, absente… :<br />
« en fait je trouve dans cette éco<strong>le</strong> il y a beaucoup plus de chamail<strong>le</strong>s que dans mon<br />
ancienne éco<strong>le</strong> mais je trouve qu’il y a beaucoup plus de gens qui sont amis en fait, dans<br />
mon ancienne éco<strong>le</strong> il y en a qui restaient toujours tout seuls dans <strong>le</strong>ur coin, et là je vois<br />
que tout <strong>le</strong> monde est uni en fait, en quelque sorte ils sont tous copains <strong>le</strong>s uns <strong>le</strong>s autres,<br />
sauf ils se chamail<strong>le</strong>nt très souvent, mais après <strong>le</strong> <strong>le</strong>ndemain “oh tu es ma copine”… donc<br />
moi je trouve qu’il y a une bonne harmonie en fait mais en même temps ils se chamail<strong>le</strong>nt<br />
beaucoup, enfin je dis ‘ils’ mais moi aussi… il y a des élèves qui sont plus ‘bagarre’, il y en<br />
a d’autres qui sont plus “oh ta mère el<strong>le</strong> est pas bel<strong>le</strong> !” ou des choses comme ça en fait,<br />
il y en a qui sont plus ‘bagarre’ et plus ‘insulte’ et il y en a qui sont <strong>le</strong>s deux… Dans mon<br />
ancienne éco<strong>le</strong>, ça mettait deux, trois jours pour qu’on soit amis, on se faisait la tête et tout,<br />
ici on se dispute, <strong>le</strong> <strong>le</strong>ndemain c’est bon on est re-amis, donc c’est bien, ça évite de perdre<br />
des bons amis, voilà ».<br />
Trois éléments peuvent se dégager.<br />
Tout d’abord l’étude comparative des entretiens a fait ressortir ce que j’appel<strong>le</strong>rai <strong>le</strong> poids<br />
des éléments évoqués par <strong>le</strong>s élèves. Hors de la pédagogie F, lorsque <strong>le</strong> domaine familial<br />
revient fréquemment dans l’entretien, il peut occulter complètement toute expression du<br />
vécu à l’éco<strong>le</strong>, quel que soit l’âge (et la classe) de l’enfant. Si la séparation est trop forte,<br />
tout ce qui est dans une éco<strong>le</strong> est mauvais, et dans l’autre est bon, sans qu’émerge aucun<br />
élément autre ; si <strong>le</strong> poids de la souffrance ne peut être parlé, il semb<strong>le</strong> que <strong>le</strong>s enfants se<br />
vivent essentiel<strong>le</strong>ment comme victimes et que ce sentiment envahisse tout ce qui se passe<br />
à l’éco<strong>le</strong>. En clair on pourrait dire que l’éco<strong>le</strong> subit <strong>le</strong> contre-coup de ce vécu extérieur, mais<br />
que rien dans l’éco<strong>le</strong> n’ouvre une brèche dans ce repli.<br />
Le deuxième élément, que montrent <strong>le</strong>s remarques des élèves : activités scolaires et<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
elations aux autres, ne sont pas disjointes au sein de l’éco<strong>le</strong> F.<br />
Face aux bagarres Habib défend l’idée que la construction des règ<strong>le</strong>s dans la classe est<br />
plus efficace que l’autorité du maître : « après ça sera du jaloux, de la jalousie et tout ça,<br />
et après ça va continuer… s’il y avait pas de règ<strong>le</strong>s dans la classe, ben tout <strong>le</strong> monde se<br />
bagarrerait et <strong>le</strong>s maîtres ils vont rien dire ». Rose précise que <strong>le</strong> maître ne fait pas tout,<br />
grâce à l’organisation des métiers : « en fait chacun dans la classe a des responsabilités…<br />
c’est des métiers qui servent dans la classe, comme ça tout <strong>le</strong> monde en fait, fait partie de<br />
la classe, on sent bien qu’on fait partie de la classe parce qu’on fait quelque chose pour<br />
la classe. Dans mon ancienne éco<strong>le</strong> c’est la maîtresse qui faisait tout, c’est el<strong>le</strong> qui faisait<br />
descendre <strong>le</strong>s élèves et tout, ici non ».<br />
Un troisième point fort issu des comparaisons réside dans <strong>le</strong> fait que au sein de la pédagogie<br />
F, <strong>le</strong>s mauvaises relations entre pairs ne cherchent pas à être compensés par une relation<br />
à l’enseignant. Ni l’enseignant n’entreprend cette démarche, ni l’élève ne cherche ce regard<br />
sur lui. La prise en compte de l’élève ne passe par une relation interpersonnel<strong>le</strong>. On peut<br />
en conclure que d’autres types de relations entre <strong>le</strong>s individus et <strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif se mettent en<br />
place. Odi<strong>le</strong> explicite fort bien cette imbrication particulière, en faisant un retour sur son<br />
éco<strong>le</strong> précédente : « en fait il y avait plus de classe, il y avait par exemp<strong>le</strong> trois CE2, des<br />
choses comme ça, mais en fait ils étaient moins autonomes, ils faisaient plus de choses<br />
col<strong>le</strong>ctif, donc ils parlaient plus fort pour que tout <strong>le</strong> monde entende, donc nous aussi on<br />
entendait tout aussi, donc c’était un peu embêtant, que ici on a tout <strong>le</strong> temps ». Le travail et<br />
l’ambiance relationnel<strong>le</strong> entre <strong>le</strong>s élèves sont intimement liés. Les métiers sont un partage<br />
de responsabilités, ils renouvel<strong>le</strong>nt aussi une certaine façon de faire confiance aux élèves et<br />
de partager <strong>le</strong> plaisir de vivre dans l’éco<strong>le</strong>. Ainsi à propos des instruments de musique, Rose<br />
établit une autre comparaison : « ils veu<strong>le</strong>nt bien prêter, en échange il faut faire attention,<br />
c’est pour ça, je crois qu’à mon ancienne éco<strong>le</strong> ils avaient peur qu’on casse des choses et<br />
alors du coup ils nous <strong>le</strong>s donnaient pas, ici ils ont plus confiance, ils nous prêtent et on peut<br />
s’en servir ».<br />
4. Le cas particulier des élèves en souffrance<br />
Les élèves qui entrent dans l’éco<strong>le</strong> Freinet ont-ils des caractéristiques particulières ? Nous<br />
avons rappelé dans <strong>le</strong> premier paragraphe que, pour <strong>le</strong> maître E qui prenait ses fonctions<br />
dans <strong>le</strong> réseau, et avait connu d’autres classes dans <strong>le</strong> même regroupement, « on aurait<br />
tort de croire que ces élèves sont plus faci<strong>le</strong>s qu’ail<strong>le</strong>urs ». L’infirmière scolaire quant à<br />
el<strong>le</strong>, avait dit avoir trouvé plus de problèmes à l’éco<strong>le</strong> F, pendant ses dépistages en CE<br />
que dans <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s de la même circonscription. En 00 nous avions établi trois positions<br />
d’élève en fonction des contraintes qui pèsent sur eux : <strong>le</strong>s premiers plus disponib<strong>le</strong>s à<br />
l’apprentissage semblaient s’épanouir vraiment dans la pédagogie Freinet ; <strong>le</strong>s seconds,<br />
comme Boris, pouvaient entreprendre tout un travail de reconstruction d’un passé lourd à<br />
porter ; <strong>le</strong>s troisièmes fortement marqués par une stabilité très précaire, et moins disponib<strong>le</strong>s<br />
à cette construction d’eux-mêmes montraient pourtant comment l’organisation de classe <strong>le</strong>s<br />
incitaient à sortir de <strong>le</strong>ur monde. À travers <strong>le</strong>s dix entretiens menés avec des élèves d’autres<br />
éco<strong>le</strong>s, nous pouvons re<strong>le</strong>ver un grand nombre de motifs de souffrance chez ces élèves,<br />
même s’ils ne sont pas présentés de la même manière. Il nous semb<strong>le</strong> intéressant de re<strong>le</strong>ver<br />
brièvement dans ce dernier paragraphe quelques éléments, qui seront développés plus<br />
amp<strong>le</strong>ment dans d’autres publications, qui permettent de s’interroger sur la manière dont <strong>le</strong>s<br />
enfants vivent, dans <strong>le</strong> cadre de l’éco<strong>le</strong>, ce qui <strong>le</strong>s fait souffrir.<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Comme motifs de souffrance apparaissent <strong>le</strong>s vio<strong>le</strong>nces physiques ou verba<strong>le</strong>s de la part<br />
des adultes ou des pairs, la peur d’être regardé ou de subir des humiliations publiques ou<br />
des injustices, <strong>le</strong>s sentiments de frustration au niveau de la liberté quand l’élève est obligé de<br />
faire (ou de manger à la cantine) quelque chose qu’il n’aime pas, mais aussi <strong>le</strong>s souffrances<br />
dues aux séparations. Dans toutes ces situations, il nous semb<strong>le</strong> essentiel<strong>le</strong>ment à travers<br />
<strong>le</strong>urs dires, que <strong>le</strong>s élèves d’autres éco<strong>le</strong>s, subissent. Il semb<strong>le</strong> que <strong>le</strong>ur désir ne peut<br />
s’exprimer. Nous ne <strong>le</strong>s avons pas entendu proposer de solution pour en sortir. L’individu<br />
semb<strong>le</strong> prisonnier d’un pouvoir qui pèse sur lui.<br />
Il est d’autres situations qui viennent d’ail<strong>le</strong>urs ou d’avant… et que l’élève transporte avec<br />
lui à l’éco<strong>le</strong>. Quelques enfants évoquent des atteintes physiques. Mélanie dit à propos des<br />
mots d’absence qu’el<strong>le</strong> est asthmatique, sans s’y attarder, sauf par un long si<strong>le</strong>nce. Lucie<br />
se révè<strong>le</strong> victime de beaucoup de choses qu’el<strong>le</strong> n’a pas choisies : « ma mère el<strong>le</strong> m’a mis<br />
dans cette éco<strong>le</strong> là », de l’injustice des adultes à son égard (à la cantine ou en classe) et<br />
revient plusieurs fois sur ses b<strong>le</strong>ssures au genou, pour dire que tout choc réveil<strong>le</strong> la b<strong>le</strong>ssure<br />
physique : « et pis el<strong>le</strong> m’a donné un coup de pied et ça s’est ouvert un petit peu » mais la<br />
b<strong>le</strong>ssure psychique aussi, puisque « à la piscine samedi je me suis ouvert en sautant en<br />
arrière et c’est <strong>le</strong> bord qui m’a cogné ». Justine a évoqué avec sa peur du noir, son aversion<br />
pour la cou<strong>le</strong>ur noire et sa peur de perdre « ses camarades, sa maîtresse, sa mamie et son<br />
pépère ».<br />
Avec Tom et Corentin nous avons vu ce qui peut être vécu comme souffrance à l’éco<strong>le</strong>…<br />
sans savoir ouvertement si cette manière de se sentir rejeté, mis à l’écart prend appui sur<br />
d’autres souffrances du même ordre. Tom va avoir une peur terrifiante de repenser à ce<br />
qu’il a vécu et Corentin après avoir insisté longuement sur <strong>le</strong> fait qu’il explique aux autres<br />
sa méthode pour <strong>le</strong>s soustractions, avoue à mots couverts qu’il y était fortement invité mais<br />
qu’ils ne l’écoutent pas : « et après j’ai du dire comment j’ai fait euh… aux autres élèves<br />
après, ouais j’aime bien, en fait el<strong>le</strong> est bien cette méthode… ils m’écoutent, mais sauf que,<br />
parfois à la fin de, quand on rentre chez nous, il sont souvent un petit peu trop bruyants. Ils<br />
sont un petit peu trop bruyants <strong>le</strong>s élèves y’a des moments ».<br />
Le cas de Charlotte a été peu évoqué. El<strong>le</strong> par<strong>le</strong> très peu de l’éco<strong>le</strong> pendant l’entretien<br />
sauf pour dire de l’ancienne éco<strong>le</strong> qu’el<strong>le</strong> y était « première toute l’année » et de cel<strong>le</strong>ci<br />
« bah… ». El<strong>le</strong> par<strong>le</strong> beaucoup plus de sa situation familia<strong>le</strong> : parents séparés, famil<strong>le</strong><br />
recomposée de chaque coté qu’el<strong>le</strong> voudrait voir disparaître. Comment peut-el<strong>le</strong> arriver à<br />
être sage chez el<strong>le</strong>, comme el<strong>le</strong> est sage à l’éco<strong>le</strong> ?… À travers cette interrogation qu’el<strong>le</strong><br />
réitère plusieurs fois, se fait jour son raisonnement – si on n’est pas sage à l’éco<strong>le</strong>, on est<br />
puni, on va dans <strong>le</strong> couloir – calqué sur un raisonnement de sa mère : « si tu fais ce que <strong>le</strong><br />
‘toutou’ il dit… ». Comment renverser <strong>le</strong> raisonnement et faire qu’en étant sage… <strong>le</strong>s choses<br />
changent à la maison comme el<strong>le</strong>s changent à l’éco<strong>le</strong> : tel est <strong>le</strong> di<strong>le</strong>mme qui l’habite en<br />
permanence : « je suis pas sage chez moi… (ah bon ça veut dire quoi ?) j’sais pas » En<br />
effet à l’éco<strong>le</strong> si on n’est pas sage, on va dans <strong>le</strong> couloir « <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s el<strong>le</strong>s y vont jamais…<br />
j’sais pas pourquoi moi j’y vais jamais, c’est bien de pas y al<strong>le</strong>r » Similitude avec <strong>le</strong>s propos<br />
de Rosine (à l’éco<strong>le</strong> F) à propos de son régime « sans sel, sans sucre qu’el<strong>le</strong> doit suivre…<br />
pour être bien à notre corps » : même contrainte qui pèse sur l’enfant. Charlotte comme<br />
Rosine soignent un lapin dans la classe. Dans la classe de Charlotte il n’y a qu’un garçon,<br />
ce sont « <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s qui lui donnent à manger… des fois on va se promener, on fait des tours<br />
dans la cour ». Étrange coïncidence ! mais pour Rosine c’est un métier reconnu par la<br />
classe. El<strong>le</strong> en a la responsabilité.<br />
Clélia à l’éco<strong>le</strong> F, révélait par l’intermédiaire du papillon que son cocon à el<strong>le</strong> c’était son lit<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
et que « samedi » el<strong>le</strong> irait dormir chez son père. Pour Mélanie, Justine et Rosine ce sont<br />
<strong>le</strong>s livres et <strong>le</strong>s histoires de chevaux… « libres », qui permettent de dire quelque chose de<br />
soi. Mais <strong>le</strong>s histoires douloureuses se projettent… aussi dans <strong>le</strong>s dessins de Charlotte :<br />
« (qu’est-ce que tu fais comme dessin ?) comme dessin j’sais pas ce que je fais… des<br />
montagnes, j’fais la montagne ». De fait Charlotte attend d’al<strong>le</strong>r « (chez papa ?)… parce que<br />
en hiver on fait du ski, j’aime bien al<strong>le</strong>r là-bas en hiver » ou dans <strong>le</strong> récit de Elsa à propos des<br />
licornes : « parce qu’y a des gens qui sont allés à la police et ils ont dit que <strong>le</strong> petit garçon y<br />
avait une licorne et euh ils étaient dans la classe de lui… parce que lui y avait pas de copain<br />
dans sa classe, il était tout seul… alors » ou encore dans la conférence de Raïssa à l’éco<strong>le</strong><br />
F. La différence entre Elsa et Raïssa c’est que l’histoire des licornes n’a pas droit de cité à<br />
l’éco<strong>le</strong>. C’est à propos des licornes que la maîtresse – gentil<strong>le</strong>, qui vient aider, à côté… –<br />
devient méchante en interdisant de dessiner en classe, sous peine de voir <strong>le</strong>s dessins<br />
arrachés ou de perdre la sollicitude de la maîtresse : « <strong>le</strong>s autres, ils <strong>le</strong> font mais pas moi…<br />
moi j’écoute la maîtresse ». En revanche, la conférence de Raïssa entre dans l’éco<strong>le</strong> par<br />
« la grande porte » : el<strong>le</strong> est préparée par des paragraphes de paro<strong>le</strong>, présentée, soumise<br />
aux questions des autres, mise au vote pour se voir attribuer une cou<strong>le</strong>ur, et fina<strong>le</strong>ment<br />
entrer dans <strong>le</strong> classement qui permet à Raïssa de se projeter dans l’avenir : « moi je veux<br />
me donner à fond pour avoir des bonnes études pour avoir un bon métier et puis tout ça ».<br />
Malgré ce qui pèse sur lui, l’élève dans la pédagogie F peut être acteur… et à partir de<br />
cette réussite il reconstruit un lien entre ce qu’il fait et ce qu’il est… Grâce à cela, l’élève en<br />
pédagogie Freinet peut al<strong>le</strong>r au-delà du « je ne sais pas » de Charlotte. Son impuissance<br />
vis-à-vis du monde des adultes n’est plus sa seu<strong>le</strong> donnée, comme nous l’avions montré<br />
avec <strong>le</strong> cas de Boris. (Jovenet, 00 )<br />
Dans <strong>le</strong>s autres éco<strong>le</strong>s on a aussi mis en évidence un certain désir de l’élève d’attirer <strong>le</strong> regard<br />
de l’enseignant(e) sur lui, ce qui n’intervient pas à l’éco<strong>le</strong> F. Chercher un adulte qui protège<br />
est bien un mécanisme spontané chez l’enfant en souffrance, et pour obtenir ce regard<br />
particulier, la rivalité avec <strong>le</strong>s autres se fait jour. Depuis Freud beaucoup de psychanalystes<br />
se sont penchés sur <strong>le</strong>s retombées de l’œdipe à l’éco<strong>le</strong>… En installant une relation de<br />
coopération, d’entraide entre <strong>le</strong>s élèves, <strong>le</strong> désir d’attirer l’attention du maître diminue, et<br />
l’élève peut trouver en lui-même, sans dépendre de l’autre, de quoi se reconstruire. N’y a-t-il<br />
pas là pour l’élève un remède inscrit dans sa vie d’écolier ?<br />
En définitive l’analyse comparative met l’accent sur ce qu’on peut nommer de façon très<br />
généra<strong>le</strong> : <strong>le</strong>s rapports entre individus à l’éco<strong>le</strong>. Il s’agit des rapports du maître à l’élève, de<br />
l’élève au maître, d’un élève à un autre élève, des élèves entre eux, mais aussi de l’élève<br />
à l’ensemb<strong>le</strong> des élèves (l’élève et <strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif). Ces « rapports des individus à l’éco<strong>le</strong> »<br />
sont vécus, ressentis et parlés de manière très différente quand on met en comparaison<br />
cette éco<strong>le</strong> en pédagogie F et <strong>le</strong>s autres éco<strong>le</strong>s. Le fait un peu surprenant, rappelons-<strong>le</strong>,<br />
c’est que l’ensemb<strong>le</strong> qui sert de comparaison n’a en soi rien de commun – puisqu’il s’agit<br />
d’entretiens menés par chaque étudiant sur un lieu différent – permet des rapprochements<br />
interrogeants.<br />
Le rapport entre individuel et col<strong>le</strong>ctif n’est-il qu’un effet de la référence théorique : la<br />
psychanalyse pousserait à mettre l’accent sur chaque individu et à s’interroger sur ses<br />
relations avec <strong>le</strong>s autres ? Il faut aussi se rappe<strong>le</strong>r que pour comprendre certaines difficultés<br />
des intervenants extérieurs, à se familiariser à ce nouveau mode pédagogique, nous nous<br />
étions demandé comment se fait habituel<strong>le</strong>ment la prise en charge des enfants en difficulté.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Nous avions souligné que fréquemment la réponse se présente sous la forme d’une<br />
discrimination : l’élève est mis à part pour pouvoir être aidé. Soit il est pris en particulier<br />
par un intervenant spécialisé, soit il est mis dans un groupe de « son » niveau, soit on<br />
cherche à <strong>le</strong> dépister pour prévoir, soit encore l’enseignant tente de l’entourer d’une relation<br />
pédagogique protectrice dans <strong>le</strong> but d’aider cet enfant… à devenir élève, et à s’insérer<br />
parmi <strong>le</strong>s autres. Nous avions remarqué que ces pratiques n’existaient pas à l’éco<strong>le</strong> F. Il<br />
n’y a pas de groupes de niveau, pas de travail de groupe d’ail<strong>le</strong>urs. Le maître E assure<br />
un suivi assez distancé parfois au sein même de l’espace physique de la classe. Nous<br />
avions noté aussi dans <strong>le</strong>s entretiens avec <strong>le</strong>s enseignants, plusieurs cas qui semblaient<br />
exemplaires d’une mise en retrait de l’enseignant par rapport à ce qui aurait pu paraître une<br />
« tentation justifiée » d’une relation protectrice. Nous en avions même conclu à une attitude<br />
suffisamment « extraordinaire » qui déroutait <strong>le</strong>s personnels intervenant de l’extérieur et<br />
habitués à travail<strong>le</strong>r autrement ail<strong>le</strong>urs.<br />
Tout semblait se dérou<strong>le</strong>r dans <strong>le</strong> travail de la classe, et par <strong>le</strong> travail en classe. L’élève y<br />
entre tel qu’il est. Il travail<strong>le</strong> et devient élève par <strong>le</strong> travail dans chacune des matières. La<br />
re<strong>le</strong>cture des différents chapitres du rapport montrait qu’aucun des chercheurs didacticiens<br />
ne mettait en évidence une prise en charge particulière d’un élève qui serait dit « plus en<br />
difficulté » mais au contraire mettait l’accent sur un rapport au travail comme étant <strong>le</strong> cœur<br />
des choix pédagogiques. Il ne s’agit à aucun moment d’une « didactique appropriée aux<br />
difficultés des élèves ». (Jovenet, 00 )<br />
De ces deux aspects : l’entrée dans <strong>le</strong> changement par <strong>le</strong>s élèves, et <strong>le</strong> refus d’un rapport<br />
individuel à l’élève en difficulté pour mettre au centre <strong>le</strong> travail col<strong>le</strong>ctif se dégagent deux<br />
pistes que nous souhaitons travail<strong>le</strong>r par la suite. La première vise à comprendre comment se<br />
tissent au jour <strong>le</strong> jour ces pratiques enseignantes qui paraissent bien spécifiques, dans <strong>le</strong>ur<br />
dérou<strong>le</strong>ment et <strong>le</strong>ur résultat. La deuxième est de savoir quel bagage peut constituer pour ces<br />
élèves <strong>le</strong>ur passage en primaire dans cette éco<strong>le</strong> Freinet. L’entrée en e est un changement<br />
peu banal dans la vie de tout élève. Il y a donc là une autre étude comparative du changement<br />
qui nous semb<strong>le</strong> très intéressante. Déjà amorcée el<strong>le</strong> semb<strong>le</strong> très prometteuse de nouvel<strong>le</strong>s<br />
explications pour comprendre la spécificité de cette éco<strong>le</strong> en pédagogie Freinet.<br />
Références bibliographiques<br />
Blanchard-Lavil<strong>le</strong> C. ( 00 ), Les enseignants entre plaisir et souffrance, Paris, PUF.<br />
Dolto F. ( ), L’image inconsciente du corps, Paris, Seuil.<br />
Freud S. ( 0 ), Cinq <strong>le</strong>çons sur la psychanalyse, Paris, Payot, tr. fr.<br />
Freud S. ( ), Abrégé de psychanalyse, Paris, PUF, tr. fr.<br />
Jovenet A.M. ( 00 ), « L’espace psychique de l’acquisition des savoirs, construit par<br />
l’éco<strong>le</strong> en pédagogie Freinet », dans Y. REUTER, dir., Démarches pédagogiques et lutte<br />
contre l’échec scolaire (2002-200 ), Rapport de recherche ERTe 0 , Vil<strong>le</strong>neuve d’Ascq,<br />
Université Char<strong>le</strong>s de Gaul<strong>le</strong>, p. 0-<br />
Jovenet A.M. ( 00 ), Enfants en souffrance à l’éco<strong>le</strong> : de la discrimination au traitement par<br />
la classe en pédagogie Freinet, », dans Y. REUTER, dir., Démarches pédagogiques et lutte<br />
contre l’échec scolaire (2002-200 ), Rapport de recherche ERTe 0 , Vil<strong>le</strong>neuve d’Ascq,<br />
Université Char<strong>le</strong>s de Gaul<strong>le</strong>, p. -<br />
Jovenet A.M. ( 00 ), Une « didactique appropriée aux difficultés des élèves » est-el<strong>le</strong><br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
tributaire des modes d’appréhension de ces difficultés ? La nouvel<strong>le</strong> revue de l’AIS –<br />
Adaptation et intégration scolaires – n° , p. -<br />
K<strong>le</strong>in M. ( ), L’amour et la haine, Paris, Payot, tr. fr.<br />
Nasio J.D. ( 000), Comment écouter un enfant ? dans Association Nationa<strong>le</strong> des<br />
psychologues scolaires dir., Différences… Indifférence, Congrès national des psychologues<br />
scolaires, p. - .<br />
Reuter Y. ( 00 ), Les principes de fonctionnement de l’éco<strong>le</strong> « Freinet », dans Y. REUTER,<br />
dir., Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire (2002-200 ), Rapport de<br />
recherche ERTe 0 , Vil<strong>le</strong>neuve d’Ascq, Université Char<strong>le</strong>s de Gaul<strong>le</strong>, p. - .<br />
Winnicott D.W.( ), Jeu et réalité. L’espace potentiel, Paris, Gallimard, tr. fr.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Protoco<strong>le</strong>s des évaluations nationa<strong>le</strong>s, CE2-6 e ,<br />
et évolution des résultats des élèves de l’éco<strong>le</strong><br />
Hélène Boucher<br />
Rouba HASSAN PILARTZ<br />
Maître de conférences<br />
Université de Lil<strong>le</strong> IV<br />
Équipe THÉODILE<br />
Depuis , des évaluations diagnostiques ont lieu à chaque rentrée scolaire, entre<br />
septembre et octobre, en CE et en e . Ces évaluations consistent en un protoco<strong>le</strong><br />
d’exercices testant <strong>le</strong>s compétences des élèves dans <strong>le</strong>s domaines variés du français et des<br />
mathématiques . Bien qu’el<strong>le</strong>s soient conçues comme un outil strictement pédagogique ,<br />
et que la direction de l’évaluation et de la prospective (DEP) du ministère de l’Éducation<br />
nationa<strong>le</strong> insiste sur <strong>le</strong>s aléas méthodologiques des comparaisons diachroniques, mettant en<br />
garde contre <strong>le</strong>s suivis longitudinaux (Hassan-Pilartz, 00 ), el<strong>le</strong>s peuvent être considérées,<br />
comme un indicateur de « bonne » ou « mauvaise santé » scolaire. Surtout si des tendances<br />
récurrentes, stab<strong>le</strong>s, homogènes, peuvent être isolées sur <strong>le</strong> long terme et si ces tendances<br />
se retrouvent dans ce que d’autres types d’outils et de démarches évaluatives semb<strong>le</strong>nt<br />
indiquer (Reuter, 00 ).<br />
C’est dans cette perspective et avec cette difficulté méthodologique, plus longuement<br />
exposée dans <strong>le</strong> précédent rapport, que j’ai entrepris de suivre l’évolution des résultats<br />
des élèves de l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher, depuis l’année 000 et jusque l’année 00 , qui<br />
travail<strong>le</strong>nt selon <strong>le</strong>s principes de la pédagogie Freinet, aux évaluations nationa<strong>le</strong>s en CE<br />
et en e afin de dégager, dans la mesure du possib<strong>le</strong>, des tendances qui s’inscrivent dans<br />
la durée. Je pensais et je continue de <strong>le</strong> penser, que cette démarche permet d’apporter<br />
des éléments intéressants, mais nécessairement insuffisants, à la question de l’évaluation<br />
des effets de ce mode de travail sur <strong>le</strong>s performances des élèves. En effet, <strong>le</strong>s auteurs<br />
du présent rapport tentent, chacun à partir de ses cadres méthodologique et théorique<br />
d’approcher cette question.<br />
1. Objectifs et méthode<br />
1.1. Objectifs généraux<br />
J’ai parlé dans <strong>le</strong> précédent rapport de l’indicateur temporel, nommé variab<strong>le</strong> GFX, qui<br />
tente de « mesurer » l’influence de l’exposition au mode de travail des maîtres « Freinet »<br />
de l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher sur <strong>le</strong>s résultats des élèves aux évaluations nationa<strong>le</strong>s. Cet<br />
Les protoco<strong>le</strong>s n’évaluent pas toutes <strong>le</strong>s compétences des programmes rég<strong>le</strong>mentaires mais<br />
seu<strong>le</strong>ment cel<strong>le</strong>s que <strong>le</strong>s concepteurs des protoco<strong>le</strong>s jugent essentiel<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong> cyc<strong>le</strong> .<br />
Permettant à l’enseignant d’évaluer <strong>le</strong> niveau et la nature des acquisitions de ces élèves, dans un<br />
domaine donné, pour mieux organiser son enseignement.<br />
Qui publie tous <strong>le</strong>s ans des dossiers consacrés aux résultats à ces évaluations sur <strong>le</strong> plan national.<br />
Désormais HB dans <strong>le</strong> texte.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
indicateur me permettait ainsi distinguer des générations « plus ou moins Freinet ».<br />
En travaillant dans une perspective comparative et longitudina<strong>le</strong>, comparant <strong>le</strong>s résultats<br />
des élèves de l’éco<strong>le</strong> HB à ceux des élèves d’une éco<strong>le</strong> témoin de milieu comparab<strong>le</strong>, à<br />
ceux de la circonscription et à ceux de la France, de 000 à 00 , on a pu montrer un effet<br />
positif de la variab<strong>le</strong> GFX en CE . L’effet de la variab<strong>le</strong> sur <strong>le</strong>s résultats en e est moins net<br />
mais n’est pas négatif.<br />
Dans cette contribution, je vais dans un premier temps compléter ces données par <strong>le</strong>s<br />
résultats aux évaluations nationa<strong>le</strong>s de la rentrée 00 pour vérifier si <strong>le</strong>s tendances décrites<br />
précédemment (Hassan-Pilartz, 00 ) se confirment. Mais je vais aussi me consacrer à<br />
des traitements plus affinés des résultats, en CE et en e , en me centrant sur certains<br />
types d’exercices ou d’items pour vérifier certaines hypothèses concernant, par exemp<strong>le</strong>, la<br />
fragilité des élèves ou au contraire <strong>le</strong>ur force dans certains domaines.<br />
Je vais aussi effectuer des comparaisons longitudina<strong>le</strong>s en suivant l’évolution des résultats<br />
des mêmes enfants en CE , puis, trois années plus tard, en e , sur des exercices similaires,<br />
c’est-à-dire qui testent <strong>le</strong>s mêmes compétences.<br />
Ces traitements contribuent toujours au même objectif énoncé plus haut, celui de déterminer<br />
avec plus de précision de quel<strong>le</strong> manière et dans quels domaines se manifeste l’effet de la<br />
variab<strong>le</strong> temporel<strong>le</strong>.<br />
1.2. Précisions et restrictions<br />
Les objectifs énoncés plus haut doivent subir quelques restrictions. D’abord, et concernant<br />
l’évolution des résultats à certains exercices, l’étude sera limitée aux domaines du français.<br />
Les mathématiques n’étant pas ma spécialité, je ne dispose pas des compétences nécessaires<br />
pour me permettre de sé<strong>le</strong>ctionner des exercices spécifiques, en fonction d’hypothèses<br />
pertinentes d’un point de vue didactique pour <strong>le</strong>s apprentissages mathématiques.<br />
Par ail<strong>le</strong>urs, ce suivi spécifique concerne <strong>le</strong>s résultats de 00 à 00 . Les résultats des<br />
années antérieures 00 , 00 (année de l’arrivée de l’équipe pédagogique actuel<strong>le</strong> à l’éco<strong>le</strong><br />
HB) ne seront pas compris. La première raison de cette limitation ne dépend pas d’un choix<br />
délibéré. En effet, <strong>le</strong>s bases de données informatiques qui contiennent <strong>le</strong>s résultats détaillés<br />
par items de ces deux années n’ont pas pu être exploitées. Les versions antérieures du<br />
logiciel Casimir qui a servi à coder <strong>le</strong>s résultats des évaluations de ces années-là n’existent<br />
plus .<br />
Mais cette limitation n’est pas synonyme de perte, au contraire. Les résultats de 00 ,<br />
ne peuvent en aucun cas être mis en relation avec <strong>le</strong> mode de travail pédagogique des<br />
maîtres de l’éco<strong>le</strong> HB, puisque <strong>le</strong>s évaluations ont lieu en tout début de rentrée scolaire.<br />
Tout au plus pouvons nous <strong>le</strong>s mettre en relation, pour <strong>le</strong> CE seu<strong>le</strong>ment, avec la manière<br />
de coder du maître ou de la maîtresse. Mais cette hypothèse, qui suppose que <strong>le</strong>s maîtres<br />
Freinet ne coderaient pas comme <strong>le</strong>urs autres collègues, n’a aucun fondement empirique.<br />
Les résultats de 00 , peuvent commencer à nous intéresser parce que <strong>le</strong>s enfants qui <strong>le</strong>s<br />
passent, en CE et en e , ont derrière eux une « année Freinet ». Mais on peut justement<br />
supposer à partir de là que ce sont <strong>le</strong>s résultats des années suivantes (à partir de 00 ) qui<br />
Remplacé depuis 00 par <strong>le</strong> logiciel J’ADE.<br />
Chaque année la version du logiciel change (la feuil<strong>le</strong> de codage si l’on veut) dans la mesure où el<strong>le</strong><br />
correspond au protoco<strong>le</strong> des exercices soumis aux élèves qui, lui aussi, change plus ou moins tous <strong>le</strong>s ans.<br />
Les exercices varient, ainsi que <strong>le</strong>ur nombre ou <strong>le</strong> nombre des items qui <strong>le</strong>s composent.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
seront <strong>le</strong>s plus parlants, notamment si on tente d’apporter quelques éléments de réponse à<br />
la question de savoir si <strong>le</strong> mode de travail des maîtres « Freinet » de l’éco<strong>le</strong> HB a des effets<br />
positifs sur <strong>le</strong> score des élèves aux évaluations nationa<strong>le</strong>s.<br />
De son côté, l’étude de l’évolution des scores des mêmes enfants, d’abord en CE puis trois<br />
années plus tard en e , sur des exercices similaires, est el<strong>le</strong> aussi restreinte pour des raisons<br />
qui échappent à ma volonté. Cette étude est différente de cel<strong>le</strong> qui consiste à comparer<br />
<strong>le</strong>s résultats globaux du CE à ceux de la e, trois années plus tard. La première cohorte<br />
d’élèves qui nous intéresse et pour laquel<strong>le</strong> je dispose, en partie, de résultats détaillés (par<br />
exercice et par item) est cel<strong>le</strong> qui a passé <strong>le</strong>s évaluations nationa<strong>le</strong>s à l’entrée en CE en<br />
000, puis à l’entrée en e en 00 . Ne disposant des bases de données détaillées, comme<br />
je l’ai expliqué plus haut, qu’à partir de l’année 00 , la « génération » antérieure, CE<br />
, e 00 , est hors de portée. Pour la génération suivante, nous disposons des cahiers<br />
d’évaluation CE des élèves de 00 , complétés par la base de données J’Ade 00 de<br />
<strong>le</strong>urs résultats en e . Ce qui nous a permis de suivre l’évolution de <strong>le</strong>ur performance entre<br />
<strong>le</strong> CE et la e dans <strong>le</strong>s mêmes domaines. En revanche, <strong>le</strong>s cahiers d’évaluation CE de<br />
l’année 00 étant introuvab<strong>le</strong>s, je n’ai pas été en mesure de faire la même chose pour la<br />
génération CE - 00 , e - 00 et c’est regrettab<strong>le</strong>.<br />
1.3. Des difficultés techniques et méthodologiques qui imposent la prudence<br />
Je voudrais mettre l’accent ici sur <strong>le</strong>s limites d’un tel travail comparatif. Ces limites traversent<br />
l’ensemb<strong>le</strong> des « conclusions » auxquel<strong>le</strong>s on pourrait aboutir et doivent rester présentes à<br />
l’esprit lors de toute <strong>le</strong>cture des résultats.<br />
Certes, la disponibilité des bases de données informatiques 00 , 00 et 00 , contenant<br />
<strong>le</strong>s scores des élèves de l’éco<strong>le</strong> HB et ceux de l’éco<strong>le</strong> témoin facilite un certain nombre de<br />
traitements mais présente une difficulté technique qui n’est pas sans alourdir la comparaison.<br />
En effet, en 00 , <strong>le</strong> logiciel de traitement des évaluations nationa<strong>le</strong>s a changé et on est<br />
passé du logiciel Casimir au logiciel J’ADE qui ne fonctionne pas exactement de la même<br />
manière. D’autre part, la feuil<strong>le</strong> de codage des résultats variant tous <strong>le</strong>s ans, la version<br />
J’ADE 00 est différente de la version 00 , ce qui m’a contrainte à jong<strong>le</strong>r entre deux<br />
versions, sur deux machines différentes, deux versions différentes ne pouvant cohabiter.<br />
Il peut y avoir éga<strong>le</strong>ment une légère variation entre <strong>le</strong>s chiffres de mes bases de données<br />
et ceux de l’inspection concernant <strong>le</strong>s scores des élèves d’HB en e car <strong>le</strong>s chiffres de<br />
l’inspection prennent en compte <strong>le</strong>s résultats de tous <strong>le</strong>s élèves provenant d’HB et scolarisés<br />
en e alors que je ne dispose que des résultats des élèves scolarisés au collège Rabelais.<br />
Il me faut aussi, sur un autre plan, sou<strong>le</strong>ver <strong>le</strong> problème de la pertinence de la comparaison<br />
des résultats dans <strong>le</strong> temps à cause du changement des exercices et du nombre d’items<br />
qui <strong>le</strong>s composent qui varie d’une année à l’autre, du regroupement différent des items,<br />
même si <strong>le</strong>s compétences évaluées restent sensib<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s mêmes . Autre illustration de<br />
ce problème, l’exercice n° du protoco<strong>le</strong> CE de 00 est identique à celui de l’exercice<br />
du protoco<strong>le</strong> de 00 mais la consigne n’est pas la même. Il faut éga<strong>le</strong>ment signa<strong>le</strong>r <strong>le</strong> fait<br />
que <strong>le</strong>s consignes de codage données aux maîtres peuvent el<strong>le</strong>s aussi varier. Brézillon et<br />
al. ( 00 ), affirment que même la comparaison des réussites à un item identique à travers<br />
<strong>le</strong>s années n’est pas significative. Les baisses ou hausses des taux ne sont pas toujours<br />
Interférant ainsi dans <strong>le</strong> taux de réussite ou d’échec.<br />
Cf. annexe pour une présentation des compétences évaluées.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
significatives d’un point de vue statistique dans la mesure où <strong>le</strong>s échantillons ne sont pas<br />
<strong>le</strong>s mêmes.<br />
2. Résultats globaux<br />
Je vais rappe<strong>le</strong>r brièvement ici <strong>le</strong>s principaux résultats auxquels ont abouti <strong>le</strong>s précédentes<br />
analyses. L’an zéro étant pour nous l’année 00 , année de l’arrivée de la nouvel<strong>le</strong> équipe<br />
pédagogique dans l’éco<strong>le</strong> HB, et compte tenu de l’amélioration constante des résultats<br />
depuis cette date je me centrerai sur l’évolution entre 00 et 00 .<br />
2.1. Rappel des principaux résultats pour <strong>le</strong> CE2 jusqu’en 2004<br />
En français, <strong>le</strong>s résultats étaient en baisse jusqu’en 00 . À partir de 00 la tendance<br />
commence à s’inverser, comme on peut <strong>le</strong> voir sur l’histogramme, pour atteindre un niveau<br />
nettement supérieur (+ points d’écart) aux scores nationaux dans certains domaines. Le<br />
domaine des outils pour écrire atteint en 00 , , % pour HB, 0, % pour la France et<br />
, % pour la circonscription. J’avais montré là une spécificité de l’éco<strong>le</strong> HB dont <strong>le</strong>s élèves<br />
de CE semb<strong>le</strong>nt avoir particulièrement progressé dans <strong>le</strong> domaine de la production d’écrits<br />
alors que la tendance est à la baisse au niveau national et au niveau de la circonscription.<br />
Lorsque l’on constate en consultant <strong>le</strong>s archives de l’éco<strong>le</strong> que l’écart au score national était<br />
de - points dans ce domaine précis en 000, l’on peut mesurer <strong>le</strong> travail accompli par <strong>le</strong>s<br />
maîtres et ses vraisemblab<strong>le</strong>s effets.<br />
0,00%<br />
0,00%<br />
0,00%<br />
0,00%<br />
0,00%<br />
0,00%<br />
0,00%<br />
0,00%<br />
0,00%<br />
0,00%<br />
Comp<br />
Outils<br />
Prod<br />
Mesures<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
trav. Num<br />
Histogramme CE2, HB, 2002-2004<br />
Ces résultats sont en cohérence avec ce que <strong>le</strong>s diverses études effectuées par notre<br />
équipe sur <strong>le</strong>s apprentissages disciplinaires, que ce soit en sciences, en mathématiques ou<br />
en français, ont montré. La production d’écrits est à l’éco<strong>le</strong> HB un élément essentiel de la<br />
pédagogie. À titre d’exemp<strong>le</strong>, Cora Cohen-Azria montre ici-même que <strong>le</strong>s élèves de cette<br />
éco<strong>le</strong>, comparés à d’autres, composent <strong>le</strong>s textes <strong>le</strong>s plus longs en réponse à des questions<br />
touchant aux connaissances scientifiques. C’est éga<strong>le</strong>ment eux qui ont <strong>le</strong>s réponses <strong>le</strong>s<br />
plus explicites sur <strong>le</strong>ur savoir ou <strong>le</strong>ur non-savoir. On retrouve ici un écho à la notion de<br />
rapport apaisé à l’écriture, dont par<strong>le</strong> Martine Fialip Baratte.<br />
En mathématiques, la progression la plus nette se constate en géométrie et dans <strong>le</strong> domaine<br />
des grandeurs et mesures, mais el<strong>le</strong> concerne tout <strong>le</strong> monde. Les autres domaines restant<br />
Moyenne<br />
00<br />
00<br />
00
stab<strong>le</strong>s. Il est à noter cependant que dans <strong>le</strong> domaine du calcul où <strong>le</strong>s résultats restent<br />
faib<strong>le</strong>s en CE , <strong>le</strong> retard est résorbé en e, comme on <strong>le</strong> verra.<br />
00<br />
00<br />
00<br />
Compréhension Outils Production Géométrie Mesures Trav num Problèmes Numération<br />
HB , 0% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0%<br />
Circ , 0% , 0% , 0% , 0% 0, 0% ,00% 0, 0% , 0%<br />
Nat , 0% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0% 0, 0%<br />
HB , 0% , 0% , 0% 0, 0% 0, 0% 0, 0% , 0% , 0%<br />
Circ. ,00% , 0% , 0% , 0% 0, 0% , 0% , 0% 0, 0%<br />
Nat , 0% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0%<br />
HB , 0% ,00% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0%<br />
Circ , 0% , 0% , 0% , 0% , 0% ,00% , 0% , 0%<br />
Nat , 0% , 0% ,00% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0%<br />
Tab<strong>le</strong>au, CE2, 2002-2004<br />
2.2. Rappel des principaux résultats pour la 6 e jusqu’en 2004<br />
En français, comme on peut <strong>le</strong> voir dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au ci-dessous, <strong>le</strong>s élèves d’HB progressent<br />
dans <strong>le</strong> domaine de la compréhension. On passe de , % de réussite en 00 à , % en<br />
00 . Cette progression est corrélée à une progression au niveau du secteur et au niveau<br />
national. D’une manière généra<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s élèves d’HB se placent mieux que <strong>le</strong>s autres élèves<br />
de la circonscription scolarisés au collège Rabelais (Circ.) dans <strong>le</strong>s domaines du français.<br />
Bien que <strong>le</strong>urs résultats dans <strong>le</strong> domaine du savoir-écrire sont en baisse, ils restent bien<br />
meil<strong>le</strong>urs que ceux des autres élèves du secteur. Notons que cette baisse est corrélée à une<br />
baisse au niveau national de plus de points entre 00 et 00 . Les élèves d’HB perdent<br />
eux , points. Cette tendance à la baisse dans ce domaine est inverse à cel<strong>le</strong> observée<br />
en CE dans <strong>le</strong> même domaine. L’effet spécifique de la variab<strong>le</strong> temporel<strong>le</strong> tend donc à se<br />
neutraliser en e , dans <strong>le</strong> sens où <strong>le</strong>s élèves ne se distinguent plus par <strong>le</strong>ur performance.<br />
Les résultats de 00 permettront de confirmer (ou d’infirmer) cette tendance.<br />
Notons que d’une manière généra<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s résultats sont moins bons en e qu’en CE et que<br />
cette tendance s’observe régulièrement dans <strong>le</strong>s évaluations nationa<strong>le</strong>s, HB ne fait pas<br />
exception. 10<br />
00<br />
00<br />
00<br />
Compréhension Outils Production<br />
HB , 0% , 0% , 0%<br />
Rab 0 , 0% , 0% ,00%<br />
Nat , 0% , 0% , 0%<br />
HB , 0% , 0% , 0%<br />
Rab , 0% ,00% , 0%<br />
Nat 0,00% , 0% , 0%<br />
HB , 0% , 0% , 0%<br />
Rab , 0% , 0% , 0%<br />
Nat , 0% , 0% 0, 0%<br />
Tab<strong>le</strong>au scores français, 6 e 2002-2004<br />
On détermine <strong>le</strong> score global dans un domaine par <strong>le</strong> nombre d’items réussis par <strong>le</strong>s élèves parmi tous<br />
<strong>le</strong>s items du domaine. Le score sur 00, que l’on emploie habituel<strong>le</strong>ment est <strong>le</strong> quotient de ce score global et<br />
du nombre d’items concernés, en d’autres termes, il s’agit de la proportion d’items réussis parmi tous <strong>le</strong>s items<br />
du domaine.<br />
0 Pour restreindre <strong>le</strong> nombre de paramètres en jeu et rendre la comparaison plus homogène, <strong>le</strong>s résultats<br />
en e des élèves provenant de HB sont comparés aux résultats des élèves de la circonscription qui sont<br />
scolarisés dans <strong>le</strong> même collège, à savoir Rabelais, et non pas à ceux de l’ensemb<strong>le</strong> de l’établissement.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
En mathématiques et d’une manière globa<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s résultats sont très moyens. Mais, comme<br />
on peut <strong>le</strong> voir en comparant <strong>le</strong>s chiffres du tab<strong>le</strong>au ci-dessous, <strong>le</strong>s élèves d’HB ont quasi<br />
systématiquement de meil<strong>le</strong>urs scores que <strong>le</strong>s autres élèves de la circonscription et que <strong>le</strong>s<br />
élèves de l’éco<strong>le</strong> témoin (éco<strong>le</strong> X) dans <strong>le</strong>s différents domaines des mathématiques. Les<br />
scores des élèves d’HB sont par ail<strong>le</strong>urs en amélioration, comme <strong>le</strong> montre l’histogramme des<br />
résultats de 00 à 00 , à l’exception de la chute en 00 dans <strong>le</strong> domaine des problèmes<br />
numériques, qui ne saurait être significative puisque cette baisse (assez importante par<br />
ail<strong>le</strong>urs, - points par rapport à 00 ) est corrélée à une forte baisse au niveau national.<br />
0<br />
00<br />
00<br />
00<br />
Numération<br />
Techniques<br />
opératoires<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Problèmes<br />
numériques Géométrie<br />
Traitement de<br />
l’information<br />
HB ,00% , 0% , 0% 0, 0% , 0%<br />
Éco<strong>le</strong> X , 0% , 0% , 0% , 0% , 0%<br />
Rab , 0% , 0% 0,00% , 0% , 0%<br />
Nat , 0% , 0% , 0% , 0% , 0%<br />
HB , 0% , 0% 0, 0% , 0% , 0%<br />
Éco<strong>le</strong> X , 0% 0, 0% , 0% , 0% , 0%<br />
Rab , 0% 0, 0% , 0% , 0% , 0%<br />
Nat 0, 0% , 0% , 0% , 0% , 0%<br />
HB , 0% , 0% , 0% , 0% , 0%<br />
Éco<strong>le</strong> X , 0% ,00% ,00% , 0% , 0%<br />
Rab , 0% , 0% , 0% , 0% , 0%<br />
Nat 0, 0% , 0% , 0% 0, 0% ,00%<br />
Tab<strong>le</strong>au score mathématiques 6 e , 2002-2004<br />
Je reproduis ici un histogramme qui offre une vision synthétique du tab<strong>le</strong>au et qui permet de<br />
visualiser l’évolution des résultats pour l’éco<strong>le</strong> HB.<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Comp. Out i l s. P r od. M oy enne Numér at i on Tec h. Opér . P r ob. Num. Géom. Tr ai t . Inf o<br />
Histogramme, scores 6e, 2002-2004<br />
2.3. Les résultats de 2005 : comparaison des distributions des scores globaux<br />
et évolution entre 2002 et 2005<br />
J’ai ajouté cette année un terme à la comparaison pour <strong>le</strong>s résultats en CE . Il s’agit d’une<br />
éco<strong>le</strong> parisienne, que j’appel<strong>le</strong>rai éco<strong>le</strong> C, située dans un quartier résidentiel, où <strong>le</strong>s élèves<br />
appartiennent à un milieu plus aisé que celui d’où proviennent <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> HB.<br />
2004<br />
2003<br />
2002
2.3.1. Français, CE2, effet positif de la variab<strong>le</strong> temporel<strong>le</strong><br />
Production Compréhension Reconnaissance des mots Écriture et orthographe Score moyen<br />
HB , , , , 71,4<br />
Éco<strong>le</strong> X , , , 67,3<br />
Éco<strong>le</strong> C , , , , 69,5<br />
Circ. , , , 68,6<br />
National , 0 , , – ,<br />
72,36<br />
Tab<strong>le</strong>au score 2005, CE2 français 1112<br />
Dans <strong>le</strong> domaine de la compréhension <strong>le</strong> score de 00 était de , 0% <strong>le</strong> plus haut depuis<br />
(qui était inférieur à 0%). Comme on peut <strong>le</strong> constater il a encore augmenté pour<br />
s’aligner sur <strong>le</strong> score national qui était de , % en 00 . L’éco<strong>le</strong> HB continue d’améliorer<br />
ses scores et se place mieux que l’éco<strong>le</strong> témoin, qui el<strong>le</strong> aussi améliore ses scores.<br />
Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong>s résultats dans <strong>le</strong>s autres domaines se maintiennent. Ils sont partout supérieurs<br />
à %. En 00 , <strong>le</strong> score était de , 0% en production et % en outils de la langue (qui<br />
regroupe des items des deux domaines écriture et orthographe et reconnaissance des mots).<br />
Le score moyen en production dépasse <strong>le</strong> score national, ce qui était déjà <strong>le</strong> cas en 00 ,<br />
où il était de %. On peut confirmer l’effet positif de la variab<strong>le</strong> GFX dans ce domaine en<br />
particulier où l’éco<strong>le</strong> HB continue de creuser l’écart avec l’éco<strong>le</strong> témoin. Notons éga<strong>le</strong>ment<br />
que <strong>le</strong>s résultats de l’éco<strong>le</strong> C ne dépassent jamais ceux de l’éco<strong>le</strong> HB.<br />
La comparaison par score moyen global montre que l’éco<strong>le</strong> HB s’aligne sur <strong>le</strong> score national<br />
en Français, totalisant un score moyen global supérieur au score national des éco<strong>le</strong>s en<br />
ZEP/REP, qui est égal à , %.<br />
2.3.2. Mathématiques, CE2<br />
Connaissance des Exploitation des Calcul Espace et Grandeurs Score moyen<br />
nombres entiers naturels données numériques<br />
géométrie et mesures global<br />
HB , , 0, 0, 60,7<br />
Éco<strong>le</strong> X , , , , 64,1<br />
Éco<strong>le</strong> C , , , , , 70,1<br />
Circ. , 0 , 0 , 0 , 0 69,70<br />
National , , , 0, , 70,85<br />
Tab<strong>le</strong>au score 2005, CE2 mathématiques<br />
Les deux domaines qui obtenaient jusque-là <strong>le</strong>s meil<strong>le</strong>urs scores, géométrie et mesure<br />
subissent des baisses de 0 points par rapport à 00 , aussi bien pour <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s HB et<br />
témoin que pour la circonscription et la France. On ne peut que constater cette baisse<br />
généralisée qui ne saurait être significative. Le seul domaine qui se maintient est celui de la<br />
connaissance des nombres qui connaît même une augmentation pour HB et l’éco<strong>le</strong> témoin<br />
où <strong>le</strong> score de 00 était respectivement de , % et , %. Notons la hausse en calcul<br />
et dans <strong>le</strong> domaine de l’exploitation des données numériques. Hausse, là encore que l’on<br />
constate pour tous. Nous ne pouvons dire plus si ce n’est que l’on a dépassé dans ces deux<br />
domaines qui restent fragi<strong>le</strong>s la barre des % pour la première fois depuis 00 .<br />
Globa<strong>le</strong>ment, si on compare <strong>le</strong> score moyen global, <strong>le</strong>s résultats de l’éco<strong>le</strong> HB restent<br />
Cela renvoie aux capacités de reconnaissance et de déchiffrage de mots. Par exemp<strong>le</strong> reconnaître<br />
dans une liste de mots proches visuel<strong>le</strong>ment, un mot rare lu par l’enseignant (cf. tab<strong>le</strong>au des compétences<br />
évaluées en français en CE , cahier de l’enseignant, 00 ).<br />
Il s’agit d’un champ de compétences transversal évalué à l’intérieur des trois autres qui correspondent<br />
à la nouvel<strong>le</strong> configuration des champs de compétences du français.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
inférieurs à ceux de la circonscription et à ceux de l’éco<strong>le</strong> témoin, mais aussi au score<br />
national ZEP/REP ( , %). Il y a peut-être là une zone où des progrès doivent encore être<br />
fait. Notons enfin que l’éco<strong>le</strong> HB continue à se distinguer en géométrie où <strong>le</strong> score est égal<br />
au score national.<br />
Enfin, l’histogramme ci-dessous donne une vision de l’évolution des résultats en CE de<br />
00 à 00 des élèves de l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher et illustre bien à la fois <strong>le</strong>s domaines dans<br />
<strong>le</strong>squels l’éco<strong>le</strong> progresse et <strong>le</strong>s domaines dans <strong>le</strong>squels même s’il n’y a pas de progrès<br />
notoires, <strong>le</strong> niveau se maintient. Il apparaît à la lumière de cet histogramme synthétique<br />
que <strong>le</strong> mode de travail des maîtres de cette éco<strong>le</strong>, outre ses résultats très positifs dans <strong>le</strong><br />
domaine de l’entrée dans l’écrit, pourrait-on dire, ne génère pas d’effets négatifs sur <strong>le</strong>s<br />
autres apprentissages au moins en CE .<br />
9 0 , 0 0 %<br />
8 0 , 0 0 %<br />
7 0 , 0 0 %<br />
6 0 , 0 0 %<br />
5 0 , 0 0 %<br />
4 0 , 0 0 %<br />
3 0 , 0 0 %<br />
2 0 , 0 0 %<br />
10 , 0 0 %<br />
0 , 0 0 %<br />
Comp Out ils Pr od Gé om M esur es t r av. Num Pr oblè mes n um or a<strong>le</strong> et<br />
Histogramme, évolution CE2, 2002-2005 13<br />
2.3.3. Français, 6 e , effet inverse ou neutre<br />
Comme <strong>le</strong> montre <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au ci-dessous, <strong>le</strong>s résultats en sixième sont toujours en baisse en<br />
production (comparés à ceux de 00 ) et sont moins bons qu’ail<strong>le</strong>urs mais restent égaux à<br />
ceux des autres élèves de la circonscription scolarisés au collège Rabelais, avec un score<br />
moyen en français qui atteint à peine <strong>le</strong>s 0%. L’effet positif de la variab<strong>le</strong> temporel<strong>le</strong> sur<br />
<strong>le</strong>s résultats du CE semb<strong>le</strong> ici s’estomper. Les élèves de l’éco<strong>le</strong> HB qui se distinguaient<br />
de <strong>le</strong>urs camardes en CE , retrouvent ici un niveau moyen avec un score moyen global de<br />
, % inférieur à celui des élèves de l’éco<strong>le</strong> témoin. Une baisse généralisée dans <strong>le</strong> domaine<br />
de la compréhension n’est pas significative d’une régression mais plutôt des incohérences<br />
internes des protoco<strong>le</strong>s qui ont été remaniés. Si la baisse dans <strong>le</strong> domaine de la production<br />
est lisib<strong>le</strong> partout, el<strong>le</strong> continue à être plus importante chez <strong>le</strong>s élèves d’Hélène Boucher et<br />
de la circonscription. On note cependant une amélioration du score dans <strong>le</strong> domaine des<br />
outils de la langue.<br />
Bien que <strong>le</strong> domaine « outils de la langue » n’apparaît plus en tant que tel dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au des<br />
compétences des évaluations de 00 , nous avons pu <strong>le</strong> recréer en regroupant des items correspondant aux<br />
outils pour lire et outils pour écrire, à savoir items pour <strong>le</strong> CE , et 0 items pour la sixième, re<strong>le</strong>vant de la<br />
capacité de reconnaître des mots d’analyser pour comprendre en CE et de l’écriture et l’orthographe en e .<br />
Des écarts de à points ne sont pas statistiquement significatifs. Étant donné que <strong>le</strong>s calculs sont<br />
fait à partir d’échantillons, des erreurs d’échantillonnage surviennent donc fata<strong>le</strong>ment (Brézillon et al., 00 ).<br />
Cf. note .<br />
Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 00 .<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
é cr it e<br />
M oyen n e<br />
2 0 0 5<br />
2 0 0 4<br />
2 0 0 3<br />
2 0 0 2
Production de textes Compréhension Outils Score moyen<br />
HB 0 ( , 0) , ( , ) , ( , ) ,<br />
Éco<strong>le</strong> X , ( ) , ( , ) , ( , ) ,<br />
Circ/Rabelais , ( , 0) ( , 0) Non disponib<strong>le</strong> Non disponib<strong>le</strong><br />
( , 0)<br />
National , ( 0, ) , ( , ) , ( , ) ,<br />
2.3.4. Mathématiques 6 e<br />
Connaissance des<br />
nombres entiers naturels<br />
HB , ( , ) , ( , 0%)<br />
Éco<strong>le</strong> X , ( , ) , ( , 0%)<br />
Circ./Rabelais , ( , ) , ( , 0%)<br />
Tab<strong>le</strong>au score 2005, Français sixième<br />
Exploitation des<br />
données numériques Calcul<br />
National , ( 0, ) , ( ,00%)<br />
,<br />
( , )<br />
,<br />
( )<br />
,<br />
( , )<br />
,<br />
( , )<br />
Espace et<br />
géométrie<br />
Tab<strong>le</strong>au score 2005, Mathématiques 6 e<br />
Grandeurs et<br />
mesures<br />
0, ( , ) , ( , ) ,<br />
( , ) , ( ) ,<br />
, ( , ) , ( , )<br />
, ( 0) 0,0 ( , ) ,<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Score moyen<br />
global<br />
Non<br />
disponib<strong>le</strong><br />
Mise à part la baisse généralisée et assez remarquab<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> domaine de la connaissance<br />
des nombres, qui ne saurait être pertinente pour notre propos, on constate une amélioration<br />
en 00 par rapport à 00 . Cette amélioration, on la constate pour tous. Le comportement<br />
des élèves de l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher n’est pas différent de celui des autres élèves dans<br />
ce sens, mais ils ont malgré tout, partout, un score supérieur à ceux des élèves de la<br />
circonscription, et dans deux domaines sur trois à ceux des élèves de l’éco<strong>le</strong> témoin. C’est<br />
<strong>le</strong> domaine des grandeurs et mesures qui paraît <strong>le</strong> plus fragi<strong>le</strong> et où <strong>le</strong>s progrès restent en<br />
deçà de la moyenne. Il est à noter que <strong>le</strong>s résultats en sixième sont meil<strong>le</strong>urs dans des<br />
domaines qui posent problème en CE , <strong>le</strong> calcul et <strong>le</strong>s problèmes numériques. Le retard qui<br />
peut apparaître en CE semb<strong>le</strong> se résorber en sixième.<br />
Notons, <strong>le</strong> score moyen global en mathématique des élèves d’HB est supérieur à celui<br />
des autres élèves (circonscription et éco<strong>le</strong> témoin comprises) et à celui du score ZEP/REP<br />
national qui est de , %.<br />
Pour finir, l’histogramme suivant offre une vision synthétique de l’évolution des scores des<br />
élèves de l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher en français et en mathématiques de 00 à 00 .<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Comp.<br />
Outils.<br />
Prod.<br />
Prob. Num.<br />
Trait. Info<br />
Histogramme, Mathématiques, Français, 6 e , 2002-2005<br />
Moyenne<br />
00<br />
00<br />
00<br />
00
2.4 À propos de l’effet de la variab<strong>le</strong> temporel<strong>le</strong> en français<br />
Afin de vérifier dans quel<strong>le</strong> mesure <strong>le</strong>s enfants de l’éco<strong>le</strong> HB arrivant en e perdent <strong>le</strong>urs<br />
moyens en français dans <strong>le</strong>s domaines du français j’ai pris <strong>le</strong> parti de comparer <strong>le</strong>s résultats<br />
globaux en CE à ceux obtenus trois années plus tard en sixième afin de vérifier si <strong>le</strong>s<br />
scores chutent significativement entre <strong>le</strong> CE et la e depuis 00 . Le tab<strong>le</strong>au suivant tente<br />
de rendre compte de cette comparaison .<br />
HB<br />
Éco<strong>le</strong> X<br />
HB<br />
Éco<strong>le</strong> X<br />
HB<br />
Éco<strong>le</strong> X<br />
HB<br />
Éco<strong>le</strong> x<br />
Compréhension Production Outils<br />
CE2 1999 6 e 2002 CE2 1999 6 e 2002 CE2 1999 6 e 2002<br />
, % , % , % , % , % , %<br />
, % , % , % , % , % , %<br />
CE2 2000 6 e 2003 CE2 2000 6 e 2003 CE2 2000 6 e 2003<br />
0,00% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0%<br />
,00% , 0% , 0% , 0% , 0% , 0%<br />
CE2 2001 6 e 2004 CE2 2001 6 e 2004 CE2 2001 6 e 2004<br />
, 0% , 0% , 0% , 0% 0, % , 0%<br />
, 0% , 0% , 0% , 0% 0, % , 0%<br />
CE2 2002 6 e 2005 CE2 2002 6 e 2005 CE2 2002 6 e 2005<br />
, 0% , 0% , 0% 0,00% , 0% , %<br />
0, 0% , % , 0% , 0% , 0% , 0%<br />
Tab<strong>le</strong>au comparatif CE2-6e, Français<br />
Ce tab<strong>le</strong>au montre tout d’abord que dans <strong>le</strong> domaine de la compréhension, à l’exception de<br />
l’année 00 qui, comme on l’a vu, a connu une chute généralisée dans ce domaine, <strong>le</strong> gain<br />
est net entre <strong>le</strong> CE et la sixième. Les résultats des élèves d’HB sont systématiquement<br />
meil<strong>le</strong>urs en e qu’en CE et cela est d’autant plus intéressant que ce ne semb<strong>le</strong> pas être<br />
systématiquement <strong>le</strong> cas pour <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> témoin. Dans ce domaine au moins<br />
l’effet de la variab<strong>le</strong> temporel<strong>le</strong> est positif. Dans <strong>le</strong> domaine des outils de la langue, c’est<br />
<strong>le</strong> contraire qui se produit, <strong>le</strong>s scores sont systématiquement et nettement moins bons en<br />
e qu’en CE pour <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> HB. C’est <strong>le</strong> cas pour <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> témoin<br />
jusqu’en 00 . Pour <strong>le</strong>s deux générations 00 - 00 et 00 - 00 , la tendance semb<strong>le</strong><br />
s’inverser ou du moins s’équilibrer.<br />
On peut dire alors que, dans ce domaine précis, l’effet des bénéfices du mode de travail<br />
pédagogique propre à l’éco<strong>le</strong> HB dont <strong>le</strong>s élèves tiraient profit en CE disparaît complètement<br />
trois ans plus tard, mais il n’apparaît pas comme pénalisant pour autant et pour l’instant.<br />
En ce qui concerne la production d’écrits, on avait montré une chute constante en e depuis<br />
00 mais lorsque l’on compare <strong>le</strong>s résultats en terme de cohorte d’élèves même si ce ne<br />
sont pas exactement <strong>le</strong>s mêmes élèves dont on est train de comparer <strong>le</strong>s résultats , on se<br />
rend compte de l’effet contraire. En effet, <strong>le</strong>s élèves qui entrent en e en 00 obtiennent,<br />
dans <strong>le</strong> domaine de la production, <strong>le</strong> doub<strong>le</strong> du score qu’ils avaient obtenus en lorsqu’ils<br />
étaient en CE . Cela peut-il être mis sur <strong>le</strong> compte de l’enthousiasme généré par l’arrivée<br />
de la nouvel<strong>le</strong> équipe un an plus tôt (en 00 ) et l’introduction de nouvel<strong>le</strong>s manières de<br />
La <strong>le</strong>cture du tab<strong>le</strong>au sera facilitée si on procède par colonne. Une <strong>le</strong>cture vertica<strong>le</strong> sera donc plus<br />
pertinente qu’une <strong>le</strong>cture horizonta<strong>le</strong>.<br />
Entre <strong>le</strong> CE et la e , il y a toujours une perte d’élèves, sans compter avec <strong>le</strong>s éventuel<strong>le</strong>s absences<br />
lors des évaluations.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
travail<strong>le</strong>r ?<br />
Notons cependant que cette tendance est en train de s’inverser pour <strong>le</strong>s générations suivantes<br />
( 00 - 00 et 00 - 00 ). Diminution de l’enthousiasme ? Les résultats des élèves de<br />
l’éco<strong>le</strong> témoin qui continuent à être moins bons en e qu’en CE tendent néanmoins à se<br />
rapprocher.<br />
Afin d’encore mieux affiner ces résultats nous avons procédé à la comparaison des résultats<br />
des mêmes élèves en 000 lorsqu’ils étaient en CE puis en 00 lorsqu’ils entraient en e<br />
sur <strong>le</strong>s items de production (exercices et en CE et exercices, , et 0 en e , selon<br />
<strong>le</strong>s années) et nous avons répété l’opération pour <strong>le</strong>s élèves de CE en 00 qui entraient<br />
en e en 00 .<br />
2.4.1. CE2-6 e , suivi d’une cohorte d’élèves<br />
En 000, élèves de l’éco<strong>le</strong> HB sont concernés par ce calcul. Ces élèves ont obtenu <strong>le</strong><br />
score de , % de réussite à l’exercice de production. Ces mêmes enfants obtiennent <strong>le</strong><br />
score de , % en e trois années plus tard. Ce qui confirme <strong>le</strong>s résultats de notre tab<strong>le</strong>au<br />
général pour 000- 00 .<br />
En 00 , élèves de l’éco<strong>le</strong> HB sont concernés par ce calcul. Ils ont obtenu <strong>le</strong> score de<br />
, % de réussite en production. Ils obtiennent en 00 , , %. Ce qui là encore confirme<br />
<strong>le</strong>s résultats du tab<strong>le</strong>au. Le mode de travail « Freinet » de l’éco<strong>le</strong> HB ne semb<strong>le</strong> pas produire<br />
un effet particulier sur <strong>le</strong>s élèves à l’entrée en e dans ce domaine. Il faudrait attendre<br />
encore <strong>le</strong>s résultats des évaluations 00 et 00 pour savoir si la tendance continue à<br />
s’inverser entre CE et e au profit du CE alors qu’el<strong>le</strong> s’équilibre ail<strong>le</strong>urs. Nous manquons<br />
d’éléments de comparaison suffisants pour juger. Les élèves de l’éco<strong>le</strong> témoin qui sont à<br />
être concernés par ce calcul obtiennent un score de , % de réussite en CE en 00 et<br />
un score comparab<strong>le</strong> en e , %, ce qui encore une fois confirme <strong>le</strong>s tendances globa<strong>le</strong>s<br />
qu’on pouvait voir dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au ci-dessus. Ces mêmes tendances ont été observées par<br />
B. Daunay en ce qui concerne la grammaire et l’orthographe.<br />
Il faudrait néanmoins être prudent avec ces résultats car ils ne concernent pas la totalité<br />
des élèves mais uniquement ceux qui sont scolarisés à HB et qui rentrent en e au collège<br />
Rabelais à l’exception des autres collèges.<br />
2.5. Fragilités et forces : scores dans certains types d’items<br />
Le premier <strong>tome</strong> du présent rapport a permis de mettre <strong>le</strong> doigt, à travers diverses<br />
contributions, sur <strong>le</strong>s points forts et <strong>le</strong>s points faib<strong>le</strong>s décelab<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong>s productions des<br />
élèves en français. Dans la continuité, je cherche ici à mieux appréhender à quel niveau se<br />
produisent <strong>le</strong>s effets du mode de travail des maîtres de l’éco<strong>le</strong> HB. Je rappel<strong>le</strong> que seu<strong>le</strong> la<br />
discipline français est concernée ici.<br />
Les comparaisons que je vais opérer ici entre taux de réussite à des items spécifiques<br />
concerneront <strong>le</strong>s années 00 et 00 et se focaliseront sur <strong>le</strong>s résultats en e car c’est à<br />
ce niveau-là que des faib<strong>le</strong>sses peuvent apparaître. Dans la mesure où <strong>le</strong>s résultats en CE<br />
sont plus que bons, il nous semb<strong>le</strong> plus pertinent de nous attacher à spécifier <strong>le</strong>s difficultés<br />
qui apparaissent plus tard.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
2.5.1. Des problèmes d’orthographe et de syntaxe ?<br />
Dans sa contribution au <strong>tome</strong> de ce rapport, Y. Reuter avait noté des problèmes en<br />
orthographe et en syntaxe au niveau du CM quelquefois plus importants qu’ail<strong>le</strong>urs. Il<br />
constate à partir de ses données que <strong>le</strong>s problèmes d’orthographe sont plus importants que<br />
<strong>le</strong>s problèmes de syntaxe et que <strong>le</strong>s progrès dans ce domaine semb<strong>le</strong>nt minimes.<br />
C’est une raison supplémentaire pour nous intéresser aux résultats en sixième pour voir si<br />
cette tendance annonce un retard qui se poursuit ou pas. D’autant plus que si l’on examine<br />
<strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au des réussites dans <strong>le</strong> domaine de l’écriture et l’orthographe de l’année 00 ,<br />
en annexe , on ne constate pas de problèmes particuliers au niveau du CE . Bien au<br />
contraire <strong>le</strong>s scores sont très souvent supérieurs pour <strong>le</strong>s élèves d’HB que pour ceux de<br />
l’éco<strong>le</strong> témoin y compris dans des domaines délicats comme celui de la dérivation avec <strong>le</strong>s<br />
trois items autour de la reconnaissance et usage de préfixes. Les performances, comme <strong>le</strong><br />
montre <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au, sont nettement meil<strong>le</strong>ures dans <strong>le</strong> domaine des accords dans <strong>le</strong> groupe<br />
nominal et <strong>le</strong>s accords sujet-verbe (mesurés sur un seul item).<br />
Pour revenir au problème de l’orthographe, l’examen du tab<strong>le</strong>au en annexe, qui présente<br />
<strong>le</strong>s taux de réussite aux évaluations de 00 aux différents items du domaine de la maîtrise<br />
des outils de la langue et de l’orthographe, confirme la faib<strong>le</strong>sse des élèves de l’éco<strong>le</strong> HB. On<br />
peut <strong>le</strong> voir pour <strong>le</strong>s items à et à re<strong>le</strong>vant de la maîtrise de l’orthographe <strong>le</strong>xica<strong>le</strong>.<br />
Cette faib<strong>le</strong>sse orthographique est confirmée par <strong>le</strong>s scores de réussite aux évaluations de<br />
00 , aux items orthographiques ( et ), dans <strong>le</strong> domaine de la production.<br />
No. de l’item Description de l’item<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Pourcentage de<br />
réussite<br />
FRA0 Produire un texte 0% , %<br />
FRA0 Segmenter un texte en phrases , % , %<br />
FRA0 Accorder <strong>le</strong> verbe % 0,0%<br />
FRA0 Effectuer <strong>le</strong>s accords dans <strong>le</strong> GN % , %<br />
FRA0 Assurer la cohérence verba<strong>le</strong> , % , %<br />
FRA0 Écrire lisib<strong>le</strong>ment , % , %<br />
FRA0 0 Respecter des contraintes , % , %<br />
FRA0 Respecter des contraintes , % 0,0%<br />
FRA0 Assurer la cohérence verba<strong>le</strong> , % , %<br />
FRA0 Utiliser <strong>le</strong>s substituts de manière cohérente , % , %<br />
FRA0 Segmenter un texte en phrases , % , %<br />
FRA0<br />
Écrire des phrases syntaxiquement<br />
correctes<br />
, % , %<br />
FRA0 Maîtriser l’orthographe grammatica<strong>le</strong> 00,00% 0 , %<br />
FRA0 Maîtriser l’orthographe <strong>le</strong>xica<strong>le</strong> 0 , % , %<br />
HB<br />
Tab<strong>le</strong>au scores 6 e , 2005, produire un texte<br />
Pourcentage de<br />
réussite<br />
Éco<strong>le</strong> X<br />
Comme <strong>le</strong> montrent <strong>le</strong>s résultats aux items et , <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> HB ont éga<strong>le</strong>ment<br />
plus de difficultés, du point de vue des protoco<strong>le</strong>s, avec l’emploi des temps verbaux. En<br />
revanche, <strong>le</strong>s résultats à l’item , montrent qu’ils ont de meil<strong>le</strong>urs scores dans la gestion<br />
de l’anaphore. Cette plus grande facilité avec l’usage des éléments textuels cohésifs était<br />
déjà visib<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s scores de 00 . Si on consulte de nouveau <strong>le</strong> troisième tab<strong>le</strong>au, en<br />
annexe , on constate que <strong>le</strong>s élèves d’HB ont des scores nettement supérieurs à ceux des<br />
élèves de l’éco<strong>le</strong> témoin aux items et qui testent la capacité à identifier <strong>le</strong>s référents<br />
des substituts <strong>le</strong>xicaux et pronominaux.<br />
Ceci rentre en résonance avec <strong>le</strong>s remarques d’Y. Reuter autour de la production textuel<strong>le</strong><br />
où ses résultats montraient (cf. <strong>tome</strong> du présent rapport) que <strong>le</strong>s élèves d’HB ont des<br />
productions textuel<strong>le</strong>ment et tendanciel<strong>le</strong>ment mieux structurées que des élèves de milieu<br />
comparab<strong>le</strong>.
2.5.2. Et <strong>le</strong> méta ?<br />
D. Lahanier Reuter avait montré dans sa contribution au premier <strong>tome</strong> de ce rapport que <strong>le</strong>s<br />
maniements méta en mathématiques sont insuffisants en terme de manipulation de termes<br />
techniques. B. Daunay et Y. Reuter montrent la même chose pour <strong>le</strong> français. Cette carence<br />
dans l’usage du vocabulaire technique peut expliquer <strong>le</strong>s difficultés que l’on retrouve au<br />
niveau de la sixième avec des scores qui restent faib<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong> domaine de la formation<br />
des mots (dérivation, reconnaissance et usages de préfixes et suffixes), en dessous de 0%<br />
de réussite. Des scores nettement moins bons que ceux des élèves de l’éco<strong>le</strong> témoin sans<br />
que la différence soit spectaculaire.<br />
No. de l’item Description de l’item Pourcentage HB Pourcentage<br />
éco<strong>le</strong> X<br />
FRA00 Retrouver un adjectif ,0% 00,0%<br />
FRA00 Dériver un mot , % , %<br />
FRA00 Dériver un mot , % , %<br />
FRA0 Dériver un mot , % 0,0%<br />
Tab<strong>le</strong>au scores 6e, 2005, formation des mots<br />
2.6. Dispersion des élèves : homogénéité des résultats<br />
L’étude de la répartition des élèves selon <strong>le</strong>s scores obtenus permet de juger de l’homogénéité<br />
ou de l’hétérogénéité d’une classe. Afin de mettre à l’épreuve l’hypothèse de l’homogénéité<br />
des résultats des élèves de l’éco<strong>le</strong> HB, nous avons étudié la répartition des scores dans <strong>le</strong>s<br />
deux disciplines : français et mathématiques, en CE et en e , sur <strong>le</strong>s trois dernières années.<br />
Les logiciels J’ADE et Casimir permettent d’obtenir des histogrammes de la répartition des<br />
scores des élèves, qu’il ne nous a pas été possib<strong>le</strong> d’importer pour <strong>le</strong>s reproduire ici.<br />
L’examen des histogrammes montre sur <strong>le</strong>s trois dernières années une homogénéité plus<br />
grande du comportement des élèves de l’éco<strong>le</strong> HB en CE comparativement à ceux de<br />
l’éco<strong>le</strong> témoin. En sixième, on ne peut guère affirmer qu’ils ont des scores plus homogènes.<br />
La situation est plutôt équilibrée et variab<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> temps.<br />
Pour rendre compte de cette plus forte homogénéité, j’ai calculé l’amplitude entre <strong>le</strong> plus<br />
bas score et <strong>le</strong> plus haut pour chacune des deux éco<strong>le</strong>s et pour chacune des disciplines. Il<br />
s’agit de calcu<strong>le</strong>r <strong>le</strong> nombre de points qui sépare <strong>le</strong> plus bas score du plus haut.<br />
CE 00 00 00<br />
HB Éco<strong>le</strong> x HB Éco<strong>le</strong> X HB Éco<strong>le</strong> X<br />
Maths 0<br />
Français 0, 0 0<br />
Tab<strong>le</strong>au amplitude des scores CE2, 2002-2005<br />
À l’exception du domaine des mathématiques en 00 , l’amplitude des scores est souvent<br />
de plusieurs dizaines de points inférieure pour <strong>le</strong>s élèves d’HB que pour <strong>le</strong>s autres. Le<br />
tab<strong>le</strong>au suivant résume la situation pour la sixième où la situation est plus contrastée, ce qui<br />
rend la différence au niveau du CE encore plus saillante.<br />
Sixième 00 00 00<br />
HB Éco<strong>le</strong> x HB Éco<strong>le</strong> X HB Éco<strong>le</strong> X<br />
Maths 0 0<br />
Français<br />
Tab<strong>le</strong>au amplitude des scores 6e, 2002-2005<br />
Les élèves de HB tendent à se comporter de manière comparab<strong>le</strong>. L’amplitude de l’écart<br />
entre <strong>le</strong>s scores moyens est bien moins forte qu’à l’éco<strong>le</strong> témoin où <strong>le</strong>s élèves sont davantage<br />
dispersés. Les différentes contributions au <strong>tome</strong> du rapport avaient déjà mis en évidence<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
une certaine homogénéité des résultats et une moindre dispersion des élèves de l’éco<strong>le</strong> HB<br />
avait été notée en français par Y. Reuter et en mathématiques par D. Lahanier Reuter. De<br />
son côté, l’étude de B. Daunay sur <strong>le</strong> métalangage montre qu’il y a éga<strong>le</strong>ment une moindre<br />
dispersion des résultats des élèves d’HB par rapport à l’éco<strong>le</strong> témoin. L’écart à la moyenne<br />
tend à se resserrer chez <strong>le</strong>s premiers. Cette moindre dispersion des résultats des élèves<br />
renvoie à une certaine homogénéité du comportement des élèves qui peut être mise en<br />
rapport avec la nature « coopérative » de la pédagogie qui résulterait dans <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong>s<br />
élèves profitent de manière éga<strong>le</strong> des apprentissages.<br />
Cette homogénéité peut aussi être mise en rapport avec une plus grande cohérence dans<br />
<strong>le</strong> codage des résultats de la part des maîtres sans qu’on puisse véritab<strong>le</strong>ment établir<br />
une relation de cause à effet entre cohérence et constance du codage des résultats et<br />
comportements similaires des élèves à l’égard des exercices.<br />
J’ai tenté à travers l’analyse d’un matériel spécifique : <strong>le</strong>s résultats aux évaluations nationa<strong>le</strong>s<br />
à l’entrée en CE et en e , qui obéissent à une logique institutionnel<strong>le</strong> particulière, de rendre<br />
compte des effets d’un mode de travail « Freinet » dans une éco<strong>le</strong> qui a connu de graves<br />
dysfonctionnements avant l’arrivée de l’équipe pédagogique actuel<strong>le</strong>.<br />
Je pense avoir réussi cette entreprise peu aisée, compte tenu des limites méthodologiques<br />
d’un tel travail, limites que j’ai rappelées au début de mon travail. À l’aide des autres<br />
contributions de ce rapport et du précédent, j’ai pu montrer des effets spécifiques relativement<br />
nets concernant <strong>le</strong>s savoirs en français. Cette spécificité vient du fait que <strong>le</strong>s effets observés<br />
ici vont dans <strong>le</strong> même sens que d’autres observations, que j’ai éga<strong>le</strong>ment rappelées chemin<br />
faisant. C’est dans cette mesure qu’ils peuvent être mis en rapport avec <strong>le</strong> mode de travail<br />
des maîtres de l’éco<strong>le</strong> HB en tant qu’il génère en partie ces effets spécifiques.<br />
Je dois néanmoins sou<strong>le</strong>ver la question de l’évaluation d’un mode de travail pédagogique<br />
qui, comme tout autre, génère des attentes et des compétences que l’on ne retrouve pas<br />
traduites dans <strong>le</strong>s exercices des protoco<strong>le</strong>s d’évaluation nationa<strong>le</strong>. Des compétences qui ne<br />
sont pas toujours mesurab<strong>le</strong>s en terme de critères « linguistiques », pour <strong>le</strong> français. Il est<br />
clair à titre d’exemp<strong>le</strong>, que <strong>le</strong>s compétences évaluées à travers <strong>le</strong>s exercices proposés ne<br />
concernent, dans <strong>le</strong> domaine de la production, ni l’imagination, ni la qualité de la narration,<br />
ni <strong>le</strong>s contenus.<br />
Les scores aux évaluations nationa<strong>le</strong>s, limités au français et aux mathématiques 0 , ne<br />
rendent pas compte non plus de l’émergence de nouvel<strong>le</strong>s compétences (ou compétences<br />
spécifiques) développées grâce à ce mode de travail que des observations assidues dans<br />
<strong>le</strong>s sal<strong>le</strong>s de classes permettent de dégager, comme <strong>le</strong> montrent ici même D. Lahanier-<br />
Reuter pour <strong>le</strong>s mathématiques, Y. Reuter pour <strong>le</strong> français ou encore C. Cohen-Azria pour<br />
<strong>le</strong>s sciences, sans oublier l’éducation civique.<br />
Enfin, concernant la pédagogie Freinet et s’agissant d’une conception particulière de<br />
l’enfant et de l’élève (Reuter, Jovenet), de l’éducation et de la « transmission des savoirs »,<br />
je voudrais conclure sur <strong>le</strong> fait qu’il est tout à fait remarquab<strong>le</strong> d’observer comment une<br />
pédagogie « alternative » forme des élèves qui semb<strong>le</strong>nt ne pas perdre <strong>le</strong>urs moyens face<br />
à des exercices dont ils ne sont pas familiers : ceux des protoco<strong>le</strong>s d’évaluation, que ce soit<br />
Le maître attribue un code allant de pour une réponse exacte à , pour une réponse erronée, pour<br />
chaque item testé, sachant qu’un exercice peut contenir un ou plusieurs items.<br />
0 Et on est en droit de s’interroger sur cette exclusivité.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
au sein même de l’éco<strong>le</strong> ou en dehors d’el<strong>le</strong> au collège. Je souhaite dans ce cadre sou<strong>le</strong>ver<br />
une question qui, à mon sens recouvre des enjeux éducatifs importants : comment une tel<strong>le</strong><br />
pédagogie compose avec <strong>le</strong>s exigences programmatiques et <strong>le</strong>s pressions socia<strong>le</strong>s et<br />
institutionnel<strong>le</strong>s sans perdre un peu, beaucoup, de son idéal ?<br />
Bibliographie<br />
Brezillon G., Chol<strong>le</strong>t-Remvikos P., Dupe C., Rebmeister B. et Zelly C. ( 00 ), « Évaluations<br />
CE -sixième. Repères nationaux, septembre 00 », Les Dossiers Enseignement Scolaire,<br />
n ° , mars 00 , MENSR-DEP.<br />
Brezillon G., Chol<strong>le</strong>t P. et Dauphin L. ( 00 ), « Les réponses des élèves de CE à l’évaluation<br />
de septembre 00 », note-évaluation, 0 .0 , MENESR-DEP, mai 00 .<br />
Hassan-Pilartz R. ( 00 ), « Évaluations nationa<strong>le</strong>s à l’entrée en CE et e , évolutions, mise<br />
en perspective, problèmes » dans Y. Reuter, dir., Démarches pédagogiques et lutte contre<br />
l’échec scolaire ; Rapport de recherche, Erte n° 0 , <strong>tome</strong> , Vil<strong>le</strong>neuve d’Ascq, Université<br />
Lil<strong>le</strong> , -<br />
Reuter Y. (dir.) ( 00 ) Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire ; Rapport de<br />
recherche, Erte n° 0 , <strong>tome</strong> , Vil<strong>le</strong>neuve d’Ascq, Université Lil<strong>le</strong><br />
Annexes<br />
Annexe 1 : protoco<strong>le</strong>s d’évaluation<br />
Que ce soit en e ou en CE , <strong>le</strong>s connaissances sont évaluées dans deux disciplines Français<br />
et Mathématiques. Chacune des disciplines est divisée en champs et des capacités relatives<br />
à chaque champ sont ainsi évaluées. Chaque exercice contient un ou plusieurs items reliés<br />
à une capacité sachant que la même capacité peut être testée dans deux champs différents.<br />
Pour prendre un exemp<strong>le</strong>, dans <strong>le</strong> protoco<strong>le</strong> e de 00 , on iso<strong>le</strong> la capacité « analyser<br />
une situation, organiser une démarche », qu’on peut retrouver dans <strong>le</strong>s champs des<br />
mathématiques (géométrie, numération, traitement de l’information, techniques opératoires<br />
et problèmes numériques). C’est pourquoi <strong>le</strong>s résultats sont présentés par champ et non<br />
par capacité.<br />
Les compétences et capacités évaluées sont <strong>le</strong>s suivantes :<br />
En mathématiques on distingue champs de connaissances : travaux géométriques,<br />
numération ora<strong>le</strong> et écrite, travaux numériques, repérage et mesure, traitement de données<br />
et résolution de problèmes. Cette division est la même pour <strong>le</strong> CE et la e même si un<br />
changement dans la nomenclature intervient. Les capacités évaluées sont : rechercher<br />
l’information, analyser une situation, appliquer une technique, produire une réponse et<br />
appliquer une connaissance.<br />
En ce qui concerne <strong>le</strong> français, on distingue deux grands champs : savoir lire d’une part,<br />
savoir écrire de l’autre. Chacun est à son tour divisé en deux autres champs : comprendre un<br />
texte et maîtriser <strong>le</strong>s outils de la langue pour lire d’une part, maîtriser <strong>le</strong>s outils de la langue<br />
J’évacue un peu vite ici la pluralité des pratiques et des conceptions qui peuvent se réclamer de la<br />
pédagogie Freinet.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
pour écrire et produire un texte d’autre part. Ces champs sont déclinés en trois capacités :<br />
la compréhension ( composantes : comprendre un message oral, construire <strong>le</strong> sens global<br />
d’un texte, mettre en relation des informations, pré<strong>le</strong>ver des informations) <strong>le</strong>s outils de la<br />
langue ( composantes : maîtriser <strong>le</strong>s outils de la langue pour comprendre et pour se faire<br />
comprendre) et la production ( composantes : maîtriser <strong>le</strong>s contraintes matériel<strong>le</strong>s, créer<br />
et construire un texte cohérent).<br />
Parmi <strong>le</strong>s compétences évaluées, certains exercices ou items, sont relatifs aux compétences<br />
de base ou jugées nécessaires pour « profiter p<strong>le</strong>inement des situations pédagogiques » du<br />
cyc<strong>le</strong>.<br />
Codage des résultats<br />
Un cahier contenant <strong>le</strong>s exercices est donné à chaque élève. Les évaluations ont lieu<br />
pendant la première semaine d’octobre généra<strong>le</strong>ment. L’enseignant attribue ensuite un<br />
code à chaque item du protoco<strong>le</strong> selon qu’il est réussi ou pas. Ce code est un chiffre qui va<br />
de 0 à . 0 sert à coder une absence de réponse. et sont des codes de réussite. C’est<br />
ceux que nous prenons en compte lors du calcul des scores de réussite. et sont des<br />
codes de réponses partiel<strong>le</strong>s. renvoie à ce qui peut être interprété comme une mauvaise<br />
<strong>le</strong>cture de la consigne. , et renvoient à une réponse erronée spécifiée et désigne une<br />
réponse erronée.<br />
00<br />
Annexe 2 : taux de réussites à des items spécifiques à un domaine<br />
*Tab<strong>le</strong>au 1. CE2 2004, éco<strong>le</strong> témoin, taux de réussite, items de production<br />
No. de<br />
l’item<br />
Description de l’item Réussites Pourcentage<br />
FRA0 S’aider d’un texte - exemp<strong>le</strong> et d’un tab<strong>le</strong>au pour rédiger un autre texte s’insérant<br />
dans un dialogue<br />
| 0.0%<br />
FRA0 S’aider d’un texte - exemp<strong>le</strong> et d’un tab<strong>le</strong>au pour rédiger un autre texte s’insérant<br />
dans un dialogue<br />
| . %<br />
FRA0 S’aider d’un texte - exemp<strong>le</strong> et d’un tab<strong>le</strong>au pour rédiger un autre texte s’insérant | . %<br />
dans un dialogue<br />
FRA0 S’inspirer d’un texte structuré et d’un dessin (portrait) pour produire un nouveau texte | . %<br />
FRA0 S’inspirer d’un texte structuré et d’un dessin (portrait) pour produire un nouveau texte | . %<br />
FRA0 S’inspirer d’un texte structuré et d’un dessin (portrait) pour produire un nouveau texte | 0.0%<br />
FRA0 Produire un texte syntaxiquement correct à partir d’un modè<strong>le</strong> | . %<br />
FRA0 0 Produire un récit en cohérence avec une situation initia<strong>le</strong> et une situation fina<strong>le</strong> | . %<br />
FRA0 Produire un récit en cohérence avec une situation initia<strong>le</strong> et une situation fina<strong>le</strong> 0 | . %<br />
FRA0 Produire un récit en cohérence avec une situation initia<strong>le</strong> et une situation fina<strong>le</strong> | 0.0%<br />
FRA0 Développer un scénario qui légitime l’issue du texte | . %<br />
FRA0 Développer un scénario qui légitime l’issue du texte | . %<br />
FRA0 Adopter un registre d’écriture (système des temps, dialogue, etc.) pertinent et correct | . %<br />
FRA0 Adopter un registre d’écriture (système des temps, dialogue, etc.) pertinent et correct | . %<br />
FRA0 Adopter un registre d’écriture (système des temps, dialogue, etc.) pertinent et correct | . %<br />
No. de l’item Description de l’item<br />
*Tab<strong>le</strong>au 2. CE2, 2005, Écriture et orthographe<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Pourcentage<br />
de<br />
réussite HB<br />
Pourcentage de<br />
réussite<br />
Éco<strong>le</strong> X<br />
FRA0 0 associer un mot polysémique à sa définition , % , %<br />
FRA0 effectuer des remplacements en passant du singulier au pluriel , % , %<br />
FRA0 effectuer des remplacements en passant du singulier au pluriel , % ,0%<br />
FRA0 effectuer des remplacements en passant du singulier au pluriel , % , %<br />
FRA0 effectuer des remplacements en passant du singulier au pluriel , % , %<br />
FRA0 effectuer des remplacements en passant du singulier au pluriel , % , %<br />
FRA0 effectuer des remplacements en passant du singulier au pluriel , % , %<br />
FRA0 dans une dictée, marquer <strong>le</strong>s accords sujet-verbe , % 0, %<br />
FRA0 dans une dictée, marquer <strong>le</strong>s accords dans <strong>le</strong> groupe nominal ,0% , %
No. de l’item Description de l’item<br />
Pourcentage<br />
de<br />
réussite HB<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Pourcentage de<br />
réussite<br />
Éco<strong>le</strong> X<br />
FRA0 dans une dictée, marquer <strong>le</strong>s accords dans <strong>le</strong> groupe nominal , % , %<br />
FRA0 dans une dictée, marquer <strong>le</strong>s accords dans <strong>le</strong> groupe nominal , % , %<br />
FRA0 dans une dictée, savoir orthographier <strong>le</strong>s mots simp<strong>le</strong>s , % , %<br />
FRA0 dans une dictée, savoir orthographier <strong>le</strong>s mots simp<strong>le</strong>s 0, % , %<br />
FRA0 dans une dictée, savoir orthographier <strong>le</strong>s mots simp<strong>le</strong>s , % 0, %<br />
FRA0 dans une dictée, savoir orthographier <strong>le</strong>s petits mots 00,0% , %<br />
FRA0 dans une dictée, savoir orthographier <strong>le</strong>s petits mots , % , %<br />
FRA0 0 dans une dictée, savoir orthographier <strong>le</strong>s petits mots , % , %<br />
FRA0 dans une dictée, mettre la majuscu<strong>le</strong> ,0% , %<br />
FRA0 dans une dictée, mettre <strong>le</strong> point final , % , %<br />
FRA0 associer un mot polysémique à sa définition , % ,0%<br />
FRA0 copier intégra<strong>le</strong>ment deux phrases , % , %<br />
FRA0 employer une écriture lisib<strong>le</strong> 00,0% 00,0%<br />
FRA0 employer une écriture cursive 00,0% 00,0%<br />
FRA0 copier deux phrases sans erreur d’orthographe , % , %<br />
FRA0 en situation de copie, mettre la majuscu<strong>le</strong> en début de phrase , % , %<br />
FRA0 en situation de copie, mettre <strong>le</strong> point final , % , %<br />
FRA0 en situation de production d’écrits, mettre la majuscu<strong>le</strong> et <strong>le</strong> point final , % ,0%<br />
FRA0 associer un mot polysémique à sa définition , % , %<br />
FRA0 0 associer un mot polysémique à sa définition 0, % , %<br />
FRA0 associer un préfixe fréquent à un adjectif pour trouver son contraire , % , %<br />
FRA0 associer un préfixe fréquent à un adjectif pour trouver son contraire , % 0 , %<br />
FRA0 associer un préfixe fréquent à un adjectif pour trouver son contraire , % , %<br />
FRA0 effectuer des remplacements en passant du masculin au féminin , % , %<br />
FRA0 effectuer des remplacements en passant du masculin au féminin 0, % , %<br />
FRA0 effectuer des remplacements en passant du masculin au féminin , % , %<br />
FRA0 effectuer des remplacements en passant du masculin au féminin , % , %<br />
FRA0 effectuer des déplacements pour reconstituer une phrase , % , %<br />
FRA0 en situation de production d’écrits, mettre la majuscu<strong>le</strong> et <strong>le</strong> point final , % , %<br />
FRA0 écrire des mots réguliers sous la dictée , % , %<br />
FRA0 écrire des mots réguliers sous la dictée ,0% , %<br />
FRA0 écrire des mots réguliers sous la dictée , % , %<br />
FRA0 écrire des mots réguliers sous la dictée , % ,0%<br />
FRA0 écrire des mots réguliers sous la dictée ,0% , %<br />
FRA0 écrire des mots réguliers sous la dictée ,0% , %<br />
FRA0 écrire des mots-outils fréquents sous la dictée , % 00,0%<br />
FRA0 écrire des mots-outils fréquents sous la dictée , % , %<br />
FRA0 0 écrire des mots-outils fréquents sous la dictée ,0% , %<br />
FRA0 écrire des mots-outils fréquents sous la dictée , % , %<br />
FRA0 écrire des mots-outils fréquents sous la dictée , % , %<br />
FRA0 écrire des mots-outils fréquents sous la dictée , % , %<br />
*Tab<strong>le</strong>au 3. Sixième, 2004, maîtriser <strong>le</strong>s outils de la langue, orthographe<br />
No. de l’item Description de l’item Résultat<br />
Pourcentage de<br />
réussite HB<br />
Pourcentage de<br />
réussite Éco<strong>le</strong> X<br />
FRA0<br />
Retrouver l’organisation<br />
logique d’un texte<br />
| . % .0%<br />
FRA0<br />
Retrouver l’organisation<br />
logique d’un texte<br />
Maîtriser <strong>le</strong>s accords pour<br />
| 0.0% 0.0%<br />
FRA0 0<br />
construire <strong>le</strong> sens d’un<br />
texte<br />
Repérer <strong>le</strong> dérou<strong>le</strong>ment<br />
| .0% .0%<br />
FRA0<br />
chronologique dans un<br />
texte<br />
Repérer <strong>le</strong> dérou<strong>le</strong>ment<br />
0 | 0.0% .0%<br />
FRA0<br />
chronologique dans un<br />
texte<br />
Identifier <strong>le</strong>s référents<br />
| . % 0.0%<br />
FRA0<br />
des substituts <strong>le</strong>xicaux et<br />
pronominaux<br />
Identifier <strong>le</strong>s référents<br />
| .0% .0%<br />
FRA0<br />
des substituts <strong>le</strong>xicaux et<br />
pronominaux<br />
| . % .0%<br />
FRA0 Maîtriser <strong>le</strong> vocabulaire | .0% 0.0%<br />
FRA0 Maîtriser <strong>le</strong> vocabulaire | . % .0%<br />
0
FRA0 Maîtriser <strong>le</strong> vocabulaire | . % 0.0%<br />
FRA0 Maîtriser <strong>le</strong> vocabulaire | .0% .0%<br />
FRA0<br />
Employer <strong>le</strong>s<br />
déterminants adéquats<br />
| 0.0% 0.0%<br />
FRA0<br />
Employer <strong>le</strong>s<br />
déterminants adéquats<br />
| .0% 0.0%<br />
FRA0 0<br />
Employer <strong>le</strong>s<br />
déterminants adéquats<br />
| .0% .0%<br />
FRA0<br />
Employer <strong>le</strong>s<br />
déterminants adéquats<br />
| 0.0% .0%<br />
FRA0<br />
Employer <strong>le</strong>s<br />
déterminants adéquats<br />
| . % .0%<br />
FRA0<br />
Employer <strong>le</strong>s<br />
déterminants adéquats<br />
| .0% .0%<br />
FRA0<br />
Employer <strong>le</strong>s<br />
déterminants adéquats<br />
Maîtriser <strong>le</strong>s accords pour<br />
| . % 0.0%<br />
FRA0<br />
construire <strong>le</strong> sens d’un<br />
texte<br />
| 0.0% 0.0%<br />
FRA0<br />
Produire des phrases de<br />
différents types et formes<br />
| . % 0.0%<br />
FRA0<br />
Maîtriser l’orthographe<br />
<strong>le</strong>xica<strong>le</strong> et grammatica<strong>le</strong><br />
| .0% .0%<br />
FRA0<br />
Maîtriser l’orthographe<br />
<strong>le</strong>xica<strong>le</strong> et grammatica<strong>le</strong><br />
| . % 0.0%<br />
FRA0<br />
Maîtriser l’orthographe<br />
<strong>le</strong>xica<strong>le</strong> et grammatica<strong>le</strong><br />
| . % .0%<br />
FRA0<br />
Maîtriser l’orthographe<br />
<strong>le</strong>xica<strong>le</strong> et grammatica<strong>le</strong><br />
0 | 0.0% 0.0%<br />
FRA0<br />
Reconnaître une forme<br />
de phrase<br />
| . % .0%<br />
FRA0<br />
Produire des phrases de<br />
différents types et formes<br />
| . % 0.0%<br />
FRA0<br />
Segmenter de façon<br />
pertinente un texte simp<strong>le</strong><br />
| . % .0%<br />
FRA0<br />
Segmenter de façon<br />
pertinente un texte simp<strong>le</strong><br />
| . % .0%<br />
FRA0<br />
Maîtriser l’orthographe<br />
<strong>le</strong>xica<strong>le</strong> et grammatica<strong>le</strong><br />
0 | 0.0% .0%<br />
FRA0<br />
Maîtriser l’orthographe<br />
<strong>le</strong>xica<strong>le</strong> et grammatica<strong>le</strong><br />
0 | 0.0% .0%<br />
FRA0<br />
Maîtriser l’orthographe<br />
<strong>le</strong>xica<strong>le</strong> et grammatica<strong>le</strong><br />
| . % 0.0%<br />
FRA0<br />
Maîtriser l’orthographe<br />
<strong>le</strong>xica<strong>le</strong> et grammatica<strong>le</strong><br />
| . % .0%<br />
FRA0<br />
Maîtriser l’orthographe<br />
<strong>le</strong>xica<strong>le</strong> et grammatica<strong>le</strong><br />
0 | 0.0% .0%<br />
FRA0<br />
Maîtriser l’orthographe<br />
<strong>le</strong>xica<strong>le</strong> et grammatica<strong>le</strong><br />
| . % 0.0%<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Écrire en petite et moyenne sections<br />
Martine FIALIP BARATTE<br />
Maître de conférences<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Équipe THÉODILE<br />
Comment <strong>le</strong>s enfants de différentes éco<strong>le</strong>s de la banlieue lilloise et ceux de l’éco<strong>le</strong> Freinet,<br />
tous scolarisés en petite et moyenne section, appréhendent-ils l’écrit et comment vivent-ils<br />
<strong>le</strong>ur entrée en écriture ? Quel<strong>le</strong>s pratiques scriptura<strong>le</strong>s mettent-ils en place en classe et à la<br />
maison ? Quel rapport à l’écrit construisent-ils ?<br />
Les élèves de petite et moyenne sections scolarisés à l’éco<strong>le</strong> Freinet ont été interrogés du<br />
septembre au octobre 00 . Ces élèves sont répartis dans trois classes de l’éco<strong>le</strong><br />
maternel<strong>le</strong> Anne Frank. Ils sont nés entre <strong>le</strong> mois de janvier 00 et <strong>le</strong> mois de mars 00<br />
pour <strong>le</strong>s petits, entre <strong>le</strong> mois de décembre 000 et <strong>le</strong> mois de décembre 00 pour <strong>le</strong>s<br />
moyens. Leurs déclarations sont comparées avec cel<strong>le</strong>s d’élèves de petite et moyenne<br />
sections de milieu social équiva<strong>le</strong>nt interrogés pour <strong>le</strong>s besoins de ma thèse (Fialip Baratte,<br />
00 ). Les entretiens portent sur quelques dimensions de l’écriture.<br />
Le corpus 1 est celui constitué par <strong>le</strong>s élèves interrogés pour ma thèse, <strong>le</strong> corpus 2 est celui<br />
de l’éco<strong>le</strong> Anne Frank, éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> du groupe Freinet.<br />
1. L’écrit à l’éco<strong>le</strong> Freinet : état des lieux<br />
Des entretiens avec <strong>le</strong>s élèves de grande section et de cours préparatoire de l’éco<strong>le</strong> Freinet<br />
ont été réalisés l’année dernière et <strong>le</strong>s résultats publiés dans <strong>le</strong> rapport de recherche<br />
(Reuter, dir. 00 ). La comparaison s’est effectuée selon un protoco<strong>le</strong> identique à celui de<br />
cette année. Les analyses des deux corpus, semblab<strong>le</strong>s quant aux pratiques scriptura<strong>le</strong>s<br />
domestiques, différaient quant à la qualité du rapport à l’écrit que <strong>le</strong>s propos des élèves<br />
permettaient de reconstruire. Plus précisément, <strong>le</strong> moment de l’entrée dans l’écrit, la manière<br />
dont ils vivaient ce moment, <strong>le</strong> sens donné à l’écriture et la clarté cognitive étaient <strong>le</strong>s quatre<br />
points de dissemblance. Pour <strong>le</strong>s enfants du groupe Freinet, <strong>le</strong> moment d’entrée en écriture<br />
était plus précoce, la clarté cognitive plus perceptib<strong>le</strong> et de façon généra<strong>le</strong>, <strong>le</strong>ur vécu et <strong>le</strong>ur<br />
rapport à l’écrit plus sereins que <strong>le</strong>s enfants du corpus .<br />
Le rapport à l’écrit se constituait autour de ces noyaux « forts ». L’entrée dans l’écrit n’était<br />
pas systématiquement associée à l’entrée en cours préparatoire et des indices forts que cette<br />
entrée était déjà effective en grande section pour de nombreux enfants étaient présents.<br />
La sérénité dont <strong>le</strong>s élèves du groupe Freinet faisaient preuve lors de cette entrée en écriture<br />
tenait à quelques éléments :<br />
– « la banalisation » de la classe du cours préparatoire (banalisation rendue possib<strong>le</strong> parce<br />
qu’ils se pensaient déjà apprentis scripteurs en grande section) ;<br />
– la construction d’une communauté éducative englobant <strong>le</strong>s activités scolaires et<br />
l’apprentissage, mais aussi la vie à l’éco<strong>le</strong>, voire à la maison ; communauté procurant aide<br />
et soutien ;<br />
Cf. <strong>le</strong> questionnaire en annexe.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0
– l’existence d’une clarté cognitive permettant de cerner <strong>le</strong>s objectifs didactiques, de distinguer<br />
<strong>le</strong>s différentes activités, de faire face aux difficultés et de trouver des aides adaptées.<br />
Ces résultats, avant <strong>le</strong>ur rapprochement avec ce que l’on doit bien appe<strong>le</strong>r « des résultats<br />
en amont », doivent être corrélés avec ceux des autres chercheurs publiés dans <strong>le</strong> rapport<br />
col<strong>le</strong>ctif cité précédemment.<br />
2. Des résultats convergents<br />
Les résultats des diverses recherches publiées dans <strong>le</strong> rapport de 00 présentent des<br />
connexions étonnantes. Je vais tenter de re<strong>le</strong>ver ici cel<strong>le</strong>s qui me paraissent avoir un lien<br />
avec mes propres constatations.<br />
0<br />
2.1. L’élément fédérateur : <strong>le</strong> travail et <strong>le</strong>s activités<br />
J’avais montré que <strong>le</strong> terme « travail » était souvent employé par <strong>le</strong>s élèves du groupe<br />
Concorde et qu’il admettait diverses acceptions. Dès la grande section, il désignait <strong>le</strong>s<br />
activités scriptura<strong>le</strong>s par rapport aux activités iconographiques et <strong>le</strong>s distinguait du jeu<br />
(Reuter, dir., 00 , p. ). Or, ce terme a été remarqué par quelques-uns des chercheurs<br />
qui ont travaillé dans <strong>le</strong> groupe scolaire Freinet. Ils l’ont entendu dans <strong>le</strong>s entretiens qu’ils<br />
ont réalisés ou ont reconstruit cette notion de travail, d’effort dans <strong>le</strong>urs analyses de<br />
travaux écrits ou d’observations des pratiques. Ce terme semb<strong>le</strong> être <strong>le</strong> fil rouge qui permet<br />
à Isabel<strong>le</strong> Delcambre d’écrire en conclusion de son artic<strong>le</strong> intitulé : Dispositifs d’oral en<br />
maternel<strong>le</strong> et en CP : « Ce qui semb<strong>le</strong> caractériser <strong>le</strong>s situations tel<strong>le</strong>s que mises en œuvre<br />
à l’éco<strong>le</strong> Freinet, c’est la dimension de travail donnée à ces situations de paro<strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctive :<br />
travail présent et travail futur, situations de travail sur la prise de paro<strong>le</strong> et sur <strong>le</strong> travail futur<br />
en mathématique… Les élèves y par<strong>le</strong>nt pour travail<strong>le</strong>r et non pour s’exprimer » (Reuter,<br />
dir., 00 , p. ). Cette notion est intégrée et partagée par <strong>le</strong>s élèves, mais aussi initiée<br />
puis encouragée par <strong>le</strong>s enseignants. Se plaçant du côté de ces derniers, Céci<strong>le</strong> Carra<br />
consacre à cette notion, un paragraphe intitulé : Le travail comme activité centra<strong>le</strong>, valorisée<br />
et valorisante (Reuter, dir., 00 , p. ). El<strong>le</strong> se base ici sur <strong>le</strong>s propos de l’enseignante de<br />
CE qui préfère employer travail<strong>le</strong>r au lieu d’apprendre, arguant que <strong>le</strong>s enfants comprenant<br />
mieux ce mot, se mettent plus vite au travail sans se poser a priori des questions qui <strong>le</strong>s<br />
déstabilisent. Mais el<strong>le</strong> montre aussi <strong>le</strong> décalage existant, (en tout cas dans un premier temps :<br />
un mois après la rentrée) entre <strong>le</strong>s conceptions enseignantes de ce terme et <strong>le</strong>s conceptions<br />
des enfants. Pour <strong>le</strong>s premiers c’est être « chercheur et acteur de ses apprentissages »,<br />
pour <strong>le</strong>s seconds, c’est « bien présenter son travail et être obéissant ». Quoi qu’il en soit,<br />
« c’est fina<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> travail qui fait d’abord sens pour <strong>le</strong>s principa<strong>le</strong>s catégories d’acteurs…<br />
même si l’activité qu’il implique… n’est pas du même type…, sens que l’on verra évoluer<br />
progressivement pour <strong>le</strong>s élèves… C’est fina<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> sens des situations scolaires qui<br />
évolue et un nouveau rapport au savoir qui tente de se construire.». Maria Pagoni peut alors<br />
faire du « travail » un des trois principes d’apprentissage prévalant dans <strong>le</strong> groupe Freinet et<br />
<strong>le</strong> formu<strong>le</strong>r ainsi : « La construction de liens et de principes communs entre <strong>le</strong> travail et la vie<br />
scolaire. » (Reuter, dir., 00 , p. ). Le « plan de travail » qui comprend « l’ensemb<strong>le</strong> des<br />
activités effectuées aussi bien dans <strong>le</strong>s disciplines scolaires que dans d’autres domaines »<br />
est <strong>le</strong> référent incontournab<strong>le</strong> des maîtres et des élèves.<br />
On voit bien que, lorsque <strong>le</strong> terme « travail » est rapproché, comme il l’est dans <strong>le</strong>s analyses<br />
précédentes, de celui d’« activités », son sens se précise et <strong>le</strong>s dimensions que ces deux mots<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
ecouvrent donnent à voir toutes <strong>le</strong>s interactions qui <strong>le</strong>s traversent. La référence constante<br />
à cette notion d’effort et aux activités qui la constituent caractérise ce groupe scolaire et sa<br />
pédagogie. El<strong>le</strong> révè<strong>le</strong> un aspect de la construction de cette communauté éducative qui se<br />
construit comme un tout ne séparant pas <strong>le</strong>s activités de classe et <strong>le</strong>s activités extérieures<br />
(récréations, rapports avec <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s, conseils de classe, réunions, etc.)<br />
La notion de travail et la conception qui en décou<strong>le</strong> fédèrent l’ensemb<strong>le</strong> des activités et des<br />
façons d’enseigner et d’apprendre dans <strong>le</strong> groupe scolaire Freinet. Il reste à mesurer <strong>le</strong>ur<br />
influence sur la qualité de l’entrée dans l’écrit.<br />
2.2. Clarté cognitive<br />
L’existence d’une clarté cognitive précoce et pertinente vis-à-vis de l’écrit, peut, outre mes<br />
analyses, s’expliquer aussi par ce qu’en dit Jacinthe Giguère (Reuter, dir., 00 , p. 0 ):<br />
« À l’éco<strong>le</strong> Freinet, l’écrit est utilisé pour régu<strong>le</strong>r <strong>le</strong> travail, pour régu<strong>le</strong>r la vie col<strong>le</strong>ctive,<br />
pour s’exprimer/communiquer et pour socialiser <strong>le</strong> travail… Pour ce qui est des articulations<br />
entre lire et écrire, on constate que l’entrée se fait <strong>le</strong> plus souvent par la production écrite,<br />
qui conduit ensuite à la <strong>le</strong>cture ». L’écrit est sollicité dans ses différentes fonctions dès <strong>le</strong>s<br />
premières années d’éco<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s apprentissages disciplinaires et sociaux. Les relations<br />
<strong>le</strong>cture-écriture sont aussi vécues de manière particulière par <strong>le</strong>s élèves du groupe Freinet.<br />
Jacinthe Giguère constate que <strong>le</strong>s élèves « deviennent plus conscients que lire peut <strong>le</strong>s<br />
aider à écrire, notamment sur <strong>le</strong> plan de l’orthographe et des idées. Ils perçoivent éga<strong>le</strong>ment<br />
davantage que la pratique de l’écriture implique la <strong>le</strong>cture ». (Reuter, dir., 00 , p. )<br />
Dans <strong>le</strong>s entretiens que j’ai réalisés, une élève de grande section disait « qu’on lit quand on<br />
écrit par exemp<strong>le</strong> : pour dire s’il y a un « a » on dit [a] » (Reuter, dir., 00 , p. 0).<br />
Cette clarté cognitive, effective dès la grande section, se montre aussi dans <strong>le</strong>s pratiques<br />
langagières ora<strong>le</strong>s, et ont un lien avec la conscience disciplinaire. Isabel<strong>le</strong> Delcambre et<br />
Cora Cohen constatent ainsi que « <strong>le</strong>s performances sont bien plus fines en termes de<br />
pratiques langagières dans <strong>le</strong> cadre de situations scientifiques à l’éco<strong>le</strong> Freinet que dans<br />
l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>. Ces performances se caractérisent par une facilité à utiliser <strong>le</strong> langage<br />
d’évocation, l’utilisation de termes plus spécifiques, i.e. plus scientifiques et une plus grande<br />
capacité d’abstraction. » (Reuter, dir., 00 , p. ).<br />
2.3. Le rapport à l’écrit<br />
Les résultats que j’avais obtenus (Reuter, dir., 00 , p. ) montraient, pour <strong>le</strong>s élèves de<br />
cours préparatoire et de grande section du groupe Freinet, une plus grande sérénité lors de<br />
l’entrée en écriture que pour <strong>le</strong>s élèves du corpus . Les indices re<strong>le</strong>vés dans <strong>le</strong>s propos<br />
des enfants semblaient lier cette sérénité au climat établi par cette communauté scolaire,<br />
climat fait de va<strong>le</strong>urs fortes comme l’entraide, la solidarité, <strong>le</strong> respect et <strong>le</strong> travail ainsi que la<br />
conscience d’être déjà entrés dans <strong>le</strong>s apprentissages écrits, apprentissages contextualisés<br />
et finalisés.<br />
D’autres éléments viennent compléter ces explications. Yves Reuter quant à lui, constate<br />
de manière généra<strong>le</strong>, suite à l’analyse de productions écrites en CM , qu’à l’éco<strong>le</strong> Freinet,<br />
l’investissement dans l’écrit est « incomparab<strong>le</strong> à ce que l’on peut trouver à milieu équiva<strong>le</strong>nt<br />
dans d’autres cadres pédagogiques qui manifeste sans doute qu’en fonction des pratiques<br />
mises en place, <strong>le</strong> rapport à l’écrit s’est modifié… » (Reuter, dir., 00 , p. ). Cet<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0
investissement important pourrait être favorisé par la sérénité du rapport à l’écrit établi dès la<br />
grande section (Reuter, dir., 00 , p. ) et (ou), à son tour favoriser cette même sérénité.<br />
Cel<strong>le</strong>-ci peut aussi être reliée à ce que Anne-Marie Jovenet nomme : « l’environnement<br />
humain à travers <strong>le</strong>s relations, <strong>le</strong> confort, l’écoute, la disponibilité et la mise en va<strong>le</strong>ur de<br />
chacun. » (Reuter, dir., 00 , p. 0 , 0 ). Ces éléments constituent pour el<strong>le</strong> « <strong>le</strong> troisième<br />
pô<strong>le</strong> du rapport à l’éco<strong>le</strong> » qui englobe <strong>le</strong>s relations extérieures (parents, conseil municipal<br />
des jeunes, visiteurs, sorties, correspondance) et <strong>le</strong>s relations intérieures tissées d’aide, de<br />
prise en compte des besoins et désirs des élèves et de respect individuel. El<strong>le</strong> peut encore<br />
être mise en relation avec la description effectuée par Dominique Lahanier Reuter : « Nous<br />
trouvons à l’éco<strong>le</strong> H. Boucher des conduites déterminées par la prise de risque ou, pour <strong>le</strong><br />
dire autrement, par un rapport à l’erreur qui ne pèserait pas sur <strong>le</strong>urs travaux. » (Reuter,<br />
dir., 00 , p. ). Ce rapport à l’erreur est aussi ce que constate Gérard Bécousse qui<br />
l’associe au système d’appréciation simp<strong>le</strong> : « c’est bien ou pas, c’est b<strong>le</strong>u, vert ou rouge »<br />
qui « modifierait la perception de l’erreur qui n’est pas grave alors qu’el<strong>le</strong> est assimilée au<br />
collège à un risque de sanction » (Reuter, dir., 00 , p. 0).<br />
On peut faire <strong>le</strong> pari que ces éléments : investissement, construction d’une col<strong>le</strong>ctivité et<br />
attitudes dynamiques contribuent à construire un climat particulier dont une des composantes<br />
est la sérénité, favorisant en retour une ambiance propice aux apprentissages. En conclusion,<br />
ces divers éléments sont confortés par <strong>le</strong>s résultats en français aux évaluations de CE et<br />
de e que Rouba Hassan résume ainsi : « L’éco<strong>le</strong> H. Boucher est en hausse dans ces deux<br />
domaines (compréhension ; outils de la langue et productions d’écrits), là où, à l’échel<strong>le</strong><br />
nationa<strong>le</strong> et au niveau de la circonscription, la tendance est à la baisse. » (Reuter, dir., 00 ,<br />
p. ).<br />
3. Cadrage théorique et méthodologique<br />
La majorité des résultats de la recherche effectuée en 00 / 00 dans <strong>le</strong>s petite et moyenne<br />
sections peuvent être rattachés à la clarté cognitive ; clarté cognitive qui semb<strong>le</strong> favoriser<br />
l’établissement d’un rapport à l’écrit construit, charpenté et exempt d’inquiétudes.<br />
Concernant la clarté cognitive, j’entends ici plus précisément :<br />
– la conscience de ce qu’est écrire,<br />
– l’acte d’écrire en particulier par rapport à celui de dessiner,<br />
– <strong>le</strong>s fonctions de l’écrit,<br />
– la conscience qu’écrire est un apprentissage,<br />
– la conscience que cet apprentissage est d’abord dévolu à l’éco<strong>le</strong>,<br />
– la conscience que <strong>le</strong>s activités scolaires d’écriture ont un objectif didactique,<br />
– la reconnaissance de l’acte d’écriture chez autrui,<br />
– l’existence d’interactions scriptura<strong>le</strong>s entre la maison et l’éco<strong>le</strong> : la reconnaissance de<br />
l’écrit dans <strong>le</strong>s deux lieux,<br />
– l’appréhension du sens de l’écriture.<br />
Cette clarté cognitive apparaît constitutive du rapport à l’écrit, celui-ci devant être décliné<br />
ici en rapport à l’écriture scolaire et rapport à l’écriture domestique ; cette distinction étant<br />
sollicitée par <strong>le</strong> découpage du questionnaire. Le rapport à l’écrit est aussi caractérisé par <strong>le</strong>s<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
notions de travail et d’activités mais aussi de sérénité.<br />
L’analyse à venir va permettre de préciser si l’entrée dans l’écrit débute dès <strong>le</strong>s plus petites<br />
classes et si des indices de la sérénité caractéristique du rapport à l’écrit des enfants de<br />
grande section et de cours préparatoire sont à l’œuvre dès la petite section. Le sens de<br />
l’écriture étaient, pour <strong>le</strong>s élèves de CP, lié au texte. Quel<strong>le</strong>s pratiques préparent dès l’éco<strong>le</strong><br />
maternel<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s enfants à cette affirmation ?<br />
Trente-quatre entretiens (vingt-deux d’élèves de moyenne section et douze d’élèves de<br />
petite section) ont été réalisés durant <strong>le</strong>s mois de septembre et octobre 00 à l’éco<strong>le</strong><br />
maternel<strong>le</strong> Anne Frank. Ils constituent <strong>le</strong> corpus . Les trois classes d’où proviennent <strong>le</strong>s<br />
entretiens sont structurées de façon particulière : el<strong>le</strong>s rassemb<strong>le</strong>nt <strong>le</strong>s tout petits, <strong>le</strong>s petits<br />
et <strong>le</strong>s moyens, soit un échantillon d’enfants allant de deux à quatre ans, nés entre <strong>le</strong><br />
décembre 000 et <strong>le</strong> 0 juil<strong>le</strong>t 00 . Tous <strong>le</strong>s enfants n’ont pu être interrogés (comme c’était<br />
déjà <strong>le</strong> cas pour <strong>le</strong> premier corpus), d’une part sur la recommandation des enseignantes<br />
signalant <strong>le</strong>s enfants « qui ne répondraient pas » et d’autre part à cause de certains élèves<br />
refusant l’entretien.<br />
Le corpus est constitué par <strong>le</strong>s entretiens de vingt et un élèves de petite section et dix-neuf<br />
de moyenne section recueillis dans trois éco<strong>le</strong>s maternel<strong>le</strong>s de la banlieue lilloise dans des<br />
milieux sociaux équiva<strong>le</strong>nts à ceux de l’éco<strong>le</strong> Freinet.<br />
Pour la clarté de l’exposé et afin de favoriser la continuité avec l’étude précédente, je reprendrai<br />
<strong>le</strong> même plan et <strong>le</strong>s mêmes objets d’analyse, tous liés à l’existence d’une clarté cognitive et<br />
à un rapport à l’écrit empreint ou non de sérénité. D’autres éléments caractéristiques de ces<br />
premières années de scolarité viendront s’y ajouter (pour <strong>le</strong>s années grande section et cours<br />
préparatoire il s’agissait de la notion de travail). Dans un premier temps, je ferai apparaître<br />
<strong>le</strong>s dissemblances et dans un second temps <strong>le</strong>s ressemblances en petite et en moyenne<br />
sections ; bien que ce découpage soit peu compatib<strong>le</strong> avec la réalité et ne rende compte<br />
qu’artificiel<strong>le</strong>ment du processus d’entrée dans l’écrit, caractérisé d’abord par la continuité<br />
et <strong>le</strong>s connexions incessantes entre <strong>le</strong>s différents niveaux scolaires. À la différence de<br />
l’analyse des propos en grande section et au cours préparatoire, une modalisation est ici<br />
indispensab<strong>le</strong> pour rendre compte de grands traits de ressemblances fortement nuancés<br />
par des touches contradictoires.<br />
4. Ressemblances<br />
Les ressemblances sont ténues et varient parfois de façon contradictoire selon <strong>le</strong> niveau<br />
scolaire. El<strong>le</strong>s sont peu nombreuses contrairement aux différences (el<strong>le</strong>s aussi ténues) et<br />
se tiennent dans quelques dimensions du rapport à l’écriture domestique.<br />
4.1. Le rapport à l’écriture domestique<br />
4.1.1. La matérialité de l’écriture domestique<br />
La matérialité de l’écriture domestique est très présente dans <strong>le</strong> discours des élèves de<br />
petite section. S’agissant du corpus , on y utilise des feuil<strong>le</strong>s, des crayons, des ciseaux,<br />
des feutres, des stylos, des papiers, des livres mais aussi ses doigts et des puzz<strong>le</strong>s. Cette<br />
matérialité de l’écriture constitue aussi l’élément principal du rapport à l’écriture domestique<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0
des enfants du premier corpus.<br />
0<br />
4.1.2. La reconnaissance et la fonctionnalité des pratiques scriptura<strong>le</strong>s<br />
domestiques<br />
En moyenne section, tous <strong>le</strong>s enfants des deux corpus voient <strong>le</strong>urs proches écrire et<br />
savent pourquoi ils écrivent. Les parents écrivent « à l’ordinateur », ils écrivent aussi « pour<br />
faire <strong>le</strong>ur travail », ou pour « <strong>le</strong>s courses ». Jeremy dans <strong>le</strong> premier corpus explique que sa<br />
maman « écrit des papiers pour se marier » et Sarah dit que sa mère écrit « pour faire à<br />
manger comme Maïté à la télé ». Ils écrivent encore des « chiffres » ou « en petit » ou parce<br />
qu’ils « ont envie ». Les supports sont remarqués, en particulier <strong>le</strong>s cahiers,<br />
« parce que <strong>le</strong>s cahiers c’est pour <strong>le</strong>s grands »<br />
dit Adnan. La fratrie se fait plus présente dans <strong>le</strong>s deux corpus. Les frères et sœurs écrivent<br />
pour faire <strong>le</strong>urs devoirs ou apprendre l’alphabet.<br />
4.1.3. Le rô<strong>le</strong> des personnes<br />
En petite et moyenne sections dans <strong>le</strong>s deux corpus, la mère et la sœur sont très présentes<br />
(<strong>le</strong> père et <strong>le</strong>s frères un peu moins). Ils endossent <strong>le</strong>s rô<strong>le</strong>s de spectateur, de modè<strong>le</strong> ou de<br />
référent :<br />
Sarah (corpus ) dit :<br />
« (J’écris) quand mon papa il est là et même ma maman, et même ma sœur et même mon petit<br />
frère ».<br />
Sophia (corpus ) :<br />
« Parce que ma mère el<strong>le</strong> fait aussi »<br />
Pour l’instant, <strong>le</strong>s personnes servent de jalons temporels et affectifs et motivent <strong>le</strong>s enfants<br />
par <strong>le</strong>ur exemp<strong>le</strong> mais ne sont pas encore des aides.<br />
Le rapport à l’écriture domestique est en construction lorsque <strong>le</strong>s enfants arrivent à l’éco<strong>le</strong>.<br />
Certaines dimensions en sont remarquées et apparaissent dans <strong>le</strong>ur discours. Les enfants<br />
sont sensib<strong>le</strong>s à la matérialité de l’écriture, reconnaissent l’écriture chez <strong>le</strong>urs proches et en<br />
disent <strong>le</strong>s fonctions ; <strong>le</strong>s personnes <strong>le</strong>s plus importantes lors de ces pratiques scriptura<strong>le</strong>s<br />
domestiques sont la mère et la grande sœur mais <strong>le</strong>ur rô<strong>le</strong> est pour l’instant passif.<br />
5. Dissemblances<br />
Les différences se situent dans quelques dimensions du rapport à l’écriture domestique et,<br />
de façon significative, dans <strong>le</strong> rapport à l’écriture scolaire. El<strong>le</strong>s tiennent plus précisément<br />
à la reconnaissance précoce des pratiques scriptura<strong>le</strong>s chez <strong>le</strong>s proches et des pratiques<br />
scolaires, à la permanence de ces pratiques scriptura<strong>le</strong>s et à <strong>le</strong>ur continuité selon <strong>le</strong>s<br />
lieux, ainsi qu’à la contextualisation et l’explicitation des conduites scriptura<strong>le</strong>s qui <strong>le</strong>s<br />
accompagnent. La construction déjà avancée de ces deux rapports à l’écrit permet de<br />
repérer des traces de clarté cognitive et de donner une coloration à ces deux rapports.<br />
5.1. Le rapport à l’écriture domestique<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
5.1.1. Les objets d’écriture<br />
En petite section, <strong>le</strong>s objets déclarés écrits à la maison sont à part éga<strong>le</strong>, des objets langagiers<br />
(prénoms, <strong>le</strong>ttres) et des dessins pour <strong>le</strong>s enfants du corpus Freinet, alors que <strong>le</strong>s enfants<br />
du corpus évoquent essentiel<strong>le</strong>ment des objets du monde et des dessins.<br />
En moyenne section, à la maison, lorsque <strong>le</strong>s enfants écrivent, ils écrivent surtout dans <strong>le</strong><br />
premier corpus des objets d’écriture, alors que dans <strong>le</strong> second, l’équilibre perdure entre<br />
objets du monde (dessins, poisson, ours, bonhommes, dinosaures, peinture) et objets<br />
d’écriture (prénoms, <strong>le</strong>ttres, messages, alphabet, mots).<br />
Il semb<strong>le</strong> y avoir un équilibre entre objets iconographiques et scripturaux chez <strong>le</strong>s enfants<br />
scolarisés à l’éco<strong>le</strong> Freinet, alors que pour <strong>le</strong>s enfants du corpus , <strong>le</strong>s objets écrits à la<br />
maison deviennent, en moyenne section, majoritairement des objets d’écriture. J’analyse<br />
cette focalisation sur <strong>le</strong>s objets d’écriture comme une contamination de l’éco<strong>le</strong> sur la maison,<br />
balayant <strong>le</strong>s pratiques iconographiques antérieures car cel<strong>le</strong>s-ci ne permettent pas de faire<br />
face aux enjeux scolaires : l’apprentissage de l’écriture et son corollaire, <strong>le</strong> passage au cours<br />
préparatoire. Le rapport à l’écriture domestique devient alors négatif pour trois garçons du<br />
corpus alors que chez <strong>le</strong>s élèves Freinet, il n’y a pas trace de rapport négatif à l’écriture<br />
domestique. Investi positivement par <strong>le</strong>s élèves du groupe Freinet, <strong>le</strong> rapport à l’écriture<br />
domestique laisse entrevoir chez <strong>le</strong>s enfants de l’autre corpus des éléments négatifs, en<br />
particulier affectifs, liés à des « difficultés d’écriture ».<br />
Il y a chez <strong>le</strong>s enfants du premier corpus un bascu<strong>le</strong>ment vers <strong>le</strong>s pratiques scolaires à la<br />
maison avec abandon des pratiques antérieures qui s’amorce dès la moyenne section alors<br />
que chez <strong>le</strong>s enfants du corpus Freinet, l’équilibre présent dès la petite section se maintient<br />
en moyenne section.<br />
5.1.2. La position de scripteur<br />
En petite section, certains enfants du corpus Freinet ont conscience qu’ils ne sont pas<br />
encore scripteurs ; à la question : « Qui écrit chez toi ?», Mohamed répond :<br />
« Tata parce que moi je peux pas ».<br />
D’autres affirment « je ne sais pas écrire », alors que <strong>le</strong>s élèves du premier corpus surtout<br />
<strong>le</strong>s garçons déclarent fermement « qu’ils savent écrire »; <strong>le</strong>s rares élèves qui disent ne pas<br />
écrire <strong>le</strong> font parce qu’ils « attendent d’être au CP. ». Cette impossibilité ne crée pas, pour<br />
<strong>le</strong>s élèves Freinet, de situation conflictuel<strong>le</strong>.<br />
En petite et moyenne sections, la fratrie est davantage citée par <strong>le</strong>s enfants du premier corpus<br />
que par ceux du second. El<strong>le</strong> joue un rô<strong>le</strong> particulier : <strong>le</strong>s enfants se positionnent en tant que<br />
scripteurs d’abord par rapport à <strong>le</strong>urs aînés ou à <strong>le</strong>urs benjamins. Pour <strong>le</strong>s enfants de l’éco<strong>le</strong><br />
Freinet, ce sont d’abord <strong>le</strong>s parents ou <strong>le</strong>s adultes qui écrivent et ils ne se comparent pas à<br />
eux ni ne se positionnent par rapport à eux. Les adultes sont une référence et un modè<strong>le</strong>, et<br />
s’il s’agit de <strong>le</strong>s imiter, il n’y a dans cet acte aucune tension perceptib<strong>le</strong>. Les enfants Freinet<br />
n’établissent pas de rapport concurrentiel avec la fratrie et ne se positionnent pas en tant<br />
que scripteurs par rapport à <strong>le</strong>ur entourage. Ils n’évoquent pas non plus <strong>le</strong>s gribouillages<br />
des plus petits de façon péjorative.<br />
En moyenne section, il est étonnant de constater entre <strong>le</strong>s deux corpus une différence<br />
étonnante : alors que <strong>le</strong>s enfants du premier corpus répondent d’abord « moi » à la question<br />
« qui écrit chez toi ?»; <strong>le</strong>s enfants de l’éco<strong>le</strong> Freinet ne se mentionnent pas a priori dans<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0
cette question qui concerne l’écriture de <strong>le</strong>urs proches et y répondent très précisément et<br />
exactement en citant <strong>le</strong>s personnes dont ils remarquent l’écriture.<br />
En petite section, <strong>le</strong> signa<strong>le</strong>ment des personnes écrivant à la maison n’est pas identique<br />
pour <strong>le</strong>s élèves des deux corpus. Ce décalage disparaît en moyenne section. Les enfants<br />
de l’éco<strong>le</strong> Freinet ne développent pas de rapport concurrentiel avec la fratrie, alimenté<br />
par la dépréciation des « barbouillages ». Le modè<strong>le</strong> des élèves Freinet serait un modè<strong>le</strong><br />
« adulte » tandis que pour <strong>le</strong>s élèves des autres éco<strong>le</strong>s, ce serait un modè<strong>le</strong> fratriarcal. La<br />
construction identitaire ne passe pas encore par l’identité scriptura<strong>le</strong>. L’écriture n’est pas<br />
vécue comme un enjeu nécessaire pour être reconnu. On peut exister au sein de la fratrie<br />
et de la famil<strong>le</strong> même si l’on n’est pas scripteur. Cet élément va avoir des incidences sur la<br />
sérénité du rapport à l’écriture.<br />
0<br />
5.1.3. La reconnaissance des pratiques scriptura<strong>le</strong>s chez <strong>le</strong>s proches<br />
En petite section, l’écriture n’est pas toujours repérée chez <strong>le</strong>s membres de la famil<strong>le</strong> des<br />
élèves du premier corpus alors qu’el<strong>le</strong> est reconnue massivement dans <strong>le</strong> corpus Freinet, et<br />
que cette écriture familia<strong>le</strong> est fonctionnalisée. Ruben affirme :<br />
Yanny dit :<br />
« Maman, el<strong>le</strong> écrit pour ses affaires ».<br />
« Maman écrit pour faire <strong>le</strong>s courses et papa écrit <strong>le</strong>s numéros qu’il appel<strong>le</strong> ».<br />
Tous <strong>le</strong>s membres de la famil<strong>le</strong> sont cités : mère, père, grands-parents, onc<strong>le</strong>s, tantes et<br />
fratrie. Les fonctions de l’écriture parenta<strong>le</strong> mises en avant sont la fonction pratique et<br />
régulatrice et la fonction administrative.<br />
5.1.4. La matérialité de l’écriture domestique<br />
En moyenne section, cette matérialité est moins exprimée et disparaît au profit de la<br />
description des activités scriptura<strong>le</strong>s alors que pour <strong>le</strong>s élèves du premier corpus, el<strong>le</strong> reste<br />
fortement exprimée.<br />
De plus, la matérialité de l’écriture n’est pas avancée comme première raison à l’envie<br />
d’écrire comme c’est <strong>le</strong> cas dans <strong>le</strong> corpus et el<strong>le</strong> revêt un caractère particulier : l’écrit<br />
peut « s’effacer ». Cette particularité de l’écrit, signalée par Raphaël, va à l’encontre de cel<strong>le</strong><br />
avancée habituel<strong>le</strong>ment de la permanence de l’écriture (Goody, 0).<br />
Ici <strong>le</strong>s enfants aiment écrire parce qu’ils écrivent « des mots », « la date ». Ce sont donc <strong>le</strong>s<br />
objets « à écrire » qui motivent ce désir. C’est encore parce que « maman écrit » que <strong>le</strong>s<br />
enfants ont envie de l’imiter. Les raisons d’écrire sont plus diverses dans <strong>le</strong> corpus Freinet.<br />
Ils aiment écrire et lorsqu’ils n’aiment pas en donnent la raison : « j’aime pas quand je<br />
dépasse » dit Joséphine, ce qui n’est pas <strong>le</strong> cas dans <strong>le</strong> premier corpus où <strong>le</strong>s raisons d’une<br />
désaffection ne sont pas exprimées.<br />
Les enfants de l’éco<strong>le</strong> Freinet se détachent plus vite (en moyenne section) de la matérialité de<br />
l’écriture domestique alors que ceux du premier y restent encore attachés. Cette matérialité<br />
n’est plus la cause de l’intérêt des élèves Freinet pour l’écriture ; celui-ci tient maintenant<br />
aux aspects graphiques même.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
5.2. Le rapport à l’écriture scolaire<br />
Il débute pour <strong>le</strong>s élèves Freinet dès la petite section, alors qu’il s’amorçait en moyenne<br />
section pour certains et en grande section pour la majorité des élèves du premier corpus.<br />
5.2.1. Contextualisation<br />
À l’éco<strong>le</strong>, ce qu’écrivent <strong>le</strong>s élèves du corpus en petite section est contextualisé ; Ruben<br />
dit :<br />
« Les bonhommes sur un cahier ».<br />
Les supports, <strong>le</strong>s circonstances, <strong>le</strong>s objectifs sont mentionnés.<br />
5.2.2. Description<br />
Les activités sont décrites ; Assia répond :<br />
« J’écris des voitures, après je fais <strong>le</strong> tour et après <strong>le</strong> bonhomme comme ça, sur la feuil<strong>le</strong><br />
debout ».<br />
La longueur des descriptions est plus importante chez <strong>le</strong>s élèves Freinet. Cette observation<br />
peut être considérée comme la manifestation d’une certaine clarté cognitive (voir <strong>le</strong> - .).<br />
5.2.3. Mise en relation de l’écrit<br />
L’écriture est la référence et <strong>le</strong>s enfants la mettent en relation avec d’autres activités. Ils<br />
écrivent <strong>le</strong>ur prénom et ceux de <strong>le</strong>urs proches, dessinent des bus et des bonhommes. Le<br />
prénom, comme dans <strong>le</strong>s dires du premier corpus n’est pas <strong>le</strong> premier objet cité lorsqu’il<br />
s’agit de définir l’écriture à l’éco<strong>le</strong>. Il entre en concurrence avec d’autres activités scolaires<br />
<strong>le</strong>ur donnant une cohérence et montrant que la notion d’écrit recouvre entièrement ces<br />
activités spécifiques du monde scolaire. Yannis annonce :<br />
« Je sais pas écrire, je fais des activités ».<br />
Cette mise en relation de l’écrit avec un nombre important d’autres pratiques permet de <strong>le</strong><br />
distinguer très précisément et de <strong>le</strong> singulariser : « écrire » s’apprend et la plupart ne savent<br />
pas encore.<br />
5.2.4. Écriture et dessin<br />
Il faut remarquer effectivement <strong>le</strong> terme « activités » qui apparaît ici. Les « activités » ont,<br />
lorsqu’el<strong>le</strong>s sont citées par <strong>le</strong>s enfants de l’éco<strong>le</strong> Freinet, un rapport étroit avec l’écrit même<br />
si <strong>le</strong>s élèves (comme Yannis) ne <strong>le</strong> perçoivent pas : on trouve en particulier des allusions au<br />
cahier de vie. Pauline B. dit :<br />
« Des bonhommes et ma maison ; des photos de mon papi et ma mamie ».<br />
Ce cahier circu<strong>le</strong> de famil<strong>le</strong> en famil<strong>le</strong> et témoigne du travail scolaire et de la vie de classe.<br />
Il rassemb<strong>le</strong> sur un même support différentes activités <strong>le</strong>ur donnant sens et cohérence,<br />
permettant <strong>le</strong>s liaisons de l’une à l’autre et <strong>le</strong>ur donnant <strong>le</strong>ur coloration « scolaire » (peutêtre<br />
par <strong>le</strong> support même). Il établit des relations fortes entre l’éco<strong>le</strong> et la maison. Le terme<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
« activités », rendues « visib<strong>le</strong>s » par <strong>le</strong>ur exposition dans <strong>le</strong> cahier de vie unifie ainsi <strong>le</strong>s<br />
pratiques scolaires sans pour autant <strong>le</strong>s brouil<strong>le</strong>r et <strong>le</strong>s transporte à la maison.<br />
En moyenne section, <strong>le</strong>s enfants de l’éco<strong>le</strong> Freinet disent presque tous écrire à l’éco<strong>le</strong>.<br />
Dans <strong>le</strong>urs propos, certains distinguent <strong>le</strong>s dessins et <strong>le</strong>s objets d’écriture. Eliséa :<br />
« J’écris des bonhommes, j’écris pas des <strong>le</strong>ttres. »<br />
Nasim emploie faire et écrire pour marquer la différence :<br />
« Je fais des dessins, j’écris mon prénom, je fais du travail. »<br />
Ceux qui n’écrivent pas ont aussi conscience de cette dissemblance. Marcus :<br />
« Non, je dessine tous <strong>le</strong>s enfants. »<br />
Cette distinction est absente du discours des élèves du premier corpus. Nicolas S.:<br />
« D’accord. Et toi à l’éco<strong>le</strong>, est-ce que tu écris ?<br />
– J’écris des dessins, mais, mais pas pour faire des traits. »<br />
Cette allusion aux activités de graphisme est fréquente dans <strong>le</strong> corpus . Ces activités de<br />
graphisme sont décrites très précisément. C’est <strong>le</strong> cas pour <strong>le</strong> bateau, la toi<strong>le</strong> d’araignée et<br />
<strong>le</strong>s poissons. Voici <strong>le</strong>s propos de Julie :<br />
« Tu écris à l’éco<strong>le</strong> ? Et qu’est ce que tu écris ?<br />
– Un bateau.<br />
– Hum. D’acc…<br />
– Avec des barres. »<br />
Voici ceux de Matthieu :<br />
« Un mouchoir Halloween.<br />
– D’accord. Oui.<br />
– Et ça c’est Madame…, j’ai fait des toi<strong>le</strong>s d’araignée et el<strong>le</strong> a fait une grosse araignée<br />
dessus. »<br />
On ne trouve pas ces remarques dans <strong>le</strong> corpus Freinet, mais on trouve <strong>le</strong> terme<br />
« activités ».<br />
La distinction entre iconographie et écriture s’opère chez <strong>le</strong>s élèves du premier corpus par<br />
une comparaison tripartite (graphisme, dessin, écrit) alors que pour <strong>le</strong>s élèves Freinet, el<strong>le</strong><br />
se ferait grâce à des comparaisons plus larges. Outre <strong>le</strong>s allusions au cahier de vie et à<br />
d’autres supports (cahier d’écrivain, portfolio, travail, etc.), ces mêmes enfants déclarent<br />
en effet « faire » des objets du monde (bonhommes, photos, cœurs, peintures, dinosaures,<br />
chevaliers, dessins) et des objets d’écriture (<strong>le</strong>ttres, noms, alphabet, prénom, travail, chiffres).<br />
Le terme « activités » recouvre pour l’instant toutes <strong>le</strong>s pratiques scolaires qu’el<strong>le</strong>s soient<br />
scriptura<strong>le</strong>s ou iconographiques permettant à certains élèves ayant conscience de ne pas<br />
« encore savoir écrire » de trouver place à l’éco<strong>le</strong> et de construire <strong>le</strong>ur rapport à l’écriture<br />
particulière qu’est l’écriture scolaire.<br />
La différence entre écrire et dessiner est davantage remarquée par <strong>le</strong>s enfants de petite et<br />
moyenne sections de l’éco<strong>le</strong> Anne Frank que par ceux du premier corpus. Alors que cette<br />
distinction se fait jour en moyenne section pour <strong>le</strong>s élèves du corpus , la majorité des élèves<br />
du corpus Freinet annonce dès la petite section une différence entre ces deux actions ;<br />
distinction qui se manifeste discursivement par l’emploi de termes précis : faire, dessiner,<br />
écrire. Cependant, cette différence n’est pas encore explicitée : « c’est pas pareil » répond<br />
la majorité des élèves.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
5.2.5. Écrire et grandir<br />
L’association entre écrire et grandir effectuée par de nombreux enfants du corpus<br />
n’apparaît dans <strong>le</strong> corpus qu’en moyenne section et pour un seul élève. El<strong>le</strong> est mise<br />
en avant par Wassim qui aime écrire parce qu’il est grand. Dans <strong>le</strong>s discours du corpus ,<br />
cette association est en place dès la petite section et el<strong>le</strong> concerne davantage d’élèves :<br />
el<strong>le</strong> est surtout avancée lorsqu’il s’agit d’expliquer la facilité à écrire. Cette mise en relation<br />
entre écrire et grandir explique pour ces élèves l’acquisition de l’écriture de façon quasi<br />
magique.<br />
Le rapport à l’écriture scolaire des enfants du corpus Freinet est établi dès la petite section<br />
et ce rapport est plutôt positif tandis que pour <strong>le</strong>s enfants du premier corpus, il s’esquisse<br />
en moyenne section et est plutôt empreint d’éléments négatifs comme on <strong>le</strong> verra dans <strong>le</strong><br />
paragraphe suivant intitulé la sérénité. Ni positif, ni négatif, à peine esquissé, <strong>le</strong> rapport<br />
à l’écriture scolaire en moyenne section des enfants du corpus est peu affirmé et peu<br />
développé. Pour ces enfants, <strong>le</strong> rapport à l’écriture scolaire apparaît d’autant plus incertain<br />
et parcellaire que <strong>le</strong> rapport à l’écriture domestique semb<strong>le</strong> nourri et consistant, mais<br />
surtout déconnecté d’un point de vue principa<strong>le</strong>ment affectif, de toutes <strong>le</strong>s autres pratiques<br />
scriptura<strong>le</strong>s.<br />
5.3. La sérénité<br />
En petite et moyenne sections, il n’est pas diffici<strong>le</strong> d’écrire pour <strong>le</strong>s enfants des deux corpus,<br />
mais <strong>le</strong>s enfants du second corpus explicitent davantage <strong>le</strong>s raisons de cette facilité. Ces<br />
raisons restituent parfois des étapes de l’apprentissage. Ainsi, Sarah dit :<br />
« Pas dur, je fais comme ça, je sais écrire tous <strong>le</strong>s chiffres, je sais écrire <strong>le</strong>s dessins mais pas <strong>le</strong>s<br />
mots. »<br />
Les raisons avancées sont aussi matériel<strong>le</strong>s :<br />
« On prend une feuil<strong>le</strong> et un crayon et on fait ça ». (Sophia)<br />
El<strong>le</strong>s tiennent encore au fait « qu’ils savent », et peuvent expliciter « ce savoir » :<br />
« Parce que si on fait un petit peu ça, on a fini » (Amar)<br />
Quatre enfants seu<strong>le</strong>ment trouvent que c’est diffici<strong>le</strong>, mais c’est la facilité qui est expliquée.<br />
Du coup, <strong>le</strong>s difficultés perdent de <strong>le</strong>ur charge négative, ce qui n’est pas <strong>le</strong> cas dans <strong>le</strong> corpus<br />
où <strong>le</strong> manque d’explicitation provoque ou amplifie des tensions et une certaine inquiétude.<br />
Les enfants du premier corpus ont donc en petite et moyenne sections des difficultés à<br />
écrire. Deux enfants en petite section, puis huit en moyenne expriment un investissement<br />
négatif : ils n’aiment pas, ne savent pas, n’y arrivent pas. Il n’y a, dans <strong>le</strong>s dires des élèves<br />
de l’éco<strong>le</strong> Freinet, aucune mention d’impuissance à écrire due aux difficultés scriptura<strong>le</strong>s.<br />
Cette sérénité des enfants de l’éco<strong>le</strong> Freinet se manifeste, après <strong>le</strong> rapport à l’écriture<br />
domestique, dans <strong>le</strong> rapport à l’écriture scolaire développé dès la petite section et globa<strong>le</strong>ment<br />
positif dès sa naissance : ils aiment écrire à l’éco<strong>le</strong>, (sauf un parce qu’il « dépasse »).<br />
5.4. La clarté cognitive<br />
5.4.1. Le nombre de réponses<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
En petite et en moyenne sections, <strong>le</strong> nombre de réponses constitue la différence la plus<br />
tangib<strong>le</strong>. Les enfants de l’éco<strong>le</strong> Anne Frank répondent tous aux questions, ce qui n’est pas<br />
<strong>le</strong> cas pour <strong>le</strong>s élèves du corpus malgré <strong>le</strong> « signa<strong>le</strong>ment » des enfants <strong>le</strong>s moins prolixes<br />
par <strong>le</strong>s enseignantes. Les enfants scolarisés à l’éco<strong>le</strong> Freinet répondent donc plus faci<strong>le</strong>ment<br />
et <strong>le</strong>urs réponses sont souvent plus consistantes et argumentées que <strong>le</strong>s enfants du corpus<br />
. Pour la petite section, on trouve dans <strong>le</strong> corpus un grand nombre de réponses par oui<br />
ou non ainsi que des réponses inadéquates ou des réponses manquantes (par exemp<strong>le</strong> :<br />
réponses non analysab<strong>le</strong>s sur à la question « Qu’est-ce que l’écriture ?» dans <strong>le</strong> corpus<br />
; sur dans <strong>le</strong> deuxième corpus). Dans <strong>le</strong> corpus , <strong>le</strong>s réponses sont plus longues<br />
et souvent argumentées. Sur l’ensemb<strong>le</strong> des questions, plus de la moitié des élèves du<br />
premier corpus ne répond pas.<br />
En moyenne section, tous <strong>le</strong>s élèves du corpus répondent, alors que deux tiers seu<strong>le</strong>ment<br />
des enfants du corpus donnent des réponses à l’ensemb<strong>le</strong> des questions. Il semb<strong>le</strong> que<br />
<strong>le</strong> langage témoigne de la clarté cognitive et que cel<strong>le</strong>-ci se renforce par l’exposition au<br />
langage.<br />
5.4.2. Le sens de l’écriture<br />
En petite et moyenne sections pour <strong>le</strong>s élèves Freinet, écrire permet de faire : « des travails<br />
à la bibliothèque », d’« écrire des <strong>le</strong>ttres », d’« apprendre un nom et apprendre l’alphabet ».<br />
D’autres raisons sont aussi avancées tenant au fait de pouvoir écrire seul et de faire tout ce<br />
qu’on veut. Pour <strong>le</strong>s élèves du corpus , <strong>le</strong> sens de l’écriture se tient essentiel<strong>le</strong>ment dans<br />
l’écriture du prénom.<br />
Le sens de l’écrit semb<strong>le</strong> s’étendre pour <strong>le</strong>s élèves Freinet dès la petite section à de nombreux<br />
objets et circonstances.<br />
5.4.3. Écrire s’apprend<br />
En moyenne section, <strong>le</strong>s élèves du corpus n’ont pas conscience que l’écriture s’apprend<br />
et qu’ils sont en apprentissage : Quentin déclare :<br />
« Et comment on fait pour apprendre à écrire ?<br />
– Ben, on prend un feutre et on enlève <strong>le</strong> bouchon et on écrit. »<br />
Les élèves Freinet savent ou ne savent pas écrire, mais ils peuvent justifier de cet état. Ils <strong>le</strong><br />
font en donnant des exemp<strong>le</strong>s précis dans <strong>le</strong> premier cas ou par comparaison avec d’autres<br />
activités dans <strong>le</strong> second (voir <strong>le</strong> - .). Lorsqu’ils « n’y arrivent pas », ils explicitent la facilité<br />
(voir <strong>le</strong> - .) ; ce qui, peut-être, permet <strong>le</strong> déc<strong>le</strong>nchement du processus d’apprentissage en<br />
dépassant <strong>le</strong>s difficultés et en précisant « l’objectif didactique » à atteindre ; ce qui, en tout<br />
cas, « positive » l’apprentissage.<br />
Les élèves du corpus conservent une approche globa<strong>le</strong> (« c’est diffici<strong>le</strong> parce que j’arrive<br />
pas ») ne permettant pas de distinguer ce qui fait entrave et <strong>le</strong>ur laissant de l’écriture la<br />
représentation d’une entité aux difficultés intégra<strong>le</strong>ment irréductib<strong>le</strong>s, <strong>le</strong> plus souvent liées<br />
intrinsèquement à grandir (« c’est diffici<strong>le</strong> parce que je suis grande »). Il semb<strong>le</strong>rait encore<br />
que, pour <strong>le</strong> corpus , <strong>le</strong>s références fortes à la matérialité de l’écriture scolaire soient des<br />
obstac<strong>le</strong>s à l’appréhension de l’objectif didactique et que <strong>le</strong>s activités annexes (ranger <strong>le</strong>s<br />
étiquettes, col<strong>le</strong>r, découper) masquent la conscience de l’acte d’écriture.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Pour <strong>le</strong>s enfants du premier corpus, <strong>le</strong> lieu d’apprentissage est toujours la maison. Les<br />
enfants du groupe Freinet ont des conceptions plus larges du lieu d’apprentissage de<br />
l’écriture : l’éco<strong>le</strong> bien sûr, mais aussi <strong>le</strong> centre de loisirs, la campagne, toutes <strong>le</strong>s classes,<br />
tout partout, à l’ordinateur. Il semb<strong>le</strong> que <strong>le</strong> monde de l’écrit soit plus étendu.<br />
Les élèves du corpus Freinet développent un rapport à l’apprentissage dont la construction<br />
semb<strong>le</strong> facilitée par la référence d’une part, à un monde plus vaste qui facilite <strong>le</strong>s comparaisons,<br />
multiplie <strong>le</strong>s lieux d’écriture et d’autre part, à des processus d’apprentissage centrés sur des<br />
objectifs précis qui permettent à une certaine sérénité de s’instal<strong>le</strong>r.<br />
5.4.4. Les termes métalinguistiques<br />
Dès la petite section, chez <strong>le</strong>s élèves Freinet, quelques termes métalinguistiques apparaissent<br />
lorsqu’il s’agit d’expliquer pourquoi ils aiment écrire: « On peut écrire des mots » dit Pauline.<br />
Bien que rares et succincts encore, ces termes ne se trouvent pas dans <strong>le</strong> premier corpus.<br />
En moyenne section, <strong>le</strong>s élèves du corpus définissent l’écriture autant par l’écriture de<br />
<strong>le</strong>ur prénom que par cel<strong>le</strong> de mots et de <strong>le</strong>ttres alors que dans <strong>le</strong> corpus , la définition de<br />
l’écriture passe d’abord par <strong>le</strong> prénom.<br />
Conclusion<br />
Les différences entre <strong>le</strong>s propos des deux corpus révè<strong>le</strong>nt dans <strong>le</strong>s discours des enfants<br />
du corpus Freinet, l’existence précoce d’un rapport à l’écrit, caractérisé par des éléments<br />
de clarté cognitive et une attention plus vive aux phénomènes scripturaux, rapport donnant<br />
l’impression d’une plus grande sérénité dans <strong>le</strong> cheminement vers l’écrit et englobant plus<br />
précocement <strong>le</strong> rapport à l’écriture scolaire.<br />
Ces différences sont cependant moins évidentes que cel<strong>le</strong>s re<strong>le</strong>vées en grande section et<br />
au cours préparatoire. Les deux premières années de scolarité maternel<strong>le</strong> présentent non<br />
pas des similitudes plus importantes entre <strong>le</strong>s enfants du groupe Freinet et <strong>le</strong>s enfants du<br />
premier corpus, mais plutôt des similitudes fortement nuancées par des traits divergents<br />
et des différences relativisées par des points de ressemblances. Les différences qui se<br />
forment, se précisent et s’accentuent par la suite tendraient à prouver <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> et l’influence<br />
de la pédagogie Freinet lors des apprentissages de l’entrée dans l’écrit.<br />
Les ressemblances se tiennent comme pour <strong>le</strong>s années à venir dans <strong>le</strong>s pratiques<br />
scriptura<strong>le</strong>s domestiques, nombreuses, nourries et investies. Cependant pour <strong>le</strong>s enfants de<br />
l’éco<strong>le</strong> Freinet, ces pratiques sont immédiatement mises en concurrence avec <strong>le</strong>s pratiques<br />
d’écriture scolaire, el<strong>le</strong>s aussi fortement investies. Cette mise en concurrence est favorisée<br />
par la construction plus précoce chez <strong>le</strong>s enfants scolarisés à l’éco<strong>le</strong> Freinet de ce rapport<br />
à l’écriture scolaire.<br />
Chez <strong>le</strong>s enfants du corpus , <strong>le</strong> terme « activités », comme <strong>le</strong> sera <strong>le</strong> terme « travail »<br />
ensuite, paraît caractériser <strong>le</strong>s discours sur l’écriture. Il permet, ainsi que <strong>le</strong> dit Yannis, de<br />
distinguer l’écrit : « À l’éco<strong>le</strong>, je sais pas écrire je fais des activités ».<br />
La distinction essentiel<strong>le</strong> se tient dans la cohérence du rapport à l’écrit que <strong>le</strong>s discours des<br />
élèves Freinet restituent. Si l’on admet que <strong>le</strong> rapport à l’écrit peut se décliner en : rapport à<br />
l’apprentissage, rapport à l’écriture domestique et rapport à l’écriture scolaire, ces différents<br />
rapports présentent chez ces enfants, des connexions se caractérisant par des al<strong>le</strong>rs et<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
etours langagiers, rendant compte de la spécificité de chacun d’entre eux mais aussi de ce<br />
qui en assure la cohésion permettant de par<strong>le</strong>r d’un rapport global à l’écrit. Cette partition<br />
en rapports distincts est intéressante car el<strong>le</strong> permet de mettre au jour <strong>le</strong>s caractéristiques<br />
de chaque rapport mais aussi ce qui <strong>le</strong>s rapproche et <strong>le</strong>s lie. Pour <strong>le</strong>s élèves du corpus ,<br />
la constitution de ces rapports est décalée : <strong>le</strong> rapport à l’écriture domestique est précoce<br />
alors que celui à l’écriture scolaire semb<strong>le</strong> apparaître en grande section, empêchant <strong>le</strong>s<br />
interactions et <strong>le</strong>s connexions. Lorsque ces rapports coexistent chez certains élèves, ils<br />
restent alors parallè<strong>le</strong>s.<br />
Les spécificités de l’écrit commencent à être perçues très tôt chez <strong>le</strong>s élèves Freinet et<br />
ce grâce aux nombreuses comparaisons possib<strong>le</strong>s et aux différentes activités proposées.<br />
Le moment de l’entrée dans l’écrit est, de fait, plus précoce. Cette entrée dans l’écrit est<br />
favorisée par la pédagogie mise en œuvre, en particulier <strong>le</strong>s différents supports écrits<br />
proposés aux élèves, mais aussi par la constitution d’une « communauté éducative ». Cel<strong>le</strong>ci<br />
se base d’une part sur <strong>le</strong> dialogue, la mise en situation, et d’autre part sur l’adhésion<br />
et la collaboration demandées aux parents. On pourrait la décliner ainsi : l’absence de<br />
concurrence déclarée, tant dans <strong>le</strong>s rapports avec la fratrie que dans <strong>le</strong>s objets écrits à la<br />
maison et à l’éco<strong>le</strong> (concurrence évidente dans <strong>le</strong> corpus ) ; la circulation des écrits entre<br />
<strong>le</strong>s deux lieux ; <strong>le</strong>s relations établies par <strong>le</strong>s enfants entre l’écriture scolaire et domestique ;<br />
<strong>le</strong>s appels fréquents aux parents pour l’accompagnement de certaines activités scolaires.<br />
Dans un tel cadre, l’écriture apparaît comme un objet d’apprentissage et non un enjeu lourd<br />
d’implications variées (redoub<strong>le</strong>ment, dévalorisation, etc.). Curieusement, dans ces deux<br />
premières années et contrairement à la grande section et au cours préparatoire, <strong>le</strong>s élèves<br />
Freinet ne se positionnent pas comme scripteurs mais plutôt comme non-scripteurs avec<br />
des modè<strong>le</strong>s forts comme la famil<strong>le</strong> et la maîtresse. Cette position <strong>le</strong>ur évite de stigmatiser<br />
<strong>le</strong>s gribouillages des plus petits.<br />
La reconnaissance, la continuité, la contextualisation, la description et l’explicitation, marquent<br />
<strong>le</strong>s propos du corpus Freinet, même si ces marques sont légères, voire ténues. La forme<br />
de travail pédagogique, <strong>le</strong>s relations avec <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s jouent un rô<strong>le</strong> non négligeab<strong>le</strong>. De<br />
ces différents facteurs se dégage une certaine sérénité, qui semb<strong>le</strong> favorab<strong>le</strong> à la réussite<br />
des apprentissages. Si dans <strong>le</strong>s deux corpus, <strong>le</strong> rapport à l’écriture domestique est <strong>le</strong> plus<br />
construit, <strong>le</strong>s élèves du groupe Freinet construisent plus tôt (dès la petite section) un rapport<br />
à l’apprentissage et à l’écriture scolaire.<br />
Bibliographie<br />
Becousse G., ( 00 ), « De l’éco<strong>le</strong> Freinet au collège : <strong>le</strong> devenir des élèves entrant en e » ,<br />
dans Reuter Y., dir : Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire, Rapport de<br />
recherche de l’ERTe 0 ( 00 - 00 ), remis à la Direction de la Recherche du Ministère<br />
de l’Éducation.<br />
Carra C., ( 00 ), « Déviances et régulations dans une éco<strong>le</strong> Freinet », dans Reuter Y., dir :<br />
Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire, Rapport de recherche de l’ERTe<br />
0 ( 00 - 00 ), remis à la Direction de la Recherche du Ministère de l’Éducation.<br />
Cohen Azria C., Delcambre I., ( 00 ), « Pratiques langagières et activités scientifiques en<br />
maternel<strong>le</strong> » , dans Reuter Y., dir : Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire,<br />
Rapport de recherche de l’ERTe 0 ( 00 - 00 ), remis à la Direction de la Recherche du<br />
Ministère de l’Éducation.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Delcambre I., ( 00 ), « Dispositifs d’oral en maternel<strong>le</strong> et en CP », dans Reuter Y., dir :<br />
Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire, Rapport de recherche de l’ERTe<br />
0 ( 00 - 00 ), remis à la Direction de la Recherche du Ministère de l’Éducation.<br />
Fialip Baratte M., ( 00 ), L’écriture avant l’écriture, discours d’enfants de maternel<strong>le</strong>, thèse,<br />
Université Char<strong>le</strong>s de Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III.<br />
Fialip Baratte M., ( 00 ), « L’entrée dans l’écrit », dans Reuter Y., dir : Démarches<br />
pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire, Rapport de recherche de l’ERTe 0 ( 00 -<br />
00 ), remis à la Direction de la Recherche du Ministère de l’Éducation.<br />
Giguere J., ( 00 a), « L’univers de l’écrit à l’éco<strong>le</strong> primaire : comparaison de trois modes<br />
de travail pédagogique », dans Reuter Y., dir : Démarches pédagogiques et lutte contre<br />
l’échec scolaire, Rapport de recherche de l’ERTe 0 ( 00 - 00 ), remis à la Direction de<br />
la Recherche du Ministère de l’Éducation.<br />
Giguere J., ( 00 b), « Influence de la pédagogie Freinet sur <strong>le</strong>s conceptions des relations<br />
<strong>le</strong>cture-écriture chez <strong>le</strong>s élèves du CP au CM », dans Reuter Y., dir : Démarches<br />
pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire, Rapport de recherche de l’ERTe 0 ( 00 -<br />
00 ), remis à la Direction de la Recherche du Ministère de l’Éducation.<br />
Goody J., ( 0), La raison graphique, La domestication de la pensée sauvage, Paris,<br />
Minuit.<br />
Hassan R., ( 00 ), « Évaluations nationa<strong>le</strong>s à l’entrée en CE et en e, évolution, mise en<br />
perspective, problèmes » , dans Reuter Y., dir : Démarches pédagogiques et lutte contre<br />
l’échec scolaire, Rapport de recherche de l’ERTe 0 ( 00 - 00 ), remis à la Direction de<br />
la Recherche du Ministère de l’Éducation.<br />
Jovenet A.M., ( 00 ), « L’espace psychique de l’acquisition des savoirs, construit par l’éco<strong>le</strong><br />
en pédagogie Freinet », dans Reuter Y., dir : Démarches pédagogiques et lutte contre<br />
l’échec scolaire, Rapport de recherche de l’ERTe 0 ( 00 - 00 ), remis à la Direction de<br />
la Recherche du Ministère de l’Éducation.<br />
Lahanier Reuter D., ( 00 ), « Enseignement et apprentissages mathématiques », dans<br />
Reuter Y., dir : Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire, Rapport de<br />
recherche de l’ERTe 0 ( 00 - 00 ), remis à la Direction de la Recherche du Ministère<br />
de l’Éducation.<br />
Pagoni M., ( 00 ), « Quels apprentissages en éducation civique et mora<strong>le</strong> ? », dans Reuter<br />
Y., dir : Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire, Rapport de recherche<br />
de l’ERTe 0 ( 00 - 00 ), remis à la Direction de la Recherche du Ministère de<br />
l’Éducation.<br />
Reuter Y., ( 00 ), « La production de textes », dans Reuter Y., dir : Démarches pédagogiques<br />
et lutte contre l’échec scolaire, Rapport de recherche de l’ERTe 0 ( 00 - 00 ), remis à<br />
la Direction de la Recherche du Ministère de l’Éducation.<br />
Annexe : questionnaire<br />
Questions<br />
I<br />
) C’est quoi écrire pour toi ?<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
) Est-ce que tu aimes ? Pourquoi ?<br />
) Est-ce bien de savoir écrire ? Pourquoi ?<br />
II<br />
) D’après toi, où apprend-on à écrire ?<br />
) Quand ?<br />
) Comment ?<br />
) Est-ce diffici<strong>le</strong> ou faci<strong>le</strong> ? Pourquoi ?<br />
) Est-ce que tu as envie d’apprendre à écrire ? Pourquoi ?<br />
III<br />
) Est-ce que tu écris chez toi ?<br />
) Quoi ?<br />
) Sur quoi écris-tu ?<br />
) Avec quoi ?<br />
) Sur quoi poses-tu ta feuil<strong>le</strong>, etc<br />
) Où écris-tu ? Dans quel<strong>le</strong> pièce ?<br />
) Quand écris-tu ?<br />
) Comment écris-tu ?<br />
) Est-ce que tu aimes ? Pourquoi ?<br />
0) Qu’est-ce que tu aimes ou n’aimes pas ? Pourquoi ?<br />
IV<br />
) Qui écrit chez toi ? Pour quoi faire ?<br />
) Quand ?<br />
) Où? Dans quel<strong>le</strong> pièce ?<br />
) Sur quel support ?<br />
) Comment ? (posture, outil)<br />
) Est-ce que la personne aime ou non ? Sais-tu pourquoi ?<br />
V<br />
) Est-ce que tu écris à l’éco<strong>le</strong>?<br />
) Quoi ?<br />
) Sur quoi ?<br />
) Avec quoi ?<br />
) Y a-t-il une différence entre écrire et dessiner ?<br />
) Ton prénom, tu l’écris ou tu <strong>le</strong> dessines ?<br />
) Est-ce que tu aimes écrire ? Pourquoi ? Qu’est-ce que tu aimes ou n’aimes<br />
pas ?<br />
) Est-ce diffici<strong>le</strong> ? Pourquoi ?<br />
) Quand vas-tu écrire ?<br />
VI<br />
Quel est ton meil<strong>le</strong>ur souvenir d’écriture ?<br />
Quel est on pire souvenir d’écriture ?<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Langue et métalangage : comparaison des<br />
compétences dans deux éco<strong>le</strong>s aux modes de<br />
travail pédagogique différents<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Bertrand DAUNAY<br />
Maître de conférences<br />
Université de Lil<strong>le</strong> III<br />
Équipe THÉODILE<br />
Dans l’analyse des productions d’élèves, <strong>le</strong>s analyses d’Yves Reuter ( 00 ) montrent la<br />
faib<strong>le</strong>sse des progrès, en trois ans, des élèves de l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher, dans <strong>le</strong> domaine<br />
de la langue en général et en orthographe particulièrement : la comparaison avec <strong>le</strong>s<br />
autres éco<strong>le</strong>s montrait là un point faib<strong>le</strong>. Ces remarques va<strong>le</strong>nt pour <strong>le</strong>s récits renvoyant à<br />
l’imaginaire ou au vécu : cf. Yves Reuter ( 00 , p. , et p. sq.) . Il faut préciser<br />
que <strong>le</strong>s différences entre <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s ne sont pas grandes, mais que l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher,<br />
qui ne propose d’ail<strong>le</strong>urs pas un apprentissage centré sur ces questions, n’a pas une plus<br />
grande réussite dans ce domaine, contrairement à d’autres qui touchent à la production de<br />
textes. Ces analyses, qui prennent comme critères l’orthographe (nombre de mots erronés)<br />
et la syntaxe (nombre de phrases simp<strong>le</strong>s et comp<strong>le</strong>xes réussies) , entrent en résonance<br />
avec <strong>le</strong>s observations de Rouba Hassan qui note, dans <strong>le</strong>s évaluations à l’entrée en e , une<br />
baisse régulière des résultats dans <strong>le</strong> champ « outils de la langue », baisse corrélée à une<br />
baisse observée au niveau national, mais <strong>le</strong>s scores de Boucher ne sont pas différents de<br />
ceux de Montaigne et sont inférieurs à ceux du pays (Hassan, 00 , p. ) .<br />
L’objectif de cette étude est d’ajouter quelques données et quelques éléments d’explication<br />
à ces observations, par la mesure de l’évolution des élèves dans <strong>le</strong> domaine de la langue,<br />
entre <strong>le</strong> CE et la e . L’étude prend pour base <strong>le</strong>s évaluations CE et e , non pour analyser<br />
<strong>le</strong>s résultats du champ « langue » (ce qu’a fait Rouba Hassan) mais pour analyser la<br />
maîtrise de la langue dans <strong>le</strong>s textes produits par <strong>le</strong>s élèves aux derniers exercices de ces<br />
deux évaluations. Il s’agit d’étudier plus spécifiquement l’orthographe, en distinguant <strong>le</strong>s<br />
catégories d’erreurs, c’est-à-dire de mesurer <strong>le</strong>s écarts à la norme.<br />
À cette étude de la maîtrise de la langue s’en ajoute une autre : cel<strong>le</strong> de la maîtrise du<br />
métalangage de la discipline. On a pu déjà noter que <strong>le</strong>s élèves de Boucher ont une forte<br />
activité réf<strong>le</strong>xive, en français notamment : ainsi, Martine Fialip ( 00 , p. ) observe<br />
que <strong>le</strong>s élèves de Boucher ont une plus grande clarté cognitive dans l’entrée dans l’écrit<br />
(ibid., p. ), Jacinthe Giguère ( 00 a, p. ) note que <strong>le</strong>s élèves de Boucher sont plus<br />
nombreux à considérer que lire peut aider à la maîtrise de l’orthographe. Mais, comme <strong>le</strong><br />
signa<strong>le</strong> <strong>le</strong> bilan final (ibid., p. ), <strong>le</strong>ur maîtrise du métalangage de la discipline est un peu<br />
défaillant et l’on observe une « déstabilisation face à des exercices métalinguistiques ».<br />
Un test « métalinguistique » a donc été passé auprès des élèves de CE , CM , CM de<br />
Boucher et de Montaigne.<br />
Cf. Yves Reuter et al. ( 00 , p. ).<br />
Cf. Rapport, p. et p. (noter que, pour <strong>le</strong>s récits renvoyant au vécu, un troisième critère est pris<br />
en compte : <strong>le</strong>s marques d’oralité).<br />
Alors que, dans <strong>le</strong>s évaluations CE , l’évolution est inverse : <strong>le</strong>s progrès sont constants et <strong>le</strong>s résultats<br />
en 00 dépassent la moyenne de la circonscription et la moyenne nationa<strong>le</strong>.
1. Maîtrise de l’orthographe<br />
0<br />
1.1. Principes d’analyse<br />
Le corpus est constitué des productions écrites réalisées aux évaluations CE de 00<br />
(exercice ) et des productions écrites réalisées aux évaluations e de 00 (exercice<br />
) des mêmes élèves de deux éco<strong>le</strong>s : Hélène Boucher ( élèves) et Montaigne (<br />
élèves). Concernant <strong>le</strong> corpus ainsi constitué, élèves n’ont pas rédigé de textes en CE<br />
à Boucher et à Montaigne : pour analyser l’évolution des erreurs, <strong>le</strong> corpus se réduit à<br />
pour Boucher et à pour Montaigne .<br />
Ce qui est visé est une sorte de bilan des savoir-faire acquis, à l’issue des cyc<strong>le</strong>s et<br />
de l’éco<strong>le</strong> primaire. Se pose cependant la question de la pertinence de ce choix : en<br />
effet, il faut tenir compte du fait que <strong>le</strong>s informations qu’il permet de livrer sont peut-être en<br />
décalage par rapport aux pratiques de Boucher : Jacinthe Giguère ( 00 b, p. ) note qu’à<br />
Boucher comme dans l’éco<strong>le</strong> « Projet », « <strong>le</strong>s exercices orthographiques et grammaticaux<br />
sont peu nombreux : plus de place est accordée à la production de textes. Il importe aussi<br />
de souligner que, dans ces deux éco<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s activités d’orthographe et grammaire sont<br />
davantage contextualisées et reliées aux projets d’écriture de la classe ». C’est d’ail<strong>le</strong>urs ce<br />
qui a amené Dominique Lahanier (Reuter dir, 00 , p. ) à ne pas se contenter de ces<br />
évaluations : « <strong>le</strong>s productions des élèves sont alors des productions écrites, individuel<strong>le</strong>s,<br />
contraintes dans <strong>le</strong> temps et ressenties par ceux-ci comme des évaluations sommatives ».<br />
Néanmoins, l’étude visant seu<strong>le</strong>ment à confirmer des observations faites en d’autres<br />
circonstances (cf. supra, introduction), <strong>le</strong> choix reste pertinent et peut mesurer précisément<br />
la maîtrise de l’orthographe en situation d’évaluation sommative. Une remarque encore :<br />
avant l’analyse des évaluations CE - e , une étude exploratoire a été menée sur un corpus<br />
de copies de CM déjà constitué par Yves Reuter (à d’autres fins), comprenant élèves<br />
( élèves de Montaigne, élèves de Boucher) : on y fera allusion, mais ce corpus n’avait<br />
qu’une fonction exploratoire de la gril<strong>le</strong> d’analyse de l’orthographe.<br />
Le corpus est analysé selon la « gril<strong>le</strong> typologique des erreurs d’orthographe » de Nina<br />
Catach ( ) L’orthographe française, Paris, Nathan, p. - . Cette gril<strong>le</strong> permet<br />
« de rattacher <strong>le</strong>s différents types d’erreurs aux éléments du système dont el<strong>le</strong>s relèvent »<br />
(ibid., p. ). Certes, précise Catach (ibid.) la gril<strong>le</strong> n’a pas été conçue pour « additionner<br />
<strong>le</strong>s erreurs de chaque élève ou de chaque classe », mais dans un but de mesure des<br />
compétences des élèves .<br />
Consigne : « Raconte une histoire dans laquel<strong>le</strong> tu introduiras la phrase suivante : À ce moment-là,<br />
un bruit étrange lui signala qu’il (el<strong>le</strong>) n’était pas seul(e) dans la maison. Cette phrase devra correspondre à<br />
un moment important de ton récit et tu la souligneras dans ton texte »<br />
Consigne : « Continue <strong>le</strong> récit de Sébasto et imagine une fin possib<strong>le</strong> dans laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong> mystère des<br />
chats sera résolu. N’oublie pas d’employer la première personne (“je”) et <strong>le</strong>s temps du passé ». Le texte à<br />
continuer est un extrait (lu en classe et faisant l’objet d’exercices précédents) du livre Les Chats de Marie-<br />
Hélène Delval, Bayard Jeunesse, .<br />
L’objectif initial était d’augmenter <strong>le</strong> corpus en prenant en compte <strong>le</strong>s évaluations CE de 00 et<br />
cel<strong>le</strong>s de e de 00 , mais ces dernières, égarées, ont été retrouvées trop tardivement pour faire l’objet d’une<br />
analyse.<br />
Voici quelques précisions sur <strong>le</strong>s catégories d’erreurs (et <strong>le</strong>s différences avec Catach) : je ne compte<br />
comme erreurs extragraphiques, parmi cel<strong>le</strong>s de Catach, que <strong>le</strong>s mauvaises coupures des mots (léco<strong>le</strong> pour<br />
l’éco<strong>le</strong>) ; je distingue, comme Catach, <strong>le</strong>s erreurs phonogrammiques avec ou sans altération phonique (par<br />
exemp<strong>le</strong>, respectivement : maisson ; anfant) ; dans la catégorie des erreurs morphogrammiques grammatica<strong>le</strong>s,<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
De fait – et c’est là un problème méthodologique qui se pose dans <strong>le</strong> traitement du corpus –<br />
el<strong>le</strong> est en partie inopérante dans une analyse « objective » de copies d’élèves, sans<br />
recours à des entretiens avec ces élèves : par exemp<strong>le</strong>, pour déterminer qu’une erreur est<br />
extragraphique ou non, il est nécessaire de connaître la prononciation effective du mot par<br />
l’élève.<br />
Mais <strong>le</strong> choix a été de faire un traitement du corpus qui puisse être reproduit sans grande<br />
distorsion par n’importe quel chercheur, en utilisant la gril<strong>le</strong> de Catach comme une typologie<br />
objective des erreurs. Dans l’analyse des résultats, il semblait pertinent de distinguer <strong>le</strong><br />
nombre de mots erronés (comptés une seu<strong>le</strong> fois même si plusieurs erreurs s’y trouvent<br />
réalisées) et <strong>le</strong> nombre total d’erreurs dans <strong>le</strong> texte : à l’usage, cette distinction ne s’est pas<br />
révélée opératoire (<strong>le</strong>s pourcentages des deux comptages étant proches), mais <strong>le</strong>s deux<br />
résultats seront donnés à chaque fois.<br />
En annexe sont reproduits <strong>le</strong>s principes théoriques et méthodologiques qui ont présidé à<br />
l’analyse des erreurs.<br />
1.2. Résultats<br />
. Il faut noter que <strong>le</strong>s élèves de Montaigne ont un nombre moyen de mots supérieur à celui<br />
de Boucher, ce qui ne va pas dans <strong>le</strong> sens des autres observations faites sur <strong>le</strong>s corpus<br />
de textes produits dans cette éco<strong>le</strong> : cela confirme que <strong>le</strong> contexte d’écriture (évaluation<br />
sommative décontextualisée) a un effet sur <strong>le</strong>s productions de ces élèves. Sans entrer dans<br />
<strong>le</strong> détail, on peut observer, par la répartition des élèves selon <strong>le</strong> nombre de mots (quarti<strong>le</strong>s),<br />
que <strong>le</strong> nombre d’élèves écrivant des textes moins longs s’accroît à Boucher en e :<br />
de à de à de à 0 de 0 à 0 de à de à 0 de 0 à de à<br />
CE e<br />
Nombre de mots – quarti<strong>le</strong>s (grisé : Boucher ; hachuré : Montaigne)<br />
. Concernant <strong>le</strong>s erreurs orthographiques, il y a peu de différences entre <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s si on<br />
prend <strong>le</strong>s moyennes des éco<strong>le</strong>s selon <strong>le</strong>s niveaux :<br />
CE<br />
e<br />
Pourcentage moyen de mots Boucher , % 0, 0%<br />
erronés<br />
Montaigne , % , %<br />
Pourcentage moyen d’erreurs Boucher , % 0, %<br />
Montaigne , % , %<br />
Résultats moyens globaux<br />
je distingue <strong>le</strong>s erreurs concernant <strong>le</strong>s verbes des autres ; <strong>le</strong>s erreurs logogrammiques correspondent à la liste<br />
de Catach (est pour et, par exemp<strong>le</strong>) ; <strong>le</strong>s erreurs idéogrammiques ne concernent pas chez moi la ponctuation<br />
(traitée à part) mais seu<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s erreurs de majuscu<strong>le</strong>s et de traits d’union.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
On peut remarquer cependant une tendance : <strong>le</strong>s élèves de Boucher font un peu moins<br />
d’erreurs en CE que ceux de Montaigne, mais <strong>le</strong> rapport s’inverse en e .<br />
. Il y a éga<strong>le</strong>ment peu de différences entre <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s si l’on prend en compte la nature des<br />
erreurs (calculée ici en pourcentage du nombre d’erreurs) :<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
CE2 6 e<br />
Résultats en pourcentage par catégories d’erreurs (grisé : Boucher ; hachuré : Montaigne)<br />
On voit que <strong>le</strong>s zones d’erreurs sont à peu près <strong>le</strong>s mêmes dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s et que <strong>le</strong>s<br />
évolutions sont éga<strong>le</strong>ment assez proches : <strong>le</strong>s erreurs se concentrent davantage dans la<br />
zone « morphogrammique verba<strong>le</strong> », mais de façon identique dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s, même<br />
si l’on note, en CE comme en e , un moins grand nombre d’erreurs dans cette zone à<br />
Boucher qu’à Montaigne. Sur ce point particulièrement, <strong>le</strong>s résultats obtenus avec <strong>le</strong> corpus<br />
exploratoire « CM » sont convergents.<br />
. Pour ce qui est de l’évolution des résultats entre <strong>le</strong> CE et la e , Boucher fait moins bien<br />
que Montaigne, qu’on prenne la moyenne des élèves ou <strong>le</strong> nombre d’élèves ayant fortement<br />
progressé :<br />
mots<br />
erronés<br />
erreurs<br />
Écart moyen entre CE et e Boucher - , 0 - ,<br />
Montaigne - 0, 0 - ,<br />
Nombre d’élèves ayant un écart supérieur Boucher sur sur<br />
à 0<br />
Montaigne sur sur<br />
Évolution des résultats entre <strong>le</strong> CE2 et la 6 e<br />
Les écarts-types (qu’il s’agisse du nombre de mots erronés ou du nombre d’erreurs) montrent<br />
éga<strong>le</strong>ment une évolution contrastée, mais avec un resserrement des résultats à Boucher et<br />
une dispersion à Montaigne :<br />
CE<br />
e<br />
mots erreurs mots erreurs<br />
erronés<br />
erronés<br />
Boucher , , , ,<br />
Montaigne , 0, , ,<br />
Écart-type<br />
Dans <strong>le</strong>s tab<strong>le</strong>aux ci-dessous, <strong>le</strong>s catégories d’erreurs sont <strong>le</strong>s suivantes :<br />
= erreur extragraphique<br />
= erreur phonogrammique avec altération phonique<br />
= erreur phonogrammique sans altération<br />
= erreur morphogrammique (verbes)<br />
= erreur morphogrammique (autres mots)<br />
= erreur mophogrammique <strong>le</strong>xica<strong>le</strong><br />
= erreur logogrammique<br />
= erreur idéogrammique<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
En prenant en compte la répartition des élèves selon <strong>le</strong>s résultats , on peut rendre compte<br />
éga<strong>le</strong>ment de la répartition des résultats concernant l’évolution entre CE et e , ce qui entre<br />
en concordance avec <strong>le</strong>s deux derniers tab<strong>le</strong>aux :<br />
0%<br />
0%<br />
0%<br />
0%<br />
0%<br />
0%<br />
0%<br />
Progrès<br />
notab<strong>le</strong>s<br />
Progrès<br />
moyens<br />
Régression Progrès<br />
notab<strong>le</strong>s<br />
Progrès<br />
moyens<br />
Mots erronés Erreurs<br />
Régression<br />
Répartition des résultats selon <strong>le</strong>s progrès (grisé : Boucher ; hachuré : Montaigne)<br />
Ce graphique livre certaines informations :<br />
– Boucher se concentre davantage dans <strong>le</strong>s progrès moyens ;<br />
– Le nombre d’élèves ayant fortement progressé est moins grand à Boucher qu’à Montaigne,<br />
quel que soit <strong>le</strong> mode de mesure choisi ;<br />
– Inversement, <strong>le</strong> nombre d’élèves ayant peu progressé ou régressé est plus grand à<br />
Boucher qu’à Montaigne.<br />
1.3. Conclusion<br />
La faib<strong>le</strong>sse de l’échantillon ne permet assurément de rien déduire de définitif des analyses<br />
ci-dessus. Mais cel<strong>le</strong>s-ci permettent de confirmer des tendances observées dans d’autres<br />
études, rappelées en introduction. Le peu de différences notab<strong>le</strong>s entre <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s ou,<br />
quand il y en a, <strong>le</strong> fait qu’el<strong>le</strong>s montrent plutôt un déficit pour l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher donne<br />
à penser que ce n’est effectivement pas dans cette zone de l’apprentissage du français que<br />
portent principa<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s effets des choix pédagogiques.<br />
2. Maîtrise métalinguistique<br />
2.1. Présentation des tests<br />
Pour approcher <strong>le</strong>s compétences des élèves dans la maîtrise du métalangage de la discipline,<br />
des exercices ont été proposés aux classes de CE , CM , CM des éco<strong>le</strong>s Boucher et<br />
Cette répartition tient compte des quarti<strong>le</strong>s, mais ces derniers ont été utilisés pour distinguer trois<br />
groupes : celui des progrès notab<strong>le</strong>s (premier quart), celui des régressions (dernier quart), celui des progrès<br />
moyens (entre <strong>le</strong>s deux : ce groupe correspond à la moitié du nombre total d’élèves).<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Montaigne. Voici <strong>le</strong> nombre et la répartition des élèves concernés :<br />
CE CM CM TOTAL<br />
Boucher 0 0<br />
Montaigne<br />
TOTAL<br />
Élèves concernés par <strong>le</strong>s tests<br />
Les exercices sont inspirés de ceux que propose Marie-Laure Élalouf ( 00 ). Cette étude<br />
visait à la fois <strong>le</strong> repérage des représentations que se font <strong>le</strong>s élèves de l’exercice de<br />
grammaire et <strong>le</strong>s modes de raisonnement qu’ils mettaient en œuvre.<br />
Les tests d’Élalouf concernaient des élèves de la e à la re et ne convenaient pas tels quels<br />
à des élèves de l’éco<strong>le</strong> élémentaire. Mais ils ont inspiré <strong>le</strong> principe même des tests et, pour<br />
certains, ont été repris – avec de légères modifications. Les changements opérés sont <strong>le</strong>s<br />
suivants :<br />
– <strong>le</strong> titre donné (« exercices de langue ») est volontairement un guide pour aider <strong>le</strong>s élèves<br />
à mobiliser <strong>le</strong>ur savoir métalinguistique ;<br />
– <strong>le</strong>s questions , , , , 0 ne sont pas posées ;<br />
– plusieurs modifications sont faites dans <strong>le</strong>s exemp<strong>le</strong>s donnés, pour simplifier <strong>le</strong>s<br />
phrases ;<br />
– dans tous <strong>le</strong>s exercices, est rajoutée la consigne « entoure-<strong>le</strong> » ;<br />
– à l’exercice , la question est modifiée pour éviter <strong>le</strong> mot « nature » ;<br />
– à l’exercice , la question est modifiée pour éviter <strong>le</strong> verbe « référer ».<br />
Le tab<strong>le</strong>au suivant récapitu<strong>le</strong> <strong>le</strong>s tests réalisés pour cette étude, en signalant <strong>le</strong>s exercices<br />
correspondants d’Élalouf, ainsi que <strong>le</strong>s compétences visées, en référence au programme<br />
du cyc<strong>le</strong> de l’éco<strong>le</strong> élémentaire 0 :<br />
Tests pour<br />
l’éco<strong>le</strong><br />
élémentaire<br />
Exercices<br />
d’Élalouf<br />
Compétences visées<br />
(programme du cyc<strong>le</strong> 3)<br />
identifier <strong>le</strong>s noms dans une phrase<br />
manipu<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s différentes expansions du nom (adjectifs qualificatifs, relatives,<br />
compléments du nom)<br />
trouver […] l’imparfait, <strong>le</strong> passé simp<strong>le</strong>, <strong>le</strong> futur, <strong>le</strong> conditionnel présent […]<br />
des verbes réguliers<br />
comprendre correctement la signification des divers emplois des temps<br />
verbaux du passé dans la narration<br />
cf. identifier <strong>le</strong>s verbes dans une phrase<br />
manipu<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s différents types de compléments des verbes <strong>le</strong>s plus fréquents<br />
cf. trouver […] l’imparfait, <strong>le</strong> passé simp<strong>le</strong>, <strong>le</strong> futur, <strong>le</strong> conditionnel présent […]<br />
des verbes réguliers<br />
cf. et 0 - manipu<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s différentes déterminations du nom (artic<strong>le</strong>s, déterminants<br />
possessifs, démonstratifs, indéfinis)<br />
- retrouver à quel substantif du texte renvoient <strong>le</strong>s différents substituts<br />
(pronoms, substituts nominaux)<br />
cf. manipu<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s différents types de compléments des verbes <strong>le</strong>s plus fréquents<br />
Compétences visées par <strong>le</strong>s tests<br />
On trouvera en annexe <strong>le</strong>s tests proposés et, <strong>le</strong> cas échéant, <strong>le</strong>s tests correspondants<br />
d’Élalouf.<br />
Les mêmes exercices ont été donnés en CE , en CM et en CM . Les différences tiennent<br />
0 En italique : <strong>le</strong>s compétences signalées explicitement dans <strong>le</strong> programme (tab<strong>le</strong>au des compétences<br />
spécifiques en ORL), mais non reprises dans la liste des compétences à acquérir en fin de cyc<strong>le</strong>.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
à deux choses : en CE , il y avait quatre énoncés au lieu de cinq ; en CM et CM , il<br />
était demandé en outre aux élèves de répondre à la question suivante : « Comment l’as-tu<br />
trouvé ? »<br />
2.2. Réponses aux questions<br />
Les résultats de Montaigne pour <strong>le</strong> CM sont surprenants : un taux moyen de réussite de<br />
% (ce qui correspond, selon <strong>le</strong>s questions, à des taux de réussite de % à %). Il<br />
s’avère, comme nous l’a indiqué l’enseignant titulaire de cette classe, que <strong>le</strong>s questions ont<br />
été posées aux élèves après des révisions systématiques des faits de langue concernés.<br />
Ce qui explique non seu<strong>le</strong>ment la très grande différence entre <strong>le</strong>s résultats à Montaigne et à<br />
Boucher, mais aussi l’étonnante progression entre <strong>le</strong> CM et <strong>le</strong> CM à Montaigne. Pour des<br />
raisons d’homogénéisation des résultats, nous n’avons pas retenu ceux de CM .<br />
Si on examine <strong>le</strong>s résultats globaux en calculant <strong>le</strong>s pourcentages de réussite par rapport<br />
au score théorique, on obtient un résultat intéressant, qui montre qu’il n’y a pas de différence<br />
notab<strong>le</strong> entre <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s :<br />
Total CE CM Total<br />
Boucher % % %<br />
Montaigne % % %<br />
Total % % %<br />
Pourcentages de réussite par rapport au score théorique<br />
Même si l’on ne prend pas en compte <strong>le</strong>s résultats de CM , <strong>le</strong>s résultats test par test en<br />
CE et en CM montrent des disparités entre <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s, mais avec, selon <strong>le</strong>s cas, une<br />
meil<strong>le</strong>ure réussite pour l’une ou pour l’autre, selon l’exercice ou, pour un exercice, selon <strong>le</strong>s<br />
niveaux. Cette disparité fait que Boucher peut avoir, pour un exercice, un meil<strong>le</strong>ur score que<br />
Montaigne en CE et moins bon en CM (par exemp<strong>le</strong> pour l’exercice ) et inversement<br />
pour un autre exercice (cf. l’exercice ). C’est pourquoi, en l’absence de régularité, il est<br />
diffici<strong>le</strong> d’interpréter ces résultats.<br />
Voici <strong>le</strong>s données brutes :<br />
Exercice<br />
CE CM Total<br />
Repérage du nom Boucher 0% % %<br />
Montaigne % % % Élalouf e<br />
Total % % % %<br />
Exercice CE CM Total<br />
Repérage du COD Boucher % % %<br />
Montaigne % % % Élalouf e<br />
Total % % % %<br />
Exercice CE CM Total<br />
Repérage du futur Boucher % % %<br />
Montaigne % % % Élalouf e<br />
Total % % 0% %<br />
Exercice CE CM Total<br />
Repérage du passé Boucher 0% % 0%<br />
Montaigne % % % Élalouf e<br />
Total % 0% % 0%<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Exercice CE CM Total<br />
Repérage du verbe Boucher 0% % 0%<br />
Montaigne 0% % %<br />
Total 0% % %<br />
Exercice CE CM Total<br />
Repérage de l’expansion Boucher 0% % %<br />
du nom Montaigne % % 0% Élalouf e<br />
Total % % % %<br />
Exercice CE CM Total<br />
Repérage du passé Boucher % % %<br />
simp<strong>le</strong> Montaigne % 0% %<br />
Total % % %<br />
Exercice CE CM Total<br />
Repérage du déterminant Boucher 0% % %<br />
Montaigne % % %<br />
Total % % %<br />
Exercice CE CM Total<br />
Repérage du COS Boucher % % %<br />
Montaigne % % %<br />
Total % % 0%<br />
Cette disparité de résultats ne permet donc pas de déduire une régularité dans la maîtrise<br />
de tel<strong>le</strong> ou tel<strong>le</strong> notion métalinguistique. Comme l’enseigne la mésaventure du test en<br />
CM à l’éco<strong>le</strong> Montaigne, <strong>le</strong>s résultats sont certainement davantage liés à la récence de<br />
l’enseignement d’une notion qu’au mode de travail pédagogique engagé.<br />
C’est sans doute ainsi que l’on peut expliquer que <strong>le</strong>s exercices et montrent une plus<br />
grande réussite en CE à Boucher qu’à Montaigne : cette solidarité des résultats pour<br />
<strong>le</strong>s deux compléments d’objets ne se retrouve pas en CM (Boucher réussit moins que<br />
Montaigne pour l’exercice , mais mieux pour l’exercice ).<br />
Une « zone » peut être intéressante à étudier, cel<strong>le</strong> du verbe, en fonction des remarques<br />
faites ci-dessus à propos des erreurs orthographiques, où l’on avait vu que <strong>le</strong>s erreurs de<br />
nature « morphogrammique verba<strong>le</strong> », étaient légèrement moins nombreuses à Boucher<br />
qu’à Montaigne. On observe ici que <strong>le</strong>s CM de Boucher ont de meil<strong>le</strong>urs résultats que<br />
Montaigne pour l’exercice (repérage du futur) et l’exercice (repérage du passé simp<strong>le</strong>) ,<br />
ainsi qu’à l’exercice (repérage du verbe) .<br />
On peut enfin observer que, tendanciel<strong>le</strong>ment, <strong>le</strong>s résultats sont meil<strong>le</strong>urs à Boucher qu’à<br />
Montaigne en CE pour <strong>le</strong>s exercices concernant <strong>le</strong>s fonctions ( , , ) que pour ceux qui<br />
concernent <strong>le</strong>s natures ( , ). Cela peut s’expliquer par l’usage d’un même métalangage<br />
(<strong>le</strong> mot « fonction » est utilisé à chaque fois), alors que <strong>le</strong>s questions concernant la nature<br />
emploient à chaque fois un métalangage différent.<br />
2.3. Justification des réponses<br />
Cela ne se vérifie pas pour <strong>le</strong>s CM à l’exercice (repérage du passé) : mais c’est un exercice<br />
spécifique, qui relève davantage de la grammaire de texte.<br />
C’est éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> cas en CE pour l’exercice ; il y a égalité pour l’exercice .<br />
Pour l’exercice , <strong>le</strong>s résultats de Boucher sont éga<strong>le</strong>ment meil<strong>le</strong>urs en CM .<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Il est intéressant d’examiner <strong>le</strong>s justifications données par <strong>le</strong>s élèves (en CM et en CM )<br />
à la question posée après chaque test : « Comment l’as-tu trouvé ? ». Il faut néanmoins<br />
signa<strong>le</strong>r que <strong>le</strong> faib<strong>le</strong> nombre de réponses et <strong>le</strong>s conditions de passation en CM Montaigne<br />
(certains des savoirs faisant l’objet des tests ayant été vus juste avant <strong>le</strong>ur passation) rendent<br />
<strong>le</strong>s résultats peu interprétab<strong>le</strong>s. Le codage est <strong>le</strong> suivant :<br />
0 = réponse sémantique, réponse tautologique, absence de réponse .<br />
= utilisation d’un métalangage par rapport à la réponse attendue.<br />
= utilisation d’un métalangage juste par rapport à la réponse attendue.<br />
Il est ainsi possib<strong>le</strong> d’établir un score pour chaque élève, de 0 à , qui signa<strong>le</strong> son<br />
utilisation du métalangage. Voici <strong>le</strong>s résultats globaux (ou <strong>le</strong>s scores de tous <strong>le</strong>s élèves sont<br />
additionnés) :<br />
Total CM CM Total<br />
Boucher % 0% 0%<br />
Montaigne % 0% %<br />
Total % % %<br />
Pourcentages de réussite par rapport au score théorique<br />
Sur cette dimension encore, <strong>le</strong>s élèves de Boucher ont des résultats moindre que ceux de<br />
Montaigne. La constatation est la même si l’on compare <strong>le</strong>s catégories d’élèves (l’axe des<br />
ordonnées indique des pourcentages, pour permettre la comparaison) :<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 à à à à<br />
Boucher Montaigne Boucher Montaigne<br />
CM CM<br />
En CM , un grand nombre d’élèves de Boucher n’utilisent aucun métalangage, ou peu. En<br />
CM , <strong>le</strong>s progrès sont visib<strong>le</strong>s, mais alors qu’aucun élève de Montaigne ne relève des deux<br />
premières catégories (scores de 0 à ), inversement, aucun élève de Boucher n’appartient<br />
à la dernière catégorie (scores de à ). L’usage du métalangage grammatical est moins<br />
aisé dans <strong>le</strong>s tests de cette nature pour <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Boucher que pour ceux de<br />
Montaigne.<br />
2.4. Conclusion<br />
Précisons que, dans l’analyse des résultats, ont été distinguées ces réponses (ainsi que <strong>le</strong>s réponses<br />
qui signa<strong>le</strong>nt l’incapacité de s’expliquer, distinguée de la non réponse). Mais <strong>le</strong> faib<strong>le</strong> nombre de réponses ne<br />
permet pas de tirer une information de ces distinctions.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Comme pour l’analyse des erreurs orthographiques, il n’est pas possib<strong>le</strong> de tirer des<br />
conclusions définitives de cette étude. Tout au plus peut-on observer des tendances,<br />
confirmées par d’autres travaux sur la comparaison entre <strong>le</strong>s modes de travail pédagogique<br />
dans ces deux éco<strong>le</strong>s : la maîtrise du métalangage grammatical comme la reconnaissance<br />
des catégories grammatica<strong>le</strong>s traditionnel<strong>le</strong>s dans un test métalinguistique sont des points<br />
faib<strong>le</strong>s de l’éco<strong>le</strong> Boucher. En tout état de cause, cette étude donne un cadre de travail<br />
pour d’autres observations de même nature, plus poussées, qui permettraient de vérifier<br />
si ces tendances correspondent à une réalité plus généra<strong>le</strong>. Deux conclusions provisoires<br />
peuvent être faites cependant : d’une part, on voit bien, dans <strong>le</strong> domaine de la maîtrise de<br />
l’orthographe comme du métalangage, une relative faib<strong>le</strong>sse de l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher.<br />
Mais, inversement, on peut dire que <strong>le</strong>s écarts n’étant pas très importants, <strong>le</strong>s résultats de<br />
Boucher sont relativement positifs, puisque ce n’est pas là-dessus que se concentrent <strong>le</strong>s<br />
efforts des maîtres dans <strong>le</strong> domaine du développement de la maîtrise du français chez <strong>le</strong>urs<br />
élèves.<br />
Références<br />
Élalouf M.-L. ( 00 ), « De la e à la re , comment mobilisent-ils <strong>le</strong>urs connaissances sur la<br />
langue dans des tâches d’explication ? », Pratiques n° - , Observations de la langue,<br />
Metz, CRESEF, p. - .<br />
Fialip-Baratte M. ( 00 ), « L’entrée dans l’écrit », dans Yves Reuter dir., p. - .<br />
Giguère J. ( 00 a), « Influence de la pédagogie Freinet sur <strong>le</strong>s conceptions des relations<br />
<strong>le</strong>cture-écriture chez <strong>le</strong>s élèves du CP au CM », dans Yves Reuter dir., p. -<br />
Giguère J. ( 00 b), « L’univers de l’écrit à l’éco<strong>le</strong> primaire : comparaison de trois modes<br />
de travail pédagogique : pédagogie Freinet, pédagogie par projet, pédagogie “classique” »,<br />
dans Yves Reuter dir., p. - .<br />
Hassan R. ( 00 ), « Évaluation nationa<strong>le</strong>s en CE et e : « Évolutions, mises en perspectives,<br />
problèmes », dans Yves Reuter dir., p. - .<br />
Reuter Y. ( 00 ), « La production de textes », dans Yves Reuter dir., p. - .<br />
Reuter Y. et al. ( 00 ) « Synthèse et propositions », dans Yves Reuter dir., p. - 0.<br />
Reuter Y. dir. ( 00 ), Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire (2002-200 ),<br />
Rapport de recherche ERTE 0 , Université Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong> – Lil<strong>le</strong> .<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Annexe 1 : principes théoriques et méthodologiques<br />
1. Comptage des mots<br />
L’unité de comparaison pour toutes <strong>le</strong>s erreurs (orthographiques, syntaxique, etc.) est <strong>le</strong><br />
nombre de mots du texte. Le comptage des mots obéit à des règ<strong>le</strong>s diverses qui ont plusieurs<br />
déterminations. Les voici énumérées :<br />
– Le nombre de mots est déterminé selon la norme : un mot orthographié à tort en deux<br />
mots compte pour un seul (par exemp<strong>le</strong>, pour quoi à la place de pourquoi compte pour un<br />
mot) et inversement un mot qui en vaut deux norma<strong>le</strong>ment compte pour deux mots par<br />
exemp<strong>le</strong>, sallonger pour s’allonger compte pour deux mots).<br />
– Les nombres étant parfois écrits en chiffres, <strong>le</strong>s erreurs sur <strong>le</strong>s nombres écrits en <strong>le</strong>ttres<br />
ne sont pas pris en compte. Exception : un, une.<br />
– Les abréviations ne sont pas prises en compte.<br />
2. Gril<strong>le</strong> d’analyse des erreurs d’orthographe<br />
Le corpus est analysé selon la « gril<strong>le</strong> typologique des erreurs d’orthographe » de Nina<br />
Catach ( , p. - ). Les choix méthodologiques sont <strong>le</strong>s suivants :<br />
– Ne sont comptées comme erreurs extragraphiques que cel<strong>le</strong>s qui consistent en une<br />
mauvaise coupure des mots, sans supposer (ce que permet la gril<strong>le</strong> de Catach utilisée<br />
avec des élèves en situation d’enseignement-apprentissage) qu’el<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong> signe d’une<br />
méconnaissance métalinguistique (préalab<strong>le</strong> à l’écrit) de la séparation des mots : el<strong>le</strong> sont<br />
en revanche, objectivement, <strong>le</strong> signe que cette séparation n’est pas rendue à l’écrit. Prenons<br />
deux exemp<strong>le</strong>s significatifs :<br />
• endessous pour en dessous ( ) entrera dans cette catégorie dans la mesure où<br />
l’expression n’est pas rendue comme composée de deux mots distincts (qu’el<strong>le</strong> soit ou non<br />
perçue comme tel<strong>le</strong>) ;<br />
•<br />
léco<strong>le</strong> pour l’éco<strong>le</strong> ( ) entrera aussi dans cette catégorie ; cela nous fera d’ail<strong>le</strong>urs<br />
négliger un type d’erreur, que Catach propose dans sa gril<strong>le</strong> comme erreur à dominante<br />
idéogrammique : l’absence d’une apostrophe.<br />
– Ne sont pas considérées comme « extragraphiques » <strong>le</strong>s erreurs qui peuvent (mais sans<br />
qu’on puisse ici <strong>le</strong> vérifier) à une question de prononciation. Par exemp<strong>le</strong>, amoire pour<br />
armoire ( ) peut certes renvoyer à un problème de prononciation, mais rien ne permettant<br />
d’en juger, il s’agira ici d’une erreur purement phonogrammique, par oubli d’un graphème.<br />
Pour compenser la perte d’information que crée ce choix, sont distinguées, dans <strong>le</strong>s erreurs<br />
phonogrammiques cel<strong>le</strong>s qui, à la <strong>le</strong>cture, altèrent la va<strong>le</strong>ur phonique et cel<strong>le</strong>s qui ne l’altèrent<br />
pas (conformément d’ail<strong>le</strong>urs à la gril<strong>le</strong> de Catach).<br />
– Les erreurs extragraphiques qui sont en même temps logogrammique (exemp<strong>le</strong> : mai<br />
pour m’a ou sant pour s’en] sont comptées dans cette catgérorie.<br />
– Les types d’erreurs sont exclusives <strong>le</strong>s unes des autres : nous empruntons à Catach la<br />
notion de « dominante » et ce n’est que la dominante qui est comptabilisée. Par exemp<strong>le</strong>,<br />
quand un est écrit pour une, l’erreur est comptée comme morphogrammique, non comme<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
phonogrammique (pour ne pas multiplier <strong>le</strong>s catégories, la dimension phonogrammique<br />
n’est pas prise en compte même, comme ici, en cas d’altération de la va<strong>le</strong>ur phonique :<br />
autrement dit, <strong>le</strong>s morphonogrammes ne sont pas comptabilisés).<br />
– Dans <strong>le</strong>s erreurs idéogrammiques touchant aux majuscu<strong>le</strong>s, n’est pas prise en compte<br />
l’absence de majuscu<strong>le</strong> au début d’un discours direct (cela relèverait de la surnorme) : <strong>le</strong>s<br />
erreurs ne sont prises en compte que par rapport au système du texte : par exemp<strong>le</strong>, sont<br />
comptées comme erreurs une majuscu<strong>le</strong> après une virgu<strong>le</strong> ou une absence de majuscu<strong>le</strong><br />
après un point, que <strong>le</strong> signe de ponctuation soit pertinent ou non.<br />
– La ponctuation n’est pas prise en compte dans <strong>le</strong> re<strong>le</strong>vé d’erreurs d’orthographe.<br />
– Par ail<strong>le</strong>urs, toujours dans <strong>le</strong> souci de ne pas multiplier <strong>le</strong>s catégories, ne sont pas prises en<br />
compte, dans <strong>le</strong> re<strong>le</strong>vé d’erreurs, <strong>le</strong>s erreurs calligraphiques (ajout ou absence de jambage<br />
par exemp<strong>le</strong>).<br />
0<br />
3. Comptage des mots erronés et des erreurs concernant l’orthographe<br />
– Dans <strong>le</strong> comptage du nombre de mots erronés, tous <strong>le</strong>s mots erronés sont comptés,<br />
même s’ils sont répétés à l’identique, mais on ne compte qu’une fois <strong>le</strong> même mot même s’il<br />
contient plusieurs erreurs. Exception : quand deux mots sont collés (erreur extragraphique)<br />
et que l’on trouve une erreur dans l’une des parties du mot – qui se trouve ail<strong>le</strong>urs dans <strong>le</strong><br />
corpus – on compte deux erreurs ; par exemp<strong>le</strong>, jusca est compté deux fois comme erreur :<br />
extragraphique et logogrammique.<br />
– Dans <strong>le</strong> comptage des types d’erreurs, c’est la règ<strong>le</strong> inverse qui s’applique : si la même<br />
erreur est répétée plusieurs fois, el<strong>le</strong> ne sera comptabilisée qu’une fois (idem si <strong>le</strong> mot<br />
appartient à la même famil<strong>le</strong> : g(u)erre et g(u)errier, dans un même texte, ne compteront<br />
que pour une erreur) ; un même mot pouvant contenir plusieurs types d’erreurs, toutes <strong>le</strong>s<br />
erreurs seront comptabilisées.<br />
– Concernant <strong>le</strong>s erreurs morphogrammiques, si el<strong>le</strong>s sont répétées sur <strong>le</strong> même mot,<br />
el<strong>le</strong>s ne sont comptées qu’une fois (c’est la règ<strong>le</strong> précédente). Mais si la même erreur<br />
morphogrammique est répétée plusieurs fois sur des mots différents (par exemp<strong>le</strong> –er pour<br />
–ait dans deux verbes différents), el<strong>le</strong>s sont comptées à chaque fois.<br />
– Les noms propres bien orthographiés sont comptés comme mots ; <strong>le</strong>s noms propres erronés<br />
ne sont pas comptés dans <strong>le</strong> comptage des erreurs ni des mots. Quand un nom propre est<br />
bien orthographié une fois, toute erreur sur une nouvel<strong>le</strong> occurrence est comptabilisée. Pour<br />
ce qui est des erreurs (idéogrammiques) sur <strong>le</strong>s majuscu<strong>le</strong>s, el<strong>le</strong>s sont comptées (et <strong>le</strong> mot<br />
concerné entre dans <strong>le</strong> décompte des mots).<br />
– Un même mot présentant deux graphies erronées différentes est comptabilisé comme<br />
deux erreurs différentes.<br />
– Néanmoins, quand deux erreurs sont liées d’une manière ou d’une autre, el<strong>le</strong>s ne sont<br />
comptées qu’une fois :<br />
• gerge [cherche] comptera pour une seu<strong>le</strong> erreur phonogrammique (c’est la même<br />
confusion de graphème dans <strong>le</strong> même mot)<br />
•<br />
persson(n)e comptera pour une seu<strong>le</strong> erreur phonogrammique (erreur sur <strong>le</strong> doub<strong>le</strong>ment<br />
d’une consonne)<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
•<br />
profés(s)eur comptera pour une seu<strong>le</strong> erreur phonogrammique (c’est l’absence des<br />
deux s qui peut expliquer l’accentuation du e) ; idem pour diquesionnaire : la séquence ques<br />
vaut pour ct et ne comptera que pour une erreur.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Annexe 2 : re<strong>le</strong>vé des erreurs orthographiques<br />
N° éco<strong>le</strong><br />
1. Re<strong>le</strong>vé des erreurs dans <strong>le</strong>s évaluations CE2<br />
Boucher<br />
Boucher<br />
extragraphique<br />
phonogrammique<br />
avec altération<br />
phonogrammique<br />
sans altération<br />
morphogrammique<br />
(verbes)<br />
Boucher 0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
morphogrammique<br />
(autres mots)<br />
Boucher 0<br />
Boucher 0 0<br />
mophogrammique<br />
<strong>le</strong>xica<strong>le</strong><br />
Boucher 0 0 0<br />
Boucher<br />
Boucher<br />
Boucher<br />
Boucher 0 0<br />
0 Boucher<br />
Boucher 0<br />
Montaigne 0<br />
Montaigne<br />
Montaigne 0<br />
Montaigne 0 0<br />
Montaigne 0 0<br />
Montaigne<br />
Montaigne 0<br />
0 Montaigne 0 0<br />
Montaigne 0 0<br />
Montaigne 0 0<br />
Montaigne<br />
Montaigne 0 0 0<br />
Montaigne<br />
Montaigne<br />
0 Montaigne 0<br />
Montaigne 0 0 0 0 0<br />
Montaigne 0<br />
Montaigne 0 0 0 0<br />
Montaigne 0 0<br />
logogrammique<br />
idéogrammique<br />
nombre de mots<br />
nombre de mots<br />
mal orthographiés
N° éco<strong>le</strong><br />
2. Re<strong>le</strong>vé des erreurs dans <strong>le</strong>s évaluations 6 e<br />
extragraphique<br />
phonogrammique<br />
avec altération<br />
phonogrammique<br />
sans altération<br />
morphogrammique<br />
(verbes)<br />
morphogrammique<br />
(autres mots)<br />
mophogrammique<br />
<strong>le</strong>xica<strong>le</strong><br />
Boucher 0 0 0<br />
Boucher 0 0 0<br />
Boucher 0 0 0 0<br />
Boucher 0 0 0<br />
Boucher 0<br />
Boucher 0<br />
Boucher 0<br />
Boucher 0 0 0<br />
Boucher 0 0<br />
Boucher 0 0 0<br />
0 Boucher<br />
Boucher 0 0 0<br />
Montaigne 0<br />
Montaigne<br />
Montaigne 0 0<br />
Montaigne 0 0 0<br />
Montaigne 0<br />
Montaigne 0<br />
Montaigne 0 0 0<br />
0 Montaigne 0 0<br />
Montaigne 0 0 0<br />
Montaigne 0 0<br />
Montaigne 0 0 0 0<br />
Montaigne 00 0<br />
Montaigne 0 0 0<br />
Montaigne 0 0<br />
0 Montaigne 0 0 0 0<br />
Montaigne 0 0<br />
Montaigne 0<br />
Montaigne 0 0 0 0 0<br />
Montaigne<br />
logogrammique<br />
idéogrammique<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
nombre de mots<br />
nombre de mots<br />
mal orthographiés
Annexe 3 : tests métalinguistiques<br />
Voici <strong>le</strong>s tests proposés aux élèves. Les phrases barrées correspondent à cel<strong>le</strong>s qui n’ont<br />
pas été données aux CE .<br />
•<br />
Exercice 1<br />
Attention à la marche.<br />
Laisse <strong>le</strong> moteur en marche.<br />
La piscine est à un quart d’heure de marche de l’éco<strong>le</strong>.<br />
Le facteur marche de plus en plus <strong>le</strong>ntement.<br />
La marche est un sport diffici<strong>le</strong>.<br />
Tous <strong>le</strong>s mots soulignés sont des noms, sauf un. Entoure-<strong>le</strong>.<br />
•<br />
Exercice 2<br />
On mange une pizza ?<br />
Il mange du pain.<br />
Le hibou ne mange que la nuit.<br />
Tu ne veux pas manger ce qu’il y a dans ton assiette ?<br />
Je mange vite un carré de chocolat<br />
Tous <strong>le</strong>s groupes de mots soulignés ont la même fonction, sauf un. Entoure-<strong>le</strong>.<br />
•<br />
Exercice 3<br />
On pourrait partir ?<br />
Tu pourras prendre ton train à l’heure.<br />
Vous pourrez éteindre la lumière avant de partir ?<br />
Quand je pourrai me <strong>le</strong>ver de mon lit, j’irai faire un tour.<br />
Nous pourrons pique-niquer au bord de l’eau.<br />
Tous <strong>le</strong>s verbes soulignés sont au même temps, sauf un. Entoure-<strong>le</strong>.<br />
•<br />
Exercice 4<br />
Il était une fois un roi qui avait deux fils. Tous <strong>le</strong>s jours, il se demandait <strong>le</strong>quel des deux était<br />
<strong>le</strong> plus courageux. Un jour, il décida de <strong>le</strong>s faire s’affronter dans un tournoi. Il demanda<br />
au premier : « Si tu gagnais ce tournoi, que ferais-tu ? ».<br />
Tous <strong>le</strong>s verbes soulignés par<strong>le</strong>nt du passé, sauf un. Entoure-<strong>le</strong>.<br />
•<br />
Exercice 5<br />
Les canards vivent dans des mares.<br />
Le canari est encore vivant.<br />
Pour vivre heureux, vivons cachés.<br />
Vivant ici, il ne peut pas être malheureux.<br />
En cette maison vivait un garçon pas comme <strong>le</strong>s autres.<br />
Tous <strong>le</strong>s mots soulignés sont des verbes, sauf un. Entoure-<strong>le</strong>.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
•<br />
Exercice 6<br />
Les magasins, à mon avis, sont très fréquentés.<br />
Les magasins de la rue sont très fréquentés.<br />
Les magasins qui vendent des vêtements sont très fréquentés.<br />
Les magasins aux vitrines attirantes sont très fréquentés.<br />
Les magasins tout illuminés sont très fréquentés.<br />
Tous <strong>le</strong>s groupes de mots soulignés ont la même fonction, sauf un. Entoure-<strong>le</strong>.<br />
•<br />
Exercice 7<br />
Il dansa toute la nuit.<br />
L’enfant s’élança vers son ami.<br />
À ton arrivée, il partira.<br />
El<strong>le</strong> chanta une heure entière.<br />
Soudain, <strong>le</strong> bateau vira de bord.<br />
Tous <strong>le</strong>s verbes soulignés sont au même temps, sauf un. Entoure-<strong>le</strong>.<br />
•<br />
Exercice 8<br />
Il vit la fil<strong>le</strong> de loin.<br />
Arrête de te ronger <strong>le</strong>s ong<strong>le</strong>s !<br />
Je te <strong>le</strong> dis une dernière fois : arrête tout de suite !<br />
Le loup entra dans la ferme.<br />
Il ne trouvait plus l’outil dont il avait besoin.<br />
Tous <strong>le</strong>s mots soulignés sont des déterminants (artic<strong>le</strong>s), sauf un. Entoure-<strong>le</strong>.<br />
•<br />
Exercice 9<br />
J’ai dit à ma mère que je ne voulais pas y al<strong>le</strong>r.<br />
Je n’aime pas par<strong>le</strong>r de moi à n’importe qui.<br />
Tu donnes un bonbon à ton frère, s’il te plaît ?<br />
Demande <strong>le</strong>s clés à la voisine.<br />
J’irai à la plage demain s’il fait beau.<br />
Tous <strong>le</strong>s groupes de mots soulignés ont la même fonction, sauf un. Entoure-<strong>le</strong>.<br />
À l’issue de chaque test, la question suivante était posée (pour <strong>le</strong>s CM uniquement) :<br />
Comment l’as-tu trouvé ?<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Voici <strong>le</strong>s tests d’Élalouf correspondant à certains de ceux proposés ci-dessus :<br />
•<br />
Exercice 1 (= exercice 1 du test ci-dessus)<br />
Attention à la marche !<br />
Quand on met cette horloge en marche, <strong>le</strong> mécanisme grince de façon étrange.<br />
La piscine est à un quart d’heure de marche du collège.<br />
Le facteur, à la fin de sa tournée, marche de plus en plus <strong>le</strong>ntement.<br />
La marche est un sport olympique.<br />
Les mots soulignés ont la même nature sauf un. Lequel ?<br />
Comment l’avez-vous trouvé ?<br />
Qu’est-ce qui <strong>le</strong> distingue des autres ?<br />
•<br />
Exercice 4 (= exercice 2 du test ci-dessus)<br />
On mange une pizza ou un sandwich ?<br />
Il mange plus de pain que de viande.<br />
Le hibou ne mange que la nuit.<br />
« Le loup l’emporte et puis <strong>le</strong> mange » (La Fontaine)<br />
Je mange à la hâte un carré de chocolat.<br />
Tous <strong>le</strong>s groupes de mots soulignés ont la même fonction sauf un. Lequel ?<br />
Comment l’avez-vous trouvé ?<br />
Qu’est-ce qui <strong>le</strong> distingue des autres ?<br />
•<br />
Exercice 5 (= exercice 3 du test ci-dessus)<br />
On pourrait essayer un autre itinéraire ?<br />
Tu pourras prendre <strong>le</strong> train de h 0 : nous avons largement <strong>le</strong> temps.<br />
Vous pourrez éteindre la lumière avant de partir ?<br />
Quand je pourrai faire des figures, j’irai m’entraîner à la Défense.<br />
Nous pourrons pique-niquer au bord de l’eau.<br />
Tous <strong>le</strong>s verbes soulignés sont au même temps sauf un. Lequel ?<br />
Comment l’avez-vous trouvé ?<br />
Qu’est-ce qui <strong>le</strong> distingue des autres ?<br />
•<br />
Exercice 6 (= exercice 4 du test ci-dessus)<br />
Il était une fois un roi qui avait deux fils. Tous <strong>le</strong>s jours, il se demandait <strong>le</strong>quel des deux<br />
serait <strong>le</strong> plus courageux. Un jour, il décida de <strong>le</strong>s faire s’affronter dans un tournoi. Il<br />
demanda au premier : « si tu gagnais ce tournoi, que ferais-tu ? ».<br />
Tous <strong>le</strong>s verbes soulignés réfèrent au passé, sauf un. Lequel ?<br />
Comment l’avez-vous trouvé ?<br />
Qu’est-ce qui <strong>le</strong> distingue des autres ?<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
•<br />
Exercice 3 (= exercice 6 du test ci-dessus)<br />
Les magasins, à mon avis, sont très fréquentés.<br />
Les magasins de la ga<strong>le</strong>rie commercia<strong>le</strong> sont très fréquentés.<br />
Les magasins qui proposent des artic<strong>le</strong>s de mode sont très fréquentés.<br />
Les magasins aux vitrines attirantes sont très fréquentés.<br />
Les magasins tout illuminés sont très fréquentés.<br />
Tous <strong>le</strong>s groupes de mots soulignés ont la même fonction, sauf un. Lequel ?<br />
Comment l’avez-vous trouvé ?<br />
Qu’est-ce qui <strong>le</strong> distingue des autres ?<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
La production textuel<strong>le</strong> : cinq ans d’analyse<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Yves REUTER<br />
Professeur des universités<br />
Université de Lil<strong>le</strong> III<br />
Équipe THEODILE<br />
Ce chapitre, bien que consacré à l’enseignement et aux apprentissages de l’écrit dans <strong>le</strong><br />
domaine du français, ne prétend pas épuiser cette matière . Dans la lignée de mes études<br />
précédentes (Reuter, 00 b et 00 ), il est centré sur la production textuel<strong>le</strong>, appréhendée<br />
au travers de récits sollicités en CM et de descriptions suscitées du CP au CM . Ce choix<br />
se justifie – outre mes intérêts de recherche – par l’importance conférée à la production<br />
textuel<strong>le</strong> en fin d’éco<strong>le</strong> primaire, importance partagée, même selon des modalités différentes,<br />
par l’institution scolaire (voir <strong>le</strong>s Instructions Officiel<strong>le</strong>s) et par <strong>le</strong>s maîtres « Freinet ».<br />
Néanmoins, à la différence de mes contributions précédentes mais en congruence avec<br />
la perspective de synthèse de ce rapport, j’accorderai une place substantiel<strong>le</strong> à la prise<br />
en compte de données issues de recherches de notre équipe portant sur <strong>le</strong>s évaluations<br />
nationa<strong>le</strong>s (Hassan, 00 et 00 ), <strong>le</strong>s compétences en orthographe et en grammaire<br />
(Daunay, 00 ) et <strong>le</strong>s relations entre <strong>le</strong>cture et écriture (Giguère, 00 a).<br />
Dans cette optique, après un premier cadrage quant aux décisions méthodologiques retenues,<br />
j’exposerai successivement <strong>le</strong>s résultats obtenus quant aux récits sollicitant l’imaginaire,<br />
aux récits sollicitant <strong>le</strong> vécu et aux descriptions, avant d’apporter quelques précisions sur<br />
la dimension temporel<strong>le</strong> de ces résultats. J’étudierai ensuite la position réf<strong>le</strong>xive des élèves<br />
de cette éco<strong>le</strong>, au travers des entretiens recueillis. J’essaierai enfin de mettre en relation<br />
ces analyses avec l’univers de l’écrit tel qu’il a été mis en place avant de revenir sur <strong>le</strong>s<br />
questions liées à l’enseignement de la langue.<br />
Il me reste à signa<strong>le</strong>r que la dimension quelque peu panoramique adoptée ici m’a contraint à<br />
alléger nombre de données, notamment quantitatives, que je précise dans d’autres artic<strong>le</strong>s<br />
publiés ou à venir.<br />
1. Les principes méthodologiques adoptés 2<br />
1.1. Les catégories d’écrits<br />
Trois catégories d’écrits ont été demandés aux élèves : des récits sollicitant l’imaginaire<br />
(R.S.I.), des récits sollicitant <strong>le</strong> vécu (R.S.V.) et des descriptions. Ces trois axes ont été<br />
retenus afin de permettre une approche de la production textuel<strong>le</strong> qui ne soit pas restreinte,<br />
comme c’est trop souvent <strong>le</strong> cas, à un type de texte, lui-même réduit à une thématique,<br />
même si cela demeure encore limité par rapport à la diversité des catégories possib<strong>le</strong>s de<br />
discours écrits qui devraient être pris en compte pour esquisser l’image d’une compétence<br />
Il reprend, pour l’essentiel, ma contribution « Enseignement et apprentissages de l’écrit », dans<br />
l’ouvrage : Une éco<strong>le</strong> Freinet. Fonctionnements et effets d’une pédagogie alternative en milieu populaire, à<br />
paraître en 00 aux éditions de l’Harmattan.<br />
Ces principes sont détaillés et discutés dans Reuter, 00 b et 00 et Reuter et Carra 00 . Il en est<br />
de même pour <strong>le</strong>s critères que j’expose dans la suite de ce chapitre.
scriptura<strong>le</strong>.<br />
Pour chacun de ces écrits, l’étude a été menée sur cinq ans, outre l’année préliminaire<br />
(avant la mise en place de la nouvel<strong>le</strong> équipe), afin de pouvoir suivre l’évolution d’élèves<br />
ayant effectué <strong>le</strong>ur scolarité dans ce cadre pédagogique, de quelques mois à plusieurs<br />
années.<br />
1.2. Les consignes et la passation<br />
Les trois consignes proposées aux élèves étaient <strong>le</strong>s suivantes :<br />
• « Raconte une soirée que tu as réel<strong>le</strong>ment vécue et qui t’as marqué. »<br />
• « C’est <strong>le</strong> soir. Comme d’habitude un enfant se couche et lit, en attendant que son père<br />
vienne l’embrasser. Mais il tarde à venir. Soudain la porte s’ouvre. Une créature monstrueuse<br />
apparaît… »<br />
• « Décris ton éco<strong>le</strong>. »<br />
Les deux premières ont été soumises uniquement aux CM , en février ou en mars ; la<br />
troisième l’a été en juin, dans la mesure où el<strong>le</strong> était proposée dans toutes <strong>le</strong>s classes à<br />
partir du CP. La passation a été effectuée par l’enseignant de chaque classe. Il lui avait<br />
été demandé de ne se livrer à aucune préparation, de ne fournir aucune aide, d’être aussi<br />
proche que possib<strong>le</strong> des conditions de travail habituel<strong>le</strong>s et de laisser <strong>le</strong> temps nécessaire<br />
aux élèves pourvu que la production soit réalisée en une seu<strong>le</strong> fois en classe.<br />
Ces catégories d’écrits et ces consignes ont été retenues pour de multip<strong>le</strong>s raisons. El<strong>le</strong>s<br />
correspondent d’abord à des domaines appartenant à la tradition scolaire, importantes en<br />
français et « norma<strong>le</strong>ment » peu ou prou travaillés. El<strong>le</strong>s permettent la mise en œuvre de<br />
variations importantes dans <strong>le</strong>s opérations cognitives et langagières selon <strong>le</strong> type de référent<br />
(à dominante temporel<strong>le</strong> ou spatia<strong>le</strong>) et <strong>le</strong> rapport (vécu ou non) à celui-ci. Ces catégories<br />
d’écrits ont, de surcroît, fait l’objet de nombreuses études quant à <strong>le</strong>urs réalisations scolaires<br />
et aux problèmes qu’el<strong>le</strong>s soulèvent, ce qui constitue un premier plan comparatif. Les<br />
consignes, quant à el<strong>le</strong>s, « marchent » (<strong>le</strong>s élèves écrivent) et ont été testées à de multip<strong>le</strong>s<br />
reprises lors de travaux antérieurs de membres de notre équipe ou d’étudiants (Deschildt<br />
00 , Humbert-Prudhomme 00 et 00 , Lammertyn et 000). El<strong>le</strong>s présentent, en<br />
outre, quelques spécificités dont il m’intéressait de voir quels effets el<strong>le</strong>s provoquaient auprès<br />
des élèves : ancrage dans <strong>le</strong> « réel », continuation au présent et absence de marquage<br />
du genre de l’enfant pour <strong>le</strong> R.S.I., possibilité de relation d’évènements (et non d’intrigue)<br />
et marquage des émotions pour <strong>le</strong> R.S.V. . Je m’étais enfin assuré que la configuration<br />
« catégorie d’écrits – situation imposée – type de consigne » était aussi étrangère, même<br />
selon des modalités différentes, à toutes <strong>le</strong>s classes retenues, ce qui renvoie à la recherche,<br />
Par exemp<strong>le</strong>, pour ce qui concerne <strong>le</strong> recours aux utilitaires.<br />
Pour <strong>le</strong>s R.S.V., voir notamment Bishop 00 ; Clanché et ; Fayol et ; Labov<br />
et Lahire . Pour <strong>le</strong>s R.S.I., Clanché , et , Kaïci et . Pour <strong>le</strong>s descriptions,<br />
Reuter 000, Reuter, dir. a et b.<br />
Pour <strong>le</strong> dire brièvement, l’ancrage dans <strong>le</strong> réel renvoie aux problèmes de catégorisation (vérité /<br />
mensonge) des élèves, la continuation au présent s’oppose aux pratiques scolaires dominantes en matière<br />
de récits fictionnels (usage du passé), l’absence de marquage du genre permet d’apprécier <strong>le</strong>s projections<br />
possib<strong>le</strong>s du narrateur, la relation d’évènements convoque des compétences différentes de cel<strong>le</strong>s qui sont<br />
habituel<strong>le</strong>ment privilégiées au travers des normes scolaires du récit et <strong>le</strong> marquage des émotions est en<br />
général peu réalisé.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
sans doute très hypothétique, d’une éga<strong>le</strong> distance aux pratiques pédagogiques…<br />
0<br />
1.3. Le corpus analysé<br />
L’analyse s’est donc réalisée sur cinq années au moins et chacune des catégories de<br />
productions des élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet a été comparée avec cel<strong>le</strong> d’autres élèves.<br />
De manière plus précise, <strong>le</strong> corpus des récits sollicitant <strong>le</strong> vécu comprend productions :<br />
de l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher (dorénavant H.B.) de l’an à l’an de l’expérience, comparées<br />
à productions d’autres élèves ( de milieu équiva<strong>le</strong>nt, issus de quatre classes et deux<br />
éco<strong>le</strong>s différentes ; de milieu plus favorisé, issus de deux classes et de deux éco<strong>le</strong>s<br />
différentes ; d’une classe de milieu un peu plus favorisé et travaillant en pédagogie du<br />
projet , alors que <strong>le</strong>s autres élèves fonctionnent selon un mode de travail classique . Le<br />
corpus des récits sollicitant l’imaginaire comprend productions : 0 de l’éco<strong>le</strong> H.B. (de<br />
l’année préliminaire à l’an de l’expérience), comparées à productions d’autres élèves<br />
( travaillant de manière classique, issus d’un milieu équiva<strong>le</strong>nt, dans quatre classes<br />
et trois éco<strong>le</strong>s différentes et étant issus d’un milieu plus favorisé dans deux classes et<br />
deux éco<strong>le</strong>s différentes ; <strong>le</strong>s autres appartenaient à la classe mentionnée travaillant en<br />
pédagogie du projet). Le corpus des descriptions comprend productions : d’H.B.,<br />
du CP au CM , de l’année préliminaire à l’an de l’expérience, comparées à 0 d’autres<br />
élèves de milieu équiva<strong>le</strong>nt, travaillant de manière classique (chaque niveau d’H.B. étant<br />
comparé à trois classes d’éco<strong>le</strong>s différentes). Le corpus total retenu pour l’analyse s’élève<br />
donc à productions.<br />
L’importance de ce corpus , rare dans <strong>le</strong>s études que j’ai pu consulter, permet sans doute<br />
de fonder, au moins en partie, la pertinence de certains résultats avancés ci-après. Il n’est<br />
cependant pas, comme c’est quasiment toujours <strong>le</strong> cas, exempt de problèmes : nombre<br />
de données de l’année préliminaire à H.B. n’ont pu être constituées ou sont lacunaires, <strong>le</strong>s<br />
données de l’an à H.B. en ce qui concerne la description n’ont pu être utilisées en raison<br />
d’une intervention guidante de l’enseignant, etc. Dans tous ces cas, j’ai dû adopter des<br />
solutions ad hoc sur <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s je me suis expliqué par ail<strong>le</strong>urs.<br />
1.4. Les critères appliqués<br />
Pour toutes <strong>le</strong>s catégories de productions, j’ai pris en compte cinq dimensions : la longueur<br />
(calculée en nombre de mots, prise comme marque possib<strong>le</strong> d’investissement et comme<br />
référent, par exemp<strong>le</strong> en ce qui concerne l’orthographe), la « langue » (en tenant compte<br />
à chaque fois au moins de l’orthographe et de la moyenne de phrases simp<strong>le</strong>s et de<br />
phrases comp<strong>le</strong>xes réussies 0 ), <strong>le</strong> respect de la consigne, la structuration textuel<strong>le</strong> (amp<strong>le</strong>ur,<br />
Toutes <strong>le</strong>urs productions ont été prises en compte, excepté cel<strong>le</strong>s des élèves arrivés au début de<br />
chaque année.<br />
Cette éco<strong>le</strong> fonctionnant en pédagogie du projet a déjà fait l’objet de recherches de la part de notre<br />
équipe (Reuter, dir. 00 a). Nous n’avons pas trouvé, dans l’Académie, d’autres éco<strong>le</strong>s ou d’autres classes<br />
se revendiquant d’une autre pédagogie.<br />
Ce terme est employé sans aucune connotation négative. Il réfère à des enseignements n’intégrant<br />
aucune innovation particulière et correspondant aux fonctionnements courants tels qu’ils sont décrits dans <strong>le</strong>s<br />
rapports existants.<br />
Je préciserai <strong>le</strong> corpus des entretiens dans la partie ( ) qui <strong>le</strong>ur est consacrée.<br />
0 J’ai pris comme indicateur pour l’orthographe <strong>le</strong> pourcentage de mots fautifs. La réussite des phrases<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
organisation, diversité des moyens textuels, gestion des problèmes…), <strong>le</strong>s contenus et<br />
<strong>le</strong>ur mode de mise en scène. Les critères spécifiques mis en œuvre seront détaillés dans<br />
chacune des parties suivantes.<br />
Il est évident que ce descriptif peut légitimement sou<strong>le</strong>ver de multip<strong>le</strong>s questions, que ce<br />
soit quant aux critères retenus, quant à <strong>le</strong>ur regroupement selon ces dimensions, quant<br />
aux décisions de calcul, quant à l’interprétation… Cela est incontournab<strong>le</strong> en recherche. Je<br />
noterai simp<strong>le</strong>ment ici que <strong>le</strong>s critères et catégories mis en œuvre, sont plus nombreux (entre<br />
0 et 0 par type d’écrits) et plus diversifiés que ceux communément retenus, favorisant<br />
sans doute une vision plus comp<strong>le</strong>xe des textes des élèves et que, de surcroît, ils ont été<br />
élaborés progressivement, sur plusieurs années, en tenant compte des travaux disponib<strong>le</strong>s<br />
et des problèmes et des réussites des élèves tels que nous avions pu <strong>le</strong>s analyser dans de<br />
nombreux autres corpus.<br />
2. Les récits sollicitant l’imaginaire (R.S.I.)<br />
2.1. L’analyse des R.S.I. 11<br />
En ce qui concerne <strong>le</strong> respect de la consigne, j’ai retenu trois critères : l’apparition, même<br />
brève, d’un élément présenté comme un monstre, la continuation du récit à la troisième<br />
personne et au présent. La structuration textuel<strong>le</strong> a été décrite au travers de quatre<br />
sous-dimensions : l’amp<strong>le</strong>ur (nombre d’actions de premier plan) ; <strong>le</strong> mode d’organisation<br />
(complétude de l’histoire, <strong>le</strong>s interactions conflictuel<strong>le</strong>s ou amica<strong>le</strong>s entre <strong>le</strong> monstre et<br />
l’enfant, la présence d’une clôture marquée) ; la gestion des problèmes (de compréhension<br />
ou de cohérence, <strong>le</strong>s reprises anaphoriques) ; la diversité des moyens textuels employés<br />
(nomination des enfants, description du monstre, fonctionnalité descriptive, présence de<br />
sentiments ou d’émotions, marquage de la pensée de l’enfant, marquage de la pensée d’un<br />
autre personnage, présence d’humour, présence de suspense, présence de faits stylistiques<br />
spéciaux ).<br />
Les contenus et <strong>le</strong>ur mode de mise en scène ont été analysés sous l’ang<strong>le</strong> de l’imaginaire<br />
et de l’investissement en prenant en compte : la réalité du monstre (à la différence d’autres<br />
scénarios tels l’illusion, la blague ou <strong>le</strong> rêve) ; <strong>le</strong>s traits pouvant marquer textuel<strong>le</strong>ment la<br />
construction du scénario imaginaire (<strong>le</strong> nombre d’actions du monstre, l’affrontement, la fuite,<br />
l’action de se cacher, <strong>le</strong>s risques pour la vie, <strong>le</strong> triomphe de l’enfant, l’issue négative, l’issue<br />
« superpositive » , l’amitié entre l’enfant et <strong>le</strong> monstre, <strong>le</strong> changement de sexe entre l’auteurélève<br />
et <strong>le</strong> narrateur) ; <strong>le</strong>s traits susceptib<strong>le</strong>s de marquer textuel<strong>le</strong>ment l’investissement (la<br />
transformation des parents en monstres ; <strong>le</strong>s traces d’un roman familial , la victimisation de<br />
a été appréciée au regard de critères scolaires classiques : majuscu<strong>le</strong> initia<strong>le</strong>, point final, structure et sens<br />
acceptab<strong>le</strong>s. Les phrases dites comp<strong>le</strong>xes comprennent une subordonnée enchâssée.<br />
Je rappel<strong>le</strong> que l’explication détaillée de ces indicateurs se trouve dans Reuter 00 b.<br />
Variations typographiques, usage « expressif » de la ponctuation, adresses aux <strong>le</strong>cteurs, comparaisons<br />
fonctionnalisées, ellipses soulignées, retournements de situation…<br />
Caractérisée par un marquage hyperbolique du bonheur final : organisation d’une grande fête,<br />
affirmation qu’on sera toujours heureux.<br />
Parents éliminés au profit de l’amitié monstre-enfant, meurtre du monstre devenu l’ami de l’enfant par<br />
<strong>le</strong> père, partage du lit du monstre ou des parents par l’enfant, meurtre du père par <strong>le</strong> monstre qui partage <strong>le</strong> lit<br />
de la mère, actions référab<strong>le</strong>s à de la pédophilie…<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
la famil<strong>le</strong> ; la solitude de l’enfant lorsque ses cris ne sont pas entendus).<br />
J’ai enfin complété ces analyses – en fonction des études disponib<strong>le</strong>s sur cette catégorie<br />
d’écrits – par <strong>le</strong> calcul de la moyenne des éléments sur <strong>le</strong>s deux pô<strong>le</strong>s constitués par la<br />
structuration textuel<strong>le</strong> et <strong>le</strong>s contenus mis en scène ainsi que par la catégorisation des écrits<br />
selon qu’ils contenaient cinq éléments ou plus présents ou réussis sur chacun de ces pô<strong>le</strong>s,<br />
l’un d’eux ou aucun.<br />
2.2. Comparaison des résultats avec <strong>le</strong>s élèves de milieu équiva<strong>le</strong>nt<br />
La comparaison des résultats des élèves d’H.B. avec ceux de milieu équiva<strong>le</strong>nt travaillant<br />
selon un mode de travail pédagogique classique est, sans conteste, à l’avantage des<br />
premiers.<br />
Leurs écrits sont beaucoup plus longs (<strong>le</strong> doub<strong>le</strong> en l’an ). Leurs performances sont<br />
supérieures en matière de langue (même s’il faut attendre l’an pour l’orthographe),<br />
notamment en ce qui concerne phrases simp<strong>le</strong>s et phrases comp<strong>le</strong>xes. Ils s’avèrent aussi<br />
supérieurs sur <strong>le</strong>s trois quart des critères concernant la structuration textuel<strong>le</strong>. De fait, <strong>le</strong>ur<br />
moyenne d’éléments est supérieure et ils sont bien plus nombreux à avoir cinq éléments ou<br />
plus actualisés ou réussis. Ils développent aussi et diversifient plus <strong>le</strong>s éléments qui ont trait<br />
à l’imaginaire et à l’investissement : supérieurs aux autres sur <strong>le</strong>s deux tiers des indicateurs,<br />
ils sont égaux sur deux et très légèrement inférieurs sur trois. Leur moyenne d’éléments est,<br />
ici aussi, supérieure et ils sont bien plus nombreux à actualiser ou réussir cinq éléments ou<br />
plus.<br />
Le bilan est donc net : ils sont supérieurs sur toutes <strong>le</strong>s dimensions et très supérieurs sur<br />
deux catégories de textes : structuration textuel<strong>le</strong> et contenus satisfaisants (cinq éléments<br />
ou plus sur chacune de ces dimensions), structuration textuel<strong>le</strong> (mais non contenus)<br />
satisfaisants. Complémentairement, il convient de noter qu’ils consacrent près du doub<strong>le</strong> de<br />
temps à la réalisation de ces productions.<br />
2.3. Comparaison des résultats avec <strong>le</strong>s élèves travaillant en pédagogie du<br />
projet<br />
La comparaison des résultats des élèves d’H.B. avec ceux d’une classe travaillant en<br />
pédagogie du projet sont, ici encore, à l’avantage des premiers.<br />
Ils écrivent beaucoup plus longuement (<strong>le</strong> doub<strong>le</strong> en l’an ). Ils réussissent mieux <strong>le</strong>urs phrases<br />
mais sont très légèrement inférieurs en orthographe. Ils respectent mieux la consigne (sauf<br />
en ce qui concerne la continuation au présent). Leurs performances sont aussi supérieures<br />
en matière de structuration textuel<strong>le</strong> : treize indicateurs sur seize, moyenne d’éléments<br />
actualisés ou réussis supérieure, plus d’élèves manifestant au moins cinq éléments… Ils<br />
actualisent aussi bien plus de traits sur la dimension de l’imaginaire et de l’investissement<br />
(ils ne sont « inférieurs » que sur un seul indicateur).<br />
Le bilan est donc encore plus net que dans <strong>le</strong> cas précédent même s’il convient de rappe<strong>le</strong>r<br />
que <strong>le</strong> nombre d’élèves travaillant en pédagogie du projet est très restreint et que ces<br />
élèves, habitués à écrire selon des modalités très différentes (durée, groupes…), ont pu<br />
Je rappel<strong>le</strong> qu’ils ne sont que quinze à avoir réalisé ce travail et qu’ils sont issus d’un milieu un peu<br />
plus favorisé.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
être particulièrement déstabilisés par la situation mise en place . Les élèves d’H.B. sont<br />
supérieurs sur toutes <strong>le</strong>s dimensions et très supérieurs sur deux catégories de textes :<br />
structuration textuel<strong>le</strong> et contenus satisfaisants, structuration textuel<strong>le</strong> satisfaisante. Ils<br />
consacrent, en outre, un peu plus de temps à la rédaction de <strong>le</strong>ur écrit.<br />
2.4. Comparaison des résultats avec des élèves de milieu plus favorisé<br />
La comparaison des résultats des élèves d’H.B. avec ceux d’élèves de milieu plus favorisé<br />
travaillant selon un mode de travail pédagogique classique s’avère plus comp<strong>le</strong>xe.<br />
Les élèves d’H.B. écrivent plus longuement <strong>le</strong>s troisième et quatrième années mais plus<br />
brièvement la cinquième année. Ils sont inférieurs sur <strong>le</strong>s trois indicateurs de langue retenus,<br />
particulièrement en orthographe. Le respect de la consigne est supérieur pour la continuation<br />
à la troisième personne, moindre pour <strong>le</strong>s deux autres critères (même s’il est supérieur pour<br />
<strong>le</strong> présent <strong>le</strong>s années précédentes et uniquement très légèrement inférieur pour l’apparition<br />
du monstre). On peut encore par<strong>le</strong>r d’une très légère supériorité des élèves de milieu<br />
plus favorisé sur <strong>le</strong>s deux dimensions restantes. Ainsi, en ce qui concerne la structuration<br />
textuel<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s élèves d’H.B. sont légèrement inférieurs sur la moyenne d’éléments actualisés<br />
ou réussis mais légèrement supérieurs sur la proportion d’élèves à en avoir au moins cinq ;<br />
il en est de même en ce qui concerne l’imaginaire et l’investissement.<br />
Le bilan n’est donc plus à l’avantage d’H.B. sur l’ensemb<strong>le</strong> des dimensions et des critères. De<br />
même, <strong>le</strong> temps consacré à la rédaction est plus réduit. Cependant, excepté en matière de<br />
langue, <strong>le</strong>s écarts sont faib<strong>le</strong>s et, si <strong>le</strong>s élèves d’H.B. sont moins nombreux dans la catégorie<br />
« structuration textuel<strong>le</strong> réussie », ils demeurent proportionnel<strong>le</strong>ment plus nombreux dans<br />
la catégorie « structuration textuel<strong>le</strong> et contenus satisfaisants ».<br />
2.5. Éléments de synthèse sur <strong>le</strong>s R.S.I.<br />
Il me semb<strong>le</strong>, au vu des résultats présentés, que <strong>le</strong> bilan d’H.B. peut être considéré comme<br />
positif pour cinq raisons au moins :<br />
– <strong>le</strong>s résultats des élèves de cette éco<strong>le</strong> surpassent ceux de milieu équiva<strong>le</strong>nt, quel que soit<br />
<strong>le</strong> mode de travail pédagogique considéré ;<br />
– même si <strong>le</strong>urs performances sont globa<strong>le</strong>ment inférieures à ceux d’élèves de milieu plus<br />
favorisé, notamment en matière de langue, cela doit être tempéré par <strong>le</strong> fait qu’el<strong>le</strong>s sont très<br />
proches, voire équiva<strong>le</strong>ntes, pour ce qui concerne la structuration textuel<strong>le</strong> et <strong>le</strong>s contenus<br />
mis en scène et que, de surcroît, l’étude de la dimension diachronique montre que nombre<br />
d’écarts se sont réduits au fil de l’expérience ;<br />
– ils s’avèrent de surcroît supérieurs à tous <strong>le</strong>s autres élèves – à l’encontre de ce qui<br />
caractérise souvent <strong>le</strong>s écrits dans <strong>le</strong>s milieux défavorisés – sur <strong>le</strong> marquage du second<br />
plan narratif (dialogue, sentiments, pensées…) : <strong>le</strong> développement de <strong>le</strong>urs écrits ne s’opère<br />
donc pas en augmentant simp<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> nombre d’actions de premier plan ;<br />
L’absence de déstabilisation des élèves « Freinet » est, en revanche, intéressante à noter.<br />
J’emprunte cette expression à Lesne ( ) qui caractérise <strong>le</strong>s fonctionnements de l’enseignement au<br />
travers d’une multiplicité d’indicateurs (rapports au pouvoir, au savoir, situations, techniques employées…).<br />
De surcroît, si on ajoute des critères tels que <strong>le</strong>s métamorphoses ou <strong>le</strong>s pouvoirs du monstre, <strong>le</strong>s<br />
résultats penchent en faveur d’H.B. (Deschildt, 00 ).<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
– on peut par<strong>le</strong>r d’un véritab<strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> textuel si l’on tient compte du respect de la consigne,<br />
de l’organisation (complétude de l’histoire ; clôture…) et de la gestion des problèmes<br />
textuels ;<br />
– enfin, et c’est sans doute là l’élément <strong>le</strong> plus remarquab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>ur supériorité dans la catégorie<br />
d’écrits « structuration textuel<strong>le</strong> et contenus satisfaisants » manifeste que la construction<br />
de l’imaginaire et l’investissement ne s’effectue pas au détriment de la gestion textuel<strong>le</strong> et<br />
se différencie ainsi des résultats des études disponib<strong>le</strong>s sur <strong>le</strong> sujet (Kaïci et ,<br />
Lammertyn et 000) montrant que <strong>le</strong>s consignes sollicitant imaginaire et investissement<br />
ont tendance à défavoriser <strong>le</strong>s élèves en difficulté en provoquant un déséquilibre au détriment<br />
du contrô<strong>le</strong> textuel.<br />
3. Les récits sollicitant <strong>le</strong> vécu (R.S.V.) 19<br />
3.1. L’analyse des R.V.S.<br />
En ce qui concerne la langue, j’ai ajouté aux critères mentionnés précédemment un indicateur<br />
portant sur l’usage éventuel de « familiarités » (“cons”, “el<strong>le</strong> m’a crié”…). Le respect de la<br />
consigne a été évalué au travers du cadre temporel (la soirée), du marquage des émotions et<br />
du récit (entendu comme présence d’au moins deux actions se succédant temporel<strong>le</strong>ment,<br />
excédant donc annonce ou annonce commentée). La structuration textuel<strong>le</strong> a été décrite<br />
au travers de l’amp<strong>le</strong>ur (nombre d’actions de premier plan), du mode d’organisation (récitintrigue<br />
ou relations d’évènements, formes d’ouverture et de clôture 0 , symétrisation du début<br />
et de la fin du procès ), de la diversité des moyens textuels (description, dialogue, indication<br />
complémentaire quant aux personnages , textualisation d’une volonté d’explicitation ,<br />
manifestation d’émotions et / ou de pensées), gestion des problèmes textuels (erreurs de<br />
premier plan, désignateurs et / ou coréférence, compréhension, successivité, chronologie…).<br />
Les contenus et <strong>le</strong>ur mode de mise en scène ont enfin été analysés au travers de la position<br />
du narrateur (agent , patient ou témoin), de la thématique (spectac<strong>le</strong>s / sorties, fêtes,<br />
atteintes à une personne…) et de son mode de traitement (marqué sous forme euphorique<br />
ou dysphorique, marqué de manière mixte, non marqué).<br />
3.2. Comparaison des résultats<br />
La comparaison des résultats avec <strong>le</strong>s élèves de milieu équiva<strong>le</strong>nt travaillant selon un mode<br />
de travail pédagogique (désormais M.T.P.) classique est, comme dans <strong>le</strong> cas des R.S.I., très<br />
à l’avantage des élèves d’H.B.<br />
La longueur est nettement supérieure (<strong>le</strong> doub<strong>le</strong>, la quatrième année). En ce qui concerne<br />
la langue, <strong>le</strong>s élèves « Freinet » ont de meil<strong>le</strong>urs résultats sur <strong>le</strong>s quatre indicateurs retenus<br />
Ces récits ont fait l’objet d’une analyse détaillée dans Reuter, 00 .<br />
0 États initial ou final, titre, mot « fin », clôture évaluative.<br />
Y compris arriver et partir.<br />
Outre <strong>le</strong> nom, l’âge et l’indication de la nature de la relation (amica<strong>le</strong>, familia<strong>le</strong>…).<br />
Cadre construit pour faire comprendre ce qui suit, marquage net de la causalité, parenthèses de<br />
précision…<br />
En distinguant agent seul / autonome, avec des amis ou au sein d’un groupe d’adultes.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
(même s’il faut attendre la quatrième année pour l’orthographe et que <strong>le</strong>s écarts sont ici plus<br />
faib<strong>le</strong>s). Leur respect de la consigne est aussi mieux marqué, notamment sur <strong>le</strong>s émotions.<br />
Ils sont encore plus souvent performants sur toutes <strong>le</strong>s composantes de la structuration<br />
textuel<strong>le</strong> (amp<strong>le</strong>ur, marquage de l’organisation, diversification des moyens textuels , gestion<br />
des problèmes). Utilisant plus de temps que <strong>le</strong>s autres élèves, ils manifestent de meil<strong>le</strong>ures<br />
performances sur <strong>le</strong>s différentes dimensions étudiées.<br />
Concernant <strong>le</strong>s contenus et <strong>le</strong>ur mode de mise en scène, j’ai pu noter trois spécificités :<br />
ils sont plus souvent en position d’agent (notamment seul) et de patient (et donc moins en<br />
position de témoin) ; ils mentionnent plus de spectac<strong>le</strong>s-sorties (et moins de fêtes) que <strong>le</strong>s<br />
autres ; <strong>le</strong>ur traitement de la thématique est plus marqué notamment sur <strong>le</strong> pô<strong>le</strong> euphorique.<br />
Je reviendrai en . . sur des interprétations possib<strong>le</strong>s de ces phénomènes.<br />
3.3. Comparaison des résultats avec <strong>le</strong>s élèves travaillant en pédagogie du<br />
projet<br />
La comparaison des résultats avec <strong>le</strong>s élèves travaillant en pédagogie du projet s’avère<br />
encore, mais avec certaines modalisations, à l’avantage des élèves d’H.B.<br />
La longueur de <strong>le</strong>urs écrits est nettement supérieure (particulièrement la quatrième année).<br />
En langue, ils ont de meil<strong>le</strong>urs résultats, excepté en orthographe. Ils manifestent aussi<br />
une maîtrise supérieure – mais moins nette que dans <strong>le</strong> cas précédent – en matière de<br />
structuration textuel<strong>le</strong>, notamment sur la diversité des moyens textuels employés (excepté<br />
pour l’utilisation du dialogue) et la maîtrise des problèmes textuels. S’ils utilisent moins<br />
de temps pour écrire que <strong>le</strong>s autres élèves, <strong>le</strong>urs performances demeurent cependant<br />
supérieures sur <strong>le</strong>s trois quarts des indicateurs retenus.<br />
Concernant <strong>le</strong>s contenus et <strong>le</strong>ur mode de mise en scène, j’ai retrouvé certaines spécificités :<br />
<strong>le</strong>s narrateurs sont plus souvent en position d’agent seul ou de patient (mais aussi de témoin) ;<br />
<strong>le</strong>s élèves mentionnent plus de spectac<strong>le</strong>s-sorties (et moins de fêtes) que <strong>le</strong>s autres ; <strong>le</strong>ur<br />
traitement de la thématique est plus marqué, essentiel<strong>le</strong>ment sur <strong>le</strong> pô<strong>le</strong> euphorique.<br />
3.4. Comparaison des résultats avec des élèves de milieu plus favorisé<br />
Comme dans <strong>le</strong> cas des R.S.I., <strong>le</strong> bilan s’avère ici un peu plus comp<strong>le</strong>xe à établir. La longueur<br />
des écrits est encore bien supérieure (particulièrement la quatrième année). En langue, si<br />
<strong>le</strong>s élèves d’H.B. réussissent plus de phrases simp<strong>le</strong>s et emploient moins de familiarités,<br />
<strong>le</strong>urs performances sont en revanche moins satisfaisantes quant aux phrases comp<strong>le</strong>xes et<br />
surtout à l’orthographe. Ils respectent en tout cas bien plus la consigne, notamment quant<br />
aux émotions et au fait de raconter (<strong>le</strong>s autres élèves recourent plus aux non-réponses,<br />
aux annonces et aux annonces commentées). En matière de structuration textuel<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s<br />
orientations sont divergentes selon <strong>le</strong>s sous-composantes : moins d’actions de premier<br />
plan, une organisation aussi marquée mais différente (plus de relations d’évènements et<br />
moins d’intrigues, plus de titres, de mots fins, d’évaluations fina<strong>le</strong>s et de symétrisation du<br />
procès évènementiel, moins d’états initial et final), une diversification des moyens textuels<br />
supérieure (si l’on considère la proportion d’élèves ayant utilisé au moins trois des modalités<br />
retenues), une gestion des problèmes textuels plus faib<strong>le</strong> quant au premier plan et aux<br />
Excepté pour <strong>le</strong> dialogue (cf. Reuter 00 ).<br />
Notamment quant au marquage de l’explicitation et aux pensées des personnages.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
problèmes de compréhension, supérieure quant aux autres indicateurs . S’ils consacrent<br />
moins de temps à la production que <strong>le</strong>s autres élèves, on ne peut cependant pas dire que<br />
<strong>le</strong> bilan <strong>le</strong>ur soit défavorab<strong>le</strong> et que <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> textuel soit moindre.<br />
Concernant <strong>le</strong>s contenus et <strong>le</strong>ur mode de mise en scène, j’ai pu retrouver ici <strong>le</strong>s tendances<br />
mentionnées précédemment : plus d’agents seuls (et avec des amis), plus de patients et<br />
beaucoup moins de témoins ; plus de spectac<strong>le</strong>s-sorties (et moins de fêtes) que <strong>le</strong>s autres ;<br />
traitement de la thématique plus marqué, notamment sur <strong>le</strong> pô<strong>le</strong> euphorique (mais moins de<br />
traitements mixtes).<br />
3.5. Éléments de synthèse sur <strong>le</strong>s R.S.V.<br />
Comme pour <strong>le</strong>s R.S.I., il me semb<strong>le</strong> qu’au vu des résultats présentés, <strong>le</strong> bilan d’H.B. est<br />
indéniab<strong>le</strong>ment positif.<br />
Ainsi, à milieu égal, quel que soit <strong>le</strong> mode de travail pédagogique ici considéré, <strong>le</strong>s<br />
performances des élèves « Freinet » sont supérieures sur <strong>le</strong>s dimensions prises en<br />
compte : longueur, langue (même s’il faut attendre la cinquième année pour l’orthographe),<br />
structuration textuel<strong>le</strong> (particulièrement organisation, diversité des moyens et gestion des<br />
problèmes).<br />
Complémentairement, la comparaison avec <strong>le</strong>s élèves de milieu plus favorisé n’est nul<strong>le</strong>ment<br />
au désavantage des élèves « Freinet », même si face à des critères scolaires classiques,<br />
ils peuvent semb<strong>le</strong>r moins performants : c’est sans doute <strong>le</strong> cas pour l’orthographe et <strong>le</strong>s<br />
phrases comp<strong>le</strong>xes ; c’est <strong>le</strong> cas pour l’organisation si l’on privilégie récit – intrigue sur<br />
relation d’évènements et si on mésestime certaines formes : titre, mot « fin », symétrie<br />
non dramatisée du procès évènementiel (ce qui est discutab<strong>le</strong> au vu des théories du récit<br />
et de la consigne proposée) ; c’est sans nul doute <strong>le</strong> cas pour la gestion des plans (en<br />
relation avec une moindre maîtrise des temps verbaux). C’est <strong>le</strong> cas pour <strong>le</strong>s problèmes de<br />
compréhension sans que l’on puisse en induire un contrô<strong>le</strong> plus limité puisque, à l’inverse,<br />
<strong>le</strong>s marques d’explication sont plus nombreuses signalant, à mon sens, un véritab<strong>le</strong> souci<br />
d’être compris par <strong>le</strong> <strong>le</strong>cteur.<br />
De manière tout à fait intéressante, sur une catégorie de textes jugée habituel<strong>le</strong>ment moins<br />
clivante que <strong>le</strong>s R.S.I. (Lammertyn, et 000), des différences se marquent selon <strong>le</strong><br />
M.T.P.. De surcroît, ici encore, <strong>le</strong> développement textuel ne se réalise pas sur <strong>le</strong> mode<br />
du « sque<strong>le</strong>tte » textuel par accumulation – juxtaposition d’actions de premier plan mais<br />
avec une véritab<strong>le</strong> expansion du second plan (à l’exception des dialogues) via descriptions,<br />
explications et textualisation de l’intériorité (émotions, pensées…). Enfin, il me semb<strong>le</strong><br />
qu’on peut par<strong>le</strong>r d’une véritab<strong>le</strong> attention au texte, d’une position réf<strong>le</strong>xive, si l’on considère<br />
respect de la consigne, moyens textuels employés et modalités d’organisation.<br />
Les spécificités dans <strong>le</strong>s contenus et <strong>le</strong>ur mode de mise en scène nécessitent d’être<br />
interprétées prudemment si on veut éviter <strong>le</strong>s risques de la sur-interprétation. Ne pas s’y<br />
risquer tiendrait en revanche d’un rapport sous-interprétatif avec <strong>le</strong> risque, trop fréquent à<br />
mon sens face à des textes d’élèves, de ne <strong>le</strong>s considérer que sous un jour formel, excluant<br />
ainsi <strong>le</strong>s contenus comme s’ils étaient secondaires, non articulés à la structuration textuel<strong>le</strong><br />
et indépendants du mode de travail adopté. Je m’en tiendrai donc à trois remarques. Ils<br />
Essentiel<strong>le</strong>ment désignateurs et successivité.<br />
Il s’agirait ici, à mon sens, d’une moindre maîtrise de certaines normes textuel<strong>le</strong>s à ne pas confondre<br />
hâtivement avec contrô<strong>le</strong> textuel ou position exotopique.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
me paraissent d’abord témoigner, par <strong>le</strong> choix de <strong>le</strong>ur thématique, d’une volonté de respect<br />
de la consigne. Il en est sans doute de même avec la position du narrateur et <strong>le</strong> traitement<br />
plus marqué. Mais ces deux traits me paraissent encore signa<strong>le</strong>r une prise de risques plus<br />
importante via l’implication comme acteur principal (agent ou patient) et l’ostension de<br />
pensées, sentiments et émotions. Si l’on accepte cette approche, on peut alors considérer<br />
que, comme dans <strong>le</strong> cas des R.S.I., <strong>le</strong>s élèves « Freinet » arrivent, plus que <strong>le</strong>s autres, à<br />
concilier investissement et contrô<strong>le</strong> textuel.<br />
4. Les descriptions<br />
4.1. L’analyse des descriptions<br />
En ce qui concerne la langue, j’ai cette fois-ci pris en compte, outre l’orthographe et la réussite<br />
syntaxique, la diversité verba<strong>le</strong> (avec comme indicateur la proportion de verbes différents<br />
de être ou avoir et la variation de certaines structures syntaxiques (avec la proportion<br />
de structures différentes de il y a 29 ). Le respect de la consigne (description à l’éco<strong>le</strong>) a<br />
été intégré dans la structuration textuel<strong>le</strong> qui comprend <strong>le</strong>s critères suivants : présence<br />
d’une description (même minima<strong>le</strong>), ancrage initial ou non, architecture (colonne ou texte),<br />
énumération 0 ou non, présence de plans (temporel, spatial, thématique…), « profondeur »<br />
des lieux (niveau global, composantes, composantes des composantes), amp<strong>le</strong>ur (nombre<br />
de dimensions évoquées : lieux, personnes, activités…).<br />
Les contenus et <strong>le</strong>ur mode de mise en scène (en fait la vision de l’éco<strong>le</strong>) a été appréhendée<br />
au travers de l’amp<strong>le</strong>ur (amp<strong>le</strong>ur des lieux, des personnes, des activités) et de la hiérarchie<br />
de ces dimensions, des formes d’exposition du travail (termes travail ou apprendre, mention<br />
d’activités précises et/ou d’objets liés au travail, évaluations positives ou négatives), du<br />
rapport à l’éco<strong>le</strong> (syntagmes possessifs : ma classe, mon maître ; évaluations positives ou<br />
négatives ; mode de textualisation du sujet : Je, Nous, On, Je + Nous et / ou on, aucune<br />
marque).<br />
4.2. Comparaison des résultats du CP au CM2 31<br />
Au CP, <strong>le</strong>s productions des élèves d’H.B. s’avèrent très supérieures car, contrairement aux<br />
autres classes où <strong>le</strong>ur proportion avoisine <strong>le</strong>s 0 %, il y a beaucoup moins d’absence d’écrits<br />
ou de textes tota<strong>le</strong>ment illisib<strong>le</strong>s. Même en n’en tenant pas compte dans <strong>le</strong>s calculs liés aux<br />
indicateurs, la longueur est bien plus conséquente et <strong>le</strong>s performances sont bien meil<strong>le</strong>ures<br />
que ce soit en matière de langue ou d’organisation descriptive. Pour <strong>le</strong> dire nettement, <strong>le</strong>s<br />
élèves « Freinet » sont supérieurs aux autres sur tous <strong>le</strong>s indicateurs pris en compte.<br />
Au CE , <strong>le</strong>s productions demeurent meil<strong>le</strong>ures sur la quasi-totalité des critères mais avec<br />
des écarts moindres et une infériorité sur l’amp<strong>le</strong>ur des dimensions et sur l’orthographe la<br />
cinquième année (point sur <strong>le</strong>quel je reviendrai ultérieurement). Il me faut encore signa<strong>le</strong>r<br />
Il s’agit cependant d’un indicateur à manier avec prudence car il peut participer, au moins au CP et au<br />
CE , du développement de la textualité descriptive.<br />
0 Entendue ici comme la succession de trois structures identiques.<br />
Je rappel<strong>le</strong> que <strong>le</strong>s comparaisons n’ont été effectuées ici qu’avec des élèves de milieu équiva<strong>le</strong>nt<br />
soumis à un M.T.P. Classique.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
que <strong>le</strong>s plans n’apparaissent, quel que soit <strong>le</strong> mode de travail pédagogique, qu’à partir du<br />
CM .<br />
Au CE , la situation est quasi-identique : supériorité sur presque tous <strong>le</strong>s critères, exception<br />
faite d’une égalité sur <strong>le</strong>s phrases comp<strong>le</strong>xes et la profondeur et d’une légère infériorité<br />
quant aux énumérations, mais avec des écarts réduits. En revanche, la longueur des écrits<br />
excède d’une trentaine de mots en moyenne cel<strong>le</strong> des autres classes, ce qui est loin d’être<br />
négligeab<strong>le</strong>.<br />
On pourrait par<strong>le</strong>r d’une « reprise marquée » au CM où <strong>le</strong>s écarts nets touchent tous <strong>le</strong>s<br />
critères, à l’exception d’une égalité sur la proportion de « il y a » et sur l’actualisation de la<br />
description ( 00% partout) et d’une plus forte proportion d’énumérations. Et, ici encore, ces<br />
résultats doivent être mis en relation avec la longueur moyenne des écrits : , 0 mots<br />
pour H.B., 0, ail<strong>le</strong>urs…<br />
Les écarts sont maintenus au CM où la longueur moyenne est <strong>le</strong> doub<strong>le</strong> de cel<strong>le</strong>s constatées<br />
ail<strong>le</strong>urs (<strong>le</strong> quadrup<strong>le</strong>, la quatrième année) : supériorité sur tous <strong>le</strong>s indicateurs en langue<br />
et en matière d’organisation textuel<strong>le</strong> avec cependant une légère infériorité sur <strong>le</strong> niveau<br />
de la profondeur (composantes des composantes de lieux), une variabilité quant aux plans<br />
selon <strong>le</strong>s années et une égalité, déjà signalée, sur l’actualisation des descriptions.<br />
4.3. La vision de l’éco<strong>le</strong><br />
Ici encore <strong>le</strong>s contenus et <strong>le</strong>ur mise en scène présentent un certain nombre de spécificités.<br />
La vision de l’éco<strong>le</strong> est plus amp<strong>le</strong> et principa<strong>le</strong>ment centrée sur <strong>le</strong>s activités où <strong>le</strong>s écarts<br />
avec <strong>le</strong>s autres élèves sont <strong>le</strong>s plus importants. À la différence de ces derniers, <strong>le</strong>s élèves<br />
d’H.B. mentionnent moins <strong>le</strong>s lieux extérieurs à l’éco<strong>le</strong> ou la cour mais plus <strong>le</strong>s classes, <strong>le</strong>s<br />
espaces spécialisés (musique, sport…) et <strong>le</strong>s espaces de passage (couloirs, escaliers…)<br />
ou « de vie » (toi<strong>le</strong>ttes, cantine…) mais sans critique et sans évoquer de crainte .<br />
Ils mentionnent aussi plus <strong>le</strong>s élèves que <strong>le</strong>s maîtres à la différence des autres éco<strong>le</strong>s et,<br />
complémentairement plus <strong>le</strong>ur classe et moins <strong>le</strong>ur maître .<br />
Au sein de ce lieu de vie, <strong>le</strong> travail est actualisé de manière bien plus importante qu’ail<strong>le</strong>urs<br />
(notamment au travers du signa<strong>le</strong>ment des matières, d’activités précises, d’objets liés au<br />
travail et des appréciations <strong>le</strong>s accompagnant) à l’inverse du jeu. Et, de surcroît, il est vu<br />
positivement, là aussi de façon plus nette que dans <strong>le</strong>s autres classes. J’ajouterai encore<br />
que <strong>le</strong>s élèves « Freinet » évoquent plus que <strong>le</strong>s autres d’autres acteurs de l’éco<strong>le</strong> (aideéducateur,<br />
parents, correspondants …).<br />
Leur exposition est en outre plus impliquée : par la quantité d’évaluatifs et par <strong>le</strong> poids des<br />
Je, Nous, On, Je + Nous et / ou On (à la différence des autres éco<strong>le</strong>s, il n’y a ici quasiment<br />
pas d’absence de marques de personne).<br />
Cette implication articu<strong>le</strong> nettement <strong>le</strong> Je individuel et <strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif (on, nous). Enfin, el<strong>le</strong><br />
est bien plus positive qu’ail<strong>le</strong>urs (proportion d’évaluations positives et quasi-absence de<br />
critiques).<br />
Voir, de ce point de vue, la fréquence du verbe faire.<br />
Il n’existe en revanche pas de différence quant à la sal<strong>le</strong> des enseignants, peu mentionnée.<br />
On pourrait avancer que l’identité de l’éco<strong>le</strong> passe par <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctifs élèves et classes.<br />
Mais, comme <strong>le</strong>s autres, ils n’évoquent que très peu <strong>le</strong> personnel de service.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
4.4. Éléments de synthèse sur <strong>le</strong>s descriptions<br />
Ce bilan – trop cavalier sans doute – appel<strong>le</strong> quelques remarques complémentaires dans<br />
la mesure où, s’il n’autorise pas comme dans <strong>le</strong> cas des récits, des comparaisons avec des<br />
élèves de milieu plus favorisé, il permet en revanche d’éclairer certaines variations selon <strong>le</strong>s<br />
classes et certaines évolutions au cours de la scolarité primaire.<br />
Ainsi, on peut constater un lieu remarquab<strong>le</strong>, <strong>le</strong> CP, avec une évolution très rapide des<br />
performances dont la croissance va se maintenir avec des écarts marqués avec <strong>le</strong>s élèves<br />
soumis à des fonctionnements pédagogiques plus classiques. Les différences sont aussi<br />
très sensib<strong>le</strong>s au CM et au CM , même s’il a parfois fallu attendre un peu plus longtemps<br />
( , , ans) certaines évolutions, ce qui renvoie à la nécessité d’une immersion temporel<strong>le</strong><br />
conséquente dans ce M.T.P.. Si la supériorité des élèves d’H.B. est aussi réel<strong>le</strong> en CE et<br />
CE , el<strong>le</strong> est cependant, à mon sens, moins patente (plus d’évolutions en dents de scie,<br />
écarts moindres avec <strong>le</strong>s autres classes, associés parfois à une vision moins spécifique).<br />
Comment en rendre compte ? Nécessité d’une décantation après un démarrage aussi fort<br />
en CP, effet maître, temps de latence entre deux étapes importantes de l’éco<strong>le</strong> ? Faut-il<br />
même en rendre compte si l’on admet que ce constat n’est éventuel<strong>le</strong>ment déceptif qu’au<br />
regard de performances ail<strong>le</strong>urs remarquab<strong>le</strong>s ? En tout cas, <strong>le</strong>s élèves d’H.B. entrent<br />
plus rapidement et plus nettement dans l’écrit (longueur, architecture textuel<strong>le</strong>…) et <strong>le</strong>urs<br />
performances en matière de description s’avèrent supérieures, pour toutes <strong>le</strong>s classes, sur<br />
toutes <strong>le</strong>s dimensions et la quasi-totalité des critères. De surcroît <strong>le</strong>urs écrits manifestent un<br />
contrô<strong>le</strong> textuel certain : ancrage initial, présence du niveau d’indexation global, organisation,<br />
traces d’explicitation…<br />
Il me semb<strong>le</strong> aussi que, comme dans <strong>le</strong> cas des récits, <strong>le</strong>s spécificités des contenus et de<br />
<strong>le</strong>ur exposition sont à mettre en relation avec des fonctionnements textuels particuliers tels<br />
développement et diversification des moyens employés via <strong>le</strong>s évaluations, <strong>le</strong>s modalités de<br />
l’implication (articulant individuel et col<strong>le</strong>ctif), <strong>le</strong>s multip<strong>le</strong>s explications (du travail effectué,<br />
des conseils, des responsabilités…), renvoyant aux modes de fonctionnement de l’éco<strong>le</strong><br />
el<strong>le</strong>-même.<br />
Il est en outre intéressant de constater que la supériorité en matière syntaxique (phrases<br />
simp<strong>le</strong>s et comp<strong>le</strong>xes réussies) est constante, du CP au CM .<br />
Enfin, je conclurai, sur trois remarques en matière d’orthographe :<br />
– ici aussi, la supériorité est quasi-constante du CP au CM , même si el<strong>le</strong> est bien plus<br />
marquée au CP et qu’il fail<strong>le</strong> attendre la cinquième année au CM (la quatrième au CM ) ;<br />
– ces résultats s’accompagnent d’une dispersion moindre des performances que dans <strong>le</strong>s<br />
autres éco<strong>le</strong>s (ce qui n’est pas <strong>le</strong> cas pour la longueur des écrits) ;<br />
– ils sont d’autant plus intéressants au regard de la prise de risques, plus importante<br />
qu’ail<strong>le</strong>urs, quant aux termes employés (par exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong>s désignations de matières, de<br />
notions ou d’activités).<br />
5. Éléments de comparaison entre <strong>le</strong>s catégories d’écrits<br />
À ce stade de l’exposition des résultats et avant d’en venir plus précisément à la dimension<br />
diachronique, j’aimerais effectuer trois remarques en guise d’approfondissement et de<br />
synthèse provisoires.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
En premier lieu, on ne peut que constater des effets bénéfiques de ce mode de travail<br />
pédagogique, quel<strong>le</strong> que soit la catégorie d’écrits convoquée puisque <strong>le</strong>s performances des<br />
élèves d’H.B. sont supérieures à cel<strong>le</strong>s des autres élèves de milieu équiva<strong>le</strong>nt et s’approchent<br />
souvent, voire dépassent parfois, cel<strong>le</strong>s d’élèves de milieux plus favorisés. Cela touche de<br />
surcroît la plupart des dimensions analysées : longueur, respect de la consigne, langue (au<br />
moins partiel<strong>le</strong>ment), structuration textuel<strong>le</strong>. Cela entre en congruence avec <strong>le</strong>s analyses<br />
des évaluations nationa<strong>le</strong>s (CE , è ) dans <strong>le</strong> domaine du français (Hassan, 00 et 00 )<br />
qui montrent des progrès partout et, dans bien des cas, des performances supérieures au<br />
REP, à la circonscription, au département, voire au territoire national.<br />
Ces performances sont co-occurentes au développement de spécificités dans l’actualisation<br />
des contenus et de <strong>le</strong>ur exposition, spécificités partiel<strong>le</strong>ment communes : expansion<br />
et précision au-delà de traits minimaux, mise en scène du sujet, investissement… Ces<br />
dimensions, dont on peut penser qu’el<strong>le</strong>s sont en relation avec <strong>le</strong> M.T.P. mis en place, me<br />
semb<strong>le</strong>nt non seu<strong>le</strong>ment participer de certaines caractéristiques de ces écrits (longueur,<br />
diversité des moyens textuels employés…) mais encore ne s’opposent nul<strong>le</strong>ment à un<br />
contrô<strong>le</strong> textuel égal ou supérieur à ce qu’il peut être ail<strong>le</strong>urs, voire <strong>le</strong> favorisent (recherche<br />
de l’intérêt, souci de la compréhension…).<br />
Enfin, j’ai déjà eu l’occasion de signa<strong>le</strong>r (Reuter 00 ) que, selon <strong>le</strong>s catégories de récits, <strong>le</strong>s<br />
élèves pouvaient modifier considérab<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>ur manière d’écrire (temps utilisé, longueur,<br />
procédés utilisés…). Dans cette perspective, je noterai ici que <strong>le</strong>s élèves « Freinet » varient<br />
plus que ceux de milieu équiva<strong>le</strong>nt <strong>le</strong>urs récits et, en cela, s’approchent des façons de<br />
faire des élèves de milieu plus favorisé ; de la même manière, <strong>le</strong>s différences entre <strong>le</strong>urs<br />
descriptions et <strong>le</strong>urs récits (longueur, langue…) sont bien plus fortes que pour <strong>le</strong>s autres<br />
élèves. J’aurais tendance à interpréter cela – avec prudence – comme une marque de<br />
soup<strong>le</strong>sse : s’adapter à une situation d’écriture spécifique plutôt que de répondre de manière<br />
uniforme à une demande non reconstruite comme singulière.<br />
J’ajouterai encore, sans pouvoir en conclure quoique ce soit mais pour ouvrir des pistes de<br />
recherche que, quel que soit <strong>le</strong> M.T.P., <strong>le</strong>s performances phrastiques sont supérieures dans<br />
<strong>le</strong>s descriptions (qui sont plus longues que <strong>le</strong>s récits).<br />
6. Remarques sur la dimension diachronique<br />
Il est clair que <strong>le</strong>s analyses présentées doivent être regardées avec prudence au regard<br />
des effectifs à chaque fois restreints d’H.B. et des variations qui concernent, entre autres,<br />
classes, niveaux, dimensions et années.<br />
0<br />
6.1. Variations selon <strong>le</strong>s classes<br />
Ainsi, certaines classes présentent quelques caractéristiques dont il n’est pas forcément<br />
faci<strong>le</strong> de rendre compte mais qui affectent indéniab<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s résultats. Je n’en prendrai ici<br />
que deux exemp<strong>le</strong>s. Les maîtres s’accordent ainsi pour dire que <strong>le</strong>s élèves du CP de 00 -<br />
00 , passés au CE en 00 , constituent une classe « diffici<strong>le</strong> » (sans pouvoir réel<strong>le</strong>ment<br />
l’expliquer) et, de fait, cela se manifeste dans une certaine régression des performances.<br />
À l’inverse, <strong>le</strong>s performances ont « explosé » en CM . La quatrième année, en raison, au<br />
moins en partie, de véritab<strong>le</strong>s <strong>le</strong>aders d’écriture, stimulant <strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif-classe.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
6.2. Variations selon <strong>le</strong>s niveaux<br />
Il existe aussi – ce que <strong>le</strong>s analyses des textes descriptifs ont permis de mettre au jour – des<br />
différences selon <strong>le</strong>s niveaux : « explosion » au CP (démarrage rapide – majorité de progrès<br />
constants) attribuab<strong>le</strong> aussi en partie aux maîtresses de maternel<strong>le</strong> ; bilan positif mais un<br />
peu moins net aux CE et CE ; bilan plus net au CM et au CM , avec cependant des<br />
modifications plus accentuées <strong>le</strong>s deux dernières années, manifestant ainsi l’importance de<br />
l’immersion temporel<strong>le</strong> (et aussi la fin de l’envoi d’élèves en grande difficulté par d’autres<br />
éco<strong>le</strong>s en cours de scolarité). À cela, il convient d’ajouter qu’à la suite de notre rapport de<br />
00 , l’accent porté de manière plus importante sur l’orthographe en CM a entraîné des<br />
progrès certains sur cette dimension… accompagnés d’une régression sur d’autres.<br />
6.3. Variations selon <strong>le</strong>s dimensions<br />
Les évolutions sont encore fortement différenciées selon dimensions et critères . J’ai ainsi<br />
pu distinguer cinq tendances principa<strong>le</strong>s : <strong>le</strong> maintien à un niveau faib<strong>le</strong> (souvent commun<br />
à tous <strong>le</strong>s élèves : fonctionnalité descriptive, plans…, parfois spécifique à H.B. : <strong>le</strong> dialogue<br />
dans <strong>le</strong>s R.S.V.) ; l’instabilité : c’est <strong>le</strong> cas, par exemp<strong>le</strong> pour l’amp<strong>le</strong>ur des dimensions, la<br />
tendance à l’énumération ou la proportion de il y a ; des progrès rapides suivis du maintien<br />
à un niveau identique (respect de la consigne, architecture, ancrage initial, phrases simp<strong>le</strong>s<br />
réussies…) ; des progrès <strong>le</strong>nts mais continus (orthographe, proportion de verbes différents<br />
d’être ou avoir) ; un « bond » la première année suivi de progrès continus (la longueur).<br />
6.4. Variations selon <strong>le</strong>s années<br />
Ces variations sont encore tributaires de grandes tendances selon <strong>le</strong>s années :<br />
– progrès nettement marqués la première année (attribuab<strong>le</strong>s, au moins en partie, à<br />
l’implication des maîtres dans la mise en place du M.T.P. et au nombre restreint d’élèves) ;<br />
– tendance à la régression la seconde année (arrivée d’élèves en grande difficulté envoyés<br />
par d’autres éco<strong>le</strong>s, troub<strong>le</strong>s sociaux et scolaires liés à la réforme des retraites, incidents<br />
dans <strong>le</strong> quartier…)<br />
– nette remontée la troisième année avec des « pics » la quatrième et la cinquième années<br />
(effets temporels de l’immersion dans <strong>le</strong> M.T.P. depuis <strong>le</strong> CP et / ou la maternel<strong>le</strong>).<br />
6.5. Mais un bilan global net<br />
Mais, au delà de ces variations, <strong>le</strong> bilan demeure nettement positif sur cette dimension<br />
temporel<strong>le</strong> : progrès sur la majeure partie des dimensions et critères ; aucune baisse (<strong>le</strong> cas<br />
<strong>le</strong> pire est <strong>le</strong> maintien des performances antérieures). Cela dans toutes <strong>le</strong>s classes (et avec<br />
des progrès plus réguliers entre <strong>le</strong>s classes que dans d’autres éco<strong>le</strong>s). Cela malgré une<br />
nette augmentation des effectifs depuis la première année…<br />
7. L’analyse des entretiens<br />
Tenter d’en rendre compte excèderait largement <strong>le</strong>s limites de ce chapitre.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Complémentairement à l’analyse des écrits, des entretiens ont été menés afin d’évaluer <strong>le</strong>s<br />
modes de réf<strong>le</strong>xion des élèves sur <strong>le</strong>s textes, l’activité même de production et <strong>le</strong>s cadres<br />
pédagogiques au sein desquels ils s’inscrivaient .<br />
Le corpus est composé de entretiens passés essentiel<strong>le</strong>ment par des étudiants de<br />
Master (Deschildt, 00 ; Humbert-Prudhomme, 00 et 00 ; Lammertyn, et 000).<br />
Ils portent aussi bien sur <strong>le</strong>s récits sollicitant <strong>le</strong> vécu que sur ceux sollicitant l’imaginaire.<br />
ont été menés avec des élèves d’H.B. (lors de trois années différentes), avec des<br />
élèves d’autres éco<strong>le</strong>s de milieu équiva<strong>le</strong>nt ou plus favorisé. Si <strong>le</strong> caractère hétérogène<br />
de ce document (Delcambre et Lahanier-Reuter, 00 ) impose sans nul doute de grandes<br />
précautions quant aux traitements effectués, il offre en retour l’avantage de fournir une base<br />
non négligeab<strong>le</strong> de comparaison selon <strong>le</strong>s élèves (de pédagogies et de milieux différents).<br />
L’analyse de ces entretiens m’a permis de mettre au jour – à côté de points communs<br />
– des singularités chez <strong>le</strong>s élèves « Freinet » en termes de tendances ou de réponses<br />
remarquab<strong>le</strong>s (présentes nul<strong>le</strong> part ail<strong>le</strong>urs). Je m’arrêterai ici, trop succinctement encore,<br />
sur sept d’entre el<strong>le</strong>s.<br />
Ces élèves manifestent d’abord – et cela est confirmé par tous <strong>le</strong>s entretiens menés par<br />
d’autres membres de l’équipe quel que soit <strong>le</strong> domaine concerné – une position plus<br />
autonome, plus assurée, au sein des interactions liées à l’entretien : ils par<strong>le</strong>nt et s’affirment<br />
plus, demandant par exemp<strong>le</strong> des reformulations des questions, signalant qu’ils n’ont pas<br />
compris ou exprimant <strong>le</strong>ur désaccord.<br />
Leurs réponses sont, individuel<strong>le</strong>ment et col<strong>le</strong>ctivement, plus diversifiées que dans <strong>le</strong>s<br />
autres classes.<br />
Ils sont encore plus précis et détaillés dans <strong>le</strong>urs explications et justifications n’hésitant pas<br />
à recourir « spontanément » à des exemp<strong>le</strong>s.<br />
Leur rapport aux normes scolaires et à l’autorité du maître est, lui-aussi, assez spécifique.<br />
Ainsi, lorsqu’on <strong>le</strong>ur demande de rappe<strong>le</strong>r la consigne, ils n’ajoutent pas, comme <strong>le</strong> font <strong>le</strong>s<br />
autres, la nécessité d’être attentif à l’orthographe ou aux conjugaisons. S’ils manifestent un<br />
véritab<strong>le</strong> respect de la consigne (cf. et ), celui-ci n’est cependant pas servi<strong>le</strong> : certains<br />
élèves expliquent ainsi, en ce qui concerne <strong>le</strong>s R.S.V. qu’ils ont préféré retenir un souvenir<br />
qui ne se passait pas en soirée car, à <strong>le</strong>ur sens, il était plus marquant, ce qu’ils ont donc<br />
privilégié. Quant au maître, il n’est pas posé, comme c’est souvent <strong>le</strong> cas ail<strong>le</strong>urs, comme un<br />
adulte détenteur d’un pouvoir absolu et arbitraire mais comme un aide, dont la compétence<br />
est tributaire de conditions déterminées et, dans <strong>le</strong> cas du R.S.V., comme un partenaire<br />
avec qui on peut discuter, voire que l’on peut faire changer d’avis.<br />
Leur position évaluative est tout aussi singulière : <strong>le</strong>s critères qu’ils mentionnent portent<br />
tendanciel<strong>le</strong>ment sur un plus grand nombre de dimensions (normes scolaires, textuel<strong>le</strong>s,<br />
génériques, communicationnel<strong>le</strong>s…), avec quelques accentuations particulières (la<br />
ponctuation, par exemp<strong>le</strong>) ; <strong>le</strong>ur discours auto-évaluatif manifeste plus de nuances : que<br />
<strong>le</strong> sentiment soit celui d’une réussite, d’une réserve ou d’un échec, il est toujours explicité<br />
avec, souvent, l’indication de ce qui est moins réussi et de ce qu’il aurait fallu faire 0 ; et cette<br />
Je développe ces analyses à propos des R.S.V. dans Reuter 00 .<br />
Par exemp<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s difficultés ressenties face aux normes langagières et, en ce qui concerne <strong>le</strong>s<br />
R.S.V., <strong>le</strong> souci de la vérité, la crainte de l’exposition de l’intime, <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> de la mémoire et <strong>le</strong> statut didactique<br />
problématique de tels écrits (ressentis trop privés, non modifiab<strong>le</strong>s, sans aides possib<strong>le</strong>s…)<br />
De fait, <strong>le</strong>s entretiens avec ces élèves durent plus longtemps qu’ail<strong>le</strong>urs.<br />
0 On ne trouve pas, en tout cas, comme ail<strong>le</strong>urs, de sentiment de réussite et d’auto-satisfaction absolu<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
appréciation est référée à la consigne et au projet textuel – communicationnel (et non à ses<br />
propres goûts ou aux effets chez ses copains).<br />
De fait, chez ces élèves, c’est la dimension communicationnel<strong>le</strong> qui s’avère fondamenta<strong>le</strong>.<br />
Ainsi, ils sont particulièrement attentifs à produire des récits compréhensib<strong>le</strong>s et intéressants ;<br />
lors de la re<strong>le</strong>cture fina<strong>le</strong>, ils ne s’attachent pas uniquement à l’orthographe mais tout autant<br />
à la cohérence et au sens ; et ils sont <strong>le</strong>s seuls à prêter aux chercheurs des intérêts autres<br />
que langagiers ou textuels (« mieux nous connaître ») et à déclarer avoir cherché à <strong>le</strong>s<br />
intéresser (« faire partager notre plaisir » ; « il faut que ce soit une soirée extraordinaire pour<br />
intéresser <strong>le</strong>s chercheurs »…).<br />
Cette dimension communicationnel<strong>le</strong> est étayée dans <strong>le</strong>ur discours par <strong>le</strong> renvoi à des<br />
dispositifs précis et diversifiés (textes libres, entretiens du matin, correspondance…) qui<br />
<strong>le</strong>ur réservent une part importante d’autonomie (écrire ou non, montrer ou non, « publier »<br />
dans des instruments col<strong>le</strong>ctifs ou non) et donc de réf<strong>le</strong>xion sur <strong>le</strong>s choix possib<strong>le</strong>s. Ces<br />
dispositifs intègrent encore des moments de négociation individuel<strong>le</strong> avec <strong>le</strong> maître, incluant<br />
des questions (pour mieux comprendre) et des suggestions portant de manière importante<br />
sur lisibilité, moyens textuels, cohérence (« pour que ça suive bien ») et informations<br />
nécessaires à la compréhension. Ils intègrent aussi des échanges avec <strong>le</strong>s autres élèves<br />
et <strong>le</strong> maître dans des moments où <strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif-classe réagit à <strong>le</strong>urs écrits. Ce dispositif,<br />
fondamental à mon sens, explique au moins en partie qu’on ne rencontre pas ici, dans <strong>le</strong><br />
rapport aux écrits, l’opposition adulte vs enfants ou la prééminence accordée aux réactions<br />
des copains, entrées très fréquentes ail<strong>le</strong>urs.<br />
Ces traits singuliers constituent <strong>le</strong>s élèves « Freinet », comparés aux autres, comme des<br />
élèves particulièrement réf<strong>le</strong>xifs quant aux textes, à <strong>le</strong>ur production et aux cadres scolaires :<br />
conscience des dispositifs, du travail nécessaire et de la modifiabilité de <strong>le</strong>urs écrits, liée<br />
aux apprentissages nécessaires et à l’aide du maître et de <strong>le</strong>urs pairs. J’ai ainsi pu montrer,<br />
dans mes analyses des R.S.V., qu’ils reconstruisaient la demande de tels récits de manière<br />
plus pertinente dans un cadre scolaire que <strong>le</strong>s autres élèves (même si cela peut être gênant,<br />
c’est plus ou moins pratiqué déjà ; il existe des aides possib<strong>le</strong>s ; on peut modifier ces écrits<br />
au regard de la compréhension et de l’intérêt…). Il convient encore de rappe<strong>le</strong>r (à la suite<br />
de Deschildt 00 ) qu’ils sont <strong>le</strong>s seuls à par<strong>le</strong>r de l’utilité des remarques du maître pour<br />
s’améliorer.<br />
Je dirais volontiers que l’on retrouve dans ces entretiens, sous des formes qui <strong>le</strong>ur sont<br />
propres, des modalités d’articulation entre implication et contrô<strong>le</strong> (ou distance réf<strong>le</strong>xive),<br />
mises au jour dans l’analyse des productions de ces mêmes élèves.<br />
8. Les relations à l’univers de l’écrit<br />
Sans sous-estimer <strong>le</strong>s problèmes théoriques et méthodologiques attachés à la question<br />
de la mise en relation de phénomènes, reconstruits comme des effets, avec un M.T.P.<br />
déterminé , il me semb<strong>le</strong> que nombre de spécificités mises au jour dans <strong>le</strong>s productions et<br />
et non argumenté.<br />
Ils rejoignent en cela <strong>le</strong>s élèves de milieu plus favorisé.<br />
Auxquels il conviendrait d’en ajouter encore d’autres tels une différenciation plus forte des écrits étudiés<br />
et pratiqués en classe, une pratique plus déclarée d’écrits extrascolaires avec, ici aussi, une différenciation<br />
plus marquée des manières d’écrire en classe et à la maison.<br />
Voir sur ces questions, Baudelot et Lec<strong>le</strong>rcq, dir. 00 ; Bru, Altet et Blanchard-Lavil<strong>le</strong>, 00 , et<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
<strong>le</strong>s entretiens, peuvent être éclairées, au moins en partie, par <strong>le</strong>s caractéristiques du M.T.P.<br />
« Freinet », notamment en ce qu’il est actualisé dans ce que j’ai appelé (Reuter, 00 ) un<br />
univers de l’écrit, c’est-à-dire <strong>le</strong> système de relations qui unit acteurs, objets et pratiques<br />
dans <strong>le</strong> domaine de l’écrit en classe. La construction de ces univers a été opérationnalisée<br />
méthodologiquement (Giguère et Reuter, 00 ) au travers d’une gril<strong>le</strong> d’analyse comprenant<br />
quatre catégories (écrits ; supports ; outils et activités), chacune d’entre el<strong>le</strong>s étant détaillée<br />
à l’aide de multip<strong>le</strong>s critères (sources, usages, fréquence…).<br />
La reconstruction de l’univers de l’écrit instauré dans cette éco<strong>le</strong> repose sur deux sources<br />
principa<strong>le</strong>s : des observations ponctuel<strong>le</strong>s (moins d’une journée) menées par divers<br />
membres de l’équipe pendant <strong>le</strong>s cinq années écoulées et des observations de moyenne<br />
durée (une semaine en continu) menées essentiel<strong>le</strong>ment par Jacinthe Giguère ( 00 )<br />
dans six classes (CE et CM ) pratiquant des pédagogies différentes (« classique », « de<br />
projet » et « Freinet »). Pour des raisons d’économie, je m’en tiendrai ici à l’exposition de<br />
ce qui m’apparaît à la fois comme spécifique de l’univers de l’écrit à H.B. et <strong>le</strong> plus à même<br />
d’éclairer <strong>le</strong>s résultats mentionnés.<br />
8.1. Un univers riche et co-construit<br />
En premier lieu, comparé à d’autres, cet univers de l’écrit apparaît bien plus stimulant. Il est<br />
quantitativement important (plus de documents partout dans l’éco<strong>le</strong> et dans <strong>le</strong>s classes) ;<br />
diversifié dans ses sources (nombre de documents viennent des élèves), dans sa composition<br />
(tous types d’écrits) , dans <strong>le</strong>s supports et outils mis à la disposition des élèves, dans <strong>le</strong>s<br />
pratiques mises en œuvre (cf. ci-après). Il est renouvelé plus fréquemment, fonctionnalisé<br />
(voir la multiplicité de pratiques, ainsi que son activation-appropriation par <strong>le</strong>s élèves,<br />
notamment en tant qu’aide ou recours, et l’intérêt que suscitent <strong>le</strong>s nouveaux affichages).<br />
Il est encore historicisé plus qu’ail<strong>le</strong>urs : il existe à H.B. des instruments col<strong>le</strong>ctifs liés à la<br />
pédagogie Freinet (cahier de vie, journal de classe…), ainsi qu’un archivage minutieux des<br />
productions des élèves qui peuvent <strong>le</strong>ur resservir ou servir à d’autres, ultérieurement<br />
8.2. Des pratiques singulières<br />
Les pratiques qui actualisent cet univers sont régulières, fréquentes (<strong>le</strong>s élèves écrivent<br />
– et lisent – une multitude de textes et diversifiées fonctionnel<strong>le</strong>ment : ainsi, outre <strong>le</strong>s<br />
fonctions classiques de l’écrit à l’éco<strong>le</strong>, on trouve ici, de manière importante la régulation de<br />
la vie col<strong>le</strong>ctive ou du travail, <strong>le</strong> recours pour ses recherches… mais moins qu’ail<strong>le</strong>urs <strong>le</strong>s<br />
fonctions de contrô<strong>le</strong> ou de répression.<br />
El<strong>le</strong>s sont principa<strong>le</strong>ment « ouvertes » (non réduites à la rédaction limitée d’une réponse<br />
– solution unique), moins imposées par <strong>le</strong> maître (laissant dans de nombreux cas la place à<br />
l’initiative et à l’autonomie des élèves y compris dans <strong>le</strong>ur choix des outils et des supports)<br />
et d’une durée plus longue et ajustée à chacun : il ne s’agit pas de faire <strong>le</strong> plus rapidement<br />
possib<strong>le</strong> ou sur un rythme unique, pré-déterminé par <strong>le</strong> maître, il s’agit de prendre <strong>le</strong> temps<br />
nécessaire pour al<strong>le</strong>r jusqu’au bout d’un projet de travail, en pouvant réfléchir, décanter,<br />
Reuter et Carra, 00 .<br />
Et pas seu<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s à appliquer.<br />
L’histoire n’est pas morte dans la mesure où <strong>le</strong> passé est constamment réactivé.<br />
Ce qui est, de facto, beaucoup moins fréquent dans un M.T.P. classique.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
eprendre, modifier…<br />
De surcroît, ces pratiques ne sont pas simp<strong>le</strong>ment juxtaposées, el<strong>le</strong> sont mises en interaction<br />
(<strong>le</strong>cture-écriture, écrit-oral, scolaire-extrascolaire, entretiens-recherche-structuration<br />
linguistique…) de manière diversifiée, explicitée (notamment par <strong>le</strong>s remarques du maître)<br />
et active par <strong>le</strong>s renvois incessants des pratiques entre el<strong>le</strong>s.<br />
El<strong>le</strong>s articu<strong>le</strong>nt en outre une véritab<strong>le</strong> stimulation (voir <strong>le</strong>s exigences des maîtres) et un<br />
étayage sécurisant : absence de stigmatisation des erreurs, coopération entre <strong>le</strong>s acteurs,<br />
choix d’écrire ou non, de dire / lire à tous ou non, de « publier » ou non, évaluation formative<br />
et personnalisée, normes explicites, co-construites, révisab<strong>le</strong>s…<br />
8.3. Six principes remarquab<strong>le</strong>s<br />
Six principes, organisant la mise en œuvre de ces pratiques, me paraissent à souligner dans<br />
la mesure où on ne <strong>le</strong>s retrouve que rarement ail<strong>le</strong>urs, en tout cas ainsi réunis et avec une<br />
tel<strong>le</strong> constance. Les pratiques langagières, notamment scriptura<strong>le</strong>s, sont systématiquement<br />
associées à la construction des savoirs (co-élaboration au tab<strong>le</strong>au, recherches individuel<strong>le</strong>s,<br />
exposés…) dans toutes <strong>le</strong>s disciplines et en laissant une large place aux projets, modifications,<br />
prolongements après questionnements, reprises… Je par<strong>le</strong>rais volontiers ici d’une mise en<br />
exercice de la fonction heuristique de l’écriture.<br />
Les élèves sont appelés à assumer, au travers des dispositifs mis en place, de multip<strong>le</strong>s<br />
rô<strong>le</strong>s : auteur, chercheur, aide, questionneur, critique, évaluateur, enseignant… Cela<br />
favorise sans doute des modes d’appropriation (de l’écriture et des savoirs) différents, la<br />
conscience des divers points de vue possib<strong>le</strong>s, la réf<strong>le</strong>xion sur la nécessaire articulation<br />
entre valorisation et critique…<br />
Le travail de construction des savoirs et savoir-faire, en particulier dans <strong>le</strong> domaine de l’écrit,<br />
passe par la constitution d’une culture commune de la classe (textes écrits par <strong>le</strong>s élèves,<br />
documents amenés, archives des entretiens…) qui constitue une médiation entre cultures<br />
extrascolaires et culture scolaire et dote <strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif-classe d’une identité, d’une histoire et<br />
d’une base de travail spécifiques.<br />
L’articulation entre individu et col<strong>le</strong>ctif (incluant maître et élèves) dans une communauté de<br />
vie, de travail et de recherche est fondamenta<strong>le</strong>. El<strong>le</strong> s’effectue via des dispositifs (cahier<br />
de vie, coévaluation, socialisation, élaboration col<strong>le</strong>ctive, retours sur <strong>le</strong>s présentations…)<br />
et des modes de travail privilégiés (individuel, col<strong>le</strong>ctif élaboratif, col<strong>le</strong>ctif-singularisé…)<br />
qui favorisent coopération et sécurisation en évitant <strong>le</strong>s oppositions récurrentes dans<br />
d’autres M.T.P. (élèves entre eux, copains vs autres élèves ; maîtres vs élèves ; adultes vs<br />
enfants).<br />
La dimension communicationnel<strong>le</strong> se trouve au cœur des pratiques langagières : multiplicité<br />
des destinataires « réels » (maître, groupe classe, élèves d’autres classes, correspondants,<br />
parents, usagers du site internet…) qui effectuent de véritab<strong>le</strong>s renvois sous de multip<strong>le</strong>s<br />
formes , variation des situations et des enjeux. Cela explique <strong>le</strong> souci des élèves quant à la<br />
Cela rejoint <strong>le</strong>s analyses effectuées dans <strong>le</strong>s autres domaines par <strong>le</strong>s membres de l’équipe et<br />
notamment la plus grande sérénité dans l’entrée dans l’écrit (cf., infra, la contribution de M. Fialip-Baratte).<br />
Au détriment donc de magistral, du col<strong>le</strong>ctif-uniforme (tout <strong>le</strong> monde fait la même chose en même<br />
temps) et des groupes restreints.<br />
Voir, par exemp<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s « échos », réactions du maître à des écrits des élèves sous forme d’autres<br />
écrits ou d’images.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
lisibilité, à la présentation, à la personnification graphique, au sens, à la compréhension, à<br />
l’intérêt… Cela favorise sans doute la conscience de la fonctionnalité et de la contextualisation<br />
des écrits.<br />
Enfin – et cela m’apparaît comme fondamental – l’articulation entre faire et réf<strong>le</strong>xion sur <strong>le</strong><br />
faire est incessamment stimulée. Cela passe par <strong>le</strong>s dispositifs et pratiques évoqués, par<br />
<strong>le</strong>s multip<strong>le</strong>s moments de discussion des projets, de programmation des tâches, d’esquisse,<br />
d’explications, de justification, de discussion, d’évaluation, de retour critique, de bilan…<br />
Ainsi, à l’opposé de nombre de discours doxiques sur <strong>le</strong>s pédagogies alternatives, faire et<br />
distance réf<strong>le</strong>xive sur <strong>le</strong> faire sont encouragés, activés, mis en interactions… expliquant, au<br />
moins en partie, <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> textuel et la réf<strong>le</strong>xivité de ces élèves, tels que nous avons pu <strong>le</strong>s<br />
décrire précédemment.<br />
8.4. Un univers de l’écrit solidement constitué<br />
Ainsi, l’univers de l’écrit tel que nous avons pu <strong>le</strong> reconstruire est singulier, différent aussi<br />
bien des univers classiques que de ceux soumis à certaines formes de préconisation en<br />
vogue chez certains didacticiens (accent porté sur <strong>le</strong>s types de textes ou la construction<br />
explicite de genres formels, priorité accordée aux activités de systématisation linguistique<br />
ou textuel<strong>le</strong>, modalités de réécriture…). Sa force tient sans doute à sa cohérence : il s’agit<br />
d’un véritab<strong>le</strong> système comp<strong>le</strong>xe 0 , fonctionnalisé et en harmonie avec des principes<br />
pédagogiques fondamentaux. El<strong>le</strong> tient encore à la pertinence de ses dispositifs, établis<br />
mais ajustab<strong>le</strong>s, garantissant à la fois étayage et autonomie.<br />
9. Retour sur la langue<br />
Revenir sur des questions de langue à la fin d’un tel chapitre mérite sans nul doute quelques<br />
justifications. J’en invoquerai ici quatre : nombre de discours théoriques et / ou médiatiques<br />
postu<strong>le</strong>nt que <strong>le</strong>s pédagogies alternatives sont moins efficaces en ce domaine ; ces<br />
questions préoccupent tous <strong>le</strong>s maîtres de primaire, maîtres « Freinet » y compris ; j’ai pu,<br />
moi-même, dans un rapport précédent (Reuter, 00 b) m’interroger sur ce point ; certains<br />
résultats, enfin, manifestent des progrès plus <strong>le</strong>nts et / ou des écarts plus faib<strong>le</strong>s avec <strong>le</strong>s<br />
performances des autres élèves.<br />
Il convient cependant, avant toute interprétation, de ne pas mésestimer la comp<strong>le</strong>xité des<br />
problèmes posés. En effet, comme j’ai pu l’exposer précédemment, la configuration est<br />
différente selon <strong>le</strong>s niveaux : ainsi, en ce qui concerne l’orthographe, on peut constater des<br />
progrès <strong>le</strong>nts en CM avec un dépassement des élèves de milieu équiva<strong>le</strong>nt la cinquième<br />
année, alors que <strong>le</strong>s progrès sont rapides et <strong>le</strong>s écarts importants en CP et que, dans<br />
<strong>le</strong>s autres classes, <strong>le</strong>s situations sont variab<strong>le</strong>s. La situation est encore différente selon<br />
<strong>le</strong>s dimensions prises en compte : en matière de phrases réussies, en CM , <strong>le</strong>s élèves<br />
« Freinet » sont immédiatement très supérieurs à ceux de milieu équiva<strong>le</strong>nt et <strong>le</strong>urs résultats<br />
approchent ou sont égaux à ceux de milieux plus favorisés ; la supériorité existe aussi pour<br />
un certain nombre de dimensions que j’ai intégrées dans <strong>le</strong>s problèmes textuels mais sans<br />
que <strong>le</strong> démarrage soit aussi rapide ou sans que <strong>le</strong>s résultats avoisinent ceux des élèves de<br />
milieu plus favorisé (erreurs liées aux « plans » textuels). Les résultats sont enfin différents<br />
selon <strong>le</strong>s catégories d’écrits (récits sollicitant <strong>le</strong> vécu ou l’imaginaire, descriptions ou<br />
0 Et non d’un agglomérat de composantes.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
exercices) et selon <strong>le</strong>s situations : courantes, mises en place par <strong>le</strong>s chercheurs, attachées<br />
aux évaluations nationa<strong>le</strong>s… On voit donc comment toute approche globalisante défierait la<br />
plus élémentaire prudence.<br />
Je m’en tiendrai donc à quelques remarques à prendre plus comme des ouvertures de débats<br />
et de recherches à approfondir, que comme des conclusions figées. J’avancerai ainsi que<br />
<strong>le</strong>s performances en matière de syntaxe me paraissent un point fort dans <strong>le</strong>s effets de cette<br />
pédagogie (en relation sans doute avec l’insistance des maîtres sur la ponctuation, l’usage<br />
de l’ordinateur, <strong>le</strong>s publications…), ce que confirment <strong>le</strong>s évaluations institutionnel<strong>le</strong>s avec<br />
cependant une supériorité dans l’usage en situation de production d’écrits par rapport aux<br />
situations plus classiques d’exercices (cf. Daunay, 00 , et Hassan, 00 ). Cela peut donc,<br />
selon <strong>le</strong>s cadres théoriques de chacun et au vu des exigences institutionnel<strong>le</strong>s et / ou des<br />
conceptions de la discipline, être estimé plus ou moins satisfaisant.<br />
Il est aussi net que l’orthographe des élèves « Freinet » s’améliore même si, en CM , cela a<br />
pris plus de temps, que <strong>le</strong>s écarts avec <strong>le</strong>s autres élèves de milieu équiva<strong>le</strong>nt sont plus réduits<br />
et qu’en cinquième année cela s’est fait au détriment d’autres dimensions. Néanmoins,<br />
il est indéniab<strong>le</strong> que, dans ses fonctionnements « normaux », ce M.T.P. arrive, avec de<br />
tels élèves, à développer la production d’écrits dans toutes ses dimensions, y compris<br />
l’orthographe, même si c’est selon des rythmes différents. C’est, en l’occurrence, d’autant<br />
plus remarquab<strong>le</strong> que la longueur des écrits s’accroît et tend à excéder celui des autres<br />
éco<strong>le</strong>s, que <strong>le</strong> nombre des élèves augmente, que <strong>le</strong>s risques pris dans <strong>le</strong>s choix <strong>le</strong>xicaux<br />
et syntaxiques sont importants et que ces progrès s’accomplissent avec une dispersion<br />
moindre des résultats que dans d’autres classes .<br />
Conséquemment, si l’on peut sans doute dire que, par certains côtés, <strong>le</strong>s effets du M.T.P. sont<br />
moindres (ou plus <strong>le</strong>nts) sur cette dimension que sur d’autres, on pourrait éga<strong>le</strong>ment avancer,<br />
en rapportant ces résultats au temps pendant <strong>le</strong>quel l’enseignement de l’orthographe est isolé<br />
des autres activités, que ce M.T.P. s’avère réel<strong>le</strong>ment efficace sans que ce soit au détriment<br />
d’autres dimensions ou d’autres activités comme c’est <strong>le</strong> cas dans des fonctionnements plus<br />
classiques. Et, pour ajouter encore de la comp<strong>le</strong>xité aux réf<strong>le</strong>xions proposées, je noterai<br />
que c’est peut-être en matière d’orthographe que <strong>le</strong>s principes pédagogiques de base de<br />
ce M.T.P. (cf. infra, <strong>le</strong> premier chapitre) sont <strong>le</strong> moins mis en œuvre, au moins en ce qui<br />
concerne créativité, recherches et individuation . Dès lors, même si on est plutôt sur des<br />
positions critiques, la question se pose de savoir si <strong>le</strong>s résultats que l’on estime mitigés sont<br />
dus à un excès ou à un déficit de pédagogie « Freinet ».<br />
Comment conclure un tel chapitre, si ce n’est en réaffirmant <strong>le</strong> caractère positif des résultats<br />
présentés : progrès dans toutes <strong>le</strong>s situations et pour toutes <strong>le</strong>s catégories d’écrits prises en<br />
compte, performances dépassant sur la quasi-totalité des indicateurs retenus cel<strong>le</strong> des élèves<br />
de milieu équiva<strong>le</strong>nt et réduisant <strong>le</strong>s écarts, voire dans certains cas égalant <strong>le</strong>s performances<br />
des élèves de milieux plus favorisés. Ces résultats sont d’autant plus remarquab<strong>le</strong>s qu’ils<br />
manifestent la résolution de problèmes récurrents dans <strong>le</strong>s productions de milieu populaire,<br />
tels qu’ils sont analysés dans la littérature théorique existante. Ainsi, <strong>le</strong> développement des<br />
écrits ne s’effectue pas au détriment du second plan textuel ou l’implication ne se réalise<br />
pas en défaveur du contrô<strong>le</strong> textuel. De surcroît, <strong>le</strong>s entretiens confirment la réf<strong>le</strong>xivité<br />
de ces élèves. S’il existe sans doute des variations, selon <strong>le</strong>s années, <strong>le</strong>s classes ou <strong>le</strong>s<br />
Ce qui peut être interprété, entre autres, comme un effet de la coopération et du fait qu’aucun élève<br />
n’est laissé pour compte.<br />
Cela demeure en revanche <strong>le</strong> cas pour la coopération et la réf<strong>le</strong>xivité (voir, par exemp<strong>le</strong>, la dictée<br />
coopérative).<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
dimensions, cela n’oblitère en rien ce bilan : ce M.T.P., tel qu’il est mis en place dans cette<br />
éco<strong>le</strong> et pour ces élèves, produit des effets indéniab<strong>le</strong>ment intéressants.<br />
On peut sans doute, ainsi que je <strong>le</strong> signalais dans la partie consacrée à la méthodologie,<br />
discuter ces résultats en critiquant <strong>le</strong>s choix ayant présidé à <strong>le</strong>ur production. Il n’en demeure<br />
pas moins que <strong>le</strong>s analyses ont porté sur six ans, ont concerné écrits et entretiens,<br />
ont pris en compte cinq dimensions textuel<strong>le</strong>s au travers de plus d’une centaine d’indicateurs<br />
et entrent en congruence avec <strong>le</strong>s analyses de recueils de données institutionnels et <strong>le</strong>s<br />
études menées dans d’autres domaines que celui de l’écrit. Ceci ne garantit rien mais<br />
prévient au moins de toute critique trop hâtive.<br />
J’ai enfin tenté de montrer en quoi <strong>le</strong>s performances analysées peuvent être mises en<br />
relation avec l’univers de l’écrit instauré, pris comme actualisation spécifique de ce M.T.P.,<br />
et notamment en quoi cela pouvait éclairer non seu<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s dimensions « formel<strong>le</strong>s » mais<br />
aussi la sé<strong>le</strong>ction des contenus et de <strong>le</strong>ur mode de mise en scène ainsi que la fécondité de<br />
<strong>le</strong>urs interactions. Ainsi en est-il, par exemp<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> cas de la description, pour l’articulation<br />
entre sujet individuel ou col<strong>le</strong>ctif ou, dans <strong>le</strong> cas des récits sollicitant <strong>le</strong> vécu, pour la position<br />
d’agent autonome privilégiée par <strong>le</strong>s élèves « Freinet ».<br />
Tous ces éléments me paraissent en tout cas confirmer que l’on est bien en présence d’un<br />
M.T.P. cohérent et puissant. En cela réside sans doute à la fois sa force et sa faib<strong>le</strong>sse puisqu’il<br />
semb<strong>le</strong> diffici<strong>le</strong> d’envisager <strong>le</strong> maintien de tels effets en isolant tel<strong>le</strong> ou tel<strong>le</strong> dimension pour<br />
l’intégrer dans un autre M.T.P., même si, nombre de principes (fréquence, diversification<br />
fonctionnel<strong>le</strong>, dispositifs évaluatifs, traitement de l’erreur…) seraient susceptib<strong>le</strong>s d’améliorer<br />
certains fonctionnements classiques.<br />
Mais cela reste à étudie plus précisément…<br />
Éléments bibliographiques<br />
Baudelot C., Lec<strong>le</strong>rcq F., dir. ( 00 ), Les effets de l’éducation, Paris, La Documentation<br />
française.<br />
Bishop M.F. ( 00 ), Les écritures de soi à l’éco<strong>le</strong> primaire de 18 0 à 2004. Place, fonctions<br />
et enjeux, Thèse de Doctorat, Université Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong> – Lil<strong>le</strong> III.<br />
Bru M., Altet M., Blanchard-Lavil<strong>le</strong> C. ( 00 ), « À la recherche des processus caractéristiques<br />
des pratiques enseignantes dans <strong>le</strong>urs rapports aux apprentissages », Revue Française de<br />
Pédagogie, n° , Évaluer et comprendre <strong>le</strong>s effets des pratiques pédagogiques, juil<strong>le</strong>t<br />
– août – septembre, - .<br />
Clanche P. ( ), « Le monde à l’envers : pédagogie du Français et traitement de la<br />
consigne en classe de seconde », Revue Française de Pédagogie, n° , - .<br />
Clanche P. ( ), L’enfant écrivain. Génétique et symbolique du texte libre, Paris, Éditions<br />
du Centurion.<br />
Clanche P. ( ), « L’enfant de neuf ans, <strong>le</strong> réel et l’imaginaire », Cahiers Binet-Simon,<br />
, Lire et écrire l’imaginaire à l’éco<strong>le</strong>, Toulouse, ERES, - .<br />
Daunay B. ( 00 ), « Langue et métalangage : comparaison des compétences dans deux<br />
éco<strong>le</strong>s aux modes de travail pédagogique différents », dans REUTER Y., dir. ( 00 ), Effets<br />
d’un mode de travail pédagogique « Freinet » en REP., Rapport de recherche remis à l’<strong>IUFM</strong><br />
du Nord-Pas de Calais.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Delcambre I., Lahanier-Reuter D. ( 00 ), « Propositions pour une étude sur <strong>le</strong>s méthodes<br />
de recherche en didactique », Les cahiers THEODILE, n° , Université Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong><br />
– Lil<strong>le</strong> III, – .<br />
Deschildt S. ( 00 ), L’écriture de récits sollicitant l’imaginaire au CM2, Mémoire de DEA en<br />
Sciences de l’Éducation, Université Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong> – Lil<strong>le</strong> III.<br />
Fabre-Cols C. ( 000), Apprendre à lire des textes d’enfants, Bruxel<strong>le</strong>s, De Bœck-Duculot.<br />
Fayol M. ( ), « La distanciation dans <strong>le</strong> langage : l’exemp<strong>le</strong> du calcul de l’origine dans <strong>le</strong><br />
récit d’expériences », Enfances, n° , - .<br />
Fayol M. ( ), Le récit et sa construction, Lausanne, Delachaux et Niestlé.<br />
Giguere J. ( 00 ), « Les cahiers et classeurs et la construction de l’image de la discipline à<br />
l’éco<strong>le</strong> primaire », Actes du Colloque Construction des connaissances et langage dans <strong>le</strong>s<br />
disciplines d’enseignement, Bordeaux, - avril 00 , CD Rom.<br />
Giguere J. ( 00 a), « Influence de la pédagogie Freinet sur <strong>le</strong>s conceptions des relations<br />
<strong>le</strong>cture-écriture chez <strong>le</strong>s élèves du CP au CM », dans Y. Reuter, dir. ( 00 b), Démarches<br />
pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire, Rapport de recherche de l’ERTe 0 , 00 -<br />
00 , remis à la Direction de la Recherche du Ministère de l’Éducation, juil<strong>le</strong>t, - .<br />
Giguere J. ( 00 b), « L’univers de l’écrit à l’éco<strong>le</strong> primaire : comparaison de trois modes de<br />
travail pédagogique » (pédagogie Freinet, pédagogie par projet, pédagogie « classique »),<br />
dans Y. Reuter, dir : Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire (2002-200 ),<br />
Rapport de recherche de l’ERTe 0 , <strong>tome</strong> , – .<br />
Giguere J. et Reuter Y. ( 00 ), « Présentation d’une gril<strong>le</strong> d’analyse de l’univers de l’écrit à<br />
l’éco<strong>le</strong> primaire », Les cahiers THEODILE, n° , 0 – .<br />
Hassan R. ( 00 ), « Évaluations nationa<strong>le</strong>s en CE et e : évolutions, mises en perspectives,<br />
problèmes », dans Y. Reuter, dir. ( 00 b) : Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec<br />
scolaire, Rapport de recherche de l’ERTe 0 , remis à la Direction de la Recherche du<br />
Ministère de l’Éducation.<br />
Hassan R. ( 00 ), « Protoco<strong>le</strong>s d’évaluations nationa<strong>le</strong>s en CE et e et évolution des<br />
résultats des élèves de l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher » dans Y. Reuter, dir. ( 00 ), Effets d’un<br />
mode de travail pédagogique « Freinet » en REP, Rapport de recherche de l’ERTe 0 ,<br />
remis à l’<strong>IUFM</strong> du Nord-Pas de Calais.<br />
Humbert-Prudhomme C. ( 00 ), Écrire des récits imaginaires au CM2. Analyse de<br />
productions et d’entretiens, Mémoire de maîtrise en Sciences de l’Éducation, Université<br />
Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong> – Lil<strong>le</strong> .<br />
Humbert-Prudhomme C. ( 00 ), Les récits sollicitant <strong>le</strong> vécu. Analyse de productions<br />
d’élèves au CM 2, Mémoire de Master , Sciences de l’Éducation, Université Char<strong>le</strong>s-de-<br />
Gaul<strong>le</strong> – Lil<strong>le</strong> .<br />
Kaïci A. ( ), La pratique de la rédaction au cyc<strong>le</strong> d’observation des collèges. Analyse<br />
des effets de quelques modes de sollicitation à l’écriture des élèves en échec. Thèse de<br />
Doctorat, Université de Bordeaux .<br />
Kaïci A. ( ), « L’histoire d’un enfant perdu », Cahiers Binet-Simon, n° , Lire et écrire<br />
l’imaginaire à l’éco<strong>le</strong>, Toulouse, ERES, - .<br />
Labov W. ( ), Le par<strong>le</strong>r ordinaire, Paris, Éditions de Minuit.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Lahire B. ( ), Culture et inégalités scolaires, Lyon, Presses Universitaire de Lyon.<br />
Lammertyn P. ( ), Écrire un récit imaginaire au CM2. Analyse des difficultés et des<br />
stratégies des élèves, Mémoire de Maîtrise, Université Char<strong>le</strong>s – de – Gaul<strong>le</strong> – Lil<strong>le</strong> .<br />
Lammertyn P. ( 000), La sollicitation de l’imaginaire dans l’écriture des récits : intérêts et<br />
problèmes, Repères, n° , Diversité narrative, Paris, INRP, - .<br />
Lesne M. ( ), Travail pédagogique et formation d’adultes, Paris, Presses Universitaires<br />
de France.<br />
Reuter Y. ( 000), La description. Des théories à l’enseignement apprentissage, Paris, ESF.<br />
Reuter Y. ( 00 ), « Les représentations de la discipline ou la conscience disciplinaire », La<br />
Lettre de la DFLM., n° , - .<br />
Reuter Y. ( 00 a), « Les principes de fonctionnement de l’éco<strong>le</strong> “Freinet” » dans Reuter<br />
Y., dir : Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire, Rapport de recherche de<br />
l’ERTe 0 ( 00 - 00 ), remis à la Direction de la Recherche du Ministère de l’Éducation,<br />
juil<strong>le</strong>t, - .<br />
Reuter Y. ( 00 b), « La production de textes », dans Reuter Y., dir : Démarches pédagogiques<br />
et lutte contre l’échec scolaire, Rapport de recherche de l’ERTe 0 ( 00 - 00 ), remis à<br />
la Direction de la Recherche du Ministère de l’Éducation, juil<strong>le</strong>t, - .<br />
Reuter Y. ( 00 ), « Les récits sollicitant <strong>le</strong> vécu au CM . Éléments d’analyse et de<br />
comparaison », Repères, n° , Écritures de soi et enseignement, Paris, INRP.<br />
Reuter Y. dir. ( a), La description. Théories, recherches, formation, enseignement,<br />
Vil<strong>le</strong>neuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion.<br />
Reuter Y. dir. ( b), Pratiques, n° , La description, septembre.<br />
Reuter Y. dir. ( 00 a), Pédagogie du projet et didactique du français. Penser et débattre<br />
avec Francis Ruellan, Vil<strong>le</strong>neuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion.<br />
Reuter Y., dir. ( 00 b) : Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire, Rapport<br />
de recherche de l’ERTE 0 ( 00 - 00), remis à la Direction de la Recherche du Ministère<br />
de l’Éducation, juil<strong>le</strong>t.<br />
Reuter Y., Carra C., ( 00 ), « Analyser un mode de travail pédagogique “alternatif ” :<br />
l’exemp<strong>le</strong> d’un groupe scolaire travaillant en pédagogie “ Freinet”, Revue Française de<br />
Pédagogie, n° , Décrire, analyser, évaluer <strong>le</strong>s pédagogies nouvel<strong>le</strong>s, octobre – novembre<br />
– décembre, - .<br />
Revue française de pédagogie, ( 00 ) : Évaluer et comprendre <strong>le</strong>s effets des pratiques<br />
pédagogiques, n° , Paris, INRP.<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Les entretiens du matin en maternel<strong>le</strong> :<br />
données complémentaires<br />
Isabel<strong>le</strong> DELCAMBRE<br />
Professeur des universités<br />
Université de Lil<strong>le</strong> III<br />
THEODILE<br />
L’observation des séances de langage qui se présentent comme première activité de la<br />
journée scolaire en maternel<strong>le</strong>, nommées rituels ou entretiens ou moments de langage,<br />
etc., est ici menée de manière à faire apparaître la structure de communication de ces<br />
moments de langage et de manière à interroger <strong>le</strong>s variations que peut subir <strong>le</strong> dialogue<br />
scolaire, cependant organisé de manière col<strong>le</strong>ctive, avec une présence constante de<br />
l’enseignante, qui accompagne <strong>le</strong>s interventions des élèves, fait progresser la situation d’un<br />
thème à un autre, clôt <strong>le</strong>s échanges, valide ou invalide <strong>le</strong>s réponses des élèves, etc. Les<br />
caractéristiques du dialogue scolaire (« polylogue inégal ritualisé », selon Bouchard, )<br />
ne sont pas toujours aussi prégnantes que l’on croit et l’une des questions que pose l’analyse<br />
détaillée des corpus recueillis en situation de classe est l’identification de ces variations et la<br />
recherche des raisons qui peuvent <strong>le</strong>s expliquer.<br />
Par ail<strong>le</strong>urs, la construction, à des fins de recherche, d’un échantillon de classes avait, lors<br />
de la première recherche, confronté quatre classes de l’éco<strong>le</strong> Freinet (trois classes de petits/<br />
moyens, une classe de grands) et une seu<strong>le</strong> classe (Moyenne section) située dans une éco<strong>le</strong><br />
proche mais ne pratiquant pas la pédagogie Freinet. Quatre nouveaux enregistrements ont<br />
été recueillis dans une autre éco<strong>le</strong> proche, présentant la même population scolaire, dans une<br />
même classe de Moyens/grands, afin d’équilibrer <strong>le</strong>s comparaisons, qui restent néanmoins<br />
déséquilibrées en quantité de prises de données dans chaque classe, mais surtout afin<br />
d’interroger <strong>le</strong>s clivages entre pédagogies qui courent <strong>le</strong> risque d’une certaine stéréotypie<br />
si <strong>le</strong>s éléments à comparer ne reflètent pas suffisamment la diversité des pratiques réel<strong>le</strong>s<br />
des enseignants. L’analyse des corpus recueillis dans cette nouvel<strong>le</strong> classe (classe F)<br />
alimentera certaines parties du texte ci-dessous, mais toujours avec <strong>le</strong> souci de reprendre<br />
<strong>le</strong>s résultats précédents pour élargir la comparaison et d’identifier des formes de variation<br />
dans <strong>le</strong>s classes Freinet et non Freinet.<br />
Les quatre nouveaux corpus seront soumis aux mêmes questions que précédemment<br />
(structure de la communication scolaire, ritualisation des prises de paro<strong>le</strong>, instauration de<br />
rô<strong>le</strong>s de locuteurs/questionneurs, autonomie des élèves par<strong>le</strong>urs par rapport aux interventions<br />
de la maîtresse, etc.). Le discours de la maîtresse, interrogée suite aux enregistrements,<br />
sera éga<strong>le</strong>ment utilisé loca<strong>le</strong>ment lorsqu’il sera nécessaire pour identifier ses objectifs<br />
d’apprentissage et d’enseignement ou interroger sa « conscience didactique » (Delcambre,<br />
Daunay, 00 ).<br />
Après une description globa<strong>le</strong> des vingt séances observées (plus de sept heures<br />
d’enregistrement), nous présenterons <strong>le</strong>s formes que prennent certaines des variations du<br />
dialogue scolaire en <strong>le</strong>s référant aux contenus programmé des activités.<br />
1. Caractérisation pédagogique des séances observées<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
1.1. L’entretien du matin, un genre scolaire ?<br />
Les vingt corpus recueillis dans <strong>le</strong>s quatre classes de l’éco<strong>le</strong> Freinet et <strong>le</strong>s classes issues de<br />
deux éco<strong>le</strong>s non Freinet présentent une caractéristique commune : ce sont des moments de<br />
regroupement des élèves autour d’une activité col<strong>le</strong>ctive où <strong>le</strong> langage fait <strong>le</strong> lien entre une<br />
activité individuel<strong>le</strong> et une situation col<strong>le</strong>ctive d’écoute, où <strong>le</strong> lieu commun d’interventions<br />
construit par l’enseignant est aussi un lieu de développement d’une paro<strong>le</strong> individuel<strong>le</strong> et<br />
d’interactions possib<strong>le</strong>ment multip<strong>le</strong>s entre élève et enseignant ou entre élèves et élèves,<br />
mais toujours sous <strong>le</strong> regard de tous. Le contenu et l’organisation de ces activités sont décrits<br />
ci-dessous, mais il nous semb<strong>le</strong> intéressant, pour démarrer, d’interroger <strong>le</strong>s noms donnés<br />
par <strong>le</strong>s institutrices à ces moments de classe. Les maîtresses de l’éco<strong>le</strong> Freinet désignent<br />
toutes ces moments par <strong>le</strong> terme « entretien » qui semb<strong>le</strong> être un terme qui peut alterner avec<br />
celui de « regroupement », « quoi de neuf ? » « moment de langage » ou « présentation »<br />
mais qu’el<strong>le</strong>s ont choisi pour se différencier du « quoi de neuf » plus caractéristique peutêtre<br />
de ce qui se passe à l’éco<strong>le</strong> élémentaire. Les activités qui s’y dérou<strong>le</strong>nt sont clairement<br />
identifiées comme spécifiques à ce moment (Delcambre, 00 c) distingué par la maîtresse<br />
D comme distinct des « activités de classe ». Les deux maîtresses non-Freinet n’utilisent<br />
pas de terme spécifique pour décrire <strong>le</strong>s situations observées dans <strong>le</strong>ur classe : l’une par<strong>le</strong><br />
de « séquence » en associant ce terme à l’expression « échange col<strong>le</strong>ctif », l’autre par<strong>le</strong> de<br />
séquence ou de séance. El<strong>le</strong>s n’utilisent pas spontanément <strong>le</strong> terme de rituel.<br />
Le rituel, tel qu’il est identifié dans la tradition de l’enseignement en maternel<strong>le</strong> (cf. <strong>le</strong>s exemp<strong>le</strong>s<br />
de rituel autour de l’appel que l’on trouve illustré dans <strong>le</strong>s documents d’accompagnement<br />
des programmes publiés en 00 ) est mis à distance par <strong>le</strong>s institutrices de l’éco<strong>le</strong> Freinet.<br />
El<strong>le</strong>s disent explicitement <strong>le</strong> refuser avec l’argument que la répétition des rituels (autour de<br />
la météo, de la date) n’engendre pas de plaisir (entretien avec la maîtresse de la classe D)<br />
à la différence d’une autre activité rituel<strong>le</strong> pratiquée par cette maîtresse, <strong>le</strong> regroupement<br />
autour d’une chanson accompagnée à la guitare par la maîtresse el<strong>le</strong>-même. Le rituel de la<br />
date peut cependant être pratiqué et considéré comme intéressant par une autre maîtresse<br />
de cette même éco<strong>le</strong> (classe E).<br />
Cependant, <strong>le</strong>s activités menées dans <strong>le</strong>s entretiens du matin sont souvent présentées<br />
comme rituel<strong>le</strong>s ou ritualisées : c’est <strong>le</strong> cas des chansons, accompagnées ou non de la<br />
guitare (classe A et D), du questionnement qui fait suite aux présentations (classe E), de<br />
l’aimant qui se déplace au tab<strong>le</strong>au <strong>le</strong> long de la liste des élèves inscrits pour faire une<br />
présentation (classe D) : il y a bien des activités ritualisées, et perçues comme tel<strong>le</strong>s par <strong>le</strong>s<br />
maîtresses, mais il y a chez el<strong>le</strong>s tout autant un refus d’une structure qui s’appel<strong>le</strong>rait ainsi.<br />
Le terme entretien semb<strong>le</strong> faire consensus entre el<strong>le</strong>s (réunion à l’éco<strong>le</strong>, octobre 00 ),<br />
il marque <strong>le</strong> caractère langagier et discursif de la situation, la maîtresse B disant parfois<br />
qu’el<strong>le</strong> « s’entretient » avec <strong>le</strong>s élèves.<br />
Dans la classe F de l’éco<strong>le</strong> Provinces, de même, des activités sont nommées par la maîtresse<br />
comme habituel<strong>le</strong>s : l’anniversaire du jour, la « comptine des jours », expression qui désigne<br />
l’établissement de la date, etc.<br />
Ces quelques remarques peuvent s’achever sur <strong>le</strong>s réf<strong>le</strong>xions suivantes : <strong>le</strong> terme de rituel<br />
ne semb<strong>le</strong> pas avoir la faveur des enseignantes, quel<strong>le</strong> que soit l’éco<strong>le</strong> où el<strong>le</strong>s enseignent.<br />
El<strong>le</strong>s mettent bien en place, cependant, des activités qui se répètent, et dont la fonction<br />
doit être interrogée. À côté d’une fonction pédagogique classique, répéter pour apprendre,<br />
<strong>le</strong>s phénomènes ritualisés renvoient à l’institutionnalisation de rô<strong>le</strong>s et de places. Le rituel<br />
selon Bourdieu ( ) est un « acte d’institution » qui rend visib<strong>le</strong> une ligne de démarcation<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
(plus qu’il ne signifie un passage). C’est un « acte de communication » qui « signifie » à<br />
quelqu’un son identité, au sens où il la verbalise et où il la lui impose, au vu de tous, avec<br />
autorité. Dans <strong>le</strong> rituel, l’individu apprend « ce qu’il est et ce qu’il a à être ». Les quelques<br />
moments où, dans <strong>le</strong>s entretiens, <strong>le</strong>s maîtresses par<strong>le</strong>nt de manière explicite des séances<br />
enregistrées, permettent de dire que ces deux fonctions (apprendre et instituer une<br />
identité) sont diversement représentées selon <strong>le</strong>s classes : la maîtresse de la classe F (non<br />
Freinet) est plus sensib<strong>le</strong> aux pré-apprentissages que <strong>le</strong>s regroupements col<strong>le</strong>ctifs peuvent<br />
permettre ; <strong>le</strong>s maîtresses Freinet sont plus centrées sur la construction d’une identité<br />
d’élève communiquant (<strong>le</strong> rituel de la présentation et du questionnement), inscrit dans un<br />
ordre col<strong>le</strong>ctif explicite et col<strong>le</strong>ctivement géré (<strong>le</strong> rituel de l’aimant ou celui de l’inscription<br />
préalab<strong>le</strong> des élèves qui veu<strong>le</strong>nt présenter quelque chose), et susceptib<strong>le</strong> de plaisir… Quant<br />
à la maîtresse de la classe C, <strong>le</strong>s séances qu’el<strong>le</strong> a données à voir étant de statut différent<br />
des entretiens ou rituels, <strong>le</strong>s observations menées chez el<strong>le</strong> ne peuvent guère être utilisées<br />
à ce moment de l’analyse.<br />
Ces différences entre <strong>le</strong>s rituels observés renvoient aussi à une différence de conscientisation<br />
chez <strong>le</strong>s maîtresses des fonctions et des fonctionnements des activités scolaires : <strong>le</strong>s<br />
maîtresses Freinet ont construit un discours sur <strong>le</strong>urs pratiques bien plus explicite que la<br />
maîtresse de la classe F qui dit, en tout début d’interview, avoir du mal à préciser quels sont<br />
<strong>le</strong>s objectifs qu’el<strong>le</strong> poursuit avec <strong>le</strong>s rituels (alors qu’ils sont bien évidemment identifiab<strong>le</strong>s<br />
dans sa mise en œuvre des séances). L’explicitation par <strong>le</strong>s enseignantes de <strong>le</strong>urs pratiques<br />
d’enseignement renvoie à ce qui avait été nommé « conscience didactique » dans Delcambre,<br />
Daunay ( 00 ) et qui désignait alors l’identification de contenus quasi-disciplinaire dans <strong>le</strong><br />
discours des enseignantes sur <strong>le</strong>ur pratiques. Ce qui est visé ne touche pas précisément à<br />
des contenus d’activités qui spécifieraient <strong>le</strong>s entretiens du matin, mais plus largement à la<br />
prise de conscience de la situation en tant que tel<strong>le</strong>, de ses fonctions et fonctionnements,<br />
mais <strong>le</strong> degré d’explicitation dans <strong>le</strong> discours de maîtresses Freinet est de même nature.<br />
Si l’entretien du matin (à Freinet) peut être considéré comme un genre scolaire, c’est<br />
vraisemblab<strong>le</strong>ment qu’il associe de manière explicite une organisation discursive spécifique<br />
(l’alternance de présentations et de questionnements) et une fonction culturel<strong>le</strong> : instituer un<br />
sujet élève dans une communauté scolaire articulée au monde familial, comme <strong>le</strong> montre<br />
l’importance accordée à la présentation d’objets apportés de la maison, et/ou centrée autour<br />
d’apprentissages marqués par la réf<strong>le</strong>xivité, comme <strong>le</strong> montrent <strong>le</strong>s présentations de travaux<br />
associées à l’explication des procédures suivies.<br />
2. Structures de la communication scolaire<br />
Pour caractériser la communication et <strong>le</strong>s formes qu’el<strong>le</strong> prend dans <strong>le</strong>s moments de langage<br />
recueillis, seront observés successivement la durée des entretiens et <strong>le</strong> rythme des échanges<br />
(en comparant <strong>le</strong>s vingt séances), cette mesure n’ayant pas été effectuée lors du précédent<br />
rapport. Puis nous décrirons de manière synthétique <strong>le</strong>s phénomènes de ritualisation de<br />
la paro<strong>le</strong> selon <strong>le</strong>s différentes classes Freinet et non Freinet. Enfin, nous analyserons <strong>le</strong>s<br />
quatre derniers corpus recueillis selon l’axe de l’autonomie de la paro<strong>le</strong> de l’élève, mesure<br />
déjà effectuée pour <strong>le</strong> précédent rapport et qui donne un aperçu des formes de contrô<strong>le</strong><br />
de l’enseignant sur <strong>le</strong> dialogue col<strong>le</strong>ctif et de ce qu’on pourrait appe<strong>le</strong>r la productivité des<br />
interventions des élèves. Les résultats obtenus permettront une comparaison avec <strong>le</strong>s<br />
résultats de l’enquête précédente.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
2.1. Durée des séances<br />
La durée moyenne des entretiens est d’environ minutes (cf. tab<strong>le</strong>au ). Sur <strong>le</strong>s vingt<br />
entretiens enregistrés, la dispersion est très importante, puisque <strong>le</strong> plus court dure minutes<br />
(n° ) et <strong>le</strong>s deux plus longs et minutes (respectivement n° 0 et ).<br />
Année Mois<br />
Numéro<br />
corpus<br />
Éco<strong>le</strong> et classe Durée en mn<br />
Année oct 0 Freinet B<br />
Année oct 0 Freinet B<br />
Année oct 0 Freinet A<br />
Année oct 0 Freinet A<br />
Année juin 0 Freinet B<br />
Année juin 0 Freinet A<br />
Année janv 0 Freinet B<br />
Année juin 0 Freinet B<br />
Année janv 0 Freinet A 0<br />
Année juin 0 Freinet A<br />
Année janv Montaigne C<br />
Année juin Montaigne C<br />
Année janv Freinet D<br />
Année janv Freinet D<br />
Année janv Freinet E<br />
Année janv Freinet E<br />
Année janv Provinces F<br />
Année janv Provinces F<br />
Année janv Provinces F<br />
Année janv 0 Provinces F<br />
Moyenne , 0<br />
Tab<strong>le</strong>au 1 Durée des entretiens<br />
Les entretiens <strong>le</strong>s plus longs (au-dessus de la durée moyenne) ont été enregistrés dans <strong>le</strong>s<br />
classes non Freinet (C et F), dans <strong>le</strong>s deux classes Freinet observées la e année (D et E)<br />
et dans deux des séances provenant d’une des petites sections Freinet la deuxième année<br />
(classe B).<br />
Une même classe de Petits/moyens Freinet (classe A) se situe toujours en dessous de cette<br />
moyenne de minutes, avec cependant une augmentation du temps la seconde année<br />
(el<strong>le</strong> passe de mn à mn en moyenne).<br />
On peut observer éga<strong>le</strong>ment, dans <strong>le</strong>s deux classes Freinet A et B, dès la première année<br />
d’observation, un allongement de la durée des entretiens à la fin de l’année (corpus à<br />
vs corpus et ).<br />
Ces phénomènes d’allongement de la durée des entretiens du matin tiennent probab<strong>le</strong>ment<br />
à la fois à l’aisance dans la prise de paro<strong>le</strong> des élèves (cas de la première année, entre<br />
octobre et juin), à l’aisance des enseignantes dans la gestion pédagogique de ces moments<br />
(cas de la classe B qui augmente très nettement <strong>le</strong> temps alloué à cette situation entre la<br />
première et la deuxième année), aux choix et aux objectifs pédagogiques : <strong>le</strong>s maîtresses<br />
non Freinet accordent apparemment une fonction particulière à ces moments, c’est chez<br />
el<strong>le</strong>s que se trouvent <strong>le</strong>s trois entretiens <strong>le</strong>s plus longs (n° , , 0) : l’une d’entre el<strong>le</strong>s<br />
avait ainsi insisté sur la place à laisser à l’expression des élèves (classe C), l’autre dit se<br />
Pour plus de lisibilité des résultats, <strong>le</strong>s moyennes et pourcentages sont arrondis à la moitié inférieure<br />
ou supérieure selon <strong>le</strong>s cas.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
soumettre à ce que <strong>le</strong>s élèves ont envie de dire (classe F).<br />
Globa<strong>le</strong>ment, on peut dire que toutes <strong>le</strong>s classes (Freinet et non Freinet) se caractérisent<br />
par une durée moyenne ou longue (de à minutes), à l’exception d’une classe Freinet<br />
(la classe A) et des observations menées dans <strong>le</strong>s petites sections la première année de<br />
l’expérience.<br />
2.2. Rapidité des échanges<br />
La seconde observation intéressante à faire est cel<strong>le</strong> de la rapidité des échanges : plus <strong>le</strong><br />
nombre de tours de paro<strong>le</strong> (TP) par minute est é<strong>le</strong>vé, plus <strong>le</strong>s échanges maître/élèves sont<br />
brefs. La moyenne se situant aux a<strong>le</strong>ntours de TP/minute, je me contenterai de souligner<br />
<strong>le</strong>s cas où <strong>le</strong> tempo se ra<strong>le</strong>ntit, ce qui indique des prises de paro<strong>le</strong> plus longues (sans que<br />
l’on sache ici si el<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong> fait de l’enseignant ou des élèves).<br />
Année Mois<br />
Numéro<br />
corpus<br />
Éco<strong>le</strong> et Classe Nbre total TP Nbre<br />
TP/mn<br />
Année oct 0 Freinet B 0 ,<br />
Année oct 0 Freinet B ,<br />
Année oct 0 Freinet A<br />
Année oct 0 Freinet A 0 ,<br />
Année juin 0 Freinet B ,<br />
Année juin 0 Freinet A ,<br />
Année janv 0 Freinet B ,<br />
Année juin 0 Freinet B ,<br />
Année janv 0 Freinet A ,<br />
Année juin 0 Freinet A ,<br />
Année janv Montaigne C ,<br />
Année juin Montaigne C ,<br />
Année janv Freinet D ,<br />
Année janv Freinet D 0 ,<br />
Année janv Freinet E ,0<br />
Année janv Freinet E 0,<br />
Année janv Provinces F ,<br />
Année janv Provinces F 0,<br />
Année janv Provinces F ,<br />
Année janv 0 Provinces F 0 ,0<br />
Moyennes , ,<br />
Tab<strong>le</strong>au 2 Rapidité des échanges<br />
Les deux séances <strong>le</strong>s plus rapides sont, la première année, cel<strong>le</strong>s du début d’année dans<br />
la classe A (corpus n° et ), déjà mentionnées comme très courtes ; <strong>le</strong>s plus <strong>le</strong>ntes sont<br />
<strong>le</strong> fait d’une maîtresse Freinet (classe D, corpus et ) et d’une maîtresse non Freinet<br />
(classe F, corpus n° et ), ce sont aussi des séances longues.<br />
Le contraste entre <strong>le</strong>s séances courtes-rapides et <strong>le</strong>s séances longues-<strong>le</strong>ntes peut renvoyer<br />
à des façons de faire des maîtresses ou à des événements particuliers aux séances<br />
enregistrées. Dans <strong>le</strong>s cas des classes A et B pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s nous avons des observations<br />
plus nombreuses, on peut constater que, pour la classe A, <strong>le</strong> rythme é<strong>le</strong>vé des séances<br />
du début de la première année ra<strong>le</strong>ntit fortement à la fin de l’année (corpus ) et l’année<br />
suivante, avec <strong>le</strong> même phénomène de ra<strong>le</strong>ntissement, cette année-là aussi entre janvier et<br />
juin (corpus et 0). On peut observer une évolution semblab<strong>le</strong>, bien que moins contrastée<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
dans la classe B. Il y a là, très vraisemblab<strong>le</strong>ment, à la fois un phénomène d’adaptation<br />
des modalités du dialogue aux élèves qui progressent dans <strong>le</strong>ur capacité langagière et/ou<br />
un phénomène d’actualisation des objectifs pédagogiques guidant plus intentionnel<strong>le</strong>ment<br />
<strong>le</strong>s pratiques de gestion du dialogue scolaire. La maîtresse de la classe F, quant à el<strong>le</strong>,<br />
présente des rythmes qui varient du simp<strong>le</strong> au doub<strong>le</strong> à quelques jours de distance : mais<br />
il est diffici<strong>le</strong> de dire si cela correspond à une évolution, <strong>le</strong>s corpus ayant été re<strong>le</strong>vés dans<br />
une période courte.<br />
À l’inverse, trois maîtresses semb<strong>le</strong>nt avoir des pratiques assez stab<strong>le</strong>s d’un jour à l’autre<br />
(classes Freinet D et E), voire même à cinq mois d’écart (classe C, non Freinet). Cette<br />
variation entre pratiques stab<strong>le</strong>s et pratiques instab<strong>le</strong>s peut s’analyser au vu des objectifs,<br />
explicites ou implicites, alloués à ces séances par <strong>le</strong>s maîtresses et/ou de <strong>le</strong>urs commentaires<br />
sur <strong>le</strong>s événements particuliers s’étant produits dans ces séances. Ainsi la maîtresse F dit<br />
s’adapter aux propositions spontanées des élèves : cela ne peut que varier d’un jour à<br />
l’autre.<br />
Globa<strong>le</strong>ment, on peut dire que ce critère identifie des sty<strong>le</strong>s d’enseignement individuels :<br />
pratiques stab<strong>le</strong>s ou instab<strong>le</strong>s, rythmes rapides ou <strong>le</strong>nts. Parmi <strong>le</strong>s pratiques stab<strong>le</strong>s à<br />
rythme plutôt rapide, se trouve la classe C (maîtresse non Freinet), parmi cel<strong>le</strong>s à rythme<br />
plutôt <strong>le</strong>nt deux classes Freinet (classes D et E).<br />
Parmi <strong>le</strong>s pratiques instab<strong>le</strong>s, on peut ranger une maîtresse non Freinet la classe F, deux<br />
maîtresses Freinet (<strong>le</strong>s classes A et B) qui ont été observées quatre à cinq fois, certes sur<br />
des temporalités différentes (A et B sur deux ans, F sur deux semaines) et à des niveaux<br />
différents (Petits/Moyens et Moyens/Grands).<br />
Ce critère n’est donc guère intéressant en soi, mais il peut contribuer à dresser un panorama<br />
plus comp<strong>le</strong>t en association avec d’autres critères (cf. ci-après).<br />
2.3. Ritualisation des prises de paro<strong>le</strong> et construction de rô<strong>le</strong>s<br />
communicationnels<br />
Les quatre maîtresses Freinet organisent <strong>le</strong>s entretiens du matin de la même manière :<br />
des élèves s’inscrivent au début de la séance pour faire une présentation à l’ensemb<strong>le</strong> de<br />
la classe regroupée autour du tab<strong>le</strong>au. Ils présentent un objet rapporté de la maison ou un<br />
travail réalisé pendant l’accueil ou <strong>le</strong>s ateliers ; ils sont institués par la maîtresse dans un rô<strong>le</strong><br />
de locuteur principal (ils changent de place et viennent s’instal<strong>le</strong>r à la place de la maîtresse)<br />
que la maîtresse par ses questions aide à investir, y compris pour des élèves très petits<br />
par<strong>le</strong>urs (voire non-par<strong>le</strong>urs dans cette situation). Puis <strong>le</strong>s élèves écouteurs sont invités à<br />
questionner <strong>le</strong> présentateur : ils sont éga<strong>le</strong>ment aidés par la maîtresse à remplir ce rô<strong>le</strong> de<br />
locuteur secondaire de manière non stéréotypée, notamment avec des exigences de varier<br />
<strong>le</strong>s questions posées, de s’adresser au locuteur principal qui doit <strong>le</strong>ur répondre, etc. Ces<br />
rô<strong>le</strong>s décrits dans Delcambre ( 00 a) sont construits dans l’énonciation répétée de règ<strong>le</strong>s<br />
ou d’interdictions dont une des plus surprenantes peut-être est <strong>le</strong> refus de l’enseignante de<br />
donner la paro<strong>le</strong> à un élève qui ne se serait pas préalab<strong>le</strong>ment « inscrit ». Cette prise de<br />
paro<strong>le</strong> est censée être préparée par l’enfant avec l’aide de ses parents, il doit avoir pensé à<br />
ce qu’il va dire. Ces moments sont pour <strong>le</strong>s maîtresses des occasions importantes de lien<br />
entre la famil<strong>le</strong> et l’éco<strong>le</strong> (Delcambre, 00 c), éga<strong>le</strong>ment à cause des photos numériques<br />
de certaines présentations qui sont collées par <strong>le</strong>s maîtresses dans <strong>le</strong> cahier de vie de la<br />
classe destiné à construire une mémoire col<strong>le</strong>ctive pour <strong>le</strong>s élèves et à informer <strong>le</strong>s parents<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
des activités de la classe.<br />
Les autres classes de maternel<strong>le</strong> observées dans <strong>le</strong>s deux autres éco<strong>le</strong>s pratiquent<br />
différemment. Nous n’avons pas à proprement par<strong>le</strong>r observé dans la classe C un entretien<br />
du matin, ni un rituel, mais une séance de langage, que nous pensons avoir été plus ou moins<br />
organisée pour satisfaire à notre demande (observer un moment de langage). Dans <strong>le</strong>s deux<br />
cas, <strong>le</strong>s élèves, installés en rond autour d’objets emmaillotés, ont été placés face à une<br />
tâche d’anticipation (de devinette) guidée par <strong>le</strong>s questions de la maîtresse, afin de parvenir<br />
à identifier l’objet dissimulé par observation-description et par formulation d’hypothèses. Les<br />
élèves ne sont chargés d’aucun rô<strong>le</strong> particulier, à part celui, traditionnel de répondeur (aux<br />
questions de la maîtresse) et d’un rô<strong>le</strong> de débal<strong>le</strong>ur lié à la tâche spécifique de ces séances<br />
(Delcambre, 00 c).<br />
Dans la classe F, nous avons observé un rituel proche de ce qu’on l’on trouve souvent<br />
dans <strong>le</strong>s études consacrées ces dernières années à cette activité (Leclaire-Halté, 00 ;<br />
Garcion-Vauthor, 00 ; Amigues et Zerbato-Poudou, 000 ou dans <strong>le</strong>s Documents<br />
d’accompagnement des Programmes publiés en avril 00 ), avec <strong>le</strong>s variantes norma<strong>le</strong>s<br />
pour une activité qui n’est pas figée dans une série de prescriptions obligatoires. Les élèves,<br />
arrivant successivement en classe, placent <strong>le</strong>ur étiquette-prénom sur un tab<strong>le</strong>au magnétique<br />
situé derrière <strong>le</strong>s bancs disposés devant <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au noir. Le rituel commence donc par une<br />
activité de numération menée col<strong>le</strong>ctivement (combien d’élèves sont absents aujourd’hui),<br />
puis par l’établissement de la date du jour, à l’aide d’étiquettes à placer/déplacer sur une<br />
frise placée au bas du tab<strong>le</strong>au (nom et date du jour, nom du mois, travail énonciatif sur<br />
<strong>le</strong> repérage dans <strong>le</strong> temps -hier, aujourd’hui, demain, etc.). Cette activité est menée par<br />
un élève différent chaque jour, dont <strong>le</strong> nom est inscrit sur un tab<strong>le</strong>au, et qui peut, de ce<br />
fait, s’y préparer. Le rituel se termine sur la présentation des ateliers qui vont suivre. Nous<br />
avons observé ces trois temps dans <strong>le</strong>s quatre séances enregistrées, nous pouvons dire<br />
qu’el<strong>le</strong>s sont réel<strong>le</strong>ment rituel<strong>le</strong>s. Cela dit, la maîtresse organise des activités langagières<br />
qui diffèrent d’un jour à l’autre : un élève annonce son anniversaire : il s’assoit devant <strong>le</strong><br />
groupe et expose comment cet événement va être fêté dans la classe et dans sa famil<strong>le</strong><br />
(corpus ) ; la maîtresse organise un travail col<strong>le</strong>ctif (à l’aide de documents issus d’un<br />
fichier conçu à cet effet) visant <strong>le</strong> repérage de différences entre deux dessins (corpus ),<br />
un élève raconte une histoire à partir de dessins collés dans son cahier (corpus ). Parfois,<br />
des micro-récits à l’initiative des élèves accompagnent tel ou tel moment (corpus : récit<br />
de la fête des rois dans <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s, du cadeau reçu à Noël ; corpus 0 : <strong>le</strong> récit de Marina<br />
qui prend la paro<strong>le</strong> pour la première fois dans cette situation col<strong>le</strong>ctive et fait un long récit<br />
d’une scène familia<strong>le</strong> « se préparer pour al<strong>le</strong>r faire des courses »). La maîtresse dira dans<br />
l’entretien mené avec el<strong>le</strong> quelques jours plus tard qu’il arrive que <strong>le</strong>s élèves arrivent de la<br />
maison avec un livre, un jouet, « quelque chose à montrer ou à raconter », mais que cela<br />
dépend des années. L’ouverture que cela traduit signifie éga<strong>le</strong>ment une absence ou un<br />
refus d’institutionnaliser une tel<strong>le</strong> pratique.<br />
Cette deuxième classe de Maternel<strong>le</strong> présente une spécificité intéressante à signa<strong>le</strong>r : une<br />
forme de prise de paro<strong>le</strong> est instituée, notamment pour <strong>le</strong>s moments de micro-récits, mais<br />
el<strong>le</strong> est la plupart du temps implicite. Les prises de paro<strong>le</strong> des élèves semb<strong>le</strong>nt spontanées à<br />
l’observateur extérieur : la maîtresse sollicite tel ou tel, au vu de ses demandes non-verba<strong>le</strong>s,<br />
il lui suffit souvent de nommer l’élève pour qu’il commence à par<strong>le</strong>r, et <strong>le</strong>s élèves enchaînent<br />
dans une succession de prises de paro<strong>le</strong>s rapides, avec une apparente reconnaissance<br />
de ce qui se joue dans ces moments, sans qu’aucune règ<strong>le</strong> soit énoncée. Les récits sont<br />
la plupart du temps adressés à la maîtresse et aucun élève n’est sollicité pour réagir à ce<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
qui a été présenté. Ce fonctionnement est à l’opposé de ce que l’on peut observer dans <strong>le</strong>s<br />
classes Freinet qui visent à institutionnaliser <strong>le</strong>s prises de paro<strong>le</strong> et qui articu<strong>le</strong>nt différents<br />
statuts de locuteurs.<br />
2.4. Contrô<strong>le</strong> du dialogue col<strong>le</strong>ctif et productivité des échanges entre élèves<br />
La question de l’autonomie de paro<strong>le</strong> des élèves, dont <strong>le</strong>s interventions sont généra<strong>le</strong>ment<br />
prises en sandwich entre deux interventions de la maîtresse avait alimenté <strong>le</strong> rapport<br />
précédent. El<strong>le</strong> renvoie à une interrogation sur la réalisation de ce modu<strong>le</strong> de base du<br />
dialogue pédagogique (question du maître/réponse de l’élève/validation du maître). Il<br />
s’agissait de voir s’il peut laisser place à une autonomisation des échanges entre élèves, et<br />
dans quel<strong>le</strong> proportion. L’idée qui sous-tend la construction de ce critère est que l’instauration<br />
d’un dialogue entre élèves permettrait de développer des aptitudes langagières, plus que<br />
<strong>le</strong> comportement de réponse aux questions de l’adulte. L’indicateur choisi est donc la<br />
proportion des échanges entre élèves, en dehors des questions de la maîtresse, autrement<br />
dit <strong>le</strong> nombre de tours de paro<strong>le</strong> pris en charge par <strong>le</strong>s élèves entre deux questions ou<br />
interventions de la maîtresse, rapporté au nombre total de tours de paro<strong>le</strong> recueillis dans<br />
chaque interaction (Delcambre, 00 b).<br />
L’étude avait porté alors sur <strong>le</strong>s classes A, B, C, D et E ; il est possib<strong>le</strong> aujourd’hui d’ajouter<br />
<strong>le</strong>s résultats de la classe F :<br />
Classe F<br />
/<br />
( %)<br />
janv janv janv 0 janv<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
/<br />
( %)<br />
/<br />
( %)<br />
/ 0<br />
( %)<br />
Tab<strong>le</strong>au 3 Les échanges entre élèves (classe F) rapportés au nombre total de tour de paro<strong>le</strong>s de<br />
l’interaction observée<br />
Ces résultats placent la classe F parmi cel<strong>le</strong>s qui instaurent un contrô<strong>le</strong> important, voire<br />
fort, sur <strong>le</strong> dialogue en classe : il y a peu d’espace pour des échanges entre élèves dans<br />
ces séances. Cela rapproche cette classe de ce qui avait été observé des classes Freinet,<br />
et la distingue nettement de l’autre classe non Freinet (la classe C) qui se caractérisait au<br />
contraire par une diminution forte de la présence de l’enseignant, au fil des observations,<br />
laissant jusqu’à % à des interactions directes entre élèves.<br />
Une deuxième observation permet d’affiner l’analyse : cel<strong>le</strong> de la forme de ces échanges<br />
entre élèves, placés dans <strong>le</strong>s interstices du dialogue organisé par la maîtresse. L’idée est<br />
d’observer à quoi sont consacrés ces échanges latéraux entre élèves. S’agit-il de forme de<br />
construction du dialogue, par reprise, ajout, reformulation, discussion, etc., ou d’énoncés<br />
parallè<strong>le</strong>s, répondant dans la même forme et de manière successive à la question de la<br />
maîtresse ? Pour ce faire, je propose <strong>le</strong>s tab<strong>le</strong>aux suivants où sont indiquées <strong>le</strong>s proportions<br />
d’énoncés répétés dans <strong>le</strong>s moments d’échanges entre élèves (Delcambre, 00 b).<br />
Classe F<br />
/<br />
janv janv janv 0 janv<br />
%<br />
/<br />
%<br />
Tab<strong>le</strong>au 4 Les échanges en parallè<strong>le</strong> rapportés au nombre d’enchaînements élèves/élèves<br />
La classe F présentent une variation importante du taux d’échanges en parallè<strong>le</strong> : de<br />
presque la moitié à à peine un dixième des échanges entre élèves. Ainsi on peut postu<strong>le</strong>r<br />
que malgré <strong>le</strong> faib<strong>le</strong> nombre de ces échanges entre élèves, <strong>le</strong> dialogue des trois dernières<br />
/<br />
%<br />
/<br />
%
séances a provoqué un petit peu plus d’initiatives individuel<strong>le</strong>s (ajouts, reformulations, etc.)<br />
ou de confrontation entre élèves que la première. Cette variation rapproche cette classe des<br />
classes C et A qui présentent une même variation importante d’une séance à l’autre de la<br />
forme des échanges entre élèves (de % à % pour la classe C et de 0% à % dans la<br />
classe A). Comme <strong>le</strong> nombre des TP concernés est souvent très petit, cela ne permet pas<br />
probab<strong>le</strong>ment de donner à ce critère un rô<strong>le</strong> important dans la caractérisation des classes,<br />
ces variations de productivité des échanges entre élèves pouvant être liés à des facteurs<br />
conjoncturels (intérêt pour <strong>le</strong> thème de discussion, événement divers retentissant sur <strong>le</strong>s<br />
confrontations entre élèves, etc.).<br />
En 00 , j’opposais <strong>le</strong>s quatre classes Freinet et la classe C en soulignant que cette dernière<br />
« se caractérise par une diminution du contrô<strong>le</strong> de l’enseignante et une augmentation de la<br />
coopération entre élèves donne l’impression de laisser aux élèves une plus grande latitude<br />
d’expression que dans <strong>le</strong>s classes A et B : <strong>le</strong> temps augmente ainsi que la paro<strong>le</strong> des élèves,<br />
la maîtresse semb<strong>le</strong> avoir laissé libre cours à l’expression des élèves, qui semb<strong>le</strong>nt s’insérer<br />
dans <strong>le</strong> dialogue de manière plus autonome » (Delcambre, 00 b).<br />
Les classes Freinet au contraire étaient caractérisées par un contrô<strong>le</strong> relativement important<br />
de la maîtresse dans la gestion du dialogue et des interventions entre élèves peu abondantes,<br />
mais plutôt productives dans <strong>le</strong> développement du dialogue.<br />
L’ajout de la classe F ne modifie guère ce panorama : à la fois el<strong>le</strong> ressemb<strong>le</strong> aux classes<br />
Freinet par l’importance de la présence de la maîtresse dans <strong>le</strong> dialogue, mais el<strong>le</strong> présente<br />
des écarts importants d’une séance sur l’autre dans la productivité de ces échanges entre<br />
élèves, ce qui met en lumière une ressemblance avec <strong>le</strong>s classes C non Freinet et A Freinet.<br />
Cela peut permettre peut-être de scinder <strong>le</strong> groupe des classes Freinet en constituant un<br />
ensemb<strong>le</strong> des classes A, C et F sur ce critère de l’importante variation des énoncés répétitifs<br />
selon <strong>le</strong>s séances, sachant que la classe C est de toute façon particulière par l’allègement<br />
de la présence verba<strong>le</strong> de la maîtresse dans la dernière séance observée, assez étonnante,<br />
mais peut-être margina<strong>le</strong>, en fin de compte.<br />
2.5. Que conclure ?<br />
Si l’on croise <strong>le</strong>s cinq critères décrits ci-dessus, il est possib<strong>le</strong> de regrouper des classes<br />
sur la base de ressemblances partagées et d’identifier <strong>le</strong>s éléments sur <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s el<strong>le</strong>s<br />
divergent.<br />
Durée de la<br />
séance<br />
Rythme des<br />
échanges<br />
Institutionnalisation<br />
du dialogue<br />
Contrô<strong>le</strong> du<br />
dialogue par la<br />
maîtresse<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Productivité des<br />
échanges entre<br />
élèves<br />
Classe A Brève Variab<strong>le</strong> Oui Fort Variab<strong>le</strong><br />
Classe B Longue Variab<strong>le</strong> Oui Fort Plutôt forte<br />
Classe C (non Freinet) Longue Rapide Non Plutôt faib<strong>le</strong> Plutôt forte<br />
Classe D Longue Lent Oui Fort Plutôt forte<br />
Classe E Longue Lent Oui Fort Plutôt forte<br />
Classe F (non Freinet) Longue Variab<strong>le</strong> Non Fort Variab<strong>le</strong><br />
Tab<strong>le</strong>au 5 Structure de la communication : synthèse<br />
Ainsi, <strong>le</strong>s classes Freinet et non Freinet s’opposent sur la présence ou l’absence d’explicitation<br />
des règ<strong>le</strong>s de prise de paro<strong>le</strong> et sur l’institution de rô<strong>le</strong>s de locuteurs pour <strong>le</strong>s élèves. C’est<br />
<strong>le</strong> seul critère qui <strong>le</strong>s unit et <strong>le</strong>s différencie des deux autres classes.<br />
Cela dit, à l’intérieur du groupe des classes Freinet, trois classes peuvent être rapprochées<br />
(B, D et E) : <strong>le</strong>s entretiens du matin sont d’une durée longue ou moyenne, <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> des
maîtresses est plutôt fort et la productivité des échanges entre élèves plutôt é<strong>le</strong>vée. B se<br />
distingue cependant des deux autres par un rythme variab<strong>le</strong> d’une séance à l’autre, alors que<br />
D et E présentent un rythme d’échanges plutôt <strong>le</strong>nt dans toutes <strong>le</strong>s séances observées.<br />
La classe A (Freinet) est plus proche de la classe F (non Freinet) que des autres classes<br />
Freinet : <strong>le</strong>s classes A et F se présentent comme des classes où <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> des maîtresses<br />
est fort, <strong>le</strong> rythme de paro<strong>le</strong> et la productivité des échanges entre élèves variab<strong>le</strong>s. El<strong>le</strong><br />
ne différent que par la durée des séances (brèves chez A et longues chez F) et par<br />
l’institutionnalisation du dialogue, qui est cependant un trait fortement discriminant.<br />
Enfin, la classe C semb<strong>le</strong> présenter une configuration qui lui est propre : une durée longue,<br />
un rythme rapide, un contrô<strong>le</strong> faib<strong>le</strong> de la maîtresse et une productivité des échanges plutôt<br />
forte.<br />
L’ajout d’une nouvel<strong>le</strong> classe dans la constitution des données permet donc de comp<strong>le</strong>xifier<br />
la description du fonctionnement des classes Freinet : unies par des choix pédagogiques<br />
(quasi didactiques, comme tentent de <strong>le</strong> montrer Delcambre et Daunay, 00 ), du moins<br />
pour ce qu’il est possib<strong>le</strong> de voir dans l’étude que nous menons, el<strong>le</strong>s peuvent se distinguer<br />
par des fonctionnements « techniques » qu’el<strong>le</strong>s partagent alors avec d’autres classes non<br />
identifiées Freinet. Cela pose la question diffici<strong>le</strong> de la hiérarchisation des critères dans la<br />
caractérisation des fonctionnements pédagogiques : va-t-on privilégier l’institutionnalisation<br />
du dialogue ou des phénomènes qui peuvent paraître plus classiques, plus partagés, moins<br />
discriminants ? L’étude des séquences dialoguées qui suit permettra de répondre à cette<br />
question.<br />
3. Les formes de l’accompagnement langagier : la part du dialogue dans<br />
<strong>le</strong> polylogue<br />
Outre <strong>le</strong> questionnement évoqué en introduction sur la possib<strong>le</strong> variabilité interne des<br />
dialogues scolaires, la question abordée dans cette section renvoie aux questionnements<br />
et aux constats des travaux d’Anne-Marie Jovenet (cf. ici-même) sur l’articulation entre<br />
individuel et col<strong>le</strong>ctif, qui semb<strong>le</strong> caractériser <strong>le</strong>s modes de prise en compte des élèves en<br />
difficulté ou en souffrance par <strong>le</strong>s maîtres Freinet et <strong>le</strong>s modalités de l’intégration de ces<br />
élèves dans <strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif classe. Une tel<strong>le</strong> problématique fait sens quand on interroge <strong>le</strong>s<br />
modalités du dialogue scolaire. Si <strong>le</strong>s rituels ou <strong>le</strong>s entretiens du matin sont investis, entre<br />
autres fonctions, d’une fonction d’apprentissage du dialogue scolaire, voire d’une fonction de<br />
développement langagier, comment ces moments col<strong>le</strong>ctifs de paro<strong>le</strong> peuvent-ils remplir ces<br />
fonctions ? On peut, comme l’ont fait certains chercheurs (A. Florin, par exemp<strong>le</strong>) construire<br />
une critique forte du fonctionnement du polylogue scolaire en montrant comment il exclut<br />
<strong>le</strong>s élèves petits ou moyens par<strong>le</strong>urs, comment il favorise plus la paro<strong>le</strong> de l’enseignant<br />
que cel<strong>le</strong> des élèves, etc. On peut aussi, et c’est ce que je vais tenter de faire ici, interroger<br />
<strong>le</strong>s modalités de fonctionnement de ce polylogue scolaire qui est peut-être plus soup<strong>le</strong><br />
qu’on ne <strong>le</strong> pense. Autrement dit, il s’agit de se demander si <strong>le</strong> polylogue peut laisser place<br />
au développement d’un dialogue maître/élève, au sens précis d’un dilogue (ou échange à<br />
deux) qui permettrait des formes d’étayage langagier, visant <strong>le</strong> développement de la paro<strong>le</strong><br />
d’un élève isolé du groupe, mais en présence du groupe.<br />
Je me propose ainsi d’identifier, dans <strong>le</strong>s transcriptions des séances enregistrées, des<br />
moments où s’instaure un dilogue entre la maîtresse et un élève particulier. J’ai choisi<br />
de considérer qu’il y a dilogue à partir du moment où une micro-interaction de ce genre<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
inclut plus de deux prises de paro<strong>le</strong> consécutives du même élève. Je considère en effet<br />
qu’un échange (deux TP) de confirmation ou reformulation est ordinaire et fréquent dans <strong>le</strong><br />
dialogue scolaire et non représentatif d’un effet de séquentialisation du dialogue ou d’une<br />
intention de la part de la maîtresse de prolonger l’interaction avec un élève particulier. Il<br />
s’agit donc de moments où l’enseignante instaure une interaction à deux devant <strong>le</strong> groupeclasse,<br />
comme une variation interne du dialogue col<strong>le</strong>ctif. Je nomme Séquence Dialoguées<br />
(SD) <strong>le</strong>s séquences ainsi identifiées.<br />
L’identification des dilogues dans <strong>le</strong>s corpus permet de décrire <strong>le</strong>s formes que prennent <strong>le</strong>s<br />
entretiens et rituels de ce point de vue et de caractériser <strong>le</strong>s pratiques des enseignantes.<br />
Il est éga<strong>le</strong>ment intéressant de voir combien d’élèves entrent ainsi dans une relation<br />
duel<strong>le</strong> avec l’enseignante. De même, on pourra questionner ce qu’on pourrait appe<strong>le</strong>r la<br />
qualité interactionnel<strong>le</strong> de ces moments, <strong>le</strong>ur durée, et pour finir <strong>le</strong>s liens que ces dilogues<br />
entretiennent avec la structure des entretiens ou des rituels (cf. ci-dessus . ) : apparaissentils<br />
de manière aléatoire ou peut-on <strong>le</strong>s mettre en relation avec des tâches langagières<br />
particulières, ce qui <strong>le</strong>ur donnerait une fonction de révélateur des spécificités pédagogiques<br />
(ou didactiques ?) de ces moments col<strong>le</strong>ctifs.<br />
3.1. Fréquence et répartition des dilogues<br />
Les dilogues sont présents dans pratiquement toutes <strong>le</strong>s séances observées, sauf deux<br />
séances dans <strong>le</strong>s classes A et F.<br />
Année Mois<br />
Numéro<br />
corpus<br />
Éco<strong>le</strong> et<br />
Classe<br />
Année oct 0 Freinet B<br />
Année oct 0 Freinet B<br />
Année oct 0 Freinet A<br />
Année oct 0 Freinet A<br />
Année juin 0 Freinet B 0<br />
Année juin 0 Freinet A<br />
Année janv 0 Freinet B<br />
Année juin 0 Freinet B<br />
Année janv 0 Freinet A 0<br />
Année juin 0 Freinet A<br />
Année janv Montaigne C<br />
Année juin Montaigne C<br />
Année janv Freinet D<br />
Année janv Freinet D<br />
Année janv Freinet E<br />
Année janv Freinet E<br />
Année janv Provinces F<br />
Année janv Provinces F<br />
Année janv Provinces F 0<br />
Année janv 0 Provinces F<br />
Total 00<br />
Moyenne<br />
Tab<strong>le</strong>au 6 Nombre des Séquences dialoguées<br />
Nbre SD<br />
La moyenne de SD par séances permet de dire que <strong>le</strong> phénomène est fréquent.<br />
Cependant, la répartition de cette structure selon <strong>le</strong>s classes est très inéga<strong>le</strong>. Le nombre<br />
moyen de SD par maîtresse varie du simp<strong>le</strong> au doub<strong>le</strong>. Le tab<strong>le</strong>au constitue deux grandes<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
catégories : <strong>le</strong>s séances denses en séquences dialoguées ( SD ou plus) et <strong>le</strong>s séances<br />
peu denses (moins de SD). Comme nos observations visent <strong>le</strong> plus souvent à comparer<br />
<strong>le</strong>s classes, <strong>le</strong> travail de comparaison porte sur <strong>le</strong> total des séances enregistrées dans<br />
chaque classe.<br />
Total<br />
des SD<br />
Nombre de séances denses<br />
(présentant SD et +)<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Nombre de séances peu<br />
denses (présentant moins<br />
de SD)<br />
Nombre de<br />
séances<br />
observées<br />
séances dont<br />
une sans SD<br />
Nombre moyen<br />
de SD/séance<br />
Classe<br />
séances ( SD) séance ( SD)<br />
.<br />
A<br />
Classe<br />
séances ( SD) séance ( SD) séances .<br />
B<br />
Classe<br />
séances ( SD) séances<br />
C<br />
Classe<br />
séances ( SD) séances .<br />
D<br />
Classe<br />
séance ( SD) séance ( SD) séances .<br />
E<br />
Classe<br />
séances dont<br />
séances ( SD) séance ( SD)<br />
.<br />
F<br />
une sans SD<br />
0 séances dont<br />
Total 00 0 séances séances<br />
deux sans SD<br />
Tab<strong>le</strong>au 7 Répartition de SD selon <strong>le</strong>s classes<br />
Le total des séances denses est un peu plus important que celui des séances peu denses,<br />
sachant que deux séances ne présentent aucune SD. Ce fait confirme l’importance du<br />
phénomène des SD dans la gestion du dialogue col<strong>le</strong>ctif.<br />
Les classes B (Freinet) et F (non Freinet) présentent la fréquence plus importante de cette<br />
structure de dialogue dans <strong>le</strong>s polylogues (presque SD/séance, en moyenne) ; <strong>le</strong>s classes<br />
A et E (Freinet) présentent une fréquence moyenne d’environ SD/séance et <strong>le</strong>s classes C<br />
(non Freinet) et D (Freinet) une fréquence un peu plus faib<strong>le</strong> (environ SD/ séance).<br />
Les écarts de répartition des SD selon <strong>le</strong>s classes mettent en évidence que séances sur<br />
0 présentant une fréquence importante de SD ont été observées à l’éco<strong>le</strong> Freinet (classes<br />
A, B et E), alors que deux seu<strong>le</strong>ment l’ont été dans une classe non Freinet (la classe F). Ces<br />
huit séances représentent par ail<strong>le</strong>urs plus de la moitié des séances observées à Freinet<br />
( / , soit %), alors que <strong>le</strong>s deux séances de la classe F ne représentent qu’un tiers<br />
des séances non Freinet ( / , soit %). Par ail<strong>le</strong>urs, il faut souligner l’importance dans<br />
ces constats, des deux classes Freinet (A et B) qui semb<strong>le</strong>nt multiplier ce fonctionnement<br />
dialogal dans <strong>le</strong>urs classes, même s’il arrive une fois à la classe A de ne pas <strong>le</strong> présenter.<br />
Par ail<strong>le</strong>urs, il faut souligner que <strong>le</strong> nombre des SD dans une séance n’est pas lié à la longueur<br />
de la séance : des 0 séances à forte fréquence de SD sont des séances courtes.<br />
Même si l’adaptation du polylogue scolaire à des fonctionnements dialogaux n’est pas<br />
l’apanage des classes Freinet, il semb<strong>le</strong> qu’il en soit une des caractéristiques.<br />
3.2. Nombre d’élèves intervenant dans <strong>le</strong>s SD<br />
Trois élèves par séance en moyenne sont <strong>le</strong>s intervenant privilégiés des séquences<br />
dialoguées, mais <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au ci-dessous montre que selon <strong>le</strong>s séances, on trouvera de à<br />
élèves intervenants (<strong>le</strong>s séances où aucun élève n’intervient sont aussi cel<strong>le</strong>s où aucune<br />
SD n’a été identifiée, mais cela ne signifie pas qu’aucun élève ne par<strong>le</strong> dans ces séances<br />
qui se présentent donc comme un dialogue col<strong>le</strong>ctif, géré par la maîtresse, de manière<br />
« classique »).
Année Mois<br />
Numéro<br />
corpus<br />
Éco<strong>le</strong> et<br />
Classe<br />
Année oct 0 Freinet B<br />
Année oct 0 Freinet B<br />
Année oct 0 Freinet A<br />
Année oct 0 Freinet A<br />
Année juin 0 Freinet B<br />
Année juin 0 Freinet A<br />
Année janv 0 Freinet B<br />
Année juin 0 Freinet B<br />
Année janv 0 Freinet A 0<br />
Année juin 0 Freinet A<br />
Année janv Montaigne C<br />
Année juin Montaigne C<br />
Année janv Freinet D<br />
Année janv Freinet D<br />
Année janv Freinet E<br />
Année janv Freinet E<br />
Année janv Provinces F<br />
Année janv Provinces F<br />
Année janv Provinces F 0<br />
Année janv 0 Provinces F<br />
Total<br />
Moyenne<br />
Nb élèves<br />
dans SD<br />
Tab<strong>le</strong>au 8 Nombre d’élèves intervenant dans <strong>le</strong>s SD<br />
On peut se demander si la variation du nombre d’élèves intervenants est liée à la fréquence<br />
des SD dans <strong>le</strong>s séances observées. De fait, dans séances sur 0 identifiées comme<br />
des séances où <strong>le</strong> nombre des SD est important (tab<strong>le</strong>au ), on constate que <strong>le</strong>s élèves<br />
interviennent en nombre plus important (de à ).<br />
Par contre, il faut de nouveau remarquer que ce nombre plus important d’élèves intervenants<br />
n’est pas systématiquement lié à la durée des séances : cinq séances courtes (dans <strong>le</strong>s<br />
classes A et B) voient intervenir plus de trois élèves dans de nombreuses SD.<br />
Peut-on établir une relation entre <strong>le</strong> nombre d’élèves intervenants et <strong>le</strong> nombre de SD ?<br />
Une tel<strong>le</strong> relation permettrait de voir si chaque nouvel<strong>le</strong> séquence dialoguée donne<br />
l’occasion à un nouvel élève d’entrer dans ce travail langagier avec l’enseignant ou s’il<br />
y a une monopolisation de ces occasions de paro<strong>le</strong> par certains élèves. La question est<br />
modestement cel<strong>le</strong> du partage équitab<strong>le</strong> entre <strong>le</strong>s élèves intervenants d’une forme de prise<br />
de paro<strong>le</strong> investie d’une forte va<strong>le</strong>ur pédagogique ou éducative.<br />
Le tab<strong>le</strong>au établit la relation entre <strong>le</strong> type de séance (denses ou peu denses en SD, en<br />
reprenant <strong>le</strong>s catégories du tab<strong>le</strong>au ) et <strong>le</strong> type de relation SD/élèves : y a-t-il un changement<br />
d’élève à chaque SD ( SD/él), un même élève intervient-il dans plus d’une SD ? voire dans<br />
deux SD ? ce qui est comptabilisé est <strong>le</strong> nombre de séances où <strong>le</strong> rapport entre ce nombre<br />
de SD et <strong>le</strong> nombre d’élèves intervenant équivaut à ou tend vers .<br />
Séances denses<br />
Séances peu<br />
denses<br />
SD/él. Entre et SD /él SD/él<br />
Tab<strong>le</strong>au 9 Relations entre nombre d’élèves et nombre de SD<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Les séances denses en SD sont plus nombreuses à faire profiter <strong>le</strong>s mêmes élèves de ces<br />
formes d’interactions dialoga<strong>le</strong>s ( séances / 0), alors que dans <strong>le</strong>s séances peu denses, il<br />
semb<strong>le</strong> qu’il y ait plutôt une tendance chez <strong>le</strong>s maîtresses à changer d’interlocuteur à chaque<br />
nouvel<strong>le</strong> séquence dialoga<strong>le</strong>. Plus il y a d’occasions d’entrer dans cette forme d’échange<br />
dialogal, plus il semb<strong>le</strong> que des élèves la monopolisent. C’est peut-être une sorte de dérive<br />
de cette structure d’interaction, lorsqu’el<strong>le</strong> se multiplie.<br />
Qu’en est-il des pratiques des maîtresses selon <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s ?<br />
SD/él. Entre et SD /él SD/él<br />
Séances denses<br />
Classes A, B Classes A, B, E, F Classe B<br />
Séances peu<br />
denses Classes A, B, D, E Classes C, D, F Classe C<br />
Tab<strong>le</strong>au 10 Relations entre nombre d’élèves et nombre de SD selon <strong>le</strong>s classes<br />
Les six séances où la répartition entre SD et élèves est la plus équitab<strong>le</strong> ont été observées à<br />
l’éco<strong>le</strong> Freinet ; <strong>le</strong>s classes non Freinet (C et F, en italiques dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au) présentent une<br />
configuration où <strong>le</strong> même élève bénéficie de plus d’une séquence. Cela peut être l’indice<br />
d’un plus grand contrô<strong>le</strong> de la paro<strong>le</strong> des élèves ou d’une plus grande organisation dans la<br />
répartition de cette paro<strong>le</strong>, bien que <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au montre que dans quelques cas (notamment<br />
la classe B) la dérive signalée plus haut puisse se rencontrer. Mais la classe B présente une<br />
très grande variété de fonctionnement.<br />
Globa<strong>le</strong>ment, on peut donc dire que l’occurrence dans <strong>le</strong> dialogue col<strong>le</strong>ctif de séquences<br />
dédiées à un échange prolongé entre la maîtresse et un élève peut favoriser un apprentissage<br />
individualisé, pour un nombre d’élèves qui n’est pas insignifiant, que ces occasions de<br />
développer un discours avec l’aide de l’enseignant ne dépendent pas forcément de la<br />
durée des séances, mais que lorsqu’el<strong>le</strong>s se multiplient dans une même séance, il y a<br />
plus de chances qu’un même élève en bénéficie plus souvent, qu’il monopolise la paro<strong>le</strong>,<br />
en quelque sorte, ou qu’il contribue à instaurer de tel<strong>le</strong>s séquences par son insistance à<br />
entrer en dialogue avec la maîtresse. L’instauration d’une régulation ou d’un contrô<strong>le</strong> de ce<br />
phénomène semb<strong>le</strong> être l’apanage des classes Freinet.<br />
3.3. La qualité interactionnel<strong>le</strong> des SD<br />
Pour décrire la qualité interactionnel<strong>le</strong> des SD (ce qui est une question redoutab<strong>le</strong>), j’ai choisi<br />
d’identifier dans <strong>le</strong>s séquences concernées <strong>le</strong> nombre d’échanges que je nomme « p<strong>le</strong>ins »<br />
(EP), c’est-à-dire des échanges où quelque chose se passe sur <strong>le</strong> plan interactionnel dans<br />
la prise de paro<strong>le</strong> de l’élève, même modestement : l’élève répond à une question, il pose une<br />
question, il apporte un élément d’information nouveau, il reprend en ajoutant un élément,<br />
il déplace <strong>le</strong> thème, etc. J’exclus donc de ces « échanges p<strong>le</strong>ins » <strong>le</strong>s répétitions simp<strong>le</strong>s,<br />
de même que <strong>le</strong>s interventions inaudib<strong>le</strong>s, ou tel<strong>le</strong>ment inachevées que l’on a du mal à<br />
identifier <strong>le</strong> début d’un énoncé.<br />
La qualité des SD peut d’abord se décrire en terme de nombre d’échanges p<strong>le</strong>ins par séance<br />
et par la moyenne d’échanges p<strong>le</strong>ins par SD.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Année Mois<br />
Numéro<br />
corpus<br />
Éco<strong>le</strong> et<br />
Classe<br />
Nbre<br />
échanges<br />
p<strong>le</strong>ins (EP)<br />
Nbre SD EP/SD<br />
Année oct 0 Freinet B ,<br />
Année oct 0 Freinet B<br />
Année oct 0 Freinet A x<br />
Année oct 0 Freinet A ,<br />
Année juin 0 Freinet B 0 , x<br />
Année juin 0 Freinet A ,<br />
Année janv 0 Freinet B , x<br />
Année juin 0 Freinet B x<br />
Année janv 0 Freinet A 0 0 0<br />
Année juin 0 Freinet A , x<br />
Année janv Montaigne C , x<br />
Année juin Montaigne C x<br />
Année janv Freinet D x<br />
Année janv Freinet D ,<br />
Année janv Freinet E , x<br />
Année janv Freinet E ,<br />
Année janv Provinces F<br />
Année janv Provinces F x<br />
Année janv Provinces F 0 0 0<br />
Année janv 0 Provinces F , x<br />
Total 00<br />
Tab<strong>le</strong>au 11 Nombre des EP par séance et proportion par Séquences Dialoguées<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Séances où<br />
<strong>le</strong>s EP sont<br />
égaux ou<br />
supérieurs à<br />
/SD<br />
À partir du tab<strong>le</strong>au , on peut établir une moyenne de échanges p<strong>le</strong>ins par séance (un<br />
peu plus si l’on exclut <strong>le</strong>s deux séances où il n’y a pas eu de SD) et un peu plus de trois<br />
échanges p<strong>le</strong>ins par séquence dialoguée, ce qui est relativement modeste, mais adapté<br />
aux contraintes du travail col<strong>le</strong>ctif, <strong>le</strong>s SD ne pouvant pas se prolonger outre mesure, sauf à<br />
perdre de vue que l’on se trouve dans une situation col<strong>le</strong>ctive d’interactions.<br />
On peut à partir de ce premier résultat faire <strong>le</strong> compte des séances où globa<strong>le</strong>ment <strong>le</strong><br />
nombre d’EP est supérieur ou égal à cette moyenne de . On s’aperçoit que chez toutes<br />
<strong>le</strong>s maîtresses (sauf cel<strong>le</strong> de la classe C), une séance sur deux présente cette qualité<br />
interactionnel<strong>le</strong>, et cela quel que soit <strong>le</strong> nombre de séquences dialoguées dans la séance.<br />
L’objectif que l’on peut penser attribuer aux SD (donner l’occasion à un élève de développer<br />
des formes de participation au dialogue autres que la répétition) semb<strong>le</strong> éga<strong>le</strong>ment réparti<br />
entre <strong>le</strong>s différentes classes, ce qui est intéressant à souligner et confirme une fois de plus<br />
l’intérêt langagier de cette variation interne au dialogue col<strong>le</strong>ctif.<br />
Si on ne regarde plus <strong>le</strong> nombre global d’EP par séance, mais la moyenne des EP par<br />
SD (dernière colonne du tab<strong>le</strong>au ), on s’aperçoit que <strong>le</strong> nombre des séances « riches »<br />
augmente un peu, car il permet d’inclure dans <strong>le</strong> total <strong>le</strong>s séances où il n’y aurait qu’une<br />
seu<strong>le</strong> séquence dialoguée avec trois échanges p<strong>le</strong>ins, non répertoriée dans <strong>le</strong> calcul<br />
précédent, basé sur une moyenne globa<strong>le</strong> de EP/séance. Ainsi pour la classe C, <strong>le</strong> total<br />
des EP sur <strong>le</strong>s deux séances observées est légèrement en deçà du résultat moyen. Mais,<br />
comme <strong>le</strong> nombre de SD est peu important, la proportion EP/SD est dans la moyenne de<br />
EP/SD. On peut cependant dire que dans cette classe, <strong>le</strong>s SD ne sont pas des structures<br />
interactionnel<strong>le</strong>s fortes.
Les SD sont donc un lieu où <strong>le</strong>s élèves, avec l’aide de la maîtresse, participent au<br />
développement du dialogue et peuvent développer des compétences interactionnel<strong>le</strong>s.<br />
Nous verrons plus bas quel<strong>le</strong>s conduites discursives ces séquences <strong>le</strong>ur proposent selon<br />
<strong>le</strong>s classes et <strong>le</strong>ur organisation spécifique.<br />
Cette caractéristique est commune à toutes <strong>le</strong>s classes et ne permet pas de distinguer <strong>le</strong>s<br />
éco<strong>le</strong>s : la classe B (Freinet) présente comme la classe F (non Freinet) des séances très<br />
riches, d’autres moins, et <strong>le</strong>s autres classes se répartissent de même. On peut interpréter<br />
cette particularité commune comme <strong>le</strong> signe de l’attention des maîtresses (sauf peut-être<br />
cel<strong>le</strong> de la classe C) à engager un dialogue avec <strong>le</strong>s élèves dès qu’il se présente, quel que<br />
soit <strong>le</strong> contexte d’apparition de ce dialogue.<br />
3.4. Longueur des Séquences Dialoguées<br />
La longueur des SD sera calculée en nombre de TP, globa<strong>le</strong>ment d’abord par séance, puis<br />
en moyenne par SD dans chaque séance, enfin on calcu<strong>le</strong>ra la proportion de TP qu’el<strong>le</strong>s<br />
représentent par rapport à la longueur tota<strong>le</strong> des séances (en TP toujours).<br />
En moyenne, <strong>le</strong>s séquences dialoguées durent TP (un peu plus si l’on ne tient pas<br />
compte des deux séances où il n’y a pas de SD), ce qui est assez court, mais la dispersion<br />
des résultats affichés dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au varie du simp<strong>le</strong> au trip<strong>le</strong>, de à TP.<br />
Les SD courtes (de à TP) se trouvent presque exclusivement à Freinet (classes A, B,<br />
D et F, séances sur observées dans cette éco<strong>le</strong>). Dans ces classes, el<strong>le</strong>s sont un peu<br />
plus nombreuses que <strong>le</strong>s séances à SD de durée moyenne (de à TP) ( séances sur<br />
, soit 0% des séances Freinet) et nettement moins que <strong>le</strong>s séances à SD longues (de<br />
à TP) ( séances sur , % des séances Freinet).<br />
Dans <strong>le</strong>s classes non Freinet, la majorité sont des séances où <strong>le</strong>s SD sont de durée moyenne<br />
( séances sur , soit 0% des séances non Freinet), <strong>le</strong> restant se partageant entre une<br />
séance à SD courte et une autre à SD longue.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Année Mois<br />
Numéro<br />
corpus<br />
Éco<strong>le</strong> et<br />
Classe<br />
Nb TP<br />
consacrés<br />
aux SD<br />
TP/SD<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
TP SD / Total<br />
TP<br />
oct 0 Freinet B ,00%<br />
Année oct 0 Freinet B 0, 0%<br />
Année oct 0 Freinet A %<br />
Année oct 0 Freinet A %<br />
Année juin 0 Freinet B %<br />
Année juin 0 Freinet A 0 %<br />
Année janv 0 Freinet B %<br />
Année juin 0 Freinet B %<br />
Année janv 0 Freinet A 0 0 0%<br />
Année juin 0 Freinet A %<br />
Année janv Montaigne C %<br />
Année juin Montaigne C 0 %<br />
Année janv Freinet D %<br />
Année janv Freinet D 0%<br />
Année janv Freinet E %<br />
Année janv Freinet E 0 %<br />
Année janv Provinces F %<br />
Année janv Provinces F 0 %<br />
Année janv Provinces F 0 0 0%<br />
Année janv 0 Provinces F 0 %<br />
total 0<br />
moyenne %<br />
Tab<strong>le</strong>au 12 Longueur des SD<br />
L’importance des séances à SD courtes à Freinet peut être mise en relation avec une<br />
observation précédente : on trouve dans <strong>le</strong>s séances Freinet un certain nombre de SD<br />
consacrées à un seul élève. On peut penser qu’il y a un point commun entre <strong>le</strong> changement<br />
régulier d’interlocuteur élève à chaque nouvel<strong>le</strong> séquence dialoguée et la relative brièveté<br />
de ces séquences : comme si ces deux phénomènes instituaient un rythme interactionnel<br />
plutôt rapide, ce qui renforce l’hypothèse d’une habitude ou d’un contrô<strong>le</strong> des enseignantes<br />
sur <strong>le</strong>ur gestion des situations d’entretiens.<br />
Les SD à Freinet sont plutôt courtes mais nombreuses, el<strong>le</strong>s occupent une proportion<br />
importante du temps total de la séance. En moyenne, sur l’ensemb<strong>le</strong> des séances, ces SD<br />
occupent % du temps total. Neuf séances consacrent ce temps ou plus (jusqu’à %) aux<br />
SD : el<strong>le</strong>s se trouvent toutes à l’éco<strong>le</strong> Freinet (dans <strong>le</strong>s classes A, B et E). Les cinq séances<br />
observées dans <strong>le</strong>s deux classes non Freinet se situent en deçà de cette moyenne, aucune<br />
de ces séances n’accorde plus d’un quart du temps total aux séquences dialoguées.<br />
Le temps accordé aux SD dans <strong>le</strong>s classes Freinet tempère l’impression de morcel<strong>le</strong>ment<br />
de l’interaction qui peut surgir de l’analyse précédente : certes <strong>le</strong>s séquences sont de durée<br />
courte ou moyenne, mais el<strong>le</strong>s occupent du quart jusqu’à plus de la moitié du temps total de<br />
la séance. Ce ne sont pas des événements aléatoires, liés à des occasions, plus ou moins<br />
saisies au vol par <strong>le</strong>s enseignantes.<br />
3.5. Trilogues<br />
Pour terminer ce panorama de l’organisation interactionnel<strong>le</strong> des séances de rituel ou<br />
d’entretiens du matin, il faut signa<strong>le</strong>r <strong>le</strong> fait que dans de ces séances, un dialogue se
transforme en trilogue : deux élèves sont engagés dans un échange avec la maîtresse sur<br />
un objet de discours commun. Parmi ces neuf séances, huit se trouvent à Freinet, dans <strong>le</strong>s<br />
quatre classes (A, B, D, E).<br />
Classe A<br />
Classe B<br />
Classe C<br />
Classe D<br />
Classe E<br />
Nbre de<br />
séances<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Nbre trilogues<br />
Tab<strong>le</strong>au 13 Nombre de trilogues<br />
Huit séances sur neuf présentent treize trilogues sur quatorze : cette variation dans la<br />
variation est présente de manière récurrente à Freinet et de manière tout à fait occasionnel<strong>le</strong>,<br />
semb<strong>le</strong>-t-il, dans une séance d’une classe non Freinet. Il est diffici<strong>le</strong> de ne pas interpréter<br />
ce phénomène comme une trace de l’attention portée à la prise de paro<strong>le</strong> des élèves par<br />
<strong>le</strong>s maîtresses Freinet dans des configurations variées, et non seu<strong>le</strong>ment dans la relation<br />
privilégiée à la paro<strong>le</strong> magistra<strong>le</strong>. On peut aussi l’interpréter comme un indice de la liberté<br />
de paro<strong>le</strong> des élèves, ou de <strong>le</strong>ur aisance dans la prise de paro<strong>le</strong> : ils ne craignent pas de<br />
s’insérer dans un dialogue maître/élève pour participer à son développement. Cet indicateur<br />
est, pour l’instant, plus important à nos yeux que celui de l’autonomie des élèves, travaillé plus<br />
haut, qui est relativement formel : même si plusieurs élèves interviennent entre deux prises<br />
de paro<strong>le</strong> de l’enseignant, il apparaît souvent qu’ils ne se par<strong>le</strong>nt pas, mais reproduisent des<br />
échanges verticaux en adressant chacun à <strong>le</strong>ur tour à l’enseignant des réponses parfois<br />
différentes, certes, ce qui me <strong>le</strong>s a fait compter comme TP non répétés. Intervenir dans un<br />
trilogue est d’une autre dimension.<br />
3.6. Vers une typologie des séquences dialoguées<br />
La question est ici d’envisager comment ces séquences dialoguées dont on a vu l’intérêt<br />
ci-dessus sont liées au contenu de l’activité de langage organisée par <strong>le</strong>s maîtresses. Il<br />
s’agit de <strong>le</strong>s catégoriser selon la tâche langagière qui y est mise en œuvre. Il s’agira ensuite<br />
de mettre en relation <strong>le</strong>s configurations obtenues avec ce qui a pu être mis en évidence de<br />
l’organisation des séances (rituels ou entretiens du matin) selon <strong>le</strong>s classes.<br />
Neuf catégories de SD peuvent être identifiées dans <strong>le</strong>s corpus recueillis :<br />
– ORG désigne des moments d’organisation du travail où la maîtresse redit en<br />
interaction avec un élève <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s de prise de paro<strong>le</strong>, essentiel<strong>le</strong>ment, ou de régulation<br />
des relations entre élèves ;<br />
– Rép. à M renvoie à des interactions maîtresse/élève initiées par une question de la<br />
maîtresse, question qui peut être réitérée ou transformée selon <strong>le</strong>s cas, ce sont des<br />
séquences dialoguées où se sent la volonté de faire dire ;<br />
– PP él (prise de paro<strong>le</strong> d’un élève) renvoie au contraire à une interaction à l’initiative<br />
d’un élève, mais développée par la maîtresse ; ce sont des interactions en rupture avec<br />
<strong>le</strong> thème ou la conduite discursive précédente ;<br />
– PRESENT désigne <strong>le</strong>s moments où un élève fait la présentation d’un objet ou d’un<br />
travail devant l’ensemb<strong>le</strong> du groupe ;<br />
–<br />
QUEST désigne <strong>le</strong>s moments où un élève pose une ou des question(s) au locuteur<br />
principal, et où il est accompagné dans ce travail par la maîtresse dans des formes de
SD qui donnent souvent lieu aux trilogues évoqués ci-dessus ;<br />
– AJOUT réfère à des moments où un développement au propos antérieur se dérou<strong>le</strong><br />
à l’initiative d’un élève, qui va être accompagné par la maîtresse, saisissant au vol en<br />
quelque sorte cette occasion d’amplifier <strong>le</strong>s contenus de discours ;<br />
– Rép. à élève désigne <strong>le</strong>s formes d’interlocution instituées dans <strong>le</strong>s entretiens du<br />
matin où <strong>le</strong> locuteur principal, répond aux questions qui lui sont posées suite à sa<br />
présentation ;<br />
– Date renvoie aux interactions spécifiquement liées à l’établissement de la date du<br />
jour ;<br />
–<br />
R/Desc renvoie aux récits ou descriptions sollicitées explicitement ou implicitement<br />
par des comportements non verbaux.<br />
Le tab<strong>le</strong>au ci-dessous identifie combien de types de SD différentes ont été repérées dans<br />
chaque séance, identifiée par la <strong>le</strong>ttre désignant la classe et <strong>le</strong> numéro de la séance. Au<br />
total, 00 séquences dialoguées ont été identifiées dans séances. Le tab<strong>le</strong>au permet<br />
de faire une comparaison entre <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s, chaque catégorie donnant lieu à un pourcentage<br />
établi par catégories.<br />
nombre de SD (/ 00)<br />
% Freinet /<br />
%<br />
non Freinet<br />
ORG Rép.<br />
à M<br />
/<br />
0%<br />
0%<br />
/<br />
0%<br />
/<br />
0%<br />
PP<br />
él<br />
/<br />
0%<br />
/<br />
0%<br />
PRESENT QUEST AJOUT Rép à<br />
élève<br />
/<br />
/ / /<br />
00% 00% 00%<br />
0 0 0 0<br />
Tab<strong>le</strong>au 14 Comparaisons entre éco<strong>le</strong>s<br />
00%<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Date R/Desc<br />
0 0<br />
00% 00%<br />
Ce tab<strong>le</strong>au fait apparaître que certaines séquences dialoguées sont communes aux classes<br />
des trois éco<strong>le</strong>s observées : ce sont des SD qui visent l’organisation du groupe ou de la<br />
paro<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> groupe, <strong>le</strong>s séquences où un élève entre dans une série de réponses aux<br />
questions de l’enseignante et cel<strong>le</strong>s qui se développent sur proposition d’un élève. Les<br />
six autres catégories de séquences différencient <strong>le</strong>s classes : présentation, question au<br />
locuteur principal, ajout au thème en cours de développement, réponse à la question posée<br />
par un élève sont propres aux classes Freinet ; interaction autour de l’établissement de la<br />
date et récits ou descriptions d’images sont propres aux classes non Freinet. La relation<br />
entre structure interactionnel<strong>le</strong> des rituels et tâches langagières est ainsi mise en évidence,<br />
d’une part ; d’autre part, la relation entre la structure des rituels et <strong>le</strong> recours aux formes<br />
particulières de gestion du dialogue col<strong>le</strong>ctif que sont <strong>le</strong>s séquences dialoguées est<br />
particulièrement visib<strong>le</strong> : ce sont des moments spécifiques de travail langagier entre l’élève<br />
et l’enseignante qui l’accompagne et ce sont aussi des moments où des formes particulières<br />
du rituel s’actualisent (en nombre dans <strong>le</strong>s classes Freinet).<br />
Il est diffici<strong>le</strong> de commenter dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au la répartition des séquences communes<br />
entre classes Freinet et non Freinet, car la quantité de séances observées dans <strong>le</strong>s deux<br />
types d’éco<strong>le</strong> n’est pas équiva<strong>le</strong>nte : si <strong>le</strong>s classes Freinet montrent plus de séquences<br />
d’organisation, de réponse à la maîtresse ou de prise de paro<strong>le</strong> d’élèves, c’est aussi que <strong>le</strong><br />
recueil de données <strong>le</strong>s concernant est plus abondant. Il faut donc détail<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s résultats par<br />
classe, ce que font <strong>le</strong>s deux tab<strong>le</strong>aux ci-dessous.
0<br />
ORG Rép.<br />
à M<br />
PP él PRESENT QUEST AJOUT Rép à<br />
élève<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Date R/Desc total<br />
B<br />
B 1<br />
A<br />
A<br />
1<br />
B 4 2 1 0<br />
A 4 1 1 1<br />
B 4<br />
B 5 1<br />
A 0 3<br />
D 2 1<br />
D 1 2<br />
E 4 4<br />
E 2<br />
Total<br />
Freinet % 0% %<br />
31<br />
42%<br />
11<br />
15% % %<br />
0 0<br />
Tab<strong>le</strong>au 15 Types de séquences dialoguées dans <strong>le</strong>s classes Freinet<br />
Quatre séquences dialoguées sur dix dans <strong>le</strong>s classes Freinet sont dédiées aux présentations,<br />
deux sur dix sont des séquences où l’élève est engagé dans une réponse aux questions de<br />
la maîtresse ; ensuite viennent <strong>le</strong>s séquences où un élève est aidé dans <strong>le</strong> questionnement<br />
qu’il fait au présentateur et cel<strong>le</strong>s où un élèves propose un thème nouveau (un peu plus<br />
d’une séquence sur dix pour chacune de ces catégories). Enfin, ce sont <strong>le</strong>s séquences<br />
d’organisation, de développement d’un thème en cours ou de réponse aux questions<br />
posées par un autre élève qui apparaissent dans des proportions plus faib<strong>le</strong>s. Ce constat<br />
confirme, s’il en est besoin, l’importance accordée par <strong>le</strong>s maîtresses aux présentations<br />
individuel<strong>le</strong>s et met en concordance ce qui se passe de fait dans <strong>le</strong>s classes avec <strong>le</strong>s<br />
discours affichés : plus de la moitié des SD ( % sont consacrées au développement des<br />
deux rô<strong>le</strong>s de locuteurs institués dans <strong>le</strong>s entretiens : celui de locuteur-présentateur et celui<br />
de questionneur.<br />
Il faut aussi souligner <strong>le</strong> caractère un peu exceptionnel des séquences « Ajout » et « Réponse<br />
à un élève » qui ne se trouvent que trois fois, mais dans <strong>le</strong>s classes A et B, c’est-à-dire dans<br />
des classes de petits-moyens. Ce qu’on pourrait croire plutôt réservé à des classes où <strong>le</strong><br />
développement du langage et de la communication autorise des formes plus origina<strong>le</strong>s du<br />
dialogue scolaire, apparaît ici dans <strong>le</strong>s premières classes de l’éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong>.<br />
Qu’en est-il des classes non Freinet ?<br />
ORG Rép.<br />
à M<br />
C<br />
C<br />
F<br />
F<br />
F 0<br />
Total<br />
non F % % %<br />
PP él PRESENT QUEST AJOUT Rép à<br />
élève<br />
0 0 0 0<br />
00%<br />
Date R/Desc total<br />
% % 00%<br />
Tab<strong>le</strong>au 16 Types de Séquences dialoguées dans <strong>le</strong>s classes non Freinet<br />
Le tab<strong>le</strong>au montre qu’il faut distinguer <strong>le</strong>s deux classes non Freinet : la place donnée<br />
aux SD révè<strong>le</strong> un fonctionnement nettement différencié dans ces deux classes. La classe<br />
C ne présente pas de SD spécifique : <strong>le</strong>s tâches langagières développées dans <strong>le</strong>s SD<br />
sont essentiel<strong>le</strong>ment des réponses aux questions de la maîtresse et des prises de paro<strong>le</strong><br />
spontanées d’élèves. Dans la classe F, ces caractéristiques transversa<strong>le</strong>s aux situations de
paro<strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctive côtoient des séquences spécifiquement liées aux activités organisées par<br />
la maîtresse, établissement de la date ou sollicitation de récits individuels ou de description<br />
d’images (un tiers des SD).<br />
Les types de SD communes à toutes <strong>le</strong>s classes (organisation du travail, de la paro<strong>le</strong>,<br />
régulation des relations entre élèves – réponses à une question initia<strong>le</strong> de la maîtresse –<br />
prise de paro<strong>le</strong> spontanée d’un élève qui ouvre un thème) ne présentent pas <strong>le</strong> même poids<br />
selon <strong>le</strong>s classes et <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s : pour <strong>le</strong>s deux classes non Freinet, el<strong>le</strong>s représentent plus<br />
de la moitié des séquences ( %) sachant que pour la classe C, el<strong>le</strong>s représentent en fait<br />
00% des SD. Pour <strong>le</strong>s classes Freinet, cela ne couvre que % des SD, <strong>le</strong> reste étant<br />
consacré aux activités spécifiques des entretiens du matin.<br />
La classe F chez qui on observe SD sur consacrées à ces activités transversa<strong>le</strong>s (soit<br />
%) est plus proche des classes Freinet : ce qui peut être considéré comme non spécifique<br />
au type de rituel institué occupe un peu plus d’un tiers des séquences dialoguées, l’essentiel<br />
étant consacré à des séquences où des objectifs spécifiques peuvent être développés.<br />
Les séquences dialoguées jouent ainsi <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> de révélateur des intentions ou des pratiques<br />
spécifiques des maîtresses. On peut dire qu’à partir du moment où la maîtresse a institué<br />
une forme de travail spécifique dans <strong>le</strong>s moments rituels, <strong>le</strong>s SD sont <strong>le</strong>s lieux où el<strong>le</strong>s<br />
peuvent se déployer, minimisant ainsi <strong>le</strong>s formes plus classiques du dialogue scolaire<br />
(comme <strong>le</strong> montre l’analyse de la durée des SD), formes qui demeurent cependant dans<br />
tous <strong>le</strong>s moments où <strong>le</strong> dialogue est col<strong>le</strong>ctif et ne se dérou<strong>le</strong> pas dans une interaction<br />
privilégiée avec un élève.<br />
3.7. Conclusion<br />
Les séquences dialoguées apparaissent comme une potentialité réel<strong>le</strong> du polylogue scolaire.<br />
El<strong>le</strong>s permettent à un élève d’entrer dans une interaction privilégiée avec l’enseignant qui<br />
peut ainsi s’attacher à développer <strong>le</strong>s compétences langagières ou pragmatiques de chacun,<br />
même dans cette situation col<strong>le</strong>ctive. On peut donc dire que l’occurrence dans <strong>le</strong> dialogue<br />
col<strong>le</strong>ctif de séquences dédiées à un échange prolongé entre la maîtresse et un élève peut<br />
favoriser un apprentissage individualisé, pour un certain nombre d’élèves.<br />
Les observations menées montrent qu’el<strong>le</strong>s ne nécessitent pas forcément d’allonger <strong>le</strong>s<br />
séances d’entretiens et que <strong>le</strong> nombre d’élèves qui y interviennent ne dépend pas non<br />
plus de <strong>le</strong>ur durée : des séances brèves peuvent faire participer de nombreux élèves à de<br />
nombreuses séquences dialoguées (c’est <strong>le</strong> cas dans <strong>le</strong>s classes Freinet, plus que dans <strong>le</strong>s<br />
autres classes).<br />
Une dérive semb<strong>le</strong> pourtant se présenter lorsque <strong>le</strong>s SD se multiplient dans une même<br />
séance ; il y a plus de chances alors qu’un même élève en bénéficie plus souvent, qu’il<br />
monopolise la paro<strong>le</strong> en quelque sorte, à moins que ce ne soit son insistance à demander<br />
la paro<strong>le</strong> qui fasse se multiplier <strong>le</strong>s SD, notamment pour régu<strong>le</strong>r ces interventions<br />
intempestives.<br />
L’objectif que l’on peut attribuer aux SD (donner l’occasion à un élève de développer des<br />
formes de participation au dialogue, autres que la simp<strong>le</strong> réponse ponctuel<strong>le</strong> à une question)<br />
semb<strong>le</strong> éga<strong>le</strong>ment réparti entre <strong>le</strong>s différentes classes observées, Freinet et non Freinet,<br />
ce qui est intéressant à souligner et confirme l’intérêt langagier de cette variation interne au<br />
dialogue col<strong>le</strong>ctif. Les SD sont un lieu où <strong>le</strong>s élèves, avec l’aide de la maîtresse, participent<br />
à l’enrichissement du dialogue et peuvent développer des compétences interactionnel<strong>le</strong>s.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
La richesse interactionnel<strong>le</strong> des SD, observées dans toutes <strong>le</strong>s classes, met cependant en<br />
évidence une contradiction interne à ce dispositif de paro<strong>le</strong> : on observe en moyenne un peu<br />
plus de trois échanges p<strong>le</strong>ins par séquence dialoguée, ce qui est relativement modeste, mais<br />
adapté aux contraintes du travail col<strong>le</strong>ctif, <strong>le</strong>s SD ne pouvant pas se prolonger outre mesure,<br />
sauf à perdre de vue que l’on se trouve dans une situation col<strong>le</strong>ctive d’interactions.<br />
Enfin, el<strong>le</strong>s jouent <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> de révélateur des dispositifs spécifiques de paro<strong>le</strong> institués dans<br />
<strong>le</strong>s classes : el<strong>le</strong>s sont liées tantôt au fonctionnement des rô<strong>le</strong>s communicationnels (classes<br />
Freinet), tantôt aux pratiques de récits spontanés ou de description dirigée (classe non<br />
Freinet). El<strong>le</strong>s participent aussi de la gestion classique du dialogue scolaire (répondre aux<br />
questions de la maîtresse, par exemp<strong>le</strong>) mais dans une moindre mesure.<br />
Cette variation du polylogue scolaire semb<strong>le</strong> cependant caractériser <strong>le</strong>s classes observées<br />
à l’éco<strong>le</strong> Freinet, même si el<strong>le</strong> n’est pas l’apanage des classes Freinet : <strong>le</strong>s SD y sont<br />
nombreuses ; plus fréquentes dans certaines classes, el<strong>le</strong>s peuvent spécifier <strong>le</strong>s pratiques<br />
de certaines maîtresses Freinet par rapport à cel<strong>le</strong>s de <strong>le</strong>urs collègues.<br />
Dans <strong>le</strong>s classes Freinet, la tendance est cel<strong>le</strong> d’un changement d’interlocuteur-élève à<br />
chaque nouvel<strong>le</strong> séquence dialoguée. La relative brièveté de ces séquences peut produire<br />
un effet de découpage stéréotypé du dialogue : des séquences relativement brèves qui se<br />
succèdent en changeant d’interlocuteur assez systématiquement. C’est la rançon peut-être<br />
d’une intentionnalité des enseignantes gérant de manière un peu rigide ces variations du<br />
dialogue scolaire mais <strong>le</strong> temps total accordé aux SD dans <strong>le</strong>s classes Freinet tempère cette<br />
impression de morcel<strong>le</strong>ment de l’interaction : certes <strong>le</strong>s séquences sont de durée courte ou<br />
moyenne, mais el<strong>le</strong>s occupent parfois jusqu’à plus de la moitié du temps total de la séance.<br />
Ce ne sont pas des événements aléatoires, liés à des occasions, plus ou moins saisies au<br />
vol par <strong>le</strong>s enseignantes, mais bien quelque chose qui ressemb<strong>le</strong> à un projet pédagogique<br />
(même s’il n’apparaît pas en tant que tel dans <strong>le</strong>s entretiens que nous avons menés avec<br />
el<strong>le</strong>s).<br />
Cependant, on a pu observer une variation dans la variation : dans <strong>le</strong>s classes Freinet, et<br />
uniquement dans ces classes, la séquence dialoguée peut se transformer en un trilogue.<br />
Phénomène intéressant qui montre d’une part, que la gestion du dialogue peut être parfois<br />
plus soup<strong>le</strong> qu’il n’y paraît dans d’autres observations et d’autre part, que <strong>le</strong>s élèves font<br />
preuve d’une grande aisance dans la prise de paro<strong>le</strong> : ils ne craignent pas de s’insérer dans<br />
un dialogue maître/élève pour participer à son développement.<br />
On peut dire que <strong>le</strong>s modulations du dialogue scolaire traditionnel contribuent dans <strong>le</strong>s classes<br />
Freinet à donner à l’individu élève non seu<strong>le</strong>ment une place particulière par l’apprentissage<br />
des rô<strong>le</strong>s communicationnels institués mais aussi des occasions de développer des<br />
expériences de la construction d’un dialogue avec l’adulte-maîtresse sur des sujets qui<br />
sont souvent <strong>le</strong>s siens mais dans des formes interactionnel<strong>le</strong>s publiques qui transforment la<br />
nature des comportements langagiers.<br />
Pour terminer, il convient de rappe<strong>le</strong>r que ce fonctionnement n’est pas la caractéristique<br />
exclusive des classes observées dans <strong>le</strong> groupe scolaire Hélène Boucher. Il se pratique<br />
éga<strong>le</strong>ment dans une des deux classes « autres » qui font partie des données recueillies,<br />
mais à un degré moindre : en effet, la ritualisation des rô<strong>le</strong>s de locuteurs est, d’après nous, un<br />
critère de différenciation central des séances observées. El<strong>le</strong> oblige à faire porter l’attention<br />
des élèves (et des maîtresses) sur la communication scolaire, sur ce qui l’institue comme<br />
rituel social et dispositif cognitif (Amigues et Zerbato-Poudou, 000, 0 ), ce qu’on peut<br />
considérer comme un des apprentissages centraux de l’éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong>, et non seu<strong>le</strong>ment<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
à faire pratiquer de manière intégrée et non explicite des formes de communication, en<br />
espérant que de cette pratique naisse un développement langagier. Cette ritualisation permet<br />
aussi de mettre l’accent sur la réf<strong>le</strong>xivité liée à l’apprentissage, dès l’éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong>, dans<br />
<strong>le</strong>s classes Freinet qui ont été l’objet de nos observations.<br />
Bibliographie<br />
Amigues R. et Zerbato-Poudou M.-Th. ( 000), Comment l’enfant devient élève. Les<br />
apprentissages à l’éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong>, Paris, Retz.<br />
Bouchard R. ( ), « Le dialogue pédagogique : unités pragmatiques et procédés<br />
énonciatifs », dans Barberis J.-M., (dir.), Le Français parlé. Variétés et discours, Praxiling,<br />
Université Paul Valéry, Montpellier , p. - .<br />
Bourdieu, P. ( ), « Les rites comme actes d’institution », Actes de la Recherche en<br />
Sciences socia<strong>le</strong>s, n° 0, p. - .<br />
Delcambre, I. ( 00 a), « Construction de rô<strong>le</strong>s discursifs en petite/moyenne section de<br />
maternel<strong>le</strong> », dans Halté J. F. & Rispail M., (dirs), L’oral dans la classe. Compétences,<br />
enseignement, activités, L’Harmattan, p. - .<br />
Delcambre I. ( 00 b), « Dispositifs d’oral en Maternel<strong>le</strong> (et au CP) », dans Reuter Y., (dir.),<br />
Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire (2002-200 ), Rapport de l’ERTé<br />
0 , p. - .<br />
Delcambre, I. ( 00 c), « Apprendre à prendre la paro<strong>le</strong> en petite section de maternel<strong>le</strong> »,<br />
Spira<strong>le</strong>, n° , Les apprentissages à l’éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong>, p. - .<br />
Delcambre I., Daunay B. ( 00 ), « Les rituels en maternel<strong>le</strong> : comment décrire <strong>le</strong>s pratiques<br />
des enseignants ? », e Colloque International, <strong>IUFM</strong> de Nantes, Former des enseignantsprofessionnels<br />
: savoirs et compétences, CD-ROM.<br />
Garcion-Vauthor ( 00 ), « L’entrée dans <strong>le</strong> contrat didactique à l’éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong>. Le rô<strong>le</strong><br />
des rituels dans la construction d’un milieu pour apprendre », Recherches en Didactique<br />
des Mathématiques, vol. , p. - 0 .<br />
Leclaire-Halte A. ( 00 ), « Pourquoi Denzel par<strong>le</strong>-t-il si peu ? Analyse d’une séquence<br />
ordinaire : la date en grande section de maternel<strong>le</strong> », dans HALTE J. F. & RISPAIL M., (dirs),<br />
L’oral dans la classe. Compétences, enseignement, activités, L’Harmattan, p. 0- 0 .<br />
Ministère de l’Éducation Nationa<strong>le</strong>, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, DESCO<br />
( 00 ) Le langage à l’éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong>. Documents d’accompagnement des programmes,<br />
Paris, CNDP.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Annexe 1<br />
codage Éco<strong>le</strong> Maîtresse Classe<br />
A Freinet Sylvie PS-MS<br />
B Freinet Fabienne PS-MS<br />
C Montaigne Joël<strong>le</strong> MS<br />
D Freinet Marie-Anne PS-MS<br />
E Freinet Pasca<strong>le</strong> GS<br />
F Provinces Elisabeth MS-GS<br />
Correspondances codes / éco<strong>le</strong>s / classes<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Conférences, comptes-rendus de <strong>le</strong>cture :<br />
compétences d’écoute et d’exposition<br />
Élisabeth NONNON<br />
Professeur des universités<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Équipe THEODILE<br />
Les activités d’exposition ora<strong>le</strong> occupent une place centra<strong>le</strong> dans la pédagogie Freinet.<br />
Depuis l’origine, à une époque où <strong>le</strong>s objectifs relatifs à la pratique ora<strong>le</strong> étaient rarement<br />
explicites à l’éco<strong>le</strong>, la pratique de la prise de paro<strong>le</strong> publique est pour el<strong>le</strong> un objectif<br />
prioritaire. Cette prise de paro<strong>le</strong> est travaillée dans ses formes argumentatives (discussions<br />
lors des conseils, en particulier) et ses formes expositives. La compétence d’exposition<br />
s’exerce de manière explicite et institutionnalisée dans des exposés (<strong>le</strong>s conférences), des<br />
comptes rendus de <strong>le</strong>cture, la présentation de travaux aux parents ou aux autres élèves,<br />
mais aussi de façon intégrée aux diverses formes de travail (comptes rendus, explicitation<br />
de démarches…). Le projet pédagogique et <strong>le</strong> fonctionnement du travail scolaire quotidien<br />
sont tels que <strong>le</strong>s occasions pour <strong>le</strong>s élèves d’exposer, de questionner et de débattre sont<br />
fréquentes et variées tout au long de la scolarité. Les activités d’exposition sont partie<br />
intégrante du fonctionnement de la classe (travail par ateliers, socialisation des recherches,<br />
travail à partir de situations vécues qu’on analyse) et des modes de travail (recherches<br />
autonomes sur documents, échanges de connaissances entre élèves). Ces choix permettent<br />
d’assurer pour chaque élève la fréquence et la répétition de cette pratique au cours de sa<br />
scolarité maternel<strong>le</strong> et élémentaire : chaque élève est amené à prendre la paro<strong>le</strong> en public<br />
de nombreuses fois chaque année, dans des formes en continuité visib<strong>le</strong> une classe à<br />
l’autre. Les activités d’exposition sont inscrites de façon explicite et régulière à l’emploi<br />
du temps, et un temps considérab<strong>le</strong> <strong>le</strong>ur est consacré. Pour <strong>le</strong>s plus institutionnalisées<br />
et ritualisées d’entre el<strong>le</strong>s, la présentation de travaux, la présentation de livres et <strong>le</strong>s<br />
conférences, deux plages hebdomadaires au moins sont consacrées au temps d’exposition<br />
lui-même, sans compter <strong>le</strong> temps de préparation (recherche sur documents, préparation<br />
de l’affiche support). Ces temps revêtent aux yeux des élèves une grande importance et<br />
sont considérés comme un travail scolaire à part entière. Ce statut des activités ora<strong>le</strong>s et <strong>le</strong><br />
temps qui <strong>le</strong>ur est consacré sont exceptionnels par rapport aux usages courants à l’éco<strong>le</strong><br />
élémentaire et constituent une originalité de la pédagogie Freinet.<br />
Cette régularité de l’exercice s’accompagne d’une importante ritualisation : une plage<br />
horaire conséquente est réservée chaque semaine au même moment à la présentation des<br />
exposés (en général la première plage d’une après-midi pour <strong>le</strong>s conférences el<strong>le</strong>s-mêmes).<br />
Les élèves s’engagent à l’avance à traiter un sujet de <strong>le</strong>ur choix, individuel<strong>le</strong>ment ou par<br />
deux, et consacrent un temps variab<strong>le</strong> selon <strong>le</strong>s cas, mais toujours assez important (parfois<br />
plusieurs séances de travail) à la préparation, en classe, de cette présentation (recherche<br />
de documents, réalisation d’une affiche), lors de plages horaires en semi-autonomie. Ceux<br />
qui pensent pouvoir présenter <strong>le</strong>ur travail s’inscrivent à l’avance au tab<strong>le</strong>au, sur <strong>le</strong> mode<br />
du volontariat. Le dérou<strong>le</strong>ment lui-même est fortement codifié, même si <strong>le</strong> passage est à<br />
l’initiative de chacun : un élève par rou<strong>le</strong>ment est chargé d’animer la séance (présenter<br />
l’orateur, maintenir l’ordre et l’écoute, scander <strong>le</strong>s phases successives de l’exercice, donner<br />
la paro<strong>le</strong> à l’auditoire pour <strong>le</strong>s questions), un autre de maintenir <strong>le</strong>s temps impartis à<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
chaque phase. L’exercice comporte une phase de présentation, appuyée sur un document<br />
écrit affiché au tab<strong>le</strong>au, suivie de questions à l’auditoire sur ce qui vient d’être dit (pour la<br />
présentation de livres) ; dans un deuxième temps, lui aussi minuté, <strong>le</strong>s auditeurs posent des<br />
questions ou font des remarques à l’orateur, sous <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> de l’animateur qui <strong>le</strong>ur passe la<br />
paro<strong>le</strong> à tour de rô<strong>le</strong>. Enfin, <strong>le</strong>s élèves votent la mention à attribuer à la présentation, selon<br />
un code de cou<strong>le</strong>ur, l’enseignant ayant une voix comme <strong>le</strong>s élèves ; cette mention entre<br />
dans l’évaluation du travail de chacun. Les affiches sont archivées et consultab<strong>le</strong>s dans la<br />
classe. Cette institutionnalisation (présence régulière à l’emploi du temps, évaluation) et<br />
cette ritualisation donnent une forte légitimité à l’activité aux yeux des élèves ; el<strong>le</strong> est donc<br />
caractérisée à la fois par une grande liberté au niveau des sujets choisis et des rythmes, et<br />
par une grande codification, voire une normativité dans <strong>le</strong> dérou<strong>le</strong>ment.<br />
Cet investissement important se justifie par <strong>le</strong> fait que l’apprentissage de la paro<strong>le</strong> publique<br />
touche à des enjeux fondamentaux pour la pédagogie Freinet. Les exposés visent <strong>le</strong><br />
développement personnel et l’affirmation de soi, la responsabilisation, l’entrée dans de<br />
nouveaux rô<strong>le</strong>s sociaux (avoir l’initiative d’un projet et <strong>le</strong> pousser jusqu’à sa réalisation, régu<strong>le</strong>r<br />
une paro<strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctive, développer un esprit critique raisonné) ; cela conduit au principe du<br />
libre choix par <strong>le</strong>s élèves des sujets qu’ils vont présenter. La fréquence et la répétition, mais<br />
aussi l’évaluation régulière par <strong>le</strong>s pairs, doivent permettre à chacun de se donner un projet<br />
de formalisation de ses centres d’intérêt et de progression sur <strong>le</strong> plan de la prise de paro<strong>le</strong>.<br />
L’exercice de la paro<strong>le</strong> publique fait aussi partie des apprentissages liés au fonctionnement<br />
démocratique et responsab<strong>le</strong> du groupe : <strong>le</strong>s exposés sont considérés comme un moyen<br />
fondamental de partage des connaissances pour l’élaboration d’une culture commune. Par<br />
ail<strong>le</strong>urs ils sont aussi chargés de fonctions épistémiques : ils sont liés à la pratique de la<br />
recherche documentaire, à l’élaboration de connaissances à partir des expériences et des<br />
centres d’intérêt de chacun. Une grande partie des apprentissages scolaires relatifs à la<br />
connaissance du monde <strong>le</strong>ur incombe.<br />
La pratique des exposés est donc chargée d’enjeux nombreux et importants, ce qui comp<strong>le</strong>xifie<br />
l’évaluation des apprentissages des élèves : quel<strong>le</strong> part accorder aux apprentissages formels<br />
liés spécifiquement à la prise de paro<strong>le</strong>, et aux apprentissages liés à la conceptualisation et<br />
aux savoirs concernés par <strong>le</strong>s domaines abordés ? El<strong>le</strong> comporte aussi de ce fait un certain<br />
nombre de tensions : tension entre <strong>le</strong> principe d’initiative, de volontariat et de libre choix<br />
des sujets pour chacun, et des exigences d’approfondissement et de progression dans <strong>le</strong><br />
traitement des sujets, par exemp<strong>le</strong>.<br />
L’importance du temps et de la va<strong>le</strong>ur accordés aux activités d’exposition et à la paro<strong>le</strong> des<br />
élèves conduit à s’interroger sur <strong>le</strong>s acquis que cet investissement produit chez <strong>le</strong>s élèves.<br />
Cependant <strong>le</strong>s spécificités de ces formes d’exercice de l’oral dans la pédagogie Freinet,<br />
d’une part, et <strong>le</strong>s objectifs larges et nombreux qui y sont attachés, d’autre part, font que<br />
des épreuves normalisées et décontextualisées d’évaluation du langage oral conviendraient<br />
mal pour cerner ces acquis. La pratique de l’exposé n’est pas dans la pédagogie Freinet un<br />
entraînement formel qui viserait simp<strong>le</strong>ment la conformité à un modè<strong>le</strong> rhétorique scolaire,<br />
ou un usage plus normé ou plus élaboré de la langue parlée. Il faut pour l’évaluer prendre en<br />
compte aussi ses objectifs relatifs au rapport au langage, à l’engagement devant un groupe,<br />
à l’investissement dans <strong>le</strong>s tâches etc. Il faut d’ail<strong>le</strong>urs souligner que même en voulant se<br />
cantonner à une évaluation stricte du langage parlé, il n’existe pas vraiment d’outils valides sur<br />
<strong>le</strong> plan scientifique pour évaluer son développement au delà des apprentissages premiers, et<br />
on ne dispose que de peu de repères faisant consensus sur ce qui pourrait être attendu aux<br />
différents niveaux scolaires de l’éco<strong>le</strong> élémentaire. De ce fait l’observation menée à l’éco<strong>le</strong><br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Hélène Boucher n’a pas mis en œuvre une épreuve d’évaluation fina<strong>le</strong> spécifique pour <strong>le</strong>s<br />
élèves de cours moyen, épreuve qui aurait été diffici<strong>le</strong> à organiser et peu significative. El<strong>le</strong><br />
a plutôt tenté de cerner, à partir d’observations des activités dans <strong>le</strong>ur contexte de classe<br />
spécifique et dans <strong>le</strong>ur durée, l’évolution des élèves dans cette pratique pendant <strong>le</strong>s années<br />
de CE et de CM , <strong>le</strong>s acquis et <strong>le</strong>s résistances relativement aux objectifs visés par l’équipe.<br />
À travers <strong>le</strong>s exposés <strong>le</strong>s enseignants inscrivent <strong>le</strong> développement du langage oral dans un<br />
projet plus global de développement de la personne, du groupe, des connaissances et de la<br />
réf<strong>le</strong>xion sur <strong>le</strong> monde. La liberté dans <strong>le</strong> choix et dans <strong>le</strong> traitement des sujets fait partie de<br />
ces objectifs : el<strong>le</strong> comp<strong>le</strong>xifie cependant l’évaluation, en offrant, à l’intérieur d’un rituel très<br />
prégnant, une grande disparité de contenus et de tâches de verbalisation, même pour un<br />
même élève. D’autre part, <strong>le</strong> principe de respect du volontariat et des rythmes de chacun a<br />
rendu relativement aléatoire <strong>le</strong> recueil de données directes : certains élèves ont été observés<br />
beaucoup plus que d’autres, certains très peu (alors que justement l’observation de <strong>le</strong>ur<br />
évolution aurait été informative). L’omniprésence de l’activité ora<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s classes Freinet,<br />
et <strong>le</strong>s conditions de recueil de données ora<strong>le</strong>s, beaucoup plus coûteuses en temps que<br />
celui de données écrites, font que <strong>le</strong> corpus n’est pas homogène et reste lacunaire. Tout en<br />
gardant une grande prudence quant aux conclusions, on peut cependant faire l’hypothèse<br />
qu’il est suffisant pour dégager certaines tendances relatives aux acquis et aux points plus<br />
problématiques dans <strong>le</strong>s évolutions de la pratique des élèves.<br />
1. Les indicateurs liés à la prise en compte du langage dans sa fonction<br />
de socialisation<br />
Dans un premier cadre d’analyse, on considérera <strong>le</strong>s pratiques d’exposé dans <strong>le</strong>ur dimension<br />
de construction identitaire et de développement de la socialisation. Il s’agit d’une pratique<br />
publique qui met en jeu la classe comme communauté d’apprentissage, regroupant des<br />
individus participant à des buts partagés, où chacun doit apprendre à s’affirmer face aux<br />
autres en posant son point de vue, en assumant ses références tout en <strong>le</strong>s transformant<br />
dans la confrontation à autrui. En ce sens <strong>le</strong> travail des exposés est complémentaire de<br />
celui qui s’exerce dans <strong>le</strong>s conseils : il s’agit de respecter <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s de la paro<strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctive,<br />
mais surtout d’apprendre à mettre à distance son expérience et de formu<strong>le</strong>r des jugements<br />
raisonnés, en tenant compte de ceux des autres et de l’intérêt du groupe. Ce travail se fait<br />
aussi bien au niveau de l’écoute (une plage importante, régulière et ritualisée, est accordée<br />
à la formulation des questions, des critiques) que celui de la prise de paro<strong>le</strong>. L’évaluation de<br />
l’oral s’attachera donc aux évolutions de ceux qui présentent comme à cel<strong>le</strong>s de ceux qui<br />
écoutent et réagissent à la présentation. Une des questions pour <strong>le</strong> chercheur est jusqu’où<br />
il considérera qu’une évolution au niveau comportemental (ne plus couper la paro<strong>le</strong>, être<br />
plus concentré) peut être catégorisée comme progrès re<strong>le</strong>vant de l’oral, et sur quels indices<br />
linguistiques et discursifs s’appuyer pour <strong>le</strong> faire. L’autre question concerne la généralisation<br />
de ce qu’on considérera comme un acquis : dans quel<strong>le</strong> mesure des conduites observées<br />
relèvent-el<strong>le</strong>s d’une acculturation à des tâches fortement ritualisées et aux normes d’une<br />
culture de groupe, dans quel<strong>le</strong> mesure s’agit-il de l’acquisition d’une compétence ora<strong>le</strong><br />
susceptib<strong>le</strong> d’être mobilisée hors contexte ?<br />
On peut lister et regrouper un certain nombre d’indicateurs re<strong>le</strong>vant de cette perspective,<br />
pour ceux qui présentent et pour ceux qui écoutent.<br />
1.1. Pour ceux qui exposent<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
1.1.1. Engagement dans l’activité, attitudes de travail<br />
Pour ceux qui présentent, on peut faire intervenir en premier lieu des indicateurs relatifs à<br />
l’engagement dans l’activité.<br />
Concernant <strong>le</strong> nombre de prises de paro<strong>le</strong> publiques volontaires pour chaque enfant, il est<br />
très variab<strong>le</strong> puisqu’el<strong>le</strong>s reposent sur <strong>le</strong> principe du volontariat. De ce fait, certains élèves<br />
ont beaucoup plus que d’autres profité des occasions de présenter un travail, du fait de<br />
<strong>le</strong>ur aisance initia<strong>le</strong>, de <strong>le</strong>ur motivation ou de <strong>le</strong>ur rapidité dans la préparation. Ce critère<br />
est donc à pondérer : <strong>le</strong> nombre de prises de paro<strong>le</strong> volontaires peut être un indicateur<br />
d’engagement, mais il est à mettre en relation avec des façons d’être qui ne relèvent qu’en<br />
partie d’apprentissages scolaires, et avec <strong>le</strong>s coûts différents occasionnés à chacun en<br />
fonction de son habitus. Cependant, même <strong>le</strong>s élèves qui se sont moins ou plus tardivement<br />
engagés ont présenté à plusieurs reprises un travail, ou ont animé une séance ; à long<br />
terme, aucun n’est resté en dehors du processus et certaines évolutions dans l’engagement<br />
ont été significatives, notamment pour des élèves qui en début de CE marquaient des<br />
réticences à par<strong>le</strong>r devant <strong>le</strong>s autres. Tous ont pris la paro<strong>le</strong> publiquement plusieurs fois au<br />
cours d’une année, dans <strong>le</strong>s comptes rendus de <strong>le</strong>cture ou dans <strong>le</strong>s exposés, seuls ou à<br />
deux devant <strong>le</strong> groupe, et ont eu à s’essayer sur plusieurs sujets : même pour ceux qui ont<br />
comparativement aux autres moins utilisé <strong>le</strong> dispositif, il y a eu davantage d’occasions de<br />
paro<strong>le</strong> publique organisée que dans la plupart des classes de cyc<strong>le</strong> III.<br />
L’engagement dans l’activité se marque aussi par <strong>le</strong> degré de préparation et <strong>le</strong> sérieux<br />
du travail qui sous-tend l’exposé. Ces éléments sont importants dans la mesure où<br />
ils marquent des évolutions dans <strong>le</strong> rapport à l’oral mais sont corollaires aussi d’autres<br />
évolutions, plus généra<strong>le</strong>s, dans <strong>le</strong> rapport aux tâches scolaires et au groupe. Les progrès<br />
sont spectaculaires pour l’ensemb<strong>le</strong> des élèves pour la présentation de livres, si on prend<br />
comme indicateurs l’attention dans la <strong>le</strong>cture, la mémorisation des épisodes, la préparation<br />
du résumé et <strong>le</strong> soin apporté à l’écrit support. La régularité de l’exercice permet aux élèves<br />
de se faire une idée relativement claire de certains aspects du travail qu’il exige, du moins<br />
<strong>le</strong>s plus visib<strong>le</strong>s, relatifs à la mémoire de l’histoire : un indicateur significatif est <strong>le</strong> désir de<br />
certains élèves de recommencer si la présentation n’est pas réussie, ainsi que la prise<br />
en compte des conseils lors d’une précédente prestation. Pour <strong>le</strong>s exposés, l’engagement<br />
apparaît notamment dans <strong>le</strong> soin apporté à l’affiche support (iconographie, décoration),<br />
soin qui devient progressivement une va<strong>le</strong>ur partagée, plus nettement que la qualité de<br />
la recherche, critère qui reste moins évident à cerner pour une grande partie des élèves.<br />
Sur <strong>le</strong> plan linguistique, la longueur de la présentation peut être considérée comme critère<br />
d’un investissement : el<strong>le</strong> augmente de façon significative pour la présentation de livres,<br />
corollairement à la précision dans <strong>le</strong> rappel des épisodes, mais moins nettement pour <strong>le</strong>s<br />
exposés. On observe aussi chez tous la disparition tendanciel<strong>le</strong> de « blancs », encore<br />
fréquents en début de CE . Cependant ces critères sont à pondérer en fonction du sujet<br />
choisi, de l’histoire de chaque exposant et de son aisance initia<strong>le</strong> : pour certains « tenir »<br />
cinq minutes représente un investissement considérab<strong>le</strong>, pour d’autres, il faudra plutôt<br />
apprendre à être moins disert et plus synthétique. L’aisance accrue de la plupart des élèves<br />
peut entrer ici en concurrence avec des critères liés au second domaine d’indicateurs,<br />
relatifs aux qualités de hiérarchisation et de synthèse. Mais à ce niveau, il est remarquab<strong>le</strong><br />
que pratiquement aucun ne soit demeuré bloqué face à un groupe, quel que soit <strong>le</strong> niveau<br />
initial, et que parfois au prix de gros efforts, même la deuxième année, tous soient devenus<br />
capab<strong>le</strong>s de prendre en charge un discours monologique relativement long.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
L’engagement dans l’activité renvoie aussi à une dimension plus qualitative, que signa<strong>le</strong>rait<br />
une exigence plus grande dans <strong>le</strong> questionnement ou la recherche de sources, plus de<br />
risque dans <strong>le</strong> traitement des documents, <strong>le</strong> fait de ne pas se réfugier dans un type de<br />
scénario bien maîtrisé. L’engagement dans l’activité ora<strong>le</strong> rejoint alors un certain nombre<br />
d’indicateurs relatifs à la dimension épistémique, et sera donc abordé dans la partie relative<br />
au deuxième cadre. On touche ici au problème de la ritualisation : si la régularité et <strong>le</strong><br />
scénario bien codifié qui président à l’exercice constituent un cadre rassurant et familier qui<br />
permet de <strong>le</strong>ver des inhibitions, d’intérioriser certains critères de réussite et de protéger la<br />
prise de risque, cette familiarité peut amener certains élèves à se contenter de reproduire<br />
<strong>le</strong> rituel, et une fois l’aisance acquise, l’activité, sans cesser d’être motivante sur <strong>le</strong> plan<br />
psychologique, peut apparaître comme en partie routinière sur <strong>le</strong> plan des apprentissages.<br />
D’où l’importance pour <strong>le</strong>s enseignants de susciter de nouveaux buts et de nouvel<strong>le</strong>s<br />
exigences, ce qui est régulièrement explicité en CM . Mais cela pose un problème diffici<strong>le</strong> à<br />
gérer de différenciation des buts, par suite de la variété des sujets choisis et des dispositions<br />
initia<strong>le</strong>s des élèves vis-à-vis de l’activité.<br />
1.1.2. Affirmation de soi, positionnement par rapport à autrui<br />
La pratique des exposés est liée dans la pédagogie Freinet à une dimension de construction<br />
de la personne : apprendre à s’affirmer devant un groupe, se poser par rapport à autrui, faire<br />
partager son expérience, expliciter ses jugements et ses sentiments.<br />
Les indicateurs <strong>le</strong>s plus évidents et classiques de ce positionnement face à autrui touchent<br />
à la dimension locutoire : maîtrise de la posture et du regard, de la voix et du souff<strong>le</strong> (débit,<br />
intensité, articulation) et au rapport d’ordre proxémique à l’auditoire. De ce point de vue,<br />
<strong>le</strong>s progrès semb<strong>le</strong>nt spectaculaires et bien partagés, même si <strong>le</strong> niveau de départ est<br />
très inégal selon <strong>le</strong>s élèves. Si en début de CE certains montrent des signes d’émotion<br />
excessive ou de paralysie face à l’auditoire (si<strong>le</strong>nce, oubli de ce qu’on a à dire, rires ou<br />
comportement parasites, attitudes de repli, débit trop rapide ou voix inaudib<strong>le</strong>), la répétition<br />
de l’exercice et sa relative désacralisation font que ces comportements se résorbent souvent<br />
relativement rapidement, même sans entraînement systématique : presque tous arrivent en<br />
cours d’année à se faire entendre, à contrô<strong>le</strong>r <strong>le</strong>ur débit et <strong>le</strong>urs gestes, à regarder l’auditoire.<br />
Le rapport à l’écrit support de l’exposé est aussi un indicateur significatif : chez la plupart<br />
des élèves, on observe au départ une centration sur <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au et l’affiche support, qu’ils<br />
utilisent comme un refuge, après quelques phrases d’introduction. Petit à petit, une partie<br />
d’entre eux parvient à l’utiliser comme outil complémentaire à la paro<strong>le</strong>, avec centration<br />
sur l’auditoire, mais la tentation de revenir à son document affiché au tab<strong>le</strong>au reste forte,<br />
même en CM , et certains ont du mal à ne pas <strong>le</strong> lire, ou à ne pas se réfugier dans <strong>le</strong> fait de<br />
montrer et nommer <strong>le</strong>s images.<br />
Ces éléments sont faci<strong>le</strong>s à signa<strong>le</strong>r et à repérer pour <strong>le</strong>s élèves. Certains font l’objet de<br />
contrats de travail ciblés (s’enregistrer pour apprendre à contrô<strong>le</strong>r son débit, par exemp<strong>le</strong>,<br />
ne pas lire son papier) et de progrès visib<strong>le</strong>s, parce que <strong>le</strong>s conditions généra<strong>le</strong>s de<br />
fonctionnement de la communication et la répétition de l’exercice favorisent cette prise de<br />
risque et cette confiance. Mais ce sont ceux aussi <strong>le</strong>s éléments <strong>le</strong> plus liés à la personne, ses<br />
façons d’être personnel<strong>le</strong>s et socia<strong>le</strong>s, et à ce titre l’évaluation touche à des résistances et<br />
des évolutions très globa<strong>le</strong>s, souvent à long terme : pour certains élèves, même en CM , se<br />
plonger dans la <strong>le</strong>cture de son affiche reste un moyen de se protéger contre <strong>le</strong>s regards de<br />
l’auditoire, même si ces comportements diminuent. Ce critère est aussi à mettre en relation<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
avec <strong>le</strong>s caractéristiques du sujet traité, son degré de distance par rapport à l’expérience<br />
du locuteur, la sécurité du locuteur en fonction des risques qu’il a pris : certains élèves<br />
arrivent à se détacher de l’écrit et à improviser parce qu’ils ont choisi un sujet proche de<br />
<strong>le</strong>ur expérience ou bien balisé ou routinier, dans d’autres cas l’absence de familiarité avec<br />
<strong>le</strong>s contenus transmis ou <strong>le</strong>ur difficulté conduit à un retour à la <strong>le</strong>cture du document écrit. La<br />
progression n’est donc pas linéaire, mais globa<strong>le</strong>ment, on peut observer que si la maîtrise<br />
en reste inéga<strong>le</strong>, l’ensemb<strong>le</strong> des élèves a été amené à expérimenter cette pratique très<br />
diffici<strong>le</strong> qui articu<strong>le</strong> l’écrit et l’oral, à prendre conscience de certaines contraintes.<br />
Les évolutions dans <strong>le</strong> positionnement de soi à travers la présentation ora<strong>le</strong> peuvent se<br />
marquer aussi par des changements qualitatifs dans la posture énonciative. Entre par<strong>le</strong>r<br />
en son propre nom (<strong>le</strong> je particulier du témoignage d’expérience, du récit d’actions), et <strong>le</strong>s<br />
formes de transmission où <strong>le</strong> sujet s’efface derrière <strong>le</strong>s informations prises sur Internet, on<br />
peut repérer quelques indices d’apprentissage de conduites mixtes : par<strong>le</strong>r en son propre<br />
nom, mais d’une démarche de recherche ou d’un raisonnement, et toutes <strong>le</strong>s façons de<br />
passer du particulier au générique et réciproquement. Majoritairement, <strong>le</strong>s exposés relèvent<br />
soit de l’une, soit de l’autre dimension : beaucoup de sujets sont ancrés dans l’expérience<br />
personnel<strong>le</strong> et restent proches du témoignage, même au cours moyen (récit d’un voyage ou<br />
d’un événement de la vie quotidienne, une maladie ou la description d’un animal familier par<br />
exemp<strong>le</strong>). Cet ancrage dans l’expérience vécue est d’ail<strong>le</strong>urs explicitement valorisé par <strong>le</strong>s<br />
enseignants comme moyen de créer une mobilisation pour la recherche de connaissances.<br />
La deuxième catégorie d’exposés concerne des sujets qui correspondent plus ou moins à un<br />
intérêt personnel, mais que <strong>le</strong>s élèves ont traités par un recueil d’informations impersonnel<strong>le</strong>s<br />
glanées dans des documents, souvent sous forme de listes (<strong>le</strong>s scorpions, la fabrication<br />
des voitures, <strong>le</strong>s bijoux, <strong>le</strong>s maisons au Moyen Âge, <strong>le</strong> Japon…). Pour <strong>le</strong> premier type<br />
d’exposés, la difficulté qui subsiste en cours moyen est de présenter un témoignage impliqué<br />
sans rester seu<strong>le</strong>ment dans <strong>le</strong> particulier et l’anecdotique, en pointant vers des éléments<br />
de généralisation possib<strong>le</strong>, des questions et des contenus de savoir impliqués dans <strong>le</strong>s<br />
faits présentés. Surtout en CM où ces démarches sont formulées de façon explicite et<br />
plus systématique, différentes procédures ont été proposées, pour expliciter et favoriser<br />
ce passage nécessaire d’une implication affective et expérientiel<strong>le</strong> à une implication plus<br />
épistémique et heuristique : à partir du récit d’une visite à Eurodisneyland, chercher quel<strong>le</strong>s<br />
questions on peut se poser à partir des parcs d’attraction, par exemp<strong>le</strong>. Complémentairement,<br />
pour <strong>le</strong> second type d’exposés, la difficulté est de ne pas se contenter d’un inventaire de<br />
données pré<strong>le</strong>vées dans des documents, mais de montrer une démarche personnel<strong>le</strong> de<br />
questionnement, de réf<strong>le</strong>xion en rapport avec son expérience et ses motivations. Là aussi<br />
certaines procédures sont explicitées (noter en début de préparation <strong>le</strong>s questions qu’on se<br />
pose sur <strong>le</strong> sujet, ce qu’on sait déjà etc.), mais <strong>le</strong>s élèves ont dans l’ensemb<strong>le</strong> des difficultés<br />
à <strong>le</strong>s rendre opératoires. Dans <strong>le</strong>s deux cas, <strong>le</strong>s changements de régime dans l’implication<br />
restent ténus et assez laborieux, et cette difficulté semb<strong>le</strong> une des plus diffici<strong>le</strong>s à surmonter.<br />
D’une séance à l’autre, <strong>le</strong>s élèves intériorisent assez vite la règ<strong>le</strong> (introduire en début ou<br />
en fin d’exposé un petit coda sur <strong>le</strong> pourquoi, par exemp<strong>le</strong>) ; mais ce coda reste souvent<br />
formel ou tautologique (j’ai fait une recherche sur la fabrication des voitures parce que c’est<br />
intéressant je trouve <strong>le</strong>s voitures ; j’ai été dans une brasserie avec mes parents alors je<br />
vais faire une conférence sur la bière). Ce qu’il est beaucoup plus diffici<strong>le</strong> de formaliser, et<br />
d’apprendre pour <strong>le</strong>s locuteurs, c’est ce que Labov appel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s modes intégrés d’évaluation<br />
(au sens de ce qui dans <strong>le</strong> discours indique pourquoi on raconte cela), et d’autre part,<br />
à expliciter <strong>le</strong> point de vue du locuteur dans la présentation des données qu’il expose.<br />
On peut re<strong>le</strong>ver dans certains exposés des indices d’une explicitation de la démarche ou<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
du questionnement, d’un commentaire personnel sur des informations recueillies dans un<br />
document, plus rarement d’une généralisation potentiel<strong>le</strong> ou d’une mise en relation avec<br />
un problème et une recherche d’informations. Mais ces indices sont ténus, instab<strong>le</strong>s d’un<br />
exposé à un autre chez <strong>le</strong> même élève, et même si on peut l’observer, l’élargissement de<br />
ces formes d’implication reste inéga<strong>le</strong>ment partagé entre <strong>le</strong>s élèves et relativement fragi<strong>le</strong>.<br />
Enfin, l’implication dans <strong>le</strong> discours se marque aussi par la capacité à formu<strong>le</strong>r et justifier<br />
un jugement personnel ou un commentaire évaluatif sur un livre lu, une expérience ou des<br />
informations recueillies. Il s’agit là d’une compétence diffici<strong>le</strong>, très marquée sur <strong>le</strong> plan socioculturel,<br />
et qu’en général peu d’élèves de cyc<strong>le</strong> III maîtrisent. Dans la pédagogie Freinet, <strong>le</strong>s<br />
occasions qu’ont <strong>le</strong>s élèves de donner <strong>le</strong>ur avis et de formu<strong>le</strong>r des jugements en <strong>le</strong>s étayant<br />
sur des justifications sont nombreuses, beaucoup plus que dans la plupart des contextes<br />
scolaires. Cependant <strong>le</strong>s modalités d’expression du jugement et <strong>le</strong>s types de justification<br />
vont dépendre fortement du type de contenu impliqué par la présentation et du rapport à ce<br />
contenu : l’ordre de validation sera différent pour un jugement esthétique sur une œuvre, un<br />
avis sur un comportement, un jugement de type épistémique, avec de grandes différences<br />
selon <strong>le</strong> domaine épistémique. Le premier type de jugement, de type esthétique, intervient<br />
régulièrement dans <strong>le</strong>s présentations de livres, et il est particulièrement diffici<strong>le</strong> à formu<strong>le</strong>r<br />
autrement que sous forme tautologique : un livre est bien parce qu’il est bien, <strong>le</strong>s critères de<br />
beauté ou de plaisir mettant en jeu des catégories esthétiques et des savoirs disponib<strong>le</strong>s<br />
de façon très inéga<strong>le</strong> pour des élèves de cet âge, en fonction de <strong>le</strong>ur environnement socioculturel.<br />
Après une phase plus ou moins longue où ils se contentent de résumer l’histoire,<br />
la régularité de l’exercice fait prendre conscience à certains de la nécessité de justifier<br />
plus explicitement <strong>le</strong>ur choix de l’ouvrage. La fréquence des mises en situation d’énoncer<br />
des jugements produit des évolutions repérab<strong>le</strong>s, quoique à des rythmes différents, chez<br />
des élèves de niveau différent. Le respect de la forme justificative minima<strong>le</strong> (étayage d’un<br />
jugement par un énoncé) se manifeste relativement vite, <strong>le</strong>s élèves ont <strong>le</strong> souci de s’acquitter<br />
de cette formulation et de sa justification, même sous forme redondante. Ici encore ce qui<br />
semb<strong>le</strong> plus diffici<strong>le</strong> à décrire, et en même temps discriminant et diffici<strong>le</strong> à apprendre pour<br />
certains élèves, c’est la pertinence, la dimension non routinière des énoncés convoqués<br />
pour l’étayage du jugement : l’énoncé justificatif reste souvent passe-partout, et <strong>le</strong>s formu<strong>le</strong>s<br />
sont fréquemment recyclées d’un exposé à un autre (il est bien parce qu’il donne bien <strong>le</strong>s<br />
détails). Un autre domaine où apparaissent des évolutions est la formulation de jugements<br />
sur la prestation d’un camarade : même si <strong>le</strong>s évaluations globa<strong>le</strong>s restent nombreuses<br />
(c’était bien ton exposé), on observe <strong>le</strong> souci de justifier ces évaluations par une raison,<br />
souvent tautologique, même en CM , mais aussi, chez certains élèves, par des critères<br />
plus analytiques (c’était bien parce que on comprenait bien, ou parce qu’on s’y croyait). Ceci<br />
étant, pour un même locuteur, <strong>le</strong>s capacités de justification d’un avis peuvent se manifester<br />
de façon inéga<strong>le</strong> selon <strong>le</strong>s domaines : il peut être diffici<strong>le</strong> pour un élève de formu<strong>le</strong>r en quoi<br />
un livre est bien, alors qu’il arrive à justifier précisément en quoi il trouve qu’une solution<br />
proposée par un camarade n’est pas bonne. Il ne faut pas négliger non plus, sur ce point<br />
comme sur d’autres, <strong>le</strong> poids du rituel et <strong>le</strong> répertoire de raisons qui s’y est construit peu à<br />
peu et que <strong>le</strong>s élèves reprennent dans ce même contexte.<br />
La dimension de construction personnel<strong>le</strong> de l’oral peut se percevoir aussi dans l’habitude<br />
prise par <strong>le</strong>s élèves de faire face aux réactions et aux questions, voire aux critiques des<br />
autres après <strong>le</strong>ur présentation. La force du rituel <strong>le</strong>s protège contre <strong>le</strong>s agressions, mais<br />
même quand <strong>le</strong>s critiques sont sévères, ils réagissent avec sang-froid et peu de réponses<br />
vio<strong>le</strong>ntes, ce qui semb<strong>le</strong> un indice de mise à distance, du moins dans ce contexte. Pour ce<br />
qui est de la pertinence dans la réponse aux questions, cette dimension sera abordée en<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
deuxième partie.<br />
1.1.3. Décentration et prise en compte des auditeurs<br />
On peut classer dans ce même cadre socio-identitaire <strong>le</strong>s indicateurs qui permettent<br />
d’inférer chez celui qui expose une décentration et un ajustement aux auditeurs, même<br />
si la décentration met aussi en jeu une dimension cognitive. Certains de ces indicateurs<br />
peuvent aussi être pointés assez faci<strong>le</strong>ment comme objets de travail pour <strong>le</strong>s élèves : ainsi<br />
l’explicitation des références inconnues des locuteurs (cadre de la situation, noms propres…),<br />
la reformulation ou la définition des mots dont on a appris <strong>le</strong> sens mais qui sont nouveaux<br />
pour <strong>le</strong> reste de la classe. Certains élèves continuent longtemps à avoir besoin qu’on <strong>le</strong>s<br />
questionne pour expliciter <strong>le</strong> sens d’un terme dont ils ne s’aperçoivent pas qu’il est inconnu<br />
de l’auditoire. Mais on peut repérer chez quelques-uns une appropriation de techniques<br />
de définition intégrée au discours, du moins pour <strong>le</strong>s mots rares, spécialisés ou ressentis<br />
comme spécifiques à une culture (hallal), pratiquement jamais pour des mots ressentis<br />
comme évidents. La dimension dialogique de décentration intervient de façon organisatrice<br />
dans l’activité d’exposition : el<strong>le</strong> intègre de façon explicite ou implicite un questionnement<br />
possib<strong>le</strong> de l’interlocuteur, comme l’a montré Labov. Cependant, <strong>le</strong>s traces visib<strong>le</strong>s du<br />
dialogisme (au sens de place donnée à l’interlocuteur) dans l’exposé monologal des élèves<br />
restent peu fréquentes. Les quelques marques linguistiques qu’on peut repérer, la présence<br />
de questions par exemp<strong>le</strong>, peuvent être interprétées tantôt comme une technique intégrée<br />
par des élèves d’emblée habi<strong>le</strong>s (c’est l’exposé sur <strong>le</strong>s travaux et à quoi servent <strong>le</strong>s travaux<br />
ben <strong>le</strong>s travaux ça sert à changer <strong>le</strong>s tuyaux d’eau chaude parce que… après d’où vient<br />
l’eau chaude ben l’eau chaude el<strong>le</strong> vient de la grande pyramide et donc c’est qu’est-ce que<br />
la pyramide la pyramide ben c’est la chaufferie l’eau chaude el<strong>le</strong> va dans <strong>le</strong>s stockages<br />
dans <strong>le</strong>s gros ballons <strong>le</strong>s ballons qui sont sur <strong>le</strong> toit des immeub<strong>le</strong>s CE2), tantôt comme<br />
appui pour l’énonciation pour un locuteur hésitant (ils mangent euh ben des qu’est-ce qu’ils<br />
mangent ben des des souris des trucs comme ça CE ). Par contre des traces repérab<strong>le</strong>s<br />
de polyphonie peuvent apparaître dans <strong>le</strong>s références (rares mais bien repérab<strong>le</strong>s) aux<br />
propos tenus par autrui (<strong>le</strong> maître ou d’autres élèves), à d’autres exposés ; el<strong>le</strong>s constituent<br />
aussi des indices relativement sûrs, à la fois sur <strong>le</strong> plan linguistique et sur celui des attitudes<br />
socia<strong>le</strong>s visées par <strong>le</strong> dispositif.<br />
1.2. Pour <strong>le</strong>s auditeurs<br />
1.2.1. L’intégration des règ<strong>le</strong>s de communication<br />
Pour <strong>le</strong>s auditeurs, on peut considérer que la capacité d’écoute est significative de progrès<br />
langagier, même si sa forme élémentaire (<strong>le</strong> si<strong>le</strong>nce pendant que quelqu’un par<strong>le</strong>, l’attention)<br />
relève aussi d’autres facteurs, liés aux règ<strong>le</strong>s disciplinaires instituées dans la classe. Le<br />
respect des tours de paro<strong>le</strong>, soutenu par un dispositif contraignant et fortement ritualisé,<br />
est un bon indicateur de l’intégration de règ<strong>le</strong>s communicatives, du moins dans ce contexte<br />
spécifique. De ce point de vue, <strong>le</strong>s résultats obtenus sont spectaculaires et rapides, dès <strong>le</strong><br />
CE : l’ensemb<strong>le</strong> des élèves a appris à respecter la paro<strong>le</strong> de celui qui par<strong>le</strong>, à se concentrer<br />
sur ce qu’il dit (si<strong>le</strong>nce, regards, peu d’occupations parasites) et à différer <strong>le</strong>ur propre prise<br />
de paro<strong>le</strong>. Le sérieux du climat de travail oral est à cet égard impressionnant. Un système<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
de rappels à l’ordre et de pénalisations assumés par l’élève animateur existe pour ceux<br />
qui ne respectent pas celui qui expose ; mais cette contrainte forte produit une disposition<br />
d’écoute qui n’est pas seu<strong>le</strong>ment passive. Reste bien sûr à mesurer jusqu’à quel point ces<br />
dispositions subsistent en dehors du contexte scolaire précis et des codes bien intégrés qui<br />
<strong>le</strong>s produisent.<br />
Les élèves ont vite intégré <strong>le</strong> rituel du questionnement, et prennent ensuite la paro<strong>le</strong> à tour<br />
de rô<strong>le</strong>, de façon ordonnée et relativement formel<strong>le</strong>. Il s’agit aussi d’un apprentissage qui<br />
s’opère de façon rapide et évidente. On peut constater que si au début chaque élève donne<br />
son avis ou pose ses questions sans tenir compte de ce qui a déjà été dit par d’autres, ces<br />
redondances (qu’on observe fréquemment dans <strong>le</strong>s cours moyens) diminuent fortement et<br />
que <strong>le</strong>s élèves semb<strong>le</strong>nt plus attentifs aux interventions des autres élèves et aux réponses<br />
déjà données. Des remarques relatives à ces redondances éventuel<strong>le</strong>s signa<strong>le</strong>nt des<br />
progrès dans la conscience méta-communicative : <strong>le</strong>s élèves sont habitués à réfléchir sur<br />
<strong>le</strong>s discours tenus et à tenir des commentaires sur eux.<br />
1.2.2. L’apprentissage de l’écoute<br />
À un deuxième niveau de l’écoute, on peut prendre comme indicateur la précision des<br />
questions ou des avis des auditeurs après l’exposé : questions formel<strong>le</strong>s, questions plus ou<br />
moins ciblées sur la spécificité de ce qui a été dit, référence précise à un énoncé entendu,<br />
citation (ben Sophia quand t’as parlé là t’as dit ils fouil<strong>le</strong>nt profondément <strong>le</strong> sol mais qu’estce<br />
qu’ils fouil<strong>le</strong>nt <strong>le</strong> sol). Si l’écoute de l’exposé au sens de respect des règ<strong>le</strong>s de sociabilité<br />
paraît indéniab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s questions ou avis sont au départ majoritairement autocentrés : <strong>le</strong>s<br />
auditeurs prennent la paro<strong>le</strong> pour rapprocher ce qu’a dit l’exposant de ce qu’eux-mêmes ont<br />
vécu (sur <strong>le</strong> mode du moi aussi j’ai été à, moi aussi j’ai un chat qui s’appel<strong>le</strong>…). Ce mode de<br />
réception subsiste chez une partie des élèves, même en deuxième année. Progressivement,<br />
on observe chez une partie des élèves un plus grand ajustement des réactions à la spécificité<br />
de ce qui a été dit : des questions ou commentaires plus précis peuvent être interprétés<br />
comme indices soit d’un souci de bien recouvrer l’univers de celui qui expose, soit dans<br />
certains cas d’un essai d’étayage, d’aide au développement. Les questions portent soit sur<br />
<strong>le</strong>s éléments informatifs présentés, <strong>le</strong> plus souvent, soit sur l’intention ou <strong>le</strong> choix de celui<br />
qui a présenté. Cependant là aussi la circulation et l’appropriation des formu<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong><br />
groupe induit des routinisations de certaines questions ou remarques, qui deviennent un<br />
passage obligé à chaque passation, en perdant <strong>le</strong>ur spécificité. Ces indices deviennent<br />
alors diffici<strong>le</strong>ment interprétab<strong>le</strong>s et fortement liés au contexte du rituel. Faut-il considérer<br />
par exemp<strong>le</strong> une question sur <strong>le</strong> passage préféré du locuteur posée à chaque fois par<br />
<strong>le</strong>s mêmes enfants comme un indice de décentration, ou comme indice d’un rituel qui<br />
signa<strong>le</strong> la participation à une culture commune, mais acquiert progressivement une part<br />
d’automatisme ?<br />
Si <strong>le</strong>s élèves manifestent peu à peu <strong>le</strong> souci de ne pas répéter une question déjà posée,<br />
ils parviennent peu à enchaîner sur <strong>le</strong>s questions précédentes, et <strong>le</strong>s questions restent<br />
dispersées. Dans certains cas, mais qui restent rares, on peut observer en CM une continuité<br />
thématique entre <strong>le</strong>s questions, qui permettent un relatif approfondissement autour d’un<br />
même thème, et des éléments de discussion. Mais la plupart du temps, <strong>le</strong>s changements<br />
thématiques sont rapides et <strong>le</strong>s questions marquent rarement un approfondissement.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
2. Les indicateurs liés à la prise en compte du langage dans ses<br />
fonctions cognitives<br />
Des pratiques ora<strong>le</strong>s comme l’exposé ou <strong>le</strong> compte rendu, <strong>le</strong> questionnement ou la<br />
formulation d’un avis ne peuvent pas être considérés comme des formes dont il faudrait<br />
seu<strong>le</strong>ment maîtriser <strong>le</strong>s codes. Même s’ils portent sur des sujets familiers, ils mettent en<br />
jeu des contenus, des savoirs, une façon d’élaborer l’expérience, des raisonnements, et<br />
ont une fonction de réf<strong>le</strong>xion sur <strong>le</strong> vécu et d’accès aux connaissances. Ces dimensions<br />
pèsent fortement dans <strong>le</strong>s jugements de qualité, et d’autant plus quand <strong>le</strong>s prises de paro<strong>le</strong><br />
sont intégrées à des visées de constructions de savoirs. L’évaluation du langage doit donc<br />
prendre en compte la façon dont <strong>le</strong>s présentations abordent <strong>le</strong>s sujets choisis, à quel niveau<br />
de traitement, selon quels modes de structuration, ce qui détermine en partie <strong>le</strong>s genres<br />
discursifs adoptés (chronique ou explication, par exemp<strong>le</strong>) et <strong>le</strong>s indices de comp<strong>le</strong>xité sur<br />
<strong>le</strong> plan linguistique. Dans quel<strong>le</strong> mesure la pratique régulière des exposés suscite-t-el<strong>le</strong> des<br />
évolutions sur <strong>le</strong> plan de la qualité des contenus transmis ?<br />
2.1. Pour ceux qui exposent<br />
2.1.1. Présenter des livres<br />
Concernant la présentation de livres, certaines caractéristiques du genre relèvent d’une<br />
codification vite acquise par tous <strong>le</strong>s élèves ; ainsi la présentation d’éléments informatifs sur<br />
l’auteur, l’éditeur, mais aussi <strong>le</strong> fait de poser une question en fin de présentation pour tester la<br />
compréhension des camarades, sont respectés par tous. Hormis <strong>le</strong>s indices préalab<strong>le</strong>ment<br />
évoqués du nombre de livres lus et du sérieux dans la préparation, une évolution dans <strong>le</strong>s<br />
conduites de résumé peut être observée. On peut prendre comme indicateurs la longueur<br />
croissante de la présentation, chez l’ensemb<strong>le</strong> des élèves observés (même si ce critère est<br />
ambiva<strong>le</strong>nt), <strong>le</strong> nombre d’épisodes identifiab<strong>le</strong>s lié à une meil<strong>le</strong>ure mémorisation, qu’on peut<br />
observer chez la plupart des élèves. Ces évolutions, corollaires à une meil<strong>le</strong>ure aisance<br />
face au groupe et à un changement du rapport au travail scolaire, semb<strong>le</strong>nt significatives.<br />
On observe aussi une efficacité croissante de la plupart des présentations dans la gestion<br />
de la référence et dans l’explicitation : cadrage de la situation, identification des actants,<br />
succession des actions. La trame de l’histoire, <strong>le</strong>s relations entre personnages deviennent<br />
dans la plupart des cas plus compréhensib<strong>le</strong>s (avec des variations selon <strong>le</strong> degré de<br />
comp<strong>le</strong>xité de l’histoire, mais il faut souligner que <strong>le</strong>s livres choisis sont souvent des albums<br />
assez courts et simp<strong>le</strong>s pour des élèves de ce niveau scolaire). Sur ce point l’évolution<br />
semb<strong>le</strong> nette ; des élèves sont capab<strong>le</strong>s de recommencer une présentation ratée pour la<br />
retravail<strong>le</strong>r en restituant l’histoire de façon complète et compréhensib<strong>le</strong>.<br />
On peut observer des progrès dans la nature des enchaînements chez une partie des<br />
élèves : davantage de liens de causalité entre actions, ou d’opposition, de justification des<br />
conduites des personnages par explicitation de raisons ou d’intentionnalité. On voit apparaître<br />
quelques verbalisations d’états mentaux des personnages (croyances, buts, réactions aux<br />
événements). Ces évolutions semb<strong>le</strong>nt cependant plus <strong>le</strong>ntes et moins bien partagées :<br />
beaucoup de présentations d’histoires continuent à présenter une accumulation de faits<br />
dont la succession peut être inférée par l’auditeur, mais avec peu d’explicitation des liens<br />
logiques (conséquence, cause, condition) ou intentionnels (but et moyen, états mentaux des<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
personnages). Un autre point d’évaluation qui reste problématique touche à la capacité de<br />
hiérarchiser et de regrouper <strong>le</strong>s événements rappelés : ce point reste discriminant, comme<br />
chez beaucoup d’élèves de cet âge. Chez certains élèves, <strong>le</strong>s résumés témoignent d’un<br />
souci croissant de dégager <strong>le</strong>s éléments <strong>le</strong>s plus importants de l’histoire et de marquer <strong>le</strong>s<br />
étapes regroupant plusieurs événements, et d’amorcer un bilan ou une évaluation. À cet<br />
égard, certaines présentations observées en CM marquaient des progrès remarquab<strong>le</strong>s<br />
chez ces élèves, par rapport à <strong>le</strong>urs prestations initia<strong>le</strong>s. Cette capacité accrue de synthèse<br />
amène d’ail<strong>le</strong>urs un raccourcissement du résumé, ce qui n’est pas forcément un critère positif<br />
aux yeux des autres élèves. Mais pour beaucoup, il reste diffici<strong>le</strong> de ne pas se perdre dans<br />
<strong>le</strong>s détails, et <strong>le</strong> marquage des grandes étapes de l’histoire n’apparaît pas clairement.<br />
Cette capacité de hiérarchisation et de synthèse est devenue en CM un objectif clairement<br />
explicité, qui a donné lieu à une consigne supplémentaire : dégager en une phrase, à la<br />
fin du résumé, l’essentiel de l’histoire. La contrainte de cette coda est respectée par <strong>le</strong>s<br />
élèves, et apparaît dans l’ensemb<strong>le</strong> opératoire. Si pour une partie d’entre eux, la formu<strong>le</strong><br />
semb<strong>le</strong> rester plus globa<strong>le</strong> ou partiel<strong>le</strong>, quelques-uns arrivent à condenser en une seu<strong>le</strong><br />
phrase plusieurs éléments pertinents en relation (du type c’est un monsieur qui vo<strong>le</strong> une<br />
poupée à une petite fil<strong>le</strong> parce que sa mère est retombée en enfance). On peut penser que<br />
cette explicitation du critère est susceptib<strong>le</strong> d’induire un resserrement des résumés euxmêmes.<br />
Un autre indicateur de cette capacité à dégager l’essentiel peut être la question<br />
que rituel<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> présentateur pose à l’auditoire pour tester sa compréhension. Le type<br />
de questions posées semb<strong>le</strong> significatif de ce qu’il juge important dans ce qu’il a dit : malgré<br />
quelques questions centrées sur des données ou des raisons qui constituent des ressorts<br />
de la narration (pourquoi <strong>le</strong> monsieur il a volé cette poupée ?), la plupart des élèves ont du<br />
mal à dépasser un niveau anecdotique et factuel (comment il s’appel<strong>le</strong> son chien ?).<br />
2.1.2. Présenter un exposé<br />
Au-delà des jugements liés à la transmission du message, l’évaluation englobe des<br />
jugements relatifs à l’élaboration du message lui-même, ce qu’il donne à voir de la sé<strong>le</strong>ction<br />
et du traitement des référents qu’il propose. Cet élément de variation entre élèves peut<br />
évidemment être partiel<strong>le</strong>ment contourné si, pour homogénéiser <strong>le</strong>s prestations et faciliter<br />
la tâche d’enseignement comme cel<strong>le</strong> d’évaluation, on fait traiter aux élèves une série de<br />
thèmes apparentés appelant <strong>le</strong> même traitement (taxonomique, par exemp<strong>le</strong> une série de<br />
présentations d’animaux sur <strong>le</strong> même modè<strong>le</strong>), et un canevas de présentation contraignant<br />
à respecter. Mais en dehors de ce formatage, <strong>le</strong>s conduites langagières sont diffici<strong>le</strong>ment<br />
séparab<strong>le</strong>s de la façon dont el<strong>le</strong>s découpent et construisent <strong>le</strong>ur référent, du positionnement<br />
épistémique : <strong>le</strong>s présentations ne sont pas équiva<strong>le</strong>ntes du point de vue du niveau de<br />
traitement des référents, de la problématisation. On peut par<strong>le</strong>r d’un animal familier sur <strong>le</strong><br />
mode du témoignage personnel, de la chronique ou du récit d’expérience, on peut aussi<br />
s’inspirer des présentations descriptives et taxonomiques des documentaires consultés, on<br />
peut sou<strong>le</strong>ver un problème à partir d’une analyse du vécu. Les critères de développement<br />
et de différenciation entre locuteurs seront alors la prédominance d’éléments factuels,<br />
narratifs ou descriptifs, de structures de liste, ou <strong>le</strong>s indices de l’explication d’un processus,<br />
l’émergence de démarches de comparaison, de mise en relation avec des éléments déjà<br />
vus ou avec une question plus large, de questionnement.<br />
Pour <strong>le</strong>s exposés, <strong>le</strong> choix du sujet relève de l’initiative des élèves, en fonction d’événements<br />
de <strong>le</strong>ur vie personnel<strong>le</strong>, parfois de la classe ou du quartier, d’intérêts ou de trouvail<strong>le</strong>s<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
documentaires. L’implication affective est souvent importante. Ces choix ne sont pas planifiés<br />
et n’entrent pas dans une progression ou une séquentialité construite par <strong>le</strong>s enseignants<br />
en fonction de thèmes de travail communs ou d’objectifs d’approfondissement dans un<br />
domaine. Il y a donc à la fois à un même moment une très grande variété de sujets abordés,<br />
et à plus long terme (une ou deux années) <strong>le</strong> retour de sujets de même type, qu’on peut<br />
ramener à quelques catégories (<strong>le</strong>s animaux, <strong>le</strong>s pays étrangers, la fabrication de produits<br />
alimentaires ou manufacturés, <strong>le</strong>s coutumes etc.). On peut donc se demander dans quel<strong>le</strong><br />
mesure <strong>le</strong>s choix de traitement de ces sujets évoluent au cours d’une année, ou des deux<br />
années de CE et CM .<br />
Le point de départ des exposés est très souvent une expérience personnel<strong>le</strong>, et pendant<br />
une partie de l’année de CE beaucoup d’entre eux se présentent comme une chronique ou<br />
un récit d’expérience : une maladie, l’accident arrivé à un animal familier, la visite d’un site<br />
effectuée en famil<strong>le</strong>. Dans ces cas, l’exposé prend la forme d’une description d’actions, régie<br />
par un principe de structuration chronologique et sur <strong>le</strong> mode du particulier : <strong>le</strong>s énoncés<br />
sont reliés par des liens de successivité, et même si <strong>le</strong>s faits relatés mettent en jeu des<br />
connaissances ou des problèmes plus généraux qui pourraient rejoindre des contenus de<br />
savoir abordab<strong>le</strong>s en CE ou en CM , ces éléments sont rarement thématisés en tant que<br />
tels. Ainsi l’élève de CM (assez bonne élève, très volontaire et sérieuse pour <strong>le</strong>s exposés)<br />
qui fait un exposé sur « ma gastro » relate assez clairement son malaise (je me sentais pas<br />
bien, j’avais mal au ventre), mentionne la décision de sa mère de faire venir <strong>le</strong> médecin,<br />
l’heure à laquel<strong>le</strong> il est venu, et plus longuement <strong>le</strong>s jeux Nintendo auxquels el<strong>le</strong> a joué<br />
avec sa camarade venue lui rendre visite, puis son retour à l’éco<strong>le</strong>. Malgré <strong>le</strong>s incitations de<br />
l’enseignant durant la préparation, el<strong>le</strong> n’a pas jugé bon de s’attarder sur <strong>le</strong>s symptômes plus<br />
précis du malaise (ce qui peut se comprendre), <strong>le</strong>s questions du médecin ou <strong>le</strong>s origines<br />
de la maladie. À une question d’un camarade (comment tu l’as attrapée ?) el<strong>le</strong> hausse <strong>le</strong>s<br />
épau<strong>le</strong>s et évoque vaguement <strong>le</strong> fait d’avoir trop mangé ; la proposition d’une autre élève<br />
(c’est des microbes) n’est pas reprise par l’exposante, faute d’une appréhension préalab<strong>le</strong><br />
de cette dimension de la question. De même la relation de l’expérience du séjour forcé à la<br />
maison reste anecdotique et ne donne pas vraiment lieu à un début d’analyse de ce vécu<br />
très particulier. Ces directions de réf<strong>le</strong>xion sont régulièrement explicitées par l’enseignant,<br />
comme des pistes à creuser ; un dispositif plus systématique a été mis en œuvre en CM<br />
pour faire émerger <strong>le</strong>s questions possib<strong>le</strong>s à partir du premier témoignage, en vue d’un<br />
deuxième exposé. Mais il reste diffici<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s élèves d’initier eux-mêmes cette ouverture sur<br />
d’autres sujets, et de dépasser ce que la relation de l’expérience peut avoir d’anecdotique :<br />
<strong>le</strong> problème reste de trouver <strong>le</strong>s relais qui permettent d’élargir et de nourrir cette motivation<br />
pour la mettre en relation avec des problèmes ou des savoirs plus généraux.<br />
D’autres sujets, moins liés à la personne, relèvent parfois d’un choix plus aléatoire ou arbitraire,<br />
d’autant plus que <strong>le</strong> rythme de rotation des présentations est plus rapide : il peut arriver que<br />
l’objectif de fréquence de la prise de paro<strong>le</strong> entre en concurrence avec celui d’investissement<br />
épistémique dans la préparation. Quand ils traitent des sujets comme <strong>le</strong> Japon, <strong>le</strong>s dauphins,<br />
la pomme de pin, <strong>le</strong>s repas, la pollution, <strong>le</strong>s maisons du Moyen Âge, <strong>le</strong>s élèves se réfèrent<br />
à un ou des documents, parfois choisis un peu au hasard, dont ils restituent des bribes, plus<br />
ou moins sur <strong>le</strong> mode du collage. L’investissement est important dans l’ensemb<strong>le</strong>, et suscite<br />
une consultation régulière de documents. Mais cette recherche semb<strong>le</strong> se marquer plutôt<br />
par la recherche d’images, de photos, à l’écrit par des ornementations, des collages, et<br />
pour beaucoup d’élèves un soin pointil<strong>le</strong>ux apporté à la présentation du document (surtout<br />
sensib<strong>le</strong> en CM ), plus que par <strong>le</strong> souci d’élargir ou de vérifier l’information. L’organisation<br />
des exposés de ce type reste dans l’ensemb<strong>le</strong> accumulative : on observe souvent une<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
juxtaposition d’éléments factuels plus ou moins hétéroclites, et beaucoup de présentations<br />
évoluent assez rapidement vers des enchaînements de type inventaire ou taxonomie, plus<br />
ou moins regroupés en grandes rubriques (alors pour <strong>le</strong>urs habits ils mettent… alors pour<br />
<strong>le</strong>ur nourriture ils mangent tel et tel mets) ou vers un commentaire des images figurant sur<br />
l’affiche (alors là c’est… et là c’est…). Quelques exposés ayant pour sujet un processus<br />
parviennent à restituer de façon claire l’enchaînement des phases, mais plutôt sous forme<br />
de séquences chronologiques (<strong>le</strong>s étapes de la fabrication de la bière, <strong>le</strong> circuit du chauffage<br />
à Mons), mais ce qui sous-tend <strong>le</strong> processus de transformation n’est pas vraiment abordé.<br />
Il <strong>le</strong>ur est évidemment diffici<strong>le</strong> à partir de <strong>le</strong>ur recherche de dégager des informations<br />
rencontrées des notions intégratrices, tel<strong>le</strong>s que <strong>le</strong>s mentionnent <strong>le</strong>s programmes de cyc<strong>le</strong><br />
III, comme <strong>le</strong>s grandes fonctions en sciences de la vie, <strong>le</strong> lien avec l’environnement etc. :<br />
ainsi la présentation des pays reste très factuel<strong>le</strong> et anecdotique. Dans l’ensemb<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s<br />
élèves ont du mal à construire une question épistémique, des repères de connaissance<br />
et une stratégie dans la recherche de documentation, permettant une organisation des<br />
énoncés selon des relations en termes de causalité, de fonctions (pourquoi ce type de<br />
nourriture, ou ce type d’habitat par exemp<strong>le</strong> ?), d’évolution, de comparaison, ce qui n’est<br />
pas du tout étonnant en cyc<strong>le</strong> III. Malgré <strong>le</strong> temps considérab<strong>le</strong> passé à ces recherches,<br />
malgré certaines procédures proposées par <strong>le</strong>s enseignants (formu<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s questions qu’on<br />
peut se poser, ce qu’on sait déjà et ce qu’on ne sait pas, ce qu’on croit, <strong>le</strong>s différentes<br />
sources possib<strong>le</strong>s…), c’est sans doute <strong>le</strong> point sur <strong>le</strong>quel <strong>le</strong>s évolutions semb<strong>le</strong>nt <strong>le</strong> moins<br />
apparentes ou <strong>le</strong> plus <strong>le</strong>ntes pour <strong>le</strong> plus grand nombre des élèves, et on observe une<br />
certaine constance dans <strong>le</strong> type d’organisation d’un exposé à un autre.<br />
Un indicateur peut être la façon dont coexistent et sont articulés dans <strong>le</strong> discours des régimes<br />
énonciatifs différents, identifiab<strong>le</strong>s comme tels (appel aux auditeurs, moments de prise en<br />
charge sur <strong>le</strong> mode du témoignage personnel, reformulation de <strong>le</strong>ctures ou de paro<strong>le</strong>s<br />
d’autrui, commentaire, formulation d’une question). Ainsi on peut considérer l’exposé de<br />
Céci<strong>le</strong> sur <strong>le</strong>s châteaux forts comme re<strong>le</strong>vant d’une organisation primitive de liste (une série<br />
de monstrations successives sur une maquette), et repérer l’absence d’énoncés mettant en<br />
relation <strong>le</strong>s caractéristiques inventoriées avec des fonctions (alors là c’est la porte là c’est<br />
l’écurie là c’est <strong>le</strong> donjon (manipu<strong>le</strong> la porte) la porte el<strong>le</strong> marche pas très bien et puis il y a<br />
des châteaux là ils habitent il y avait des grands lits et puis il y avait des bancs pour ceux qui<br />
étaient malades <strong>le</strong>s instruments pour la guerre étaient des arbalètes des arcs des euh). On<br />
peut évaluer à l’inverse comme pertinente la remarque de Lucien et la rattacher à un autre<br />
niveau de traitement de l’objet (moi j’ai été dans un château et il y avait un guide et la guide<br />
el<strong>le</strong> avait dit que c’était important de montrer qu’on avait de la va<strong>le</strong>ur CE ), en mobilisant pour<br />
ce jugement plusieurs indices discursifs (présence de paro<strong>le</strong>s rapportées, indication d’une<br />
finalité, présence d’un jugement sur l’importance). Mais <strong>le</strong> fait de sé<strong>le</strong>ctionner cet apportlà,<br />
de <strong>le</strong> mobiliser à ce moment-à relève-t-il d’une compétence ora<strong>le</strong>, et peut-il s’apprendre<br />
dans une didactique de l’oral ?<br />
Il faut mentionner enfin <strong>le</strong> travail de réf<strong>le</strong>xion sur ces questions d’épistémologie qui est<br />
proposé aux élèves, surtout en CM , par <strong>le</strong>s interventions de l’enseignant à propos des<br />
activités d’exposé : <strong>le</strong>s élèves sont fréquemment amenés à se demander s’ils savent<br />
ou s’ils croient, s’ils sont sûrs ou non de ce qu’ils avancent. On peut voir des traces de<br />
cette préoccupation sur <strong>le</strong>s modalités du savoir dans <strong>le</strong>s exposés de quelques élèves, qui<br />
mentionnent <strong>le</strong>ur source, indiquent quand ils croient et ne sont pas sûrs (plus d’ail<strong>le</strong>urs<br />
dans <strong>le</strong>s réponses aux questions que dans la phase d’exposé el<strong>le</strong>-même : on peut l’inférer<br />
à partir de la présence d’indicateurs de modalités épistémiques du type certain / douteux<br />
(ainsi à une question sur la respiration des grillons, la réponse peut-être avec des branchies<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
je sais pas il faudrait regarder peut-être qu’ils respirent pas). Même si el<strong>le</strong> ne concerne<br />
vraisemblab<strong>le</strong>ment pas l’ensemb<strong>le</strong> des élèves, il s’agit d’une compétence remarquab<strong>le</strong> pour<br />
des élèves de cyc<strong>le</strong> III.<br />
2.2. Pour ceux qui écoutent et questionnent<br />
De même pour évaluer des évolutions dans la façon dont <strong>le</strong>s élèves qui écoutent questionnent<br />
ou commentent ce qu’ils ont entendu, on a besoin de recourir à des critères comme la<br />
précision ou la pertinence, qui se situent au carrefour des dimensions psychologique,<br />
cognitive et linguistique.<br />
Si <strong>le</strong> sérieux et la discipline dans l’écoute et la prise de paro<strong>le</strong> sont à observer chez l’ensemb<strong>le</strong><br />
des élèves, comme on l’a vu précédemment, il peut y avoir des niveaux très différents dans<br />
la qualité du retour qui est fait à l’exposant sur ce qu’il a présenté.<br />
Au départ, <strong>le</strong>s commentaires étaient majoritairement globaux et indifférenciés (il était bien<br />
ton exposé ; j’ai rien compris). Même si ce genre d’intervention subsiste chez beaucoup,<br />
on peut observer, avec la régularité de l’écoute, une tendance à situer plus précisément la<br />
question ou <strong>le</strong> commentaire sur un aspect de ce qui a été dit : davantage d’interventions<br />
se focalisent sur un moment ou un énoncé posant problème (de type à la fin j’ai pas<br />
compris qu’est-ce qu’il a ce que j’ai pas compris c’est pourquoi il voulait pas.), relèvent une<br />
contradiction ou une omission, ou demandent une justification focalisée sur une assertion<br />
précise de l’exposé.<br />
Beaucoup d’interventions apportent un élément complémentaire d’information. Si durant <strong>le</strong><br />
premier trimestre du CE ces compléments étaient <strong>le</strong> plus souvent autocentrés et rattachés à<br />
l’expérience personnel<strong>le</strong> de l’intervenant (ce qui reste vrai même en CM sur certains sujets<br />
sensib<strong>le</strong>s), <strong>le</strong>s élèves semb<strong>le</strong>nt intégrer progressivement, plus ou moins rapidement selon<br />
<strong>le</strong>s cas, certaines caractéristiques de la tâche, et on observe une plus grande proportion<br />
d’apports informatifs sur l’objet lui-même, en rapport avec l’expérience, ou avec d’autres<br />
sources, notamment la <strong>le</strong>cture de documents (un arbre ça peut al<strong>le</strong>r très haut parce que j’ai<br />
lu dans un livre qu’on pouvait faire un tunnel CE ) ou un travail scolaire antérieur (quand<br />
on était en Charente <strong>le</strong> prof il m’avait dit qu’un arbre ça faisait une dizaine de mètres). Il y<br />
a donc une clarification progressive des visées de l’exercice, et une certaine socialisation<br />
des informations. On observe éga<strong>le</strong>ment qu’en cours d’année <strong>le</strong>s élèves apportent moins<br />
d’informations déjà données par d’autres, ce qui semb<strong>le</strong> indiquer que <strong>le</strong>s enjeux affectifs<br />
de la prise de la paro<strong>le</strong> ou ses visées de valorisation personnel<strong>le</strong>, même s’ils restent forts,<br />
font place, sinon à des enjeux plus épistémiques, du moins à une représentation de la<br />
tâche plus en termes de travail en commun sur un sujet. On observe aussi quelques<br />
amorces d’enchaînements marquant une continuité thématique entre <strong>le</strong>s compléments<br />
d’information apportées par plusieurs élèves, ce qui pourrait potentiel<strong>le</strong>ment constituer un<br />
approfondissement en commun du thème, ou des amorces de débat. Mais ces moments<br />
de convergence restent rares, et il y a peu de discussions ou de réfutations. Peut-être la<br />
codification un peu formel<strong>le</strong> de la prise de paro<strong>le</strong> à tour de rô<strong>le</strong>, gérée par l’élève animateur<br />
sans une visée relative au contenu, induit-el<strong>le</strong> une dispersion des interventions, qui restent<br />
pour la plupart juxtaposées.<br />
De même <strong>le</strong>s informations complémentaires proposées sont souvent factuel<strong>le</strong>s, loca<strong>le</strong>s,<br />
et permettent rarement une recatégorisation, ou une intégration dans des notions plus<br />
intégratives. En CM , l’enseignant aborde explicitement la question, en soulignant que ce<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
serait <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> de l’animateur de la séance d’écarter <strong>le</strong>s questions ou <strong>le</strong>s compléments trop<br />
anecdotiques ou éloignés du thème principal : mais au cours des séances observées, aucun<br />
élève animateur n’a été à même d’opérer cette sé<strong>le</strong>ction en termes de pertinence, ce qui<br />
semb<strong>le</strong> un objectif essentiel mais ambitieux pour des élèves de cours moyen.<br />
Un indicateur essentiel est en effet <strong>le</strong> niveau de traitement qu’induit la question ou <strong>le</strong><br />
commentaire : beaucoup restent des demandes d’information ou d’explicitation portant<br />
sur des points factuels qu’on peut estimer de détail, qui appel<strong>le</strong>nt des réponses brèves et<br />
informatives. Mais on pourra interpréter une question ou un commentaire comme pertinents<br />
sans qu’on puisse toujours rattacher ce jugement à des phénomènes linguistiques réguliers.<br />
Certaines questions peuvent être jugées pertinentes, en ce qu’el<strong>le</strong>s ouvrent sur un autre<br />
espace de questionnement, notamment par un déplacement de la thématisation (la question<br />
posant comme thème l’élément présupposé par l’énoncé précédent). Mais ce déplacement<br />
n’est pas toujours compris par l’élève questionné, à la fois parce qu’il n’entrevoit pas une<br />
autre dimension des faits présentés, et parce que la question el<strong>le</strong>-même parvient mal à<br />
expliciter son foyer et <strong>le</strong> déplacement qu’el<strong>le</strong> pourrait amener. Dans ce cas l’élève cherche<br />
à reformu<strong>le</strong>r, mais souvent répète l’énoncé non compris. Ainsi, après <strong>le</strong> récit par une élève<br />
de l’accident, l’amputation et la guérison de son chat, <strong>le</strong> changement de niveau que propose<br />
la question d’un élève sur <strong>le</strong> processus de guérison (interrogation sur <strong>le</strong>s phénomènes de<br />
cicatrisation) reste implicite, question qu’il réitère faute de savoir la reformu<strong>le</strong>r :<br />
A<strong>le</strong>x : comment ça s’est guéri ?<br />
Jessica : ben ils l’ont recousu<br />
A<strong>le</strong>x : ben oui mais comment ça s’est guéri ?<br />
Jessica : ben ça s’est guéri (CM )<br />
Quand il intervient dans la question d’un élève, ce déplacement de ce qui était thème et<br />
présupposés ne parvient qu’exceptionnel<strong>le</strong>ment à ouvrir un nouveau développement<br />
thématique si l’enseignant ne <strong>le</strong> relaye pas en explicitant <strong>le</strong>s enjeux de la question et <strong>le</strong><br />
changement de niveau de traitement. Le jugement de pertinence de l’adulte ne converge<br />
pas toujours avec <strong>le</strong>s effets pragmatiques produits dans l’interaction : une question comme<br />
cel<strong>le</strong> d’A<strong>le</strong>xandre, pertinente aux yeux de l’enseignant, est souvent disqualifiée par <strong>le</strong>s<br />
élèves questionnés, qui ne comprennent pas ce qui en est <strong>le</strong> foyer :<br />
A<strong>le</strong>xandre : moi j’ai deux petits choses à vous dire c’est comment <strong>le</strong> bébé il se fait et la<br />
deuxième c’est comment il peut se nourrir<br />
Hinde : ben on l’a dit<br />
A<strong>le</strong>xandre : oui mais comment<br />
Roxane : ben la maman el<strong>le</strong> mange et ça passe dans un tuyau<br />
A<strong>le</strong>xandre : mais comment… (CE )<br />
La difficulté didactique intrinsèque à l’exercice, pour l’enseignant, est de savoir quand<br />
et jusqu’à quel point valoriser et renvoyer au groupe une question qu’il juge pertinente,<br />
soit pour expliciter <strong>le</strong> mécanisme même d’une question d’approfondissement à partir d’un<br />
énoncé, soit pour indiquer l’intérêt du domaine induit par la question. Ainsi Océane relève<br />
une proposition dans un exposé (Amina el<strong>le</strong> a dit que quand on tombe sur <strong>le</strong> béton il y a des<br />
microbes qui rentrent) et la prolonge par une question qui déplace <strong>le</strong> thème (moi je trouve<br />
que c’est bien de faire ça et je me demande pourquoi il y a des microbes qui rentrent dans <strong>le</strong><br />
corps CE ), et ne soulève pas d’écho chez ses camarades. Re<strong>le</strong>ver une tel<strong>le</strong> question et la<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
commenter pourrait peut-être aider <strong>le</strong>s élèves à distinguer des niveaux de questionnement<br />
et éventuel<strong>le</strong>ment des procédures, mais l’ouverture des sujets à approfondir deviendrait vite<br />
ingérab<strong>le</strong> en raison du nombre de thèmes abordés simultanément, et l’enseignant choisit <strong>le</strong><br />
plus souvent de ne pas alourdir l’exercice en ouvrant trop de pistes, au détriment peut-être<br />
de la systématisation des procédures.<br />
Quelques indices de la capacité à reformu<strong>le</strong>r et expliciter <strong>le</strong> foyer de la question apparaissent,<br />
surtout la deuxième année, en relation avec une meil<strong>le</strong>ure mémoire de l’interaction et<br />
peut-être une conscience plus claire, chez certains, des champs disciplinaires en relation<br />
avec l’événement relaté. Ainsi si la question précédente sur la guérison de l’amputation ne<br />
parvient pas à ouvrir un développement thématique (sur un contenu peut-être diffici<strong>le</strong>ment<br />
abordab<strong>le</strong> en CM ), cel<strong>le</strong> d’une autre élève lors du même exposé reprend et déplace plus<br />
explicitement une question déjà posée (moi j’avais presque la même question je voulais<br />
savoir si <strong>le</strong>s os des chats sont <strong>le</strong>s mêmes que <strong>le</strong>s nôtres, reprenant comment c’est sa jambe<br />
ton chat est-ce qu’il a des os et ils ont coupé son os), et pointe une question épistémique<br />
identifiab<strong>le</strong> par <strong>le</strong>s élèves, liée à une démarche connue (comparaison) qui rencontre des<br />
objectifs disciplinaires. Cette intervention apparaît dans un contexte où <strong>le</strong> questionnement a<br />
été plus fortement institutionnalisé et fait l’objet d’une réf<strong>le</strong>xion plus explicite en commun. La<br />
référence au discours d’autrui pour situer <strong>le</strong> sien peut être considérée comme un indicateur<br />
fiab<strong>le</strong> sur <strong>le</strong> plan de l’attention à l’interaction, et de la conscience de registres différents de<br />
traitement. Mais là encore <strong>le</strong>s élèves semb<strong>le</strong>nt avoir besoin de l’étayage de l’enseignant<br />
pour repérer et valoriser de tel<strong>le</strong>s ouvertures thématiques.<br />
Il reste que ces moments de problématisation ou de discussion restent variab<strong>le</strong>s en fonction<br />
des sujets abordés, dont <strong>le</strong>s caractéristiques déterminent en partie <strong>le</strong>s genres mis en œuvre<br />
et <strong>le</strong>s modes d’intervention. Certains sujets, soit trop familiers et chargés affectivement,<br />
soit trop lointains, semb<strong>le</strong>nt se prêter à des juxtapositions de témoignages ou d’apports<br />
ponctuels (<strong>le</strong>s animaux familiers, par exemp<strong>le</strong>), ou des inventaires de données empruntées,<br />
d’autres semb<strong>le</strong>nt plus propices à des enchaînements entre élèves et à des interrogations.<br />
On pourrait faire la même remarque pour <strong>le</strong>s livres présentés. De façon généra<strong>le</strong>, la plus<br />
grande fermeture de l’exercice et des contenus abordés, la coupure avec <strong>le</strong> vécu immédiat<br />
de chacun semb<strong>le</strong>nt favoriser, dans certains cas, des enchaînements relativement longs, de<br />
type argumentatif, autour de problèmes abordés par l’album. On a pu observer, notamment<br />
en CM , des échanges riches où plusieurs élèves enchaînaient sur <strong>le</strong>s propos des uns<br />
des autres sur un mode problématique ou sur la confrontation d’interprétations relatives<br />
au comportement d’un personnage (l’ambiva<strong>le</strong>nce des sentiments d’un personnage vis-àvis<br />
de son petit frère, par exemp<strong>le</strong>) ou au sens d’une histoire un peu opaque (<strong>le</strong>s relations<br />
ambiguës du rêve et de la réalité dans un des livres présentés). Mais de tels échanges,<br />
remarquab<strong>le</strong>s à ce niveau, sont menés par certains enfants qui sont réel<strong>le</strong>ment entrés dans<br />
la démarche d’interprétation (Lucien, A<strong>le</strong>x, David, sans être forcement de très bons élèves<br />
sur <strong>le</strong> plan scolaire), et ont lieu à propos de certains livres. Là aussi la généralisation de<br />
l’évaluation est diffici<strong>le</strong>.<br />
Même si on peut décrire en termes linguistiques ces déplacements de référent, de<br />
niveau de généralité, de registre, de genre discursif (plus explicatif et moins proche de la<br />
liste, par exemp<strong>le</strong>), ces progrès de la pertinence ne coïncident pas forcément avec des<br />
caractéristiques linguistiques simp<strong>le</strong>s à inventorier. Le paradoxe est que ce qu’on a <strong>le</strong> plus<br />
de mal à décrire, surtout sous la forme d’une liste de critères décontextualisés, est ce qui<br />
joue <strong>le</strong> plus dans <strong>le</strong>s jugements évaluatifs en situation. Surtout quand l’oral engage des<br />
contenus notionnels en relation avec des connaissances scolaires, il est peu pertinent<br />
00<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
d’iso<strong>le</strong>r des critères spécifiques d’une compétence strictement linguistique ou rhétorique ;<br />
mais on peut se demander si quand on par<strong>le</strong> de pertinence, de capacité de hiérarchiser<br />
ou de problématiser on est encore dans <strong>le</strong> domaine de l’oral, voire dans <strong>le</strong> domaine de<br />
l’enseignement explicite.<br />
Les principes même de la pratique des conférences impliquent cette intégration des objectifs<br />
cognitifs à l’apprentissage de l’oral. Ces compétences sont par là même très liées aux<br />
contenus abordés et toujours mises en œuvre en contexte, de façon intégrée aux sujets<br />
proposés. L’habitude de rechercher ce qui est détail et ce qui se rattache à l’essentiel,<br />
d’expliciter sa position par rapport à ce qu’on expose, s’instal<strong>le</strong>nt progressivement plutôt<br />
par <strong>le</strong> retour en situation sur ce qui a été dit, par rapport à un contenu, des enjeux, des<br />
relations possib<strong>le</strong>s avec ce qui a déjà été travaillé et ce qui peut donner lieu à travail. Mais<br />
l’explicitation de ces déplacements nécessaires ne peut intervenir trop lourdement et de<br />
façon trop didactique lors des exposés eux-mêmes, ce qui « rescolariserait » l’exercice et<br />
changerait son sens aux yeux des élèves. L’intervention des enseignants lors de l’exposé luimême<br />
est donc relativement légère (avec des différences notab<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong>s deux classes).<br />
Mais de ce fait la prise de conscience et <strong>le</strong> transfert d’un exposé à un autre semb<strong>le</strong>nt <strong>le</strong>nts<br />
pour une grande partie des élèves. Une méthodologie généra<strong>le</strong> a été proposée aux élèves<br />
en CM pour orienter la phase de préparation (distinguer <strong>le</strong>s faits qui constituent <strong>le</strong> point de<br />
départ et <strong>le</strong>s questions qu’ils peuvent sou<strong>le</strong>ver, préciser la question, inventorier <strong>le</strong>s sources<br />
possib<strong>le</strong>s pour un approfondissement…). Mais <strong>le</strong> passage au générique risque toujours<br />
de vider d’une partie de son opérationnalité <strong>le</strong>s préconisations, en minimisant <strong>le</strong> poids des<br />
savoirs et de la maturité notionnel<strong>le</strong> relatifs aux domaines dont on par<strong>le</strong>, et <strong>le</strong>s difficultés du<br />
transfert. Les principes génériques nécessitent un étayage fort pour être recontextualisés, ce<br />
qui peut entrer en concurrence avec l’objectif d’autonomie dans la recherche documentaire.<br />
De par <strong>le</strong>s tensions liées à la comp<strong>le</strong>xité du projet, et par l’ambition de ces objectifs de haut<br />
niveau (sur <strong>le</strong>squels butent en général la majorité des élèves de cyc<strong>le</strong> III), ces compétences<br />
malgré la pratique répétée se construisent <strong>le</strong>ntement et de façon moins bien partagée que<br />
d’autres compétences acquises rapidement par l’ensemb<strong>le</strong> des élèves (notamment cel<strong>le</strong>s<br />
qui concernent <strong>le</strong> rapport à la tâche et à la prise de paro<strong>le</strong>, l’intégration de codes des genres<br />
ou de la culture de la classe, <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s socia<strong>le</strong>s de la communication).<br />
3. Les indicateurs liés au langage dans ses aspects linguistiques et<br />
textuels<br />
Il est diffici<strong>le</strong> d’évaluer un développement linguistique des élèves en compatibilisant de<br />
façon quantitative des indicateurs linguistiques réel<strong>le</strong>ment significatifs : d’une part la qualité<br />
des énoncés, par exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong>s mises en relation, passe en grande partie par des éléments<br />
paraverbaux comme l’intonation, et d’autre part <strong>le</strong>s marques linguistiques sont rarement<br />
interprétab<strong>le</strong>s de façon univoque. Ainsi un indicateur comme la longueur de la prise de<br />
paro<strong>le</strong> et <strong>le</strong> nombre d’énoncés enchaînés, dans l’ensemb<strong>le</strong> significatif, est à pondérer en<br />
fonction des élèves (il est très significatif pour certains élèves pour qui la paro<strong>le</strong> publique<br />
monologique était diffici<strong>le</strong> et restreinte au départ), et en relation avec d’autres critères (une<br />
plus grande capacité à hiérarchiser <strong>le</strong>s événements, par exemp<strong>le</strong>). De même <strong>le</strong>s termes à<br />
fonction d’organisation textuel<strong>le</strong> comme donc ou alors peuvent avoir une fonction avant tout<br />
phatique ou servir d’appui pour l’énonciation, plus que de relation logique entre énoncés.<br />
Enfin <strong>le</strong> répertoire des formes de phrase, des types d’enchaînement ou du vocabulaire<br />
mobilisé connaissent des variations d’un sujet traité à un autre.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0
Comme on l’a vu en première partie, <strong>le</strong>s aspects locutoires sont ceux sur <strong>le</strong>squels la pratique<br />
régulière de la prise de paro<strong>le</strong> produit <strong>le</strong>s progrès <strong>le</strong>s plus nets et <strong>le</strong>s plus généralisés,<br />
compte tenu du niveau de départ des élèves. Pratiquement tous <strong>le</strong>s élèves (même si tous<br />
n’ont pu être observés) ont appris au cours des deux années à soutenir devant un grand<br />
auditoire un discours monologique d’au moins cinq minutes audib<strong>le</strong>, relativement articulé,<br />
sans déclarer forfait et sans rupture majeure du fil du discours. Il subsiste évidemment<br />
de grandes inégalités dans l’aisance, <strong>le</strong>s qualités communicatives, la capacité de capter<br />
l’intérêt, mais en fonction du niveau de départ, tous ont progressé dans <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> de<br />
l’émotion, du débit, de l’élocution, et dans une certaine capacité de faire face à l’auditoire<br />
sans se réfugier dans son écrit. Même s’il reste diffici<strong>le</strong> de s’abstraire de son écrit, surtout<br />
pour <strong>le</strong>s exposés, tous ont appris à ne pas lire <strong>le</strong>ur texte, et même à par<strong>le</strong>r sans support<br />
écrit, pour <strong>le</strong>s résumés de livres. Il s’agit d’un résultat rarement observé dans la plupart des<br />
classes de cours moyen.<br />
La régularité de l’activité a amené aussi l’appropriation par la plupart des élèves, et de<br />
façon relativement rapide, d’un certain nombre de techniques liées à la prise de paro<strong>le</strong><br />
et à la conduite de l’exposé. Par exemp<strong>le</strong> tous débutent par une formu<strong>le</strong> d’introduction<br />
présentant <strong>le</strong> sujet, et souvent <strong>le</strong> justifiant brièvement (justification souvent biographique, ou<br />
par l’intérêt porté au thème). Certains ont acquis la technique d’annoncer <strong>le</strong>s rubriques qu’ils<br />
vont traiter : alors on a cherché la nourriture, <strong>le</strong>s habits, <strong>le</strong>s jeux, souvent en s’appuyant sur<br />
l’affiche support, quelques-uns cel<strong>le</strong> de poser des questions pour introduire des parties de<br />
<strong>le</strong>ur exposés (mais cette présence de questions rhétoriques est susceptib<strong>le</strong> d’interprétations<br />
diverses selon <strong>le</strong>s cas). Pour la tâche la plus codifiée (la présentation de <strong>le</strong>cture), ils ont<br />
appris dans l’ensemb<strong>le</strong> à mettre en œuvre des lieux obligés : ils terminent <strong>le</strong>ur résumé par<br />
une reformulation synthétique, un essai d’avis ou de justification du passage préféré. Ceux<br />
qui questionnent ont tous très vite acquis une technique de présentation de ce qu’ils ont à<br />
dire, du type j’ai trois remarques à faire, la première c’est que, la deuxième que etc. (ce qui<br />
ne préjuge pas du contenu des remarques en question). Ils ont à des titres divers intégré<br />
des formu<strong>le</strong>s parfois élaborées qui font partie de la culture de la classe, notamment dans la<br />
forme des questions et la formulation des avis.<br />
Ces consignes, par exemp<strong>le</strong> chercher la question qu’on va annoncer en début d’exposé,<br />
sont certainement des outils : il semb<strong>le</strong> qu’au début de <strong>le</strong>ur appropriation, on peut <strong>le</strong>s<br />
interpréter comme indices d’un travail de distanciation, et d’anticipation par rapport à ce<br />
qu’on a à dire, qui représente un seuil considérab<strong>le</strong> pour des élèves de cet âge. Mais assez<br />
vite on s’aperçoit que ces codes peuvent fonctionner comme des routines, et l’évaluation se<br />
déplace : la routine apparaît comme productive pour certains, plus mécanique et formel<strong>le</strong><br />
pour d’autres.<br />
Sur certains plans, l’expérience réitérée, intégrée évidemment à tout <strong>le</strong> dispositif de<br />
responsabilisation et de motivation des apprentissages mis en œuvre par l’équipe, génère<br />
d’el<strong>le</strong>-même des évolutions significatives (relatives à l’aisance et à la sécurité, à la capacité<br />
d’improviser à partir d’une trame, de développer de façon plus structurée une histoire ou une<br />
présentation de faits), sans qu’il soit besoin d’un appareil métadiscursif trop lourd. Mais sur<br />
d’autres, beaucoup plus comp<strong>le</strong>xes et diffici<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s évolutions que peut susciter la régularité<br />
de la pratique sont moins évidentes à court terme.<br />
La relative convergence de la présentation des livres fait que <strong>le</strong>s restitutions d’histoire<br />
semb<strong>le</strong>nt s’être régulièrement améliorées, en fonction du niveau de départ de chaque<br />
élève : nombre des épisodes marquants restitués, identification des actants, intrigues moins<br />
lacunaires, meil<strong>le</strong>ure explicitation des points saillants de l’histoire pour la plupart, et pour<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
certains, explicitation accrue d’états mentaux des personnages, liaisons plus dynamiques<br />
(buts et tentatives, par exemp<strong>le</strong>), quelques procédés de mise en tension de la narration.<br />
Les indicateurs sont cependant à pondérer dans la mesure où la comp<strong>le</strong>xité des histoires à<br />
restituer est aléatoire en fonction du choix des élèves et ne fait pas l’objet d’une régulation<br />
ou d’une programmation. Dans un cadre d’apprentissage, en effet, ces éléments intervenant<br />
dans <strong>le</strong> jugement de clarté doivent aussi être mis en relation avec la comp<strong>le</strong>xité du référent<br />
traité et <strong>le</strong>s risques pris, ce dont ne tient pas forcément compte <strong>le</strong> jugement social immédiat<br />
de la classe. Rendre compte d’un livre de jeunesse impliquant de subtils va-et-vient entre<br />
<strong>le</strong> monde réel et <strong>le</strong> monde imaginaire et des éléments d’incertitude dans l’interprétation,<br />
par exemp<strong>le</strong>, peut amener un compte-rendu laborieux, mal perçu par <strong>le</strong>s autres élèves,<br />
alors qu’il témoigne de la part de l’élève d’une activité considérab<strong>le</strong> de linéarisation, de<br />
différenciation, de délimitation d’univers. Par contre <strong>le</strong>s discours sur <strong>le</strong> livre (début d’analyse<br />
de la réception, justification du choix ou des difficultés d’interprétation) semb<strong>le</strong>nt rester<br />
déceptifs dans la plupart des présentations : <strong>le</strong>s réponses du type ça va, comme ça ou<br />
parce que c’est bien à la question as-tu aimé <strong>le</strong> livre ? subsistent même en CM . C’est un<br />
point sur <strong>le</strong>quel, comme on peut s’y attendre <strong>le</strong>s élèves présentent des résistances, hors<br />
quelques exceptions remarquab<strong>le</strong>s, ce qui rejoint une difficulté généra<strong>le</strong> dans beaucoup de<br />
cours moyens regroupant des élèves culturel<strong>le</strong>ment peu habitués à par<strong>le</strong>r des livres et des<br />
expériences esthétiques.<br />
Pour <strong>le</strong>s exposés, la variété des sujets abordés appel<strong>le</strong> des modes d’organisation différents,<br />
et si <strong>le</strong>s progrès sur <strong>le</strong>s critères généraux précédemment évoqués sont évidents, la<br />
progression ne semb<strong>le</strong> pas linéaire et aussi claire sur <strong>le</strong> plan des organisateurs du discours,<br />
des genres discursifs adoptés, de la présence de plusieurs registres différents articulés<br />
(données, questions, commentaires), ou d’indices de modalisations. Des élèves peuvent<br />
revenir à propos de tel ou tel sujet à une organisation en liste, régie par une série de<br />
présentatifs (alors ici il y a et puis il y a…), même si pour un autre sujet on a pu observer<br />
l’émergence d’éléments de problématisation, d’explication ou d’argumentation. Il semb<strong>le</strong> que<br />
ce soit sur ces modes d’organisation du discours que la force d’inertie soit la plus lourde et<br />
l’apprentissage <strong>le</strong> plus <strong>le</strong>nt. Il est bien évident que beaucoup de facteurs comp<strong>le</strong>xes sont mis<br />
en jeu et qu’il s’agit de compétences qui ne peuvent être acquises par simp<strong>le</strong> entraînement.<br />
Le dispositif de l’éco<strong>le</strong> Freinet a donc <strong>le</strong> mérite de confronter élèves et enseignants à cette<br />
exigence très importante mais aussi de servir de révélateur à sa difficulté, qui dans d’autres<br />
pratiques pédagogiques peut passer inaperçue puisque <strong>le</strong>s élèves sont rarement confrontés<br />
à des tâches de ce niveau.<br />
On peut s’interroger sur <strong>le</strong>s tensions didactiques propres à l’ambition de la tâche et au<br />
dispositif. L’intervention de l’enseignant est décisive pour la mise en relief du foyer de ce<br />
qu’on veut dire, pour la recherche de questions pouvant mettre en perspective <strong>le</strong>s éléments<br />
présentés, <strong>le</strong> déplacement d’une liste de faits particuliers ou d’éléments descriptifs vers des<br />
centres d’intérêt potentiel<strong>le</strong>ment généralisab<strong>le</strong>s (sans par<strong>le</strong>r de la vérification de la validité<br />
des informations proposées ou de <strong>le</strong>ur pertinence disciplinaire). Cela pose la question des<br />
modalités des interventions, qui ne peuvent pas être trop didactiques dans <strong>le</strong> cadre même<br />
de la pratique des exposés, tel qu’il est défini par l’équipe Freinet. Le principe de liberté de<br />
choix, essentiel de ce projet, implique une absence de programmation ou de regroupement<br />
des sujets, qui limite <strong>le</strong>s possibilités d’approfondissement des contenus, de construction<br />
d’une démarche d’investigation et de traitement des documents. Des dispositifs ont<br />
cependant été mis en place à plusieurs reprises, surtout en CM , pour mener en commun<br />
une démarche d’investigation, réfléchir aux attendus de la démarche ; mais cela peut entrer<br />
en tension avec <strong>le</strong> souci de désacraliser l’exercice aux yeux des élèves et d’assurer sa<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0
égularité pour permettre à chacun de nombreux passages. Ainsi la variété des sujets en<br />
cours simultanément à tous <strong>le</strong>s moments de l’année constitue une énorme richesse, mais en<br />
même temps, peut-être, un facteur de dispersion qui rend plus diffici<strong>le</strong> l’approfondissement<br />
et <strong>le</strong>s transferts, et peut produire à plus long terme des effets de répétition. Le problème<br />
est peut-être celui de savoir s’il est possib<strong>le</strong> d’articu<strong>le</strong>r la valorisation des initiatives et des<br />
engagements personnels, et de certains outils de programmation ou de séquentialisation<br />
des apprentissages, ce qui est particulièrement diffici<strong>le</strong> à établir pour l’oral.<br />
Il faut donc accepter la diversité des modes et des rythmes des apprentissages de<br />
différents niveaux impliqués dans <strong>le</strong>s mêmes tâches ora<strong>le</strong>s, et donc l’hétérogénéité des<br />
façons d’évaluer selon ces composantes. Avec <strong>le</strong>s limites méthodologiques de l’observation<br />
menée ici, notamment la difficulté à assurer un suivi effectif, régulier et continu de tous <strong>le</strong>s<br />
élèves sur une durée longue, on peut cependant cerner des évolutions, des avancées et<br />
des piétinements, qui montrent la comp<strong>le</strong>xité de ces apprentissages et la multiplicité des<br />
niveaux engagés.<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Activités scientifiques et conduites langagières<br />
Cora COHEN-AZRIA<br />
Maître de conférences<br />
Isabel<strong>le</strong> DELCAMBRE<br />
Professeur des universités<br />
Université de Lil<strong>le</strong> III<br />
Équipe THEODILE<br />
Ce chapitre fait suite au travail que nous avons réalisé sur l’évaluation des contenus<br />
d’apprentissage et des démarches scientifiques dans deux éco<strong>le</strong>s maternel<strong>le</strong>s aux pédagogies<br />
contrastées ). Ces premières analyses s’appuyaient sur des entretiens individuels réalisés<br />
hors des classes. L’objectif de ce travail était de mesurer <strong>le</strong>s contenus de savoirs mobilisés<br />
par <strong>le</strong>s élèves, <strong>le</strong>s conduites langagières et <strong>le</strong>ur articulation avec une démarche scientifique.<br />
Pour poursuivre cette recherche, nous avons focalisé notre regard sur <strong>le</strong> travail en classe.<br />
Pour cela, nous avons mené des observations d’activités scientifiques organisées par <strong>le</strong>s<br />
maîtresses. Cette approche complémentaire nous permet de porter un regard analytique<br />
et comparatif sur <strong>le</strong>s constructions des activités scientifiques et <strong>le</strong>s démarches en jeu. Les<br />
résultats de ces deux approches peuvent ici être mises en relation.<br />
1. Conduites langagières et construction des activités<br />
Pour la transcription des documents vidéo, nous avons établi non une transcription intégra<strong>le</strong><br />
des échanges verbaux mais un script chronométré (voir <strong>le</strong>s annexes) où <strong>le</strong>s prises de paro<strong>le</strong><br />
des enseignantes sont résumées et mises en parallè<strong>le</strong> avec la description des objets et la<br />
description des actions effectuées par l’enseignante ou <strong>le</strong>s élèves avec ou à propos de ces<br />
objets. L’analyse qui suit ne peut donc pas viser des descriptions quantitatives mais el<strong>le</strong><br />
permet de traiter assez précisément de la structure des séances observées, en repérant<br />
<strong>le</strong>s moments d’introduction des consignes de travail, <strong>le</strong>s types de problèmes scientifiques<br />
posés aux élèves, et <strong>le</strong>s formes du questionnement magistral au long de ces séances.<br />
Dans <strong>le</strong> texte qui suit, <strong>le</strong>s maîtresses sont désignées par <strong>le</strong>ur initia<strong>le</strong> : F. et S. sont <strong>le</strong>s<br />
deux maîtresses de l’éco<strong>le</strong> Freinet, J., la maîtresse non-Freinet. El<strong>le</strong>s enseignent dans des<br />
classes de petits-moyens (F. et S.) et dans une classe de moyens pour J.<br />
1.1. L’introduction de l’activité scientifique<br />
La formulation de la consigne principa<strong>le</strong> de travail ne se situe pas au même moment dans<br />
<strong>le</strong>s trois classes. Chez F. et J, la consigne apparaît après un temps plus ou moins long de<br />
manipulation ou d’observation des objets, qui sont organisés par <strong>le</strong>s maîtresses comme un<br />
espace de problème (voir ci-dessous l’analyse des objets). Chez S. la séance démarre par<br />
la formulation de la consigne.<br />
Chez S., donc, la consigne donnée d’emblée (« on va mettre l’eau qui est dans la grande<br />
COHEN-AZRIA C., DELCAMBRE I. ( 00 ), « Pratiques langagières et activités scientifiques en<br />
maternel<strong>le</strong> » dans REUTER Y., dir., Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire ( 00 - 00 ).<br />
Rapport de recherche ERTE 0 , Vil<strong>le</strong>neuve d’Ascq, Université Char<strong>le</strong>s de Gaul<strong>le</strong>, p. - .<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0
assine, là-bas [dans des saladiers] »), ne semb<strong>le</strong> pas construire pas un vrai problème pour<br />
<strong>le</strong>s élèves ; mais el<strong>le</strong> est suivie immédiatement par une demande de réf<strong>le</strong>xion anticipatrice<br />
(« on va faire comment pour mettre l’eau là-bas ? ») et par un refus par la maîtresse de la<br />
solution évidente (« prendre une bouteil<strong>le</strong> »), refus qui va aboutir à l’idée de transporter<br />
l’eau avec ses mains : c’est une première expérience d’une solution qui va poser el<strong>le</strong>-même<br />
problème (il y en aura d’autres dans cette séance).<br />
Les élèves de F. pendant <strong>le</strong>s premières vingt minutes remplissent des gobe<strong>le</strong>ts avec l’eau<br />
du grand bac devant <strong>le</strong>quel ils sont installés, puis la transvasent d’un pot à un autre pot ;<br />
parfois la maîtresse suggère de dénombrer <strong>le</strong>s pots remplis et rangés sur <strong>le</strong> bord du bac, ou<br />
de dire combien la bouteil<strong>le</strong> permet de remplir de pots (conservation des quantités). Enfin<br />
el<strong>le</strong> formu<strong>le</strong> la consigne de travail : « Il y a une bassine, vous prenez ce que vous vou<strong>le</strong>z et<br />
vous al<strong>le</strong>z <strong>le</strong> renverser dans une des deux bassines ».<br />
Les élèves de J. manipu<strong>le</strong>nt pendant cinq minutes de petits ciseaux de métal, et observent<br />
<strong>le</strong>s mouvements des lames quand on écarte ou resserre <strong>le</strong>s doigts, puis ils observent une<br />
paire disjointe pour identifier l’endroit du pivot qui permettrait de la reconstituer. Quand la<br />
maîtresse place sur la tab<strong>le</strong> des branches de ciseaux disjointes en carton avec des attaches<br />
parisiennes ou des barres de plastique et des écrous, issus d’un jeu de construction, el<strong>le</strong><br />
donne la consigne « on va essayer de faire des ciseaux ».<br />
Le rapport entre consigne et manipulation est donc différent, de même <strong>le</strong> sens de la<br />
manipulation : la consigne de S. est une consigne pour manipu<strong>le</strong>r, el<strong>le</strong> ouvre toute une série<br />
de problèmes liés au fait que la solution immédiate (« prendre une bouteil<strong>le</strong> ») est refusée<br />
par la maîtresse. Chez F., la consigne suit un temps long de manipulation libre des élèves,<br />
accompagné de questions abondantes de la maîtresse, qui cherchent à faire verbaliser<br />
par <strong>le</strong>s élèves ce qu’ils font ou observent. Chez J., la consigne est formulée cinq minutes<br />
après <strong>le</strong> début de l’activité, laquel<strong>le</strong> est fortement guidée à la fois par la construction du<br />
milieu (objets préparés et présentés <strong>le</strong>s uns après <strong>le</strong>s autres par la maîtresse selon une<br />
planification prévue à l’avance) et par <strong>le</strong>s questions qui guident l’observation des élèves. On<br />
pourrait dire que chez J., la manipulation sert l’observation guidée de l’objet technique, alors<br />
que chez F. el<strong>le</strong> permet d’explorer par l’action <strong>le</strong>s propriétés de l’eau.<br />
Si l’on considère <strong>le</strong> contenu sémantique des consignes, on peut observer une opposition<br />
nette entre <strong>le</strong>s deux classes Freinet et la classe non-Freinet : chez S. et F., <strong>le</strong>s consignes<br />
verbalisent <strong>le</strong> but à atteindre, visent <strong>le</strong> résultat final de l’action (<strong>le</strong> déplacement de volumes<br />
d’eau) qui sera effectivement atteint dans la séance. Chez J. la consigne donne éga<strong>le</strong>ment<br />
un but (faire des ciseaux) qu’il faut prendre au pied de la <strong>le</strong>ttre : <strong>le</strong> contenu d’apprentissage<br />
visé est bien de construire des ciseaux, c’est-à-dire identifier un fonctionnement mécanique<br />
(attache et pivot) et non de comprendre comment des ciseaux peuvent couper. Le contenu<br />
de savoir est de nature technologique. On peut dire que ce but (construire des ciseaux) est<br />
éga<strong>le</strong>ment atteint, sauf que <strong>le</strong>s ciseaux construits ne peuvent pas couper…<br />
Si l’on considère la forme verba<strong>le</strong> des énoncés, el<strong>le</strong> diffère éga<strong>le</strong>ment entre <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s :<br />
<strong>le</strong>s énoncés des deux maîtresses Freinet sont clairement directifs, « on va mettre… » (S),<br />
« Vous prenez…. et vous al<strong>le</strong>z <strong>le</strong> renverser…. » (F), alors que J. atténue l’acte de paro<strong>le</strong><br />
directif « on va essayer de faire… ». Le positionnement énonciatif des maîtresses est<br />
inversement proportionnel au sty<strong>le</strong> de l’activité : actes de langage directifs vont de pair avec<br />
une activité ouverte pour <strong>le</strong>s élèves, actes de langage modalisés vont de pair avec une<br />
activité décomposée en sous-activités et dirigée par la maîtresse.<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
1.2. Les problèmes posés<br />
Aux différents moments de ces trois séances, différents problèmes émergent ou sont posés<br />
par <strong>le</strong>s maîtresses, qui comp<strong>le</strong>xifient ou réorientent la question principa<strong>le</strong> posée par la<br />
consigne.<br />
Chez F., outre <strong>le</strong>s problèmes liés à la manipulation initia<strong>le</strong> évoqués ci-dessus (remplissage,<br />
transvasement, dénombrement, conservation des quantités), surgit un problème imprévu,<br />
celui de la surface de l’eau (on croit que la bassine est p<strong>le</strong>ine mais on peut encore verser de<br />
l’eau). Ce problème surgit à l’initiative d’une élève qui joue avec la situation de recherche et<br />
la présence d’une observatrice extérieure à la classe. Par ail<strong>le</strong>urs, toute la fin de la séance<br />
(environ minutes, pratiquement 0% du temps total) est consacrée successivement à<br />
une récapitulation ora<strong>le</strong> de ce que <strong>le</strong>s élèves ont fait avec l’eau, puis à un dessin individuel<br />
qui sera <strong>le</strong> support d’une dictée individuel<strong>le</strong> à l’adulte, où <strong>le</strong>s élèves sont confrontés à des<br />
problèmes de formulation de l’activité scientifique avec un travail <strong>le</strong>xical important.<br />
Chez S., <strong>le</strong>s problèmes posés aux élèves apparaissent tout au long de la séance, et sont<br />
généra<strong>le</strong>ment liés à deux phénomènes différents :<br />
– la maîtresse place <strong>le</strong>s élèves devant des problèmes inédits : transporter de l’eau<br />
avec des « récipients » percés (<strong>le</strong>s mains, puis une bouteil<strong>le</strong> qu’el<strong>le</strong> avait percée de<br />
trous avant la séance), al<strong>le</strong>r jusqu’au bout de l’activité, c’est-à-dire finir de vider l’eau, en<br />
cherchant d’autres récipients que ceux utilisés jusqu’alors, ce qui induit un travail sur la<br />
comparaison des récipients (de plus en plus petits) et des transvasements d’un récipient<br />
à l’autre ; enfin, quand même la plus petite cuillère ne peut plus récupérer d’eau, el<strong>le</strong><br />
pousse à continuer à chercher des solutions (renverser la bassine, essorer avec une<br />
éponge, puis une serviette éponge, ce qui permet de se demander quel<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong>s<br />
perceptions de l’eau (non plus la vue mais <strong>le</strong> toucher, la sensation de mouillé).<br />
–<br />
El<strong>le</strong> suscite à une dizaine de reprises dans <strong>le</strong>s 0 minutes que dure la séance la<br />
recherche d’idées ou de solutions pour faire face aux problèmes rencontrés. Et cela, dès<br />
<strong>le</strong> début où el<strong>le</strong> oriente <strong>le</strong>s élèves vers la recherche d’une solution inédite au problème<br />
du transport de l’eau (dans <strong>le</strong>s mains). Cette insistance constitue des phénomènes<br />
ordinaires (la bassine est encore mouillée) en problème à résoudre (l’essuyer avec une<br />
éponge ou une serviette, ce qui oblige à se demander où est passée l’eau) ; on peut<br />
postu<strong>le</strong>r que cela vise la prise de conscience par <strong>le</strong>s élèves des problèmes liés aux<br />
propriétés de l’eau et à sa manipulation.<br />
Un temps de récapitulation est éga<strong>le</strong>ment organisé : il dure 0 minutes (environ 0% du<br />
temps) et se dérou<strong>le</strong> à l’oral, la maîtresse écrivant dans un cahier, sous forme de dictée<br />
col<strong>le</strong>ctive à l’adulte.<br />
Chez J., <strong>le</strong>s problèmes, liés à la consigne principa<strong>le</strong>, sont essentiel<strong>le</strong>ment des problèmes<br />
de construction (repérer la place du pivot qui réunit <strong>le</strong>s deux branches), ou de manipulation<br />
motrice des objets (difficulté à serrer un boulon, à enfoncer une attache parisienne). Une<br />
fois <strong>le</strong>s ciseaux de papier reconstitués, la maîtresse introduit dans la situation une feuil<strong>le</strong><br />
de papier et demande aux élèves de dire pourquoi <strong>le</strong>urs ciseaux de carton ne peuvent pas<br />
la couper (<strong>le</strong>s ciseaux reconstitués avec <strong>le</strong>s grandes barres de plastique jaune sont trop<br />
grands pour <strong>le</strong>s petites mains des élèves, et sont donc laissés de côté dans cette dernière<br />
phase). La séance se termine par une description des propriétés physiques des branches de<br />
métal par rapport aux branches de carton (activité <strong>le</strong>xica<strong>le</strong>) où l’énoncé du fonctionnement<br />
des ciseaux (ce qui fait qu’ils coupent) est <strong>le</strong> fait de la maîtresse (« quand on utilise des<br />
ciseaux il faut faire attention. Parce que…. ça coupe »), sous une forme plus normative que<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0
scientifique. Il n’y a pas de récapitulation avec <strong>le</strong>s élèves.<br />
On peut donc observer des pratiques nettement différentes entre ces trois maîtresses :<br />
0<br />
– confrontation à des problèmes construits par la maîtresse (S.) ou émergence de<br />
problèmes à partir de la situation et de l’activité des élèves (F et S) ;<br />
– confrontation à des problèmes scientifiques (S. et F. <strong>le</strong>s propriétés de l’eau) ou<br />
technologiques (J. <strong>le</strong>s ciseaux) ;<br />
– situation de découverte par manipulation plus ou moins organisée (S. et F.) ou<br />
pseudo-découverte/transmission d’un savoir présenté par l’enseignante comme devant<br />
être compris/accepté par <strong>le</strong>s élèves (J.) ;<br />
– place et formes très différentes accordées aux activités de récapitulation, ora<strong>le</strong>s (S.)<br />
ou ora<strong>le</strong>s et écrites (F.).<br />
1.3. Les questions posées par l’enseignante et <strong>le</strong>ur rapport à la situation<br />
d’action<br />
Nous ne visons pas ici une analyse quantitative du nombre de questions posées, de <strong>le</strong>ur<br />
type, fonction, etc. L’établissement des scripts des séances ne permet qu’une estimation<br />
proportionnel<strong>le</strong>, à partir des différents moments des séances, tels qu’el<strong>le</strong>s sont retranscrites.<br />
L’analyse accorde une priorité aux relations entre <strong>le</strong>s questions posées par <strong>le</strong>s maîtresses<br />
et <strong>le</strong>s situations d’action qu’el<strong>le</strong>s ont mises en place. Ces questions sont-el<strong>le</strong>s articulées<br />
à ce que font <strong>le</strong>s élèves ou à ce qui se passe ? Reviennent-el<strong>le</strong>s sur ce qui s’est passé ?<br />
Anticipent-el<strong>le</strong>s sur ce que <strong>le</strong>s élèves pourraient faire ou sur ce qui pourrait se passer ?<br />
Nous tentons éga<strong>le</strong>ment d’identifier autant que possib<strong>le</strong> <strong>le</strong>s conduites discursives qu’el<strong>le</strong>s<br />
induisent pour <strong>le</strong>s élèves (description, justification, explication essentiel<strong>le</strong>ment).<br />
1.3.1. Classe de F (activité eau)<br />
Trois groupes de questions peuvent être mis en évidence pendant l’activité .<br />
– Des questions sur <strong>le</strong>s actions en cours ( %) visent à faire décrire aux élèves ce<br />
qu’ils sont en train de faire. Ces questions sont généra<strong>le</strong>ment adressées aux élèvesacteurs<br />
eux-mêmes qui sont ainsi placés dans une position quasi réf<strong>le</strong>xive.<br />
– Des questions sur <strong>le</strong>s phénomènes observab<strong>le</strong>s ( 0%) amènent <strong>le</strong>s élèves à<br />
décrire ou à expliquer ce qui se passe sous <strong>le</strong>urs yeux, ce qu’ils peuvent observer des<br />
phénomènes que <strong>le</strong>urs actions provoquent.<br />
–<br />
Minoritairement, des questions sur l’anticipation de phénomènes ou sur des<br />
projets que <strong>le</strong>s élèves pourraient avoir envie de mener à partir de la situation tel<strong>le</strong><br />
qu’el<strong>le</strong> se développe. De même, <strong>le</strong>s questions de dénomination d’objets sont très peu<br />
fréquentes.<br />
Le questionnement porte majoritairement sur la situation présente, il est articulé aux actions<br />
en cours.<br />
Le dernier temps de la séance est consacré à une verbalisation ora<strong>le</strong> puis à une dictée<br />
à l’adulte individuel<strong>le</strong> à partir d’un dessin que <strong>le</strong>s élèves font sur <strong>le</strong> champ. Cette activité<br />
repose sur des opérations de remémoration des actions effectuées dans la séance et/<br />
Ces pourcentages très approximatifs, vu la nature des corpus utilisés, ne sont à lire que comme des<br />
indications de tendance. Par ail<strong>le</strong>urs, pour ce premier cas, ils ne décrivent que <strong>le</strong>s interactions verba<strong>le</strong>s en<br />
groupe sans intégrer la phase de dictée à l’adulte individuel<strong>le</strong> termina<strong>le</strong>.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
ou de verbalisation du nom des objets utilisés. Les questions sont donc essentiel<strong>le</strong>ment<br />
des questions sur <strong>le</strong>s actions passées, avec un décalage temporel important, et sur la<br />
dénomination.<br />
1.3.2. Classe de S (activité eau)<br />
Trois grands types de questions caractérisent cette séance :<br />
– Des questions d’anticipation sur l’action à venir ou sur la recherche de solutions<br />
qui pourraient être essayées (environ %).<br />
– Des questions sur <strong>le</strong>s actions en cours qui visent à faire décrire aux élèves ce<br />
qu’ils observent des autres ( %) ; el<strong>le</strong>s ne sont pas (ou très rarement) adressées<br />
aux élèves-acteurs. Ces élèves sont constitués en objet d’observation pour <strong>le</strong>s autres<br />
élèves. Ces questions d’observation peuvent être des ordres indirects d’imiter celui<br />
qu’on observe ; en général, ce sont des questions précises qui pointent sur ce qu’il faut<br />
regarder.<br />
– Pour environ 0%, des questions de justification ou d’explication des choix<br />
effectués par <strong>le</strong>s élèves (choix d’action ou d’objet) et des questions qui visent à faire<br />
évaluer <strong>le</strong>s solutions imaginées. Il s’agit donc de questions qui amènent <strong>le</strong>s élèves à<br />
revenir sur des phénomènes qui viennent de se dérou<strong>le</strong>r, en léger décalage temporel<br />
par rapport à l’action. Le temps verbal est généra<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> passé composé, ce qui<br />
différencie ces questions des questions sur l’action, qui sont généra<strong>le</strong>ment au présent.<br />
Les deux maîtresses Freinet se différencient par l’importance accordée à la verbalisation<br />
concomitante à l’action ; F. provoque davantage que S. une verbalisation sur l’action, S<br />
davantage une verbalisation de justification a posteriori ou d’anticipation. Ceci vaut pour <strong>le</strong>s<br />
verbalisations dans <strong>le</strong> temps même de l’action, car F. instal<strong>le</strong> un temps long de récapitulation<br />
fina<strong>le</strong>, qui s’apparente à une verbalisation a posteriori ; mais à la différence de S., el<strong>le</strong> incite<br />
à décrire plutôt qu’à justifier/expliquer.<br />
1.3.3. Classe de J (activité ciseaux)<br />
Quatre groupes de questions peuvent être constitués :<br />
– Les questions qui visent la description d’actions en cours ou de phénomènes<br />
qui se produisent suite aux actions ( 0%), comme <strong>le</strong> fonctionnement des ciseaux dans<br />
<strong>le</strong> temps où ils sont manipulés. Les actions concernées sont soit cel<strong>le</strong>s des élèves<br />
qui sont proposées à l’observation des autres, soit la maîtresse lorsqu’el<strong>le</strong> montre un<br />
montage ou un fonctionnement. Les élèves à observer sont souvent constitués comme<br />
modè<strong>le</strong>s à suivre (« fais comme ça »).<br />
– Des questions qui s’apparentent à des guides pour l’action, et sont souvent des<br />
ordres indirects demandant aux élèves d’effectuer un geste, <strong>le</strong> bon geste, sur <strong>le</strong> champ<br />
( 0%).<br />
– Un petit nombre de questions sur l’anticipation d’actions à accomplir ou de<br />
phénomènes à observer.<br />
–<br />
Deux occurrences de questions visant à revenir sur une difficulté de montage pour<br />
l’expliquer ou y remédier.<br />
La spécificité de J. tient surtout à la deuxième catégorie de questions : la séance vise à<br />
faire construire des ciseaux en respectant <strong>le</strong> fonctionnement de l’objet, el<strong>le</strong> a souvent une<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0
dimension prescriptive et normative (voir, par exemp<strong>le</strong>, à la dix-neuvième minute, la présence<br />
dans <strong>le</strong> discours de modè<strong>le</strong>s à imiter).<br />
Cette dimension prescriptive est quasiment absente des situations Freinet, qui mettent en<br />
place des situations-problèmes où la solution est à inventer (voir la fréquence des verbes<br />
« trouver » chez S.) ou bien où <strong>le</strong> potentiel des situations est à explorer (F.). Chez J., <strong>le</strong>s<br />
questions d’anticipation sont généra<strong>le</strong>ment suivies immédiatement d’une réponse donnée<br />
par maîtresse.<br />
Les questions de description sont majoritaires chez J., comme chez F. à Freinet. Mais<br />
el<strong>le</strong>s n’ont pas la même va<strong>le</strong>ur : J. fait décrire pour orienter vers <strong>le</strong> bon geste, souvent par<br />
imitation ; F. fait décrire pour susciter une verbalisation des phénomènes provoqués par la<br />
libre manipulation, avec l’espoir peut-être de provoquer une prise de conscience.<br />
Ces conduites descriptives dans ces deux classes s’opposent à la fréquence des questions<br />
de justification/explication chez S.<br />
0<br />
1.4. Trois mises en œuvre différentes de l’activité scientifique<br />
Les trois ordres de phénomènes décrits ci-dessus convergent entre eux et permettent<br />
d’établir trois sty<strong>le</strong>s différents d’enseignement scientifique en maternel<strong>le</strong> :<br />
– une situation ouverte, où la manipulation libre des élèves est associée à des questions<br />
de description concomitantes à l’action, où <strong>le</strong> questionnement du maître s’ajuste <strong>le</strong> plus<br />
possib<strong>le</strong> aux actions des élèves, sans objectif disciplinaire fort (voir l’occurrence tardive<br />
de la consigne), mais suivie d’un moment long de passage à l’écrit individuel ;<br />
– une situation construite par la maîtresse comme une série de problèmes inédits (avec<br />
une occurrence immédiate de la consigne et une orientation forte vers la recherche<br />
de solutions inédites), où <strong>le</strong> questionnement de la maîtresse vise <strong>le</strong>s conduites de<br />
justification et d’explication, suivie d’un moment de récapitulation col<strong>le</strong>ctive, assez<br />
court ;<br />
–<br />
une situation d’activités normées, où <strong>le</strong>s manipulations et <strong>le</strong>s conduites de description<br />
sont l’occasion de découvrir et d’appliquer <strong>le</strong>s bonnes réponses à un problème fermé,<br />
sans verbalisation fina<strong>le</strong>.<br />
2. Regards sur <strong>le</strong>s objets<br />
Il nous a semblé nécessaire de réfléchir sur <strong>le</strong> statut des objets présents dans <strong>le</strong>s trois<br />
séances. Cet ang<strong>le</strong> d’attaque n’est pas lié spécifiquement à la maternel<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s objets<br />
(scientifiques ou non) qui sont donnés aux élèves comme support de démarches ou<br />
d’apprentissages scientifiques créent des occasions d’apprendre, de réfléchir, de découvrir<br />
des phénomènes ou des propriétés, de construire des images de l’activité scientifique,<br />
etc. Ce sont en l’occurrence des supports de l’activité au moins aussi importants que <strong>le</strong>s<br />
interactions verba<strong>le</strong>s. Nous proposons une typologie des objets qui ont été en usage dans<br />
<strong>le</strong>s trois séances observées et une caractérisation des pratiques d’activité scientifique en<br />
maternel<strong>le</strong> selon <strong>le</strong>s statuts donnés aux objets.<br />
2.1. Catégories d’objets<br />
Dans <strong>le</strong>s trois séances, des objets sont utilisés et manipulés par <strong>le</strong>s maîtresses et <strong>le</strong>s élèves.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Nous proposons ici une analyse à partir d’une catégorisation de ces éléments en fonction de<br />
<strong>le</strong>ur statut durant <strong>le</strong>s activités observées.<br />
2.1.1. Objets pédagogiques et/ou éducatifs<br />
Ces objets entrent dans des activités d’apprentissages ou pédagogiques. Ils n’ont pas<br />
(ou peu) d’existence ou de pertinence ail<strong>le</strong>urs. Ils peuvent être construits ou non pour <strong>le</strong>s<br />
séances.<br />
●<br />
non fabriqués par <strong>le</strong>s maîtresses :<br />
– Louche en plastique de cou<strong>le</strong>urs vives (F).<br />
– Petits pichets en plastique (S).<br />
– Matériel pédagogique en plastique du type jeu de construction : longues barres<br />
jaunes trouées à interval<strong>le</strong>s réguliers et écrous b<strong>le</strong>us (J).<br />
– Paires de ciseaux à bouts ronds (J).<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
fabriqués pour ou durant la séance :<br />
Flacons de shampooing troués (S).<br />
Ciseaux en papier ou en carton (J).<br />
Deux branches disjointes d’une paire de ciseau en métal (J).<br />
Branches de grands ciseaux non jointes en carton (J).<br />
Les objets fabriqués ou transformés par la maîtresse présentent des caractéristiques très<br />
spécifiques qui <strong>le</strong>s distinguent radica<strong>le</strong>ment des objets usuels ou des objets éducatifs :<br />
ce sont des objets qui n’ont pas <strong>le</strong>ur équiva<strong>le</strong>nt ail<strong>le</strong>urs, ils n’existent que pour la situation<br />
d’apprentissage visée, ce sont des objets-problèmes. Ils portent plus ouvertement que <strong>le</strong>s<br />
objets éducatifs l’intention de faire réfléchir <strong>le</strong>s élèves, de <strong>le</strong>ur faire prendre conscience d’un<br />
fonctionnement ou d’une propriété.<br />
2.1.2. Objets pédagogisés<br />
Ces objets ont un ancrage et un usage non scolaire mais sont ici utilisés avec des objectifs<br />
pédagogiques et d’apprentissage. Le travail de décontextualisation/recontextualisation est<br />
donc important puisqu’ils sont détournés de <strong>le</strong>urs fonctions premières.<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
●<br />
Pot de chocolat en poudre (F).<br />
Pots de fromage blanc (F).<br />
Bouteil<strong>le</strong>s de shampooing et de gel douche (S).<br />
Passoire, verres, bols, cuillères en plastique (S).<br />
Cuillères (de mesure) pour <strong>le</strong> café ou <strong>le</strong> lait maternisé (S).<br />
Entonnoir (S).<br />
Dès à coudre (S).<br />
Mouchoirs (S).<br />
Éponges (S).<br />
Chiffons (S).<br />
Bassines (F et S).<br />
Ils ne sont pas rangés parmi <strong>le</strong>s objets scolarisés dans la mesure où ils sont transformés par la<br />
maîtresse pour devenir de nouveaux objets (« objets-problèmes »).<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
2.1.3. Objets scolaires sans finalité pédagogique<br />
Ces objets sont présents dans la classe et directement liés à l’activité mais pas dans un<br />
rapport pédagogique.<br />
– La serpillière et <strong>le</strong> racloir dans la classe de F qui sont utilisés par l’ATSEM et non par<br />
<strong>le</strong>s élèves.<br />
– Le tissu placé sous la tab<strong>le</strong> pour éviter <strong>le</strong>s flaques.<br />
2.1.4. Objets dont <strong>le</strong> statut se transforme dans l’activité :<br />
Durant la séance <strong>le</strong>s objets peuvent changer de statut selon <strong>le</strong>s discours et <strong>le</strong>s actions qui<br />
<strong>le</strong>ur sont associés.<br />
– La serpillière ou l’éponge ne sont pas utilisés de la même façon lorsque S demande<br />
aux élèves de <strong>le</strong>s utiliser pour déplacer de l’eau, ou lorsque dans la classe de F, l’ATSEM<br />
nettoie la classe pendant que se dérou<strong>le</strong>, à côté, la dernière partie de l’activité.<br />
–<br />
Le pot de chocolat est nommé et utilisé à la manière quotidienne dans <strong>le</strong> discours des<br />
élèves de F, et défini uniquement comme un récipient par F, objet pédagogisé, donc.<br />
Ces deux exemp<strong>le</strong>s ne sont pas révélateurs au même degré des problèmes posés par <strong>le</strong>s<br />
objets dans l’univers pédagogique. Dans <strong>le</strong> premier cas, il s’agit d’un objet qui, selon <strong>le</strong>s<br />
situations et <strong>le</strong>s intentions des maîtresses, reçoit ou non une fonction pédagogique ; il est<br />
objet scolaire sans finalité pédagogique chez F., objet pédagogisé chez S. Dans <strong>le</strong> second<br />
cas, <strong>le</strong> pot de chocolat, objet pédagogisé par la maîtresse dans la situation, va occasionner<br />
de nombreuses interactions entre la maîtresse et une élève qui lui refuse son statut d’objet<br />
pédagogisé, et l’utilise pour transformer la situation d’apprentissage scientifique (transvaser<br />
de l’eau) en jeu (jouer à faire du chocolat, du café, etc.). Le travail de décontextualisation/<br />
recontextualisation est ici visib<strong>le</strong>, de par la résistance d’une élève, alors qu’il semb<strong>le</strong> al<strong>le</strong>r de<br />
soi dans <strong>le</strong> travail avec <strong>le</strong>s éponges chez S.<br />
Cela dit, un objet pédagogisé peut provoquer des surprises, revêtir pour un temps <strong>le</strong> statut<br />
d’objet « farceur ». C’est <strong>le</strong> cas de l’éponge dans la classe de S. Cet objet y est utilisé<br />
pour permettre des déplacements d’eau. Lors de sa première utilisation par <strong>le</strong>s élèves,<br />
il mousse, provoquant ainsi un décalage entre <strong>le</strong>s discours attendus par la maîtresse et<br />
ceux immédiatement produits par <strong>le</strong>s élèves. On par<strong>le</strong> d’objet farceur, dans la mesure où<br />
cette caractéristique est inattendue pour la maîtresse aussi ; ce qui <strong>le</strong> différencie des objets<br />
pédagogiques transformés par el<strong>le</strong> avec une intention d’apprentissage, que l’on a appelé<br />
des « objets problèmes ».<br />
Enfin, l’objet pédagogisé peut redevenir un objet scolaire et perdre sa finalité pédagogique :<br />
c’est <strong>le</strong> cas des bassines, chez F., qui une fois la séance terminée sont vidées et essuyées<br />
par l’ATSEM sous <strong>le</strong> regard interrogatif de certains élèves qui semb<strong>le</strong>nt percevoir la perte<br />
de statut de l’objet sur <strong>le</strong>quel ils se sont centrés pendant l’activité.<br />
2.1.5. Objets liés à l’écriture :<br />
Nous avons observé des temps d’écriture durant <strong>le</strong>s deux séances de l’éco<strong>le</strong> Freinet (papier,<br />
stylos, crayons,… classe de S. et de F.). Il n’existe pas de moment équiva<strong>le</strong>nt dans l’activité<br />
de l’autre éco<strong>le</strong> (classe de J.).<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
2.2. Usages différenciés des objets selon <strong>le</strong>s classes<br />
Les classes Freinet se caractérisent, entre autres, par une utilisation d’objets pédagogisés.<br />
L’éco<strong>le</strong> va ici puiser des objets à l’extérieur de ses frontières mais pour répondre à ses propres<br />
objectifs. Cela demande un travail important de décontextualisation/recontextalisation de la<br />
part des maîtresses. Néanmoins, il n’existe pas de façon identique dans <strong>le</strong>s deux classes<br />
puisque la consigne n’est pas donnée aux mêmes moments des activités. Lorsque S présente<br />
d’emblée <strong>le</strong> problème à résoudre (déplacer l’eau), <strong>le</strong>s objets convoqués deviennent des<br />
outils au service de ce problème. Ils ne relèvent plus de la sphère quotidienne. Les élèves<br />
utilisent des récipients (inéga<strong>le</strong>ment efficaces) pour réaliser l’action demandée et pas des<br />
pots de yaourts ou des bouteil<strong>le</strong>s de shampooing détournés de <strong>le</strong>urs fonctions premières.<br />
Ainsi, nous observons qu’ils ne voient pas, ou ne par<strong>le</strong>nt pas de l’ancienne fonction de<br />
l’objet. Dans la classe de F, la consigne arrive après 0 minutes. Les élèves peuvent pendant<br />
ce premier temps manipu<strong>le</strong>r toute une série d’objets à <strong>le</strong>ur guise. La situation met donc<br />
en présence un liquide (l’eau) et des récipients spécifiques (comme un pot de chocolat).<br />
Les élèves, n’ayant pas construit encore d’autre cadre que celui lié à l’espace scolaire de<br />
l’activité, produisent des discours basés sur <strong>le</strong>ur quotidien hors-scolaire. Ils font semblant<br />
de boire, de préparer une boisson chocolatée… C’est <strong>le</strong> discours de la maîtresse (F) qui va<br />
canaliser puis interdire <strong>le</strong>s activités de jeu d’illusion mises en place spontanément par <strong>le</strong>s<br />
élèves (jouer à faire comme si…). Dans <strong>le</strong>s classes Freinet, si la maîtresse n’a pas établi<br />
d’emblée, par l’intermédiaire de la consigne qu’on ne joue pas, qu’on ne fait pas semblant,<br />
alors el<strong>le</strong> <strong>le</strong> rétablit dès que ce type de situation est construit par <strong>le</strong>s élèves. Il existe certes<br />
une différence temporel<strong>le</strong> entre <strong>le</strong>s deux classes, mais dans <strong>le</strong>s deux cas, <strong>le</strong>s maîtresses<br />
recontextualisent, par <strong>le</strong>urs énoncés verbaux, l’objet. Celui-ci est au service d’un travail ou<br />
d’une consigne mais pas d’un jeu. Ici <strong>le</strong> travail scolaire est mis à distance des situations qui<br />
feraient illusion. Ce n’est pas <strong>le</strong> cas de la classe de J qui déclare à la minute 0 « je vous ai<br />
apporté des ciseaux pour faire semblant », à la minute ’ « tiens <strong>le</strong>s comme si c’était des<br />
ciseaux », et fera semblant de se couper <strong>le</strong> doigt à la minute ’. Les ciseaux en carton sont<br />
des objets pédagogiques construits pour la séance. C’est donc la maîtresse qui <strong>le</strong>s introduit<br />
et qui <strong>le</strong>s accompagne d’un discours basé sur <strong>le</strong> jeu du « faire comme si ». Cette situation<br />
est très différente des deux précédentes. Dans l’éco<strong>le</strong> Freinet ces types de discours sont<br />
portés uniquement par <strong>le</strong>s élèves et sont recadrés systématiquement par <strong>le</strong>s maîtresses.<br />
Notons cependant que dans la classe de S, <strong>le</strong>s élèves peuvent continuer à « faire semblant »<br />
dès que la maîtresse ne <strong>le</strong>s regarde plus (cf. <strong>le</strong>s actions répétées de Camil<strong>le</strong> qui mime <strong>le</strong>s<br />
gestes liés au ménage – à partir de la e minute). Ainsi <strong>le</strong> discours de la maîtresse pose<br />
des limites qu’il ne faut pas franchir mais qui <strong>le</strong> sont hors de son regard. L’élève montre par<br />
cette attitude la prise de conscience de ce qui doit être fait ou pas, la situation interdite étant<br />
cachée. Lorsque des objets pédagogiques, fabriqués pour la séance, sont à l’œuvre dans<br />
<strong>le</strong>s deux classes Freinet, ils ont <strong>le</strong> statut d’outils et non pas d’objets d’étude. De plus, ils sont<br />
transformés par <strong>le</strong>s maîtresses et non pas créés comme <strong>le</strong> fait J. Cette distinction permet<br />
d’éclairer <strong>le</strong> discours qui <strong>le</strong>ur est associé. Une élève de la classe de S refuse d’utiliser<br />
un flacon parce qu’il est troué. C’est une sorte de dysfonctionnement de l’objet qui est<br />
mis en avant ici. Durant toute l’activité J nomme « ciseaux pour faire semblant » <strong>le</strong>s deux<br />
« lames » en cartons. El<strong>le</strong> va demander aux élèves de couper du papier avec cet objet<br />
malgré <strong>le</strong>urs réticences. Et ce n’est qu’à la fin de la séance qu’il sera question dans sa<br />
phrase de conclusion de vrais et de faux ciseaux. Cette catégorisation en termes de vrais et<br />
faux objets n’est jamais utilisée à l’éco<strong>le</strong> Freinet et serait peu pertinente aux vues des objets<br />
fabriqués par <strong>le</strong>s maîtresses.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Le temps de l’écriture sur <strong>le</strong>s actions et <strong>le</strong>s manipulations n’est pas présent en dehors des<br />
classes Freinet dans <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s il apparaît différemment. En effet c’est la maîtresse S qui<br />
écrit sous la dictée des élèves dans <strong>le</strong> temps de conclusion, alors que dans la seconde<br />
classe (F), chaque élève réalise une production personnel<strong>le</strong> (dessin et commentaire écrit<br />
sous forme de dictée à l’adulte) pour faire <strong>le</strong> récit de ce qui a eu lieu précédemment.<br />
3. Scénarios des activités scientifiques<br />
Les trois scénarios sont bien évidemment différents d’une classe à l’autre.<br />
Classe de S Classe de F Classe de J<br />
– Problème posé par la maîtresse.<br />
– Résolution sans outils (objets absents)<br />
– Proposition d’outils par <strong>le</strong>s élèves<br />
(déplacement de volume d’eau par<br />
transvasement).<br />
– Utilisation d’outils de plus en plus fins<br />
– Changement de problème scientifique<br />
(absorption).<br />
– Changement d’outils.<br />
– Arrêt de l’activité car il n’y a plus d’eau<br />
dans la bassine de départ.<br />
– Conclusion en groupe.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
– Manipulation d’objets sans consigne.<br />
– 0’ : problème posé par la maîtresse.<br />
– Recentrage des manipulations des<br />
élèves (déplacement de volume d’eau<br />
par transvasement).<br />
– Arrêt de l’activité car <strong>le</strong>s élèves<br />
ne peuvent plus mettre d’eau dans<br />
la bassine d’arrivée – risque de<br />
débordement.<br />
– Conclusions duel<strong>le</strong>s : un élève et la<br />
maîtresse.<br />
Tab<strong>le</strong>au 1 : scénarios des activités scientifiques<br />
– Manipulation sans consigne.<br />
– Travail sur la première<br />
caractéristique : <strong>le</strong> pivot.<br />
– Travail sur la seconde<br />
caractéristique : la matière<br />
(coupante ou pas).<br />
– Fin de l’activité.<br />
Les objets ne sont pas toujours introduits en même temps que la consigne. Ils peuvent la<br />
précéder et ainsi être mis immédiatement au service de diverses manipulations (F), être<br />
demandés par <strong>le</strong>s élèves pour pouvoir répondre à la consigne (S), ou apportés au fur et à<br />
mesure par la maîtresse en fonction des nouvel<strong>le</strong>s consignes (J).<br />
Les activités basées sur l’eau font travail<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s élèves sur différentes propriétés de l’eau<br />
(« ça mouil<strong>le</strong> », « ça cou<strong>le</strong> », « ça déborde »…), et sur <strong>le</strong>s déplacements de volume d’eau à<br />
l’aide de récipients. Mais <strong>le</strong>s problèmes scientifiques se distinguent lorsque dans la classe<br />
de S. <strong>le</strong> travail s’oriente sur une nouvel<strong>le</strong> façon de déplacer l’eau : on passe du déplacement<br />
avec récipients au déplacement par absorption et essorage. De plus, la fin de l’activité n’est<br />
pas attribuée au même phénomène. Dans la classe de S, c’est l’objectif annoncé au début<br />
qui, atteint, marque la fin de l’activité « on va mettre l’eau qui est dans la grande bassine,<br />
là-bas ». Il ne reste plus d’eau dans la bassine de départ, <strong>le</strong>s manipulations s’arrêtent. Dans<br />
la classe de F, <strong>le</strong> regard est porté sur la bassine d’arrivée. El<strong>le</strong> est p<strong>le</strong>ine, continuer de la<br />
remplir c’est créer un débordement, l’activité s’arrête.<br />
Dans la séance sur <strong>le</strong>s ciseaux, deux caractéristiques de cet outil sont travaillées : <strong>le</strong> point<br />
de pivot entre <strong>le</strong>s deux parties mobi<strong>le</strong>s et <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong>s lames peuvent couper selon la<br />
matière dont el<strong>le</strong>s sont faites. Ces deux caractéristiques ne sont pas travaillées en même<br />
temps. Le savoir est découpé et présenté successivement, sans mise en relation durant la<br />
séance. La dernière caractéristique permet de conclure la séance sur un discours lié aux<br />
risques de l’objet (« avec des vrais ciseaux ça fait mal, on se b<strong>le</strong>sse, du métal c’est coupant,<br />
une lame c’est coupant »). Ainsi <strong>le</strong>s ciseaux ne sont pas toujours définis par <strong>le</strong>ur fonction,<br />
être un outil coupant (création de ciseaux en cartons), mais peuvent l’être par <strong>le</strong>ur forme, ou<br />
la manière de <strong>le</strong>s faire fonctionner (mettre <strong>le</strong>s doigts dans <strong>le</strong>s poignées et <strong>le</strong>s actionner).
4. Liens avec <strong>le</strong>s résultats précédents<br />
Il s’agit maintenant d’établir quelques relations entre cette analyse circonstanciée des trois<br />
séances observées et ce que nous avons pu mettre en évidence des conduites langagières<br />
des élèves dans des entretiens à visée scientifique que nous avons dépouillés pour <strong>le</strong><br />
précédent rapport (juin 00 ). Les élèves dont nous avons analysé alors <strong>le</strong>s conduites<br />
langagières sont <strong>le</strong>s mêmes que ceux qui participent aux séances que nous venons de<br />
décrire (données recueillies en 00 - 00 ).<br />
Nous nous contenterons de mettre en évidence quelques relations entre ces deux ordres de<br />
données différentes : l’organisation des apprentissages scientifiques dans ces trois classes<br />
et l’actualisation par <strong>le</strong>s élèves de conduites langagières dans des situations décrochées.<br />
Il ne nous paraît pas possib<strong>le</strong> d’inférer des relations directes de cause à effet entre ces<br />
deux ordres de données différentes, tant <strong>le</strong>s biais sont innombrab<strong>le</strong>s, ne serait-ce que<br />
temporel<strong>le</strong>ment. En effet <strong>le</strong>s séances ont été observées en novembre (chez F.) et en février<br />
(chez S. et J.) et <strong>le</strong>s entretiens individuels avec <strong>le</strong>s élèves en janvier (chez J. et F.) et février<br />
(chez S.). S’il y a une grande proximité des deux recueils de données pour <strong>le</strong>s classes<br />
de S. et J., ce n’est pas <strong>le</strong> cas pour <strong>le</strong>s élèves de F. Par ail<strong>le</strong>urs, il faudrait évaluer <strong>le</strong>s<br />
productions verba<strong>le</strong>s des élèves, indépendamment de ce dispositif, pour pouvoir établir<br />
qu’un lien entre production langagière et organisation pédagogique ne dépend pas d’autres<br />
facteurs, comme la maîtrise du langage construite par exemp<strong>le</strong> dans la famil<strong>le</strong>, ou comme<br />
la familiarité des élèves avec des situations de paro<strong>le</strong> inédites pour eux (ce qui est <strong>le</strong> cas<br />
fréquemment mis en évidence des élèves Freinet), etc. Ces mises en relation sont donc à<br />
prendre avec beaucoup de précautions.<br />
Les premiers résultats de la précédente étude mettaient d’abord en évidence des différences<br />
entre <strong>le</strong>s trois classes dans la quantité globa<strong>le</strong> de paro<strong>le</strong> et l’engagement des élèves dans la<br />
situation d’entretien, qu’il nous semb<strong>le</strong> diffici<strong>le</strong> de reprendre ici de manière détaillée, vu que<br />
nous n’avons pas analysé ce que disent <strong>le</strong>s élèves dans <strong>le</strong>s séances de classe. Cependant<br />
la constatation que <strong>le</strong>s élèves de J. sont davantage si<strong>le</strong>ncieux et formu<strong>le</strong>nt davantage de<br />
réponses non-verba<strong>le</strong>s que <strong>le</strong>s élèves de S. et de F. est intéressante. Cela peut être mis<br />
en relation avec la nature du questionnement des maîtresses : <strong>le</strong>s élèves de J. sont, en<br />
classe, dans une position de répondeurs, voire de bons répondeurs (c’est-à-dire la position<br />
de celui qui a trouvé la réponse attendue), au contraire, par exemp<strong>le</strong>, des élèves de S. qui<br />
sont mis dans une position de chercheur d’idées et de solutions ou des élèves de F. qui sont<br />
abondamment sollicités pour décrire ce qu’ils font ou ce qu’ils voient, de manière ouverte.<br />
Devant une situation inédite pour eux, <strong>le</strong>s élèves de J. prennent peu de risques par rapport<br />
aux élèves Freinet qui ont peut-être moins peur de se tromper.<br />
Nous avions ensuite analysé un aspect des ressources linguistiques mobilisées par <strong>le</strong>s<br />
élèves, <strong>le</strong>s adjectifs, en quantifiant la production globa<strong>le</strong> d’adjectifs dans <strong>le</strong>s entretiens, aux<br />
différentes phases, et en identifiant si <strong>le</strong>s élèves produisaient des adjectifs en réponse à des<br />
questions de description ou d’argumentation ou d’explication. Nous avions constaté que <strong>le</strong>s<br />
élèves Freinet produisaient globa<strong>le</strong>ment davantage d’adjectifs que ceux de la classe de J.<br />
et qu’entre <strong>le</strong>s deux classes Freinet, c’était <strong>le</strong>s élèves de S. qui produisaient plus d’adjectifs<br />
que ceux de F.. En ce qui concerne <strong>le</strong>s types de discours différents, <strong>le</strong>s élèves des trois<br />
classes ont des résultats à peu près équiva<strong>le</strong>nts concernant la description, mais <strong>le</strong>s élèves<br />
Freinet se distinguent des autres par <strong>le</strong>ur production argumentative et explicative, <strong>le</strong>s élèves<br />
de F. étant un peu plus représentés dans <strong>le</strong>s conduites d’argumentation, et ceux de S. dans<br />
<strong>le</strong>s conduites d’explication. Il est possib<strong>le</strong> de mettre en relation ces résultats, notamment<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
ceux qui concernent <strong>le</strong>s types de discours différents, avec ce que nous avons observé ici<br />
du questionnement des maîtresses. La description apparaît comme la conduite discursive<br />
commune aux trois classes, selon des proportions variab<strong>le</strong>s, mais cela dépend peut-être<br />
des spécificités des séances observées. Par contre, nous avons pu mettre en évidence<br />
une demande importante de justification ou d’explication chez S. qu’il est diffici<strong>le</strong> de ne pas<br />
relier avec <strong>le</strong>s résultats de ses élèves lors des entretiens. La proportion d’élèves de F. qui<br />
entrent dans un propos argumentatif est, quant à lui, moins faci<strong>le</strong> à mettre en relation avec<br />
<strong>le</strong>s séances observées.<br />
Enfin, parmi d’autres observations, nous avions mis en évidence des comportements<br />
langagiers comp<strong>le</strong>xes, comme la verbalisation par anticipation d’un phénomène dont on<br />
peut inférer l’éventualité de l’occurrence à partir des expériences précédentes (la main<br />
va-t-el<strong>le</strong> laisser une trace sur <strong>le</strong> bois, comme el<strong>le</strong> l’a fait sur <strong>le</strong> sab<strong>le</strong> ou l’argi<strong>le</strong> ?). Nous<br />
avions observé quels liens cette verbalisation avait avec l’action : <strong>le</strong>s élèves verbalisaient-ils<br />
d’abord, par anticipation donc, avant de vérifier <strong>le</strong>ur hypothèse par une action sur <strong>le</strong> bois, ou<br />
agissaient-ils d’abord pour verbaliser ensuite, ou encore faisaient-ils <strong>le</strong>s deux simultanément ?<br />
L’autre conduite « comp<strong>le</strong>xe » était la production de ce que nous avons appelé « un récit<br />
d’hypothèses » : <strong>le</strong>s élèves étaient amenés à par<strong>le</strong>r à partir d’une empreinte d’animal prise<br />
dans un bloc d’argi<strong>le</strong> séché à propos du phénomène duquel cet objet pouvait résulter (récit<br />
d’une histoire non observée, d’une histoire supposée, reconstruction de l’histoire de l’argi<strong>le</strong><br />
comme objet évolutif, etc.). Sur ces deux conduites, <strong>le</strong>s élèves Freinet se distinguent des<br />
élèves de J. : ils sont <strong>le</strong>s seuls à verbaliser par anticipation sans manipulation préalab<strong>le</strong><br />
et à produire un récit d’hypothèses, surtout, pour ce dernier critère, <strong>le</strong>s élèves de S.. Là<br />
encore, il est intéressant de mettre en relation ces conduites langagières observées dans<br />
des situations décrochées avec ce que révè<strong>le</strong> l’analyse des séances de classe : l’importance<br />
des questions d’anticipation chez S. (un peu moindre chez F.) et la recherche de solutions<br />
à des problèmes inédits semb<strong>le</strong> laisser des traces lorsque ces élèves sont confrontés à de<br />
nouvel<strong>le</strong>s situations. S’il est diffici<strong>le</strong> d’établir sur ces points des différences entre <strong>le</strong>s deux<br />
classes Freinet, en tout cas, l’absence des élèves de J. dans cette catégorie de résultats<br />
peut être mise en relation avec <strong>le</strong> questionnement fermé de la maîtresse orienté vers<br />
l’application de techniques normées et dans <strong>le</strong>s phases de recherche de solution, l’absence<br />
de production langagière autre que la réponse aux questions posées et l’adaptation aux<br />
attentes de la maîtresse.<br />
Il nous semb<strong>le</strong>, pour terminer, que <strong>le</strong>s deux classes Freinet observées se rapprochent plus<br />
de ce que l’on peut attendre d’un enseignement scientifique, notamment par l’articulation<br />
forte entre la paro<strong>le</strong> des élèves et <strong>le</strong>ur action, par l’importance accordée à la recherche<br />
de solutions, aux conduites de justification et à la verbalisation de l’action a posteriori,<br />
notamment dans <strong>le</strong>s phases de récapitulation écrite, par <strong>le</strong> statut sérieux (non-fictif) donné<br />
aux objets observés/manipulés et par l’absence d’un questionnement fermé et normatif chez<br />
<strong>le</strong>s maîtresses. Dans ces deux classes, sont posés <strong>le</strong>s soubassements d’un enseignement<br />
des sciences à l’éco<strong>le</strong>.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Annexes<br />
Annexe 1 : Séance du 24/11/2003 (classe des petits-moyens – F.) :<br />
activité EAU<br />
Légende : M. désigne la maîtresse, <strong>le</strong>s autres initia<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s élèves.<br />
Entre [ ], des interventions d’élèves uti<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong> sens.<br />
En caractères gras, <strong>le</strong> marquage d’un changement d’activité.<br />
Time Énoncés de la maîtresse Actions des élèves Objets manipulés<br />
[l’eau ça va être pour nous]<br />
’ Vous attendez, je n’ai pas mis <strong>le</strong>s tabliers On enlève <strong>le</strong>s pulls et on<br />
met <strong>le</strong>s tabliers plastique<br />
L et O vont vers <strong>le</strong> bac à<br />
eau<br />
’ O. Qu’est-ce qui mouil<strong>le</strong> ? t’as trouvé du<br />
lait ? où ça ? tu crois que c’est du lait ?<br />
’ Qu’est-ce que t’es en train de faire là ?<br />
qu’est-ce que tu fais ? Tu utilises quoi ? À<br />
quoi ça sert ?<br />
’ Qu’est-ce que tu as rempli là ? Qu’estce<br />
que c’est cet objet-là ? ça s’appel<strong>le</strong><br />
comment ? c’est un verre ? [une bouteil<strong>le</strong>]<br />
Qu’est-ce que tu viens de faire ? Qu’est-ce<br />
que tu as mis dans ta bouteil<strong>le</strong>?<br />
’ Tu as mis l’eau de la bouteil<strong>le</strong> dans quoi ?<br />
Dans combien de verres ?<br />
0’ Qu’est-ce que ça fait quand tu remplis la<br />
bouteil<strong>le</strong> ?<br />
’ 0 [un élève dit « assez »] Assez de quoi ?<br />
Qu’est-ce que vous vou<strong>le</strong>z faire ? Remplir<br />
tout ?<br />
[el. « la bouteil<strong>le</strong>, Madame, el<strong>le</strong> est pas<br />
assez…. »]<br />
’ Qu’est-ce que tu as fait ? Est-ce qu’on est<br />
en train de jouer à la cuisine ? [L. par<strong>le</strong> sans<br />
arrêt de faire du chocolat, du café, etc.]<br />
Les élèves remplissent <strong>le</strong>s<br />
gobe<strong>le</strong>ts avec <strong>le</strong>s louches<br />
L. fait semblant de boire,<br />
suite du remplissage.<br />
Les gobe<strong>le</strong>ts p<strong>le</strong>ins sont<br />
vidés puis remplis à<br />
nouveau.<br />
On passe d’une activité de<br />
remplissage à une activité<br />
de transvasement. (L.<br />
remplit un pot à l’aide d’un<br />
autre pot rempli).<br />
Les verres remplis<br />
commencent à être rangés<br />
sur <strong>le</strong> bord du bac.<br />
L. a versé sa bouteil<strong>le</strong> dans<br />
<strong>le</strong>s verres de O.<br />
L. remplit ses pots en <strong>le</strong>s<br />
comptant.<br />
’ (Entrée d’une e élève<br />
sortant de la sieste).<br />
Suite du remplissage (avec<br />
<strong>le</strong>s louches ou d’autres<br />
pots, selon <strong>le</strong>s élèves) et de<br />
l’alignement des pots sur <strong>le</strong>s<br />
bords du bac<br />
’ Qu’est-ce qu’on va faire avec tous ces pots<br />
remplis ?<br />
20’ Il y a une bassine, vous prenez ce que<br />
vous vou<strong>le</strong>z et vous al<strong>le</strong>z <strong>le</strong> renverser<br />
dans une des deux bassines…<br />
’ Doucement… qu’est-ce qui se passe quand<br />
on va trop vite ? [ça tombe]<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Bac à eau p<strong>le</strong>in de gobe<strong>le</strong>ts<br />
transparents semblab<strong>le</strong>s<br />
+ quelques grosses<br />
louches de cou<strong>le</strong>ur vive<br />
(objets scolaires, sauf un<br />
pot d’Ovomaltine : objet<br />
extrascolaire).<br />
M. instal<strong>le</strong> deux bassines<br />
vides sur des tab<strong>le</strong>s sur <strong>le</strong><br />
côté du bac<br />
La M. va chercher d’autres<br />
pots : une vingtaine de<br />
petits pots de fromage blanc<br />
(objets scolarisés).<br />
Une serpillière est placée<br />
sous <strong>le</strong>s pieds des élèves.<br />
Les trois bassines vides.
’ L. si tu prends trois verres qu’est-ce qui se<br />
passe ? [ça arrose par terre]<br />
’ 0 M. essaie de faire dire à V. « j’ai rempli » Une bassine est presque<br />
p<strong>le</strong>ine.<br />
’ 0 [à élève Qui dit « ça fait des bul<strong>le</strong>s ici »]<br />
el<strong>le</strong> va jusqu’où l’eau ici ?<br />
’ L. on n’a pas dit qu’on prenait l’eau des<br />
bassines, on a dit qu’on prend l’eau du bac<br />
pour la mettre dans <strong>le</strong>s bassines.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Il n’y a presque plus d’eau<br />
dans <strong>le</strong> bac<br />
0’ Tu peux encore en mettre, L. ? L. cherche à voir jusqu’où<br />
on peut verser de l’eau dans<br />
une bassine sans qu’el<strong>le</strong><br />
déborde.<br />
’ 0 Qu’est-ce qui se passe, L. ? On cherche une autre<br />
serpillière<br />
Est-ce qu’on peut encore en mettre là ? V. verse un bocal dans une<br />
bassine presque p<strong>le</strong>ine.<br />
’ 0 Qu’est-ce qui se passe là ? On <strong>le</strong>s range, Les élèves. empi<strong>le</strong>nt <strong>le</strong>s<br />
<strong>le</strong>s gobe<strong>le</strong>ts ?<br />
gobe<strong>le</strong>ts.<br />
’ Stop ! ça cou<strong>le</strong>, ça veut dire ? Tu peux<br />
encore en mettre ou pas ?<br />
[el : j’ai mouillé <strong>le</strong> pull, c’est froid]<br />
Ah, tu vois, c’est froid !<br />
36’20 Alors on va poser <strong>le</strong>s mains, on pose la<br />
louche, on avait mis <strong>le</strong> pot là, c’est pas<br />
pour rien, qu’est-ce qu’on a fait ? On a<br />
rempli quoi ? Tu as travaillé à quoi ?<br />
Les élèves sont autour du<br />
bac, mains posées à plat<br />
’ 0 (Arrivée d’une autre élève).<br />
0’ On a rempli bassines et il n’y en a plus<br />
dans <strong>le</strong> bac ? Si on renverse, qu’est-ce qui<br />
va se passer ?<br />
41’ On va essayer de dessiner ce qu’on a<br />
fait.<br />
Élèves assis autour de la<br />
tab<strong>le</strong>.<br />
53’25 On va mettre dans un cahier. M. écrit sous la dictée<br />
ce que chaque élève a<br />
dessiné.<br />
Qu’est-ce que tu as fait ? et après ? t’as<br />
plongé dans l’eau ? t’es sûre ?<br />
Tu t’es servi de la louche pour faire quoi ?<br />
C’est tout ? avec <strong>le</strong>s bassines, on a fait<br />
quoi ?<br />
Ça veut dire « on a mis de l’eau dans la<br />
bassine »<br />
’ Fin de la séance<br />
M. écrit « j’ai renversé de<br />
l’eau avec <strong>le</strong> gobe<strong>le</strong>t ».<br />
Écrit « on a rempli la<br />
bassine d’eau ».<br />
M. fait répéter la phrase<br />
écrite.<br />
M. fait ce travail avec<br />
chaque élève.<br />
Papier, crayons.<br />
La femme de service vient<br />
rac<strong>le</strong>r <strong>le</strong> sol p<strong>le</strong>in d’eau et<br />
vider <strong>le</strong>s bassines (regard de<br />
V. sur cet objet qui perd son<br />
statut scolaire).
Annexe 2 : Séance du 02/02/2004 (classe des petits-moyens – S.) : activité<br />
EAU<br />
Légende : M. désigne la maîtresse, <strong>le</strong>s autres initia<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s élèves.<br />
Entre [ ], des interventions d’élèves uti<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong> sens<br />
En caractères gras, <strong>le</strong> marquage d’un changement d’activité<br />
En italique des indications de contextes<br />
Time Énoncés de la maîtresse Actions des élèves Objets manipulés<br />
0’<br />
0’ 0<br />
0’<br />
’ 0<br />
’0<br />
’<br />
On va mettre l’eau qui est dans la grande<br />
bassine, là-bas.<br />
On va faire comment pour mettre l’eau làbas<br />
?<br />
[on va prendre une bouteil<strong>le</strong>]<br />
Comment tu vas faire Mariam ?<br />
[on va prendre une bouteil<strong>le</strong>]<br />
Tu n’es pas obligée de faire comme Camil<strong>le</strong>.<br />
Qui a une autre idée ?<br />
Est-ce qu’on peut faire sans <strong>le</strong>s bouteil<strong>le</strong>s ?<br />
Est-ce qu’on peut amener l’eau là-bas sans<br />
<strong>le</strong>s bouteil<strong>le</strong>s ?<br />
Est-ce qu’on peut faire sans rien ?<br />
Est-ce qu’on peut transporter l’eau comme<br />
ça ?<br />
[Non]<br />
[on peut faire avec ses mains]<br />
Est-ce qu’on peut faire avec ces mains ? Tu<br />
essayes ?<br />
[faut al<strong>le</strong>r vite]<br />
[on peut faire avec ses mains]<br />
Est-ce qu’on peut faire avec ces mains ? Tu<br />
essayes (à Camil<strong>le</strong>)<br />
[faut al<strong>le</strong>r vite]<br />
Tu y arrives.<br />
[Il y a un trou] entre <strong>le</strong>s deux mains de<br />
Raphaël<br />
Qu’est-ce qui va se passer s’il y a un trou<br />
là ?<br />
Fais bien attention Raphaël.<br />
On va regarder….<br />
Bon je crois que Camil<strong>le</strong> avait une bonne<br />
idée.<br />
[<strong>le</strong>s bouteil<strong>le</strong>s]<br />
On va arrêter.<br />
Y’a que Raphaël qui n’a pas réussi. Tu veux<br />
lui montrer Camil<strong>le</strong> comment on fait.<br />
Les élèves portent des<br />
tabliers et sont debout devant<br />
deux grandes bassines<br />
d’eau.<br />
Camil<strong>le</strong> met de l’eau dans<br />
ses mains et tente de<br />
l’amener dans la bassine<br />
vide.<br />
Les autres élèves la<br />
regardent.<br />
Les autres élèves essaient.<br />
Raphaël ne serre pas assez<br />
ses deux mains.<br />
Les élèves tentent mais ce<br />
n’est pas évident.<br />
Les élèves qui n’ont pas<br />
encore fini continuent.<br />
Les élèves qui n’ont pas<br />
encore réussi continuent.<br />
La maîtresse est face au<br />
matériel qu’el<strong>le</strong> va sortir<br />
et fait des trous dans une<br />
bouteil<strong>le</strong> de shampooing.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
grandes bassines d’eau.
4’20<br />
’<br />
’ 0<br />
’<br />
’<br />
’ 0<br />
’<br />
’ 0<br />
’0<br />
’<br />
’<br />
’<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Les élèves se réunissent<br />
autour de la boîte avec <strong>le</strong>s<br />
différents récipients.<br />
Les élèves choisissent.<br />
Certains enfants en<br />
prennent deux, un dans<br />
chaque main.<br />
Ils commencent à utiliser<br />
<strong>le</strong>s ustensi<strong>le</strong>s pour vider <strong>le</strong>s<br />
bassines p<strong>le</strong>ines dans <strong>le</strong>s<br />
saladiers vides ( ).<br />
Raphaël fait <strong>le</strong>s premiers<br />
al<strong>le</strong>r-retour avec un pichet.<br />
D’autres élèves mettent plus<br />
de temps mais arrivent avec<br />
un récipient p<strong>le</strong>in d’eau dans<br />
chaque main.<br />
L’enseignante apporte du<br />
matériel :<br />
Arrosoir.<br />
Bouteil<strong>le</strong> de shampoing.<br />
Pichet en plastique.<br />
Verres en plastiques.<br />
Passoire.<br />
Arrosoir.<br />
Bouteil<strong>le</strong> de shampoing.<br />
Pichet en plastique.<br />
Verres en plastique.<br />
Alors qui est-ce qui y arrive ?<br />
[moi]<br />
il faut trouver une solution. L’élève change d’objet. Camil<strong>le</strong> a une bouteil<strong>le</strong> de<br />
shampoing percée.<br />
Qu’est-ce qu’il a pris Brahim ?<br />
La maîtresse va prendre<br />
deux grandes bassines, car<br />
Je vais prendre une grande bassine.<br />
Une élève par<strong>le</strong> de la bouteil<strong>le</strong> percée.<br />
<strong>le</strong>s saladiers sont p<strong>le</strong>ins.<br />
Les élèves continuent<br />
toujours <strong>le</strong>urs al<strong>le</strong>r-retour.<br />
Comment tu peux faire ?<br />
Il faut trouver une solution.<br />
Qui peut l’aider ? Camil<strong>le</strong> tu peux aider<br />
Alissa.<br />
Pourquoi tu as pris ça Brahim ? [un truc pour<br />
arroser <strong>le</strong>s f<strong>le</strong>urs] Camil<strong>le</strong>-]<br />
Pourquoi il a pris ça Brahim ?<br />
[Parce que c’est pour mettre de l’eau<br />
dedans pour arroser <strong>le</strong>s f<strong>le</strong>urs-Camil<strong>le</strong>]<br />
Pourquoi tu l’as choisi ?<br />
[Parce qu’il était grand- Brahim]<br />
On arrête un peu et on va regarder Brahim<br />
parce qu’il a quelque chose de grand.<br />
[y’a plus d’eau.]<br />
Et ça c’est quoi ?<br />
[De l’eau, mais y’en plus beaucoup.]<br />
Oui mais il faut finir.<br />
[Attend j’ai trouvé une solution. Tu prends de<br />
l’eau]<br />
Brahim tente de remplir son<br />
arrosoir.<br />
Il reste très peu d’eau dans<br />
<strong>le</strong>s bassines.<br />
Les élèves touchent avec<br />
<strong>le</strong>s mains <strong>le</strong> fond de la<br />
bassine pour constater<br />
qu’il reste un peu d’eau.<br />
Les élèves ne touchent que<br />
<strong>le</strong>s bassines à vider, ils ne<br />
vont plus vers <strong>le</strong>s bassines à<br />
remplir.<br />
Camil<strong>le</strong> tente de remplir son<br />
arrosoir mais n’y arrive pas.<br />
el<strong>le</strong> prend un broc plus petit<br />
que l’arrosoir, et el<strong>le</strong> rempli<br />
avec l’arrosoir.<br />
Arrosoir.<br />
Petit broc.<br />
Grand arrosoir.
’0<br />
’ 0<br />
0’00<br />
0’ 0<br />
Qu’est ce qu’el<strong>le</strong> a pris Camil<strong>le</strong> ?<br />
[de l’eau]<br />
Non c’est pas de l’eau ça- el<strong>le</strong> montre <strong>le</strong><br />
broc.<br />
C’est quoi ça ?<br />
[Camil<strong>le</strong> : pour mettre du café dans <strong>le</strong>s bols]<br />
Pourquoi tu prends celui là et tu ne<br />
continues pas avec l’arrosoir qui est grand ?<br />
[Parce qu’il y a plus beaucoup d’eau.]<br />
Tu n’y arrives plus ? pourquoi ? à Brahim<br />
[Parce y’a plus beaucoup d’eau.]<br />
Et pourquoi tu n’y arrives pas avec<br />
l’arrosoir ?<br />
Qui veut aider Brahim ?<br />
Vas-y aide <strong>le</strong> !<br />
[Non ça cou<strong>le</strong>]<br />
Tu crois que tu ne peux pas y arriver avec<br />
celui-là ? essaye.<br />
La maîtresse lui met dans <strong>le</strong>s mains, mais<br />
l’élève <strong>le</strong> repose.<br />
Essaye avec celui-là (la bouteil<strong>le</strong> trouée).<br />
Une autre élève répond, [non il est cassé]<br />
Alors tu peux pas remplir avec ça ?<br />
0’ 0 Alicia tu veux aider Léa ?<br />
[Je veux prendre là-bas.] Camil<strong>le</strong> montre <strong>le</strong>s<br />
saladiers p<strong>le</strong>ins<br />
0’ 0<br />
’00<br />
’0<br />
’<br />
’<br />
’<br />
non puisqu’on doit prendre tout ce qui est ici<br />
pour mettre là-bas.<br />
Qu’est-ce qu’il a pris Brahim pour que ce<br />
soit plus faci<strong>le</strong> ?<br />
Tu sais pourquoi tu fais comme ça ?<br />
Regardez ce qu’el<strong>le</strong> fait Camil<strong>le</strong>.<br />
Est-ce qu’el<strong>le</strong> pourrait faire autrement ?<br />
Regardez ce qu’el<strong>le</strong> fait Mariam, tu as vu ?<br />
Regardez comment el<strong>le</strong> fait el<strong>le</strong> pour remplir<br />
sans bouteil<strong>le</strong> son pot.<br />
Pourquoi tu prends plus de bouteil<strong>le</strong>s<br />
Mariam ?<br />
Tu sais<br />
Camil<strong>le</strong> continue de remplir<br />
son broc pour remplir son<br />
arrosoir pour remplir <strong>le</strong><br />
saladier et donc vider la<br />
bassine !<br />
Brahim prend un flacon<br />
de « petit marseillais gel<br />
douche » pour <strong>le</strong> remplir et<br />
ensuite remplir son arrosoir.<br />
Les élèves changent de<br />
récipients<br />
Une élève prend un flacon de<br />
gel douche troué.<br />
Les élèves continuent de<br />
tenter de vider <strong>le</strong>s bassines,<br />
il font <strong>le</strong>s mêmes gestes<br />
avec <strong>le</strong>s mêmes objets<br />
qu’au début, mais c’est peu<br />
efficace.<br />
Ils continuent….<br />
Camil<strong>le</strong> utilise maintenant<br />
trois objets intermédiaires :<br />
une bouteil<strong>le</strong> de shampoing<br />
qu’el<strong>le</strong> va vider dans <strong>le</strong> broc<br />
qu’el<strong>le</strong> vide dans l’arrosoir.<br />
(mais il n’y pas vraiment<br />
d’eau).<br />
Mariam essaie de prendre<br />
l’eau avec ses mains pour<br />
remplir <strong>le</strong> broc.<br />
Mariam continue et ne<br />
répond pas.<br />
Broc.<br />
Arrosoir.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Flacon de « petit marseillais<br />
gel douche ».<br />
Arrosoir.<br />
Bol.<br />
Petite bouteil<strong>le</strong> de jus.<br />
Les mains de Mariam.
’<br />
’<br />
’ 0<br />
’<br />
’ 0<br />
’ 0<br />
16’20<br />
’<br />
’<br />
’<br />
’0<br />
’<br />
0’<br />
0’<br />
[Y’a plus d’eau]<br />
Est-ce qu’il y a plus d’eau dans <strong>le</strong>s bassines<br />
ou y’en a encore ?<br />
Y’en a plus beaucoup, mais y’en a encore.<br />
Est-ce qu’on arrive encore à remplir avec <strong>le</strong>s<br />
bouteil<strong>le</strong>s ?<br />
[moi j’arrive plus]<br />
Alors qu’est-ce qu’il faut trouver<br />
maintenant ?<br />
Avec quoi on pourrait remplir maintenant ?<br />
Si quelqu’un a une autre idée, vous me<br />
dîtes.<br />
[J’y arrive plus, y’a plus beaucoup d’eau]<br />
Il faut trouver une autre idée<br />
On arrête un peu et on cherche une idée.<br />
On regarde comment on peut faire.<br />
Est-ce qu’avec l’arrosoir tu y arrives encore<br />
Brahim ?<br />
Est-ce qu’avec <strong>le</strong>s bouteil<strong>le</strong>s vous y<br />
arrivez ?<br />
On va regardez si Raphaël il y arrive avec<br />
sa bouteil<strong>le</strong>.<br />
Pourquoi on n’y arrive plus avec la<br />
bouteil<strong>le</strong> ?<br />
Avec quoi on pourrait arriver ?<br />
Qu’est-ce qu’on pourrait prendre pour<br />
prendre <strong>le</strong> fond de l’eau ?<br />
Il faut trouver une idée.<br />
Léa, tu étais allé chercher un objet pour<br />
remplir encore.<br />
Léa el<strong>le</strong> a trouvé une idée, il faudrait qu’el<strong>le</strong><br />
nous explique pourquoi el<strong>le</strong> prend ça.<br />
En parlant de la cuillère Léa dit : c’est plus<br />
pour <strong>le</strong> chocolat.<br />
Si tu prends quelque chose, tu vas expliquer<br />
pourquoi tu prends ça.<br />
Pourquoi tu prends ça ? el<strong>le</strong> s’adresse à<br />
chaque élève.<br />
Qu’est-ce qui va <strong>le</strong> mieux pour vider <strong>le</strong> fond<br />
de la bassine ?<br />
Est-ce que Camil<strong>le</strong> el<strong>le</strong> a trouvé un bon<br />
outil ?<br />
Alors qu’est-ce qui est plus pratique pour<br />
vider <strong>le</strong> fond de la bassine ?<br />
Comment ça s’appel<strong>le</strong> ce qu’el<strong>le</strong> a pris<br />
Camil<strong>le</strong> comment ça s’appel<strong>le</strong> ça ?<br />
entonnoir<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Brahim change d’outil,<br />
continue <strong>le</strong>s mêmes gestes,<br />
même s’il n’arrive pas à<br />
remplir l’eau.<br />
Les fil<strong>le</strong>s utilisent <strong>le</strong>urs<br />
mains, pas <strong>le</strong>s garçons.<br />
Les élèves ont du mal à<br />
arrêter.<br />
Raphaël essaie de prendre<br />
de l’eau avec sa bouteil<strong>le</strong>,<br />
mais cela ne marche pas.<br />
Léa va voir dans <strong>le</strong> carton<br />
de matériel et prend une<br />
cuillère.<br />
Les autres élèves vont<br />
chercher des objets dans <strong>le</strong><br />
carton.<br />
Les élèves reviennent avec<br />
des objets plus « fins ».<br />
Ils prennent <strong>le</strong>urs petits<br />
objets ou <strong>le</strong>s pel<strong>le</strong>s pour<br />
continuer de vider la bassine.<br />
Ils continuent.<br />
Arrosoir.<br />
Autre bouteil<strong>le</strong>.<br />
Cuillère en plastique.<br />
Cuillères.<br />
Pel<strong>le</strong>s.<br />
Dosettes.<br />
Les verres, tail<strong>le</strong> « dés à<br />
coudre ».<br />
Entonnoir.
’0<br />
’<br />
’<br />
’ 0<br />
’<br />
25’47<br />
Brahim commence à avoir du mal. Viens et<br />
regarde comment ils font ici.<br />
Non Camil<strong>le</strong> tu ne fais pas ça.<br />
C’est une solution de facilité.<br />
[y’a plus d’eau]<br />
Y’en a plus du tout ?<br />
[Si, mais pas beaucoup]<br />
Est-ce que c’est une bonne idée ?<br />
[Non]<br />
Pourquoi ?<br />
[y’a des trous]<br />
Alors pourquoi tu remplis ça ?<br />
Je suis sûre que si Brahim il s’arrange avec<br />
Raphaël ils pourront vider la bassine.<br />
Ensemb<strong>le</strong> vous pouvez trouver une solution.<br />
Essaie une solution pour al<strong>le</strong>r plus vite.<br />
C’est rapide ce que tu fais Brahim.<br />
Est-ce que <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s ont une idée pour<br />
al<strong>le</strong>r plus vite ?<br />
Ils continuent.<br />
Brahim reprend son pichet,<br />
mais n’y arrive pas.<br />
Ils regardent <strong>le</strong>s autres faire.<br />
Et retente avec son pichet.<br />
Alors il <strong>le</strong> penche et avec<br />
sa main droite tente de faire<br />
rentrer l’eau dans <strong>le</strong> pichet.<br />
Camil<strong>le</strong> fait en sens inverse<br />
de ce qui est demandé,<br />
el<strong>le</strong> commence à vider <strong>le</strong>s<br />
bassines p<strong>le</strong>ines.<br />
Certains remplissent avec<br />
<strong>le</strong>urs cuillères <strong>le</strong>s arrosoirs<br />
ou <strong>le</strong>ur bouteil<strong>le</strong> et attendent<br />
avant de <strong>le</strong>s vider dans<br />
<strong>le</strong>s bassines, d’autres<br />
remplissent une cuillère et<br />
font l’al<strong>le</strong>r-retour pour la vider<br />
dans <strong>le</strong>s bassines.<br />
Une élève se sert de la<br />
passoire.<br />
Ils vont chercher différents<br />
types de cuillères.<br />
Les élèves rac<strong>le</strong>nt <strong>le</strong> fond<br />
avec <strong>le</strong>urs cuillères.<br />
Les garçons font des al<strong>le</strong>rretour<br />
avec <strong>le</strong>urs cuillères<br />
(el<strong>le</strong>s ne semb<strong>le</strong>nt jamais<br />
contenir de l’eau).<br />
Comment on peut faire à deux ?<br />
Qu’est-ce qu’el<strong>le</strong> est en train de faire<br />
Camil<strong>le</strong> ?<br />
Camil<strong>le</strong> penche la bassine.<br />
’0<br />
Recommence ce que tu as fait Camil<strong>le</strong>.<br />
El<strong>le</strong> recommence.<br />
Personne ne semb<strong>le</strong> trouver<br />
l’idée bonne. Ils continuent.<br />
’<br />
C’est une bonne idée. Mariam penche la bassine<br />
pour s’aider.<br />
’<br />
C’était quoi ta bonne idée ? Explique aux<br />
garçons un peu.<br />
’ Est-ce que c’est bientôt fini de vider l’eau ?<br />
Une élève renverse la<br />
bassine et <strong>le</strong> fond de l’eau se<br />
renverse sur la tab<strong>le</strong>.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
0’0<br />
0’<br />
’0<br />
31’18<br />
’<br />
’ 0<br />
’<br />
’0<br />
’<br />
’<br />
’<br />
Où tu aurais pu vider la bassine ? Camil<strong>le</strong> prend la bassine et<br />
va la vider dans <strong>le</strong>s saladiers.<br />
On regarde s’il y a encore de l’eau dans <strong>le</strong>s<br />
bassines ou pas.<br />
Est-ce qu’il reste de l’eau dans <strong>le</strong>s<br />
bassines ?<br />
Est-ce que c’est sec ?<br />
Comment on peut faire ?<br />
Est-ce qu’on peut l’en<strong>le</strong>ver avec une<br />
bouteil<strong>le</strong> ?<br />
Avec quoi on peut en<strong>le</strong>ver l’eau au fond<br />
du bac ici ?<br />
Il reste des petites gouttes.<br />
Comment on fait pour essuyer quand il reste<br />
un tout petit peu d’eau, sur une tab<strong>le</strong>,…<br />
avec quoi on essuie ?<br />
[un torchon, une serviette]<br />
Qu’est-ce qu’on peut prendre aussi ?<br />
[mouchoir]<br />
Qu’est-ce qu’on peut prendre encore?<br />
Avec quoi <strong>le</strong>s mamans essuient la nappe<br />
quelque fois quand el<strong>le</strong> est mouillée ?<br />
[éponge]<br />
On va essayer avec <strong>le</strong>s trois : une éponge,<br />
un mouchoir, une serviette.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Deux élèves font la même<br />
chose avec la deuxième<br />
bassine.<br />
Mariam revient avec un<br />
arrosoir p<strong>le</strong>in (el<strong>le</strong> s’est servi<br />
dans <strong>le</strong>s saladiers p<strong>le</strong>ins).<br />
La maîtresse reprend tous<br />
<strong>le</strong>s récipients et <strong>le</strong>s range<br />
dans un carton.<br />
La maîtresse apporte <strong>le</strong>s<br />
nouveaux outils.<br />
Ils se mettent à essuyer <strong>le</strong>s<br />
bacs et la tab<strong>le</strong>.<br />
La maîtresse retire <strong>le</strong>s<br />
bassines de la tab<strong>le</strong>.<br />
On continue à amener l’eau là-bas. Les élèves essorent <strong>le</strong>urs<br />
éponges sur <strong>le</strong>s saladiers.<br />
Un garçon plonge son<br />
éponge dans <strong>le</strong> saladier puis<br />
l’essore.<br />
La maîtresse ne voit pas.<br />
Non Camil<strong>le</strong>, c’est pas ça qu’il faut faire. Camil<strong>le</strong> fait la même chose<br />
Qu’est-ce qu’il faut faire ?<br />
Voilà<br />
[ça fait de la mousse]<br />
Camil<strong>le</strong> essore son éponge<br />
Les élèves font des al<strong>le</strong>rretour<br />
et essorent <strong>le</strong>urs<br />
« outils » sur <strong>le</strong>s saladiers.<br />
mouchoirs.<br />
éponges.<br />
chiffons.
’<br />
Mais Camil<strong>le</strong>,<br />
[y’a du produit]<br />
Qu’est-ce qui marche <strong>le</strong> mieux pour essuyer<br />
la tab<strong>le</strong> ?<br />
Le chiffon, <strong>le</strong> mouchoir ou l’éponge ?<br />
Camil<strong>le</strong> replonge son éponge<br />
dans <strong>le</strong> saladier.<br />
Demande à Camil<strong>le</strong> de te prêter son éponge Ils échangent <strong>le</strong>urs outils.<br />
Camil<strong>le</strong> replonge son chiffon<br />
’0<br />
dans <strong>le</strong> saladier comme s’il<br />
s’agissait d’une serpillière.<br />
El<strong>le</strong> fixe la caméra.<br />
Les autres continuent<br />
d’essorer au dessus des<br />
saladiers.<br />
Camil<strong>le</strong> replonge son chiffon<br />
dans <strong>le</strong> saladier comme s’il<br />
s’agissait d’une serpillière.<br />
’<br />
El<strong>le</strong> fixe à nouveau la<br />
caméra.<br />
El<strong>le</strong> regarde du côté de la<br />
maîtresse qui ne la voit pas<br />
faire.<br />
On va laisser finir Léa. Camil<strong>le</strong> replonge son chiffon<br />
’<br />
dans <strong>le</strong> saladier. El<strong>le</strong> fixe la<br />
caméra. Regarde sa copine<br />
et lui dit « regarde moi ».<br />
Regarder ici Léa a pris une grande<br />
’<br />
serviette éponge et essuie<br />
la tab<strong>le</strong>. Les autres la<br />
regardent.<br />
’ Qu’est-ce qu’el<strong>le</strong> est en train de faire ?<br />
’<br />
Est-ce qu’il y a encore beaucoup d’eau sur<br />
la tab<strong>le</strong> ?<br />
El<strong>le</strong> est où l’eau maintenant ?<br />
Mariam touche la serviette<br />
’ [Dans la serviette]<br />
pour montrer où se trouve<br />
On va regarder.<br />
l’eau.<br />
’0 Est-ce qu’on voit de l’eau sur la serviette ?<br />
’<br />
C’est en touchant.<br />
Vous vou<strong>le</strong>z en<strong>le</strong>ver vos tabliers.<br />
Qu’est-ce que tu devais faire comme Les élèves sont<br />
39’35<br />
travail ?<br />
C’est quoi <strong>le</strong> travail qu’il fallait faire ?<br />
Qu’est-ce qu’on a pris au début ?<br />
rassemblés sur <strong>le</strong>s bancs.<br />
Ils répondent peu.<br />
Pourquoi il avait choisi un arrosoir<br />
Brahim ?<br />
Fin à minutes<br />
Serviette éponge.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
La maîtresse a un cahier<br />
et un stylo.
Annexe 3 : Séance du 02/02/2004 (classe des petits-moyens – J.) :<br />
activité Ciseaux<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Légende : M désigne la maîtresse, <strong>le</strong>s autres initia<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s élèves.<br />
Entre [ ], des interventions d’élèves uti<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong> sens<br />
En italique des indications de contextes<br />
En caractères gras, <strong>le</strong> marquage d’un changement d’activité<br />
Dispositif spatial et identification des élèves placés face à face :<br />
Fil<strong>le</strong> Garçon<br />
Garçon F (Julie)<br />
Maîtresse<br />
caméra<br />
Time Énoncés de la maîtresse Actions des élèves Objets manipulés<br />
’ 0 Regarde <strong>le</strong>s ciseaux, qu’est-ce qu’ils<br />
font ? Regardez, qu’est-ce qu’el<strong>le</strong>s font<br />
<strong>le</strong>s lames ? el<strong>le</strong>s restent pareil<strong>le</strong>s ?<br />
(à F1) Refais-<strong>le</strong>, pose <strong>le</strong>s ciseaux sur<br />
la tab<strong>le</strong>, posez <strong>le</strong>s ciseaux sur la tab<strong>le</strong>.<br />
Qu’est-ce qu’el<strong>le</strong> fait, Armel<strong>le</strong> ? c’est quoi<br />
ça ? E-car-ter, el<strong>le</strong> écarte <strong>le</strong>s anneaux,<br />
écartez <strong>le</strong>s anneaux, regardez <strong>le</strong>s mains,<br />
quand on écarte <strong>le</strong>s anneaux, qu’est-ce<br />
qu’el<strong>le</strong>s font <strong>le</strong>s lames des ciseaux ?<br />
[F : ouvertes]<br />
’ Quand on resserre <strong>le</strong>s anneaux, <strong>le</strong>s lames<br />
sont fermées et quand on <strong>le</strong>s écarte, el<strong>le</strong>s<br />
sont… [F : ouvertes]<br />
Quand on met <strong>le</strong>s doigts dans <strong>le</strong>s<br />
anneaux, quand on écarte <strong>le</strong>s anneaux,<br />
prenez <strong>le</strong>s ciseaux dans <strong>le</strong>s mains, on va<br />
écarter <strong>le</strong>s doigts…<br />
’ quand tu écartes, ça écarte <strong>le</strong>s lames,<br />
écarte tes doigts, qu’est-ce que ça fait ?<br />
ça ouvre <strong>le</strong>s lames, quand tu resserres <strong>le</strong>s<br />
doigts, ça ferme, on ouvre on ferme, on<br />
ouvre, on ferme, tu essaies G ?<br />
’ Hop, voilà, tu écartes <strong>le</strong>s doigts ça ouvre<br />
<strong>le</strong>s lames quand tu <strong>le</strong>s fermes, ça ferme<br />
<strong>le</strong>s lames.<br />
Les élèves utilisent <strong>le</strong>s ciseaux<br />
de manière conventionnel<strong>le</strong>,<br />
mais sans avoir de papier à<br />
couper.<br />
F pose ses ciseaux ouverts<br />
sur la tab<strong>le</strong>.<br />
Les élèves <strong>le</strong>s posent ouverts<br />
sur la tab<strong>le</strong>.<br />
F et G <strong>le</strong>s regardent sans <strong>le</strong>s<br />
toucher.<br />
F et G <strong>le</strong>s manipu<strong>le</strong>nt dans<br />
<strong>le</strong> plan de la tab<strong>le</strong> en utilisant<br />
pouces et index.<br />
Les élèves prennent <strong>le</strong>s ciseaux<br />
de manière conventionnel<strong>le</strong><br />
en mettant <strong>le</strong>s doigts dans <strong>le</strong>s<br />
anneaux.<br />
Une élève fait fonctionner <strong>le</strong>s<br />
ciseaux à l’horizonta<strong>le</strong> sur la<br />
tab<strong>le</strong>.<br />
M. place <strong>le</strong> pouce et <strong>le</strong> majeur<br />
de F dans <strong>le</strong>s trous et l’aide<br />
à ouvrir/fermer, en tenant <strong>le</strong>s<br />
ciseaux au-dessus de la tab<strong>le</strong>.<br />
19’35 on va poser <strong>le</strong>s ciseaux. M. pose sur la tab<strong>le</strong> <strong>le</strong>s deux<br />
branches de ciseaux de<br />
métal.<br />
’ 0 Regardez… [el : c’est cassé] c’est<br />
démonté ; si on veut <strong>le</strong> remettre comment<br />
il faut faire ?<br />
[F : mettre ça la]<br />
vas-y fais-<strong>le</strong>.<br />
F montre une branche et un<br />
anneau, puis el<strong>le</strong> associe <strong>le</strong>s<br />
deux branches, au dessus de la<br />
tab<strong>le</strong>, et en <strong>le</strong>s collant l’une sur<br />
l’autre à l’endroit du pivot, mais<br />
sans <strong>le</strong>s croiser clairement.<br />
paires de petits ciseaux à<br />
bouts ronds.<br />
Deux branches disjointes<br />
d’une paire de ciseaux de<br />
métal.
20’20 Ceux-là sont cassés ça va pas bien<br />
marcher, moi je vous ai ramené des<br />
ciseaux pour faire semblant.<br />
0’ J’ai rapporté ça (branches en carton), on<br />
va poser ça (ciseaux en métal), vous me<br />
<strong>le</strong> donnez ?<br />
Je vous ai rapporté ça (branches en<br />
carton), qui est-ce qui en veut ?<br />
’ On va essayer de faire des ciseaux,<br />
comment on va faire ça ? comment on va<br />
faire ? [c’est cassé]<br />
’ Regarde comme ça,<br />
[F : des ciseaux !]<br />
M. commence à distribuer à<br />
F1 & G1 deux branches de<br />
carton et une attache<br />
à F2 & G2 deux branches de<br />
plastique et un écrou.<br />
M. ramasse <strong>le</strong>s petits ciseaux.<br />
G & F placent l’écrou en haut<br />
d’une barre jaune.<br />
G & F manipu<strong>le</strong>nt <strong>le</strong>s<br />
branches de carton.<br />
Ils hésitent sur l’orientation<br />
des branches. G essaie<br />
d’enfoncer l’attache dans <strong>le</strong>s<br />
branches approximativement<br />
superposées.<br />
M montre comment on<br />
reconstitue la paire disjointe<br />
en croisant et en associant <strong>le</strong>s<br />
deux branches (une partie de<br />
vis est en place et permet de<br />
reconstituer la paire).<br />
il y a une petite vis là el<strong>le</strong> pointe sur <strong>le</strong> point d’attache,<br />
puis pose <strong>le</strong>s branches sur la<br />
tab<strong>le</strong>.<br />
F s’empare de la paire<br />
disjointe.<br />
’0 Je tiens <strong>le</strong>s ciseaux comme ça M. prend un des petits ciseaux<br />
de métal, l’ouvre, et <strong>le</strong> tient par<br />
un des anneaux entre <strong>le</strong> pouce<br />
et l’index. El<strong>le</strong> l’agite dans l’air<br />
(<strong>le</strong> point d’attache est ainsi plus<br />
visib<strong>le</strong>).<br />
’ Essaie de croiser comme ça F travail<strong>le</strong> avec <strong>le</strong>s ciseaux<br />
démontés et essaie de <strong>le</strong>s<br />
ajuster, comme M.<br />
’ Regardez F , el<strong>le</strong> a croisé <strong>le</strong>s ciseaux,<br />
croisé <strong>le</strong>s ciseaux comme ça<br />
(à G1) Essaie un petit peu, essaie de<br />
croiser<br />
M. intervient auprès de F et<br />
réajuster <strong>le</strong> croisement des<br />
deux branches en pointant<br />
l’endroit de la vis.<br />
M. pointe sur <strong>le</strong>s deux barres<br />
parallè<strong>le</strong>s que G a devant lui la<br />
place du pivot.<br />
’ Julie, qu’est-ce que tu as fait ? Julie tient entre ses mains deux<br />
barres jaunes superposées. Un<br />
boulon est placé sur l’une des<br />
deux, tout en haut.<br />
’ Je peux en<strong>le</strong>ver ?<br />
Regardez Julie, ce qu’el<strong>le</strong> a fait là<br />
je vais t’aider, pour attacher il faut peutêtre<br />
que tu attaches ici<br />
M. ôte <strong>le</strong> boulon que Julie avait<br />
placé sur <strong>le</strong> dernier trou d’une<br />
barre jaune et place <strong>le</strong>s deux<br />
barres comme il faut en pointant<br />
avec l’index l’endroit où il faut<br />
<strong>le</strong>s attacher (au milieu des<br />
barres).<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Branches de grands<br />
ciseaux en carton ;<br />
non jointes, et attaches<br />
parisiennes.<br />
Matériel pédagogique<br />
en plastique, type jeu de<br />
construction : longues<br />
barres jaunes trouées à<br />
interval<strong>le</strong>s réguliers et<br />
écrous b<strong>le</strong>us.<br />
Paire disjointe.<br />
Ciseaux de métal.
’0 Regarde si on met <strong>le</strong> doigt, mets ton doigt,<br />
si on prend <strong>le</strong> doigt de F , je vais faire<br />
des ciseaux, ça marche, mais on peut<br />
pas laisser ton doigt, on va mettre autre<br />
chose, al<strong>le</strong>z vas-y, tu essaies d’attacher.<br />
’ (à F2) Qu’est-ce qui ne va pas ? qu’estce<br />
qu’il faut faire pour que ça ail<strong>le</strong> ? tu te<br />
souviens on a un jeu avec des boulons,<br />
on tourne, on visse, vas-y<br />
(À F1) tu fais pareil avec tes ciseaux (de<br />
carton)<br />
G , tu essaies de faire des ciseaux ?<br />
Qu’est-ce qu’el<strong>le</strong> a fait, F ? el<strong>le</strong> a croisé<br />
<strong>le</strong>s ciseaux<br />
’ On va regarder ce qu’el<strong>le</strong> a fait Julie,<br />
tu <strong>le</strong>s ouvres tes ciseaux ?<br />
on va laisser ça (l’écrou),<br />
tiens-<strong>le</strong>s comme des ciseaux, tiens-<strong>le</strong>s<br />
comme si c’était des ciseaux.<br />
’ (à F1) tu sais avec <strong>le</strong>s ciseaux (de métal),<br />
pour <strong>le</strong>s réparer, ça va être diffici<strong>le</strong> car ils<br />
sont cassés, on va faire en semblant, fais<br />
pareil avec ton carton.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
M. met son index dans <strong>le</strong> trou<br />
central, puis el<strong>le</strong> <strong>le</strong> remplace<br />
par celui de F et fait tourner <strong>le</strong>s<br />
branches autour du doigt de F ,<br />
en plaçant ses pouce et index<br />
dans <strong>le</strong>s trous à l’extrémité des<br />
branches.<br />
G a croisé <strong>le</strong>s deux barres<br />
mais de manière asymétrique<br />
en choisissant un point<br />
d’attache différent sur chaque<br />
barre.<br />
F a du mal à associer <strong>le</strong>s<br />
parties de l’écrou.<br />
F a bien associé la paire de<br />
métal disjointe.<br />
G a vaguement rapproché ses<br />
deux morceaux de papier sur<br />
la tab<strong>le</strong> et essaie d’enfoncer<br />
l’attache mais <strong>le</strong> bois de la tab<strong>le</strong><br />
l’en empêche, M. intervient<br />
pour écarter <strong>le</strong>s deux branches<br />
en rendant visib<strong>le</strong> <strong>le</strong> point<br />
d’attache.<br />
Julie présente <strong>le</strong>s deux<br />
branches fermées, fixées avec<br />
l’écrou.<br />
F tourne l’écrou.<br />
M. prend <strong>le</strong>s « ciseaux »<br />
fermés, <strong>le</strong>s ouvre en tirant sur<br />
chaque branche et <strong>le</strong>s redonne<br />
ouverts à F .<br />
F place son index et son<br />
annulaire dans un trou de<br />
chaque branche.<br />
M. s’approche de F , lui enlève<br />
la paire de métal disjointe et<br />
dispose devant el<strong>le</strong> <strong>le</strong>s deux<br />
branches de carton, légèrement<br />
écartées.<br />
M. change <strong>le</strong>s attaches<br />
parisiennes de G F .<br />
’ 0<br />
Attends, je vais t’en donner une autre el<strong>le</strong><br />
est un petit peu écartée (l’attache)<br />
Attends El<strong>le</strong> place <strong>le</strong>s deux attaches<br />
parisiennes au centre de la<br />
construction en papier de G<br />
F .<br />
Et maintenant, on va écarter un petit peu M aide F à placer <strong>le</strong>s deux<br />
branches l’une sur l’autre pour<br />
fixer l’attache.<br />
’ (à G2) : voilà voilà, tu as des ciseaux mais<br />
il faut que tu fermes xxx sinon ça ne va<br />
pas tenir tu te souviens qu’il faut visser ?<br />
on avait fait ça une fois et maintenant<br />
(à F1) ce que tu avais fait tout à l’heure, tu<br />
avais croisé<br />
prends-<strong>le</strong>s comme des ciseaux, tes doigts<br />
dans <strong>le</strong> trou tu écartes maintenant voilà<br />
t’as des grands ciseaux maintenant
27’27 Je vais vous donner un papier, on va<br />
regarder si ça marche<br />
essaie de couper<br />
’ Après un essai avec <strong>le</strong>s ciseaux<br />
de papier, Garçon gauche<br />
s’empare des ciseaux en métal,<br />
M. <strong>le</strong>s lui enlève des mains.<br />
’ 0<br />
Ah non non non tu essaies de couper avec<br />
<strong>le</strong>s ciseaux que tu as fabriqués, essaie de<br />
couper avec ça<br />
Ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas ? M. donne une feuil<strong>le</strong> à G.<br />
Ça ne va pas (assertif)<br />
’ (à G) Je vais tenir <strong>le</strong> papier, essaye de<br />
couper<br />
idem avec Julie<br />
’ Essayez un peu avec <strong>le</strong>s vrais ciseaux,<br />
touchez <strong>le</strong>s lames, comment el<strong>le</strong>s sont ?<br />
[froides] el<strong>le</strong>s sont froides et puis…<br />
prenez ça (papier) un petit peu dans <strong>le</strong>s<br />
mains, <strong>le</strong>s lames, touche <strong>le</strong>s lames, estce<br />
que c’est pareil que là ? (métal) [non]<br />
et toi touche ici, tout doucement on va<br />
toucher là (tranche de la lame)<br />
’ 0 quand on utilise des ciseaux il faut faire<br />
attention. Parce que…. ça coupe, <strong>le</strong>s<br />
lames el<strong>le</strong>s sont dures, el<strong>le</strong>s sont en<br />
métal,<br />
et ça (plastique) est-ce que ça coupe<br />
comme un couteau ? [non non] ça, ça<br />
coupe comme un couteau ? [oui] ben<br />
essaie, si ça coupe comme un couteau<br />
ça peut couper <strong>le</strong>s doigts, [oui] est-ce que<br />
ça coupe <strong>le</strong>s doigts ? [non, non ça coupe<br />
<strong>le</strong> papier] ça coupe même pas <strong>le</strong> papier<br />
ce ne sont pas des lames, pour que ça<br />
coupe il faut que ce soit dur, il faut que ce<br />
soit en métal<br />
0’ Et là c’est quoi ça, il était en quoi ? il fait<br />
dans quoi ? c’est du carton, prends-<strong>le</strong><br />
dans tes mains<br />
Essayez de faire ça (avec <strong>le</strong> métal)<br />
essayez de <strong>le</strong>s casser on peut pas c’est<br />
trop dur.<br />
J’en ai d’autres pour faire semblant,<br />
essaie aussi, est-ce que tu peux faire<br />
pareil avec ces ciseaux – là (métal) c’est<br />
solide, c’est dur <strong>le</strong> métal<br />
’ Voilà. C’est fragi<strong>le</strong> <strong>le</strong> carton, <strong>le</strong> carton<br />
ça ne peut pas couper, tu vois, tu peux<br />
passer ton doigt c’est pareil, là çà n’est<br />
pas coupant, on peut pas se b<strong>le</strong>sser avec<br />
ça, avec des vrais ciseaux ça fait mal, on<br />
se b<strong>le</strong>sse, du métal c’est coupant, une<br />
lame c’est coupant voilà.<br />
Arrêt à<br />
’<br />
[observateur : Bon ? c’est fini pour vous ?<br />
bon, on arrête alors]<br />
M. passe son doigt sur <strong>le</strong><br />
tranchant des lames de ciseaux<br />
(en papier et métal), et guide <strong>le</strong>s<br />
doigts des élèves de même.<br />
M. prend <strong>le</strong>s ciseaux papier,<br />
el<strong>le</strong> <strong>le</strong>s plie, essaie de faire<br />
de même avec <strong>le</strong>s ciseaux de<br />
métal.<br />
Les élèves essaient de plier <strong>le</strong><br />
métal puis <strong>le</strong> papier.<br />
M. donne à F & G <strong>le</strong>s ciseaux<br />
en papier.<br />
M. passe son doigt sur <strong>le</strong><br />
tranchant du papier et du<br />
plastique.<br />
El<strong>le</strong> fait semblant de couper son<br />
doigt avec <strong>le</strong>s vrais ciseaux.<br />
M. se tourne vers la caméra.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Feuil<strong>le</strong>s de papier blanc.<br />
Deux autres paires<br />
de ciseaux de carton,<br />
construites, encore plus<br />
grandes.
Pratiques langagières dans <strong>le</strong>s classes de<br />
mathématiques<br />
1. Objet d’étude et méthodologie<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Dominique LAHANIER-REUTER<br />
Maître de conférences<br />
Université de Lil<strong>le</strong> III<br />
Équipe THEODILE<br />
Dans la continuité de la recherche précédente, nous avons cherché à décrire <strong>le</strong>s<br />
fonctionnements didactiques dans <strong>le</strong>s classes de mathématiques du groupe scolaire<br />
Concorde. Pour approcher ces fonctionnements, nous avons décidé de nous intéresser<br />
tout particulièrement aux objets d’étude et aux manières de travail<strong>le</strong>r avec ces objets tels<br />
que nous pouvions <strong>le</strong>s appréhender au travers d’observations de classe. Cet intérêt nous<br />
a semblé légitime a priori car <strong>le</strong>s résultats que nous avions obtenus laissaient supposer<br />
des objets à travail<strong>le</strong>r et des façons de <strong>le</strong>s étudier tout à fait spécifiques aux classes<br />
de mathématiques de cet établissement. L’une des particularités de l’organisation de<br />
l’enseignement des mathématiques dans cette éco<strong>le</strong> « freinet » est en effet de privilégier<br />
<strong>le</strong>s recherches individuel<strong>le</strong>s, qui permettent à chaque élève de travail<strong>le</strong>r une question<br />
personnel<strong>le</strong>. L’une des caractéristiques <strong>le</strong>s plus emblématiques de l’enseignement de cette<br />
discipline, à savoir que l’ensemb<strong>le</strong> des élèves de la classe étudient en même temps <strong>le</strong><br />
même objet n’est donc pas ici respectée. D’autre part nous avions pu, à partir d’observations<br />
dans ces classes, re<strong>le</strong>ver des thèmes de recherche mathématiques « extra-ordinaires »,<br />
comme celui du nombre de cerc<strong>le</strong>s nécessaire à la construction de deux, trois… rosaces,<br />
d’autres au contraire dans <strong>le</strong>squels nous pouvions reconnaître des thèmes « classiques » à<br />
l’éco<strong>le</strong> comme celui de la recherche de la conversion de dirhams en euros. Ainsi, l’analyse<br />
de ces objets d’étude dans <strong>le</strong>s classes de mathématiques de cette éco<strong>le</strong> « freinet » peut<br />
être un point intéressant de notre projet de connaissances, en ce qu’ils apparaissent à la<br />
fois différents et similaires d’autres objets étudiés ail<strong>le</strong>urs, ils disent quelque chose des<br />
pratiques et dispositifs disciplinaires dans cette éco<strong>le</strong> et peut-être de <strong>le</strong>urs effets. Mais nous<br />
avons éga<strong>le</strong>ment choisi d’étudier de façon attentive <strong>le</strong>s manières de travail<strong>le</strong>r avec ces<br />
objets d’étude qui s’instaurent dans ces classes. Nous avions déjà pu mettre en évidence<br />
des rapports à l’erreur qui nous paraissaient spécifiques des élèves « freinet », ainsi que<br />
des conduites argumentatives qui l’étaient tout autant. Il nous a en conséquence semblé<br />
que l’analyse des positions respectives du maître et des élèves par rapport à ces objets,<br />
aux résultats et à la façon dont ils émergeaient et dont ils étaient confirmés ou non pourrait<br />
nous révé<strong>le</strong>r éga<strong>le</strong>ment des particularités de la gestion didactique des maîtres « freinet ».<br />
Ce sera donc en terme de phénomènes de topogénèse et de chronogénèse que nous<br />
chercherons à décrire principa<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s manières de faire associées à l’étude de questions<br />
disciplinaires.<br />
Pour mener à bien notre étude, nous nous sommes essentiel<strong>le</strong>ment centrés sur l’analyse<br />
de discours écrits et oraux. Par exemp<strong>le</strong>, nous avons étudié <strong>le</strong>s différentes formulations<br />
et reformulations des projets, questions, thèmes de recherche énoncés par <strong>le</strong>s élèves<br />
ou l’enseignant pour décrire <strong>le</strong>s objets d’étude. De même, pour mettre en évidence des<br />
phénomènes de gestion de la chronogénèse, nous avons tenté d’identifier certaines
des interactions langagières décisives en terme d’avancée du temps didactique, de<br />
programmation de l’étude, d’inscription dans la mémoire col<strong>le</strong>ctive ou individuel<strong>le</strong>… enfin,<br />
pour signa<strong>le</strong>r des gestions particulières de la topogénèse nous avons fait <strong>le</strong> choix de nous<br />
centrer principa<strong>le</strong>ment sur l’analyse d’énoncés – des élèves ou du maître –. Ainsi ce sont <strong>le</strong>s<br />
pratiques langagières qui constituent <strong>le</strong> cadre de l’analyse que nous allons développer.<br />
Méthodologiquement, cela signifie que nous travaillons à partir de retranscriptions des<br />
échanges oraux dans la classe de mathématiques, de travaux écrits d’élèves produits<br />
toujours dans l’espace de cette classe.<br />
De façon plus généra<strong>le</strong>, notre projet de description des pratiques disciplinaires et de <strong>le</strong>urs<br />
effets nécessite encore une possibilité de comparaison. Nous avons repris notre position<br />
antérieure. Les opérations de comparaison que nous avons menées sont de deux ordres :<br />
Des comparaisons de productions d’élèves sollicitées auprès de plusieurs classes<br />
de différentes éco<strong>le</strong>s. Ces productions d’élèves sont recueillies dans <strong>le</strong>s classes de<br />
mathématiques, mais el<strong>le</strong>s ne sont pas des productions ordinaires : l’énoncé, la consigne<br />
de travail ne sont pas établis par l’enseignant mais par <strong>le</strong>s chercheurs. ces supports sont<br />
<strong>le</strong>s mêmes pour tous et engagent dans des tâches et des conduites langagières que nous<br />
considérons a priori peu fréquentes à l’éco<strong>le</strong>, bien qu’explicitement consacrées par <strong>le</strong>s<br />
instructions officiel<strong>le</strong>s des niveaux d’enseignement visés.<br />
Des comparaisons des interactions langagières ‘ordinaires’, non sollicitées par <strong>le</strong> chercheur<br />
dans <strong>le</strong>s classes el<strong>le</strong>s-mêmes.<br />
Les premières comparaisons sont utilisées pour déce<strong>le</strong>r des éventuel<strong>le</strong>s spécificités des<br />
élèves de l’éco<strong>le</strong> « Freinet », dans <strong>le</strong>urs compétences langagières et disciplinaires. Ces<br />
éventuel<strong>le</strong>s spécificités nous servent à construire des hypothèses sur <strong>le</strong>s usages du langage<br />
dans la discipline considérée. Les secondes comparaisons sont destinées à montrer <strong>le</strong>s<br />
particularités de certains phénomènes didactiques mis en évidence.<br />
2. Comparaison de productions d’élèves « suscitées »<br />
L’étude a été menée en comparant <strong>le</strong>s productions<br />
–<br />
–<br />
des élèves de CM et CM « Freinet » des années 00 et 00 ;<br />
des élèves de trois CM et deux CM d’éco<strong>le</strong>s de la banlieue lilloise.<br />
Ces éco<strong>le</strong>s se différencient de l’éco<strong>le</strong> « Freinet » par <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong>s enseignants ne se<br />
revendiquent pas du mouvement Freinet. L’une d’entre el<strong>le</strong>s s’en distingue aussi par la<br />
répartition des milieux socioculturels des élèves qui la fréquentent. En effet, cel<strong>le</strong>-ci fait<br />
apparaître davantage d’élèves issus de milieux dits « plutôt favorisés » que l’éco<strong>le</strong> Hélène<br />
Boucher. L’étude a été élargie aux productions d’élèves de CM d’une autre éco<strong>le</strong> de la<br />
banlieue lilloise, cette fois très semblab<strong>le</strong> en ce qui concerne la répartition des milieux<br />
socioculturels à cel<strong>le</strong> de l’éco<strong>le</strong> Freinet. Au total, productions d’élèves ont été<br />
recueillies.<br />
L’énoncé et la consigne donnés aux élèves sont <strong>le</strong>s suivants :<br />
« Comment faire pour tracer cette figure ? »<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Il s’agit par conséquent d’une tâche d’écriture d’un « programme d’instructions pour<br />
reproduire une figure comp<strong>le</strong>xe ». El<strong>le</strong> requiert pour être menée à bien, d’identifier et de<br />
désigner des éléments constructib<strong>le</strong>s par <strong>le</strong> <strong>le</strong>cteur, d’identifier et de désigner <strong>le</strong>s relations<br />
constructib<strong>le</strong>s qui existent entre ces divers éléments. Il n’est ainsi pas équiva<strong>le</strong>nt, lorsque l’on<br />
est élève de CM ou de CM , de produire comme programme de construction : « trace deux<br />
droites perpendiculaires, trace un cerc<strong>le</strong> dont <strong>le</strong> centre est <strong>le</strong> croisement des deux droites et<br />
relie <strong>le</strong>s points d’intersection des deux droites et du cerc<strong>le</strong> » ou « trace un carré, trace ses<br />
diagona<strong>le</strong>s et son centre, trace <strong>le</strong> cerc<strong>le</strong> dont <strong>le</strong> centre est celui du carré et qui passe par<br />
<strong>le</strong>s sommets du carré » ou encore « trace un cerc<strong>le</strong> et un carré à l’intérieur de ce cerc<strong>le</strong> ».<br />
En effet <strong>le</strong> premier texte désigne des objets et des relations géométriques entre ces objets<br />
qui sont aisément constructib<strong>le</strong>s par des élèves de ces niveaux scolaires. En revanche<br />
<strong>le</strong> second suppose <strong>le</strong> tracé d’un carré, ce qui l’est déjà moins. Enfin <strong>le</strong> dernier « ellipse »<br />
justement des tracés nécessaires pour parvenir à inscrire un carré dans un cerc<strong>le</strong>.<br />
Nous avons retenu comme premiers indicateurs des positions d’écriture adoptées<br />
par <strong>le</strong>s élèves <strong>le</strong>s éléments choisis et <strong>le</strong>urs désignations, <strong>le</strong>s relations géométriques<br />
mentionnées et <strong>le</strong>ur désignation (<strong>le</strong>s indicateurs correspondants sont <strong>le</strong>s nombres de<br />
termes géométriques utilisés, <strong>le</strong>s éléments choisis – cerc<strong>le</strong>, droites, sommets etc. – <strong>le</strong>s<br />
relations tel<strong>le</strong>s la perpendicularité, <strong>le</strong>s positions topologiques etc.). Il s’agit en conséquence<br />
de déce<strong>le</strong>r, au travers des discours des élèves, <strong>le</strong>s analyses de la figure qu’ils ont choisies<br />
de communiquer.<br />
2.1. Les prises en compte à l’écrit de la structure géométrique de la figure<br />
La structure géométrique de la figure est l’ensemb<strong>le</strong> des relations qui lient <strong>le</strong>s différents<br />
éléments la composant. Cette structuration dépend donc du choix des éléments qui la<br />
composent et du type de relations perçues/transcrites. Les éléments qui composent la figure<br />
peuvent être des lignes (<strong>le</strong>s droites perpendiculaires, <strong>le</strong> cerc<strong>le</strong> <strong>le</strong> carré) ou des points et des<br />
lignes (<strong>le</strong> point d’intersection des droites, <strong>le</strong> cerc<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s sommets du carré etc.). De même<br />
<strong>le</strong>s relations entre ces éléments peuvent être « non mentionnées » – <strong>le</strong>s éléments dans ce<br />
cas seront dits indépendants – ou « topologiques », c’est-à-dire non constructib<strong>le</strong>s à la règ<strong>le</strong><br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
et au compas (à l’intérieur, autour etc.) ou encore « géométriques » c’est-à-dire dans <strong>le</strong><br />
contexte de cette tâche, constructib<strong>le</strong>s à la règ<strong>le</strong> et au compas, éventuel<strong>le</strong>ment à l’équerre :<br />
être <strong>le</strong> centre d’un cerc<strong>le</strong>, être perpendiculaires etc.<br />
Les résultats des traitements effectués sont <strong>le</strong>s suivants :<br />
Mentionné1 Instrumenté Indépendant Situé Déterminé<br />
Partiel<strong>le</strong>ment<br />
déterminé<br />
Cerc<strong>le</strong> 0 ( %) ( 0%) ( %) 0 ( %) ( %) 0 ( %)<br />
Carré ( %) ( %) ( %) ( %) ( %) 0 ( %)<br />
Droites ( %) ( %) 0 ( %) ( %) ( %) ( , %)<br />
Tab<strong>le</strong>au 1 : Prise en compte des lignes de la figure<br />
Les termes « indépendant », « situé », « déterminé », « partiel<strong>le</strong>ment déterminé » renvoient<br />
respectivement à des textes :<br />
– où la ligne apparaît sans qu’aucun lien soit fait avec <strong>le</strong>s autres lignes mentionnées :<br />
‘il y a un cerc<strong>le</strong>, un carré et deux droites’ ;<br />
– où la ligne mentionnée est située topologiquement par rapport à l’une des autres par<br />
une indication non contraignante pour la construction géométrique : <strong>le</strong> cerc<strong>le</strong> est autour<br />
du carré, <strong>le</strong> carré est dans <strong>le</strong> cerc<strong>le</strong>…<br />
–<br />
où la ligne mentionnée est entièrement déterminée par la construction des éléments<br />
précédents : Trace <strong>le</strong> cerc<strong>le</strong> dont <strong>le</strong> centre est <strong>le</strong> milieu du carré et qui passe par tous<br />
ses sommets par exemp<strong>le</strong>.<br />
Le fait de ne pas mentionner de liens entre <strong>le</strong>s trois éléments géométriques renvoie à une<br />
absence de point de vue géométrique dans <strong>le</strong> contexte de la tâche ou à une incapacité,<br />
dans la situation proposée à en rendre compte par écrit.<br />
Regardons classe par classe. Les différentes classes étudiées sont identifiées dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au<br />
par <strong>le</strong> niveau scolaire (CM ou CM ) puis par une abréviation : HB 0 pour Hélène Boucher<br />
00 , Mon pour « Montaigne », WA pour « Wasquehal classe A », WB pour « Wasquehal<br />
classe B ».<br />
Classe CM HB0 CM Mon CM WA CM WB CM HB0 CM HB0 CM WA CM WB Total<br />
Lignes<br />
Indé<br />
Pendantes<br />
Tab<strong>le</strong>au 2 : Nombre de productions décrivant trois lignes indépendantes<br />
Si ce n’est dans la classe de Mon, <strong>le</strong> nombre de tel<strong>le</strong>s productions est restreint : la très grande<br />
majorité des élèves tente de construire à l’écrit une description/construction qui prenne en<br />
compte <strong>le</strong>s relations entre <strong>le</strong>s trois éléments. Les différences ne sont pas statistiquement<br />
significatives, ce qui signifie pour nous qu’il n’est pas possib<strong>le</strong> de discriminer tel<strong>le</strong> ou tel<strong>le</strong><br />
éco<strong>le</strong> selon ce critère. Cependant, nous noterons, pour <strong>le</strong>s classes Freinet, un progrès, du<br />
niveau CM au niveau CM , que l’on ne constate pas dans <strong>le</strong>s classes WA et WB.<br />
Classe<br />
lignes<br />
CM HB0 CM Mon CM WA CM WB CM HB0 CM HB0 CM WA CM WB Total<br />
situées<br />
topologiquement<br />
0 0 0<br />
Tab<strong>le</strong>au 3 : Nombre de productions décrivant au moins deux des trois lignes situées<br />
topologiquement<br />
Nous dirons que <strong>le</strong> cerc<strong>le</strong> est mentionné dès que l’élève utilise <strong>le</strong> terme cerc<strong>le</strong> ou <strong>le</strong> terme rond, <strong>le</strong><br />
carré si <strong>le</strong>s termes carré ou losange <strong>le</strong> sont, <strong>le</strong>s droites si <strong>le</strong>s termes droites, diagona<strong>le</strong>s, croix <strong>le</strong> sont.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
A une exception près (l’une des deux CM ), nous constatons une harmonie complète des<br />
distributions selon <strong>le</strong>s niveaux et <strong>le</strong>s classes. Un tiers des élèves de CM ne parvient pas<br />
à mobiliser dans <strong>le</strong> contexte de cette tâche des relations géométriques constructib<strong>le</strong>s entre<br />
<strong>le</strong>s éléments de la figure, contre / e des élèves de CM . Il s’agit pour nous de compétences<br />
d’ordre géométriques qui sont donc comparab<strong>le</strong>s (puisque <strong>le</strong>s différences ne sont toujours<br />
pas significatives), avec cette fois une plus grande incertitude sur la constance des progrès<br />
réalisés à Freinet.<br />
Classe<br />
Déterminant<br />
CM HB0 CM Mon CM WA CM WB CM HB0 CM HB0 CM WA CM WB Total<br />
au moins<br />
ligne<br />
0<br />
Tab<strong>le</strong>au 4 : Nombre de productions déterminant au moins l’une des trois lignes<br />
Ce tab<strong>le</strong>au est pratiquement l’inverse du précédent. Si cette fois c’est à l’éco<strong>le</strong> Mon que l’on<br />
trouve <strong>le</strong> moins de productions prenant en compte la constructibilité ou la description d’une<br />
relation géométrique entre <strong>le</strong>s éléments de la figure, il n’en reste pas moins, que, encore<br />
une fois, <strong>le</strong>s élèves Freinet ne peuvent être distingués des autres, quant à la mobilisation<br />
de compétences d’écriture en géométrie. Nous enregistrons éga<strong>le</strong>ment un progrès (peu<br />
conséquent certes, mais effectif) du CM au CM .<br />
Au total, en ce qui concerne la gestion à l’écrit des relations géométriques entre <strong>le</strong>s éléments,<br />
gestion qui rappelons <strong>le</strong> n’est pas simp<strong>le</strong>, il apparaît que :<br />
– <strong>le</strong>s productions des élèves de Freinet présentent, à niveau scolaire équiva<strong>le</strong>nt, des<br />
caractéristiques comparab<strong>le</strong>s à cel<strong>le</strong>s des élèves des autres établissements ;<br />
– sur deux des critères considérés, el<strong>le</strong>s sont « supérieures » à cel<strong>le</strong>s des élèves de<br />
l’établissement voisin.<br />
–<br />
Les progressions sont aussi nettes, entre <strong>le</strong> CM1 et <strong>le</strong> CM2, voire davantage, que<br />
cel<strong>le</strong>s observées dans l’établissement éloigné.<br />
Mais, comme nous l’avons dit plus haut, l’analyse de la figure ne tient pas seu<strong>le</strong>ment à la<br />
prise en compte des « lignes » mais aussi à cel<strong>le</strong> des points. Étudier la figure en terme de<br />
configuration de points et de lignes représente la mobilisation d’une compétence importante :<br />
cette analyse suppose de prendre aussi en compte des éléments presque invisib<strong>le</strong>s et de<br />
<strong>le</strong>ur accorder la même importance qu’aux éléments très visib<strong>le</strong>s (<strong>le</strong>s lignes). Mais la simp<strong>le</strong><br />
mention de ces points (<strong>le</strong> centre du cerc<strong>le</strong> et <strong>le</strong>s sommets du carré) est insuffisante dès lors<br />
que ces points apparaissent comme structurant <strong>le</strong>s relations entre <strong>le</strong>s éléments de la figure :<br />
dans ce cas, <strong>le</strong>s points mentionnés vont devoir « changer de statut » : <strong>le</strong> point O de centre<br />
du cerc<strong>le</strong> devient <strong>le</strong> point d’intersection des deux droites, <strong>le</strong>s intersections du cerc<strong>le</strong> et des<br />
deux droites deviennent <strong>le</strong>s sommets du carré. Mais ces transformations, ces changements<br />
de statut ne sont que discursifs. Les points de la figure ne se transforment pas, mais<br />
uniquement <strong>le</strong> regard que l’on porte sur eux.<br />
Non<br />
mentionné<br />
Mentionné dont Apparaît Construits Naturalisé<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Apparaît(ssent)<br />
et change(nt) de<br />
statut<br />
O ( %) 0 ( %) dont ( %) 0 ( %) ( %)<br />
A, B, C, D 0 ( %) ( %) Dont ( %) ( %) ( %) ( %)<br />
Tab<strong>le</strong>au 5 : Prise en compte des points particuliers de la figure<br />
DUVAL R. ( 00 ), Les conditions cognitives de l’apprentissage de la géométrie : développement<br />
de la visualisation, différenciation des raisonnements et coordination de <strong>le</strong>ur fonctionnements, Anna<strong>le</strong>s de<br />
didactique et de sciences cognitives, Vol 0, p. – .
Les termes “apparaît”, « apparaissent et changent de statut » différencient <strong>le</strong>s productions<br />
des élèves selon que <strong>le</strong>s points concernés apparaissent une fois et une seu<strong>le</strong> (trace un<br />
cerc<strong>le</strong> de centre O, puis deux droites, puis un carré à l’intérieur du cerc<strong>le</strong> ») ou au contraire<br />
apparaissent au moins deux fois en changeant de rô<strong>le</strong> : ‘Trace un cerc<strong>le</strong> de centre O. Puis<br />
trace deux droites qui se croisent en O’.<br />
Quelques remarques sur ces décomptes :<br />
Une minorité d’élèves s’appuient sur <strong>le</strong>s points structurant la figure. Un indicateur discriminant<br />
se trouve être la mention par <strong>le</strong>s élèves des points – centre du carré, intersection des droites,<br />
centre du cerc<strong>le</strong> ou sommets du carré, intersections des droites et du cerc<strong>le</strong>, points repérés<br />
sur <strong>le</strong>s droites. Le fait que cet indicateur soit discriminant n’est pas pour nous surprendre.<br />
En effet, l’analyse d’une figure comp<strong>le</strong>xe peut s’effectuer à plusieurs niveaux : soit en terme<br />
de configuration de traits et de lignes, soit en terme de configuration de points. D’autres<br />
que nous ont mis en évidence <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong>s élèves de primaire acquièrent tardivement la<br />
compétence d’analyse d’une figure en terme de configuration de points.<br />
Faire apparaître à l’écrit un point (ou plusieurs) sous divers rô<strong>le</strong>s ou sous diverses appellations<br />
(centre du cerc<strong>le</strong> vs intersection des perpendiculaires) est la marque, selon nous, d’une<br />
distance réf<strong>le</strong>xive par rapport à la figure, instaurée par l’écriture : en effet, ces changements<br />
de statut nécessitent de rappe<strong>le</strong>r, au cours de l’écriture un point déjà mentionné. Pour <strong>le</strong> dire<br />
très vite, l’élève renonce à « montrer du doigt » sur la figure <strong>le</strong> point dont il par<strong>le</strong>, mais tente<br />
de <strong>le</strong> désigner au <strong>le</strong>cteur puis de <strong>le</strong> reconvoquer.<br />
Classe CM HB0 CM Mon CM WA CM WB CM HB0 CM HB0 CM WA CM WB Total<br />
Mention<br />
de O<br />
0 143 0<br />
Tab<strong>le</strong>au 6 : Nombre de productions mentionnant <strong>le</strong> point O<br />
Une seu<strong>le</strong> classe, statistiquement, se distingue des autres, cel<strong>le</strong> du CM WB, par la proportion<br />
importante d’élèves qui mentionnent <strong>le</strong> point O. Les élèves Freinet, particulièrement ceux de<br />
CM , soutiennent la confrontation avec succès.<br />
Classe CM HB0 CM Mon CM WA CM WB CM HB0 CM HB0 CM WA CM WB Total<br />
Mention de<br />
ABCD<br />
0 13<br />
Tab<strong>le</strong>au 7 : Nombre de productions mentionnant <strong>le</strong>s points ABCD<br />
Deux classes, statistiquement, se distinguent des autres ; la classe de CM WB encore une<br />
fois, par la proportion importante d’élèves qui mentionnent <strong>le</strong>s points et cel<strong>le</strong> de CM Mon<br />
cette fois par la proportion inverse. Si, tendanciel<strong>le</strong>ment, <strong>le</strong>s élèves de CM Freinet tardent<br />
un peu plus à prendre en compte <strong>le</strong>s points nommés, en revanche, <strong>le</strong>urs progrès sont à la<br />
hauteur de ceux réalisés dans <strong>le</strong>s autres CM .<br />
Classe CM HB0 CM Mon CM WA CM WB CM HB0 CM HB0 CM WA CM WB Total<br />
Mention de<br />
O<br />
0 0<br />
Changement<br />
de statut<br />
14<br />
Tab<strong>le</strong>au 8 : Nombre de productions mentionnant un changement de statut de O<br />
parmi cel<strong>le</strong>s où il est mentionné<br />
Si des élèves de CM peuvent encore mentionner <strong>le</strong> point O (généra<strong>le</strong>ment comme centre<br />
Les nombres apparaissant en gras dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au sont ceux sur <strong>le</strong>squels porte une différence<br />
significative.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
du cerc<strong>le</strong>) sans transcrire, à l’écrit, <strong>le</strong>s changements de rô<strong>le</strong> que présente ce point, cela<br />
s’estompe en CM . Cependant, nous observons des différences (légères) de retrait des<br />
élèves Freinet par rapport aux deux autres classes de CM .<br />
Regardons maintenant, de façon globa<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s nombres de productions dans <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s<br />
élèves font changer <strong>le</strong> statut de points<br />
Classe CM HB0 CM Mon CM WA CM WB CM HB0 CM HB0 CM WA CM WB Total<br />
Aucun<br />
changement<br />
17 4<br />
changement 11<br />
changements<br />
Total<br />
changements<br />
de statut<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0<br />
2 0 16<br />
Tab<strong>le</strong>au 9 : Nombre de productions mentionnant un ou deux changements de statut<br />
Pour <strong>le</strong>s élèves de CM Freinet, la confrontation est fructueuse. Cependant, pour <strong>le</strong> niveau<br />
CM , nous constatons que <strong>le</strong>s années ne sont pas équiva<strong>le</strong>ntes. Si <strong>le</strong> nombre d’élèves<br />
parvenant à mobiliser cette compétence dans <strong>le</strong> contexte de la tâche reste stab<strong>le</strong> et<br />
comparab<strong>le</strong> à celui du CM WA et inférieur à celui du CM WB, il semb<strong>le</strong> que pour l’année<br />
00 , <strong>le</strong> nombre de ceux qui n’y parviennent pas est plus important qu’ail<strong>le</strong>urs.<br />
En conséquence, nous avancerions l’hypothèse selon laquel<strong>le</strong> :<br />
– Ces compétences géométriques peuvent être décelées auprès des élèves de<br />
Freinet, dans un nombre global qui est comparab<strong>le</strong> ou légèrement inférieur à celui<br />
re<strong>le</strong>vé dans des classes dont la population est nettement différenciée et qui suivent un<br />
mode d’enseignement plus « traditionnel ».<br />
–<br />
Cependant, il semb<strong>le</strong> que <strong>le</strong> nombre d’élèves Freinet qui ne marquent pas cette<br />
compétence discursive et géométrique reste important.<br />
En résumé, cette analyse nous conduirait à examiner, dans la classe Freinet, comment <strong>le</strong>s<br />
élèves désignent, à l’écrit, une partie ou un objet du monde accessib<strong>le</strong>, visib<strong>le</strong> ; comment ils<br />
gèrent, dans <strong>le</strong>urs discours, dans <strong>le</strong>urs écrits, la re-convocation de ces parties, objets déjà<br />
désignés ; comment <strong>le</strong>s enseignants s’attardent ou ne s’attardent pas sur <strong>le</strong>s manières de<br />
faire possib<strong>le</strong>s.<br />
2.2. Les autres caractéristiques de l’écrit<br />
La première caractéristique prise en compte est cel<strong>le</strong> de la longueur des textes écrits.<br />
Classe CM HB0 CM Mon CM WA CM WB CM HB0 CM HB0 CM WA CM WB Total<br />
Longueur<br />
moyenne<br />
44,14 28,14 22,42 , , 46,48 , , 0 ,<br />
Tab<strong>le</strong>au 10 : Longueur moyenne (en nombre d’unités) des textes d’élèves<br />
Deux des trois classes de Freinet se distinguent significativement des autres par la longueur<br />
importante des textes produits. Comme Yves Reuter <strong>le</strong> signa<strong>le</strong> dans l’analyse des textes<br />
écrits par <strong>le</strong>s élèves dans <strong>le</strong> cadre de la classe de français, nous observons aussi une<br />
très nette tendance à écrire longuement. Cette caractéristique est ici à interpréter comme<br />
une écriture « aidante » ou encore coopérative : <strong>le</strong>s élèves de Freinet indiquent au <strong>le</strong>cteur<br />
qu’ils construisent plutôt comme un pair (voir ci-dessous) <strong>le</strong>s instruments à prendre,<br />
l’accompagnent de conseils (tiens bien ta pointe) etc. Toujours dans <strong>le</strong> contexte de la tâche
demandée, il y a donc une moins importante prise en compte de l’économie du texte, ce qui<br />
est en revanche <strong>le</strong> cas par exemp<strong>le</strong> du CM WB.<br />
Nous retiendrons par conséquent comme piste d’étude des conduites langagières dans la<br />
classe la longueur des interventions ora<strong>le</strong>s des élèves, <strong>le</strong> <strong>le</strong>cteur privilégié de <strong>le</strong>urs textes,<br />
l’auditeur privilégié de <strong>le</strong>urs discours.<br />
Au-delà de la longueur des textes, la conduite même du discours est à interroger. La<br />
tâche demandée requiert une programmation des actions préconisées et une planification<br />
du discours en conséquence. Nous avons retenu des indicateurs liés à ces opérations,<br />
tels la présence de « clôture » (« et voilà ta figure est terminée »), tels des marquages de<br />
planification (la numérotation des actions à mener) et des indicateurs qui sont pour nous<br />
des indices de dysfonctionnement de ces opérations, comme peuvent l’être des ajouts du<br />
type « j’avais oublié de dire » ou des contraintes qui surviennent tardivement, après que <strong>le</strong>s<br />
actions aient été décrites.<br />
Nous avons éga<strong>le</strong>ment retenu <strong>le</strong>s marques de planification : en effet la tâche proposée<br />
peut être interprétée comme cel<strong>le</strong> de l’écriture d’une suite d’actions visant à reconstruire<br />
la figure. Certains élèves recourent à une écriture sous forme de liste ordonnée d’actions.<br />
D’autres marquent cette temporalité par des adverbes (maintenant, ensuite etc.). D’autres<br />
enfin clôturent <strong>le</strong>ur texte par une indication du type « et voilà, ta figure est terminée » ou<br />
simp<strong>le</strong>ment par <strong>le</strong> mot « fin ». Certains dysfonctionnements peuvent provenir d’opérations<br />
de planification. Ainsi, des élèves font référence dans <strong>le</strong>urs textes à des éléments qu’ils<br />
n’ont pas encore présentés, d’autres ajoutent des contraintes « qu’ils avaient oubliées ».<br />
Classe CM HB0 CM Mon CM WA CM WB CM HB0 CM HB0 CM WA CM WB Total<br />
Actions<br />
uniquement<br />
Planification 18 12 0<br />
Clôture 0<br />
Tab<strong>le</strong>au 11 : Nombre de productions où l’on relève la présence de listes d’actions, de marques de<br />
planification, de clôture<br />
Il y a très peu de différences en ce qui concerne la répartition des textes composés uniquement<br />
de listes d’action ainsi qu’en ce qui concerne <strong>le</strong>s marques de clôture. Curieusement, <strong>le</strong>s<br />
marques de planification, dans <strong>le</strong>s établissements autres que Freinet, s’estompent ou<br />
disparaissent au CM , tandis qu’el<strong>le</strong>s se renforcent légèrement à Freinet.<br />
Une autre caractéristique des textes produits est cel<strong>le</strong> de l’usage inadéquat des artic<strong>le</strong>s<br />
définis – « <strong>le</strong>, <strong>le</strong>s… » - et indéfini – « un, des… ». En effet <strong>le</strong>s éléments présentés peuvent<br />
être non déterminés par ce qui précède ou au contraire entièrement déterminés. Par exemp<strong>le</strong>,<br />
si l’élève a dit comment construire <strong>le</strong>s quatre points ABCD sur deux droites perpendiculaires<br />
d’intersection O, <strong>le</strong> cerc<strong>le</strong> dont il va par<strong>le</strong>r ensuite (de centre O et passant par <strong>le</strong>s quatre<br />
points) est entièrement déterminé. Or ces déterminations ne sont pas d’ordre linguistique :<br />
ce n’est pas parce que l’élément a déjà été cité dans <strong>le</strong> texte qu’il est déterminé désormais<br />
mais parce que <strong>le</strong>s contraintes géométriques <strong>le</strong> définissent de façon unique. Cette tension<br />
entre deux ordres de détermination explique sans doute <strong>le</strong> nombre de dysfonctionnements<br />
dans l’usage des artic<strong>le</strong>s.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Classe<br />
Productions<br />
CM HB0 CM WA CM WB CM HB0 CM HB0 CM WA CM WB Total<br />
présentant ce<br />
type d’erreurs<br />
Productions<br />
où deux au<br />
moins des<br />
éléments sont<br />
situés<br />
0 0<br />
Tab<strong>le</strong>au 12 : Nombre de productions où l’on relève des erreurs <strong>le</strong>/un<br />
Nous ramenons ce nombre à celui des productions où il peut s’avérer nécessaire de par<strong>le</strong>r<br />
de nouveau, de reconvoquer un élément déjà mentionné. Ceci ne concerne par conséquent<br />
que <strong>le</strong>s productions qui ne sont pas des descriptions de trois lignes indépendantes. Il apparaît<br />
que la proportion de ce type d’erreur (dont l’analyse mériterait d’être poussée) est la même<br />
dans <strong>le</strong>s deux établissements .<br />
Un autre indicateur de la manière dont <strong>le</strong>s élèves expriment <strong>le</strong>s nécessités qui pèsent sur<br />
la construction de la figure est l’usage de termes qui indiquent <strong>le</strong>ur prise en compte dans<br />
<strong>le</strong> discours : « il faut », « on doit »…(‘il faut que <strong>le</strong> cerc<strong>le</strong> passe bien par <strong>le</strong>s points’ par<br />
exemp<strong>le</strong>).<br />
Classe<br />
Moyenne<br />
CM HB0 CM Mon CM WA CM WB CM HB0 CM HB0 CM WA CM WB Total<br />
de<br />
l’emploi<br />
1,19 0, 0,11 0,14 0, 0, 0, 0,00 0, 0<br />
Tab<strong>le</strong>au 13 : Moyenne de l’usage de « il faut », « on doit »<br />
Les usages de ces termes ou équiva<strong>le</strong>nts sont relativement différenciés. Il semb<strong>le</strong> bien que<br />
c’est à l’éco<strong>le</strong> Freinet qu’ils soient <strong>le</strong>s plus généralisés, quel que soit <strong>le</strong> niveau scolaire. Ainsi,<br />
nous avancerons l’hypothèse selon laquel<strong>le</strong> la nécessité (pragmatique, ou géométrique) est<br />
ressentie par <strong>le</strong>s élèves et transcrite dans <strong>le</strong> discours. Il n’y a pas toujours identification de<br />
la solution mais en revanche <strong>le</strong>s élèves de Freinet, plus qu’ail<strong>le</strong>urs expriment à l’écrit <strong>le</strong>s<br />
contrô<strong>le</strong>s qui sont à <strong>le</strong>ur charge ou à cel<strong>le</strong> du <strong>le</strong>cteur. Il y a identification des contraintes de<br />
la situation, peut être pourrions nous al<strong>le</strong>r jusqu’à dire du problème qui est posé à l’élève, en<br />
cours de réalisation de la tâche. Nous serons en conséquent attentifs, dans <strong>le</strong>s observations<br />
et <strong>le</strong>s analyses des pratiques de classe à la manière dont <strong>le</strong> problème initial se transforme<br />
en cours d’étude. Y a-t-il identification, par <strong>le</strong>s élèves de Freinet, dans <strong>le</strong>s classes de<br />
mathématiques, de « nouvel<strong>le</strong>s questions » ou de transformations de questions initia<strong>le</strong>s ?<br />
Et si oui, comment <strong>le</strong> maître gère-t-il ces transformations, ces apparitions ?<br />
Différencier <strong>le</strong>s productions de ces élèves peut éga<strong>le</strong>ment s’appuyer sur la position du<br />
scripteur vis-à-vis du <strong>le</strong>cteur. Certains ont une position « aidante » ou « coopérative » en<br />
fournissant des aides instrumenta<strong>le</strong>s, ou des conseils (« tiens bien ta pointe… »). D’autres<br />
reconstruisent un autre <strong>le</strong>cteur (sans doute l’enseignant) en se montrant en train de faire<br />
(« je prends mon compas … ». Des indicateurs, tels la présence de conseils ou d’aides, tels<br />
<strong>le</strong> mode utilisé (impératif ou autre) tels enfin <strong>le</strong> sujet adopté (écriture en « je » ou non…)<br />
sont ainsi intéressants à mettre en œuvre.<br />
L’étude, faute de temps, n’a pas été menée sur <strong>le</strong>s productions des élèves du CM Mon.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Classe CM HB0 CM Mon CM WA CM WB CM HB0 CM HB0 CM WA CM WB Total<br />
« je » 0 7 12 0 0<br />
« tu, vous » 3 0 18<br />
« on »<br />
Tab<strong>le</strong>au 14 : Nombre de productions où l’on relève la présence de « je », « tu, vous » « on »<br />
Les élèves de Freinet n’écrivent pratiquement pas en « je ». Cela nous semb<strong>le</strong> indiquer<br />
qu’ils ne reconstruisent, et ce dès <strong>le</strong> CM à la différence des autres établissements, une<br />
position d’évaluation. Le <strong>le</strong>cteur construit n’est pas l’enseignant évaluateur mais un <strong>le</strong>cteur<br />
qui est tantôt <strong>le</strong>ur pair tantôt un <strong>le</strong>cteur générique.<br />
Classe CM HB0 CM Mon CM WA CM WB CM HB0 CM HB0 CM WA CM WB Total<br />
Impératif , 0,05 , , 0,65 , , 3,05 ,<br />
Infinitif 0, 0,10 0, 0, 0, , 0, 0, 0,<br />
Indicatif 0, 0,95 0,47 0, 0, 0, 0, 0, 0,<br />
Tab<strong>le</strong>au 15 : Moyenne des apparitions des modes<br />
Ce tab<strong>le</strong>au ne fait que confirmer <strong>le</strong> précédent, pour certains des résultats (<strong>le</strong>s élèves du<br />
CM WB donnent des ordres ou des conseils à un pair/ <strong>le</strong>s élèves de Montaigne ne <strong>le</strong> font<br />
pratiquement pas…). Quant aux élèves Freinet, il semb<strong>le</strong> que ceux-ci adoptent des positions<br />
diversifiées : soit en s’adressant à des pairs, soit en adoptant un ton plus « neutre », proche<br />
de celui de la recette ou du plan de construction.<br />
A l’heure actuel<strong>le</strong>, ces deux façons de faire fonctionner <strong>le</strong>s indicateurs nous montrent,<br />
très globa<strong>le</strong>ment, qu’il y a très peu de particularités des productions « Freinet » vis-à-vis<br />
des productions des élèves des classes non Freinet de l’échantillon retenu. Cela signifie<br />
par conséquent, que sur une tâche non habituel<strong>le</strong>, assez comp<strong>le</strong>xe, ils soutiennent la<br />
comparaison avec des élèves de milieux différenciés, re<strong>le</strong>vant d’un mode d’enseignement<br />
disciplinaire différent.<br />
Si nous essayons en revanche de souligner <strong>le</strong>urs caractéristiques :<br />
– Un nombre non négligeab<strong>le</strong> d’élèves de cet établissement continue à rencontrer des<br />
difficultés à déférer à l’écrit la mission de rendre compte de statuts différents d’éléments<br />
structurant de la figure considérée, ainsi qu’à gérer correctement <strong>le</strong>s convocations au fil<br />
du texte d’éléments déjà présentés ;<br />
– Ils produisent des textes en moyenne plus longs que ceux des autres classes parce<br />
qu’ils adoptent une position très coopérative à l’égard du <strong>le</strong>cteur reconstruit ;<br />
– Ils marquent beaucoup plus que tous <strong>le</strong>s autres la nécessité des constructions (il<br />
faut, on doit), mais de façon linguistique ;<br />
– Ils construisent un <strong>le</strong>cteur qui est <strong>le</strong>ur pair, plutôt que l’enseignant ;<br />
– Aucun d’entre eux ne s’inscrit dans un contexte d’évaluation par <strong>le</strong> maître (une<br />
des classes de l’échantillon en revanche adopte de façon très caractéristique cette<br />
position).<br />
Ces caractéristiques nous permettent d’élaborer des hypothèses concernant <strong>le</strong>s<br />
caractéristiques de la mise en œuvre du dispositif pédagogique particulier, des pratiques<br />
dans la classe de mathématiques.<br />
–<br />
Les élèves ont, plus que d’autres, la possibilité de produire des textes longs, de<br />
Ces caractéristiques ont été étudiées plus haut, el<strong>le</strong>s sont éga<strong>le</strong>ment mises en évidence par <strong>le</strong><br />
biais d’une autre méthode d’analyse des données, l’Analyse Statistique Implicative, dans l’artic<strong>le</strong> (à paraître)<br />
Didactic of mathematics ans Statistic Implicative Analysis, qui figure dans <strong>le</strong> <strong>tome</strong> II du présent rapport.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
produire des discours écrits longs ;<br />
– Les élèves ont la possibilité de s’adresser aux autres et non pas seu<strong>le</strong>ment à<br />
l’enseignant ;<br />
– Les élèves peuvent avoir des postures coopératives à l’égard des autres élèves ;<br />
– L’émergence de nouvel<strong>le</strong>s questions, <strong>le</strong>s transformations de la question initia<strong>le</strong> font<br />
l’objet d’attentions particulières ;<br />
–<br />
L’évaluation n’est pas <strong>le</strong> but ultime des productions.<br />
Nous nous sommes données par conséquent pour tâche d’essayer de valider ou d’invalider<br />
ces hypothèses selon <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s il y aurait des différences selon ces critères dans <strong>le</strong>s classes<br />
de mathématiques Freinet et dans d’autres classes ne re<strong>le</strong>vant pas des mêmes dispositifs<br />
pédagogiques.<br />
3. Modes d’étude et pratiques langagières dans la classe<br />
0<br />
3.1. Les objets d’étude et <strong>le</strong>s modes d’études dans <strong>le</strong>s temps plutôt<br />
individuels<br />
La première caractéristique à souligner est la diversité des objets d’étude construits, dans<br />
un même temps, dans <strong>le</strong>s classes de mathématiques à l’éco<strong>le</strong> « Freinet » (avec sans doute<br />
une restriction sur cette diversité à l’éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong>, où il semb<strong>le</strong> que <strong>le</strong>s élèves soient<br />
davantage confrontés, en même temps, à un même objet). Cette diversité est manifeste<br />
lorsque l’on prend en compte <strong>le</strong>s situations que l’élève dit étudier : « comment construire<br />
<strong>le</strong> symétrique d’un triang<strong>le</strong> précisément », « peut-on construire des figures de périmètres<br />
‘très grand’ », « l’invention d’un code secret » etc.. El<strong>le</strong> peut même apparaître déroutante,<br />
tant certains d’entre eux sont éloignés des objets d’étude disciplinaires inscrits dans <strong>le</strong>s<br />
programmes officiels et de <strong>le</strong>ur mode d’étude.<br />
Cependant, <strong>le</strong>s maîtres ne reconnaissent pas toujours cette diversité. En effet, ils disent<br />
discerner d’autres objets d’étude possib<strong>le</strong>s que ceux que <strong>le</strong>s élèves déclarent a priori. Leur<br />
travail consiste par conséquent à faire émerger cet objet d’étude rendu accessib<strong>le</strong> à la fois<br />
par la question que l’élève se donne et <strong>le</strong>s interventions de l’enseignant et cel<strong>le</strong>s des autres<br />
élèves. En conséquence, nous avancerons que <strong>le</strong>s objets d’étude présents dans <strong>le</strong>s classes<br />
de mathématiques de Freinet sont des objets qui se construisent dans cette tension entre<br />
plusieurs « désirs », entre plusieurs positions, cel<strong>le</strong> de l’élève et cel<strong>le</strong>s du maître et cel<strong>le</strong>s<br />
des autres élèves.<br />
Est-ce que la position du maître est entièrement définie et identifiée comme position de celui<br />
qui sait (avant <strong>le</strong>s autres) qui sait différemment (des autres) ? Nous répondrons que cela<br />
ne semb<strong>le</strong> pas toujours être <strong>le</strong> cas, mais nous avons surtout des exemp<strong>le</strong>s des moments<br />
col<strong>le</strong>ctifs et non pas des moments individuels (maître et élève en tête à tête). Nous prendrons<br />
pour exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong>s séquences en CE au cours desquel<strong>le</strong>s un objet d’étude apparaît : la<br />
règ<strong>le</strong> d’ajout de zéros dans une multiplication par 0, 00… Durant ces séquences, l’étude<br />
et sa progression est entièrement assurée / dévolue à trois élèves. Le maître ne manifeste<br />
à aucun moment <strong>le</strong> fait qu’il sait (la place que peut représenter cette étude dans <strong>le</strong> cursus,<br />
que d’autres ont déjà étudié ce moyen de faire des opérations à moindre frais etc.).<br />
Comment intervient <strong>le</strong> maître pour faire émerger <strong>le</strong>s objets d’étude qu’il « souhaite » voir<br />
apparaître ? Il nous semb<strong>le</strong> que ce sont surtout par des planifications du travail de l’élève :<br />
« je te propose de recommencer », « tu vas en faire des centaines », « non, tu n’as pas<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
fini » qui consistent essentiel<strong>le</strong>ment en des demandes d’ajouts, de reprises, d’expansions<br />
du travail et non pas, comme cela peut apparaître dans d’autres classes, par des travaux<br />
distincts. La continuité est la marque de l’éco<strong>le</strong> Freinet. Cette continuité dans <strong>le</strong> travail<br />
entrepris, la durée de la « recherche entreprise » parfois sur plusieurs semaines est un point<br />
essentiel de ce dispositif pédagogique. En effet, s’inscrire dans la durée permet à l’élève<br />
de tisser des liens entre <strong>le</strong>s différents moments d’activité dans la classe de mathématiques,<br />
c’est-à-dire de développer une certaine clarté cognitive, en empruntant ce concept à Michel<br />
Brossard . Même si <strong>le</strong>s questions du maître, ses exigences, si <strong>le</strong>s remarques des autres<br />
élèves remodè<strong>le</strong>nt l’étude de l’élève, il n’en reste pas moins que l’activité de l’élève n’est<br />
pas une suite de tâches sur <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s il n’exerce aucun contrô<strong>le</strong>, et dont il a la charge de<br />
reconstruire <strong>le</strong>s liens.<br />
Ces demandes ou exigences planificatrices ne sont pas <strong>le</strong>s seuls moyens dont <strong>le</strong> maître<br />
use. Les conseils, aides apportées… dans une gestion plus immédiate du travail de<br />
l’élève contribuent éga<strong>le</strong>ment à l’émergence des questions : « tu vas commencer par une<br />
feuil<strong>le</strong> de papier quadrillé », « tu vas te mettre devant <strong>le</strong> ca<strong>le</strong>ndrier »etc.<br />
Légitimités des objets d’études et des travaux des élèves<br />
Caractérisés par <strong>le</strong>ur construction « en regard » par l’enseignant et l’élève dans ces moments<br />
individuels, par <strong>le</strong>ur diversité, par <strong>le</strong>ur éloignement parfois des études programmées par<br />
l’Institution, <strong>le</strong>s objets d’étude à Freinet sont spécifiés aussi par <strong>le</strong>s légitimités qu’ils reçoivent.<br />
L’étude commence invariab<strong>le</strong>ment (en primaire) par de l’écrit (je considère ici que des tracés<br />
sont de l’écrit) individuel. Cette production d’écrit est immédiatement considérée comme un<br />
travail (<strong>le</strong>s désignations sont explicites « c’est un joli travail », <strong>le</strong>s rappels à l’ordre aussi),<br />
volontaire, signifiant, intéressant pour l’élève et la col<strong>le</strong>ctivité.<br />
Par exemp<strong>le</strong>, <strong>le</strong> maître expose l’écrit d’une élève absente et dit que « même si el<strong>le</strong> n’est pas<br />
là, on va essayer de comprendre ce qu’el<strong>le</strong> a voulu faire ». C’est en effet <strong>le</strong> travail initial de<br />
l’élève (à l’écrit) qui légitime l’étude entreprise. On peut faire la distinction avec ce qui se<br />
passe dans d’autres éco<strong>le</strong>s, où ce qui légitime l’étude est <strong>le</strong> sens à accorder à l’exécution<br />
tâche délivrée par <strong>le</strong> biais d’un énoncé produit par <strong>le</strong> maître. L’intérêt que revêt <strong>le</strong> travail<br />
entrepris, la légitimité de l’étude est attestée éga<strong>le</strong>ment par <strong>le</strong> maître : c’est lui qui dit – en<br />
‘privé’ – « ça c’est intéressant », « je passerai bien ma matinée à ça, veinard », mais aussi<br />
par <strong>le</strong>s élèves, cette fois en public : « c’est bien ce que tu as essayé » etc.<br />
La signification de l’étude portée par un élève en particulier est aussi attestée à l’oral par<br />
<strong>le</strong> maître, qui insiste plus qu’ail<strong>le</strong>urs sur <strong>le</strong> partage du sens, à la fois en privé : « tu iras voir<br />
Hassan », et en public : « on reprend l’idée de… ». Enfin, ce sens et cette légitimité sont<br />
accrédités par la publication des recherches mathématiques sous forme de recueils diffusés<br />
auprès des parents d’élèves.<br />
Les situations de légitimité du travail individuel mené, de l’étude poursuivie par l’élève, <strong>le</strong>s<br />
moyens utilisés pour attester du sens accordé à ceux-ci sont par conséquent diversifiés.<br />
Selon ces situations et ces moyens (essai de compréhension a priori, intérêt marqué par<br />
l’enseignant, par <strong>le</strong>s élèves, identification de l’élève et de sa recherche, identification de<br />
l’expertise d’un élève sur une question, personnalisation des idées et des questions, diffusion<br />
des textes dans la sphère familia<strong>le</strong>) <strong>le</strong>s ordres et <strong>le</strong>s sources de la légitimité sont diversifiés<br />
éga<strong>le</strong>ment : <strong>le</strong> premier ordre de légitimité est celui du travail écrit, <strong>le</strong> second celui de la<br />
communauté des pairs, <strong>le</strong> troisième celui de l’enseignant, <strong>le</strong> quatrième celui des savoirs et<br />
BROSSARD M. ( ), Activités métalinguistiques et situations scolaires, Revue repères, Numéro ,<br />
INRP, Paris.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
des savoir faire de référence, <strong>le</strong> cinquième celui de lisibilité du travail scolaire dans l’espace<br />
familial, de la reconnaissance extérieure de ce travail.<br />
On peut comprendre dès lors que l’évaluation (sous une forme de note ou d’appréciation)<br />
n’est pas <strong>le</strong> but ou la seu<strong>le</strong> source de légitimité de la production de l’élève. On voit éga<strong>le</strong>ment<br />
que des postures de coopération entre élèves peuvent se développer, que des échanges<br />
entre élèves (et non pas seu<strong>le</strong>ment entre élèves et enseignant) sont encouragés, puisque<br />
<strong>le</strong>s écrits ou <strong>le</strong>s paro<strong>le</strong>s d’un élève peuvent devenir des références pour <strong>le</strong>s autres.<br />
Les productions écrites individuel<strong>le</strong>s de recherche des élèves.<br />
Ces écrits sont signifiants pour l’élève : à Freinet, <strong>le</strong>s écrits sont signés (même à l’éco<strong>le</strong><br />
maternel<strong>le</strong> « on va mettre ton prénom pour voir qu’il est à toi ») ce sont des écrits d’auteur<br />
et non d’exécutant. Si nous reprenons cette distinction comme Goody la construit, cela<br />
permet d’interroger <strong>le</strong>s formes standardisées que revêtent ces écrits scolaires. Si nous<br />
analysons <strong>le</strong>s prescriptions ora<strong>le</strong>s de l’enseignant, nous constatons qu’à Freinet, c’est la<br />
planification ou l’organisation contrainte de l’activité, du travail qui formate avant tout <strong>le</strong>s<br />
écrits produits : « il faut mettre un titre, se donner un défi », « sur <strong>le</strong>s feuil<strong>le</strong>s on marque ce<br />
que l’on a appris » « il faut s’organiser sur son cahier ». Au contraire, dans d’autres classes,<br />
c’est davantage <strong>le</strong> respect de l’orthographe, la forme du résultat « la phrase pour indiquer <strong>le</strong><br />
résultat » qui formate <strong>le</strong>s écrits produits individuel<strong>le</strong>ment par <strong>le</strong>s élèves.<br />
Ajoutons que ces écrits ne sont pas uniformes pour l’ensemb<strong>le</strong> des élèves, ce qui signifie<br />
tout simp<strong>le</strong>ment que <strong>le</strong>s cahiers d’élèves à Freinet ne sont pas identiques, qu’ils sont des<br />
écrits retravaillés sans cesse, produits sur des supports différents des autres classes (des<br />
feuil<strong>le</strong>s de papier vierge et non pas des cahiers réglés), qu’ils peuvent être déchirés, jetés<br />
à la poubel<strong>le</strong> s’ils sont insatisfaisants… Cette caractéristique du dispositif pédagogique est<br />
importante, et rejoint cel<strong>le</strong> que nous avons soulignée plus haut, de la continuité du travail<br />
de l’élève. Les possibilités de réécriture, d’essais successifs contribuent selon nous à la<br />
responsabilisation de l’élève et à une construction du statut de l’erreur qui nous était déjà<br />
apparue comme très différenciée dans cette éco<strong>le</strong>.<br />
Enfin, et c’est peut être un des points <strong>le</strong>s plus importants, ces écrits ne sont pas notés.<br />
Certes ils sont évalués au sens de validés ou rejetés, mais la différence reste essentiel<strong>le</strong>.<br />
L’écrit de l’élève reste « intact » ou plutôt n’est modifié ou déchiré que par l’élève lui-même.<br />
Nous ne remarquons pas, comme cela est <strong>le</strong> cas ail<strong>le</strong>urs, de productions barrées au crayon<br />
rouge, ou annotées. Cette particularité contribue éga<strong>le</strong>ment au statut de l’erreur, au sens<br />
que ces écrits prennent dans <strong>le</strong> travail de l’élève.<br />
Le travail « individuel » de l’élève est en conséquence un travail continu, signifiant. Les<br />
productions écrites sont personnalisées, reprises, légitimées.<br />
Cependant, une interrogation demeure au regard de la diversité (apparente) des études<br />
menées : comment se fait-il que <strong>le</strong>s élèves que nous avons interrogé dans cet établissement,<br />
sur des thèmes scolaires mathématiques divers, fassent preuve de savoirs et de savoir faire<br />
comparab<strong>le</strong>s de façon très honorab<strong>le</strong> à ceux de <strong>le</strong>urs condiscip<strong>le</strong>s d’autres établissements ?<br />
En effet, si l’on peut supposer qu’un élève qui a travaillé longuement sur <strong>le</strong> thème de la symétrie<br />
orthogona<strong>le</strong> par exemp<strong>le</strong>, construit des connaissances sur cet objet, on peut s’étonner qu’il<br />
en manifeste à propos d’un autre objet. Comment est assurée dans ce dispositif particulier<br />
la rencontre avec d’autres thèmes d’études, comment des savoirs communs (et des savoir<br />
faire) peuvent-ils se constituer ? La diffusion et l’élaboration de tels savoirs, savoir faire<br />
GOODY J. ( ), La raison graphique, Éditions de Minuit, Paris.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
est très largement dévolue aux situations col<strong>le</strong>ctives de travail, que nous allons explorer à<br />
présent.<br />
Références de ces objets d’études, institutionnel<strong>le</strong>s, mathématiques, loca<strong>le</strong>s, règ<strong>le</strong>s des<br />
contrats didactiques.<br />
Pour chacune de ces séquences, nous allons essayer de décrire quel<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong>s références<br />
qui peuvent légitimer ces études, dans <strong>le</strong> monde scolaire et dans <strong>le</strong> monde mathématique.<br />
Il s’agit donc de voir comment <strong>le</strong>s prescriptions de l’institution peuvent être satisfaites, si<br />
savoirs mathématiques peuvent être des références à ces objets d’étude scolaires. Nous<br />
allons éga<strong>le</strong>ment tenter de comprendre comment ces objets d’étude col<strong>le</strong>ctifs peuvent<br />
s’insérer, pratiquement, dans <strong>le</strong> temps didactique de la classe particulière observée. Il<br />
est en effet important de voir si, dans <strong>le</strong>s classes Freinet, <strong>le</strong>s prescriptions disciplinaires,<br />
<strong>le</strong>s références scolaires sont satisfaites. Dans un deuxième temps, nous essayons, pour<br />
chacune des séquences analysées d’identifier <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s du contrat didactique – c’est-à-dire<br />
<strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s liées à la spécificité de l’objet d’étude – que l’enseignant cherche à instaurer au<br />
cours de ces situations.<br />
3.2. Les objets d’étude et <strong>le</strong>s modes d’étude col<strong>le</strong>ctifs<br />
Les caractéristiques des manières de faire que nous venons d’évoquer étaient plutôt<br />
attachées aux interactions ‘privées’ entre <strong>le</strong> maître et l’élève. Nous essayons maintenant de<br />
caractériser <strong>le</strong>s modes d’étude lors des moments col<strong>le</strong>ctifs, afin de comprendre comment<br />
ces dispositifs pédagogiques permettent l’identification de savoirs, savoir faire communs,<br />
comment des études col<strong>le</strong>ctives peuvent être menées. En effet, il est prévu (et il arrive<br />
régulièrement) des séquences dans la classe de mathématiques où tous travail<strong>le</strong>nt <strong>le</strong><br />
même objet. Ces séquences débutent en règ<strong>le</strong> généra<strong>le</strong> par l’exposé d’un élève qui vient<br />
rendre compte de l’avancée de sa recherche. Selon <strong>le</strong>s cas, <strong>le</strong>s autres élèves et <strong>le</strong> maître<br />
interviennent, font des remarques, posent des questions. Durant un temps qui peut être très<br />
variab<strong>le</strong>, l’élève qui expose a un statut différent des autres, et a une position par rapport<br />
à l’objet d’étude différente. Cependant, cette position, ce statut peut aussi être changé,<br />
lorsque par exemp<strong>le</strong> une question problématique apparaît et lorsque <strong>le</strong> maître décide que <strong>le</strong><br />
travail est désormais col<strong>le</strong>ctif « ce n’est plus ta recherche maintenant ».<br />
Nous avons analysé séquences en détail, à Freinet à Provinces, en CE , en CM ,<br />
à quelques semaines d’interval<strong>le</strong>. Le découpage en séquences est effectué selon <strong>le</strong> thème<br />
de travail et l’organisation du travail col<strong>le</strong>ctif. Décrivons <strong>le</strong>s rapidement :<br />
« La règ<strong>le</strong> des zéros », Freinet CE : <strong>le</strong> thème de l’étude est celui de la règ<strong>le</strong> des zéros<br />
(qui consiste à trouver <strong>le</strong> résultat d’un produit d’un entier par 0, 00, 000… en ajoutant à<br />
l’écriture du premier nombre , , … zéros). Cette séquence de classe est organisée autour<br />
de l’exposé par un élève de sa « recherche mathématique » et <strong>le</strong>s questions, demandes du<br />
maître et des autres élèves.<br />
« La recherche de Yasmina I <strong>le</strong>s équiva<strong>le</strong>nces », Freinet CE : <strong>le</strong> thème de l’étude est celui<br />
des équiva<strong>le</strong>nces entre objets : un pull pour trois chaussettes etc. Yasmina est absente,<br />
c’est donc une séance immédiatement col<strong>le</strong>ctive de travail qui s’instaure.<br />
« La recherche de Yasmina II : <strong>le</strong>s calculs », Freinet CE : <strong>le</strong> thème de l’étude est celui de<br />
l’écriture de certaines sommes en tenant compte des équiva<strong>le</strong>nces entre objets : combien<br />
de chaussettes représente la somme d’un pull et d’une jupe ? Il s’agit, comme la précédente,<br />
d’un travail col<strong>le</strong>ctif.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
« Calcul avec <strong>le</strong>s jours », Freinet, CM : <strong>le</strong> thème de l’étude est celui des calculs (produit,<br />
somme, différence) rendus possib<strong>le</strong>s par la correspondance entre un jour de la semaine et<br />
<strong>le</strong>s représentants numériques de son ordre d’apparition dans la suite lundi, mardi etc.<br />
« Correction d’additions », Provinces, CE : <strong>le</strong> thème de l’étude est celui des techniques<br />
opératoires de l’addition sur des nombres entiers à trois chiffres. La séquence se dérou<strong>le</strong> de<br />
la façon suivante : un élève va au tab<strong>le</strong>au et écrit son résultat.<br />
« Calcul mental », Provinces, CE : <strong>le</strong> thème de l’étude est celui des tab<strong>le</strong>s de multiplication<br />
ainsi que celui des la règ<strong>le</strong> des zéros (produit de 0 par par exemp<strong>le</strong>) limitée aux dizaines.<br />
La séquence se dérou<strong>le</strong> sous la forme de questions et de réponses individuel<strong>le</strong>s ‘en <strong>le</strong>vant<br />
l’ardoise’.<br />
« Travail sur la <strong>le</strong>cture d’énoncé », Provinces, CE : <strong>le</strong> thème de l’étude est celui de la<br />
<strong>le</strong>cture d’un énoncé de problème additif avec recherche des informations nécessaires. La<br />
séquence est cel<strong>le</strong> d’un travail col<strong>le</strong>ctif, piloté par <strong>le</strong> maître.<br />
3.2.1. La règ<strong>le</strong> des zéros<br />
La règ<strong>le</strong> des zéros est un contenu scolaire explicitement désigné dans <strong>le</strong>s programmes de<br />
mathématiques de CE . Méthode de calcul, el<strong>le</strong> représente une économie de temps et se<br />
base sur la numération décima<strong>le</strong>. L’étude qu’expose l’élève a pour origine une remarque<br />
(lorsque l’on effectue une liste d’opérations x 00, x 00 etc. on s’aperçoit que l’écriture du<br />
produit peut s’anticiper par cet ajout de deux zéros au premier facteur). Cette méthode n’est<br />
pas, durant la séquence, validée ou fondée, mais admise. Le travail col<strong>le</strong>ctif a pour objectif<br />
d’expliquer et de faire fonctionner cette règ<strong>le</strong> sur des exemp<strong>le</strong>s « péril<strong>le</strong>ux » (nombres à<br />
plusieurs chiffres). Du point de vue de l’élève qui présente cette recherche, el<strong>le</strong> s’inscrit dans<br />
une perspective plus large : Anthony travail<strong>le</strong> régulièrement sur <strong>le</strong>s multiplications, avec un<br />
attrait particulier pour <strong>le</strong>s « grandes et longues » opérations. Cet attrait ne s’est pas démenti,<br />
puisqu’en CM , il a poursuivi son exploration de très grandes et comp<strong>le</strong>xes multiplications.<br />
Du point de vue de l’ensemb<strong>le</strong> de la classe, la règ<strong>le</strong> des zéros, dont c’est la première<br />
apparition, sera travaillée dans <strong>le</strong>s séquences suivantes, toujours sous la « direction » du<br />
même élève. En revanche, l’extension de cette règ<strong>le</strong> à des produits moins extraordinaires<br />
( 0x ou 000x par exemp<strong>le</strong>) ne sera pas abordée immédiatement mais différée.<br />
Les règ<strong>le</strong>s du « contrat didactique » à établir reposent donc sur la prise en compte de la<br />
surprise devant des agencements d’écriture ainsi que sur la recherche du gain de temps<br />
dans la menée des calculs. Il s’agit donc, dans la classe de mathématiques, de reconnaître<br />
que <strong>le</strong>s connaissances à établir sont des connaissances, des savoir-faire qui permettent ce<br />
gain de temps (en maths, on cherche à al<strong>le</strong>r plus vite). Mais il s’agit aussi de « voir », de<br />
« remarquer » des régularités d’écriture et de <strong>le</strong>s interpréter en tant que règ<strong>le</strong>s généra<strong>le</strong>s.<br />
Les listes écrites par Anthony au tab<strong>le</strong>au (et qui sont longues et répétitives, ordonnées<br />
par lui) constituent un des éléments du milieu pour appréhender la vision du phénomène<br />
d’écriture, <strong>le</strong>s propositions de calcul « péril<strong>le</strong>ux » en constituent un autre pour faire éprouver<br />
l’économie de temps que cette règ<strong>le</strong> représente.<br />
3.2.2. La recherche de Yasmina I<br />
Comme nous l’avions fait dans <strong>le</strong> rapport ERTe, nous nous sommes données comme contrainte<br />
d’utiliser uniquement <strong>le</strong> vocabulaire de la classe. Ainsi, nous ne par<strong>le</strong>rons pas de congruence, puisque <strong>le</strong><br />
terme n’est pas apparu.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
La recherche de Yasmina s’inscrit dans une gamme d’exercices que nous pourrions<br />
dénommer « exercices d’échanges ou de conversion » : « un jeton rouge pour deux jetons<br />
verts, un jeton vert pour trois jetons b<strong>le</strong>us, combien de jetons b<strong>le</strong>us pour cinq jetons rouges<br />
etc. » Ces exercices sont présents éga<strong>le</strong>ment dans <strong>le</strong>s manuels scolaires dès la classe<br />
de CP. Leur programmation s’inscrit dans l’exploration des principes de la numération<br />
décima<strong>le</strong> (et même plus largement dans <strong>le</strong>s principes de numération), dans <strong>le</strong>s premières<br />
études de structures et plus tardivement dans l’étude de la proportionnalité. Encore une<br />
fois, la recherche de Yasmina n’est donc pas décalée par rapport aux instructions officiel<strong>le</strong>s<br />
du CE . Le travail col<strong>le</strong>ctif, durant cette séquence, va consister à la compréhension des<br />
relations choisies par l’élève entre des objets (une jupe est éga<strong>le</strong> à deux pulls, un pull vaut<br />
trois chaussettes etc.). Le contexte de la recherche de Yasmina fait que <strong>le</strong>s élèves vont<br />
commencer par explorer ces relations en fixant des prix aux différents objets. L’objectif<br />
du maître est de convaincre <strong>le</strong>s élèves que, même si <strong>le</strong>s prix initiaux choisis varient, <strong>le</strong>s<br />
relations entre <strong>le</strong>s divers prix trouvés demeurent. Du point de vue de l’élève (absente) qui<br />
présente cette recherche, l’intérêt est de former des opérations « bizarres » : que va<strong>le</strong>nt, en<br />
chaussettes, trois jupes plus un pull ? Nous retrouvons une origine importante des recherches<br />
Freinet, la formation et l’exploration d’opérations non-conformes, inspirées par <strong>le</strong>s opérations<br />
habituel<strong>le</strong>s (multiplication, addition, soustraction). Dans <strong>le</strong> cas présent, se mê<strong>le</strong> peut être <strong>le</strong><br />
désir du code secret, bref <strong>le</strong> plaisir de jong<strong>le</strong>r avec des écritures mystérieuses et codées.<br />
Cet attrait pour <strong>le</strong>s codes, l’élaboration d’opérations étranges a pour effet ici de conduire<br />
l’élève à l’établissement de relations entre objets, bref à la description d’une structure, qui<br />
reste très simp<strong>le</strong> : <strong>le</strong>s relations entre objets ne sont pas exactes, constatées entre des prix<br />
réels. Ce jeu et <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> du jeu que se donne l’élève sont des éléments du sens de la<br />
situation. Dans la classe, cette première séquence se poursuit lors de la deuxième séance<br />
analysée.<br />
Les règ<strong>le</strong>s du contrat didactique que l’enseignant cherche à mettre en œuvre au fil de la<br />
séquence sont <strong>le</strong>s suivantes : <strong>le</strong> travail doit être organisé de façon chronologique. Un premier<br />
temps doit être consacré à la compréhension des règ<strong>le</strong>s de conversion, des correspondances<br />
entre objets. Un second temps est réservé à la manipulation des opérations. (Le maître,<br />
durant la première séance, déboutera plusieurs fois des élèves qui tentent de ne pas observer<br />
cette chronologie en proposant des résultats aux opérations mystérieuses de Yasmina « on<br />
s’occupe pas des opérations »). Une deuxième règ<strong>le</strong> concerne la forme argumentative que<br />
doivent prendre <strong>le</strong>s résultats obtenus (« Si une jupe est éga<strong>le</strong> à 0… »), règ<strong>le</strong> que <strong>le</strong> maître<br />
tente d’établir en demandant systématiquement aux élèves « Pourquoi ? ». Enfin, la dernière<br />
règ<strong>le</strong> est cel<strong>le</strong> de la prise en compte, de la marque en tant que phénomène mathématique,<br />
de la persistance des relations numériques.<br />
3.2.3. La recherche de Yasmina II<br />
Durant cette séquence (qui a lieu <strong>le</strong> <strong>le</strong>ndemain), <strong>le</strong>s opérations mystérieuses sont abordées.<br />
Cependant l’étude antérieure conduit <strong>le</strong>s élèves à remplacer encore <strong>le</strong>s objets par des prix.<br />
L’objectif initial du maître qui est d’explorer <strong>le</strong>s liens entre objets et d’en user pour établir<br />
des conversions ne se réalise pas « on peut essayer de remplacer <strong>le</strong>s vêtements qui sont<br />
là par d’autres vêtements […] sans passer par <strong>le</strong>s nombres ». En revanche, une partie de<br />
la séquence va être consacrée à l’écriture multiplicative d’une somme et à une approche<br />
de la division (« 0 c’est combien de chaussettes orange ? »). Les élèves résistent par<br />
conséquent aux injonctions et aux conseils du maître. Il semb<strong>le</strong> que <strong>le</strong>s élèves inscrivent cette<br />
séquence dans la continuité de la séquence précédente, basée sur des correspondances<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
numériques et n’acceptent pas la rupture proposée par <strong>le</strong> maître.<br />
Les règ<strong>le</strong>s du contrat didactique que l’enseignant échoue à mettre en œuvre sont : l’usage<br />
des correspondances numériques peut être abandonné avec profit, la connaissance<br />
des relations entre objets permet de définir des opérations entre ces objets. Les règ<strong>le</strong>s<br />
qu’il parvient plus ou moins à établir sont : la recherche du gain de temps (à l’écrit) que<br />
représentent <strong>le</strong>s écritures multiplicatives « pour al<strong>le</strong>r plus vite, on connaît l’opération » (voir<br />
la règ<strong>le</strong> des zéros) et la prise en compte, la marque en tant que phénomène mathématique,<br />
de la persistance des relations numériques (voir Recherche de Yasmina I).<br />
3.2.4. Le calcul avec <strong>le</strong>s jours (CM1)<br />
La séquence est initialisée par l’exposé de la recherche de Mélanie, qui effectue des<br />
opérations avec <strong>le</strong>s jours. Pour ce faire, el<strong>le</strong> établit une correspondance entre l’écriture<br />
d’un jour (Lundi) et <strong>le</strong>s nombres qui indiquent la place de ce jour dans <strong>le</strong>s semaines ( , ,<br />
etc.). On pourrait dire qu’il s’agit d’une relation de congruence modulo , mais <strong>le</strong> mot<br />
ne sera jamais prononcé. Ce type de correspondance qui, à une liste d’objets organisées<br />
en associe un seul ( , , … sont associés à Lundi) est étudié en mathématiques (il s’agit<br />
de rassemb<strong>le</strong>r différents objets selon une relation d’équiva<strong>le</strong>nce 9 et de désigner chacune<br />
des classes d’équiva<strong>le</strong>nce par un représentant). Ce type de correspondance a été un objet<br />
d’enseignement au collège durant la réforme des mathématiques modernes, il a disparu<br />
des programmes ensuite. Cependant, il reste un objet implicite, puisqu’il soutient <strong>le</strong> travail<br />
prévu en e et dans <strong>le</strong>s classes successives sur <strong>le</strong>s écritures fractionnaires, puis en e <strong>le</strong><br />
travail sur <strong>le</strong>s vecteurs. En conséquence, nous sommes confrontés à une étude qui ne<br />
s’inscrit pas dans <strong>le</strong>s prescriptions officiel<strong>le</strong>s de la discipline scolaire, mais qui ne peut pas<br />
être considérée comme illégitime. Néanmoins, nous pouvons considérer l’activité durant<br />
cette séquence comme une activité d’organisation de données, de <strong>le</strong>cture et d’écriture de<br />
tab<strong>le</strong>aux (<strong>le</strong>s nombres associés aux différents jours vont être organisés de cette façon).<br />
Dans ce cas, el<strong>le</strong> s’inscrit dans <strong>le</strong> programme de ce niveau d’étude. Durant la séquence de<br />
travail observée, <strong>le</strong> maître va s’attacher dans un premier temps au calcul (en proposant et<br />
en faisant proposer des calculs comp<strong>le</strong>xes), aux règ<strong>le</strong>s d’écriture des calculs comp<strong>le</strong>xes,<br />
pour ensuite travail<strong>le</strong>r sur l’usage du tab<strong>le</strong>au, en faisant chercher <strong>le</strong>s « représentants » – <strong>le</strong>s<br />
jours – de nombres importants. C’est une élève qui va faire surgir <strong>le</strong> nom de représentant et<br />
l’intérêt de cette notion en substituant dans <strong>le</strong>s calculs, des nombres par des jours. (« c’est<br />
très beau Roxane, c’est même émouvant »). L’intérêt et <strong>le</strong> sens de l’objet d’étude, pour<br />
l’élève qui a initié la recherche, sont encore une fois l’attrait que représentent <strong>le</strong>s opérations<br />
mystérieuses.<br />
Les règ<strong>le</strong>s du contrat didactique sont : l’attention aux formes de l’expression (« je ne<br />
comprends pas, tu n’es pas assez claire »), la prise en compte, la marque en tant que<br />
phénomène mathématique cette fois d’un résultat surprenant (dimanche est élément<br />
neutre) et son explication (« je sais pourquoi parce que ça va de en »), la recherche des<br />
exemp<strong>le</strong>s ou des applications extrêmes (on peut prendre même avec trois millions),<br />
<strong>le</strong>s différentes façons de lire un tab<strong>le</strong>au sont possib<strong>le</strong>s (en colonnes ou en lignes).<br />
3.2.5 Les corrections d’additions<br />
Dans ce cas, deux nombres entiers sont équiva<strong>le</strong>nts si <strong>le</strong> reste de <strong>le</strong>ur quotient par est <strong>le</strong> même.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
La séquence est consacrée à la correction d’additions de nombres entiers à trois ou quatre<br />
chiffres posées en ligne. Il s’agit dans un premier temps de décompositions additives (milliers,<br />
centaines dizaines… 000+ 00+ ) puis d’additions systématisées dans <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s seul <strong>le</strong><br />
deuxième terme de la somme change : + 0, + 00, + 000. Ces exercices<br />
s’inscrivent tout à fait dans <strong>le</strong> programme de ce niveau scolaire, il s’agit de travail<strong>le</strong>r sur la<br />
numération décima<strong>le</strong> et l’organisation unités, dizaines, centaines…. C’est <strong>le</strong> maître qui écrit<br />
l’énoncé au tab<strong>le</strong>au, à partir du manuel. Il s’agit sans doute d’un exercice de routine, puisqu’il<br />
n’a pas remarqué que deux des opérations proposées sont identiques. En conséquence,<br />
il s’agit bien de comprendre que <strong>le</strong> résultat n’a aucun intérêt en lui-même, et qu’il ne s’agit<br />
que de s’exercer.<br />
Les règ<strong>le</strong>s du contrat didactique sont : il faut repérer la place et la désignation de chaque<br />
chiffre des nombres pour additionner milliers avec milliers, centaines avec centaines etc.<br />
Une partie du travail est un jeu d’écriture qui ne nécessite pas de verbalisation. Enfin, <strong>le</strong>s<br />
nombres sont choisis absolument au hasard.<br />
3.2.6. Le calcul mental<br />
La séquence est consacrée à la vérification de la connaissance des tab<strong>le</strong>s de multiplication,<br />
puis à une mise en œuvre de la règ<strong>le</strong> des zéros sur des produits du type 0x . Ceci est en<br />
parfaite concordance avec <strong>le</strong>s instructions officiel<strong>le</strong>s. Le lien entre <strong>le</strong>s deux parties de la<br />
séquence est délicat à négocier, car il est à la charge des élèves. L’enseignant insiste sur la<br />
rupture entre ces deux parties, mais confie à certains <strong>le</strong> soin de produire <strong>le</strong>s multiplications<br />
à calcu<strong>le</strong>r.<br />
Les règ<strong>le</strong>s du contrat didactique sont : <strong>le</strong>s connaissances sur <strong>le</strong>s tab<strong>le</strong>s de multiplication<br />
servent à al<strong>le</strong>r <strong>le</strong> plus rapidement possib<strong>le</strong>, (« dépêche toi !! ») et doivent être automatisées.<br />
Dans <strong>le</strong>s produits proposés ensuite, il faut que figure un nombre à deux chiffres « terminé » par<br />
un zéro. Il existe une méthode pour trouver rapidement <strong>le</strong>s résultats de tel<strong>le</strong>s multiplications,<br />
autre que <strong>le</strong> calcul « posé », reposant sur des déplacements de chiffres.<br />
3.2.7. Travail sur la <strong>le</strong>cture d’un énoncé de problème additif<br />
Le travail col<strong>le</strong>ctif est consacré au rappel des règ<strong>le</strong>s instituées sur la conduite de <strong>le</strong>cture et de<br />
réécriture d’un énoncé de « problème mathématique ». Ces règ<strong>le</strong>s, fina<strong>le</strong>ment reformulées<br />
par l’enseignant sont cel<strong>le</strong>s qui figurent dans <strong>le</strong>s programmes officiels de mathématiques<br />
(données inuti<strong>le</strong>s etc.). Une seconde phase de travail est consacrée à la mise en œuvre<br />
de ces règ<strong>le</strong>s, à partir d’un énoncé donné par l’enseignant. Cette séquence de travail<br />
fait suite à une première séance, qui a lieu quelques jours plus tôt. Lors de cette séance<br />
initia<strong>le</strong>, l’enseignant avait choisi un énoncé de problème additif dans <strong>le</strong>quel <strong>le</strong>s données<br />
surabondantes (à supprimer) concernaient <strong>le</strong> nombre de voyageurs dans un métro,<br />
tandis que <strong>le</strong>s données importantes (à conserver) concernaient <strong>le</strong>s horaires, <strong>le</strong>s durées<br />
des transports. Cette fois, l’enseignant propose aux élèves un énoncé de problème où <strong>le</strong>s<br />
rô<strong>le</strong>s sont inversés : <strong>le</strong>s horaires, <strong>le</strong>s durées des transports sont à négliger, tandis que <strong>le</strong>s<br />
nombres des passagers sont <strong>le</strong>s données à conserver. L’un des objectifs de l’enseignant<br />
est, nous semb<strong>le</strong>-t-il, de montrer l’influence de la question posée sur <strong>le</strong> choix des données<br />
à conserver.<br />
Les règ<strong>le</strong>s du contrat didactique que l’enseignant cherche à instaurer sont <strong>le</strong>s suivantes :<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
il existe des indices, élaborés par <strong>le</strong> rédacteur de l’énoncé, qui permettent de discerner<br />
données inuti<strong>le</strong>s et données à conserver. La <strong>le</strong>cture d’un énoncé en mathématiques suppose<br />
une stratégie de <strong>le</strong>cture guidée par la question posée. La « réécriture du texte de l’énoncé »<br />
peut s’effectuer en barrant <strong>le</strong>s informations inuti<strong>le</strong>s. Enfin et surtout, <strong>le</strong>s élèves ne doivent<br />
pas entreprendre immédiatement <strong>le</strong>s calculs : l’activité des élèves doit être planifiée et cette<br />
planification est strictement fixée.<br />
3.2.8. Comparaison des différentes séquences<br />
Sur ces quelques séquences, nous voyons effectivement se dessiner quelques<br />
caractéristiques des études en mathématiques menées à l’éco<strong>le</strong> Freinet. Tout d’abord, <strong>le</strong>s<br />
objets étudiés ont une référence dans <strong>le</strong> champ scientifique mathématique. Nous soulignons<br />
ensuite qu’ils sont souvent explicitement désignés comme objets d’enseignement dans <strong>le</strong>s<br />
programmes officiels, que <strong>le</strong>s compétences travaillées <strong>le</strong> sont éga<strong>le</strong>ment. Enfin, si certains<br />
d’entre eux ne sont pas des objets d’enseignement ou ne <strong>le</strong> sont plus, <strong>le</strong>ur apparition dans<br />
la classe est induite par des élèves. Ces objets ont éga<strong>le</strong>ment une source spécifique, qui est<br />
<strong>le</strong> travail antérieur individuel de chaque élève. Nous avançons que <strong>le</strong>s choix des questions<br />
des élèves sont des choix effectués selon des attirances, du plaisir à faire : ainsi, plusieurs<br />
sources de légitimité de ces études peuvent se mê<strong>le</strong>r dans la classe. Nous ne savons pas<br />
comment ces sources différentes peuvent être identifiées et démêlées par <strong>le</strong>s élèves.<br />
En ce qui concerne <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s des contrats didactiques que <strong>le</strong>s différents enseignants<br />
cherchent à établir, nous avons été frappée par <strong>le</strong> fait que dans plusieurs séquences<br />
observées à Freinet persistaient deux éléments : la première règ<strong>le</strong> est cel<strong>le</strong> qu’il existe des<br />
phénomènes mathématiques, c’est-à-dire des faits surprenants, reproductib<strong>le</strong>s dans cette<br />
discipline, dont <strong>le</strong>s apparitions sont à comprendre ou à anticiper ou à utiliser. La seconde<br />
règ<strong>le</strong> est cel<strong>le</strong> de la recherche de l’économie de temps. Ces remarques sont construites à<br />
partir des observations de classe, mais el<strong>le</strong>s font écho aux discours des enseignants de cet<br />
établissement, tels que nous avions pu <strong>le</strong>s recueillir lors de <strong>le</strong>urs réunions pédagogiques.<br />
Ces règ<strong>le</strong>s ne sont pas négociées dans <strong>le</strong>s autres classes observées. Deux différences<br />
nous paraissent en conséquence caractériser l’étude dans <strong>le</strong>s classes de mathématiques<br />
à Freinet. La première est que l’enseignant tente de faire construire des lois à partir de<br />
régularités inattendues ou imprévues plutôt que d’énoncer ces lois, la seconde est que <strong>le</strong><br />
gain de temps, la rapidité d’exécution au cours d’une activité mathématique est plutôt à<br />
Freinet un objectif à atteindre qu’une injonction à respecter.<br />
3.3. Énoncés et consignes, supports du travail col<strong>le</strong>ctif<br />
Les activités mathématiques à l’éco<strong>le</strong> sont largement tributaires des énoncés de problèmes,<br />
questions et consignes données, qui formatent plus ou moins <strong>le</strong> travail des élèves. Pour<br />
chacune des séquences analysées, nous avons re<strong>le</strong>vé <strong>le</strong>s caractéristiques des énoncés,<br />
<strong>le</strong>ur mode d’élaboration ou <strong>le</strong>ur origine.<br />
3.3.1. La règ<strong>le</strong> des zéros<br />
Les énoncés col<strong>le</strong>ctifs sur <strong>le</strong>squels <strong>le</strong>s élèves travail<strong>le</strong>nt au cours de cette séquence sont :<br />
x 00, x 00. Ils sont proposés par <strong>le</strong> maître et <strong>le</strong>ur résolution s’effectue et à l’écrit et à<br />
l’oral. Leur succession traduit une augmentation de la difficulté à dire <strong>le</strong> résultat obtenu par<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
simp<strong>le</strong> déplacement des zéros. (ils ne sont pas choisis au hasard)<br />
3.3.2. La recherche de Yasmina I<br />
Les énoncés travaillés col<strong>le</strong>ctivement sont <strong>le</strong>s énoncés écrits par Yasmina (qui est absente) :<br />
des codes ou des dessins stylisés marquent <strong>le</strong>s relations : une jupe vaut un pantalon, une<br />
jupe vaut deux chaussettes orange, un pull vaut une chaussette verte, un pull vaut trois<br />
jupes. En dessous figurent des opérations : chaussettes vertes plus deux pantalons (en<br />
chaussettes orange), quatre pantalons (en chaussettes orange). Les relations entre objets<br />
sont simp<strong>le</strong>s et « surabondantes » : <strong>le</strong>s égalités entre la jupe et <strong>le</strong> pantalon d’une part et<br />
<strong>le</strong> pull et la chaussette verte d’autre part comp<strong>le</strong>xifient la description sans véritab<strong>le</strong>ment<br />
apporter des contributions à la structure. Le texte de l’énoncé est en fait plus comp<strong>le</strong>xe que<br />
ceux des manuels sur <strong>le</strong> même sujet.<br />
3.3.3. La recherche de Yasmina II<br />
L’énoncé initial est <strong>le</strong> même que précédemment. Même si on ne comprend pas <strong>le</strong> choix de<br />
Yasmina, même si on peut supposer qu’el<strong>le</strong> a écrit plus ou moins au hasard <strong>le</strong>s relations et<br />
<strong>le</strong>s opérations à effectuer, il n’en reste pas moins que cet énoncé sera intangib<strong>le</strong>, parce que<br />
c’est <strong>le</strong> travail d’une élève.<br />
3.3.4. Les calculs avec <strong>le</strong>s jours<br />
L’énoncé initial est celui de Mélanie : « Lundi+ Jeudi x Dimanche ? ». D’autres énoncés vont<br />
ensuite être construits et travaillés. C’est <strong>le</strong> maître qui demande aux élèves de proposer un<br />
énoncé : mardi x dimanche+dimanche – samedi+lundi – mercredi (deux élèves y participent),<br />
puis chacun va contribuer pour un terme à : DxJ+D-S+Me-Ma-LxMa-V, puis une élève va<br />
énoncer un « défi » : « trouver <strong>le</strong> jour d’un nombre » et de même <strong>le</strong>s élèves vont proposer 0,<br />
, , 00 auxquels <strong>le</strong> maître ajoute . Ces énoncés traduisent la volonté du maître de<br />
construire des énoncés extraordinaires par <strong>le</strong>ur longueur et d’étendre <strong>le</strong> champ numérique<br />
des énoncés proposés. Le maître se charge donc de la tâche de repousser <strong>le</strong>s limites des<br />
applications, d’étendre ce que l’on est capab<strong>le</strong> de traiter.<br />
3.3.5. Les corrections<br />
Les énoncés, comme nous l’avons dit plus haut, sont cette fois extraits du manuel en usage<br />
dans la classe (voir en annexe). Les premiers ne nécessitent pas de mises en œuvre de<br />
connaissances de tab<strong>le</strong>s d’addition, mais des traitements d’écriture ( 000+ 00+ s’effectue<br />
en plaçant, à la place adéquate <strong>le</strong>s chiffres et dans l’écriture de 000). Les suivants<br />
requièrent des connaissances de tab<strong>le</strong>s d’addition et des appariements des chiffres selon <strong>le</strong>ur<br />
position dans l’écriture des nombres : + 0 s’effectue en identifiant <strong>le</strong>s chiffres appariés<br />
et et en effectuant + . Il n’y pas de retenue à effectuer. Seu<strong>le</strong> la dernière opération<br />
soulève <strong>le</strong> problème de l’écriture d’un résultat dont <strong>le</strong> nombre de chiffres est supérieur à<br />
celui du premier terme de la somme. Enfin, pour <strong>le</strong>s opérations, l’ordre des termes des<br />
sommes donne une place prépondérante dans <strong>le</strong>s traitements au premier terme qui est<br />
celui à transformer. L’exercice est donc bien un exercice de routine, auquel correspond une<br />
technique scolaire identifiée. La systématisation des écritures proposée permet d’objectiver<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
cette technique. Ces énoncés, produits par un maître qui détient <strong>le</strong> savoir sont regroupés,<br />
réunis selon <strong>le</strong> principe de l’identité de la technique à mettre en œuvre. A charge à l’élève<br />
de comprendre <strong>le</strong> principe de ce rassemb<strong>le</strong>ment/regroupement.<br />
0<br />
3.3.6. Le calcul mental<br />
Les différents énoncés sont : x , x , x , x , x , x , x , 0x , x (rejeté), 0x ,<br />
0x (rejeté), 0x , 0x . Les premiers – posés par l’enseignant – portent sur la tab<strong>le</strong> de .<br />
Une rupture est organisée par l’enseignant lorsqu’il propose 0x . Le maître demande alors<br />
aux élèves de construire eux-mêmes <strong>le</strong>s énoncés, mais en rejetant certains. Le premier<br />
( x ) l’est parce qu’il n’exige pas la mise en œuvre de la même technique que 0x , <strong>le</strong><br />
troisième parce qu’il est trop régulier. Là encore, <strong>le</strong>s énoncés sont réunis selon <strong>le</strong> principe<br />
de l’identité de la technique qui permet de <strong>le</strong>s traiter. Leurs variations sont contrôlées par <strong>le</strong><br />
maître afin que <strong>le</strong>s limites de la technique soient perçues et dépassées.<br />
3.3.7. Travail sur la <strong>le</strong>cture d’un énoncé de problème additif<br />
L’énoncé est extrait du manuel en usage dans la classe : « L’avion Paris-Athènes s’est<br />
envolé de l’aéroport d’Orly à h avec passagers à bord. Après h 0 de vol il a atterri<br />
à Rome pour une esca<strong>le</strong> de 0 mn. 0 passagers sont descendus et sont montés.<br />
L’avion a atterri à Athènes 0 mn après son départ de Rome et tous <strong>le</strong>s passagers sont<br />
descendus. Combien de passagers sont arrivés à Athènes ? ». Les informations inuti<strong>le</strong>s<br />
sont <strong>le</strong>s informations d’horaire et de durée, <strong>le</strong>s informations uti<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong>s effectifs des<br />
passagers. Selon <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s de l’enseignant, <strong>le</strong> texte réécrit pourrait être : « L’avion s’est<br />
envolé de l’aéroport d’Orly avec passagers à bord. Il a atterri à Rome. 0 passagers<br />
sont descendus et sont montés. L’avion a atterri à Athènes et tous <strong>le</strong>s passagers sont<br />
descendus », en admettant que <strong>le</strong>s informations de lieux sont uti<strong>le</strong>s à la compréhension du<br />
texte et à l’organisation des données. Ce texte est proposé dans <strong>le</strong> but de faire fonctionner<br />
<strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s de traitement d’un énoncé de problème mathématique. Mais il est l’occasion<br />
de mettre à l’épreuve la règ<strong>le</strong> qui dit « Je cherche l’unité » pour éliminer <strong>le</strong>s informations<br />
inuti<strong>le</strong>s. En effet, « l’unité à chercher doit se trouver dans la question ». Or, l’unité ici est<br />
« passager ». Ce n’est pas une unité au sens scolaire du terme, comme peuvent l’être m,<br />
cm, mn etc. En conséquence, l’énoncé a été choisi pour dénoncer des usages établis et<br />
étendre <strong>le</strong>s pratiques liées à une technique institutionnalisée 0 .<br />
Les énoncés qui supportent <strong>le</strong> travail des élèves sont donc différents à Freinet et dans <strong>le</strong>s<br />
classes « ordinaires » sur deux caractéristiques au moins : La première est que la plupart<br />
des énoncés initiaux sont élaborés par un élève, lors d’un travail individuel. La seconde est<br />
que si une série d’énoncés est proposée dans la classe, <strong>le</strong> regroupement de ces énoncés<br />
est un regroupement qui est géré par <strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif. Nous avons vu que des variations régulées<br />
des énoncés initiaux sont proposées dans <strong>le</strong>s classes Freinet, comme ail<strong>le</strong>urs, et que des<br />
régulations de ces variations sont gérées par <strong>le</strong> maître. Personne n’est l’initiateur d’une<br />
rupture bruta<strong>le</strong>, sans transition, de « genres » d’énoncés. En revanche, <strong>le</strong> maître se donne,<br />
comme ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong> droit de proposer des questions qui étendent <strong>le</strong> champ des traitements<br />
effectués.<br />
0 Cela explique la colère du maître à la réponse d’une élève qui, s’appuyant sur <strong>le</strong> travail antérieur, dit<br />
qu’il faut « éliminer <strong>le</strong>s passagers » – au lieu d’« éliminer <strong>le</strong>s informations inuti<strong>le</strong>s », dans l’activité préparatoire<br />
au travail.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Nous voyons encore une fois apparaître, sous un autre ang<strong>le</strong>, la caractéristique de continuité<br />
du travail dans la classe de mathématiques. Cet aspect différent peut-il contribuer à expliquer<br />
l’attention que portent <strong>le</strong>s élèves de Freinet à la transformation des questions initia<strong>le</strong>s que<br />
nous avions soulignée dans <strong>le</strong> premier paragraphe ?<br />
3.4. Analyse des interactions verba<strong>le</strong>s<br />
L’analyse qui précède ne prend pas en compte la/<strong>le</strong>s manière(s) dont <strong>le</strong>s interventions des<br />
élèves et du maître construisent peu à peu cette étude, permettent aux règ<strong>le</strong>s de s’établir<br />
ou au contraire de s’effondrer. El<strong>le</strong> ne prend pas en compte non plus au fond, la gestion<br />
de l’étude au cours de la séquence, <strong>le</strong>s positions des uns et des autres. Il nous semb<strong>le</strong><br />
puisqu’une très grande partie du travail col<strong>le</strong>ctif dans la classe de mathématiques consiste<br />
à élaborer un discours « recevab<strong>le</strong> » et <strong>le</strong>s conditions de recevabilité de ce discours qu’il est<br />
important d’analyser <strong>le</strong>s modes d’interactions verba<strong>le</strong>s.<br />
Nous avons retenu <strong>le</strong>s échanges retranscrits col<strong>le</strong>ctifs durant ces sept séquences. Malgré<br />
<strong>le</strong>s différences (qui sautent aux yeux), malgré <strong>le</strong>s thèmes et <strong>le</strong>s entrées, il nous a été possib<strong>le</strong><br />
de choisir des indicateurs qui permettaient des comparaisons.<br />
Dans un premier temps, nous avons identifié, pour chacune des prises de paro<strong>le</strong> :<br />
– l’auteur : <strong>le</strong> maître, un élève, des élèves ;<br />
– La prise de paro<strong>le</strong> de l’élève, selon qu’el<strong>le</strong> est explicitement sollicitée, qu’el<strong>le</strong> est donnée, qu’el<strong>le</strong> est<br />
prise ;<br />
– <strong>le</strong> destinataire, lorsqu’il est mentionné ou peut être reconstruit. S’il ne l’est pas, nous supposerons que<br />
c’est « la classe » dans son ensemb<strong>le</strong> qui est destinataire ;<br />
–<br />
<strong>le</strong> type d’interventions que nous allons traiter ensuite.<br />
L’étude des premiers indicateurs nous fait apparaître <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au suivant :<br />
La règ<strong>le</strong> des<br />
zéros<br />
Freinet<br />
La recherche<br />
de Yasmina<br />
Freinet<br />
La recherche<br />
de Yasmina<br />
Freinet<br />
Le calcul avec<br />
<strong>le</strong>s jours<br />
Freinet<br />
Correction<br />
Provinces<br />
Calcul Mental<br />
Provinces<br />
Travail sur<br />
l’énoncé<br />
Provinces<br />
Durée<br />
approximative<br />
0 mn<br />
heure<br />
heure<br />
h mn<br />
0 mn<br />
0 mn<br />
0 mn<br />
Nombre<br />
de tours<br />
de paro<strong>le</strong><br />
(durée<br />
moyenne)<br />
… du<br />
maître<br />
… d’élève<br />
( s) ( %) ( %)<br />
( s) ( %)<br />
Dont<br />
Paro<strong>le</strong>s<br />
d’élèves<br />
Données<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Dont<br />
Paro<strong>le</strong>s<br />
d’élèves<br />
Prises<br />
0<br />
( %) %)<br />
0<br />
( %) ( %) ( %)<br />
0<br />
( s) ( %) ( %) ( %) ( %)<br />
( s)<br />
0<br />
( %) ( %)<br />
0<br />
( %) ( %)<br />
( s) ( 0%) ( 0%) ( %) ( %)<br />
( s) ( %)<br />
0<br />
( %) ( %) ( %)<br />
( s) ( 0%) ( 0%) ( %) ( %)<br />
Tab<strong>le</strong>au 16 : Répartition des tours de paro<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong>s séquences
Trois résultats marquent <strong>le</strong>s différences entre <strong>le</strong>s séquences.<br />
Le premier est la densité des tours de paro<strong>le</strong>s. A Provinces, un tour de paro<strong>le</strong> peut être bref,<br />
même très bref (un mot), à Freinet il sont dans l’ensemb<strong>le</strong> beaucoup plus longs : élèves et<br />
maître en règ<strong>le</strong> généra<strong>le</strong> s’expriment par des phrases complètes. Le second est la part du<br />
maître dans ces échanges. Si à Freinet on observe une répartition éga<strong>le</strong> entre interventions<br />
du maître et interventions des élèves, à Provinces, l’enseignant par<strong>le</strong> significativement<br />
davantage. Enfin, <strong>le</strong>s élèves prennent la paro<strong>le</strong> beaucoup plus librement à Freinet qu’à<br />
Provinces où prévaut la paro<strong>le</strong> explicitement sollicitée (sans que l’élève n’ait manifestement<br />
l’envie de répondre) .<br />
Ces trois différences, qui sont convergentes, expliquent pour partie <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong>s élèves<br />
de Freinet développent <strong>le</strong>ur pensée davantage à l’oral (voir premier rapport) et peut être à<br />
l’écrit que d’autres élèves interrogés.<br />
Tournons nous à présent vers l’analyse plus précise des interventions des différents acteurs<br />
des situations observées. Nous commencerons par cel<strong>le</strong>s des enseignants.<br />
3.5. Analyse des interventions ora<strong>le</strong>s de l’enseignant<br />
3.5.1. Formes des interventions<br />
Les types d’intervention du maître sont éga<strong>le</strong>ment révélateurs. Nous proposons de<br />
différencier <strong>le</strong>s dimensions des interventions du maître dans la classe tout d’abord selon<br />
<strong>le</strong>s formes que prennent ces interventions : el<strong>le</strong>s peuvent être des questions, des ordres ou<br />
simp<strong>le</strong>ment des énoncés déclaratifs. 12<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Questions Ordres Déclarations<br />
La règ<strong>le</strong> des zéros<br />
Freinet ( %) ( %) ( %) 12<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet ( %) ( %) ( %)<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet ( 0%) ( %) ( %)<br />
Le calcul avec <strong>le</strong>s jours<br />
Freinet ( %) ( %) ( %)<br />
Nombre<br />
de<br />
Tours de paro<strong>le</strong><br />
Cependant ces données chiffrées masquent la répartition temporel<strong>le</strong> de ces prises de paro<strong>le</strong>. Le<br />
nombre d’interventions sollicitées des élèves dépend du type d’activité mise en place. Par exemp<strong>le</strong> à Freinet,<br />
la paro<strong>le</strong> est d’abord massivement donnée au début de la « recherche col<strong>le</strong>ctive », puis dans un temps<br />
conséquent, el<strong>le</strong> va être majoritairement sollicitée pour redevenir à la fin soit donnée, soit prise. A Provinces,<br />
el<strong>le</strong> est uniquement sollicitée au début (pour <strong>le</strong>s corrections col<strong>le</strong>ctives etc.) et sera donnée ou prise plus<br />
largement lors de l’étude du problème. Ainsi il semb<strong>le</strong> que dans <strong>le</strong>s deux classes, <strong>le</strong>s modes de prise de paro<strong>le</strong><br />
des élèves soient différemment contrôlées par <strong>le</strong> maître selon <strong>le</strong>s activités en cours.<br />
Nous traitons ici de dimensions et non de catégories. Par conséquent <strong>le</strong> nombre total d’énoncés<br />
n’est pas la somme de ceux qui présentent ou une forme interrogative, ou une forme déclarative etc. Le<br />
pourcentage est à entendre de la manière suivante : % des tours de paro<strong>le</strong> de l’enseignant présentent une<br />
forme interrogative et non % des tours de paro<strong>le</strong> de l’enseignant sont des formes interrogatives.<br />
0
Correction<br />
Provinces ( 0%) ( 0%) ( %)<br />
Calcul Mental<br />
Provinces<br />
Travail sur l’énoncé<br />
Provinces<br />
0<br />
( 0%) ( %) ( %)<br />
0<br />
( %) ( %) ( 0%)<br />
Tab<strong>le</strong>au 17 : Formes des tours de paro<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong>s séquences<br />
Les formes d’interventions du maître sont en conséquence contrastées selon <strong>le</strong>s séquences,<br />
même si majoritairement, dans chacune d’entre el<strong>le</strong>s, prime la dimension « déclarative ».<br />
Ces contrastes, sur <strong>le</strong>squels nous allons nous pencher plus précisément, portent sur <strong>le</strong>s<br />
formes interrogatives et surtout sur <strong>le</strong>s formes « impératives ». Nous retiendrons, dans notre<br />
perspective de comparaison, que <strong>le</strong>s maîtres de Freinet ordonnent très peu (comparativement<br />
à celui de l’autre éco<strong>le</strong>). Nous ne trouvons que très peu d’impositions directes qu’el<strong>le</strong>s soient<br />
à l’égard de l’ensemb<strong>le</strong> des élèves ou adressées à un élève seul.<br />
3.5.2. Contributions du maître au discours sur l’objet d’étude : <strong>le</strong>s réactions<br />
immédiates au discours d’un élève<br />
Regardons plus précisément la nature de ces interventions. Pour <strong>le</strong>s analyser, nous<br />
proposons de distinguer tout d’abord <strong>le</strong>s interventions de l’enseignant qui ont pour objet et<br />
pour objectif de travail<strong>le</strong>r sur l’objet d’étude directement. Nous distinguerons des moments<br />
où <strong>le</strong>s interventions sont « directes » et ceux où el<strong>le</strong>s sont des réactions au discours d’un<br />
élève. Il s’agit, dans cette distinction, de différencier ce qui est intervention travaillant<br />
directement à partir de la paro<strong>le</strong> ou de l’écrit d’un élève et en conséquence de voir comment<br />
cette paro<strong>le</strong> est prise en compte dans l’immédiateté des échanges dans la classe, et ce qui<br />
est intervention du maître qui suspend ce dialogue ou cherche à en instaurer un nouveau.<br />
Il nous semb<strong>le</strong> en effet que dans une classe de mathématiques, lorsque nous cherchons à<br />
décrire comment, au cours des échanges de paro<strong>le</strong>, se construit un discours recevab<strong>le</strong> sur<br />
l’objet d’étude considéré, nous devons différencier ce qui est de l’ordre du travail col<strong>le</strong>ctif à<br />
partir de l’énoncé d’un ou des élèves et ce qui est de l’ordre de l’organisation de ce travail<br />
par l’enseignant ou de la contribution directe de l’enseignant au discours final. Il s’agit aussi<br />
de voir si <strong>le</strong> discours acceptab<strong>le</strong> se construit plutôt à partir de celui de l’élève ou plutôt à<br />
partir de celui du maître.<br />
Lorsque <strong>le</strong> maître intervient en réaction au discours (oral ou écrit) d’un élève, ses réactions<br />
peuvent prendre différentes formes : il peut en effet <strong>le</strong> reprendre (<strong>le</strong> reformu<strong>le</strong>r ou <strong>le</strong> répéter).<br />
Ces opérations peuvent avoir pour but de diffuser <strong>le</strong> discours d’un des élèves à la classe,<br />
de <strong>le</strong> valider en <strong>le</strong> reprenant, de <strong>le</strong> modifier pour <strong>le</strong> rendre conforme, bref il s’agit de rendre<br />
audib<strong>le</strong> une paro<strong>le</strong> de l’élève. L’enseignant peut aussi réagir au discours d’un élève en <strong>le</strong><br />
décrétant partiel<strong>le</strong>ment ou tota<strong>le</strong>ment inaudib<strong>le</strong>. Dans ce cas, ses réactions pourront prendre<br />
la forme d’injonctions à <strong>le</strong> rendre audib<strong>le</strong>. Ce n’est plus <strong>le</strong> maître qui se charge de ce travail<br />
mais il invite l’élève à <strong>le</strong> faire. Ces injonctions peuvent être des injonctions pour <strong>le</strong> rendre<br />
accessib<strong>le</strong> à tous : <strong>le</strong> maître demande d’écrire au tab<strong>le</strong>au ou de redire ce qui a pu ne pas<br />
être entendu par tous. El<strong>le</strong>s peuvent être des injonctions visant à la modification du discours<br />
par l’élève qui est inaudib<strong>le</strong> parce qu’erroné : <strong>le</strong> maître peut rejeter l’énoncé, ou <strong>le</strong> rectifier,<br />
ou <strong>le</strong> dénoncer, voire l’arrêter. El<strong>le</strong>s peuvent être aussi des injonctions à poursuivre un<br />
discours qui n’est pas encore audib<strong>le</strong> parce qu’incomp<strong>le</strong>t. Dans ce cas, <strong>le</strong> maître peut faire<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
une demande factuel<strong>le</strong> à l’élève, lui demander une explication, lui demander un exemp<strong>le</strong> ou<br />
encore simp<strong>le</strong>ment lui demander de poursuivre.<br />
Enfin, <strong>le</strong>s interventions du maître en réaction directe à un discours d’élève peuvent comporter<br />
une dimension évaluative, qui a pour but de décider si <strong>le</strong> discours est audib<strong>le</strong>, recevab<strong>le</strong><br />
ou non. Dans ce dernier cas, il n’y a pas toujours de façon conjointe une injonction de<br />
l’enseignant demandant un retravail de l’élève.<br />
La règ<strong>le</strong> des zéros<br />
Freinet<br />
La recherche de<br />
Yasmina<br />
Freinet<br />
La recherche de<br />
Yasmina<br />
Freinet<br />
Le calcul avec <strong>le</strong>s<br />
jours<br />
Freinet<br />
Réactions<br />
au discours d’un<br />
élève<br />
13<br />
Reformulations<br />
Répétitions<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Injonctions<br />
A<br />
modifier<br />
Injonctions<br />
A<br />
poursuivre<br />
( %) ( %) ( 0%) ( %)<br />
0<br />
( %) ( %)<br />
Injonctions<br />
A<br />
publier<br />
Évaluations<br />
0<br />
(0%)<br />
0<br />
( 0%) ( %) ( %)<br />
( %) ( %) ( %) ( %) ( %)<br />
0<br />
( 0%) ( %) ( %)<br />
Correction<br />
Provinces ( %) ( %) ( %) ( %)<br />
0<br />
(0%) ( %)<br />
0<br />
( %)<br />
Calcul Mental<br />
Provinces ( %) ( %) ( %) ( %) ( %)<br />
Travail sur l’énoncé<br />
Provinces ( %)<br />
0<br />
( %) ( %) ( %) ( %)<br />
Tab<strong>le</strong>au 18 : Types d’intervention du maître : réactions au discours d’un élève<br />
Les deux dimensions des interventions de l’enseignant qui différencient <strong>le</strong>s classes Freinet<br />
des autres classes sont donc <strong>le</strong>s proportions de reformulations (un peu supérieures à<br />
Freinet) et cel<strong>le</strong>s des évaluations (très minorées à Freinet). Pour trois des classes Freinet<br />
on peut ajouter aussi la proportion des injonctions à poursuivre qui reste importante. En<br />
conséquence, <strong>le</strong>s réactions de l’enseignant au discours des élèves sont marquées à Freinet<br />
par des dimensions qui sont davantage qu’ail<strong>le</strong>urs cel<strong>le</strong>s de rendre <strong>le</strong> discours audib<strong>le</strong> et<br />
beaucoup moins qu’ail<strong>le</strong>urs par cel<strong>le</strong>s de l’évaluation de ces discours. On pourrait dire qu’à<br />
Freinet <strong>le</strong> maître accompagne davantage la paro<strong>le</strong> de l’élève en la soutenant (soit en la<br />
reformulant soit en demandant d’expanser son discours) et que ces enseignants valident ou<br />
invalident immédiatement moins qu’ail<strong>le</strong>urs ces discours.<br />
Regardons plus précisément encore <strong>le</strong>s différences entre <strong>le</strong>s interventions évaluatives :<br />
Il s’agit toujours de dimensions d’un énoncé : ainsi dans cette séquence, l’enseignant réagit fois au<br />
discours d’un élève.
La règ<strong>le</strong> des zéros<br />
Freinet<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet<br />
Le calcul avec <strong>le</strong>s jours<br />
Freinet<br />
Correction<br />
Provinces<br />
Calcul Mental<br />
Provinces<br />
Travail sur l’énoncé<br />
Provinces<br />
Demande<br />
Avis<br />
Approuve Désapprouve Demande<br />
« qui a eu bon ?<br />
qui a eu faux ? »<br />
0 0 0 0<br />
0<br />
0 0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0<br />
0 0<br />
Tab<strong>le</strong>au 19 : Types d’évaluation immédiate<br />
Ce décompte porte certes sur de petits effectifs. Cependant, la tendance est généra<strong>le</strong> et à ce<br />
titre peut être conservée : à l’éco<strong>le</strong> Freinet, nous n’avons pas re<strong>le</strong>vé, dans ces observations<br />
de paro<strong>le</strong>s du maître qui désignait une réponse, un énoncé d’élève comme « faux » ou<br />
comme « faute ». Cela ne signifie pas pour autant que <strong>le</strong>s maîtres Freinet ne rejettent<br />
ni ne dénoncent certains énoncés, mais qu’ils n’adoptent pas de positions de sanctions<br />
immédiate : dire <strong>le</strong> vrai, dire <strong>le</strong> faux ne prend pas <strong>le</strong>s mêmes formes à Freinet qu’ail<strong>le</strong>urs. Ce<br />
résultat est pour nous un indice fort de la construction de l’erreur, de son statut particulier.<br />
Nous remarquons éga<strong>le</strong>ment que <strong>le</strong> maître Freinet sollicite l’avis des autres élèves et que<br />
ceci est aussi un trait relativement caractéristique du mode d’évaluation immédiate à l’oral.<br />
Là encore, ceci est pour nous la preuve que la position du maître vis-à-vis de l’étude n’est<br />
pas cel<strong>le</strong> de celui qui peut constamment attribuer une va<strong>le</strong>ur aux énoncés des élèves mais<br />
plutôt cel<strong>le</strong> de celui qui tente de faire attribuer une validité col<strong>le</strong>ctive à ces énoncés.<br />
3.5.3. Contributions du maître au discours sur l’objet d’étude : <strong>le</strong>s interventions<br />
« directes »<br />
Nous ne considérons toujours que <strong>le</strong>s interventions du maître qui ont des effets immédiats<br />
sur l’élaboration du discours col<strong>le</strong>ctif sur l’objet d’étude. S’il ne réagit pas à un discours<br />
d’élève, en <strong>le</strong> validant ou l’invalidant, en négociant sa formulation… si donc <strong>le</strong> maître n’est<br />
pas occupé à rendre audib<strong>le</strong> <strong>le</strong> discours d’un élève, il peut aussi prendre à sa charge <strong>le</strong><br />
discours audib<strong>le</strong>, soit chercher à <strong>le</strong> susciter.<br />
Nous avons appelé ‘contributions directes à l’objet d’étude’ <strong>le</strong>s moments des interventions<br />
du maître où il assume la charge de l’étude : ce sont <strong>le</strong>s moments où <strong>le</strong> maître fournit luimême<br />
<strong>le</strong>s réponses, ou des méthodes, <strong>le</strong>s moments où il dit <strong>le</strong> résultat obtenu. Mais ce sont<br />
ceux aussi où il souligne l’importance d’un fait, d’une remarque. Ceux encore où il fournit
des indices (position éclairée par l’approche de G. Brousseau ). Enfin, ce sont ceux où il<br />
fournit des éléments de savoir (ce que l’on nomme « représentants » ou pourquoi on utilise<br />
<strong>le</strong> signe « ~ » au lieu du signe « = »). Nous avons hésité à faire entrer dans cette catégorie<br />
<strong>le</strong>s moments où <strong>le</strong> maître ‘dit l’énoncé’ c’est-à-dire <strong>le</strong>s moments où <strong>le</strong> maître se charge de la<br />
question posée à la classe. En effet, toutes <strong>le</strong>s autres catégories formant ces contributions<br />
directes à l’objet d’étude n’appel<strong>le</strong>nt pas forcément de réponses des élèves, n’en suscitent<br />
pas forcément, à la différence de cette dernière.<br />
Nous avons distingué « fournit des réponses » de « dit <strong>le</strong> résultat obtenu » selon <strong>le</strong> temps<br />
dans <strong>le</strong>quel s’inscrivait la prise de paro<strong>le</strong> : <strong>le</strong> maître fournit des réponses lorsqu’il « fait à la<br />
place des élèves », <strong>le</strong> maître dit <strong>le</strong> résultat obtenu lorsqu’il est <strong>le</strong> porte paro<strong>le</strong> du travail d’un<br />
ou des élève(s).<br />
La règ<strong>le</strong> des zéros<br />
Freinet<br />
La recherche de<br />
Yasmina<br />
Freinet<br />
La recherche de<br />
Yasmina<br />
Freinet<br />
Le calcul avec <strong>le</strong>s<br />
jours<br />
Freinet<br />
Correction<br />
Provinces<br />
Calcul Mental<br />
Provinces<br />
Travail sur l’énoncé<br />
Provinces<br />
Fournit<br />
Réponse<br />
Fournit<br />
Éléments de<br />
Technique<br />
Ou de<br />
méthode<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Fournit<br />
Vocabulaire<br />
Ou<br />
Des codes<br />
Souligne<br />
L’importance<br />
Fournit<br />
indices<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
Dit<br />
<strong>le</strong><br />
résultat<br />
obtenu<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0<br />
Tab<strong>le</strong>au 20 : Contributions directes du maître à l’objet d’étude<br />
Dit<br />
l’énoncé<br />
Les fluctuations sont essentiel<strong>le</strong>ment conditionnées à la situation. Les seu<strong>le</strong>s différences<br />
un peu marquantes concernent <strong>le</strong>s délivrances d’indices. Lors d’un travail de recherche,<br />
<strong>le</strong>s maîtres Freinet délivrent très peu d’indices que ce soit sur la façon de faire ou sur <strong>le</strong>s<br />
résultats attendus. Là encore, c’est peut-être la responsabilité de l’élève qui est engagée<br />
dans cette construction de la place du maître qui n’est pas celui qui dévoi<strong>le</strong> peu à peu ses<br />
attentes. L’aide à Freinet existe, mais el<strong>le</strong> prend des formes col<strong>le</strong>ctives : c’est l’enseignant<br />
qui demande directement à un élève de venir en soutenir un autre, comme <strong>le</strong> montre ce<br />
tab<strong>le</strong>au :<br />
BROUSSEAU G. ( ), « Le contrat didactique : <strong>le</strong> milieu », Recherches en didactique des<br />
mathématiques, vol / , La Pensée Sauvage, p. 0 - .
La règ<strong>le</strong> des zéros<br />
Freinet<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet<br />
Le calcul avec <strong>le</strong>s jours<br />
Freinet<br />
Correction<br />
Provinces<br />
Calcul Mental<br />
Provinces<br />
Travail sur l’énoncé<br />
Provinces<br />
Demandes<br />
d’aide<br />
0 0<br />
Aides directes,<br />
conseils<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0 0<br />
0<br />
Tab<strong>le</strong>au 21 : La gestion de l’aide<br />
Le maître peut influer directement comme nous venons de <strong>le</strong> voir sur la construction de<br />
l’objet d’étude, en fournissant des résultats, des méthodes etc. Mais il peut aussi influer<br />
indirectement en demandant aux élèves de fournir des résultats, des méthodes etc.<br />
La règ<strong>le</strong> des zéros<br />
Freinet<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet<br />
Le calcul avec <strong>le</strong>s jours<br />
Freinet<br />
Correction<br />
Provinces<br />
Calcul Mental<br />
Provinces<br />
Travail sur l’énoncé<br />
Provinces<br />
Demandes<br />
Factuel<strong>le</strong>s<br />
(Col<strong>le</strong>ctives)<br />
0 0<br />
0 0<br />
0<br />
Demandes<br />
De<br />
Méthodes<br />
(col<strong>le</strong>ctives)<br />
Tab<strong>le</strong>au 22 : Demandes de contributions directes à l’objet d’étude<br />
Nous remarquons que certaines séquences se dérou<strong>le</strong>nt sans qu’il y ait de questions<br />
col<strong>le</strong>ctives, nouvel<strong>le</strong>s, du maître. Il s’agit effectivement de séquences dont <strong>le</strong> dérou<strong>le</strong>ment est<br />
régulé ou se régu<strong>le</strong> de façon tout à fait particulière. La séquence « règ<strong>le</strong> des zéros » est une<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
séquence durant laquel<strong>le</strong> on aura remarqué <strong>le</strong> retrait de l’enseignant, qui est pratiquement<br />
une séquence d’échanges entre élèves. La séquence de « correction » quant à el<strong>le</strong> offre un<br />
exemp<strong>le</strong> de situation parfaitement réglée : <strong>le</strong>s élèves désignés viennent tour à tour écrire au<br />
tab<strong>le</strong>au <strong>le</strong>urs résultats. Si nous regardons à présent <strong>le</strong>s autres séquences, nous constatons<br />
que <strong>le</strong>s enseignants de Freinet, proportionnel<strong>le</strong>ment, ont beaucoup moins recours aux<br />
questions factuel<strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctives. Pour grossir <strong>le</strong> trait, nous dirons que l’enseignement en<br />
mathématiques à Freinet est très éloigné du mode « questions de l’enseignant », « réponses<br />
brèves de l’élève », « évaluation de la réponse de l’élève ».<br />
3.5.6. Les interventions de planification du maître<br />
Le maître a une tâche essentiel<strong>le</strong> qui est cel<strong>le</strong> de gérer <strong>le</strong> temps didactique et par conséquent<br />
cel<strong>le</strong> de <strong>le</strong> dire. L’inscription dans <strong>le</strong> temps didactique peut prendre plusieurs formes : cel<strong>le</strong><br />
des regards sur <strong>le</strong> passé : regards lointains qui sont des rappels, regards sur ce qui vient<br />
d’être fait : ce que l’on a réussi à faire ; Vient ensuite la planification proprement dite des<br />
actions à effectuer : ce que l’on va faire, ce que l’on va réussir à faire, mais aussi ce que l’on<br />
ignore encore.<br />
La règ<strong>le</strong> des zéros<br />
Freinet<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet<br />
Le calcul avec <strong>le</strong>s jours<br />
Freinet<br />
Correction<br />
Provinces<br />
Calcul Mental<br />
Provinces<br />
Travail sur l’énoncé<br />
Provinces<br />
Rappels Ce<br />
que<br />
L’on a<br />
réussi<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Ce que<br />
L’on va<br />
faire<br />
Ce que<br />
L’on va<br />
Réussir<br />
A faire<br />
0 0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Tab<strong>le</strong>au 23 : Planifications<br />
0 0 0<br />
0<br />
Ce<br />
que<br />
L’on<br />
ignore<br />
Encore une fois, <strong>le</strong>s effectifs sont très faib<strong>le</strong>s. Mais la différence encore une fois rassemb<strong>le</strong><br />
des éléments convergents : <strong>le</strong>s enseignants de Freinet disent ce qui a été réussi ou ce qui<br />
va l’être.<br />
Ceci contribue à l’image positive du travail col<strong>le</strong>ctif qui caractérise <strong>le</strong>s modes d’interventions<br />
de l’enseignant à Freinet, image qui se construit progressivement, au travers de cette<br />
particularité, mais aussi au travers de la gestion de l’évaluation, de la responsabilisation<br />
de l’élève, de l’aide. Si nous ajoutons à cette caractéristique cel<strong>le</strong>s déjà soulignées plus<br />
haut, à savoir l’équilibre de ces interventions et de cel<strong>le</strong>s des élèves, l’absence d’évaluation<br />
immédiate en vrai/faux, l’intérêt porté au discours de l’élève (qu’il s’agisse de reformulations
ou d’injonctions à poursuivre) nous obtenons une description de ces modes d’intervention<br />
à l’oral qui peut contribuer effectivement à expliquer <strong>le</strong>s caractéristiques des modes de<br />
discours des élèves en mathématiques : la longueur des textes, des discours oraux, <strong>le</strong><br />
rapport à l’erreur que nous avions pu mettre en évidence.<br />
Tournons nous à présent vers <strong>le</strong>s modes d’intervention dans la classe, lors de séquences<br />
de travail col<strong>le</strong>ctif des élèves.<br />
3.6. Analyse des interventions des élèves durant <strong>le</strong>s séquences observées<br />
Pour analyser <strong>le</strong>s interventions des élèves, nous avons adopté une stratégie induite de cel<strong>le</strong><br />
que nous venons d’exposer pour analyser <strong>le</strong>s interventions du maître. Indépendamment<br />
des places, des rô<strong>le</strong>s respectifs dans la classe, certaines dimensions sont communes aux<br />
analyses des interventions du maître et de l’élève : la forme (interrogative, déclarative…)<br />
par exemp<strong>le</strong>. D’autres peuvent <strong>le</strong> semb<strong>le</strong>r moins naturel<strong>le</strong>ment, comme <strong>le</strong>s dimensions de<br />
planification, qui pourraient ne caractériser que <strong>le</strong>s interventions du maître. Néanmoins, nous<br />
avons décidé a priori de reproduire <strong>le</strong>s dimensions des interventions de l’enseignant pour<br />
analyser <strong>le</strong>s interventions de l’élève. Cette décision, d’ordre méthodologique, se comprend<br />
par <strong>le</strong>s résultats que nous avions exposés dans <strong>le</strong> précédent rapport : à l’éco<strong>le</strong> Freinet, nous<br />
avions pu constater, à certains moments, des positions d’élèves qui étaient des positions<br />
d’enseignant (voir <strong>le</strong> cas Hugo) . Ainsi, nous analysons <strong>le</strong>s interventions des élèves selon<br />
qu’el<strong>le</strong>s sont contributives aux objets d’étude (fournir des résultats, des méthodes etc.) mais<br />
aussi en ce qu’el<strong>le</strong>s peuvent être des réactions au discours d’un élève (et pourquoi pas<br />
du maître). Nous avons décidé d’examiner <strong>le</strong>s interventions des élèves sous cet ang<strong>le</strong>, en<br />
regardant par exemp<strong>le</strong> si un élève « rejette, dénonce… <strong>le</strong> discours d’un autre » ou encore<br />
s’il évalue l’énoncé d’un autre que lui.<br />
Cependant, ces dimensions communes ne peuvent suffire, ne serait-ce que parce que <strong>le</strong>s<br />
rô<strong>le</strong>s et positions des élèves ne sont pas cel<strong>le</strong>s du maître.<br />
– Les interventions de l’élève se distinguent de cel<strong>le</strong>s de l’enseignant tout d’abord<br />
parce qu’el<strong>le</strong>s peuvent être autorisées ou non.<br />
– El<strong>le</strong>s ne coïncident pas non plus parce que l’élève a une position qui l’amène à prendre<br />
en compte (la plupart du temps) <strong>le</strong>s injonctions de l’enseignant (à redire, à poursuivre<br />
etc.) ou <strong>le</strong>s questions col<strong>le</strong>ctives de l’enseignant. Nous avons en conséquence étudié<br />
<strong>le</strong>s dimensions correspondantes des réponses des élèves (modifie, poursuit, ou encore<br />
répond).<br />
–<br />
Enfin, nous avons supposé que <strong>le</strong>s différences de places entre élèves et enseignants<br />
pouvaient amener <strong>le</strong>s élèves à provoquer des interventions constitutives du rô<strong>le</strong> du maître<br />
(en particulier <strong>le</strong>s opérations de planification). Nous avons en conséquent constitué une<br />
dimension qui rend compte des questionnements de l’élève à l’enseignant (questions<br />
sur ce que l’on va faire, questions pour se voir fournir des éléments de savoir, des<br />
indices etc.).<br />
Toutes ces dimensions ne sont pas actualisées, loin de là, dans <strong>le</strong>s séquences observées.<br />
Nous présentons ici parfois des dimensions regroupées, pour la compréhension des<br />
tab<strong>le</strong>aux. En annexe figurent <strong>le</strong>s tab<strong>le</strong>aux détaillés.<br />
LAHANIER-REUTER D. ( 00 ), « Enseignement et apprentissages mathématiques », in REUTER Y.<br />
(dir), Rapport de Recherche Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire, Tome I, pp. - .<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
0<br />
3.6.1. Formes des interventions des élèves<br />
Nous regardons ici si <strong>le</strong>s interventions des élèves sont plutôt des questions, des ordres ou<br />
des déclarations. Il nous a semblé aussi intéressant de prendre en compte la continuité de<br />
la prise de paro<strong>le</strong>. Cel<strong>le</strong>-ci est possib<strong>le</strong> pour l’enseignant, peut-être l’est-el<strong>le</strong> moins pour<br />
l’élève. Pour chacun des tours de paro<strong>le</strong>, nous avons considéré que la paro<strong>le</strong> de l’élève était<br />
continue tant que deux interlocuteurs différents n’intervenaient pas.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Questions Ordres Déclarations Paro<strong>le</strong>s<br />
Continues<br />
La règ<strong>le</strong> des zéros<br />
Freinet ( %)<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet ( %)<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet ( %)<br />
Le calcul avec <strong>le</strong>s jours<br />
Freinet<br />
Correction<br />
Provinces<br />
Calcul Mental<br />
Provinces<br />
Travail sur l’énoncé<br />
Provinces<br />
0<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
( 0%)<br />
( %)<br />
( 0%)<br />
( %)<br />
Tab<strong>le</strong>au 24 : formes des interventions des élèves<br />
Nombre<br />
Tours de paro<strong>le</strong><br />
Durant <strong>le</strong>s séquences de recherche, où <strong>le</strong> travail des élèves n’est pas organisé de façon<br />
rituel<strong>le</strong>, nous re<strong>le</strong>vons une moindre continuité des paro<strong>le</strong>s des élèves dans la classe de<br />
Provinces. Il nous semb<strong>le</strong> au contraire que dans <strong>le</strong>s classes Freinet, un élève peut s’instaurer<br />
comme interlocuteur durab<strong>le</strong>ment. Nous soulignons éga<strong>le</strong>ment, malgré la faib<strong>le</strong>sse des<br />
effectifs, <strong>le</strong> fait qu’à Freinet, et à Freinet seu<strong>le</strong>ment, un élève puisse donner des ordres.<br />
(« Regarde, mais regarde !! »).<br />
3.6.2. Réactions d’un élève au discours d’un pair (ou exceptionnel<strong>le</strong>ment de<br />
l’enseignant)<br />
Regardons à présent si cette attitude peut aussi se caractériser par des réactions au discours<br />
des autres élèves qui la renforceraient.<br />
La règ<strong>le</strong> des zéros<br />
Freinet<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet<br />
Reformu<strong>le</strong><br />
Répète<br />
Injonctions<br />
A<br />
modifier<br />
Injonctions<br />
A<br />
poursuivre<br />
Injonctions<br />
A<br />
publier<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Évaluations
La recherche de Yasmina<br />
Freinet<br />
Le calcul avec <strong>le</strong>s jours<br />
Freinet<br />
Correction<br />
Provinces<br />
Calcul Mental<br />
Provinces<br />
Travail sur l’énoncé<br />
Provinces<br />
0 0<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
Tab<strong>le</strong>au 25 : Réactions d’élèves au discours d’autrui<br />
Les différences sont nettes. Les élèves de Freinet interviennent régulièrement sur <strong>le</strong>s discours<br />
de <strong>le</strong>urs pairs. Les pratiques langagières dans ces classes de mathématiques construisent<br />
un espace partagé, où <strong>le</strong>s dialogues se croisent. C’est bien en terme d’interactions col<strong>le</strong>ctives<br />
qu’il faut <strong>le</strong>s envisager et non en terme de dialogue « fermé » maître/élève.<br />
Cette caractéristique éclaire <strong>le</strong>s positions d’écriture que nous avions pu re<strong>le</strong>ver. Si <strong>le</strong>s<br />
élèves de Freinet s’adressent à <strong>le</strong>urs camarades, soit pour soutenir <strong>le</strong>urs discours, soit pour<br />
l’invalider ou <strong>le</strong> contester, ceci explique sans doute que <strong>le</strong> <strong>le</strong>cteur auquel ils s’adressent soit<br />
un pair, que <strong>le</strong>urs textes soient des textes « aidant » etc. Ceci explique éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>ur plus<br />
grande facilité à développer un discours argumentatif (voir Rapport I).<br />
Regardons à présent la façon dont <strong>le</strong>s élèves contribuent à l’objet d’étude.<br />
Comme dans <strong>le</strong> cas des analyses des interventions de l’enseignant, nous distinguons ce<br />
qui est de l’ordre de « fournir une réponse », qui désigne <strong>le</strong>s moments des interventions<br />
de l’élève où ce dernier réagit immédiatement à une question directe (« Athènes c’est la<br />
capita<strong>le</strong> de ? ») et « dire <strong>le</strong> résultat obtenu » qui désigne des moments où l’élève répond à<br />
une question du type « Qu’est-ce que tu as trouvé ? ».<br />
La règ<strong>le</strong> des zéros<br />
Freinet<br />
La recherche de<br />
Yasmina<br />
Freinet<br />
La recherche de<br />
Yasmina<br />
Freinet<br />
Le calcul avec <strong>le</strong>s<br />
jours<br />
Freinet<br />
Correction<br />
Provinces<br />
Fournit<br />
Réponse<br />
Fournit<br />
Éléments de<br />
Technique<br />
Ou de<br />
méthode<br />
Souligne<br />
L’importance<br />
Fournit<br />
Du<br />
Vocabulaire<br />
Ou<br />
Des codes<br />
0 0 0 0<br />
0<br />
Fournit<br />
indices<br />
0 0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
« Dit » signifie ici élabore, participe à la construction de l’énoncé et non pas « lit ».<br />
Dit<br />
<strong>le</strong><br />
résultat<br />
obtenu<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Dit 16<br />
l’énoncé
Calcul Mental<br />
Provinces<br />
Travail sur l’énoncé<br />
Provinces<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
Tab<strong>le</strong>au 26 : Contributions des élèves à l’objet d’étude<br />
La catégorie « fournit du vocabulaire ou des codes » regroupait des moments d’intervention<br />
spécifiques du maître, au cours desquels il donne <strong>le</strong> vocabulaire adéquat, <strong>le</strong>s codes en<br />
usage. Cette catégorie, lorsque nous la faisons fonctionner pour l’analyse des élèves pose<br />
un problème : doit-on y faire figurer <strong>le</strong>s moments des interventions des élèves au cours<br />
desquel<strong>le</strong>s l’élève invente une représentation symbolique, une désignation, même si cette<br />
dernière n’est pas culturel<strong>le</strong>ment partagée ? Ou devons-nous conserver la même définition<br />
plus étroite pour cette analyse et cette discipline particulière ? La question n’est pas simp<strong>le</strong>,<br />
car el<strong>le</strong> touche à l’interprétation des pratiques disciplinaires. En effet, <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong><br />
primaire peuvent être chargés d’exposés dans d’autres disciplines que <strong>le</strong>s mathématiques<br />
et être amenés, par une recherche documentaire, à « fournir » des termes techniques<br />
ou des codages utilisés ail<strong>le</strong>urs. Or, en mathématiques, il nous semb<strong>le</strong> que ce type de<br />
recherches documentaires ne soit pas en usage. Par conséquent la décision à prendre n’est<br />
pas simp<strong>le</strong>. Pour l’instant, nous ne pouvons que re<strong>le</strong>ver que, quel<strong>le</strong> que soit la définition que<br />
nous adoptons pour cette catégorie (vocabulaire, code reconnus ail<strong>le</strong>urs/ vocabulaire, code<br />
inventés à l’intérieur de la classe) el<strong>le</strong> n’est pas ici représentée.<br />
Quelques remarques sur ce tab<strong>le</strong>au : la différence entre des séquences peut encore se<br />
lire dans <strong>le</strong>s poids respectifs des dimensions « fournir une réponse » et « dire <strong>le</strong> résultat<br />
obtenu ». Au cours de certaines séquences l’élaboration de l’objet d’étude s’effectue<br />
majoritairement dans un travail col<strong>le</strong>ctif, à l’oral, tandis que dans d’autres, des moments de<br />
travail individuel sont ensuite col<strong>le</strong>ctivisés. Une deuxième remarque est la présence (rare)<br />
de prises de position professora<strong>le</strong> par des élèves : souligner l’importance d’un résultat ou<br />
d’une méthode revient souvent à l’enseignant. Or, ici certains élèves adoptent cette position<br />
« el<strong>le</strong> est bien ta méthode, el<strong>le</strong> permet d’al<strong>le</strong>r vite ». De même, fournir des indices à celui qui<br />
est en train de faire est la marque d’un enseignant.<br />
Passons maintenant aux réponses de l’élève face aux réactions, à son discours de<br />
l’enseignant ou des autres élèves<br />
La règ<strong>le</strong> des<br />
zéros<br />
Freinet<br />
Reformulations<br />
Répétitions<br />
Injonctions<br />
A<br />
modifier<br />
Injonctions<br />
A<br />
poursuivre<br />
Injonctions<br />
A<br />
publier<br />
Élèves 0<br />
Enseignant<br />
Accepte ou refuse<br />
explicitement<br />
0<br />
0%<br />
Modifie<br />
%<br />
Poursuit<br />
0<br />
0%<br />
Publie<br />
%<br />
Évaluations<br />
Donne avis<br />
0<br />
0%
La recherche de<br />
Yasmina<br />
Freinet<br />
La recherche de<br />
Yasmina<br />
Freinet<br />
Le calcul avec <strong>le</strong>s<br />
jours<br />
Freinet<br />
Correction<br />
Provinces<br />
Calcul Mental<br />
Provinces<br />
Travail sur<br />
l’énoncé<br />
Provinces<br />
Élève 0<br />
Enseignant 0 0<br />
Accepte ou refuse<br />
explicitement<br />
0<br />
0%<br />
Modifie<br />
Élève 0 0<br />
Enseignant<br />
Élève<br />
Accepte ou refuse<br />
explicitement<br />
%<br />
%<br />
Modifie<br />
%<br />
Poursuit<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
%<br />
Poursuit<br />
Enseignant 0 0<br />
Accepte ou refuse<br />
explicitement<br />
0<br />
0%<br />
Modifie<br />
%<br />
%<br />
Poursuit<br />
00%<br />
Publie<br />
00%<br />
Publie<br />
0%<br />
Publie<br />
00%<br />
Élève 0 0 0 0<br />
Enseignant 0<br />
Accepte ou refuse<br />
explicitement<br />
0<br />
0%<br />
Modifie<br />
%<br />
Poursuit<br />
Élèves 0 0<br />
Enseignant<br />
Accepte ou refuse<br />
explicitement<br />
0<br />
0%<br />
Modifie<br />
0%<br />
%<br />
Poursuit<br />
00%<br />
Élève 0 0 0<br />
Enseignant 0<br />
Accepte ou refuse<br />
explicitement<br />
0<br />
0%<br />
Modifie<br />
%<br />
Poursuit<br />
%<br />
Publie<br />
00%<br />
Publie<br />
0<br />
0%<br />
Publie<br />
Tab<strong>le</strong>au 27 : réponses des élèves aux réactions de l’enseignant et des autres élèves<br />
00%<br />
Donne avis<br />
%<br />
Donne avis<br />
0%<br />
Donne avis<br />
0%<br />
Donne avis<br />
0%<br />
Donne avis<br />
%<br />
Donne avis<br />
0<br />
0%<br />
Ce tab<strong>le</strong>au permet aussi, malgré la comp<strong>le</strong>xité de sa <strong>le</strong>cture, de faire émerger certains<br />
phénomènes et de relativiser éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s résultats avancés.
Si nous commençons par <strong>le</strong>s différences, nous voyons qu’à l’éco<strong>le</strong> Freinet, <strong>le</strong> taux de<br />
modifications effectives des discours est bien moindre que celui re<strong>le</strong>vé à Provinces. Les<br />
injonctions du maître, dans cette classe, à reprendre, modifier un discours jugé inaudib<strong>le</strong> ou<br />
inexact sont suivies d’effet. En revanche, à Freinet, ce l’est dans une moindre mesure. En<br />
conséquence, nous pouvons nous interroger sur <strong>le</strong> fait que des discours erronés puissent<br />
ne pas être repris, corrigés, amendés immédiatement. La liberté de paro<strong>le</strong>, la participation<br />
col<strong>le</strong>ctive, <strong>le</strong> statut de l’erreur non discriminante sont ici à opposer à un mode d’enseignement<br />
très « dirigiste », qui établit très nettement des positions différentes, mais où <strong>le</strong>s élèves sont<br />
« obligés » de rectifier <strong>le</strong>urs erreurs.<br />
De même, <strong>le</strong>s deux modes d’enseignement peuvent aussi être opposés par <strong>le</strong> pourcentage<br />
de paro<strong>le</strong>s d’élèves « donnant <strong>le</strong>ur avis » lorsque <strong>le</strong> maître ou un élève évalue. Cette fois,<br />
c’est à Freinet que <strong>le</strong>s pourcentages de réponse sont conséquents : <strong>le</strong>s élèves donnent un<br />
avis sur une proposition, tandis qu’à Provinces, malgré des sollicitations, ils ne <strong>le</strong> font pas.<br />
Cette dernière différence n’est pas surprenante, et complète l’opposition remarquée.<br />
4. En guise de conclusion<br />
Nous dégageons trois conclusions :<br />
– la cohérence des types de pratiques langagières dans la classe de mathématiques<br />
à Freinet,<br />
– l’adéquation entre <strong>le</strong>s caractéristiques re<strong>le</strong>vées de ces pratiques et cel<strong>le</strong>s des<br />
compétences et attitudes des élèves,<br />
–<br />
la cohérence des résultats et des descriptions obtenues avec <strong>le</strong>s résultats et <strong>le</strong>s<br />
descriptions des travaux des membres de l’équipe travaillant dans d’autres disciplines<br />
scolaires.<br />
4.1. La cohérence des pratiques langagières dans <strong>le</strong>s classes de<br />
mathématiques<br />
Malgré <strong>le</strong>s différences qui ne peuvent être effacées entre <strong>le</strong>s maîtres ni entre des élèves<br />
de niveaux scolaires distincts, il semb<strong>le</strong> qu’à l’éco<strong>le</strong> Freinet l’analyse des pratiques<br />
langagières dans <strong>le</strong>s classes de mathématiques nous conduisent à iso<strong>le</strong>r des modes de<br />
fonctionnement, des usages relativement stab<strong>le</strong>s et originaux. Du point de vue des modes de<br />
fonctionnement de l’écrit, nous rappelons que <strong>le</strong>s écrits individuels produits dans <strong>le</strong>s classes<br />
de mathématiques sont des écrits inscrits dans la continuité du travail de l’élève, signifiants<br />
pour ces derniers. Du point de vue des usages du langage à l’oral dans la classe, nous<br />
avons pu mettre en évidence <strong>le</strong>s caractéristiques suivantes : <strong>le</strong>s prises de paro<strong>le</strong> sont des<br />
prises de paro<strong>le</strong> partagées (même si <strong>le</strong> maître par<strong>le</strong> davantage parfois). Les interventions<br />
des élèves ne se limitent pas à des réponses à des questions posées par <strong>le</strong> maître mais sont<br />
des interventions au cours desquel<strong>le</strong>s un même élève peut dérou<strong>le</strong>r son propre discours,<br />
en adoptant des positions différentes : tour à tour il peut être exposant et dans ce cas<br />
soumis aux interrogations, aux propositions de reformulations etc. des autres acteurs de la<br />
classe, ou il peut être « critique » et dans ce cas soumettre l’autre à des interrogations, des<br />
reformulations, des évaluations etc. De même, <strong>le</strong>s interventions du maître sont particularisées<br />
par <strong>le</strong> fait qu’el<strong>le</strong>s ne sont pas uniquement des questions factuel<strong>le</strong>s ou de recherche, mais<br />
surtout par <strong>le</strong> fait qu’el<strong>le</strong>s ne sont pas stigmatisantes puisque la dimension évaluative est<br />
fortement minorée par d’autres dimensions et qu’au contraire, l’enseignant dans <strong>le</strong>s classes<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
de Freinet insiste sur <strong>le</strong>s réussites accomplies. El<strong>le</strong>s contribuent aussi à forger <strong>le</strong>s relations<br />
entre élèves en organisant l’aide, en organisant la construction col<strong>le</strong>ctive d’énoncés etc.<br />
Enfin, <strong>le</strong> maître peut choisir de s’effacer, parfois temporairement, pour laisser l’espace du<br />
dialogue aux élèves.<br />
Pour <strong>le</strong> dire autrement, <strong>le</strong>s éléments de topogénèse – au sens de Y. Chevallard – sont<br />
mis en œuvre de façon tout à fait spécifique dans ces classes : <strong>le</strong>s positions d’enseignant<br />
sont accessib<strong>le</strong>s et volontairement dévolues à quelques élèves (sans qu’il y ait abandon<br />
de la part du maître de sa position). La position de l’enseignant lors de l’étude est cel<strong>le</strong><br />
d’un contributeur particulier, non pas cel<strong>le</strong> du maître omniscient, mais celui qui gère <strong>le</strong>s<br />
échanges (parfois sévèrement), <strong>le</strong>s suscite et <strong>le</strong>s encourage. Nous voyons aussi comment la<br />
chronogénèse s’effectue de façon singulière dans cette classe. L’une de ses caractéristiques<br />
est la continuité du travail de l’élève, fortement opposée au morcel<strong>le</strong>ment, à l’inclusion dans<br />
un temps très strict et délimité que nous pouvons souligner ail<strong>le</strong>urs. Cette relation au temps<br />
est encore confortée par <strong>le</strong> fait que la rapidité d’exécution n’est pas un critère d’évaluation<br />
du travail de l’élève, mais un objectif ou une légitimation de ce travail : on a <strong>le</strong> droit de faire<br />
<strong>le</strong>ntement, dans un temps sans limite précise et inéluctab<strong>le</strong> pour se donner et trouver <strong>le</strong>s<br />
moyens de faire plus vite. Ce processus de chronogénèse prend éga<strong>le</strong>ment une forme<br />
particulière, puisque l’étude col<strong>le</strong>ctive prend appui sur une question individuel<strong>le</strong>, soutenue<br />
par l’enseignant.<br />
Ainsi <strong>le</strong>s pratiques langagières dans <strong>le</strong>s classes de mathématiques à l’éco<strong>le</strong> Freinet<br />
présentent des caractéristiques communes, qui sont des éléments importants du dispositif<br />
pédagogique.<br />
4.2. L’adéquation aux analyses des compétences et des attitudes des élèves de<br />
cet établissement<br />
La recherche que nous avons entreprise supposait d’explorer <strong>le</strong>s compétences et <strong>le</strong>s attitudes<br />
des élèves de Freinet lorsque ces derniers étaient confrontés à des tâches mathématiques.<br />
Nous avions mené des entretiens (avec Anne-Marie Jovenet), puis nous avons analysé<br />
des productions d’élèves écrites de Freinet en <strong>le</strong>s comparant systématiquement à cel<strong>le</strong>s<br />
d’autres élèves. Il est alors apparu que <strong>le</strong>s connaissances mathématiques mises en œuvre<br />
des élèves Freinet sont très comparab<strong>le</strong>s à cel<strong>le</strong>s des élèves d’autres établissements<br />
scolaires, avec des caractéristiques intéressantes : la plupart d’entre eux montrent des<br />
compétences argumentatives et explicatives bien supérieures aux autres à l’oral. A l’écrit,<br />
nous avons souligné la longueur des textes écrits ainsi que la construction du <strong>le</strong>cteur en<br />
tant que « pair ». Dans toutes ces situations, ora<strong>le</strong>s et écrites, <strong>le</strong> rapport à l’erreur que nous<br />
avons pu analyser est un rapport particulier : l’erreur est rectifiab<strong>le</strong>, el<strong>le</strong> est un incident<br />
normal dont l’identification ne provoque ni blocage ni panique. En revanche, ces élèves sont<br />
davantage en difficulté lorsqu’ils sont confrontés à des tâches requerrant des <strong>le</strong>ctures de<br />
codes mathématiques ou des connaissances de termes techniques.<br />
Ces résultats peuvent être expliqués tout d’abord par la diversité des objets étudiés<br />
col<strong>le</strong>ctivement et la part que prend l’enseignant pour construire cette étude. Les exigences<br />
que pose <strong>le</strong> maître (trouver des méthodes pour al<strong>le</strong>r plus vite, dépasser <strong>le</strong>s applications<br />
immédiates et repousser <strong>le</strong>s limites de ces applications…) et dont il assume souvent la<br />
responsabilité – au même titre que certaines reformulations – peuvent expliquer que <strong>le</strong>s<br />
connaissances construites par <strong>le</strong>s élèves Freinet sont comparab<strong>le</strong>s aux autres. De plus,<br />
CHEVALLARD, Y., , La transposition didactique, La Pensée Sauvage, Grenob<strong>le</strong>.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
mais il s’agit là seu<strong>le</strong>ment d’une hypothèse, la continuité de l’étude, l’écou<strong>le</strong>ment du temps<br />
didactique, nous paraissent pouvoir peser largement de façon positive sur l’élaboration<br />
des savoirs et savoir-faire. Les compétences argumentatives et explicatives développées<br />
par <strong>le</strong>s élèves sont, selon nous, contributives des pratiques langagières que nous venons<br />
d’explorer. Néanmoins, l’absence de confrontation directe à des codes « culturel<strong>le</strong>ment »<br />
admis ou l’absence de références à des ressources, des fichiers de travaux existant ail<strong>le</strong>urs<br />
peut expliquer certaines défaillances : nous avancerions que dans d’autres disciplines<br />
scolaires, <strong>le</strong>s élèves de Freinet peuvent se constituer ou consulter des documents qui<br />
informent, renseignent, ou qui sont des traces de résolution de problèmes tel<strong>le</strong> qu’ils ont<br />
pu être effectués ail<strong>le</strong>urs, par d’autres… En mathématiques, l’accès à des ouvrages de<br />
vulgarisation est limité. Et <strong>le</strong> monde clos de la classe peut parfois empêcher la rencontre<br />
avec des questionnements, des solutions que d’autres ont déjà expérimentés.<br />
4.3. La cohérence entre <strong>le</strong>s résultats apportés et ceux des autres membres de<br />
l’équipe<br />
Ces résultats sont convergents avec ceux des autres études menées dans <strong>le</strong> cadre de la<br />
recherche. Dans d’autres disciplines scolaires, des caractéristiques communes sont re<strong>le</strong>vées :<br />
la longueur des textes produits par <strong>le</strong>s élèves (Y. Reuter, R. Hassan), <strong>le</strong>s compétences<br />
argumentatives et explicatives observées dans des situations de classe et expérimenta<strong>le</strong>s<br />
(C. Cohen-Azria, I. Delcambre, M. Pagoni)… L’étude des évaluations nationa<strong>le</strong>s menée<br />
par R. Hassan confirme que <strong>le</strong>s connaissances des élèves de Freinet en mathématiques<br />
sont comparab<strong>le</strong>s à cel<strong>le</strong>s des autres éco<strong>le</strong>s du secteur, voir sur certains domaines – la<br />
géométrie – <strong>le</strong>s surpassent. Nous rapprochons éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s défaillances constatées sur<br />
la connaissance de certains termes techniques et de certains codes géométriques des<br />
résultats avancés par B. Daunay , bien que <strong>le</strong>s liens soient encore à réfléchir. En ce qui<br />
concerne <strong>le</strong> rapport à l’éco<strong>le</strong>, au savoir des élèves de cet établissement que nous lisons au<br />
travers de <strong>le</strong>urs postures dans la classe, de <strong>le</strong>ur mode d’intervention, de <strong>le</strong>ur construction<br />
de l’erreur, nos résultats convergent avec ceux d’Anne-Marie Jovenet.<br />
Quant aux modes de fonctionnement des maîtres, là encore nos analyses trouvent un<br />
écho avec cel<strong>le</strong>s des autres membres de l’équipe : la gestion de la paro<strong>le</strong>, de l’étude est<br />
sans doute particularisée par la discipline dans laquel<strong>le</strong> ces observations s’inscrivent, mais<br />
nous retrouvons <strong>le</strong> respect de la paro<strong>le</strong> de l’autre, la construction de l’aide col<strong>le</strong>ctive (nous<br />
pensons ici aux situations de dictée), l’absence d’évaluation négative immédiate.<br />
Par conséquent, ce dispositif pédagogique particulier a des effets confirmés sur <strong>le</strong>s<br />
apprentissages réalisés, sur <strong>le</strong>s façons dont <strong>le</strong>s enfants deviennent des élèves, sur <strong>le</strong>s<br />
façons de vivre d’une classe.<br />
Références bibliographiques<br />
Brossard M. ( ), « Activités métalinguistiques et situations scolaires », Repères, n° ,<br />
INRP, Paris.<br />
Brousseau G. ( ), « Le contrat didactique : <strong>le</strong> milieu », Recherches en didactique des<br />
Nous n’avons pas eu <strong>le</strong> temps matériel d’étudier de façon détaillée l’orthographe des productions des<br />
élèves Freinet. Mais <strong>le</strong> nombre de mots défaillants est en moyenne supérieur à Freinet que dans <strong>le</strong>s autres<br />
établissements, résultat partiel qui confirme <strong>le</strong>s siens.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
mathématiques, vol / , La Pensée Sauvage, p. 0 - .<br />
Chevallard Y. ( ), La transposition didactique, La Pensée Sauvage, Grenob<strong>le</strong><br />
Duval R. ( 00 ), « Les conditions cognitives de l’apprentissage de la géométrie :<br />
développement de la visualisation, différenciation des raisonnements et coordination de <strong>le</strong>ur<br />
fonctionnements », Anna<strong>le</strong>s de didactique et de sciences cognitives, Vol 0, p. - .<br />
Goody J. ( ), La raison graphique, Éditions de Minuit, Paris<br />
Lahanier-Reuter D ( 00 ), « Enseignement et apprentissages mathématiques », in Reuter<br />
Y. (dir), Rapport de Recherche Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire,<br />
Tome I, p. - .<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Annexes<br />
Annexe 1 : Graphe implicatif des relations entre items décrivant <strong>le</strong>s positions<br />
d’écriture en géométrie<br />
Graphe 1 : Relations implicatives entre items<br />
Annexe 2 : Énoncés de la séquence « corrections »<br />
000+ 00+ 0+ = ; 000+ 00+ = ; 000+ = ; 000+ = ; 000+ 00+ = ;<br />
000+ 00+ = ;<br />
000+ 000= ; 00+ 000= ; + 000= ; + 0= ; + 00= ; + 000= ;<br />
0 + 0= ; 0 + 00= ; 0 + 000= ;<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Annexe 3 : Tab<strong>le</strong>aux supplémentaires<br />
La règ<strong>le</strong> des zéros<br />
Freinet<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet<br />
Le calcul avec <strong>le</strong>s jours<br />
Freinet<br />
Correction<br />
Provinces<br />
Calcul Mental<br />
Provinces<br />
Travail sur l’énoncé<br />
Provinces<br />
Reformulations<br />
Répétitions<br />
0<br />
0<br />
Reformulations Répétitions<br />
Tab<strong>le</strong>au 27 : Répartition des reformulations et des répétitions dans <strong>le</strong>s interventions de l’enseignant<br />
La règ<strong>le</strong> des zéros<br />
Freinet<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet<br />
La recherche de Yasmina<br />
Freinet<br />
Le calcul avec <strong>le</strong>s jours<br />
Freinet<br />
Correction<br />
Provinces<br />
Calcul Mental<br />
Provinces<br />
Travail sur l’énoncé<br />
Provinces<br />
Contributions directes Réactions au discours de l’élève<br />
0<br />
0<br />
Tab<strong>le</strong>au 28 : Confrontation des nombres de contributions directes et des interventions<br />
en réaction au discours d’un élève<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Regards sur <strong>le</strong>s contenus de savoirs en sciences<br />
à partir de productions écrites suscitées<br />
0<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Cora COHEN-AZRIA<br />
Maître de conférences<br />
Université de Lil<strong>le</strong> III<br />
Équipe THEODILE<br />
Ce chapitre, consacré à l’apprentissage, fait suite à une première recherche (Cohen-Azria,<br />
00 ) qui concernait l’enseignement des sciences.<br />
Dans ce premier travail, j’avais mis en évidence certaines spécificités de l’enseignement<br />
des sciences dans l’établissement Hélène Boucher à l’aide d’une comparaison avec<br />
d’autres éco<strong>le</strong>s s’inscrivant dans des pédagogies différentes. Les places relatives des sujets<br />
apprenants, des enseignants et des savoirs s’avéraient être un nœud dans la structure<br />
pédagogique. Ainsi, j’avais décrit des formes et des natures de savoirs différenciées existant<br />
dans <strong>le</strong>s classes de sciences en fonction des pédagogies mises en œuvre. Ce travail avait<br />
pu être réalisé principa<strong>le</strong>ment à partir d’entretiens avec <strong>le</strong>s élèves et <strong>le</strong>s enseignants. J’avais<br />
éga<strong>le</strong>ment recueilli des données écrites liées au quotidien des classes (cahiers,…).<br />
Ce travail s’inscrit dans la continuité et la complémentarité. En effet, <strong>le</strong>s données recueillies<br />
ne font pas partie du quotidien des classes. Ce sont des questionnaires que j’ai réalisé à<br />
cet effet. Les productions sont donc suscitées par <strong>le</strong> chercheur et non par <strong>le</strong>s maîtres. Ils<br />
permettront de travail<strong>le</strong>r sur l’acquisition de connaissances, de démarches et de savoirfaire.<br />
1. Présentation de la recherche<br />
Il sera question ici d’un travail basé sur <strong>le</strong>s contenus de savoirs en sciences à partir<br />
de productions écrites suscitées. J’ai fait passer des questionnaires sur différentes<br />
thématiques dans <strong>le</strong>s classes de CE , CM et CM de l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher et d’une<br />
éco<strong>le</strong> similaire du point de vue sociologique. Les maîtres de cette dernière éco<strong>le</strong> ne se<br />
revendiquent d’aucun courant pédagogique. El<strong>le</strong> sera donc nommée dans ce texte « éco<strong>le</strong><br />
traditionnel<strong>le</strong> ». Évidemment cette appellation n’est qu’une étiquette facilitant l’écriture, el<strong>le</strong><br />
n’est porteuse, à mes yeux, d’aucune connotation. Cette comparaison permet de voir s’il<br />
existe des ressemblances et des différences entre <strong>le</strong>s productions des élèves soumis à des<br />
pédagogies contrastées. L’éco<strong>le</strong> qui pourra par la suite être appelée « éco<strong>le</strong> Freinet » n’est<br />
pas la représentante de la pédagogie Freinet. Les résultats ne pourront pas être généralisés<br />
mécaniquement aux classes « Freinet » et aux classes « traditionnel<strong>le</strong>s ».<br />
Seront ici exploités <strong>le</strong>s questionnaires sur :<br />
– <strong>le</strong> volcanisme (n =<br />
00 - 00 et 00 - 00<br />
) – CE , CM et CM durant <strong>le</strong>s années scolaires 00 - 00 ,<br />
–<br />
la technologie (n =<br />
00 - 00 .<br />
) – CM et CM durant <strong>le</strong>s années scolaires 00 - 00 et<br />
Pour ne pas alourdir <strong>le</strong> texte, des formu<strong>le</strong>s tel<strong>le</strong>s que « <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet », « <strong>le</strong>s élèves de<br />
Freinet »… pourront être utilisées.
Il est intéressant ici de comparer <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s de façon généra<strong>le</strong> ainsi que <strong>le</strong>s niveaux<br />
scolaires. Un regard sera éga<strong>le</strong>ment porté sur <strong>le</strong>s questions d’évolution entre <strong>le</strong>s classes<br />
dans chaque établissement. Ce sont <strong>le</strong>s mêmes élèves qui sont suivis durant <strong>le</strong>ur cursus .<br />
Ces questionnaires permettent d’étudier des connaissances liées aux contenus de savoirs<br />
en jeu, mais aussi des savoirs plus transversaux. Faire varier <strong>le</strong>s thématiques permet donc<br />
de travail<strong>le</strong>r sur des types de savoirs généralisab<strong>le</strong>s et spécifiques.<br />
Les catégories permettant d’étudier <strong>le</strong>s réponses des élèves ont été construites après <strong>le</strong>cture<br />
des questionnaires. Les données ont été traitées à l’aide du logiciel « SPHINX ».<br />
2. Analyse des questionnaires sur <strong>le</strong> volcanisme<br />
Ces données concernent <strong>le</strong>s questionnaires distribués durant <strong>le</strong>s années scolaires<br />
00 - 00 , 00 - 00 et 00 - 00 .<br />
Éco<strong>le</strong>s / années 2003-2004 2004-2005 2005-2006 TOTAL<br />
CE2 traditionnel<strong>le</strong> 79<br />
Freinet 0 63<br />
CM1 traditionnel<strong>le</strong> 58<br />
Freinet 0 0 61<br />
CM2 traditionnel<strong>le</strong> 0 57<br />
Freinet 59<br />
TOTAL 119 126 132 377<br />
Doc 1 : Détail des nombres de questionnaires selon <strong>le</strong>s sous-populations<br />
Les données vont être traitées ici d’une part, à partir de la population généra<strong>le</strong>, et d’autre<br />
part en interrogeant <strong>le</strong>s spécificités des différents niveaux scolaires. Les ressemblances<br />
et <strong>le</strong>s différences sont étudiées. Il est à noter que <strong>le</strong>s questionnaires remplis lors de la<br />
dernière année de passation à l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> sont à manipu<strong>le</strong>r avec une extrême<br />
précaution. En effet ils révè<strong>le</strong>nt une uniformisation des réponses expliquée par l’organisation<br />
de cours avant la distribution des questionnaires ou de séances de corrections dans <strong>le</strong><br />
cadre de la classe. Ces suppositions m’ont été confirmées lors d’entretiens informels avec<br />
<strong>le</strong>s enseignants concernés. Mettre de côté de façon définitive <strong>le</strong>s données de cette dernière<br />
année aurait été une solution. Mais faire ce choix aurait masqué toute une série de résultats<br />
ou de nuances qui apparaissent clairement ou en creux dans la comparaison avec cette<br />
sous-population particulière. J’y reviendrai au cours de la présentation des résultats et plus<br />
tard dans l’analyse (cf. partie 2.10).<br />
Tous <strong>le</strong>s éléments d’analyse ne sont pas présentés ici. Ils seront précisés au fur et à mesure.<br />
Seuls <strong>le</strong>s grands axes figurent dans cette première partie.<br />
Des dessins scientifiques ont été demandés. J’ai travaillé à partir de :<br />
–<br />
–<br />
–<br />
<strong>le</strong>urs contenus scientifiques,<br />
<strong>le</strong>urs types d’annotation,<br />
ainsi que du nombre d’annotation.<br />
Pour <strong>le</strong>s écrits des élèves concernant <strong>le</strong> fonctionnement du volcan, j’ai réalisé une typologie<br />
selon qu’ils faisaient appel :<br />
–<br />
–<br />
aux éléments visib<strong>le</strong>s (lave, éruption…),<br />
aux éléments invisib<strong>le</strong>s (chambre magmatique,…),<br />
Des variations peuvent exister (changements d’éco<strong>le</strong>, absences <strong>le</strong> jour du travail sur <strong>le</strong><br />
questionnaire,…).<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
– aux causes de l’éruption,<br />
– aux conséquences de l’éruption.<br />
Ces critères permettent d’observer deux positionnements dans l’écriture : l’un lié à un<br />
temps fixe (description de l’objet d’étude) et l’autre lié à un phénomène dynamique et<br />
chronologique.<br />
Les élèves ont été amenés à écrire sur <strong>le</strong>s recherches possib<strong>le</strong>s autour du volcanisme<br />
aujourd’hui. J’ai classé <strong>le</strong>s réponses selon la mise en évidence de :<br />
–<br />
–<br />
–<br />
recherches d’explication globa<strong>le</strong> (comment fonctionne <strong>le</strong> volcan ?) ;<br />
recherches d’indicateurs spécifiques (d’où vient la lave ?…) ;<br />
recherches liées à des observations (recherches d’échantillon : « lave séchée »…).<br />
J’ai recensé éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s sources citées par <strong>le</strong>s élèves pour chercher des informations<br />
complémentaires sur <strong>le</strong>s volcans.<br />
D’une manière généra<strong>le</strong> dans chaque questionnaire, j’ai compté <strong>le</strong> nombre de phrases<br />
complètes, <strong>le</strong> nombre de formu<strong>le</strong>s pertinentes (autres que des phrases : ex : où peux-tu<br />
trouver des informations ? dans des livres).<br />
2.1. Dessins, annotations, explications schématisées<br />
Si tous <strong>le</strong>s élèves réalisent <strong>le</strong> dessin d’un volcan, il n’est pas systématiquement annoté<br />
malgré la consigne. D’une manière généra<strong>le</strong> un quart des élèves se contente de dessiner<br />
(moins d’un quart à l’éco<strong>le</strong> Freinet, mais plus d’un quart dans l’autre éco<strong>le</strong>). Les annotations<br />
sont plus souvent présentes, mais aussi plus nombreuses dans <strong>le</strong>s productions issues de<br />
l’éco<strong>le</strong> Freinet. Cela peut s’observer à partir des moyennes du nombre de mots utilisés pour<br />
accompagner <strong>le</strong>s dessins (cf. doc n° ), mais aussi parce qu’au delà de mots, la population<br />
de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> se trouve de moins en moins représentée en comparaison avec<br />
cel<strong>le</strong> de l’éco<strong>le</strong> Freinet.<br />
Annotations<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
Nombre de mots<br />
Freinet .<br />
Traditionnel<strong>le</strong> .<br />
TOTAL 3.86<br />
Doc 2 : Moyennes du nombre de mots utilisés par <strong>le</strong>s élèves - tous niveaux (3 années)4<br />
|t| s à .0 .<br />
Les va<strong>le</strong>urs du tab<strong>le</strong>au sont <strong>le</strong>s moyennes calculées sans tenir compte des non-réponses.<br />
Ces résultats apparaissent de manière beaucoup plus tranchée si on fait abstraction de la<br />
dernière année. Au sein de la sous-population basée sur <strong>le</strong>s deux premières années, <strong>le</strong>s<br />
élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet utilisent deux fois plus de mots dans <strong>le</strong>urs annotations ( . ) que<br />
<strong>le</strong>urs camarades de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> ( . ) . L’écart est ici plus marqué. Lorsque <strong>le</strong>s<br />
enseignants de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> cadrent cette activité ils ne permettent pas de comb<strong>le</strong>r<br />
l’écart entre <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s, ils <strong>le</strong> réduisent.<br />
Sur <strong>le</strong>s trois années, l’observation des différents niveaux scolaires montre qu’en CM <strong>le</strong>s<br />
différences sont <strong>le</strong>s plus significatives. Les élèves de CM issus de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong><br />
Les artic<strong>le</strong>s ne sont pas comptés.<br />
À partir de maintenant, dans <strong>le</strong>s tab<strong>le</strong>aux (d’effectifs ou de moyennes), <strong>le</strong>s nombres soulignés sont<br />
ceux qui portent <strong>le</strong>s différences significatives.<br />
Moyennes du nombre de mots utilisés.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
laissent plus souvent <strong>le</strong>urs dessins sans annotations et lorsqu’ils <strong>le</strong>s annotent ils utilisent,<br />
en moyenne, moins de mots que <strong>le</strong>s élèves de Freinet (cf. doc n° et n° ).<br />
Annotations<br />
Absence Présence TOTAL<br />
Éco<strong>le</strong>s – classes de CM1 d’annotations d’annotations<br />
Freinet 61<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 58<br />
TOTAL 22 97 119<br />
Doc 3 : Présence/ absence d’annotations dans <strong>le</strong>s classes de CM1 (3 années).<br />
La dépendance est significative. chi2 = 6,22, s à .01.<br />
Annotations<br />
Éco<strong>le</strong>s – classes de CM1<br />
Nombre de mots<br />
Freinet .0<br />
Traditionnel<strong>le</strong> .<br />
TOTAL 3.52<br />
Doc 4 : Moyennes du nombre de mots utilisés par <strong>le</strong>s élèves de CM1 dans <strong>le</strong>s annotations (3 années)<br />
|t| s à .0 .<br />
Les va<strong>le</strong>urs du tab<strong>le</strong>au sont <strong>le</strong>s moyennes calculées sans tenir compte des non-réponses.<br />
Si on continue d’étudier cette situation en terme d’évolution durant <strong>le</strong> cursus, il existe une<br />
évolution généra<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s vers une utilisation de plus de mots dans <strong>le</strong>s<br />
annotations. Les élèves de CM produisent en général plus de mots que <strong>le</strong>s élèves de CM .<br />
Mais, à ce niveau scolaire l’écart se creuse entre <strong>le</strong>s deux établissements.<br />
Annotations<br />
Éco<strong>le</strong>s – classes de CM2<br />
Nombre de mots<br />
Freinet .<br />
Traditionnel<strong>le</strong> .<br />
TOTAL 4.78<br />
Doc 5 : Moyennes du nombre de mots utilisés par <strong>le</strong>s élèves de CM2 dans <strong>le</strong>s annotations (3 années)<br />
|t| s à .0 .<br />
Les va<strong>le</strong>urs du tab<strong>le</strong>au sont <strong>le</strong>s moyennes calculées sans tenir compte des non-réponses.<br />
Dans la consigne, il est demandé aux élèves d’accompagner <strong>le</strong>urs dessins d’annotations.<br />
Par contre il n’est pas précisé de faire appel ou non à un autre système d’explication.<br />
L’analyse des productions montre que certains élèves font spontanément <strong>le</strong> choix d’utiliser<br />
une ou plusieurs cou<strong>le</strong>urs.<br />
L’étude de ces travaux révè<strong>le</strong> que l’utilisation des cou<strong>le</strong>urs répond à une intention explicative<br />
de la part des élèves. En effet, <strong>le</strong>s différentes cou<strong>le</strong>urs donnent à voir des éléments du<br />
phénomène volcanique comp<strong>le</strong>xe à verbaliser par des annotations. Ce soin apporté au dessin<br />
est interprété ici comme un effort lié au contenu et non pas comme un souci esthétique. En<br />
effet ces éléments graphiques prolongent <strong>le</strong>s informations données dans <strong>le</strong>s annotations.<br />
Dans la population généra<strong>le</strong>, il apparaît, qu’en moyenne, c’est à l’éco<strong>le</strong> Freinet que l’utilisation<br />
de cou<strong>le</strong>urs est <strong>le</strong> plus souvent répandue. Si l’on observe maintenant <strong>le</strong> nombre de cou<strong>le</strong>urs<br />
utilisées dans <strong>le</strong>s dessins, de nouveau, c’est <strong>le</strong> même établissement qui se distingue par<br />
cette façon de faire.<br />
Nbre de cou<strong>le</strong>urs Non 1 2 3 4 5 TOTAL<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
réponse<br />
Freinet 183<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 194<br />
TOTAL 7 204 92 46 19 9 377<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Doc 6 : Nombre de cou<strong>le</strong>urs dans <strong>le</strong>s dessins, toutes populations (3années).<br />
La dépendance est très significative. chi2 = 27,77, s à .01.<br />
La population des CM est ici intéressante dans la mesure où el<strong>le</strong> nous permet d’observer<br />
<strong>le</strong>s différences <strong>le</strong>s plus tranchées. Durant <strong>le</strong>s trois années de passation, très peu d’élèves<br />
de CM de l’éco<strong>le</strong> Freinet utilisent une seu<strong>le</strong> cou<strong>le</strong>ur. Dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> par contre,<br />
<strong>le</strong>s dessins sont caractérisés par l’utilisation d’une ou de deux cou<strong>le</strong>urs. Rares sont <strong>le</strong>s<br />
cas où ces élèves dépassent ce nombre d’outils. Deux hypothèses peuvent être avancées<br />
concernant l’analyse des productions des classes de CM .<br />
– Il pourrait s’agir d’un effet lié aux pratiques du maître et donc d’une culture de classe.<br />
Le contexte scolaire de passation de ces questionnaires permet de conserver ces<br />
usages.<br />
– La deuxième hypothèse s’enracine dans une approche moins focalisée sur la classe<br />
et plus ouverte sur l’éco<strong>le</strong>. Ainsi, ces résultats ne seraient pas liés à l’effet des pratiques<br />
du maître de CM , mais des maîtres de l’éco<strong>le</strong>. Serait marqué ici l’aboutissement<br />
d’objectifs pédagogiques partagés par l’équipe enseignante s’inscrivant dans la durée<br />
depuis l’éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> jusqu’au CM .<br />
Nbre de cou<strong>le</strong>urs<br />
Éco<strong>le</strong>s- classes de CM2<br />
Non réponse 1 2 3 4 5 TOTAL<br />
Freinet 0 0 59<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 57<br />
TOTAL 1 33 41 19 15 7 116<br />
Doc 7 : Nombre de cou<strong>le</strong>urs dans <strong>le</strong>s dessins des élèves de CM2 (3 années).<br />
La dépendance est très significative. chi2 = 36,13, s à .01.<br />
Du point de vue des critères liés aux systèmes explicatifs dans <strong>le</strong>s dessins, <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s<br />
se distinguent de façon significative. En effet, <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet utilisent plus<br />
généra<strong>le</strong>ment différents moyens pour étoffer <strong>le</strong>urs explications, et cela lorsqu’il s’agit de<br />
système imposé (annotations) ou spontané (codes cou<strong>le</strong>urs).<br />
2.2. Types de volcans<br />
Pour décrire et analyser <strong>le</strong>s dessins de volcans, j’ai pris en compte la présence ou l’absence<br />
de différents critères :<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
volcan en éruption ou en sommeil,<br />
fumée,<br />
projections,<br />
lave.<br />
En règ<strong>le</strong> généra<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s dessins montrent <strong>le</strong> plus souvent un volcan en éruption avec de la<br />
lave, et très peu comportent des éléments liés à la présence de fumée. Ces productions<br />
décrivent <strong>le</strong>s volcans de façon stéréotypée (Allain, ). El<strong>le</strong>s sont caractéristiques de<br />
représentations fréquentes étudiées dans différents niveaux scolaires. Mais des différences<br />
significatives existent entre <strong>le</strong>s dessins réalisés dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s. Les élèves de l’éco<strong>le</strong><br />
Freinet dessinent plus souvent des éléments de projection (c’est <strong>le</strong> cas de façon encore plus<br />
importante si l’on fait abstraction de la dernière année ).<br />
C’est dans la population des CM que cela est <strong>le</strong> plus marqué. Les dessins des élèves de<br />
Voir à ce sujet l’étude spécifique de cette population et ses caractéristiques.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
CM ne relèvent pas d’une représentation commune sur <strong>le</strong>s volcans.<br />
Projections<br />
Absence<br />
Présence<br />
TOTAL<br />
Éco<strong>le</strong>s – classes de CM2 d’élément de projection d’élément de projection<br />
Freinet 0 59<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 57<br />
TOTAL 61 55 116<br />
Doc 8 : Présence/ absence d’éléments de projections dans <strong>le</strong>s dessins de CM2 (3 années).<br />
La dépendance est très significative. chi2 = 20,01, s à .01.<br />
En étudiant <strong>le</strong>s productions des élèves, j’ai pu distinguer cinq types de dessins :<br />
– type a : intérieur invisib<strong>le</strong> (volcan dessiné comme une montagne).<br />
Ces dessins présentent <strong>le</strong>s contours extérieurs d’un volcan ayant une forme de montagne.<br />
L’intérieur est opaque.<br />
– type b : volcan dessiné comme un récipient (il n’y pas de chambre, <strong>le</strong> volcan est<br />
rempli de magma comme un verre <strong>le</strong> serait avec un liquide).<br />
Ce type de dessin intègre un nouvel élément de représentation graphique puisqu’il est<br />
dessiné en coupe ou en transparence (sans que cette indication ne soit écrite). L’espace<br />
rendu visib<strong>le</strong> n’est pas compartimenté.<br />
– type c : présence d’une chambre magmatique bien délimitée. Le dessin s’arrête à la<br />
« base » du volcan, rien ne figure sous la surface de la terre.<br />
Ce type de dessin propose une organisation autre de l’intérieur du volcan en transparence<br />
puisque <strong>le</strong> volume visib<strong>le</strong> est subdivisé. Apparaît ainsi ce qui peut se rapprocher ou symboliser<br />
une chambre magmatique.<br />
– type d : prise en compte de l’intérieur de la terre (<strong>le</strong> dessin ne s’arrête pas à la<br />
« bordure » inférieure du volcan).<br />
Ce type intègre un nouvel élément. Le dessin n’est plus limité aux éléments issus du volcan<br />
(lave, fumée,…) et à ceux qui sont à l’intérieur. Vient s’ajouter ici un lien entre <strong>le</strong> volcan et<br />
« l’intérieur de la terre ». Ainsi il n’existe plus de frontière étanche à la base du volcan.<br />
–<br />
type e : autres.<br />
Ces dessins ne sont pas « hiérarchisés » dans la liste comme <strong>le</strong>s autres. Il existe ici une<br />
rupture dans <strong>le</strong>s productions graphiques. Ces dessins sont souvent hors sujet. Ils peuvent<br />
ne pas représenter un volcan.<br />
L’étude de la population généra<strong>le</strong> montre des réponses assez ressemblantes ne permettant<br />
pas de voir des différences entre <strong>le</strong>s deux établissements. La globalité masque ici des<br />
éléments de différenciation. En effet, l’étude des sous-populations constituées par <strong>le</strong>s<br />
différents niveaux scolaires permet d’observer des nuances ou des différences.<br />
Les productions des élèves de CE , entre autres, présentent des différences significatives.<br />
Type de dessins<br />
Éco<strong>le</strong>s – classes de CE2<br />
a b c d e TOTAL<br />
Freinet 0 62<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 0 78<br />
TOTAL 79 21 28 9 3 140<br />
Doc 9 : Répartition des types de dessins sur <strong>le</strong>s volcans, classe de CE2 (3 années)<br />
La dépendance est significative. chi = , , s à .0 .<br />
Une des différences significative concerne la présence relative de dessins de type c<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
(chambre magmatique bien délimitée sans éléments sous la surface de la terre). Beaucoup<br />
moins nombreux sont <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet qui donnent ces éléments d’information<br />
dans <strong>le</strong>urs dessins en comparaison avec <strong>le</strong>urs homologues de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>. Cette<br />
répartition montre que <strong>le</strong>s élèves de CE indiquent d’avantage d’éléments de connaissances<br />
scientifiques dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> que dans l’éco<strong>le</strong> Freinet. Il faut rester prudent quant<br />
à ce que j’appel<strong>le</strong> ici « éléments de connaissances scientifiques ». Le dessin du volcan<br />
« posé » sur la surface de la terre n’est pas une connaissance scientifique « exacte ».<br />
Néanmoins, <strong>le</strong>s types de dessins sont hiérarchisés ici, non pas depuis des représentations<br />
fausses (type a) vers des représentations plus justes (type d), mais en termes d’éléments<br />
scientifiques (ou s’y rapprochant) plus ou moins mis en évidence.<br />
Cette mise au point permet de dire que <strong>le</strong>s élèves de CE de l’éco<strong>le</strong> Freinet réalisent des<br />
dessins moins fins du point de vue des éléments scientifiques contenus. Si cette situation<br />
est liée au projet d’enseignement, peut-être celui-ci s’organise-t-il autour d’objectifs décalés<br />
par rapport aux enseignements scientifiques. Aucun élément ne permet, jusqu’à présent<br />
d’al<strong>le</strong>r plus loin ou même d’y répondre, ne serait-ce qu’en terme de lien.<br />
Un autre élément apparaît dans ces résultats : seuls <strong>le</strong>s élèves de CE de Freinet font<br />
des dessins « aberrants » ou hors sujet. Certes il convient de rester prudent au vu du petit<br />
nombre d’élèves concernés ( / ). Néanmoins à ce niveau scolaire aucun élève de l’éco<strong>le</strong><br />
traditionnel<strong>le</strong> ne réalise ce type de dessin. Je peux mettre en lien ici <strong>le</strong>s choix pédagogiques<br />
des enseignants Freinet et ce type de résultats. En effet, en CE , <strong>le</strong>s maîtres partent<br />
toujours des connaissances des élèves : tout peut être écrit ou dit pour être objet de travail.<br />
Ils travail<strong>le</strong>nt sur des savoirs plus proches des élèves qu’ils ne <strong>le</strong> font dans <strong>le</strong>s niveaux<br />
supérieurs. C’est là <strong>le</strong> point de départ du travail de classe. Plus on avance dans la scolarité,<br />
plus cela est cadré dans la mesure où des acquis sont censés avoir été construits.<br />
Si nous étudions maintenant la sous-population constituée par <strong>le</strong>s élèves de CM sur la<br />
même période ( années scolaires), nous pouvons observer des différences entre <strong>le</strong>s<br />
établissements, mais qui ne vont pas dans <strong>le</strong> même sens que <strong>le</strong>s résultats précédents.<br />
Type de dessins<br />
Éco<strong>le</strong>s – classes de CM1<br />
Non réponse a b c d e TOTAL<br />
Freinet 0 61<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 58<br />
TOTAL 4 51 24 21 11 8 119<br />
Doc 10 : Répartition des types de dessins sur <strong>le</strong>s volcans, classe de CM1 (3 années)<br />
La dépendance est significative. chi = , , s à .0 .<br />
Dans ce niveau scolaire, <strong>le</strong>s tendances s’inversent par rapport aux classes de CE . En<br />
effet, plus aucun élève de l’éco<strong>le</strong> Freinet ne réalise de dessin de type e, alors qu’on en<br />
dénombre dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>. Évidemment la même prudence est à avoir ici au vu<br />
des effectifs concernés. Il faut continuer à l’analyser en terme de présence ou d’absence.<br />
Les dessins hors sujet n’existent plus dans la classe Freinet, mais apparaissent dans l’éco<strong>le</strong><br />
traditionnel<strong>le</strong>.<br />
Même si <strong>le</strong>s résultats ne sont pas significatifs, il faut noter (pour pouvoir <strong>le</strong> nuancer en<br />
fonction de l’analyse à venir d’autres sous-populations) la présence plus importante de<br />
dessins de type c (présence d’une chambre magmatique) à l’éco<strong>le</strong> Freinet et de type d<br />
(prise en compte de l’intérieur de la terre) à l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>.<br />
La dernière année de passation s’étant révélée problématique dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> , il<br />
Rappelons que <strong>le</strong>s enseignants de cette éco<strong>le</strong> ont corrigé <strong>le</strong>s questionnaires avec <strong>le</strong>s élèves ou<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
est prudent d’étudier <strong>le</strong>s données en excluant cette dernière sous population.<br />
Type de dessins<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
Non réponse a b c d e TOTAL<br />
Freinet<br />
Traditionnel<strong>le</strong><br />
TOTAL<br />
0 0<br />
Doc 11 : Répartition des types de dessins sur <strong>le</strong>s volcans, toutes classes (2 années)<br />
La dépendance est significative. chi = , , s à .0 .<br />
Il apparaît ici des résultats différents. Cette population donne à voir que, toute classes<br />
confondues, c’est à l’éco<strong>le</strong> Freinet que des dessins intégrant des éléments scientifiques<br />
plus fins apparaissent plus fréquemment (dessins de types c et d).<br />
L’analyse particulière des niveaux scolaires permet d’affiner cette observation. En effet, ce<br />
sont <strong>le</strong>s classes de CM et de CM qui expliquent ces résultats puisque cette tendance<br />
généra<strong>le</strong> trouve son origine dans ces niveaux. La différence est d’autant plus marquée<br />
que l’on avance dans <strong>le</strong> cursus scolaire. Pour exemp<strong>le</strong>, en CM , deux fois plus d’élèves<br />
de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> comparativement à l’éco<strong>le</strong> Freinet dessinent un volcan de type a<br />
( / ). Autre résultat parlant : élèves de CM de l’éco<strong>le</strong> Freinet font un dessin de type d<br />
(pour élève CM de l’autre éco<strong>le</strong>). Durant <strong>le</strong>s deux premières années, c’est-à-dire lorsque<br />
<strong>le</strong>s enseignants de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> n’interviennent pas, <strong>le</strong>s élèves de CM et de CM à<br />
l’éco<strong>le</strong> Freinet dessinent donc plus fréquemment des volcans comportant des informations<br />
scientifiques plus fines. Les données de CE donnent à voir des résultats inversés.<br />
2.3. Explication du volcanisme<br />
Il est demandé aux élèves d’expliquer <strong>le</strong> volcanisme.<br />
Sur la population globa<strong>le</strong>, seuls <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet répondent à cette question<br />
par une formu<strong>le</strong> du type « je ne sais pas ». Dans l’autre éco<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s élèves, ont d’avantage<br />
tendance à laisser l’espace de réponse vide.<br />
Les explications rédigées par <strong>le</strong>s élèves ont été classées selon trois catégories non<br />
exclusives. Une réponse peut ainsi s’inscrire dans plusieurs catégories.<br />
– Approche descriptive : l’explication est liée à l’éruption et à la lave (ce qui est visib<strong>le</strong><br />
dans <strong>le</strong> phénomène). C’est une description du phénomène qui préside ici.<br />
– Explication comp<strong>le</strong>xe : l’écrit est lié à ce qui est invisib<strong>le</strong>. Il rend compte de qui<br />
peut être appelé un phénomène comp<strong>le</strong>xe : l’élève par<strong>le</strong> de chambre, de magma, de<br />
cratère…<br />
– Explication causa<strong>le</strong> : L’explication est ici d’avantage orientée sur un phénomène<br />
inscrit dans <strong>le</strong> temps avec une cause, une origine, un élément déc<strong>le</strong>ncheur (ex :<br />
« tremb<strong>le</strong>ment de terre »,…).<br />
–<br />
Explication liant <strong>le</strong>s conséquences : Les élèves peuvent expliquer <strong>le</strong> phénomène<br />
en abordant <strong>le</strong>s conséquences des éruptions volcaniques (morts, feu, destruction de<br />
villages, de végétations….).<br />
D’une manière généra<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s populations se ressemb<strong>le</strong>nt dans la production d’explications<br />
faisant appel à des éléments descriptifs, des explications comp<strong>le</strong>xes ou aux conséquences<br />
des éruptions volcaniques. Par contre, el<strong>le</strong>s se distinguent concernant <strong>le</strong>s écrits liés aux<br />
causes du phénomène. En effet, <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet <strong>le</strong>s abordent plus fréquemment.<br />
proposé des cours avant de <strong>le</strong>s distribuer.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Ils s’appuient dans <strong>le</strong>urs explications sur une chaîne d’évènements. Le phénomène décrit<br />
est d’une certaine façon ici contextualisé.<br />
L’analyse des différents niveaux scolaires montre des différences significatives entre <strong>le</strong>s<br />
deux éco<strong>le</strong>s, spécifiques selon <strong>le</strong>s classes.<br />
Dans la population généra<strong>le</strong> des CE , ce sont <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> qui<br />
formu<strong>le</strong>nt <strong>le</strong> plus souvent une explication comp<strong>le</strong>xe, alors que <strong>le</strong>s non-réponses sont plus<br />
fréquentes chez <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet. Il est à noter, malgré cette première remarque,<br />
que seuls ces derniers écrivent des formu<strong>le</strong>s du type « je ne sais pas ». Ces écrits ne sont<br />
pas comptabilisés comme des non-réponses, mais comme des réponses spécifiques.<br />
explication comp<strong>le</strong>xe<br />
Éco<strong>le</strong> – classe de CE2<br />
absente présente TOTAL<br />
Freinet 38<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 53<br />
TOTAL 72 19 91<br />
Doc 12 : Présence/absence d’explication de type comp<strong>le</strong>xe – classe de CE2<br />
La dépendance est significative. chi = , , s à .0 .<br />
Cette situation est inversée dans <strong>le</strong>s classes de CM , puisque <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet<br />
produisent ici très significativement plus d’explications de type comp<strong>le</strong>xe faisant appel à des<br />
éléments non visib<strong>le</strong>s.<br />
explication comp<strong>le</strong>xe<br />
Éco<strong>le</strong> – classes de CM2<br />
absente présente TOTAL<br />
Freinet 59<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 57<br />
TOTAL 76 40 116<br />
Doc 13 : Présence/absence d’explication de type comp<strong>le</strong>xe – classe de CM2<br />
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
Il est intéressant de confronter cette comparaison entre <strong>le</strong> premier et <strong>le</strong> dernier niveau<br />
étudié en terme d’évolution. En effet alors que <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet produisent moins<br />
d’explications comp<strong>le</strong>xes en CE , ils seront plus performants, comparativement, dans ce<br />
type de formulation en CM . Du point de vue comparatif, la situation est inversée dans<br />
l’autre éco<strong>le</strong>. Les élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet semb<strong>le</strong>nt travail<strong>le</strong>r et affiner ce type de savoir<br />
durant <strong>le</strong>ur scolarité. Ce n’est pas <strong>le</strong> cas dans la seconde éco<strong>le</strong>. En effet, l’évolution n’est<br />
pas marquée de façon aussi forte.<br />
Toujours concernant <strong>le</strong> CM , <strong>le</strong> fait de donner des explications causa<strong>le</strong>s au fonctionnement<br />
des volcans (sans que cela ne soit précisément demandé) permet de différencier <strong>le</strong>s<br />
deux éco<strong>le</strong>s. Les élèves de CM de l’éco<strong>le</strong> Freinet ont donc plus tendance à expliquer <strong>le</strong><br />
phénomène volcanique avec une approche plus globa<strong>le</strong> que cel<strong>le</strong> qui est lié au moment de<br />
l’éruption.<br />
explication causa<strong>le</strong><br />
Éco<strong>le</strong> – classe de CM2<br />
absente présente TOTAL<br />
Freinet 59<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 57<br />
TOTAL 78 38 116<br />
Doc 14 : Présence/absence d’explication de type causal – classe de CM2<br />
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
L’étude de la sous-population des CM permet de mettre en évidence un autre type de<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
différence significative. Les élèves de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> rédigent plus souvent une<br />
description que <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet.<br />
explication comp<strong>le</strong>xe<br />
Éco<strong>le</strong> – classes de CM1<br />
absente présente TOTAL<br />
Freinet 0 61<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 58<br />
TOTAL 69 50 119<br />
Doc 15 : Présence/absence d’explication de type description – classe de CM1<br />
La dépendance est significative. chi = , , s à .0 .<br />
Travail<strong>le</strong>r sur <strong>le</strong>s deux premières années conforte en partie ces résultats. En effet, <strong>le</strong>s<br />
populations se ressemb<strong>le</strong>nt lorsque <strong>le</strong>s explications des élèves sont liées aux éléments<br />
visib<strong>le</strong>s. Par contre el<strong>le</strong>s se distinguent lorsque <strong>le</strong>s élèves font appel à des explications<br />
« comp<strong>le</strong>xes » (éléments non visib<strong>le</strong>s) ou à des discours sur <strong>le</strong>s causes du phénomène.<br />
Dans <strong>le</strong>s deux cas, c’est à l’éco<strong>le</strong> Freinet que <strong>le</strong>s élèves utilisent plus souvent ces deux<br />
types d’écrits scientifiques. Mais des variations existent entre <strong>le</strong>s niveaux scolaires. Alors<br />
que <strong>le</strong>s élèves de CM et de CM de l’éco<strong>le</strong> Freinet vont beaucoup plus souvent rédiger une<br />
explication de type « comp<strong>le</strong>xe » que <strong>le</strong>urs homologues de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>, la tendance<br />
est inversée pour <strong>le</strong>s CE . Notons ici que ce sont <strong>le</strong>s élèves de CM qui se caractérisent de<br />
façon importante par des écrits faisant appel aux causes de phénomène.<br />
Il est à noter éga<strong>le</strong>ment que, dans cette sous-population constituée par <strong>le</strong>s deux premières<br />
années de passation, <strong>le</strong>s conséquences du volcanisme ne constituent que très rarement<br />
l’objet d’un écrit.<br />
Cette analyse est à mettre en relation avec <strong>le</strong>s interventions des enseignants dans l’éco<strong>le</strong><br />
traditionnel<strong>le</strong>. Il ne semb<strong>le</strong> pas qu’el<strong>le</strong>s modifient l’intégration d’éléments d’explication<br />
comp<strong>le</strong>xes. Les résultats ne sont que peu modifiés.<br />
2.4. Sur <strong>le</strong> travail des chercheurs<br />
Les élèves ont été interrogés d’une part sur l’existence ou pas de chercheurs dont l’activité<br />
serait basée sur <strong>le</strong>s volcans, et d’autre part, sur <strong>le</strong> type de recherches auxquel<strong>le</strong>s ils peuvent<br />
se livrer.<br />
Trois catégories de recherche peuvent être construites à la <strong>le</strong>cture des réponses.<br />
– Les recherches peuvent s’orienter vers une explication du phénomène global (ex :<br />
« ils cherchent comment fonctionne <strong>le</strong> volcan »).<br />
– Les chercheurs peuvent travail<strong>le</strong>r sur des questions plus spécifiques en s’interrogeant<br />
sur des indicateurs identifiés (ex : « ils cherchent à savoir d’où vient la lave », sa<br />
température,….). Le phénomène est ici découpé en éléments distincts mais liés.<br />
–<br />
Les recherches sont basées sur des observations, sur des objets scientifiques précis,<br />
des échantillons (ex : « ils cherchent de la lave séchée », « ils vont voir ce qu’il y a sur<br />
<strong>le</strong> volcan »…).<br />
En règ<strong>le</strong> généra<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s populations se ressemb<strong>le</strong>nt lorsque <strong>le</strong>s élèves font référence à<br />
des recherches basées sur explications globa<strong>le</strong>s et généra<strong>le</strong>s, ou sur des questions plus<br />
spécifiques. La seu<strong>le</strong> différence très significative dans <strong>le</strong>s réponses autour du travail des<br />
chercheurs concerne <strong>le</strong> statut des observations. Dans la population généra<strong>le</strong>, deux fois plus<br />
d’élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet indiquent que <strong>le</strong>s scientifiques recherchent des objets particuliers<br />
(« lave séchée »,…) et qu’ils partent de <strong>le</strong>urs observations pour étudier <strong>le</strong> volcanisme. Il y a<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
ici dans <strong>le</strong>s productions une importance donné au réel, à l’observation du concret pour faire<br />
de la recherche. Seul ce type de réponses inclut des éléments de la démarche adoptée par<br />
<strong>le</strong>s scientifiques.<br />
C’est au niveau CM que la différence est la plus fortement marquée.<br />
0<br />
Travail du chercheur : observation<br />
Éco<strong>le</strong> – classes de CM1<br />
absente présente TOTAL<br />
Freinet 61<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 58<br />
TOTAL 102 17 119<br />
Doc 16 : Présence/absence de recherches basées sur l’observation – classes de CM1<br />
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
Ce type de résultats semb<strong>le</strong> pouvoir être mis en relation avec <strong>le</strong>s formes pédagogiques<br />
à l’œuvre dans <strong>le</strong>s classes. Le « quoi de neuf » mis en place dans l’éco<strong>le</strong> Freinet, par<br />
exemp<strong>le</strong>, peut être <strong>le</strong> lieu d’observation avant la naissance d’un questionnement et d’un<br />
travail scientifique. Cet exemp<strong>le</strong> n’est qu’un moyen pédagogique parmi d’autres utilisés<br />
dans cette éco<strong>le</strong> nécessitant une première approche concrète devant des objets réels. Cette<br />
hypothèse de lien entre pratiques pédagogiques et positionnement des élèves dans <strong>le</strong>urs<br />
écrits sera croisée avec d’autres résultats pour pouvoir l’éprouver.<br />
Précisons ici qu’à cette question lors de la dernière année de passation, <strong>le</strong>s réponses dans<br />
l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> sont souvent identiques. El<strong>le</strong>s utilisent toute <strong>le</strong> terme de « volcanologue »<br />
et par<strong>le</strong>nt de <strong>le</strong>ur travail de prévision ou de recherche d’informations.<br />
2.5. Ajout d’informations scientifiques<br />
Une question donne la possibilité aux élèves d’ajouter des informations sur <strong>le</strong>s volcans<br />
(« que sais-tu d’autre sur <strong>le</strong>s volcans ? »). Ainsi, s’ils connaissent d’autres éléments que<br />
ceux qu’ils ont eu l’occasion d’écrire précédemment, ils peuvent <strong>le</strong>s présenter sans cadrage<br />
particulier.<br />
Quatre catégories de réponses ont été identifiées :<br />
– L’absence de réponse : l’élève n’ajoute pas d’information et laisse cette rubrique vide<br />
(codé : non réponse).<br />
– L’élève répète une information déjà consignée ail<strong>le</strong>urs dans <strong>le</strong> questionnaire (codé :<br />
bis).<br />
– L’élève ajoute une ou des information(s) supplémentaires par rapport à ce qu’il a déjà<br />
écrit ail<strong>le</strong>urs dans <strong>le</strong> questionnaire (codé : sup).<br />
–<br />
L’élève écrit en toute <strong>le</strong>ttre qu’il ne sait rien d’autre (« rien », « je ne sais rien d’autre »)<br />
(codé : rien).<br />
Cette question éclaire des postures différentes chez <strong>le</strong>s élèves.<br />
Ajout d’informations<br />
Non sup bis rien TOTAL<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
réponse<br />
Freinet 0 183<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 194<br />
TOTAL 94 165 40 78<br />
Doc 17 : Ajout d’informations – toutes classes (3 années)<br />
La dépendance est très significative. chi = .0 , s à .0 .<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Très peu d’élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet répètent des informations déjà écrites, ils respectent<br />
la consigne. Ce n’est pas <strong>le</strong> cas des élèves de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>. Néanmoins autant<br />
d’élèves dans <strong>le</strong>s deux établissements ajoutent des informations nouvel<strong>le</strong>s.<br />
Une hypothèse pour travail<strong>le</strong>r sur ces données peut être articulée avec <strong>le</strong> positionnement<br />
que <strong>le</strong>s élèves auraient par rapport au <strong>le</strong>cteur du questionnaire. Dans ce cadre <strong>le</strong>s élèves<br />
qui répondent en répétant des informations déjà données pourraient être motivés par <strong>le</strong> fait<br />
de ne pas vouloir laisser une rubrique vide. Cette attitude relèverait d’une mise en parallè<strong>le</strong><br />
entre ce questionnaire et une évaluation. Cette question propose un exercice d’autant plus<br />
diffici<strong>le</strong> qu’il ne cadre pas particulièrement <strong>le</strong> champ des réponses possib<strong>le</strong>s. El<strong>le</strong> laisse une<br />
grande liberté aux élèves. C’est donc dans l’éco<strong>le</strong> Freinet que cette possibilité, ou ce risque,<br />
est pris plus fréquemment.<br />
C’est dans <strong>le</strong>s classes de CE et de CM que ces résultats apparaissent de façon<br />
significative.<br />
Ajout d’informations<br />
Non sup bis rien TOTAL<br />
Éco<strong>le</strong>s – classes de CE2 réponse<br />
Freinet 63<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 79<br />
TOTAL 34 74 13 21 142<br />
La dépendance est significative. chi = , 0, s à .0 .<br />
Doc 18 : Ajout d’informations – CE2 (3 années)<br />
Ajout d’informations<br />
Non sup bis rien TOTAL<br />
Éco<strong>le</strong>s – classes de CM2 réponse<br />
Freinet 59<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 57<br />
TOTAL 23 40 23 27 116<br />
Doc 19 : Ajout d’informations – CM2 (3 années)<br />
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
Il semb<strong>le</strong> donc que <strong>le</strong> « non-respect » de la consigne caractérise la population issue de<br />
l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>. Les élèves préfèrent répéter des informations plutôt que de laisser la<br />
case vide.<br />
En excluant <strong>le</strong>s données issues de la dernière année, la seu<strong>le</strong> distinction importante entre<br />
<strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s concerne l’absence de réponse. En effet, près de deux fois plus d’élèves<br />
de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> ( ) que de l’éco<strong>le</strong> Freinet ( ) ne répondent pas. Les données sont<br />
inversées pour la réponse écrite par l’élève du type « rien ». C’est encore une fois à l’éco<strong>le</strong><br />
Freinet que l’aveu d’ignorance est plus fréquent.<br />
2.6. Formulation de questions par <strong>le</strong>s élèves<br />
À la fin du questionnaire, <strong>le</strong>s élèves qui <strong>le</strong> désirent peuvent formu<strong>le</strong>r des questions<br />
concernant <strong>le</strong> volcanisme. Dans un premier temps ils indiquent s’ils ont des questions, et,<br />
dans l’affirmative, <strong>le</strong>s posent par écrit. On peut ainsi dénombrer <strong>le</strong> nombre d’élèves déclarant<br />
avoir des questions, et ensuite pointer la présence ou l’absence de questions véritab<strong>le</strong>ment<br />
posées.<br />
Certains élèves ne cochent rien et ne formu<strong>le</strong>nt pas de questions (codé : non réponse).<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Questions<br />
Non absence présence TOTAL<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
réponse<br />
Freinet 0 183<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 194<br />
TOTAL 18 258 101 377<br />
Doc 20 : Présence/absence de questions – toute la population (3 années)<br />
La dépendance est significative. chi = , , s à .0 .<br />
C’est dans l’éco<strong>le</strong> Freinet que <strong>le</strong>s élèves posent relativement plus de questions en fin<br />
de questionnaire. Cette différence est significative dans la population généra<strong>le</strong> et très<br />
significative dans la population des CM .<br />
Questions<br />
Non absence présence TOTAL<br />
Éco<strong>le</strong>s – Classes de CM2 réponse<br />
Freinet 0 59<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 57<br />
TOTAL 5 73 38 116<br />
Doc 21 : Présence/absence de questions – classes de CM2 (3 années)<br />
La dépendance est très significative. chi = ,0 , s à .0 .<br />
2.7. Stratégies déclarées de documentation<br />
Les élèves sont amenés à écrire sur <strong>le</strong>urs stratégies de documentation concernant <strong>le</strong><br />
volcanisme. La formulation de l’énoncé annonce clairement qu’ils peuvent citer différentes<br />
sources.<br />
Douze catégories ont été construites pour organiser <strong>le</strong>urs réponses :<br />
– Livres<br />
– Parents<br />
– Maître<br />
– Experts<br />
– Dictionnaires<br />
– Encyclopédie<br />
– Internet<br />
– Télévision<br />
– Journaux<br />
– Documents ou pratiques pédagogiques (BTJ, documents scolaires du type manuels,<br />
ou exposés et conférences pris en charge par <strong>le</strong>s élèves…)<br />
– En se rendant sur <strong>le</strong> volcan.<br />
–<br />
Certains élèves ont écrit en toutes <strong>le</strong>ttres « je ne sais pas ». Ils ont été pris en compte<br />
de façon séparée pour ne pas faire d’amalgame entre ce qui ne répondent pas et ce qui<br />
formu<strong>le</strong> une absence de connaissance sur un point particulier. Une dernière catégorie<br />
permet donc de <strong>le</strong>s rassemb<strong>le</strong>r (codé : jnsp).<br />
Sur la population globa<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet proposent une variété de sources<br />
d’information plus importante que <strong>le</strong>urs camarades. Majoritairement, <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong><br />
traditionnel<strong>le</strong> proposent un ou deux moyens d’information. Ils ne dépassent jamais . Ce qui<br />
n’est pas <strong>le</strong> cas des élèves de Freinet. De plus, ce n’est que dans cette dernière éco<strong>le</strong> que<br />
nous trouvons des inscriptions du type « je ne sais pas ». Néanmoins, il faut rester prudent<br />
quant aux conclusions à tirer ici au vu du nombre d’élèves concernés.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Nombre de sources d’information<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
Non réponse 1 2 3 4 5 6 jnsp TOTAL<br />
Freinet 0 183<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 0 0 194<br />
TOTAL 136 71 83 64 16 3 1 3 377<br />
Doc 22 : Nombre de sources d’information citées – toutes classes (3 années)<br />
La dépendance est très significative. chi = 0, , s à .0 .<br />
L’accent va maintenant être porté sur <strong>le</strong>s différences significatives et très significatives entre<br />
<strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s.<br />
Aucun élève de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> ne cite <strong>le</strong>s parents comme une source d’informations.<br />
Seuls certains élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet <strong>le</strong> font. D’un point de vue socio-culturel <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s<br />
sont tout à fait comparab<strong>le</strong>s. Il n’est pas possib<strong>le</strong> d’affirmer que <strong>le</strong>s parents auraient des<br />
comportements ou des positionnements différents dans <strong>le</strong>s deux sphères. Néanmoins, il<br />
est concevab<strong>le</strong> d’imaginer que <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s, par l’intermédiaire des maîtres et de <strong>le</strong>ur choix<br />
pédagogiques, <strong>le</strong>ur laissent des places différentes. Il s’agit ici d’une reconnaissance des<br />
formes de connaissances et de savoirs. L’éco<strong>le</strong> Freinet n’introduit pas l’idée que seul <strong>le</strong><br />
savoir légitime est <strong>le</strong> travail scolaire. Il reconnaît différentes formes de savoirs (celui des<br />
élèves et des parents). Dans cet établissement il est proposé aux parents d’animer des<br />
ateliers après <strong>le</strong>s cours. Les maîtres peuvent éga<strong>le</strong>ment proposer eux-mêmes des ateliers.<br />
Ces séances ont lieu dans <strong>le</strong>s locaux de l’éco<strong>le</strong> (sal<strong>le</strong>s de classes…). Le parent est donc<br />
l’adulte référent proposant, partageant et transmettant un savoir ou un savoir-faire. Dans <strong>le</strong><br />
cadre de cette éco<strong>le</strong>, ce que l’élève sait ou croit savoir est pris en compte et souvent comme<br />
point de départ de séances d’enseignement et d’apprentissage. C’est <strong>le</strong> cas des exposés,<br />
des conférences ou des moments de « quoi de neuf ? », qui peuvent d’ail<strong>le</strong>urs être préparés<br />
à la maison. En effet, <strong>le</strong>s maîtres peuvent, par exemp<strong>le</strong>, proposer aux parents de donner<br />
un objet lié à <strong>le</strong>ur histoire familia<strong>le</strong> ou quotidienne pour ancrer <strong>le</strong> contenu d’un « quoi de<br />
neuf ? ».<br />
Les enseignants reconnaissent <strong>le</strong>s différentes formes de connaissances et de savoirs<br />
chez <strong>le</strong>s élèves et <strong>le</strong>urs parents. Cela semb<strong>le</strong> avoir des répercussions dans <strong>le</strong> discours<br />
des élèves. Même s’il est important de rester nuancé, il convient de s’interroger sur <strong>le</strong>s<br />
différentes frontières permettant de circonscrire <strong>le</strong> savoir que l’éco<strong>le</strong> reconnaît.<br />
Une autre différence très significative réside dans <strong>le</strong> fait de trouver des informations en<br />
demandant au maître. Aucun élève de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> ne cite <strong>le</strong> maître comme une<br />
source d’information. Ce type de réponse est spécifique à l’éco<strong>le</strong> Freinet. La relation maîtreélèves<br />
et la place relative de chacun sont au cœur de ce type de référence et de discours.<br />
Dans certaines structures, demander au maître ne serait-il pas montrer ce qui n’est pas su ?<br />
Faire aveu d’ignorance en quelque sorte ? Si cette relation comporte une part d’évaluation<br />
importante, cette hypothèse est tout à fait pertinente. Dans l’éco<strong>le</strong> Freinet, <strong>le</strong> maître se<br />
révè<strong>le</strong> être un référent concernant <strong>le</strong> savoir. Cette reconnaissance est intéressante à pointer.<br />
Évidemment, il n’est pas possib<strong>le</strong> de dire qu’el<strong>le</strong> n’existe pas dans la seconde éco<strong>le</strong>. Par<br />
contre, si <strong>le</strong> plan de l’évaluation est un plan central dans la relation entre <strong>le</strong>s élèves et <strong>le</strong><br />
maître, el<strong>le</strong> peut s’opposer à ce type de déclaration.<br />
S’il existe peu de différences dans <strong>le</strong>s stratégies de recherche d’informations à l’aide du<br />
dictionnaire, il semb<strong>le</strong> que <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> proposent davantage cette<br />
réponse. La situation est différente vis-à-vis de l’encyclopédie. En effet, la différence est<br />
très significative entre <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s quant à l’utilisation déclarée de cet outil. Ce sont <strong>le</strong>s<br />
élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet qui vont largement plus citer l’encyclopédie comme une ressource<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
pertinente. L’encyclopédie permet de travail<strong>le</strong>r au delà du sens du mot, <strong>le</strong>s définitions sont<br />
moins fermées et plus développées que cel<strong>le</strong>s que présente <strong>le</strong> dictionnaire.<br />
Concernant l’appel à un expert, pour trouver des informations, la différence est peu<br />
significative mais cette possibilité est relativement plus souvent citée à l’éco<strong>le</strong> Freinet.<br />
Ce sont <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> qui font plus souvent référence à Internet ou à<br />
l’ordinateur comme sources d’information. Alors que la télévision est d’avantage citée par<br />
<strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet. Il y a là une reconnaissance des sphères de savoirs hors du<br />
monde scolaire.<br />
La dernière différence très significative concerne <strong>le</strong>s outils pédagogiques (BTJ, documents<br />
créés pour l’éco<strong>le</strong>, conférences réalisées par <strong>le</strong>s élèves…). C’est à Freinet que <strong>le</strong>s élèves<br />
recensent ces moyens d’informations. Même si cela n’est pas très fréquent, quelques élèves<br />
par<strong>le</strong>nt de <strong>le</strong>urs camarades comme des sources possib<strong>le</strong>s de savoirs. Ce n’est jamais <strong>le</strong> cas<br />
dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>. Par contre, ces élèves par<strong>le</strong>nt d’apprendre <strong>le</strong>urs <strong>le</strong>çons comme<br />
d’une source de nouvel<strong>le</strong>s informations. Il faut ici rester prudent, ces déclarations sont rares<br />
mais existent de façon exclusive dans l’une ou l’autre éco<strong>le</strong>.<br />
Il semb<strong>le</strong> que <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet reconnaissent dans <strong>le</strong>urs déclarations des<br />
moyens de s’informer liés à l’intérieur de l’éco<strong>le</strong> (documents pédagogiques, maîtres,…) et<br />
des éléments extérieurs (parents, télévision,…), <strong>le</strong>s deux sphères existant dans <strong>le</strong>s écrits.<br />
Cette situation ne se présente pas de la même façon dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> qui se<br />
caractérise par des déclarations organisées autour du dictionnaire et d’Internet (outils plus<br />
transversaux, moins spécifiques).<br />
L’étude des niveaux scolaires montre des éléments différents. Les CE de l’éco<strong>le</strong> Freinet<br />
se caractérisent par un nombre de non-réponse relativement important (puisque doub<strong>le</strong> par<br />
rapport à la seconde éco<strong>le</strong>).<br />
Nombre de sources d’information<br />
Éco<strong>le</strong>s – Classes de CE2<br />
Non réponse 1 2 3 4 TOTAL<br />
Freinet 0 63<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 79<br />
TOTAL 65 37 27 10 3 142<br />
Doc 23 : Nombre de sources d’information citées – CE2 (3 années)<br />
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
En CE , c’est dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> que <strong>le</strong>s élèves citent plus souvent et d’avantage<br />
de sources d’information. Il existe aussi une autre différence entre <strong>le</strong>s deux établissements<br />
quant à l’utilisation déclarée des livres. C’est dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> qu’ils sont largement<br />
plus cités.<br />
Livres<br />
Éco<strong>le</strong>s – Classes de CE2<br />
absence présence TOTAL<br />
Freinet 63<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 79<br />
TOTAL 100 42 142<br />
Doc 24 : Présence/absence de la citation « livres »<br />
dans <strong>le</strong>s sources d’informations – classes de CE2 (3 années)<br />
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
Ici encore une différence très significative existe entre <strong>le</strong>s deux sous-populations. Les élèves<br />
de CE de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> font beaucoup plus souvent référence à l’internet.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Internet<br />
Éco<strong>le</strong>s – Classes de CE<br />
Freinet<br />
Traditionnel<strong>le</strong><br />
absence présence TOTAL<br />
TOTAL 0 0<br />
Doc 25 : Présence/absence de la citation « internet » dans <strong>le</strong>s sources<br />
d’informations – classes de CE2 (3 années)<br />
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
En revanche, nous retrouvons ce que nous avons déjà pu observer dans la population<br />
généra<strong>le</strong> quant aux outils et méthodes pédagogiques comme sources de savoirs. C’est en<br />
effet uniquement dans l’éco<strong>le</strong> Freinet que ces réponses sont formulées.<br />
Outils pédagogiques<br />
Éco<strong>le</strong>s – Classes de CE<br />
Freinet<br />
absence présence TOTAL<br />
Traditionnel<strong>le</strong><br />
TOTAL<br />
0<br />
Doc 26 : Présence/absence de la citation « outils pédagogiques» dans <strong>le</strong>s sources<br />
d’informations – classes de CE2 (3 années)<br />
La dépendance est très significative. chi = 0, , s à .0 .<br />
Les CE de l’éco<strong>le</strong> Freinet sont plus orientées vers des réponses liées exclusivement à<br />
l’éco<strong>le</strong> par rapport à <strong>le</strong>urs camarades de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>. En effet, ils se distinguent par<br />
l’utilisation déclarée de sources tel<strong>le</strong>s que <strong>le</strong> maître ou d’éléments construit par et/ou pour<br />
l’éco<strong>le</strong>. Dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s réponses des élèves placent <strong>le</strong>s livres et Internet en<br />
premières positions. Il nous faut suivre comment cela évolue durant <strong>le</strong> cursus scolaire. Peutêtre<br />
existe-t-il une évolution ou des déplacements entre des statuts tels que l’élève, l’enfant<br />
et <strong>le</strong> citoyen ?<br />
Les élèves de CM se ressemb<strong>le</strong>nt à deux exceptions près. En effet, <strong>le</strong> maître n’est cité que<br />
par <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet, et c’est toujours dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> que <strong>le</strong>s élèves<br />
répondent plus souvent que <strong>le</strong> dictionnaire est une source d’information importante.<br />
En dehors de ces éléments, il n’y a pas de différences significatives dans <strong>le</strong>urs<br />
déclarations.<br />
Dictionnaire<br />
Éco<strong>le</strong>s – Classes de CM<br />
Freinet<br />
Traditionnel<strong>le</strong><br />
TOTAL 0<br />
absence présence TOTAL<br />
Doc 27 : Présence/absence de la citation « dictionnaire » dans <strong>le</strong>s sources d’informations – classes<br />
de CM1 (3 années)<br />
La dépendance est très significative. chi = . , s à .0 .<br />
Des différences sont très marquées dans <strong>le</strong>s réponses des CM .<br />
Nombre de sources d’information<br />
Éco<strong>le</strong>s – Classes de CM<br />
Freinet<br />
Non réponse TOTAL<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 0<br />
TOTAL 0<br />
Doc 28 : Nombre de sources d’information citées – CM2 (3 années)<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
On constate ici beaucoup plus de non-réponses en CM dans <strong>le</strong>s classes « traditionnel<strong>le</strong>s »<br />
qu’à Freinet. C’est en terme d’évolution que cela s’avère intéressant. En effet, <strong>le</strong>s élèves de<br />
CM donnent à voir une situation inversée par rapport aux élèves de CE . L’évolution est<br />
plus constante à l’éco<strong>le</strong> Freinet, moins de ruptures sont observées.<br />
Nous retrouvons ce que nous avons déjà observé dans la population globa<strong>le</strong> concernant<br />
<strong>le</strong> nombre de sources différences dans <strong>le</strong>s écrits des élèves. Au delà de deux sources, <strong>le</strong>s<br />
élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet sont <strong>le</strong>s plus représentés.<br />
Livres<br />
Éco<strong>le</strong>s – Classes de CM2<br />
absence présence TOTAL<br />
Freinet 59<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 57<br />
TOTAL 56 60 116<br />
Doc 29 : Présence/absence de la citation « dictionnaire » dans <strong>le</strong>s sources d’informations – classes<br />
de CM2 (3 années)<br />
La dépendance est significative. chi = , , s à .0 .<br />
Le livre, comme source d’informations, permettait de distinguer <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s par rapport<br />
aux classes de CE . Il <strong>le</strong> permet éga<strong>le</strong>ment concernant <strong>le</strong>s CM , mais de façon opposée.<br />
En CM , c’est à Freinet que <strong>le</strong> livre est plus souvent cité.<br />
Dans cette sous-population, s’adresser à un expert pour chercher des informations n’est pas<br />
cité de la même façon dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s. C’est dans l’éco<strong>le</strong> Freinet que cela apparaît<br />
plus fréquemment.<br />
Expert<br />
Éco<strong>le</strong>s – Classes de CM2<br />
absence présence TOTAL<br />
Freinet 59<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 57<br />
TOTAL 102 14 116<br />
Doc 30 : Présence/absence de la citation « expert » dans <strong>le</strong>s sources d’informations<br />
– classes de CM2 (3 années)<br />
La dépendance est significative. chi = , , s à .0 .<br />
Il en est de même pour <strong>le</strong>s citations de la télévision et de l’encyclopédie.<br />
télévision<br />
Éco<strong>le</strong>s – Classes de CM2<br />
absence présence TOTAL<br />
Freinet 0 59<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 57<br />
TOTAL 92 24 116<br />
Doc 31 : Présence/absence de la citation « télévision» dans <strong>le</strong>s sources d’informations – classes de<br />
CM2 (3 années)<br />
La dépendance est très significative. chi = , 0, s à .0 .<br />
encyclopédie<br />
Éco<strong>le</strong>s – Classes de CM2<br />
absence présence TOTAL<br />
Freinet 59<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 57<br />
TOTAL 102 14 116<br />
Doc 32 : Présence/absence de la citation « encyclopédie » dans <strong>le</strong>s sources d’informations – classes<br />
de CM2 (3 années)<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
2.8. Quantité d’écriture<br />
J’ai travaillé sur la quantité d’écriture produite par <strong>le</strong>s élèves dans <strong>le</strong>s questionnaires en<br />
distinguant :<br />
– <strong>le</strong> nombre de phrases complètes,<br />
–<br />
<strong>le</strong> nombre de formu<strong>le</strong>s pertinentes (autres que des phrases).<br />
Dans la population généra<strong>le</strong>, il n’existe pas de différences significatives concernant <strong>le</strong><br />
nombre de phrases complètes rédigées par <strong>le</strong>s élèves. Par contre, ce sont <strong>le</strong>s élèves de<br />
l’éco<strong>le</strong> Freinet qui ont recours plus souvent que <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> à l’écriture<br />
de formu<strong>le</strong>s pertinentes.<br />
|t| s à .0 .<br />
Moyennes<br />
Nombre de phrases Nombre de formu<strong>le</strong>s<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
complètes<br />
pertinentes<br />
Freinet . .<br />
Traditionnel<strong>le</strong> . .<br />
TOTAL 3.19 2.19<br />
Doc 33 : Moyennes du nombre phrases complètes et de formu<strong>le</strong>s pertinentes<br />
utilisés par <strong>le</strong>s élèves tous niveaux (3 années)<br />
Les va<strong>le</strong>urs du tab<strong>le</strong>au sont <strong>le</strong>s moyennes calculées sans tenir compte des non-réponses.<br />
Il est intéressant de voir que « l’habitude scolaire » qui est de répondre toujours par une<br />
phrase n’est pas toujours « respectée » ici. D’ail<strong>le</strong>urs sur certains questionnaires remplis à<br />
l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> durant la troisième année de passation, <strong>le</strong> maître corrige <strong>le</strong>s productions<br />
des élèves en complétant des phrases. Par exemp<strong>le</strong>, à la question « que sais-tu d’autre sur<br />
<strong>le</strong>s volcans ? », l’élève répond : « il existe deux types de volcans » et <strong>le</strong> maître fait précéder<br />
cette phrase (considérée ici comme complète) par « je sais que ». D’ail<strong>le</strong>urs cet écart se<br />
creuse encore plus la dernière année.<br />
Lorsque j’observe <strong>le</strong>s trois niveaux scolaires de façon isolée, je retrouve <strong>le</strong>s mêmes résultats,<br />
à savoir une production équiva<strong>le</strong>nte de phrases complètes et une production plus importante<br />
de formu<strong>le</strong>s (autres que des phrases) dans <strong>le</strong>s classes Freinet. Il existe une évolution dans<br />
la mesure où <strong>le</strong>s élèves de CE produisent moins de phrases que <strong>le</strong>s élèves de CM qui en<br />
produisent moins que <strong>le</strong>urs aînés.<br />
2.9. Spécificités des éco<strong>le</strong>s<br />
J’ai travaillé sur la caractérisation des réponses des sous-populations pour expliquer ce qui<br />
différencie <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s (par méthode d’analyse de la variance, type ANOVA).<br />
D’une manière généra<strong>le</strong>, c’est-à-dire en m’appuyant sur la population globa<strong>le</strong>, j’observe<br />
que <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet vont spontanément utiliser des cou<strong>le</strong>urs pour donner<br />
des éléments d’explication à <strong>le</strong>ur dessin et faciliter ainsi la compréhension du <strong>le</strong>cteur. Ils<br />
vont éga<strong>le</strong>ment annoter <strong>le</strong>urs dessins et utiliser plus que <strong>le</strong>s élèves de l’autre éco<strong>le</strong> des<br />
formu<strong>le</strong>s pertinentes autres que des phrases. Ce sont des « savoir-faire » qui ne sont pas<br />
nécessairement (ou toujours) mis en avant dans l’Éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>.<br />
Le nombre et la variété des moyens d’information sont éga<strong>le</strong>ment des éléments qui marquent<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
une différence entre <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s : <strong>le</strong>s moyens d’information étant souvent plus variés<br />
et plus nombreux dans <strong>le</strong>s questionnaires issus de l’éco<strong>le</strong> Freinet. Les sphères de savoirs<br />
sont reconnues éga<strong>le</strong>ment ail<strong>le</strong>urs qu’à l’éco<strong>le</strong> plus faci<strong>le</strong>ment par ces élèves-là. Ils ont plus<br />
de questions que <strong>le</strong>urs collègues de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> et ils ajoutent plus souvent des<br />
informations nouvel<strong>le</strong>s suite à la consigne.<br />
Il semb<strong>le</strong>rait que lorsqu’il est donné ici une liberté passant par exemp<strong>le</strong> par la forme donnée<br />
aux consignes (questions ouvertes, réalisation de dessin…) <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet<br />
s’en emparent avec plus de facilité.<br />
C’est aussi <strong>le</strong> cas concernant <strong>le</strong>s réponses liées à une liberté que l’élève s’accorde luimême<br />
: par exemp<strong>le</strong> lorsqu’il fait part de son ignorance (utilisation plus fréquente à l’éco<strong>le</strong><br />
Freinet de la formu<strong>le</strong> « je ne sais pas »).<br />
Il semb<strong>le</strong> que plus on avance dans <strong>le</strong> cursus scolaire, plus <strong>le</strong>s élèves des deux éco<strong>le</strong>s se<br />
différencient. Il existe ici une évolution forte à l’éco<strong>le</strong> Freinet. Il est possib<strong>le</strong> d’al<strong>le</strong>r plus loin<br />
en disant que <strong>le</strong>s élèves de CE de l’éco<strong>le</strong> Freinet sous souvent moins « pertinents » que<br />
<strong>le</strong>s CE de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>, et dès <strong>le</strong> CM cette tendance s’inverse de façon forte, pour<br />
être massive en CM . Ce résultat est sûrement à attribuer au travail d’équipe existant dans<br />
cette éco<strong>le</strong>. Dans l’autre établissement, <strong>le</strong> cursus est moins linéaire et davantage <strong>le</strong> lieu de<br />
ruptures entre <strong>le</strong>s classes<br />
2.10. Une sous-population particulière<br />
D’un point de vue méthodologique, il est important de préciser la singularité de la dernière<br />
année de passation des questionnaires. En effet, dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s enseignants<br />
ont fait travail<strong>le</strong>r <strong>le</strong>urs élèves sur <strong>le</strong> volcanisme avant de soumettre <strong>le</strong>s questionnaires. Cela se<br />
voit dès la première <strong>le</strong>cture que j’ai pu en faire. C’est dans cette population qu’une distinction<br />
existe entre lave et magma, même si <strong>le</strong>urs relations ne sont que rarement explicites. Pour<br />
<strong>le</strong>s CM , par exemp<strong>le</strong>, tous <strong>le</strong>s dessins se ressemb<strong>le</strong>nt beaucoup (type d) avec <strong>le</strong>s mêmes<br />
annotations et <strong>le</strong>s mêmes indications. Les élèves écrivent par exemp<strong>le</strong> que la « température<br />
du magma est de 1000 », ils donnent une distance entre <strong>le</strong> « haut du volcan » et un point<br />
sous la terre, ils citent « <strong>le</strong>s volcans calmes ou explosifs » ou encore par<strong>le</strong>nt des « 1300<br />
volcans actifs dans <strong>le</strong> monde ». Concernant <strong>le</strong>s annotations, il existe un nombre intéressant<br />
de variations autour des termes scientifiques : pour « cheminée » j’ai pu trouver des termes<br />
comme « chenil<strong>le</strong> », pour panache « penache », ou des phrases comme « la température<br />
du magma est de 00 km ». Ces dessins donnent parfois l’impression d’éléments livrés hors<br />
de tout contexte. En effet, <strong>le</strong>s contours du volcan sont parfois absents alors que certaines<br />
informations scientifiques figurent, mais sans liens entre el<strong>le</strong>s. Il semb<strong>le</strong>, à la <strong>le</strong>cture de ces<br />
productions, que <strong>le</strong>s élèves ne se sont pas encore emparés de l’enseignement qui <strong>le</strong>ur a<br />
été donné.<br />
En CM toujours, dans certains questionnaires figurent deux dessins. L’un au recto du<br />
côté des questions, l’autre au verso, sur la page blanche. Le second semb<strong>le</strong> être lié à un<br />
enseignement. J’ai, dans ce cas pris, en compte uniquement <strong>le</strong> premier (cela s’est présenté<br />
de nombreuses fois). Le dessin n° par exemp<strong>le</strong> montre une juxtaposition de deux<br />
modè<strong>le</strong>s de volcans (b et d). Il semb<strong>le</strong>, à la <strong>le</strong>cture du questionnaire, que <strong>le</strong> volcan de type<br />
b est lié aux connaissances de l’élève, et <strong>le</strong> d à l’enseignement récent sur <strong>le</strong>s volcans.<br />
En effet il existe un décalage entre <strong>le</strong>s écrits qui suivent et <strong>le</strong> dessin de type d. Cet élève<br />
semb<strong>le</strong> négocier avec ces deux états de connaissances en superposant <strong>le</strong>s deux schémas.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Il n’existe pas de dessins de ce type dans l’éco<strong>le</strong> Freinet.<br />
Concernant <strong>le</strong>s CM , il y a presque systématiquement deux dessins pour toute la classe<br />
comme si certains avaient été copiés du tab<strong>le</strong>au. Il existe quelques variations dans <strong>le</strong> nombre<br />
d’annotations présentes. Et, encore une fois, comme pour la classe précédente, il y a des<br />
dessins qui se superposent avec un dessin « spontané » de l’élève et <strong>le</strong> dessin qui serait<br />
celui du maître.<br />
Ce qui est ici intéressant, c’est que <strong>le</strong>s élèves issus de cette sous-population ont des<br />
difficultés à ajouter des informations supplémentaires lorsque cela <strong>le</strong>ur est demandé. Ils<br />
sont systématiquement dans une répétition d’éléments scientifiques déjà écrits auparavant.<br />
Dans <strong>le</strong> questionnaire n° , par exemp<strong>le</strong>, l’élève écrit « je n’ai plus de questions sur<br />
<strong>le</strong>s volcans ». Il semb<strong>le</strong>rait que <strong>le</strong> savoir présenté ne <strong>le</strong>ur permettent ni d’al<strong>le</strong>r au-delà ni<br />
de poser de questions. Alors que l’élève de l’éco<strong>le</strong> Freinet est mis dans une position de<br />
recherche permanente. Cette sous-population issue de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> donne parfois<br />
à voir l’inverse.<br />
J’ai donc, au cours des traitements de données, analysé <strong>le</strong>s résultats de la population globa<strong>le</strong>,<br />
et j’ai, à chaque fois, extrait cette dernière année pour observer s’il existait des variations.<br />
Ces procédures sont présentées dans <strong>le</strong> texte mais pas de façon systématique pour ne pas<br />
alourdir la présentation. Parfois des tendances apparaissent dans <strong>le</strong> sens où <strong>le</strong>s élèves de<br />
l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> déclarent des éléments de savoirs plus fins que <strong>le</strong>s élèves de Freinet.<br />
D’autres fois <strong>le</strong>s écarts se creusent entre <strong>le</strong>s deux populations puisque <strong>le</strong>s enseignements<br />
peuvent bloquer <strong>le</strong>s élèves dans certaines situations (poser des questions, ajouter des<br />
éléments nouveaux de savoirs,…).<br />
La situation se révè<strong>le</strong> ici paradoxa<strong>le</strong> dans la mesure où, bien que des enseignements soient<br />
donnés par <strong>le</strong>s maîtres, aucun élève ne <strong>le</strong>s cite comme des sources d’information. Alors que<br />
dans l’éco<strong>le</strong> Freinet, <strong>le</strong>s maîtres ne font pas de cours de ce type et sont pourtant cités dans<br />
cette catégorie.<br />
3. Analyse des questionnaires sur la technologie<br />
J’ai exploité ici <strong>le</strong>s questionnaires de CM et de CM concernant la technologie sur deux<br />
années scolaires : 00 - 00 et 00 - 00 .<br />
Années<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
2004-2005 2005-2006 TOTAL<br />
Freinet 79<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 72<br />
TOTAL 78 73 151<br />
Doc 34 : Détails des nombres de questionnaires selon <strong>le</strong>s années et <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s<br />
3.1. Flotte, cou<strong>le</strong> ? éléments d’explications<br />
Il a été demandé aux élèves de dessiner et d’expliquer pourquoi certains objets cou<strong>le</strong>nt et<br />
d’autres flottent.<br />
Différents critères sont recensés dans <strong>le</strong>urs productions pour expliquer ces phénomènes :<br />
–<br />
–<br />
<strong>le</strong> poids,<br />
la présence d’air dans l’objet,<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
– <strong>le</strong> fait que l’objet présente des trous dans sa structure,<br />
– la forme de l’objet (présence de bordure…).<br />
Il n’y pas de différences entre <strong>le</strong>s deux établissement concernant la production de dessins.<br />
Ils se plient de la même façon à la consigne.<br />
Dans la population globa<strong>le</strong>, seul <strong>le</strong> critère lié à la présence d’air permet de différencier <strong>le</strong>s deux<br />
éco<strong>le</strong>s. En effet sur la référence aux autres critères <strong>le</strong>s deux populations se ressemb<strong>le</strong>nt.<br />
0<br />
Critère : air<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
absence présence TOTAL<br />
Freinet<br />
Traditionnel<strong>le</strong><br />
0<br />
TOTAL 128 23 151<br />
Doc 35 : Présence/absence du critère « air » - population globa<strong>le</strong><br />
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
Les élèves dans <strong>le</strong>urs dessins peuvent faire appel à un ou plusieurs critères.<br />
Nombre de critères<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
Non réponse 1 2 3 TOTAL<br />
Freinet 79<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 0 72<br />
TOTAL 10 93 46 2 151<br />
Doc 36 : Nombre de critères explicatifs dans <strong>le</strong>s dessins - population globa<strong>le</strong><br />
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
Deux fois plus d’élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet que de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> font appel à deux<br />
critères combinés. Et aucun à l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> ne construit une explication basée sur<br />
trois critères explicatifs.<br />
Si l’on observe <strong>le</strong>s deux niveaux scolaires, en CM <strong>le</strong>s populations se ressemb<strong>le</strong>nt, et<br />
c’est en CM qu’el<strong>le</strong>s se distinguent et que <strong>le</strong>s différences entre <strong>le</strong>s deux classes sont très<br />
significatives :<br />
Nombre de critères<br />
Éco<strong>le</strong>s - CM2<br />
Non réponse 1 2 3 TOTAL<br />
Freinet 40<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 32<br />
TOTAL 6 39 26 1 72<br />
Doc 37 : Nombre de critères explicatifs dans <strong>le</strong>s dessins – CM2 uniquement<br />
La dépendance est très significative. chi = ,0 , s à .0 .<br />
Quatre fois plus d’élèves de CM de l’éco<strong>le</strong> Freinet composent des explications à l’aide de<br />
deux critères par rapport aux élèves issus de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>.<br />
3.2. La pi<strong>le</strong> et son fonctionnement<br />
Les élèves ont été amenés à expliquer l’utilisation et <strong>le</strong> fonctionnement des pi<strong>le</strong>s. Les<br />
élèves répondent de la même façon concernant la question suivante « à quoi sert une pi<strong>le</strong><br />
é<strong>le</strong>ctrique ? ». Par contre <strong>le</strong>s populations se différencient dans <strong>le</strong>s explications liées au<br />
fonctionnement de cet objet.<br />
J’ai construit six catégories de réponses :<br />
–<br />
la pi<strong>le</strong> ne produit pas d’énergie mais sert à la transmettre ;<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
– la pi<strong>le</strong> produit de l’énergie ;<br />
– la pi<strong>le</strong> est définie comme un « stock limité » d’énergie, el<strong>le</strong> est amenée à<br />
« s’user » ;<br />
– l’élève répond au fonctionnement de la pi<strong>le</strong> en expliquant son mode d’emploi ;<br />
– réponse du type : « je ne sais pas » ;<br />
–<br />
absence de réponse.<br />
Au sein de la population généra<strong>le</strong> <strong>le</strong>s deux établissements se distinguent sur quatre types<br />
de réponses : la pi<strong>le</strong> comme source d’énergie, comme stock d’énergie fini, <strong>le</strong>s réponses<br />
construites autour du mode d’emploi de la pi<strong>le</strong> et cel<strong>le</strong>s qui constituent un aveu d’ignorance<br />
(« je ne sais pas »).<br />
La pi<strong>le</strong> produit de l’énergie<br />
Eco<strong>le</strong>s<br />
non oui TOTAL<br />
Freinet 79<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 72<br />
TOTAL 112 39 151<br />
Doc 38 : La pi<strong>le</strong> décrite comme produisant de l’énergie<br />
La dépendance est significative. chi = , , s à .0 .<br />
Deux fois plus d’élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet décrivent la pi<strong>le</strong> comme un élément produisant<br />
de l’énergie. Ce critère permet de voir une différence très forte au sein de la population des<br />
CM .<br />
La pi<strong>le</strong> comme stock d’énergie fini<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
non oui TOTAL<br />
Freinet 79<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 72<br />
TOTAL 143 8 151<br />
Doc 39 : La pi<strong>le</strong> décrite comme un stock fini d’énergie<br />
La dépendance est très significative. chi = , 0, s à .0 .<br />
Aucun élève de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> n’aborde dans ses explications la notion d’usure de la<br />
pi<strong>le</strong>.<br />
Rép. liées au mode d’emploi de la pi<strong>le</strong><br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
non oui TOTAL<br />
Freinet 79<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 72<br />
TOTAL 110 41 151<br />
Doc 40 : La pi<strong>le</strong> expliquée par son mode d’emploi<br />
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
La consigne pour cette question est : « explique comment fonctionne une pi<strong>le</strong> ». Trois fois<br />
plus d’élèves issus de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> rédigent une explication autour du mode d’emploi.<br />
Ce critère permet de voir une différence très forte au sein de la population des CM et des<br />
CM .<br />
« je ne sais pas »<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
non oui TOTAL<br />
Freinet 0 79<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 72<br />
TOTAL 141 10 151<br />
Doc 41 : « Aveu d’ignorance »<br />
La dépendance est très significative. chi = , 0, s à .0 .<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
C’est encore une fois dans l’éco<strong>le</strong> Freinet que, de nouveau, l’aveu d’ignorance est plus<br />
souvent observé (principa<strong>le</strong>ment en CM ). Par contre dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>, l’absence<br />
de réponse est plus fréquente (principa<strong>le</strong>ment en CM ).<br />
3.3. Déclarations des moyens d’auto-vérification<br />
À la différence du questionnaire précédent, il n’est pas demandé aux élèves de donner des<br />
sources d’information, mais des moyens de vérifier ce qu’ils ont écrit concernant la pi<strong>le</strong> et<br />
son fonctionnement.<br />
C’est toujours uniquement dans <strong>le</strong>s réponses de l’éco<strong>le</strong> Freinet qu’il est possib<strong>le</strong> de lire des<br />
réponses du type « je ne sais pas ».<br />
Dans la population généra<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet présentent plus souvent <strong>le</strong> livre<br />
comme un outil de vérification.<br />
Le livre : outil de vérification<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
non oui TOTAL<br />
Freinet 79<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 72<br />
TOTAL 123 28 151<br />
Doc 42 : Le livre comme outil de vérification<br />
La dépendance est très significative. chi = , 0, s à .0 .<br />
Ils citent éga<strong>le</strong>ment plus souvent un spécialiste (professionnel extérieur à l’éco<strong>le</strong>).<br />
Citation du professionnel<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
non oui TOTAL<br />
Freinet 79<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 72<br />
TOTAL 143 8 151<br />
Doc 43 : Le professionnel comme outil de vérification<br />
La dépendance est significative. chi = , , s à .0 .<br />
Les élèves proposent aussi de réaliser des expériences pour vérifier <strong>le</strong>urs réponses.<br />
Ce critère est plus largement cité par <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>. Il est question<br />
d’expérience plus loin dans <strong>le</strong> questionnaire.<br />
Réalisation d’expériences<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
non oui TOTAL<br />
Freinet 79<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 72<br />
TOTAL 101 50 151<br />
Doc 44 : La réalisation d’expérience comme élément de vérification<br />
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
D’autres critères comme l’utilisation du dictionnaire ou de l’encyclopédie sont davantage<br />
cités par <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet.<br />
Pour <strong>le</strong>s CM Internet est un critère différenciant <strong>le</strong>s deux populations ( / ), ainsi que<br />
la télévision ( /0), c’est toujours dans l’éco<strong>le</strong> Freinet que ces éléments sont cités plus<br />
souvent.<br />
Si on étudie <strong>le</strong> nombre de moyens différents cités par <strong>le</strong>s élèves dans la population globa<strong>le</strong>,<br />
<strong>le</strong>s deux établissements se ressemb<strong>le</strong>nt. Par contre, si l’on regarde au sein de chaque<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
niveau scolaire, nous pouvons voir qu’il existe des différences importantes.<br />
Nombre de moyens de vérifications<br />
Éco<strong>le</strong>s – classes de CM2<br />
Non réponse 1 2 3 4 TOTAL<br />
Freinet 0 40<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 32<br />
TOTAL 14 39 10 4 5 72<br />
Doc 45 : Nombre de moyens de vérifications cités – Classes de CM2<br />
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
C’est en CM à l’éco<strong>le</strong> Freinet que <strong>le</strong>s élèves citent davantage de moyens de vérification. Les<br />
élèves de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> en citent moins et ont plus tendance à laisser des réponses<br />
vides.<br />
3.4. Souvenirs d’expériences<br />
Une question fermée permet à l’élève de déclarer s’il a déjà réalisé une expérience (oui /<br />
non).<br />
Souvenir d’expériences réalisées<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
non oui TOTAL<br />
Freinet 79<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 72<br />
TOTAL 29 122 151<br />
Doc 46 : Nombre de moyens de vérifications cités – Classes de CM2<br />
La dépendance est très significative. chi = 0, , s à .0 .<br />
Les élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet déclarent beaucoup plus souvent que <strong>le</strong>urs camarades ne pas<br />
avoir réalisé d’expériences. Si on observe <strong>le</strong>s différents niveaux, cela permet de voir que ce<br />
sont <strong>le</strong>s élèves de CM qui « tirent <strong>le</strong>s résultats » dans ce sens.<br />
Il <strong>le</strong>ur est demandé, par la suite de dessiner et d’expliquer une expérience. Nous pouvons<br />
observer plus de deux fois plus de dessins dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>. Cette situation est en<br />
lien avec <strong>le</strong>s éléments du tab<strong>le</strong>au précédant.<br />
Réalisation de dessins<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
non oui TOTAL<br />
Freinet 79<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 72<br />
TOTAL 36 115 151<br />
Doc 47 : Réalisation d’un dessin d’expérience<br />
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
Les dessins ont été exploités de différentes manières. J’y ai recensé <strong>le</strong>s éléments suivants<br />
en terme de présence ou d’absence (éléments non demandés dans la consigne) :<br />
– l’élève explique son expérience ;<br />
– l’élève légende son dessin ;<br />
– l’élève pose une question liée à son expérience ;<br />
– l’élève contextualise son expérience (il explique pourquoi il a inventé, par exemp<strong>le</strong>,<br />
un système pour nettoyer l’eau) ;<br />
–<br />
l’élève donne <strong>le</strong>s résultats de son expérience.<br />
Dans la population généra<strong>le</strong> deux critères permettent de différencier <strong>le</strong>s deux établissements :<br />
la présence de légendes et la présentation des résultats de l’expérience.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Présence de légendes<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
non oui TOTAL<br />
Freinet 79<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 0 72<br />
TOTAL 104 47 151<br />
Doc 48 : Présence de légendes dans <strong>le</strong>s dessins d’expérience<br />
La dépendance est très significative. chi = ,0 , s à .0 .<br />
Parmi <strong>le</strong>s dessins réalisés, trois fois plus de dessins de l’éco<strong>le</strong> Freinet comportent des<br />
annotations par rapport aux dessins réalisés dans l’autre éco<strong>le</strong>.<br />
Présence des résultats<br />
Éco<strong>le</strong>s<br />
non oui TOTAL<br />
Freinet 79<br />
Traditionnel<strong>le</strong> 72<br />
TOTAL 117 34 151<br />
Doc 49 : Présence des résultats dans <strong>le</strong>s dessins d’expérience<br />
La dépendance est très significative. chi = , , s à .0 .<br />
Ici nous pouvons observer une différence très significative entre <strong>le</strong>s deux établissements.<br />
Les élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet donnent près de cinq fois plus souvent <strong>le</strong>s résultats de <strong>le</strong>urs<br />
expériences.<br />
Les dessins des deux éco<strong>le</strong>s sont liés à des expériences différentes :<br />
– 5 thématiques sont traitées à l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> (parmi el<strong>le</strong>s figurent l’é<strong>le</strong>ctricité et<br />
la flottabilité – <strong>le</strong>s deux thématiques présentes dans <strong>le</strong> questionnaire) ;<br />
–<br />
20 thématiques à l’éco<strong>le</strong> Freinet (parmi el<strong>le</strong>s figurent l’é<strong>le</strong>ctricité et la flottabilité).<br />
Il existe une variété de thématiques quatre fois plus variées dans <strong>le</strong>s déclarations des élèves<br />
de l’éco<strong>le</strong> Freinet. Dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s élèves se regroupent autour d’expériences<br />
partagées. Dans l’autre établissement certaines thématiques peuvent être présentées par un<br />
ou deux élèves uniquement. Il existe une histoire de classe et une histoire plus personnel<strong>le</strong><br />
dans <strong>le</strong>s activités réalisées en classe.<br />
3.5. Spécificités des éco<strong>le</strong>s<br />
Les classes se ressemb<strong>le</strong>nt sur certains critères, mais <strong>le</strong>s différences sont marquées et<br />
nombreuses.<br />
Les élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet ont plus souvent expliqué la flottabilité à l’aide de deux critères.<br />
Leurs camarades construisent <strong>le</strong>urs explications à partir d’un critère unique. Les élèves de<br />
CM creusent <strong>le</strong>s différences.<br />
Les écrits concernant <strong>le</strong>s pi<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>ur utilité permettent d’observer une population homogène.<br />
Néanmoins, <strong>le</strong>s sous-populations se distinguent lorsqu’il est question de décrire des<br />
fonctionnements. De nouveau, la population Freinet rédige un écrit ancré sur un phénomène<br />
dynamique prenant en compte <strong>le</strong> temps. Ainsi la question de l’usure de la pi<strong>le</strong> et <strong>le</strong> fait<br />
qu’el<strong>le</strong> représente un stock fini d’énergie permet de distinguer <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s. Les élèves de<br />
l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> restent davantage sur un moment précis du phénomène : lorsque la<br />
pi<strong>le</strong> fonctionne. Ils ont tendance à décrire <strong>le</strong> mode d’emploi de l’objet quand <strong>le</strong>s élèves de<br />
l’éco<strong>le</strong> Freinet en expliquent <strong>le</strong> fonctionnement.<br />
Concernant <strong>le</strong>s outils de vérifications de <strong>le</strong>urs connaissances technologiques, <strong>le</strong>s résultats<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
sont intéressants tant du point de vue de la thématique que de la comparaison avec un<br />
type de savoir différent comme <strong>le</strong> volcanisme (cf. éléments de synthèse). Les élèves de<br />
l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> vont plus souvent citer l’expérience comme un moyen de vérification.<br />
Le livre n’est que très peu cité par cette population. Il semb<strong>le</strong> que la discipline technologie<br />
se structure, à l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>, autour d’expériences, de matériel et de manipulations.<br />
À l’éco<strong>le</strong> Freinet, la situation apparaît différente. Le savoir est ici éga<strong>le</strong>ment associé à des<br />
<strong>le</strong>ctures (livre, encyclopédie). On voit aussi que <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> déclarent<br />
avoir fait plus d’expériences. Une précaution est à prendre avant toute interprétation. Les<br />
élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet sont parfois moins « performants » du point de vue du <strong>le</strong>xique ou<br />
des codages disciplinaires (Reuter, 00 ). Peut-être s’agit-il ici de ce type de flottement ?<br />
Nommer ce type de démarche et de manipulation est peut-être moins fréquent à l’éco<strong>le</strong><br />
Freinet. Peut-être l’expérimentation n’est-el<strong>le</strong> pas la réponse exclusive ou prioritaire à tous <strong>le</strong>s<br />
problèmes posés en technologie dans cette éco<strong>le</strong> ? Néanmoins <strong>le</strong>s expériences présentées<br />
sont largement plus variées dans cet établissement. Cela peut être mis en relation avec <strong>le</strong>s<br />
cheminements individuels ou par petits groupes impulsés par <strong>le</strong>s moyens pédagogiques<br />
choisis. L’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> fonctionnerait plus souvent de façon col<strong>le</strong>ctive. Cette situation<br />
semb<strong>le</strong> réduire la variété des discours d’élèves, mais aussi aplanir <strong>le</strong>s éléments scientifiques<br />
portés par <strong>le</strong>s dessins d’expériences. Les résultats ou <strong>le</strong>s légendes sont plus souvent<br />
présents dans <strong>le</strong>s productions des élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet. Vivant des situations scolaires<br />
différentes ces élèves sont amenés à se <strong>le</strong>s présenter et donc à transformer <strong>le</strong>urs dessins<br />
d’un écrit pour soi à un écrit support de communication.<br />
Encore une fois l’aveu d’ignorance est largement plus formulé par <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong><br />
Freinet que par <strong>le</strong>s autres élèves. Il n’est donc pas lié à un type de savoir, de connaissance<br />
ou de thématique.<br />
4. Éléments de synthèse<br />
Dans cette dernière partie, je ne reprendrai pas <strong>le</strong>s résultats présentés plus haut, mais je<br />
vais tenter de <strong>le</strong>s combiner pour en retenir des tendances.<br />
Ce travail s’articu<strong>le</strong> autour de deux contenus de savoirs différents. Des questions permettent<br />
d’aborder des démarches de recherches ou de vérifications d’informations communes aux<br />
deux thématiques. Dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s élèves différencient <strong>le</strong>urs réponses selon<br />
qu’ils écrivent sur <strong>le</strong>s volcans ou sur la technologie. Il existe une polarisation des déclarations<br />
en terme d’activités de manipulation et de <strong>le</strong>cture. Le travail sur <strong>le</strong>s volcans engendre des<br />
recherches basées sur des écrits (livres, dictionnaires), alors que la technologie pousse à<br />
rester dans la manipulation, la réalisation d’expériences. Les élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet ne<br />
se positionnent pas de la même façon puisque <strong>le</strong>s outils de documentation ou de recherche<br />
peuvent être différents types d’écrits que l’on soit dans l’un ou l’autre des thèmes. Les<br />
contours des sous-disciplines ne se dessinent pas de la même façon.<br />
Une continuité existe de façon beaucoup plus forte entre <strong>le</strong>s classes de l’éco<strong>le</strong> Freinet.<br />
L’analyse des questionnaires permet de voir se dessiner une évolution entre <strong>le</strong>s niveaux<br />
scolaires dans cette éco<strong>le</strong>. Ce constat peut faci<strong>le</strong>ment être relié aux déclarations des<br />
enseignants sur <strong>le</strong>ur travail d’équipe et sur <strong>le</strong>s distinctions qu’ils effectuent entre <strong>le</strong>s modes<br />
d’actions spécifiques aux niveaux scolaires. En CE , <strong>le</strong>s élèves travail<strong>le</strong>nt sur un savoir qui<br />
<strong>le</strong>ur est proche, <strong>le</strong>s exigences des maîtres évoluent dans <strong>le</strong> temps et <strong>le</strong>s types d’activités se<br />
structurent alors différemment. Ainsi, ce travail montre que si l’on compare uniquement <strong>le</strong>s<br />
élèves de CE entre eux, c’est dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> qu’ils sont <strong>le</strong>s plus « performants ».<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Cette situation s’inverse de façon massive en CM . Il est donné du temps aux élèves dans<br />
l’éco<strong>le</strong> Freinet pour partir de <strong>le</strong>urs savoirs familiers, <strong>le</strong>s déconstruire parfois, et reconstruire<br />
des savoirs « scientifiques ». Il a souvent été allégué, sans que cela n’ait jamais été étudié ,<br />
que <strong>le</strong>s élèves ayant travaillé en primaire à partir de la pédagogie Freinet auraient des<br />
difficultés à suivre au collège. Ces résultats m’amènent à déplacer la question. Puisqu’il<br />
existe une tel<strong>le</strong> continuité entre <strong>le</strong>s niveaux scolaires au sein de l’éco<strong>le</strong> étudiée ici, que peut<br />
provoquer un changement d’établissement au milieu de cette scolarité ? Cette question peut<br />
être posée de façon plus précise sur <strong>le</strong> passage après <strong>le</strong> CE de l’éco<strong>le</strong> Freinet vers une<br />
autre éco<strong>le</strong>. Quel<strong>le</strong>s répercussions, en termes d’apprentissages, pourrait avoir cette rupture<br />
de modalité pédagogique ? Dans l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong>, <strong>le</strong> suivi entre <strong>le</strong>s classes n’est pas<br />
perceptib<strong>le</strong> de la même façon. C’est plus souvent en terme de rupture que <strong>le</strong> passage entre<br />
<strong>le</strong>s classes peut être décrit.<br />
Ce travail permet de mettre en évidence de nombreuses différences entre <strong>le</strong>s deux<br />
établissements. Si on regarde <strong>le</strong>s résultats de façon globa<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet<br />
réalisent plus souvent que <strong>le</strong>s autres élèves des écrits dynamiques prenant en compte une<br />
forme de chronologie (volcanisme et technologie). Ils vont au delà d’une description d’un<br />
moment figé, pour travail<strong>le</strong>r plus spontanément sur des phénomènes inscrits dans <strong>le</strong> temps.<br />
Ainsi certains éléments de savoirs plus fins peuvent être déclinés dans ce cadre.<br />
Je tiens à rappe<strong>le</strong>r, pour finir, que <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> Freinet sont amenés plus souvent<br />
que <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> à reconnaître des formes de savoirs non-scolaires<br />
(cf. stratégies de documentation). Cette éco<strong>le</strong> semb<strong>le</strong> tisser plus de liens avec des éléments<br />
présents hors de ses frontières.<br />
Enfin, il me semb<strong>le</strong> très important de recontextualiser ce travail. Il permet de comparer<br />
deux établissements se ressemblant du point de vue sociologique. Des ressemblances et<br />
des différences sont identifiés dans <strong>le</strong>s apprentissages et <strong>le</strong>s savoirs-faire des élèves. La<br />
comparaison avec d’autres types d’établissements autrement différenciés (du point de vue<br />
sociologique, pédagogique,…) permettrait d’avancer dans la connaissance des effets de ce<br />
mode de travail.<br />
Bibliographie<br />
Allain J.C., ( ), « Séismes, éruptions volcaniques et intérieur de la terre : conceptions<br />
d’élèves de huit à dix ans », Aster n° 0, p. - 0.<br />
Becousse G., ( 00 ), « Le devenir des élèves en sixième », dans Reuter Y, Démarches<br />
pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire ( 00 - 00 ), Erte 0 , rapport de recherche<br />
Tome , p. - .<br />
Cohen-Azria C., ( 00 ), « Représentations, pratiques postures dans l’enseignement des<br />
sciences », dans Reuter Y, Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire ( 00 -<br />
00 ), Erte 0 , rapport de recherche Tome , p. - .<br />
Reuter Y, ( 00 ), « Éléments pour un bilan provisoire : intérêts, limites et transférabilité »,<br />
dans Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire ( 00 - 00 ), Erte 0 ,<br />
rapport de recherche Tome , p. - 0.<br />
Voir l’artic<strong>le</strong> à ce sujet dans <strong>le</strong> rapport de recherche précédent (Bécousse. 00 ).<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Annexes<br />
Annexe 1 Questionnaire sur <strong>le</strong>s volcans<br />
Prénom : Nom : Classe :<br />
LES VOLCANS<br />
) Dessine un volcan (de façon détaillée) et annote ton dessin :<br />
) Explique comment fonctionne un volcan :<br />
) Y-a-t-il des personnes qui étudient <strong>le</strong>s volcans ?<br />
Oui Non<br />
Si oui, que cherchent-ils ?<br />
Si non, pourquoi ?<br />
) Que sais-tu d’autre sur <strong>le</strong>s volcans ?<br />
) As-tu encore des questions sur <strong>le</strong>s volcans ?<br />
Oui Non<br />
Si oui pose-<strong>le</strong>s par écrit :<br />
) Comment pourrais-tu trouver <strong>le</strong>s réponses à ces questions, ou des informations sur <strong>le</strong>s<br />
volcans ? (Tu peux donner plusieurs réponses)<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Annexe 2 Questionnaire sur la technologie<br />
Prénom : Nom : Classe :<br />
TECHNOLOGIE<br />
) Dans l’eau, certains objets flottent, d’autres cou<strong>le</strong>nt.<br />
Explique pourquoi ça flotte ? Explique pourquoi ça cou<strong>le</strong> ?<br />
Tu peux ajouter des dessins à tes explications.<br />
) À quoi sert une pi<strong>le</strong> é<strong>le</strong>ctrique ?<br />
) Explique comment fonctionne une pi<strong>le</strong> ?<br />
) Comment pourrais-tu vérifier ta réponse ?<br />
) As-tu déjà fait une expérience ?<br />
Oui Non<br />
Si oui, dessine-la et explique-la :<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Construire des apprentissages en éducation<br />
civique et mora<strong>le</strong><br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Maria PAGONI<br />
Maître de conférences<br />
Université de Lil<strong>le</strong> III<br />
Équipe THEODILE<br />
Cette contribution s’inscrit dans la continuité de cel<strong>le</strong> effectuée dans <strong>le</strong> rapport de recherche<br />
de l’équipe ERTé de 00 concernant l’impact de la pédagogie Freinet mise en place par<br />
<strong>le</strong>s enseignants de l’éco<strong>le</strong> HB, sur l’éducation civique et mora<strong>le</strong> des élèves. Cette première<br />
contribution portait, plus précisément, sur l’analyse des représentations des élèves par<br />
rapport au règ<strong>le</strong>ment scolaire, ses fonctions (pourquoi il existe), <strong>le</strong>s dispositifs de sa mise<br />
en place (conseil d’élèves), <strong>le</strong>s droits et obligations des élèves et des enseignants, à partir<br />
d’entretiens menés pendant <strong>le</strong>s deux premières années du projet. Les analyses effectuées<br />
mettaient en évidence qu’il y a deux tendances dans <strong>le</strong> discours des élèves interrogés :<br />
– La première, observée essentiel<strong>le</strong>ment à l’éco<strong>le</strong> témoin, consiste en une attitude de<br />
rejet de l’autorité de l’enseignant et de méfiance par rapport à la responsabilité dont il fait<br />
preuve dans différentes situations : sa capacité de protéger <strong>le</strong>s élèves en prenant une<br />
décision juste ; la justice des sanctions imposées en classe ; la responsabilité dont il fait<br />
preuve face à ses propres devoirs ; <strong>le</strong> respect exprimé vis-à-vis de l’élève. Les mêmes<br />
élèves déclarent que <strong>le</strong> règ<strong>le</strong>ment intérieur de l’éco<strong>le</strong> est inuti<strong>le</strong>. Il est un produit des<br />
adultes, rigide et inefficace, qui ne prend pas en compte <strong>le</strong>s besoins des élèves et qui<br />
n’est pas nécessaire pour la régulation de la vie scolaire et la résolution des conflits.<br />
– La deuxième tendance, observée surtout à l’éco<strong>le</strong> HB, consiste en la reconnaissance<br />
de l’autorité de la loi dans toutes ses formes. Les actions et <strong>le</strong>s choix des enseignants<br />
sont reconnus comme légitimes et valides dans différents domaines : <strong>le</strong> domaine des<br />
sanctions où la privation de l’autonomie est déclarée stimu<strong>le</strong>r la réf<strong>le</strong>xion de l’élève par<br />
rapport à son action par opposition aux sanctions expiatoires (heures de col<strong>le</strong>) qui sont<br />
considérées comme stéri<strong>le</strong>s et inefficaces ; <strong>le</strong> respect des enfants et de <strong>le</strong>urs droits,<br />
ainsi que <strong>le</strong> respect des règ<strong>le</strong>s communes de l’éco<strong>le</strong> ; la disponibilité des enseignants<br />
et la reconnaissance de <strong>le</strong>ur efficacité vis-à-vis de la protection des élèves. Ces élèves<br />
semb<strong>le</strong>nt reconnaître l’utilité du règ<strong>le</strong>ment intérieur de l’éco<strong>le</strong> et de la classe et des<br />
autres institutions, comme <strong>le</strong> conseil d’élèves, et sont capab<strong>le</strong>s de décrire avec précision<br />
<strong>le</strong> texte du règ<strong>le</strong>ment intérieur et de justifier sa mise en forme. En effet, à chaque artic<strong>le</strong><br />
du règ<strong>le</strong>ment correspondent trois colonnes qui définissent <strong>le</strong>s obligations de chacun<br />
des acteurs éducatifs : <strong>le</strong>s enseignants, <strong>le</strong>s élèves et <strong>le</strong>s parents. Les élèves semb<strong>le</strong>nt<br />
reconnaître ce texte comme source de définition des responsabilités de chacun.<br />
Suite à ces résultats nous avons formulé l’hypothèse suivante : grâce au système<br />
d’institutionnalisation des normes scolaires, la pédagogie mise en place dans cette éco<strong>le</strong><br />
favorise l’installation d’un climat de justice où élèves et enseignants sont soumis aux mêmes<br />
lois explicites et formalisées. Ce climat contribue à une éducation à la responsabilité des<br />
acteurs éducatifs :<br />
–<br />
Pour <strong>le</strong>s enseignants, il s’agit d’adopter une attitude d’éthique professionnel<strong>le</strong><br />
(remplir son devoir envers une loi impersonnel<strong>le</strong>) et prendre la loi comme un objet<br />
d’apprentissage (Pagoni, 00 ).
– Pour <strong>le</strong>s élèves, il s’agit de développer une attitude de responsabilité et de jugement<br />
autonome face aux situations de la vie scolaire.<br />
– Pour interroger ces deux hypothèses, nous allons analyser deux types de<br />
données dans <strong>le</strong> présent artic<strong>le</strong> :<br />
– Le jugement moral des élèves exprimé par rapport à de petites situations de conflit<br />
qui concernent <strong>le</strong>s va<strong>le</strong>urs de solidarité, de justice, de confiance et de respect des<br />
droits d’autrui aussi bien dans <strong>le</strong> cadre scolaire que dans <strong>le</strong> cadre extra-scolaire.<br />
Ces questionnaires ont été remplis par <strong>le</strong>s élèves de CE , CM et CM de l’éco<strong>le</strong><br />
HB et de l’éco<strong>le</strong> témoin de l’agglomération lilloise dans laquel<strong>le</strong> sont aussi effectués<br />
nos entretiens avec <strong>le</strong>s élèves. L’analyse de ce questionnaire s’inscrit donc dans la<br />
continuité de l’analyse des entretiens.<br />
–<br />
Les attitudes des élèves et des enseignants au sein des conseils d’élèves : quels<br />
sont <strong>le</strong>s thèmes dont <strong>le</strong>s élèves par<strong>le</strong>nt, quel<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong>s normes mobilisées pendant <strong>le</strong>s<br />
débats et la résolution des conflits, quel est <strong>le</strong> degré de participation des élèves par rapport<br />
à celui de l’enseignant, quel<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong>s activités langagières qui sont dominantes ?<br />
Est-ce qu’il y a des indicateurs qui montrent que la loi et son fonctionnement sont pris<br />
comme des objets d’apprentissage ? Est-ce qu’il y a des différences par rapport à<br />
d’autres conseils à ce propos ? Ces données vont nous aider à mieux expliquer <strong>le</strong>s<br />
résultats observés dans <strong>le</strong>s entretiens et <strong>le</strong>s questionnaires et à construire certaines<br />
hypothèses interprétatives concernant la pédagogie utilisée à l’éco<strong>le</strong> HB dans ce<br />
domaine d’apprentissage.<br />
1. Évaluation du jugement moral des élèves à partir de petites situations<br />
de conflit<br />
00<br />
1.1. Précisions méthodologiques<br />
Cette partie présente l’analyse du questionnaire qui a été rempli par <strong>le</strong>s élèves de CE ,<br />
CM et CM en mai 00 de l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher et de l’éco<strong>le</strong> témoin qui se trouve dans<br />
l’agglomération lilloise. Les caractéristiques de cette population sont présentées dans <strong>le</strong><br />
tab<strong>le</strong>au ci-dessous :<br />
Tab<strong>le</strong>au 1. Caractéristiques de la population qui a répondu au questionnaire.<br />
Éco<strong>le</strong> Classe<br />
Sexe<br />
F G<br />
Éco<strong>le</strong> HB<br />
Somme HB<br />
CE<br />
CM<br />
CM<br />
Éco<strong>le</strong> témoin CE<br />
Somme témoin<br />
CM<br />
CM<br />
0<br />
Total 0<br />
Ce questionnaire est constitué par quatre situations qui mettent en scène des transgressions<br />
de lois (mora<strong>le</strong>s, juridiques ou institutionnel<strong>le</strong>s) à l’intérieur ou à l’extérieur de l’éco<strong>le</strong>, comme<br />
<strong>le</strong> montre <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au suivant :<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
Total
Situations<br />
Caractéristiques<br />
Perspectives de<br />
la loi<br />
Tab<strong>le</strong>au 2. Caractéristiques des situations proposées aux élèves<br />
Situation n° Situation n° Situation n° Situation n°<br />
-Loi mora<strong>le</strong>, non écrite<br />
- Loi institutionnel<strong>le</strong><br />
Va<strong>le</strong>urs en jeu - égalité des droits,<br />
justice de partage, de<br />
distribution<br />
Lieu À l’intérieur de la<br />
classe<br />
Loi mora<strong>le</strong>,<br />
non écrite<br />
Solidarité,<br />
responsabilité<br />
col<strong>le</strong>ctive<br />
À l’extérieur de<br />
l’éco<strong>le</strong><br />
- Loi juridique<br />
- Loi mora<strong>le</strong>, non<br />
écrite<br />
Respect des<br />
droits, non respect<br />
des droits<br />
À l’extérieur de<br />
l’éco<strong>le</strong><br />
Acteurs impliqués Entre élèves Entre enfants Entre personnes<br />
qui ne se<br />
connaissent pas<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
-loi institutionnel<strong>le</strong><br />
(autorité adulte)<br />
- loi mora<strong>le</strong> non<br />
écrite<br />
Justice d’une<br />
punition<br />
À l’intérieur de<br />
l’éco<strong>le</strong><br />
Entre maître et<br />
élèves<br />
El<strong>le</strong>s sont inspirées de di<strong>le</strong>mmes moraux qui ont été utilisés pour évaluer <strong>le</strong> jugement moral<br />
des enfants, des ado<strong>le</strong>scents et des adultes pendant <strong>le</strong>s années 0. Ces types de di<strong>le</strong>mmes<br />
ont donné lieu à une série de travaux aussi bien de recherche que d’outils de formation dans<br />
une perspective didactique : comment et dans quel<strong>le</strong>s conditions des situations de ce type,<br />
fictives ou réel<strong>le</strong>s, peuvent être utilisées en classe pour construire des tâches scolaires<br />
susceptib<strong>le</strong>s d’aider <strong>le</strong>s élèves à construire des notions mora<strong>le</strong>s et/ou juridiques liées au<br />
fonctionnement de la loi (Pagoni, 00 ) ?<br />
Chaque situation est suivie par trois types de questions : une question qui invite l’élève<br />
à exprimer un jugement par rapport à l’action commise par <strong>le</strong>s acteurs de la situation ;<br />
une question qui invite l’élève à justifier <strong>le</strong> jugement exprimé précédemment ; une question<br />
qui porte sur des perspectives d’actions possib<strong>le</strong>s pour trouver une solution au problème<br />
évoqué.<br />
Précisons que dans <strong>le</strong> présent contexte ces situations ne sont pas utilisées comme des<br />
outils psychologiques d’évaluation du jugement moral (à quel stade se situe l’élève ?),<br />
usage qui, par ail<strong>le</strong>urs a été critiquée par différents auteurs. El<strong>le</strong>s constituent pour nous des<br />
outils d’évaluation didactique qui révè<strong>le</strong>nt si et comment <strong>le</strong>s élèves mobilisent une notion<br />
(juste/injuste, responsabilité, solidarité, droit/non droit) dans une situation de résolution<br />
de problème. El<strong>le</strong>s constituent donc des moyens d’évaluation des acquis opératoires des<br />
élèves dans ce domaine d’apprentissage.<br />
1.2. Analyse des résultats<br />
1.2.1. Situation n°1.<br />
Cette semaine, Sylvie est responsab<strong>le</strong> de la distribution de la paro<strong>le</strong> dans la classe. Or, ses<br />
camarades remarquent qu’el<strong>le</strong> a tendance à donner la paro<strong>le</strong> à ses meil<strong>le</strong>ures copines et à ne<br />
pas faire attention aux autres élèves qui lèvent la main.<br />
A. Qu’est-ce que tu penses de l’action de Sylvie ?<br />
B. Dis aussi pourquoi.<br />
C. Qu’est-ce que tu penses que ses camarades doivent faire pour résoudre ce problème ?<br />
Pour la question A nous trouvons différents types de réponse :<br />
0
0<br />
– jugement imprécis (impr) qui fait appel à une norme non définie : c’est bien, pas bien,<br />
c’est mal, c’est bête, c’est pas correct, ce n’est pas une bonne action, c’est normal, ce<br />
n’est pas normal, el<strong>le</strong> a raison, el<strong>le</strong> a tort.<br />
– jugement affectif (aff) : c’est gentil, méchant ; el<strong>le</strong> aime que ses copines ; el<strong>le</strong> n’aime<br />
pas <strong>le</strong>s autres camarades ; el<strong>le</strong> n’aime pas <strong>le</strong>s garçons ;<br />
– jugement qui fait appel à une va<strong>le</strong>ur (val) qui est cel<strong>le</strong> de juste/injuste et responsab<strong>le</strong> :<br />
ce n’est pas juste ; el<strong>le</strong> ne fait pas bien sa responsabilité ;<br />
– Absence de réponse ou « je ne sais pas » ou réponse hors contexte ou réponse qui<br />
répète la consigne (abs)<br />
Tab<strong>le</strong>au 3 : Analyse des réponses de la question 1A1<br />
Types de réponse ( A)<br />
Éco<strong>le</strong> Classe abs aff impr val Total<br />
HB CE ,0 % , % , % , % 00,00%<br />
CM , % , % , % , % 00,00%<br />
CM , % , 0% , % , 0% 00,00%<br />
Somme HB ,0 % , % , % , % 00,00%<br />
Témoin CE , % , % 0,00% , % 00,00%<br />
CM , % , % , % , % 00,00%<br />
CM , % , % , % , % 00,00%<br />
Somme témoin , % , % , % , % 00,00%<br />
Total , % , 0% , % 0, % 00,00%<br />
Trois remarques sont à effectuer par rapport à ce tab<strong>le</strong>au. Premièrement, la référence<br />
à la notion de justice a tendance à augmenter avec l’âge dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s mais<br />
évolue plus <strong>le</strong>ntement à l’éco<strong>le</strong> témoin ( , % en CM contre , 0% à l’éco<strong>le</strong> HB).<br />
Ensuite, nous remarquons que <strong>le</strong>s réponses affectives sont plus présentes à l’éco<strong>le</strong><br />
témoin, surtout en CE ( , %) et en CM ( , %). Fina<strong>le</strong>ment, il s’agit de constater<br />
que l’absence de réponse est plus fréquente à l’éco<strong>le</strong> Montaigne, surtout en CE et en<br />
CM ( , % et , %).<br />
Pour la question B nous trouvons <strong>le</strong>s catégories suivantes de réponse :<br />
– justification tautologique (taut) : répétition de l’action ou répétition du jugement de<br />
va<strong>le</strong>ur de la question précédente : parce qu’el<strong>le</strong> n’interroge que ses copines ; parce que<br />
<strong>le</strong>s autres n’ont plus la paro<strong>le</strong> ; parce qu’on peut choisir <strong>le</strong>s autres élèves ; parce que<br />
c’est pas bien ;<br />
– justification par rapport à une loi ou un droit (droit) ou une va<strong>le</strong>ur généralisée : parce<br />
que tout <strong>le</strong> monde peut avoir la paro<strong>le</strong> ; parce que c’est pas juste ; parce que même<br />
<strong>le</strong>s autres ont droit à la paro<strong>le</strong> ; parce qu’el<strong>le</strong> ne respecte pas <strong>le</strong>s autres élèves ; parce<br />
qu’el<strong>le</strong> fait des différences ;<br />
– justification par rapport à une règ<strong>le</strong> (règ<strong>le</strong>) : parce que tout <strong>le</strong> monde doit avoir la<br />
paro<strong>le</strong> ;<br />
– Pas de réponse ou « je ne sais pas » ou réponse hors contexte (Abs) ;<br />
–<br />
Justification compréhensive faisant appel aux conséquences sur <strong>le</strong>s autres ou à<br />
l’analyse des motifs des autres (autres) : tout <strong>le</strong> monde va être jaloux ; <strong>le</strong>s autres ne<br />
peuvent pas donner <strong>le</strong>ur avis ; parce que <strong>le</strong>s autres attendent ; <strong>le</strong>s autres n’ont jamais<br />
la paro<strong>le</strong> et ne peuvent pas dire ce qu’ils pensent ; tout <strong>le</strong> monde veut s’exprimer ; sinon<br />
Tous <strong>le</strong>s tab<strong>le</strong>aux présentent <strong>le</strong>s pourcentages des réponses des élèves calculés en ligne. Les<br />
fréquences brutes n’y sont pas présentées parce que certains tab<strong>le</strong>aux seraient trop denses et diffici<strong>le</strong>s à lire.<br />
Les rubriques « somme » et « total » ne représentent pas donc <strong>le</strong> total des pourcentages mais <strong>le</strong> total des<br />
fréquences des réponses qui correspondent à des pourcentages toujours calculés en ligne.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
<strong>le</strong>s autres ne peuvent pas réfléchir et progresser ;<br />
– justification qui fait appel à l’autorité ou à la peur des conséquences sur soi (ego) :<br />
parce qu’ils vont la critiquer ; un jour el<strong>le</strong> va se retrouver toute seu<strong>le</strong>.<br />
Tab<strong>le</strong>au 4 : Analyse des réponses de la question 1B<br />
Types de réponse ( B)<br />
Éco<strong>le</strong> Classe abs aff autres droit ego règ<strong>le</strong> taut Total<br />
HB CE 0, % 0,00% , % 0,00% , 0% , 0% , % 00,00%<br />
CM , % 0,00% , % ,0 % 0,00% ,0 % , % 00,00%<br />
CM , % 0,00% , % , 0% 0,00% , % , % 00,00%<br />
Somme HB , % 0,00% , % ,0 % , % , % , % 00,00%<br />
Témoin CE , % , % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 00,00%<br />
CM , % 0,00% ,0 % 0,00% 0,00% , % 0, % 00,00%<br />
CM , % 0,00% , % , % , % , % ,00% 00,00%<br />
Somme témoin , % , % , % , % , % , % , % 00,00%<br />
Total , % 0, % , % , % , % , % ,0 % 00,00%<br />
Le tab<strong>le</strong>au montre que :<br />
– l’absence de réponse, <strong>le</strong>s justifications tautologiques et <strong>le</strong>s justifications par référence<br />
à une règ<strong>le</strong> sont équiva<strong>le</strong>ntes dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s sauf pour <strong>le</strong> CM de l’éco<strong>le</strong> HB où<br />
cette catégorie est particulièrement augmentée. Les arguments affectifs sont aussi très<br />
peu présents dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s.<br />
– Les arguments qui se réfèrent aux conséquences sur <strong>le</strong>s autres sont plus utilisés à<br />
l’éco<strong>le</strong> HB surtout dans <strong>le</strong>s classes de CE et de CM ( , % contre 0% et ,0 % à<br />
l’éco<strong>le</strong> témoin) tandis qu’en CM <strong>le</strong>s résultats sont inversés ( , % à l’éco<strong>le</strong> HB contre<br />
, % à l’éco<strong>le</strong> témoin).<br />
– La référence aux droits est équiva<strong>le</strong>nte dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s mais avec des variations<br />
entre <strong>le</strong>s classes : à l’éco<strong>le</strong> HB el<strong>le</strong> est plus fréquente en CM ( ,0 %) tandis qu’à<br />
l’éco<strong>le</strong> témoin el<strong>le</strong> est plus fréquente en CM ( , %).<br />
Face à cette question C (perspectives d’action), nous pouvons trouver <strong>le</strong>s catégories<br />
suivantes de réponse :<br />
– Résoudre <strong>le</strong> problème par la communication (comm) : par<strong>le</strong>r à Sylvie ;<br />
– Résoudre <strong>le</strong> problème en faisant appel à l’autorité du maître (aut) ;<br />
– Résoudre <strong>le</strong> problème par l’agressivité (agres) : ils doivent lui crier dessus ;<br />
– Résoudre <strong>le</strong> problème par une stratégie instrumenta<strong>le</strong> (instr) : ils doivent devenir ses<br />
copains et copines pour qu’el<strong>le</strong> <strong>le</strong>s interroge ;<br />
– Résoudre <strong>le</strong> problème par <strong>le</strong> recours à une institution, par exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong> conseil d’élève<br />
ou <strong>le</strong> changement de responsabilité (inst) : ils doivent changer de responsab<strong>le</strong> de<br />
distribution de la paro<strong>le</strong> ; ils doivent voter pour élire une autre personne ; la critiquer (ce<br />
qui signifie « critiquer Sylvie dans <strong>le</strong> Conseil » où il y a un temps spécial consacré aux<br />
critiques) ;<br />
–<br />
Absence de réponse ou « je ne sais pas » ou réponse hors contexte (Abs). On met<br />
aussi ici <strong>le</strong>s réponses qui décrivent la réaction des camarades sans donner de solution,<br />
par exemp<strong>le</strong> « je pense que ses camarades ne sont pas contents » ou encore <strong>le</strong>s<br />
réponses tautologiques : « ils doivent trouver une solution ».<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0
0<br />
Tab<strong>le</strong>au 5 : Analyse des réponses de la question 1C<br />
Types de réponses ( C)<br />
Éco<strong>le</strong> Classe abs agres aut comm inst instr règ<strong>le</strong> Total<br />
HB CE , % 0,00% ,0 % 0,00% , % 0,00% 0,00% 00,00%<br />
CM , 0% 0,00% ,0 % , % 0, % 0,00% 0,00% 00,00%<br />
CM ,00% 0,00% ,00% , 0% , 0% 0,00% 0,00% 00,00%<br />
Somme HB , % 0,00% 0, % , % 30,6 % 0,00% 0,00% 00,00%<br />
Témoin CE 0,00% 0,00% 0,00% , % 0,00% , % , % 00,00%<br />
CM ,0 % 0,00% , % ,0 % , % ,0 % 0,00% 00,00%<br />
CM 0, % 0, % , % , % 0, % 0,00% 0,00% 00,00%<br />
Somme témoin , % , % 49,23% , % , % , % , % 00,00%<br />
Total , 0% , % , % ,0 % , % , % 0, % 00,00%<br />
L’absence de réponse est plus fréquente à l’éco<strong>le</strong> HB pour <strong>le</strong>s classes de CE et de CM .<br />
Parmi <strong>le</strong>s perspectives d’action qui sont données, on peut remarquer qu’à l’éco<strong>le</strong> témoin<br />
la première réaction qui apparaît est <strong>le</strong> recours au maître ( , %), puis la communication<br />
( , %) tandis qu’à l’éco<strong>le</strong> HB <strong>le</strong>s élèves évoquent plus souvent <strong>le</strong> recours à une instance<br />
institutionnel<strong>le</strong> ( 0, %) ce qui révè<strong>le</strong> une tendance importante d’intégration du mode de<br />
fonctionnement de cette éco<strong>le</strong>.<br />
1.2.2. Situation n°2<br />
C’est l’hiver. Quatre copains du quartier jouent dans la rue en lançant des bou<strong>le</strong>s de neige.<br />
L’un des enfants casse <strong>le</strong> carreau d’une voiture sans faire exprès. Le propriétaire de la voiture<br />
arrive et veut obtenir réparation. Un des quatre enfants, Mathieu, dénonce l’enfant qui a cassé<br />
<strong>le</strong> carreau.<br />
A. Qu’est-ce que tu penses de l’action de Mathieu ?<br />
B. Dis aussi pourquoi.<br />
C. Qu’est-ce que tu proposerais au propriétaire de la voiture si tu faisais partie de ce groupe<br />
d’enfants ?<br />
Pour la question A nous trouvons quatre catégories de réponses :<br />
– Jugement imprécis (impr) : c’est bien / correcte / pas bien ;<br />
– Jugement affectif (aff) : gentil / pas gentil, méchant ;<br />
– indécis (indécis) : c’est bien et pas bien ;<br />
–<br />
absence de jugement ou réponse hors contexte (abs) : je pense que cette action doit<br />
réparation.<br />
Tab<strong>le</strong>au 6 : Analyse des réponses de la question 2A<br />
Types de réponses ( A)<br />
Éco<strong>le</strong> Classe abs aff impr indécis Total<br />
HB CE ,0 % , 0% , % 0,00% 00,00%<br />
CM ,0 % , % , % ,0 % 00,00%<br />
CM , 0% 0,00% ,00% , 0% 00,00%<br />
Somme HB , 0% , % , % ,0 % 00,00%<br />
témoin CE 0,00% , % , % , % 00,00%<br />
CM , % , % , % , % 00,00%<br />
CM 0,00% , % , % , % 00,00%<br />
Somme témoin 0, % , % , % , % 00,00%<br />
Total , % , 0% , 0% ,0 % 00,00%<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Le tab<strong>le</strong>au ci-dessus montre que <strong>le</strong> jugement qui domine dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s est <strong>le</strong> jugement<br />
normatif imprécis (bien / pas bien). Il n’y a pas de réponses exprimées en termes de va<strong>le</strong>urs<br />
explicites comme c’était <strong>le</strong> cas dans la première situation. Nous pouvons expliquer cette<br />
tendance par <strong>le</strong> fait que la première situation est familière aux élèves puisqu’el<strong>le</strong> renvoie à<br />
l’expérience de <strong>le</strong>ur vie de classe où la notion de justice fait partie du quotidien scolaire de<br />
façon implicite ou explicite. Par contre la deuxième situation, d’une part est inconnue aux<br />
élèves puisqu’el<strong>le</strong> est imaginaire et se dérou<strong>le</strong> à l’extérieur de l’éco<strong>le</strong> et, d’autre part, el<strong>le</strong> fait<br />
allusion à la notion de solidarité qui n’est pas fréquemment utilisée au sein de l’éco<strong>le</strong>.<br />
En question B <strong>le</strong>s justifications fournies par <strong>le</strong>s élèves se repartissent dans <strong>le</strong>s catégories<br />
suivantes :<br />
– Éviter <strong>le</strong>s mauvaises conséquences sur <strong>le</strong>s autres (autres) en faisant preuve d’une<br />
prise de conscience de l’appartenance col<strong>le</strong>ctive : sinon tout <strong>le</strong> monde aurait pris pour<br />
lui ;<br />
– Éviter <strong>le</strong>s mauvaises conséquences sur soi (ego) : après ils ne voudront plus lui<br />
causer ;<br />
– Argument affectif (aff) concernant la trahison des copains (c’est un de ses copains),<br />
ou la mise à la place de l’autre (si c’était lui, il n’aurait pas aimé). Ce qui différencie<br />
cette catégorie de la catégorie « autres » c’est qu’el<strong>le</strong> se base sur une perspective<br />
d’attachement interpersonnel et non pas sur une perspective liée à la col<strong>le</strong>ctivité.<br />
– Réponse tautologique (description de l’action) ou jugement de va<strong>le</strong>ur général qui<br />
renvoie plutôt à la réponse précédente (taut) : parce que Mathieu dénonce l’enfant qui<br />
a cassé <strong>le</strong> carreau ; parce que c’est normal ; c’est pas bien de dénoncer ;<br />
– Faire référence à une règ<strong>le</strong> (règ<strong>le</strong>) : il faut toujours dire la vérité ; il faut dénoncer<br />
celui qui l’a fait ;<br />
– Faire référence à l’autorité (aut) : dire aux parents, punir.<br />
– Faire appel à la responsabilité (resp) du coupab<strong>le</strong> (il faut se dénoncer soi-même), à<br />
ses motifs (il n’a pas fait exprès), ou au partage de la responsabilité au sein du groupe (il<br />
jouait lui aussi) ;<br />
–<br />
Absence de réponse ou « je ne sais pas » (abs).<br />
Tab<strong>le</strong>au 7 : Analyse des réponses de la question 2B<br />
Types de réponse ( B)<br />
Éco<strong>le</strong> Classe abs aff aut autres ego règ<strong>le</strong> resp taut Total<br />
HB CE , % ,0 % , % , 0% 0,00% , 0% 0,00% 0, % 00,00%<br />
CM , % ,0 % 0,00% , % , % , % , 0% , % 00,00%<br />
CM , % , % 0,00% 0,00% , 0% , % , % 0,00% 00,00%<br />
Somme HB 0, % , % , % , % , % , % , % , % 00,00%<br />
Témoin CE , % , % 0,00% , % 0,00% , % , % , % 00,00%<br />
CM , % 0, % 0,00% ,0 % , % ,0 % ,0 % , % 00,00%<br />
CM , % , % 0,00% , % 0, % 0,00% 0, % , % 00,00%<br />
Somme témoin , % , % 0,00% , % , % , % , % , % 00,00%<br />
Total , % 0, % 0, % , % , % , 0% 0, % , 0% 00,00%<br />
Le tab<strong>le</strong>au montre que l’absence de réponse est plus fréquente à l’éco<strong>le</strong> HB particulièrement<br />
en CE . D’une manière généra<strong>le</strong>, c’est surtout <strong>le</strong>s réponses affectives qui sont mobilisées<br />
par <strong>le</strong>s élèves, et el<strong>le</strong>s sont un peu plus é<strong>le</strong>vées à l’éco<strong>le</strong> témoin surtout en CE et en CM .<br />
Les réponses tautologiques sont aussi fréquentes dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s mais avec des<br />
variations par classe : el<strong>le</strong>s ont tendance à diminuer avec l’âge à l’éco<strong>le</strong> HB (0,00% en CM )<br />
tandis qu’el<strong>le</strong>s sont très fréquentes en CM à l’éco<strong>le</strong> témoin ( , %). Autre différence<br />
qu’on peut observer c’est que <strong>le</strong>s arguments liés à la responsabilité sont plus présents à<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0
l’éco<strong>le</strong> HB et, surtout en CM .<br />
Pour la question C <strong>le</strong>s perspectives d’action proposées peuvent se catégoriser de la façon<br />
suivante :<br />
0<br />
– Recourir au dialogue pour excuser, dire qu’on n’a pas fait exprès (comm) ;<br />
– Adopter une attitude qui fait appel au profit personnel (ego) : je vais la réparer pour<br />
me faire payer ;<br />
– Faire appel à l’autorité (aut) des parents ou du propriétaire : je lui dirais de venir et<br />
<strong>le</strong>s punir ;<br />
– Faire appel à la réparation sans précision (resp) : il faut réparer, al<strong>le</strong>r chez <strong>le</strong><br />
garagiste ;<br />
–<br />
Proposer de répartir <strong>le</strong> remboursement entre tous <strong>le</strong>s enfants du groupe ou essayer<br />
de protéger <strong>le</strong> coupab<strong>le</strong> (solid) : je dirais que c’est pas nous qui l’avons fait ;<br />
Tab<strong>le</strong>au 8 : Analyse des réponses de la question 2C<br />
Types de réponse ( C)<br />
Éco<strong>le</strong> Classe abs aut comm ego resp solid Total<br />
HB CE , % , % , % , % 0, % 0,00% 00,00%<br />
CM 0, % 0,00% , % 0,00% , % , % 00,00%<br />
CM , 0% ,00% , % , % ,00% ,00% 00,00%<br />
Somme HB ,0 % , % , % , % 0, % , 0% 00,00%<br />
Témoin CE , % , % 0,00% , % , % , % 00,00%<br />
CM , % 0,00% ,0 % 0,00% 0, % , % 00,00%<br />
CM , % , % , % , % ,00% , % 00,00%<br />
Somme témoin , % , % ,0 % , % , % , % 00,00%<br />
Total , % , % , % , % ,0 % , % 00,00%<br />
Le tab<strong>le</strong>au montre que l’absence de réponse est particulièrement é<strong>le</strong>vée à la classe de<br />
CE de l’éco<strong>le</strong> HB ( , % des réponses). On remarque que la proposition qui domine<br />
dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s, c’est la proposition de réparation de l’acte (resp) qui se présente de<br />
façon plus é<strong>le</strong>vée à l’éco<strong>le</strong> témoin en classes de CE et de CM . Si on fait une analyse plus<br />
détaillée par classe, on voit qu’à l’éco<strong>le</strong> témoin, en CM , la catégorie la plus é<strong>le</strong>vée est la<br />
communication ( , %), catégorie qui est aussi particulièrement é<strong>le</strong>vée en classe de CE<br />
de la même éco<strong>le</strong> tandis qu’en CM c’est surtout la catégorie de solidarité qui se distingue<br />
( , %). À l’éco<strong>le</strong> HB, La solidarité apparaît plus accentuée en CM ( ,00%), en CM <strong>le</strong>s<br />
propositions effectuées se partagent entre communication ( , %) et solidarité ( , %)<br />
tandis qu’en CE c’est <strong>le</strong> recours à l’autorité qui apparaît aussi très souvent ( , %). Les<br />
mêmes catégories de réponse apparaissent donc dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s mais avec des<br />
variations importantes entre <strong>le</strong>s classes.<br />
1.2.3. Situation n°3<br />
Denise, une fil<strong>le</strong> de 0 ans, aime beaucoup des animaux. Mais il y a quelques mois qu’el<strong>le</strong><br />
s’est aperçue que <strong>le</strong> chien du voisin était attaché toute la journée en plus d’être malpropre et<br />
mal nourri. Il arrive même que ce chien soit battu par son propriétaire lorsque celui-ci est une<br />
mauvaise humeur. À chaque fois qu’el<strong>le</strong> regarde à travers la clôture el<strong>le</strong> voit que <strong>le</strong> chien a l’air<br />
encore plus misérab<strong>le</strong>. Denise s’inquiète que <strong>le</strong> chien souffre et puisse mourir de tels mauvais<br />
traitements.<br />
A. Qu’est-ce que Denise doit faire à ton avis ? B. Dis aussi pourquoi. C. Qu’est-ce que Denise<br />
a <strong>le</strong> droit de faire pour sauver <strong>le</strong> chien ? D. Qu’est-ce que Denise n’a pas <strong>le</strong> droit de faire pour<br />
sauver <strong>le</strong> chien ?<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Dans cette situation <strong>le</strong> choix de la perspective d’action vient d’abord ( A), puis vient la<br />
justification ( B), puis viennent deux questions qui renvoient aux notions de droit ( C) et de<br />
non droit ( D). L’objectif de ce questionnement était de voir si <strong>le</strong>s élèves font la distinction<br />
entre un choix d’action qui correspond à <strong>le</strong>ur propre conception du devoir (agir devant une<br />
situation de maltraitance) et l’espace de possib<strong>le</strong>s offert par la loi à ce propos (droits et non<br />
droits à respecter).<br />
A. Le tab<strong>le</strong>au suivant montre que <strong>le</strong>s élèves font des propositions d’action qui se distinguent<br />
selon différentes catégories.<br />
Tab<strong>le</strong>au 9 : Analyse des réponses de la question 3A<br />
Types de réponse ( A)<br />
Éco<strong>le</strong> Classe abs aut comm indiff inst<br />
perso/<br />
nonpert perso/pert Total<br />
HB CE , % 0,00% , % 0,00% , % 0, % ,0 % 00,00%<br />
CM , % , % , % 0,00% , % ,0 % , % 00,00%<br />
CM , 0% 0,00% , % 0,00% , % , 0% , 0% 00,00%<br />
Somme HB , % , % 0, % 0,00% , % , 0% , % 00,00%<br />
Témoin CE 0,00% , % , % 0,00% 0,00% 0,00% , % 00,00%<br />
CM , % ,0 % 0, % 0,00% , % ,0 % ,0 % 00,00%<br />
CM 0,00% , % , % , % , % , % , % 00,00%<br />
Somme témoin , % , % , % , % ,0 % , % 0, % 00,00%<br />
Total , % , % , % , % , 0% , % , 0% 00,00%<br />
Ces catégories correspondent aux réponses suivantes :<br />
– Résoudre <strong>le</strong> problème par la communication (comm) : par<strong>le</strong>r au propriétaire, discuter<br />
avec lui ;<br />
– Résoudre <strong>le</strong> problème en faisant appel à l’autorité des parents (aut) : <strong>le</strong> dire à ses<br />
parents ;<br />
– Proposer une action personnel<strong>le</strong> pertinente, c’est-à-dire autorisée (perso/pert) : el<strong>le</strong><br />
doit s’occuper de lui, l’aider ;<br />
– Proposer une action personnel<strong>le</strong> non pertinente (perso/nonpert) : <strong>le</strong> détacher, <strong>le</strong><br />
libérer, <strong>le</strong> délivrer ;<br />
– Proposer une action qui fait appel à une instance extérieure, une institution (inst) :<br />
el<strong>le</strong> doit porter plainte, al<strong>le</strong>r voir la police, al<strong>le</strong>r voir la SPA, <strong>le</strong> vétérinaire.<br />
– Absence de réponse ou « je ne sais pas » ou réponse hors contexte (Abs) qui<br />
témoigne d’une confusion de points de vue : je pense que Denise aime beaucoup <strong>le</strong>s<br />
animaux ;<br />
–<br />
Proposer une attitude de neutralité ou d’indifférence (indiff) : el<strong>le</strong> ne doit rien faire ;<br />
Le tab<strong>le</strong>au montre qu’à l’éco<strong>le</strong> HB nous avons un plus grand nombre de réponses<br />
personnel<strong>le</strong>s pertinentes ou non pertinentes ( , % et , 0% respectivement). À<br />
l’éco<strong>le</strong> témoin, <strong>le</strong>s propositions d’action sont plus éga<strong>le</strong>ment reparties entre <strong>le</strong>s actions<br />
de communication ( , %) et de recours à une institution ( ,0 %) tandis qu’on trouve<br />
aussi un pourcentage non négligeab<strong>le</strong> de réponses d’indifférence en CM ( , %). Nous<br />
pouvons donc faire une première hypothèse qui consiste à dire que la notion du devoir à<br />
l’éco<strong>le</strong> témoin se situe déjà dans l’espace des possib<strong>le</strong>s du droit tandis qu’à l’éco<strong>le</strong> HB <strong>le</strong>s<br />
réponses révè<strong>le</strong>nt plutôt la spontanéité d’un devoir moral d’assistance.<br />
Face à la question B <strong>le</strong>s justifications fournies par <strong>le</strong>s élèves se distinguent selon <strong>le</strong>s<br />
catégories suivantes :<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0
0<br />
– justification qui fait appel à la peur des conséquences sur soi (ego) : c’est pas ses<br />
affaires ;<br />
– jugement de va<strong>le</strong>ur général (impr) : parce que c’est pas bien, c’est méchant ;<br />
– conséquences sur <strong>le</strong> chien (aff) : parce qu’il peut mourir, parce qu’il lui fait mal, pour<br />
<strong>le</strong> sauver, il est malheureux ;<br />
– Faire appel à une va<strong>le</strong>ur (val) généralisée (un chien est presque comme un<br />
humain) ou à un droit (on n’a pas <strong>le</strong> droit de maltraiter <strong>le</strong>s animaux), ou à une fonction<br />
généralisée (parce que la SPA protège <strong>le</strong>s animaux) ;<br />
– Faire appel à la responsabilité de Denise face au chien et par rapport à ses principes<br />
(resp) : parce qu’el<strong>le</strong> aime <strong>le</strong>s animaux, parce qu’el<strong>le</strong> doit faire son idée ;<br />
– Pas de réponse ou « je ne sais pas » ou réponse hors contexte (Abs) ;<br />
Tab<strong>le</strong>au 10 : Analyse des réponses de la question 3B<br />
Types de réponse ( B)<br />
Éco<strong>le</strong> Classe abs aff ego impr resp val Total<br />
HB CE , % ,0 % 0,00% 0,00% 0,00% , 0% 00,00%<br />
CM , % , % 0,00% , % ,0 % , 0% 00,00%<br />
CM , % ,00% , % ,00% 0,00% , 0% 00,00%<br />
Somme HB 38,71% , % , % , 0% , % , % 00,00%<br />
Témoin CE , % , % 0,00% , % 26,67% , % 00,00%<br />
CM , % , % , % , % ,0 % , % 00,00%<br />
CM , % , % , % 0, % 0,00% 0, % 00,00%<br />
Somme témoin , % , % 9,23% 0, % 9,23% 0, % 00,00%<br />
Total , 0% , % , % , % ,0 % 0, % 00,00%<br />
Nous remarquons que l’absence de réponse est plus fréquente à l’éco<strong>le</strong> HB et, surtout, en<br />
classe de CE , comme nous l’avons déjà remarqué auparavant. Les justifications affectives<br />
dominent dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s et sont presque équiva<strong>le</strong>ntes ( , % à l’éco<strong>le</strong> HB et , %<br />
à l’éco<strong>le</strong> témoin) comme c’est <strong>le</strong> cas aussi pour <strong>le</strong>s réponses imprécises mais avec des<br />
variations selon <strong>le</strong>s classes : <strong>le</strong>ur présence est presque doublée en CM de l’éco<strong>le</strong> HB par<br />
rapport à l’éco<strong>le</strong> témoin ( ,00% à l’éco<strong>le</strong> HB contre 0, % à l’éco<strong>le</strong> témoin). La catégorie<br />
responsabilité est plus accentuée en CE à l’éco<strong>le</strong> témoin mais el<strong>le</strong> est plus fréquente<br />
en CM à l’éco<strong>le</strong> HB tandis que la catégorie « va<strong>le</strong>ur » est presque équiva<strong>le</strong>nte dans <strong>le</strong>s<br />
deux éco<strong>le</strong>s ( , % à l’éco<strong>le</strong> HB et 0, % à l’éco<strong>le</strong> témoin). Soulignons fina<strong>le</strong>ment que<br />
la catégorie qui renvoie à une attitude égocentrique est plus présente à l’éco<strong>le</strong> témoin et<br />
surtout en classe de CM ( , % contre , % à l’éco<strong>le</strong> HB).<br />
Face à la question C nous retrouvons <strong>le</strong>s mêmes catégories de réponse que nous avons<br />
distinguées à la question A, à savoir :<br />
– Proposer une action personnel<strong>le</strong> pertinente (perso/pert) : el<strong>le</strong> a <strong>le</strong> droit de <strong>le</strong> caresser,<br />
s’occuper de lui, <strong>le</strong> laver, <strong>le</strong> nourrir ;<br />
– Proposer une action personnel<strong>le</strong> non pertinente (perso/nonpert) : <strong>le</strong> détacher, <strong>le</strong><br />
libérer, <strong>le</strong> délivrer, <strong>le</strong> prendre chez el<strong>le</strong> ;<br />
– Proposer une action de communication (comm) : par<strong>le</strong>r au propriétaire, discuter avec<br />
lui, <strong>le</strong> disputer, demander sa permission ;<br />
– Résoudre <strong>le</strong> problème en faisant appel à l’autorité des parents (aut) : <strong>le</strong> dire à ses<br />
parents, demander <strong>le</strong>ur permission pour l’avoir ;<br />
– Proposer une action qui fait appel à une instance extérieure, une institution (inst) :<br />
el<strong>le</strong> doit porter plainte, al<strong>le</strong>r voir la police, al<strong>le</strong>r voir la SPA, <strong>le</strong> vétérinaire, prendre en<br />
compte la loi ;<br />
–<br />
Absence de réponse ou « je ne sais pas » ou réponse hors contexte (Abs) ;<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
– Proposer une attitude de neutralité ou d’indifférence (indiff) : el<strong>le</strong> a <strong>le</strong> droit de ne pas<br />
<strong>le</strong> libérer ;<br />
Tab<strong>le</strong>au 11 : Analyse des réponses de la question 3C<br />
Types de réponse ( C)<br />
Éco<strong>le</strong> Classe abs aut comm indiff inst<br />
perso/<br />
nonpert perso/pert Total<br />
HB CE , % 0,00% 0,00% , % , 0% , % , % 00,00%<br />
CM 0,00% 0,00% ,0 % 0,00% 0, % , % , % 00,00%<br />
CM , 0% 0,00% , 0% , % , 0% 0,00% , % 00,00%<br />
Somme HB , % 0,00% ,0 % , % , % , % , % 00,00%<br />
Témoin CE , % , % 0,00% 0,00% , % , % , % 00,00%<br />
CM , % , % ,0 % 0,00% , % , % , % 00,00%<br />
CM , % 0, % , % , % ,00% 0, % 0, % 00,00%<br />
Somme témoin 0,00% , % , % , % , % , % , % 00,00%<br />
Total , % , % , 0% , % ,0 % , % , % 00,00%<br />
Les résultats que nous obtenons face à cette question sont équiva<strong>le</strong>nts aux résultats<br />
obtenus à la question A. L’absence de réponse est très présente en CE à l’éco<strong>le</strong> HB. À<br />
l’éco<strong>le</strong> HB dominent <strong>le</strong>s réponses affectives non pertinentes (détacher <strong>le</strong> chien, <strong>le</strong> libérer,<br />
<strong>le</strong> prendre chez el<strong>le</strong>) et <strong>le</strong>s réponses personnel<strong>le</strong>s pertinentes sont équiva<strong>le</strong>ntes dans <strong>le</strong>s<br />
deux éco<strong>le</strong>s. À l’éco<strong>le</strong> témoin <strong>le</strong>s droits concernant <strong>le</strong> recours à des institutions ainsi que la<br />
communication sont plus souvent mentionnées ( , % et , % respectivement).<br />
Les réponses qui se réfèrent au non droit (question D) peuvent être catégorisées de la<br />
façon suivante :<br />
– Proposer une action personnel<strong>le</strong> non pertinente (perso/nonpert) : <strong>le</strong> nourrir, s’occuper<br />
de lui, <strong>le</strong> dire au propriétaire. Ces actions ne sont pas pertinentes (par rapport à la<br />
question posée) parce qu’el<strong>le</strong>s sont autorisées (el<strong>le</strong>s correspondent à des droits : c’est<br />
l’inverse de la question précédente). La pertinence est évaluée par rapport à la question<br />
posée ;<br />
– Proposer une action personnel<strong>le</strong> pertinente, c’est-à-dire non autorisée (perso/pert) :<br />
<strong>le</strong> vo<strong>le</strong>r, <strong>le</strong> libérer, entrer chez <strong>le</strong> voisin, <strong>le</strong> détacher, <strong>le</strong> forcer ;<br />
– Proposer une action par rapport à l’autorité (aut) : <strong>le</strong> prendre sans la permission de<br />
ses parents ;<br />
–<br />
Absence de réponse, « je ne sais pas » ou confusion de points de vue (abs), par<br />
exemp<strong>le</strong> : <strong>le</strong> propriétaire n’a pas <strong>le</strong> droit de <strong>le</strong> frapper tandis que la question porte sur<br />
Denise.<br />
Tab<strong>le</strong>au 12 : Analyses des réponses de la question 3D<br />
Types de réponse ( D)<br />
perso/ perso/<br />
Éco<strong>le</strong> Classe abs aut nonpert pert Total<br />
HB CE , % 0,00% 0,00% , % 00,00%<br />
CM ,0 % 0,00% , % , % 00,00%<br />
CM , 0% 0,00% 0,00% , 0% 00,00%<br />
Somme HB 0,00% 0,00% , % , % 00,00%<br />
Témoin CE , % , % , % , % 00,00%<br />
CM , % 0,00% , % 0,00% 00,00%<br />
CM , % , % , % 0, % 00,00%<br />
Somme témoin , % ,0 % , % , % 00,00%<br />
Total ,0 % , % , % , % 00,00%<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
0
Nous remarquons qu’il y a un très grand nombre d’absence de réponse à cette question,<br />
surtout en CE mais aussi en CM à l’éco<strong>le</strong> HB. Les réponses pertinentes dominent dans<br />
<strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s, résultat qui nous fait supposer que la notion de non-droit est mieux intégrée<br />
par <strong>le</strong>s élèves que la notion de droit.<br />
0<br />
1.2.4. Situation n°4<br />
Hier, pendant la recréation, deux élèves de CM , Nicolas et Christophe, se sont bagarrés dans<br />
<strong>le</strong>s toi<strong>le</strong>ttes. Nicolas a accusé Christophe d’avoir pris son nouveau stylo-plume. Christophe a dit<br />
que ce n’était pas vrai. Énervé, Nicolas s’est jeté sur lui et a commencé à lui donner des coups<br />
de pieds. D’autres élèves sont venus <strong>le</strong>s séparer.<br />
A. Qu’est-ce qui te semb<strong>le</strong>rait vraiment juste que l’enseignant de garde fasse pour cette<br />
situation ?<br />
B. Dis aussi pourquoi.<br />
C. Qu’est-ce qui te semb<strong>le</strong>rait vraiment injuste que l’enseignant de garde fasse pour cette<br />
situation ?<br />
A. Les jugements exprimés par <strong>le</strong>s élèves révè<strong>le</strong>nt <strong>le</strong>ur représentation d’une action juste<br />
de la part des enseignants. Nous pouvons <strong>le</strong>s catégoriser de la façon suivante :<br />
– Faire preuve d’une action d’autorité (aut) : punir sans précision (ne pas préciser si<br />
on punit un ou <strong>le</strong>s deux et dans quel<strong>le</strong>s conditions), appe<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s parents ou confisquer<br />
<strong>le</strong> stylo-plume ;<br />
– Faire preuve d’indifférence (indiff) : <strong>le</strong>s laisser se bagarrer ;<br />
– Exercer sa responsabilité en tant qu’enseignant (resp) : <strong>le</strong>s arrêter, <strong>le</strong>s surveil<strong>le</strong>r,<br />
garder <strong>le</strong>s yeux sur eux. ;<br />
– Essayer d’avoir une attitude de justice (just) : chercher <strong>le</strong> coupab<strong>le</strong>, fouil<strong>le</strong>r <strong>le</strong> garçon,<br />
chercher la vérité, chercher <strong>le</strong> stylo ;<br />
–<br />
Absence de réponse (abs) ou description de l’action (ils se sont bagarrés), ou<br />
confusion de points de vue (la question porte sur l’action de l’enseignant et non pas sur<br />
l’action de Nicolas) : c’est juste que Nicolas accuse Christophe.<br />
Tab<strong>le</strong>au 13 : Analyse des réponses à la question 4A.<br />
Types de réponse ( A)<br />
Éco<strong>le</strong> Classe abs aut indiff just resp Total<br />
HB CE , % ,0 % 0,00% 0,00% , 0% 00,00%<br />
CM , % , % 0,00% , % ,0 % 00,00%<br />
CM , % , 0% 0,00% 12, 0% , % 00,00%<br />
Somme HB , % , % 0,00% , % , % 00,00%<br />
Témoin CE 0,00% , % 0,00% 0,00% , % 00,00%<br />
CM ,0 % , % 0,00% , % , % 00,00%<br />
CM ,00% 0, % , % , % , % 00,00%<br />
Somme témoin ,0 % , % ,0 % 0, % 0, % 00,00%<br />
Total , % ,0 % , % , % 0, % 00,00%<br />
L’absence de réponse est plus fréquente à l’éco<strong>le</strong> HB pour <strong>le</strong>s classes de CE et de CM .<br />
La tendance dominante dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s est de considérer comme juste l’action qui<br />
renvoie à l’exercice de l’autorité et el<strong>le</strong> se trouve plus accentuée à l’éco<strong>le</strong> témoin ( , %<br />
contre , %). Le recours à la responsabilité de l’enseignant est presque équiva<strong>le</strong>nt dans<br />
<strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s tandis que la recherche de justice est plus fréquente à l’éco<strong>le</strong> témoin pour<br />
<strong>le</strong>s classes de CE et de CM , résultat qui est inversé en classe de CM ( , 0% à l’éco<strong>le</strong><br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
HB contre , % à l’éco<strong>le</strong> témoin). Signalons fina<strong>le</strong>ment que nous avons encore une fois<br />
quelques réponses manifestant de l’indifférence seu<strong>le</strong>ment en classe de CM de l’éco<strong>le</strong><br />
témoin ( , %).<br />
B. Les justifications de l’action juste fournies par <strong>le</strong>s élèves renvoient aux catégories<br />
suivantes :<br />
– Recours à une règ<strong>le</strong> ou à un jugement de va<strong>le</strong>ur (règ<strong>le</strong>) : c’est pas bien de mentir, on<br />
n’a pas <strong>le</strong> droit de se bagarrer ;<br />
– Prise en compte des conséquences de sécurité sur <strong>le</strong>s élèves (autres) : ils peuvent<br />
se b<strong>le</strong>sser, ils vont recommencer ;<br />
– Faire preuve d’une attribution psychologique personnel<strong>le</strong> (aff) : Nicolas est jaloux,<br />
c’est de sa faute ;<br />
– Faire appel à une attitude d’indifférence (indiff), non implication face aux problèmes<br />
des élèves : c’est <strong>le</strong>urs affaires ;<br />
– Faire appel à la responsabilité des enseignants (resp) : c’est son métier, il faut qu’il<br />
trouve <strong>le</strong> coupab<strong>le</strong> ;<br />
– Absence de réponse ou « je ne sais pas » (abs).<br />
Tab<strong>le</strong>au 14 : Analyse des réponses à la question 4B.<br />
Types de réponse ( B)<br />
Éco<strong>le</strong> Classe abs aff autres règ<strong>le</strong> resp Total<br />
HB CE , % 0,00% , % ,0 % , % 00,00%<br />
CM , % , % , 0% , % , 0% 00,00%<br />
CM 0,00% 0,00% , 0% , 0% 0,00% 00,00%<br />
Somme HB , % ,0 % ,0 % , % , % 00,00%<br />
Témoin CE , % , % , % , % , % 00,00%<br />
CM , % ,0 % , % , % , % 00,00%<br />
CM 0,00% 0, % 0,00% , % 0,00% 00,00%<br />
Somme témoin , % 0, % , % , % ,0 % 00,00%<br />
Total 0, % , % , % , % , % 00,00%<br />
Il y a un grand nombre de non-réponses dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s, ce qui peut être expliqué<br />
par la fatigue des élèves arrivant vers la fin de ce test étrange. Nous observons aussi qu’à<br />
l’éco<strong>le</strong> témoin il y a un plus grand recours à des règ<strong>le</strong>s scolaires ( , % contre , %) et à<br />
l’éco<strong>le</strong> HB il y a une petite différence, mais pas forcément significative, pour évoquer comme<br />
argument la responsabilité du maître face à son métier ( , % à l’éco<strong>le</strong> HB contre ,0 % à<br />
l’éco<strong>le</strong> témoin). Cette différence concerne surtout la classe de CM ( , 0% contre , %).<br />
Par contre la catégorie de prise en compte des conséquences sur <strong>le</strong>s élèves (catégorie<br />
« autres ») est plus augmentée en CM à l’éco<strong>le</strong> HB ( , 0% contre 0,00%) et en CM à<br />
l’éco<strong>le</strong> témoin ( , % contre , 0%).<br />
C. Les actions injustes proposées par <strong>le</strong>s élèves renvoient aux catégories suivantes :<br />
– Faire preuve d’injustice dans la punition (injust) : punir celui qui n’a rien fait ou punir<br />
tous <strong>le</strong>s deux ; punir un seul, faire des distinctions : favoriser ses « chouchou »… ;<br />
– Faire preuve d’autorité, imposer une punition trop sévère ou expiatoire (aut) : des<br />
heures de col<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s frapper, <strong>le</strong>s renvoyer ;<br />
– Ne pas exercer sa responsabilité en tant qu’enseignant (indiff) : ne pas intervenir, <strong>le</strong>s<br />
laisser faire, dire seu<strong>le</strong>ment « arrêtez » ;<br />
– Exercer sa responsabilité en tant qu’enseignant (resp) : al<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s séparer n’est pas<br />
juste, Christophe doit se défendre tout seul ;<br />
–<br />
Absence de réponse, « je ne sais pas » ou confusion des points de vue (abs) : Nicolas<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
a menti, ils se sont bagarrés.<br />
Tab<strong>le</strong>au 15 : Analyse des réponses à la question 4C.<br />
Types de réponse ( C)<br />
Éco<strong>le</strong> Classe abs aut indiff injust resp Total<br />
HB CE , % 0,00% ,0 % , % 0,00% 00,00%<br />
CM 0, % , 0% ,0 % , % 0,00% 00,00%<br />
CM , % ,00% , % , 0% 0,00% 00,00%<br />
Somme HB , % , % , % , % 0,00% 00,00%<br />
Témoin CE , % , % , % , % 0,00% 00,00%<br />
CM , % , % , % 0, % 0,00% 00,00%<br />
CM , % 0, % 0, % , % , % 00,00%<br />
Somme témoin 0,00% , % , % 0, % , % 00,00%<br />
Total , % ,0 % , % , % 0, % 00,00%<br />
Les réponses concernant la discrimination dans la punition sont plus fréquentes à l’éco<strong>le</strong><br />
témoin ( 0, % contre , % à l’éco<strong>le</strong> HB) tandis que l’attitude d’indifférence des<br />
enseignants est plus dénoncée à l’éco<strong>le</strong> HB et surtout en CE ( ,0 %) et en CM ( , %).<br />
La dénonciation d’un acte d’autorité est plus accentuée en CM à l’éco<strong>le</strong> HB ( ,00% contre<br />
0, % à l’éco<strong>le</strong> témoin) tandis qu’el<strong>le</strong> est plus fréquente en CE et en CM à l’éco<strong>le</strong><br />
témoin. Fina<strong>le</strong>ment, la revendication d’une résolution en autonomie est présente seu<strong>le</strong>ment<br />
en classe de CM à l’éco<strong>le</strong> témoin ( , %). Il apparaît donc que <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> témoin<br />
sont plus sensib<strong>le</strong>s aux questions de justice de la part de l’enseignant tandis que <strong>le</strong>s élèves<br />
de l’éco<strong>le</strong> HB ont tendance à interpréter <strong>le</strong> problème en termes de responsabilité personnel<strong>le</strong><br />
de l’enseignant et/ou des élèves.<br />
1.3. Pour une synthèse<br />
Après cette analyse, nous voulons insister sur <strong>le</strong>s résultats suivants :<br />
– Il y a des variations des résultats par rapport aux classes : il y a un grand nombre<br />
d’absence de réponses en CE à l’éco<strong>le</strong> HB diffici<strong>le</strong> à expliquer mais <strong>le</strong> contenu des<br />
réponses obtenues est souvent positif (voir par exemp<strong>le</strong> la situation n° ). En CM et<br />
en CM <strong>le</strong>s résultats varient en faveur de l’une ou de l’autre éco<strong>le</strong> en fonction des<br />
situations.<br />
– Par rapport aux jugements, l’utilisation d’un vocabulaire précis (juste /injuste,<br />
responsab<strong>le</strong>) pour évaluer <strong>le</strong>s actes commis est très peu présente dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s<br />
tandis que domine <strong>le</strong> recours à des jugements normatifs mais imprécis (c’est bien / pas<br />
bien, c’est mal, c’est bête, il a raison, il a tort…). Les quelques utilisations des notions<br />
de juste/injuste pour analyser une situation de relations entre élèves (situation n° ) sont<br />
attestées à l’éco<strong>le</strong> HB La dernière situation (n° ) qui renvoie à la résolution juste d’un<br />
conflit entre élèves par l’enseignant révè<strong>le</strong> qu’à l’éco<strong>le</strong> HB <strong>le</strong>s élèves ont tendance à<br />
interpréter l’attitude de l’enseignant en termes de responsabilité personnel<strong>le</strong> (remplir son<br />
propre devoir) plutôt qu’en termes de discrimination, ce qui est plus fréquent à l’éco<strong>le</strong><br />
témoin. Comme l’ont montré nos entretiens <strong>le</strong>s élèves de cette éco<strong>le</strong> revendiquent de<br />
la part des enseignants, dans <strong>le</strong> quotidien, une attitude de justice mal appliquée à <strong>le</strong>urs<br />
yeux, situation qui peut éventuel<strong>le</strong>ment expliquer <strong>le</strong>ur sensibilité face à cette notion.<br />
–<br />
En ce qui concerne <strong>le</strong>s justifications, on remarque que la notion de non-droit, d’interdit<br />
est plus faci<strong>le</strong>ment acquise et utilisée dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s tandis que <strong>le</strong> recours aux<br />
droits (des élèves ou des adultes) apparaît quelques fois à l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher avec<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
une faib<strong>le</strong> fréquence et avec des variations selon <strong>le</strong>s situations (voir surtout la situation<br />
n° ). À l’éco<strong>le</strong> Hélène Boucher on trouve souvent des arguments qui concernent <strong>le</strong>s<br />
responsabilités des différents acteurs ainsi que des arguments qui révè<strong>le</strong>nt la prise<br />
de conscience des conséquences d’une action sur <strong>le</strong>s autres. À l’éco<strong>le</strong> témoin il y a à<br />
la fois des arguments de recours à la règ<strong>le</strong> (surtout sous forme d’interdits) mais aussi<br />
des arguments d’indifférence (« ce n’est pas ses affaires »), de centration sur soi et<br />
d’instrumentalisation, tendances qui n’existent presque pas à l’éco<strong>le</strong> HB.<br />
–<br />
Par rapport aux perspectives d’action, en ce qui concerne <strong>le</strong>s situations à l’intérieur<br />
de l’éco<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> témoin ont tendance à faire appel à l’enseignant pour<br />
résoudre <strong>le</strong>s conflits et, en deuxième place, à la communication (discuter avec <strong>le</strong>s élèves<br />
concernés) tandis que <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> HB ont tendance à recourir à l’instance<br />
instutionnel<strong>le</strong> du conseil de classe ou d’éco<strong>le</strong>. En ce qui concerne <strong>le</strong>s situations à<br />
l’extérieur de l’éco<strong>le</strong>, il apparaît que <strong>le</strong>s élèves de l’éco<strong>le</strong> témoin ont une assez bonne<br />
connaissance des marges et limites de <strong>le</strong>urs droits à l’extérieur de l’éco<strong>le</strong> et <strong>le</strong>urs<br />
réponses à ce propos sont souvent plus pertinentes que cel<strong>le</strong>s des élèves de l’éco<strong>le</strong> Hélène<br />
Boucher. Les réponses des élèves de l’éco<strong>le</strong> HB semb<strong>le</strong>nt être plus pertinentes pour <strong>le</strong>s situations à<br />
l’intérieur de l’éco<strong>le</strong> (situations et ).<br />
2. Les conseils d’élèves<br />
Nous allons analyser deux conseils d’élèves effectués au cyc<strong>le</strong> (CM et CM ) en <strong>le</strong>s<br />
comparant avec deux conseils de niveau équiva<strong>le</strong>nt en CM (deux séances d’une même<br />
classe) dans une éco<strong>le</strong> située dans <strong>le</strong> canton de Genève où cette pratique s’est largement<br />
répandue ces dix dernières années selon une recherche récente (Laplace 00 ). Cette éco<strong>le</strong><br />
se caractérise par <strong>le</strong> développement de dispositifs dans un cadre plus large de prévention de<br />
la vio<strong>le</strong>nce mis en place par <strong>le</strong>s autorités municipa<strong>le</strong>s. L’établissement possède deux types de<br />
structures. D’une part il y a des instances de participation à différents échelons : <strong>le</strong>s conseils<br />
de classe, <strong>le</strong> conseil des enfants, <strong>le</strong> conseil des adultes (enseignants + un représentant des<br />
parents d’élèves). D’autre part, un dispositif de médiation par <strong>le</strong>s pairs a permis de former<br />
un nombre important d’élèves à la médiation en cas de conflits. Le fonctionnement des<br />
conseils de classe est inspiré des pratiques Freinet mais aucun enseignant ne se revendique<br />
pour autant d’un mouvement pédagogique particulier. Les enseignants assignent deux<br />
buts principaux aux conseils de classe : la pacification de l’espace scolaire et l’initiation au<br />
fonctionnement démocratique (Laplace 00 ). Aucun travail préalab<strong>le</strong> n’est effectué par<br />
rapport aux règ<strong>le</strong>s scolaires comme c’est <strong>le</strong> cas dans l’éco<strong>le</strong> lilloise .<br />
2.1. Définition de la gril<strong>le</strong> d’analyse<br />
Notre analyse vise à saisir à la fois la forme et <strong>le</strong> contenu du discours produit au sein du conseil.<br />
El<strong>le</strong> suit une évolution progressive qui va d’un découpage large du corpus obtenu selon <strong>le</strong>s<br />
thèmes des interactions jusqu’à une catégorisation fine des actes de langage produits par <strong>le</strong>s<br />
interlocuteurs. Cette analyse emprunte beaucoup d’éléments à la méthodologie proposée<br />
par F. François et ses collaborateurs qui s’inscrivent dans l’approche interactionniste du<br />
Les résultats de ces observations sont <strong>le</strong> produit d’un travail de collaboration effectué par Maria Pagoni<br />
(Lil<strong>le</strong> III) et Philippe Haeberli (Université de Genève). Ils sont présentés dans un artic<strong>le</strong> écrit en commun qui<br />
figure dans <strong>le</strong> volume (Annexes) du présent rapport (voir Pagoni, Haeberli 00 ).<br />
Voir à ce propos François F. et all. ( 0), La communication inéga<strong>le</strong> ; heures et malheurs de<br />
l’interaction verba<strong>le</strong>s, ainsi que F. François ( ), Jeux de langage et dialogues à l’éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong>, CRDP<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
langage que nous avons déjà mentionnée.<br />
Dans cette optique, <strong>le</strong> corpus est d’abord distingué en épisodes définis par <strong>le</strong> thème dont<br />
on par<strong>le</strong> (on peut aussi par<strong>le</strong>r des objets de discours). Le changement de thème marque<br />
<strong>le</strong> commencement d’un nouvel épisode. À l’intérieur d’un épisode l’objet se transforme, se<br />
précise, se construit. Les épisodes nous montrent un processus de résolution du problème,<br />
depuis <strong>le</strong> signa<strong>le</strong>ment d’un dysfonctionnement ou l’annonce d’un litige jusqu’à la prise de<br />
décision fina<strong>le</strong>. Pour analyser ce processus, nous utilisons, plus précisément, <strong>le</strong>s indicateurs<br />
suivants :<br />
1. Les échanges qui se dérou<strong>le</strong>nt à l’intérieur d’un épisode autour d’un sous-thème<br />
spécifique qui fait partie du thème général. Ce qui nous intéresse ici c’est d’une<br />
part la forme des échanges : est-ce qu’ils prennent <strong>le</strong> caractère d’une succession<br />
d’échanges minimaux ou d’échanges parallè<strong>le</strong>s ou prennent-ils <strong>le</strong> caractère<br />
d’échanges-débats ? D’autre part il s’agit d’observer quels sont <strong>le</strong>s objets de<br />
discussion qui sont liés à chaque type d’échange et, plus particulièrement des<br />
échanges-débats.<br />
2. Les modalités de prise de décision utilisée (vote, promesse, prescription du<br />
maître…). S’agit-il de favoriser une procédure rég<strong>le</strong>mentée, selon des règ<strong>le</strong>s fixées<br />
à l’avance (comme <strong>le</strong> vote) ? Quel<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong>s compétences et <strong>le</strong>s notions mora<strong>le</strong>s<br />
ou juridiques favorisées par cette démarche ?<br />
3. Les arguments et/ou principes utilisés pour soutenir ou réfuter une position :<br />
arguments concernant <strong>le</strong> travail, <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s de classe, l’éthique, l’autorité ou la<br />
pertinence d’une action.<br />
4. L’analyse des fonctions d’intervention aussi bien du maître que des élèves. Pour<br />
analyser ces fonctions nous prenons comme unité d’analyse la proposition qui peut<br />
être définie comme un énoncé qui se construit autour d’un objet du discours (<strong>le</strong><br />
thème dont on par<strong>le</strong>) et nous procédons à une catégorisation de ces énoncés en<br />
fonction de l’intention du locuteur. Pour <strong>le</strong> contexte spécifique du conseil d’élèves<br />
où il est question de régu<strong>le</strong>r, d’organiser <strong>le</strong> monde social de la classe, nous avons<br />
estimé intéressant de faire une analyse en termes d’actes de langage (Sear<strong>le</strong>), et<br />
plus particulièrement de la force illocutoire des actes produits par <strong>le</strong>s acteurs du<br />
conseil. Nous avons distingué trois grands regroupements des actes de langage<br />
des acteurs éducatifs qui suivent chronologiquement <strong>le</strong> dérou<strong>le</strong>ment de prise de<br />
décision. Ces regroupements correspondent aux trois grandes fonctions du conseil<br />
que nous avons distinguées dans la partie théorique : fonction d’évaluation, fonction<br />
d’orientation de l’action (prise de décision), fonction de conceptualisation. Ils<br />
révè<strong>le</strong>nt des différentes façons de se référer à des normes implicites ou explicites<br />
(règ<strong>le</strong>s scolaires, principes moraux ou juridiques, normes socia<strong>le</strong>ment partagées,<br />
règ<strong>le</strong>s de fonctionnement…) pour agir socia<strong>le</strong>ment au sein du conseil et construire<br />
<strong>le</strong> sens des « situations de référence » (voir <strong>le</strong>s tab<strong>le</strong>aux des annexes) :<br />
Fonction d’évaluation : ces énoncés expriment la position du locuteur par rapport à une<br />
action effectuée sous forme de dysfonctionnement, de critique personnel<strong>le</strong>, de commentaire<br />
ou d’expression d’un sentiment personnel positif ou négatif. Ce positionnement peut donner<br />
lieu à une série d’interactions sous forme d’accord ou de désaccord, de doutes ou de<br />
recherches pour restituer l’action en question selon certains critères, chercher à corriger<br />
et/ou à s’adapter au discours de l’autre.<br />
Midi-Pyrénées. Sur l’analyse des interactions plus généra<strong>le</strong>ment voir Vion A. ( ), La communication<br />
verba<strong>le</strong>. Analyse des interactions, Paris, Hachette et Pratiques n° 0 - 0 ( ) sur <strong>le</strong> thème : Interactions et<br />
apprentissages.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Fonction de conceptualisation : ces énoncés visent à éclaircir <strong>le</strong>s positions exprimées<br />
auparavant en apportant des informations, précisions, explications et par l’intermédiaire<br />
de différents procédés du discours tels que la reprise ou la reformulation. Nous trouvons<br />
aussi ici des efforts d’argumentation qui peuvent varier de la simp<strong>le</strong> démonstration et du<br />
témoignage jusqu’à l’utilisation de principes plus généraux de justification.<br />
Fonction d’orientation de l’action : ces énoncés sont orientés vers l’action. Il s’agit soit<br />
d’organiser l’action selon des règ<strong>le</strong>s déjà fixées (gestion de procédures), soit de guider<br />
l’organisation de nouvel<strong>le</strong>s actions en donnant des ordres, en prescrivant des règ<strong>le</strong>s ou en<br />
faisant des propositions de règ<strong>le</strong>s et/ou d’actions spécifiques.<br />
2.2. Présentation des résultats<br />
Nous allons centrer nos résultats d’une part sur <strong>le</strong>s fonctions d’intervention de l’enseignant<br />
et des élèves (à partir de l’analyse des actes du langage) et d’autre part sur <strong>le</strong>s normes<br />
mobilisées pendant <strong>le</strong>s interactions (à partir de l’analyse des objets soumis à la discussion<br />
et des arguments utilisés).<br />
2.2.1. Le rô<strong>le</strong> de l’enseignant<br />
Dans <strong>le</strong>s deux conseils de l’éco<strong>le</strong> lilloise <strong>le</strong>s interventions du maître constituent presque<br />
un tiers du total des interventions ( tours de paro<strong>le</strong> sur en CM soit , % et<br />
tours de paro<strong>le</strong> sur en CM soit , %). Cette fréquence montre que <strong>le</strong> maître a<br />
un rô<strong>le</strong> important d’encadrement qui se manifeste pourtant différemment dans <strong>le</strong>s deux<br />
conseils. En CM <strong>le</strong>s interventions du maître ont surtout une fonction d’éclaircissement<br />
( , %) puisqu’il intervient souvent pour reformu<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s propositions soumises au vote ou<br />
<strong>le</strong>s prises de décision effectuées par <strong>le</strong>s élèves, ou encore pour donner des explications et<br />
formaliser une notion et ses propriétés. Ces interventions peuvent être considérées comme<br />
des « intentions didactiques » implicites qui s’explicitent quand <strong>le</strong> moment pertinent arrive.<br />
Ainsi, l’enseignant formalise <strong>le</strong>s propriétés d’une proposition soumise au vote et révè<strong>le</strong><br />
son caractère de « guide pour l’action » quand <strong>le</strong>s élèves essayent de définir la tâche du<br />
responsab<strong>le</strong> du matériel et quand un élève fait une proposition de vote qui ne clarifie pas<br />
cette tâche :<br />
. J. : Moi je propose xxx on va noter tous <strong>le</strong>s noms et celui qui par exemp<strong>le</strong> prend un stylo<br />
b<strong>le</strong>u il marque un rond et si <strong>le</strong> soir il ne <strong>le</strong> rend pas il ne marque pas de croix et si <strong>le</strong> <strong>le</strong>ndemain il<br />
<strong>le</strong> rend là il marque une croix<br />
. A. : Je prends la paro<strong>le</strong> <strong>le</strong> sablier de discussions est terminé nous passons aux<br />
propositions<br />
00. Az : Je propose qu’on prenne tous <strong>le</strong>s stylos qu’on a et qu’on <strong>le</strong>s mette là bas<br />
0 . M : Oui mais la proposition à voter c’est pas ça soit c’est cel<strong>le</strong> de Julien soit c’est cel<strong>le</strong> de<br />
Samir pour voter il faut donner une phrase sur laquel<strong>le</strong> on peut voter si tu propose qu’on range<br />
tout ça <strong>le</strong> responsab<strong>le</strong> du matériel il va <strong>le</strong> faire suivant la proposition qu’on va voter<br />
D’autres interventions de formalisation de ce maître concernent des propriétés des lois faites<br />
au sein de la classe: <strong>le</strong>s lois sont faites on <strong>le</strong>s a discutées et votées pour qu’on puisse vivre<br />
tranquil<strong>le</strong>ment dans la classe (99), et toutes <strong>le</strong>s classes de l’éco<strong>le</strong> ont des lois différentes<br />
parce que ça dépend des enfants qui sont dans la classe aussi (171).<br />
En revanche, <strong>le</strong>s interventions de l’enseignant de la CM sont partagées entre <strong>le</strong>s fonctions<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
d’éclaircissement et <strong>le</strong>s fonctions de gestion des procédures. Il n’effectue aucune intervention<br />
de formalisation mais il intervient très souvent au moment des prises de décision pour<br />
rappe<strong>le</strong>r une règ<strong>le</strong> ou une responsabilité susceptib<strong>le</strong> de donner une solution par rapport au<br />
problème soumis à la discussion, comme on <strong>le</strong> voit dans la liste suivante :<br />
Rappe<strong>le</strong>r une responsabilité :<br />
je pense que <strong>le</strong> responsab<strong>le</strong> des tab<strong>le</strong>aux c’est son métier ( )<br />
c’est Tristan qui s’occupe de l’ordre du jour ( )<br />
c’est lui qui est responsab<strong>le</strong> de l’ordre du jour et il gère <strong>le</strong> temps ( )<br />
Laura c’était propreté de la classe ( )<br />
Rappe<strong>le</strong>r une règ<strong>le</strong> de procédure ou une règ<strong>le</strong> de classe :<br />
mais on ne par<strong>le</strong> pas des gens qui ne sont pas là ( )<br />
il me semb<strong>le</strong> que l’aide au métier ne remplace que quand on est absent il me semblait que<br />
c’était ça ( )<br />
attention aujourd’hui la majorité change on est dix huit ça fait neuf plus un ça fait dix ( )<br />
on ne par<strong>le</strong> pas de quelque chose qui concerne quelqu’un qui n’est pas là ( )<br />
lorsqu’il y a un changement de place il faut que tout <strong>le</strong> monde soit d’accord ( )<br />
je te rappel<strong>le</strong> que c’est quand on est autonome qu’on choisit sa place pour travail<strong>le</strong>r quand<br />
on est pas autonome c’est moi qui te place ( )<br />
Ainsi, malgré <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong>s intentions didactiques des deux maîtres se manifestent<br />
différemment, el<strong>le</strong>s ont une orientation commune qui consiste à préserver la fonctionnalité<br />
des règ<strong>le</strong>s de la classe c’est-à-dire <strong>le</strong>s rendre uti<strong>le</strong>s et opérationnel<strong>le</strong>s pour résoudre <strong>le</strong>s<br />
problèmes rencontrés. De ce fait ils encadrent la discussion pour faire en sorte que <strong>le</strong>s<br />
problèmes individuels des élèves s’intègrent dans une réf<strong>le</strong>xion plus large concernant la<br />
mise en place et <strong>le</strong> fonctionnement des règ<strong>le</strong>s scolaires. Cette attitude de prise en charge de<br />
l’individuel par <strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif qui est typique de la pédagogie Freinet (voir aussi <strong>le</strong>s contributions<br />
d’Anne-Marie Jovenet et de Dominique Lahanier-Reuter dans ce rapport) présente aussi<br />
un intérêt didactique particulier. La codification des règ<strong>le</strong>s s’appuie sur certains principes<br />
fondamentaux du droit selon des travaux récents de la didactique de l’éducation civique<br />
(Robert , Audigier, Lagelée ) comme la fonction de la loi en tant qu’outil de régulation<br />
de la vie col<strong>le</strong>ctive. Ainsi, malgré <strong>le</strong> fait que, pour <strong>le</strong>s enseignants en question, <strong>le</strong> fondement<br />
de cette attitude est essentiel<strong>le</strong>ment pédagogique et politique (rendre <strong>le</strong>s élèves actifs aussi<br />
bien face à l’apprentissage que face à la loi), cette attitude présente un intérêt didactique<br />
pour l’observation du chercheur, digne à signa<strong>le</strong>r, concernant la conceptualisation de la<br />
notion de la loi et de ses propriétés.<br />
Dans l’éco<strong>le</strong> genevoise l’intervention de l’enseignant est beaucoup moins importante : six<br />
interventions pour <strong>le</strong> premier conseil, pour <strong>le</strong> deuxième soit, moins de % des interventions<br />
tota<strong>le</strong>s même si cel<strong>le</strong>s-ci sont plus longues que la moyenne des prises de paro<strong>le</strong> des élèves.<br />
La fonction d’éclaircissement est presque absente tandis que <strong>le</strong>s fonctions qui dominent<br />
sont l’orientation de l’action et l’évaluation de l’autre. Par exemp<strong>le</strong>, dans <strong>le</strong> cas du conflit<br />
entre R et O., <strong>le</strong> maître prescrit à O. <strong>le</strong> comportement à adopter à l’égard de R. tout en<br />
critiquant <strong>le</strong> comportement de celui-ci face au conseil (Pagoni, Haeberli, 00 .):<br />
( 00) Et puis pareil pour <strong>le</strong>s mots qui sont réglés ou qui ne sont pas réglés, il suffit qu’on te touche<br />
un petit peu, tout de suite tu mets un mot dans la boîte. Alors essaie de rég<strong>le</strong>r d’abord <strong>le</strong>s choses<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
par toi-même. Est-ce que tu lui as dit, à Raphaël, «Raphael, arrête de jouer avec ma trousse» ?<br />
«Raphael, j’aimerais que tu t’arrêtes» et puis tu lui dis fermement ? Non. Tu <strong>le</strong> laisses faire et<br />
puis après vite tu vas mettre un mot dans la boîte, comme cela on en par<strong>le</strong> tous ensemb<strong>le</strong>. Et<br />
puis comme cela on <strong>le</strong> pointe bien du doigt. Mais ce n’est pas <strong>le</strong> seul parce que beaucoup de tes<br />
camarades pourraient mettre aussi un mot parce que c’est vrai que des fois tu es très insistant,<br />
donc je pense que <strong>le</strong> progrès, il est à faire de part et d’autre… (…) Et bien moi je propose que<br />
cela cesse, mais dans <strong>le</strong>s deux sens. Autant Osur, toi tu es aussi très insistant, donc tu embêtes<br />
aussi, tu n’es pas innocent, autant Raphaël, et bien de ton côté, tes petites vengeances, et bien<br />
on s’en passerait bien.<br />
2.2.2. Les normes mobilisées<br />
Les objets soumis à la discussion dans <strong>le</strong>s deux conseils de l’Éco<strong>le</strong> lilloise concernent <strong>le</strong>s<br />
catégories suivantes : règ<strong>le</strong>s de procédure (trouver, par exemp<strong>le</strong>, une règ<strong>le</strong> de changement<br />
de métier chaque semaine), sanctions injustes de la part des responsab<strong>le</strong>s de métiers,<br />
défauts de responsabilités de la part des responsab<strong>le</strong>s de métiers, changements de place<br />
liés aux gênes de travail, puis il y a aussi des critiques diverses qui concernent des pertes<br />
d’objets ou des insultes mais qui sont peu présentes. On remarque donc qu’il y a peu de<br />
temps consacré à des événements personnels qui ne s’intègrent pas dans <strong>le</strong> système de<br />
fonctionnement des règ<strong>le</strong>s de la classe.<br />
En revanche, à Genève, <strong>le</strong>s litiges qui surviennent entre élèves aussi bien en classe qu’en<br />
dehors de la sal<strong>le</strong> de classe, sont régulièrement soumis à discussion et occupent un temps<br />
important du conseil. Des objets qui concernent l’ensemb<strong>le</strong> de la classe ou une partie de la<br />
classe (par exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s) sont plus rarement soumis à la discussion. Si on classe <strong>le</strong>s<br />
objets soumis à la discussion dans l’ordre décroissant en fonction du nombre de tours de<br />
paro<strong>le</strong> on obtient la liste suivante : chacun doit se responsabiliser ( ), M. se moque du<br />
nom de famil<strong>le</strong> de P. ( ), R. m’embête ( ), je veux profiter de ma pause du matin ( ) P.<br />
insulte C. ( ), <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s doivent se changer plus vite dans <strong>le</strong>s vestiaires ( ), A. bavarde et<br />
me dérange dans mon travail ( ), <strong>le</strong> stand au centre commercial ( ), remerciements à G.<br />
de nous aider à ranger ( ), nouvel<strong>le</strong>s à propos du camp ( ). Notons que deux des objets<br />
qui concernent la col<strong>le</strong>ctivité à savoir chacun doit se responsabiliser et je veux profiter de ma<br />
pause du matin sont soumis au conseil par l’enseignant ce qui peut être considéré comme<br />
une intention didactique de sa part pour attirer la réf<strong>le</strong>xion des élèves sur des questions<br />
qui concernent <strong>le</strong> fonctionnement et pas des incidents personnels. Il y a donc la même<br />
tendance qui est observée à l’éco<strong>le</strong> lilloise à la seu<strong>le</strong> différence qu’à l’éco<strong>le</strong> de Genève el<strong>le</strong><br />
n’est pas explicitée ni institutionnalisée.<br />
Au sein de ces objets de discussion on remarque que <strong>le</strong> débat s’instal<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s conseils<br />
observés à Mons quand il s’agit d’examiner soit la validité d’une accusation (est-el<strong>le</strong> bien<br />
fondée ?), soit la pertinence d’une règ<strong>le</strong> (est-el<strong>le</strong> efficace ?), soit l’attitude d’un élève en tant<br />
que responsab<strong>le</strong> (quel est <strong>le</strong> travail d’un responsab<strong>le</strong> de métier ?) ou en tant que récepteur<br />
d’une décision (quel<strong>le</strong> est ou doit être l’attitude envers une décision que l’intéressé ne<br />
considère pas juste ?). Dans cette optique, l’efficacité (qui renvoie, au fond, à la facilitation<br />
du travail scolaire), la justice et la responsabilité sont <strong>le</strong>s trois va<strong>le</strong>urs qui sont <strong>le</strong> plus utilisées<br />
pour soutenir <strong>le</strong>s positionnements des locuteurs. Mais la justice n’est jamais mentionnée en<br />
tant que tel<strong>le</strong> tandis que la responsabilité et <strong>le</strong> travail sont souvent utilisés de façon explicite.<br />
Ainsi, nous considérons que c’est la responsabilité qui constitue la va<strong>le</strong>ur intégratrice de<br />
ces conseils tandis que la justice (en tant que va<strong>le</strong>ur centra<strong>le</strong> de la théorie du droit) reste<br />
un principe implicite de fonctionnement. Nous pouvons citer à ce propos deux événements<br />
didactiques observés dans <strong>le</strong>s débats mentionnés ci-dessus.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Le premier événement se situe dans l’épisode concernant la sanction injuste de N (CM ,<br />
e épisode). Il permet <strong>le</strong> passage de la vérité de l’accusation à la nécessité d’accepter la<br />
décision du responsab<strong>le</strong>. En effet, <strong>le</strong> débat part au début de l’échange sur la « véracité »<br />
des « faits » concernant l’accusation : N refuse d’avoir parlé à haute voix deux fois. Des<br />
témoignages viennent soutenir ou défendre son accusation mais dont la « preuve »<br />
restant diffici<strong>le</strong> à effectuer : quel<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong>s limites entre la « petite » voix et la « haute »<br />
voix ? Comment peut-on déterminer ces critères de jugement ? C’est à ce moment-là<br />
qu’apparaissent d’autres interventions qui situent <strong>le</strong> débat à un autre niveau. La question<br />
n’est pas comment établir <strong>le</strong>s « faits » parce que de toute façon la décision est <strong>le</strong> produit<br />
d’un jugement personnel. Le problème renvoie plutôt d’une part à la confiance faite aux<br />
responsab<strong>le</strong>s des métiers et, d’autre part, à la responsabilité de l’accusé qui consiste à<br />
accepter la décision de ceux qui font <strong>le</strong>ur métier :<br />
Az : Xxx aussi je regardais <strong>le</strong>s hamsters et el<strong>le</strong> a mis une croix /mais j’ai dit c’est pas grave /parce<br />
que je parlais à la grosse voix /V ?<br />
V : C’est comme moi /j’avais retiré une croix à xx parce qu’el<strong>le</strong> par<strong>le</strong> à la grosse voix à O donc<br />
j’ai retiré une croix aussi à O /parce qu’el<strong>le</strong>s parlaient ensemb<strong>le</strong> à la grosse voix /et après el<strong>le</strong>s<br />
disaient qu’el<strong>le</strong>s ne parlaient pas à la grosse voix<br />
Az: J ?<br />
J. : Moi je trouve que ceux qui mettent <strong>le</strong>s croix ils font <strong>le</strong>ur métier /et il faut faire comme Az il faut<br />
pas dire non je n’ai pas parlé à la grosse voix<br />
Ainsi, <strong>le</strong> problème est abordé en termes de principes d’action de chacun plutôt qu’en termes<br />
de restitution des faits, en transformant celui-ci d’un problème pragmatique voir juridique<br />
(qu’est-ce qui s’est passé ?) en un problème éthique mettant en jeu la responsabilité aussi<br />
bien de l’acteur que de l’évaluateur (quel<strong>le</strong> est mon attitude face à ce jugement ?).<br />
Le deuxième événement se situe dans <strong>le</strong> troisième épisode du conseil de CM consacré<br />
aux précautions à prendre en compte lors de l’institution de la responsabilité d’un métier. Les<br />
élèves signa<strong>le</strong>nt un dysfonctionnement concernant la tâche du responsab<strong>le</strong> du matériel : il<br />
n’y a plus de matériel dans <strong>le</strong> bac prévu à cet effet, donc il faut transformer la définition de<br />
cette tâche : quel est <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> du responsab<strong>le</strong> du matériel, autrement dit, comment va-t-on<br />
faire pour emprunter du matériel ? Il y a surtout deux arguments qui apparaissent au cours<br />
de ce débat :<br />
– Argument de travail : la tâche du responsab<strong>le</strong> du matériel ne doit pas gêner son<br />
travail.<br />
–<br />
Argument de contrô<strong>le</strong> et/ou de protection : il faut prévoir une règ<strong>le</strong> qui empêche <strong>le</strong>s<br />
élèves de la classe de tricher (si c’est eux qui doivent mettre un rond quant ils empruntent<br />
un objet, comment peut-on garantir qu’ils ne vont pas tricher ?)<br />
Ces deux arguments transforment <strong>le</strong> dysfonctionnement signalé, d’un problème de contrô<strong>le</strong><br />
à un problème éthique qui met en jeu la responsabilité de l’élève : il n’est pas possib<strong>le</strong> de<br />
contrô<strong>le</strong>r complètement l’activité de quelqu’un. L’observation des règ<strong>le</strong>s s’appuie avant tout<br />
sur la responsabilité de chacun. Cel<strong>le</strong>s-ci ont une fonction de contrô<strong>le</strong> mais aussi, et surtout,<br />
de protection du travail de l’élève.<br />
Dans <strong>le</strong>s conseils genevois observés, des séquences d’échanges-débats ont lieu lorsqu’il<br />
s’agit par exemp<strong>le</strong> d’établir <strong>le</strong>s faits (s’est-el<strong>le</strong> moquée du nom de famil<strong>le</strong> ?) d’interpréter<br />
des faits, des paro<strong>le</strong>s (y a-t-il eu intention d’injurier ?), d’évaluer <strong>le</strong>s comportements (estce<br />
que se moquer du nom de famil<strong>le</strong>, c’est bien ?), de juger de l’efficacité et de la justice<br />
« Par<strong>le</strong>r à petite voix » est une règ<strong>le</strong> de la classe dont la transgression « coûte » une croix à l’élève<br />
concerné.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
d’une règ<strong>le</strong> concernant <strong>le</strong>s responsabilités. Comme dans <strong>le</strong> conseil de l’éco<strong>le</strong> HB, <strong>le</strong>s trois<br />
va<strong>le</strong>urs de responsabilité, d’efficacité et de justice se retrouvent à propos des discussions<br />
sur <strong>le</strong>s responsabilités dans la classe. Dans ce dernier cas, <strong>le</strong>s va<strong>le</strong>urs de responsabilité et,<br />
dans un autre contexte, d’efficacité sont affichées clairement, notamment par l’enseignant.<br />
Les principes de justice ne sont pas revendiqués mais ressortent de remarques de certains<br />
élèves. La différence est que la responsabilité prend ici plutôt <strong>le</strong> sens d’une responsabilité<br />
interpersonnel<strong>le</strong> basée sur la sollicitude et l’empathie (Pagoni , Gendron 00 ) :<br />
ressentir <strong>le</strong>s besoins de l’autre, se mettre à sa place pour comprendre sa souffrance, éviter<br />
de lui provoquer de la peine. Cette sensibilisation affective apparaît aussi dans <strong>le</strong>s prises<br />
de décision de résolution des conflits où <strong>le</strong>s propositions de solution prennent souvent<br />
un caractère interpersonnel plutôt que col<strong>le</strong>ctif : s’excuser, arrêter… même si el<strong>le</strong>s sont<br />
soumises au vote de la classe.<br />
Pour illustrer comment cette notion de sollicitude intervient dans la manière dont <strong>le</strong>s conflits<br />
entre individus sont discutés et résolus, nous présentons quelques extraits de l’épisode<br />
où « M. se moque du nom de famil<strong>le</strong> P. » où on voit apparaître <strong>le</strong> principe de réciprocité<br />
(Pagoni, Haeberli, 00 ) dans la forme suivante : ne fais pas aux autres ce que tu ne veux<br />
pas qu’ils te fassent :<br />
( ) En fait je ne vois pas pourquoi tu te moquerais de… juste parce que… peut-être que c’est<br />
ton pire ennemi et tout ça, mais ce n’est pas une raison de se moquer de son nom de famil<strong>le</strong> (…)<br />
Alors ne fais pas aux autres ce que tu n’aimes pas qu’ils fassent.<br />
….<br />
( 0) Toi, tu as envie que je demande par exemp<strong>le</strong> à quelqu’un, par exemp<strong>le</strong> à<br />
Osur qu’il dise ton nom de famil<strong>le</strong> en tamoul et puis qu’après je me moque comme<br />
cela ? Toi, tu aimerais ? Non, je ne pense pas que tu aimerais, donc euh…<br />
qui aboutit à une tentative de formulation d’une règ<strong>le</strong> généralisée :<br />
( ) Alors je propose que dès qu’il y a quelqu’un qui dit un nom de famil<strong>le</strong> en se moquant, toi tu<br />
arrêtes de te marrer parce que peut-être que ce n’est pas marrant.<br />
et la prise en compte du point de la souffrance de la victime :<br />
( )… parce que peut-être que Raul, cela l’a b<strong>le</strong>ssé aussi alors il faut quand même que tu<br />
t’excuses parce que si lui il s’en souvient, c’est que c’est vrai.<br />
Enfin, <strong>le</strong> cas est réglé par un vote portant sur trois propositions qui démontrent la singularité de<br />
la solution adoptée ainsi que la primauté du souci de pacification précédemment évoqué :<br />
( ) Solution une : Mélissa arrête. Solution deux : Mélissa s’excuse. Et solution trois : Mélissa<br />
arrête et s’excuse. Qui vote pour la solution une ? La solution deux ? La solution trois ?<br />
2.2.3. Les interventions des élèves<br />
Les remarques qui précèdent sont confirmées par l’étude des actes de langage des élèves<br />
dans <strong>le</strong>s conseils observés. Les tab<strong>le</strong>aux présentés en annexes montrent l’analyse détaillée<br />
des deux conseils de classe de l’éco<strong>le</strong> HB tandis que <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au qui suit donne un aperçu<br />
synthétique de la comparaison des conseils de classe dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s. On remarque<br />
que, dans l’ensemb<strong>le</strong>, dans tous <strong>le</strong>s conseils observés la fonction dominante est cel<strong>le</strong> de<br />
l’orientation de l’action, ce qui révè<strong>le</strong> <strong>le</strong>ur caractère procédural.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
0<br />
Tab<strong>le</strong>au 16 : Actes de langage des élèves (exprimés en pourcentage)<br />
Établissements<br />
Fonctions<br />
Éco<strong>le</strong> Mons (M) Éco<strong>le</strong> Genève (G)<br />
CM CM e e<br />
Évaluation<br />
Se positionner , , .<br />
Interagir , , , .<br />
Sous-total<br />
Conceptualisation<br />
, , , .<br />
Éclaircir , , ,<br />
Argumenter , , 0, 0.<br />
Sous-total<br />
Orientation de l’action<br />
, , .<br />
Gérer <strong>le</strong>s procédures , , , .<br />
Guider l’action , , . .<br />
Sous-total , , , .<br />
TOTAL 00 00 00 00<br />
Quelques différences sont à remarquer. La première concerne <strong>le</strong> fait qu’au sein de la<br />
fonction d’« orientation de l’action » la répartition des catégories n’est pas la même entre<br />
<strong>le</strong>s deux établissements. Ainsi, au sein de l’éco<strong>le</strong> de Genève la catégorie « gestion des<br />
procédures » intègre surtout l’acte de « donner la paro<strong>le</strong> » tandis qu’el<strong>le</strong> intègre des actes<br />
beaucoup plus variés au sein de l’éco<strong>le</strong> HB : « demander la participation », « annoncer<br />
une action », « rappe<strong>le</strong>r une règ<strong>le</strong> ou une procédure », ce qui révè<strong>le</strong> une intégration, par<br />
<strong>le</strong>s élèves, d’un système plus comp<strong>le</strong>xe et organisé de fonctionnement du Conseil. Dans<br />
l’établissement de Genève, la catégorie « guider l’action » comporte un nombre important<br />
d’énoncés qui correspondent à des ordres personnalisés (arrêter, s’excuser…) ; à l’éco<strong>le</strong><br />
HB, la même catégorie est composée surtout de propositions ou de prescriptions de règ<strong>le</strong>s<br />
qui concernent l’ensemb<strong>le</strong> de la classe.<br />
À l’éco<strong>le</strong> genevoise la deuxième fonction dominante est l’évaluation ( , % et , %) au<br />
détriment de la présence relativement faib<strong>le</strong> de la fonction de conceptualisation et, surtout,<br />
de l’argumentation ( 0, % et 0, %). Ces tendances sont plutôt inversées au sein de<br />
l’établissement de Mons où la fonction d’argumentation se présente relativement é<strong>le</strong>vée<br />
( , % et , %) et cel<strong>le</strong> de l’évaluation relativement faib<strong>le</strong> ( , % et , %).<br />
Il semb<strong>le</strong>rait donc que <strong>le</strong>s conseils de classe de l’éco<strong>le</strong> de Genève présentent un caractère<br />
plus axiologique qui n’est pas forcément suivi par une attitude d’analyse et de réf<strong>le</strong>xion par<br />
rapport aux critères de jugement utilisés.<br />
Les observations qui précèdent, même qualitatives et n’ayant pas prétention à la<br />
généralisation, révè<strong>le</strong>nt que l’activité de résolution des conflits mise en place dans <strong>le</strong>s<br />
conseils de classe de l’éco<strong>le</strong> HB observés, porte des traces de conceptualisation de la<br />
notion de la loi et de son fonctionnement.<br />
Concernant une fonction essentiel<strong>le</strong> de la loi qui est la régulation de la vie col<strong>le</strong>ctive, el<strong>le</strong><br />
apparaît à travers <strong>le</strong>s liens qui se tissent entre la résolution des conflits d’une part et <strong>le</strong>s<br />
règ<strong>le</strong>s de la classe d’autre part. Dans l’éco<strong>le</strong> de Mons, <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s scolaires et <strong>le</strong> rituel du<br />
fonctionnement de la classe (<strong>le</strong>s responsabilités) sont <strong>le</strong> point de départ des litiges soumis à<br />
la discussion et <strong>le</strong> point d’arrivée des prises de décision. Par contre dans l’éco<strong>le</strong> genevoise,<br />
<strong>le</strong>s litiges ont un caractère plus contextualisé et <strong>le</strong>s prises de décision mettent souvent en<br />
exergue la réparation de l’acte commis par l’acteur sur <strong>le</strong> plan personnel (s’excuser, se<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
concilier…). Ce résultat révè<strong>le</strong> la question de la finalité et du pouvoir des conseils d’élèves à<br />
l’éco<strong>le</strong> de Genève. Sont-ils un moyen de faire réel<strong>le</strong>ment participer <strong>le</strong>s élèves aux décisions<br />
ou sont-ils envisagés comme un espace d’expression nécessaire à construire un préalab<strong>le</strong><br />
à l’apprentissage ? Rappelons à ce propos que dans des observations occasionnel<strong>le</strong>s que<br />
nous avions effectuées à une éco<strong>le</strong> de l’agglomération lilloise que nous avions pris comme<br />
éco<strong>le</strong> témoin lors de la réalisation de nos entretiens avec <strong>le</strong>s élèves (voir à ce propos<br />
notre contribution dans <strong>le</strong> rapport de recherche de 00 ) l’objectif de « laisser <strong>le</strong>s élèves<br />
s’exprimer » était apparu comme un objectif essentiel des enseignants.<br />
Mais ce premier résultat est en même temps lié aux va<strong>le</strong>urs construites lors de ces moments<br />
de discussion. Notre recherche montre que la notion de responsabilité est une va<strong>le</strong>ur<br />
commune qui apparaît dans <strong>le</strong>s deux établissements scolaires mais avec des variations de<br />
sens dans chacun d’eux. Au sein des conseils genevois, el<strong>le</strong> prend plutôt la forme d’une<br />
responsabilité interpersonnel<strong>le</strong> basée sur l’empathie et l’intérêt pour <strong>le</strong> bien-être d’autrui. Au<br />
sein de l’éco<strong>le</strong> de Mons, el<strong>le</strong> se traduit par une discipline envers son devoir, devoir fixé par<br />
la loi commune à tous (lois de la classe et de l’éco<strong>le</strong>). Un tel objectif peut se traduire par<br />
deux attitudes possib<strong>le</strong>s.<br />
Une première attitude consiste à mettre en place un fonctionnement procédural visant à<br />
l’application stricte des règ<strong>le</strong>s, ce qui constitue un vrai risque de juridiscisation de la vie<br />
scolaire montré par certains auteurs (Rey 00 ). Cette attitude renvoie à une approche<br />
positiviste du droit qui s’oppose à son approche herméneutique soulignée ces dernières<br />
années par <strong>le</strong>s auteurs qui travail<strong>le</strong>nt sur l’introduction de la théorie du droit comme cadre de<br />
référence de l’éducation civique à l’éco<strong>le</strong>. Chez <strong>le</strong>s élèves cette approche peut se manifester<br />
par <strong>le</strong>ur tendance à vouloir à tout prix établir <strong>le</strong>s « faits » pour rétablir la vérité des actes<br />
commis avant de <strong>le</strong>s évaluer. De longs débats sont observés dans <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s sur la<br />
« véracité » des jugements exprimés. Or, entre l’action effectuée et son évaluation se situe<br />
l’opération d’interprétation qui dépend des principes de fonctionnement de chacun. Est-ce<br />
qu’on centre donc la discussion sur <strong>le</strong>s principes d’interprétation adoptés ou sur la restitution<br />
des faits qui risque de transformer <strong>le</strong> conseil en une procédure de preuves ? L’exemp<strong>le</strong><br />
de N que nous avons cité montre bien comment peut s’effectuer un tel déplacement du<br />
questionnement des élèves.<br />
Cette réf<strong>le</strong>xion révè<strong>le</strong> qu’une autre attitude est possib<strong>le</strong> pour aider <strong>le</strong>s élèves à construire<br />
l’importance des règ<strong>le</strong>s scolaires. El<strong>le</strong> consiste à favoriser la réf<strong>le</strong>xion sur <strong>le</strong>s principes de<br />
ces règ<strong>le</strong>s et de <strong>le</strong>urs propriétés et laisser la place à la discussion sur des cas particuliers et<br />
la négociation de <strong>le</strong>ur sens. Outre l’intérêt que cette attitude présente du point de vue de la<br />
socialisation démocratique des élèves, son intérêt didactique est aussi à souligner : aider <strong>le</strong>s<br />
élèves à construire la notion de la loi et d’autres qui lui sont proches au lieu de se contenter<br />
à son application. Dans <strong>le</strong>s deux classes que nous avons observées à l’éco<strong>le</strong> HB, il y a<br />
des tendances nettes qui vont dans ce sens-là mais sans occuper une place centra<strong>le</strong> dans<br />
<strong>le</strong>s discussions et pas dans toutes <strong>le</strong>s classes. Les enseignants n’ayant pas une intention<br />
didactique explicitée, ils donnent des bribes de réf<strong>le</strong>xion de ce type aux élèves sans toujours<br />
<strong>le</strong>s systématiser. C’est ce phénomène qui, à notre avis, explique la variation que nous<br />
avons observée dans <strong>le</strong>s résultats des élèves lors des entretiens et des questionnaires.<br />
Les entretiens révè<strong>le</strong>nt que <strong>le</strong>s élèves adhèrent au système de fonctionnement de l’éco<strong>le</strong> et<br />
sont capab<strong>le</strong>s d’expliquer <strong>le</strong>s finalités du règ<strong>le</strong>ment de classe et d’éco<strong>le</strong> et <strong>le</strong> questionnaire<br />
a révélé que <strong>le</strong>s notions de droit, justice, responsabilité et solidarité sont en cours de<br />
construction et que <strong>le</strong>ur usage varie selon <strong>le</strong>s classes et <strong>le</strong>s situations.<br />
Se pose enfin la question de ce qui peut traverser <strong>le</strong>s murs du conseil pour être discuté,<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
question qui renvoie aux liens entre public et privé dans l’application de la loi. Dans <strong>le</strong>s<br />
conseils lillois, la classe, à l’initiative de l’enseignant, refuse systématiquement tous <strong>le</strong>s<br />
litiges qui ne sont pas liés au travail scolaire (au sens général de toutes <strong>le</strong>s activités qui<br />
concernent la vie de la classe) et, selon <strong>le</strong> discours des enseignants, apprendre à faire<br />
cette distinction - entre ce qui peut être soumis au conseil et ce qui peut être résolu par<br />
chacun en privé - est fondamental pour la prise de conscience du fonctionnement de la<br />
classe. À Genève, au contraire, <strong>le</strong>s litiges tournent systématiquement autour des plaintes<br />
personnel<strong>le</strong>s et l’enseignant utilise son droit d’intervention pour orienter <strong>le</strong>s élèves vers des<br />
questions de fonctionnement.<br />
D’une manière généra<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s observations qui précèdent nous amènent à considérer que<br />
<strong>le</strong> système d’institutionnalisation des règ<strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctives qui est mis en place au sein de<br />
cette éco<strong>le</strong> par différents moyens, crée un mode de fonctionnement basé sur la justice. Ce<br />
fonctionnement vise, en réalité, à transformer <strong>le</strong>s normes en lois explicites et formalisées<br />
par des outils spécia<strong>le</strong>ment conçus à cet objectif. La pédagogie qui est mise en place repose<br />
sur un questionnement de fond sur <strong>le</strong>s normes scolaires aussi bien face à l’apprentissage<br />
que face à la socialisation. La réf<strong>le</strong>xion col<strong>le</strong>ctive sur <strong>le</strong>s normes d’évaluation des activités<br />
de classe (écriture, compréhension exposés), la remise en question de la programmation<br />
au profit de l’apprentissage créatif, la prise en charge par <strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif des élèves en difficulté<br />
scolaire soulignés dans l’introduction et par <strong>le</strong>s autres contributions de ce rapport, vont dans<br />
ce sens-là. Nous sommes donc plus face à un espace de droit plutôt que face à un espace<br />
de discipline au sens où Foucault ( ) en par<strong>le</strong> :<br />
– la discipline, imposée par la norme, juge plutôt <strong>le</strong>s individus et <strong>le</strong>s dispositions tandis<br />
que <strong>le</strong> droit juge <strong>le</strong>s actes et <strong>le</strong>s faits. La dépersonnalisation des interactions et des<br />
objets de discussion au sein des conseils observés va dans ce sens-là.<br />
– La loi qualifie <strong>le</strong>s actes en distinguant entre <strong>le</strong> permis et <strong>le</strong> défendu tandis que la<br />
norme est au contraire un critère positif qui se substitue à la spontanéité et à l’initiative<br />
individuel<strong>le</strong>s que la loi ménage : <strong>le</strong> recours à des procédures pour mettre en place un<br />
système verrouillé de contrô<strong>le</strong> réciproque peut être un indicateur de ce principe.<br />
–<br />
La loi marque <strong>le</strong>s frontières entre l’espace public et l’espace privé des individus tandis<br />
que la norme pénètre cet espace privé pour classer ou hiérarchiser <strong>le</strong>s individus selon<br />
<strong>le</strong>ur comportement : cette distinction est clairement effectuée au sein des conseils<br />
comme nous venons de <strong>le</strong> signa<strong>le</strong>r.<br />
Nos observations ont montré que « cet espace de droit » gagne la confiance des élèves et<br />
que sa conceptualisation est en cours d’élaboration même si el<strong>le</strong> n’est pas complètement<br />
accomplie, et avec des différences importantes par rapport à d’autres populations. Des<br />
recherches plus fines (basées sur un plus grand nombre de situations pour chaque notion<br />
liée au droit) et plus étendues (auprès d’un plus grand nombre d’élèves) seraient nécessaires<br />
pour montrer mieux <strong>le</strong> bien-fondé de ces interprétations.<br />
Bibliographie<br />
Audigier F. et Lage<strong>le</strong>e G. dir., ( ), Éducation civique et initiation juridique dans <strong>le</strong>s<br />
collèges, Paris, INRP.<br />
Canivez P., ( ), Éduquer <strong>le</strong> citoyen ? Paris, Hatier.<br />
Dworkin R., ( ), Prendre <strong>le</strong>s droits au sérieux, Paris, PUF.<br />
Foucault M., ( ), Surveil<strong>le</strong>r et punir, Paris, Gallimard.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Gendron C., ( 00 ), Éduquer au dialogue ; l’approche de l’éthique de la sollicitude, Paris,<br />
L’Harmattan.<br />
Laplace C., ( 00 ), Approche clinique des pratiques du conseil d’élèves dans l’Éco<strong>le</strong><br />
genevoise (1990-2001), Université de Genève (thèse de doctorat).<br />
Pagoni-Andreani M., ( ), Le développement socio-moral ; des théories à l’éducation<br />
civique, Lil<strong>le</strong>, Presses Universitaires du Septentrion.<br />
Pagoni-andreani M., ( 00 ), « L’éducation mora<strong>le</strong> », dans Weil-Barais A., coord., Les<br />
apprentissages scolaires, Paris, Bréal, - .<br />
Pagoni M., ( 00 ), « Quels apprentissages en éducation civique et mora<strong>le</strong> ? Conseils de<br />
classe et rapport à la loi » dans Reuter Y., Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec<br />
scolaire, ERTé 0 00 - 00 , - .<br />
Pagoni M., ( 00 ), Respect de l’autorité de l’enseignant et éthique professionnel<strong>le</strong> au<br />
sein de la pédagogie Freinet, communication au colloque : Autorité éducative, savoir,<br />
socialisation démocratique, Université Montpellier , <strong>IUFM</strong> de Montpellier, et septembre,<br />
Montpellier.<br />
Pagoni M., Haeberli Ph., ( 00 ), « Conseils d’élèves et savoirs en éducation civique et<br />
mora<strong>le</strong> : étude comparative de deux établissements scolaires en France et en Suisse »,<br />
communication présentée au colloque de l’AFEC : L’Éco<strong>le</strong>, lieu de tensions et de médiations :<br />
quels effets sur <strong>le</strong>s pratiques scolaires ? Analyses et comparaisons internationa<strong>le</strong>s, du<br />
au juin 00 , Vil<strong>le</strong>neuve d’Ascq, Université Lil<strong>le</strong> .<br />
Rey J-F., ( 00 ), L’éco<strong>le</strong> sous l’emprise du droit : retours ou détour ? Le Télémaque, dossier<br />
spécial : Éducation mora<strong>le</strong> : nouvel<strong>le</strong>s questions, nouveaux conflits ? coordonnée par Maria<br />
Pagoni, Presses universitaires de Caen, n° , p. - .<br />
Robert F., ( ), Enseigner <strong>le</strong> droit à l’Éco<strong>le</strong>, Paris, ESF.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
ANNEXES<br />
Épisodes<br />
Fonctions<br />
Analyse des actes de langage des élèves- Éco<strong>le</strong> HB - Classe de CM1<br />
(19/04/02)<br />
- Règ<strong>le</strong><br />
d’attribution des<br />
métiers<br />
-<br />
Sanction<br />
injuste de<br />
Naïma<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
-<br />
Sanction<br />
injuste de<br />
Gw.<br />
- Le<br />
métier du<br />
responsab<strong>le</strong><br />
du matériel<br />
TOTAL<br />
Se positionner<br />
(évaluer)<br />
Signa<strong>le</strong>r un<br />
dysfonctionnement<br />
Critiquer/protester/<br />
accuser<br />
Commenter<br />
Exprimer une<br />
préférence<br />
Juger/affirmer<br />
Sous-total<br />
Interagir<br />
Accepter/confirmer<br />
Réfuter/contester/<br />
refuser<br />
Douter/ironiser<br />
Rechercher<br />
Demander une<br />
confirmation<br />
Corriger<br />
( ,0%) ( , %) ( 0, %) ( , %)<br />
Sous-total<br />
Éclaircir<br />
Donner une<br />
information/lire<br />
Demander une<br />
explication/<br />
précision<br />
Reprendre<br />
Expliquer/reformu<strong>le</strong>r<br />
Compléter<br />
0 ( 0,0%) ( , %) ( , %) 0 ( , %) ( , %)<br />
Sous-total<br />
Argumenter<br />
Montrer par une action<br />
ou par un exemp<strong>le</strong><br />
Justifier<br />
( ,0%) ( ,0%) ( , %) ( , %) 0 ( , %)<br />
Raconter pour<br />
témoigner<br />
0<br />
Sous-total<br />
Gérer des procédures<br />
Donner la paro<strong>le</strong><br />
Demander la<br />
participation<br />
Annoncer une action<br />
Rappe<strong>le</strong>r la procéd/<br />
organiser/recentrer<br />
( ,0%) ( , %) ( 0, %) ( , %) ( , %)<br />
Sous-total ( ,0%) ( , %) ( 0, %) ( , %) 0 ( , %)
Orienter l’action /<br />
construire des normes<br />
Exécuter/faire<br />
Ordonner/demander<br />
une action à qq’un<br />
Prescrire une règ<strong>le</strong><br />
Proposer<br />
Sous-Total ( ,0%) ( , %) ( , %) ( , %) ( , %)<br />
TOTAL ( 00%) ( 00%) ( 00%) ( 00%) 0 ( 00%)<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Épisodes<br />
Fonctions<br />
Analyse des actes de langage des élèves – Éco<strong>le</strong> HB - CM2 (11/02/2003)<br />
- Les<br />
métiers<br />
-<br />
Critiques<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />
-<br />
Changements<br />
de place<br />
- et<br />
-<br />
Projets de<br />
classe<br />
TOTAL<br />
Interagir pour restituer une action<br />
Accepter/confirmer<br />
Réfuter/contester/refuser<br />
Douter<br />
Rechercher<br />
Demander une confirmation<br />
Corriger<br />
Sous-total<br />
Se positionner<br />
Signa<strong>le</strong>r un dysfonctionnement<br />
( , %) 0( , %) ( , %) ( , %)<br />
Critiquer/protester contre qq’un/<br />
accuser<br />
Commenter/ironiser/insinuer<br />
Exprimer une préférence<br />
Affirmer<br />
0<br />
Sous-total<br />
Éclaircir<br />
Donner une information/lire<br />
Demander une explication/<br />
précision<br />
Reprendre<br />
Expliquer/reformu<strong>le</strong>r<br />
Compléter<br />
( , %) ( , %) ( , %) ( , %) ( , %)<br />
Sous-total<br />
Argumenter<br />
Montrer par une action ou par un<br />
exemp<strong>le</strong><br />
Justifier<br />
Raconter pour témoigner ou pour<br />
comparer<br />
( , %) ( %) ( , %) ( , %) ( , %)<br />
Sous-total<br />
Gérer des procédures<br />
Donner la paro<strong>le</strong><br />
Demander la participation<br />
( , %) ( , %) ( , %) ( , %) 0 ( , %)<br />
Annoncer une action<br />
Rappe<strong>le</strong>r une règ<strong>le</strong> ou une<br />
procéd/organiser/recentrer<br />
0<br />
Sous-total<br />
Guider l’action /construire des<br />
normes<br />
Exécuter/faire<br />
Ordonner/demander une action à<br />
qq’un<br />
Prescrire une règ<strong>le</strong><br />
Proposer<br />
0( , %) ( , %) ( , %) 0 ( , %) ( , %)<br />
Sous-Total ( %) ( , %) ( , %à ( , %) ( , %)<br />
TOTAL ( 00%) ( 00%) ( 00%) ( 00%) ( 00%)
Éléments de synthèse : bilan et perspectives<br />
Yves REUTER, Gérard BÉCOUSSE, Céci<strong>le</strong> CARRA, Cora COHEN-AZRIA, Bertrand DAUNAY,<br />
Isabel<strong>le</strong> DELCAMBRE, Martine FIALIP-BARATTE, Rouba HASSAN-PILARTZ, Anne-Marie JOVENET,<br />
Dominique LAHANIER-REUTER, Maria PAGONI<br />
Ce dernier chapitre – discuté par l’ensemb<strong>le</strong> des membres de l’équipe – vise à établir un bilan<br />
provisoire des analyses réalisées. Il s’organise, en réponse aux questions initia<strong>le</strong>s, autour<br />
de trois grands points : <strong>le</strong>s intérêts de l’expérience menée, ses limites, et <strong>le</strong>s conditions de<br />
sa possib<strong>le</strong> transférabilité. Il ne se comprend qu’à la lumière de l’ensemb<strong>le</strong> du rapport qui<br />
l’étaye et <strong>le</strong> modalise. Il sera complété et affiné par <strong>le</strong>s analyses complémentaires que nous<br />
menons encore.<br />
1. Les intérêts de l’expérience menée<br />
Ces intérêts peuvent se décliner au travers d’une dizaine de dimensions sur <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s,<br />
selon nous, se réalisent des « effets positifs ».<br />
. . Fondamenta<strong>le</strong>ment, par rapport à l’état antérieur qui a justifié ce projet, l’éco<strong>le</strong> se<br />
relève, tant sur <strong>le</strong> plan de l’augmentation du nombre d’élèves (avec, de surcroît, des<br />
demandes de famil<strong>le</strong>s « extérieures ») que sur celui des savoirs et des savoir-faire<br />
évalués institutionnel<strong>le</strong>ment, même si la hausse des performances évaluées est loin<br />
d’être homogène.<br />
. . Les phénomènes de vio<strong>le</strong>nces tendent à diminuer, accompagnés d’une évolution<br />
des représentations et des normes chez <strong>le</strong>s élèves. On constate ainsi une meil<strong>le</strong>ure<br />
intégration des normes, une appropriation du règ<strong>le</strong>ment supérieure à cel<strong>le</strong> constatée dans<br />
d’autres établissements, un sentiment de justice plus fort accompagné d’une meil<strong>le</strong>ure<br />
acceptation des sanctions, moins de stigmatisation des différences ou des problèmes<br />
entre <strong>le</strong>s élèves (nous n’avons pas, par exemp<strong>le</strong>, repéré de boucs émissaires)<br />
. . Les élèves « à problèmes » envoyés par <strong>le</strong>s autres éco<strong>le</strong>s ou <strong>le</strong>s élèves « en<br />
souffrance » semb<strong>le</strong>nt éga<strong>le</strong>ment mieux s’intégrer en étant sollicités au même titre que<br />
<strong>le</strong>s autres (et non comme des élèves singuliers), cette « restauration » fonctionnant en<br />
relation étroite avec la pédagogie commune et la construction des savoirs. En d’autres<br />
termes – et il en est ici de même que pour <strong>le</strong>s vio<strong>le</strong>nces – <strong>le</strong> traitement des problèmes<br />
ne s’effectue pas en soulignant des différences, en catégorisant de manière fixiste<br />
et stigmatisante ou apitoyée certains élèves, en <strong>le</strong>s isolant et en <strong>le</strong>ur appliquant des<br />
stratégies spécifiques en dehors du cadre commun de la classe et de la pédagogie mise<br />
en œuvre, mais en intégrant autant que faire se peut ces élèves dans <strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif – classe,<br />
dans <strong>le</strong>s dispositifs partagés, dans <strong>le</strong> travail de construction des savoirs…<br />
. . Les rapports à l’éco<strong>le</strong>, au travail, aux apprentissages, aux savoirs… nous paraissent<br />
aussi évoluer de manière « positive » : climat de travail et valorisation de celui-ci ;<br />
autonomisation dans <strong>le</strong>s tâches et prise de risques (questionnements, manifestations<br />
d’incompréhension, aveux d’ignorance, absence de crainte des erreurs, essais de stratégies<br />
diversifiées…), opposées à l’inhibition des élèves, souvent notée ail<strong>le</strong>urs ; développement<br />
d’une distance réf<strong>le</strong>xive accompagnée de discours explicatifs et argumentatifs étayés ;<br />
sentiment de sécurité (dans la cour…) et de sérénité (par exemp<strong>le</strong>, par rapport à l’entrée<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
dans l’écrit) ; clarté dans la relation entre situations, activités et objectifs ; conscience et<br />
contrô<strong>le</strong> des tâches ; sens attribué aux apprentissages et sentiment précoce et important<br />
d’être en apprentissage à l’éco<strong>le</strong> via <strong>le</strong> travail ; vision positive de l’éco<strong>le</strong> et des savoirs…<br />
Autant d’éléments re<strong>le</strong>vés de manière convergente quel que soit <strong>le</strong> domaine considéré,<br />
<strong>le</strong> cadre théorique adopté, <strong>le</strong>s méthodes de recueil ou de traitement mises en œuvre.<br />
. . En ce qui concerne <strong>le</strong>s apprentissages disciplinaires, même s’ils demeurent<br />
hétérogènes, nombre de résultats convergent autour de progrès depuis la mise en<br />
place de l’expérience, avec des résultats égaux ou supérieurs à ceux d’élèves de milieu<br />
équiva<strong>le</strong>nt mais soumis à un mode de travail pédagogique différent voire, sur certains<br />
points, avec des résultats moins éloignés de ceux d’élèves de milieux plus favorisés.<br />
C’est ainsi <strong>le</strong> cas pour :<br />
– l’entrée dans l’écrit ;<br />
– … la production écrite avec notamment l’investissement (<strong>le</strong> développement de la<br />
longueur des textes, la fréquence des écrits…), la diversification des moyens textuels,<br />
l’actualisation conjointe de l’imaginaire et de la structuration textuel<strong>le</strong>…<br />
– la gestion de l’oral (dès la maternel<strong>le</strong>) avec des indicateurs intéressants quant à<br />
l’écoute et au respect de l’autre, la longueur des productions, l’élocution et l’aisance, la<br />
capacité à par<strong>le</strong>r sans notes ;<br />
– <strong>le</strong>s apprentissages mathématiques : avec des performances notab<strong>le</strong>s (par exemp<strong>le</strong><br />
en symétrie axia<strong>le</strong>), <strong>le</strong> développement d’explications et d’arguments, la variété des<br />
stratégies employées, <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> de la tâche…<br />
–<br />
<strong>le</strong>s apprentissages scientifiques notamment en ce qui concerne <strong>le</strong> questionnement,<br />
<strong>le</strong> rapport aux savoirs, <strong>le</strong>ur mise en réseau (au sein de la classe) et la dynamique à<br />
l’œuvre dans <strong>le</strong>ur construction…<br />
. . Contrairement à nombre d’idées reçues – et même si cela doit encore être vérifié<br />
par une étude plus approfondie sur un plus grand nombre d’élèves – <strong>le</strong> passage en<br />
sixième ne s’avère pas problématique. Globa<strong>le</strong>ment, <strong>le</strong>s élèves conservent <strong>le</strong>ur niveau<br />
antérieur, ils s’adaptent bien (au point d’ail<strong>le</strong>urs de ne pas toujours être repérés par <strong>le</strong>s<br />
enseignants), et ils n’éprouvent pas de sentiment de rupture particulier.<br />
. . Des effets intéressants peuvent aussi être constatés chez <strong>le</strong>s enseignants de cette<br />
éco<strong>le</strong> : pas de demande de mutation (même si <strong>le</strong> volontariat et la cooptation était au<br />
fondement de <strong>le</strong>ur projet, cette réalité, après plusieurs années, diffère sensib<strong>le</strong>ment de<br />
ce que l’on constate souvent dans <strong>le</strong>s zones diffici<strong>le</strong>s), solidarité, concertation constante<br />
(y compris entre maternel<strong>le</strong> et primaire), congruence dans <strong>le</strong>s manières de faire au sein<br />
de l’éco<strong>le</strong>, stimulation dans l’inventivité, intégration réussie de certains intervenants<br />
« périphériques » : maître RASED, aide-éducateur…<br />
. . Complémentairement – et même si cela ne s’effectue pas sans certaines tensions –<br />
on peut constater que cette expérience engendre une certaine stimulation, une attention<br />
plus grande aux pratiques et aux résultats, entre <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s de la circonscription.<br />
. . Du côté des parents aussi – même si cela est loin d’être simp<strong>le</strong> – on peut<br />
constater certains déplacements dans <strong>le</strong>s discours, <strong>le</strong>s attitudes, <strong>le</strong>s comportements :<br />
satisfaction accrue vis-à-vis de l’éco<strong>le</strong>, amélioration (même fragi<strong>le</strong>) de certaines relations,<br />
investissement un peu plus important comme parent d’élève, voire comme animateur<br />
d’atelier du soir…<br />
. 0. À ces éléments, il convient encore d’ajouter deux constat, non négligeab<strong>le</strong>s, en ce<br />
qui concerne <strong>le</strong>s élèves de cette éco<strong>le</strong>. Ils sont moins déstabilisés que d’autres face à des<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
tâches, des situations ou des tests inhabituels auxquels nous avons pu <strong>le</strong>s soumettre (ce<br />
qui semb<strong>le</strong> témoigner d’une véritab<strong>le</strong> soup<strong>le</strong>sse adaptative) et plus sereins que d’autres<br />
dans <strong>le</strong>urs relations à des adultes qu’ils connaissent moins.<br />
Tout cela nous amène à poser nettement que l’expérience menée ici, au regard de la situation<br />
antérieure de l’éco<strong>le</strong>, des élèves concernés et du milieu environnant, s’avère, en l’état de<br />
nos recherches, bénéfique.<br />
2. De quelques problèmes<br />
Mais <strong>le</strong> caractère bénéfique mentionné précédemment rencontre aussi – ce qui est normal ! –<br />
certaines limites. Nous nous contenterons de re<strong>le</strong>ver ici quatre zones de problèmes que<br />
nous allons essayer de spécifier plus avant dans <strong>le</strong>s recherches à venir.<br />
. . En premier lieu, <strong>le</strong> dispositif mis en place et ses effets demeurent fragi<strong>le</strong>s, dans<br />
un environnement social particulièrement rude et sujet à des dysfonctionnements<br />
sporadiques liés aux difficultés à vivre, aux relations avec la police, aux drames humains…<br />
L’investissement des parents reste limité. L’intégration des normes par <strong>le</strong>s élèves est<br />
toujours vacillante comme en témoignent, par exemp<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s problèmes récurrents lors de<br />
la venue de remplaçants. Cela révè<strong>le</strong> sans doute, que <strong>le</strong>s repères patiemment construits<br />
demeurent fortement tributaires des dispositifs et de l’autorité des maîtres. Cela peut<br />
aussi signa<strong>le</strong>r, à certains moments, un travail d’accompagnement et d’aide, plus (trop)<br />
limité des maîtres de cette éco<strong>le</strong> face aux collègues remplaçants. Cela peut renvoyer à<br />
une volonté d’autovalorisation inconsciente (montrer par comparaison sa va<strong>le</strong>ur) ou à un<br />
fonctionnement groupal (on est dans ou hors l’équipe et on ne donne que partiel<strong>le</strong>ment<br />
<strong>le</strong>s clés à ceux qui sont extérieurs). Mais cela ne doit pas faire oublier <strong>le</strong>s conditions<br />
parfois problématiques des remplacements (remplaçants arrivant à la dernière minute ou<br />
en retard). Et cela rappel<strong>le</strong>, en tout cas, à quel point <strong>le</strong>s élèves sont « diffici<strong>le</strong>s ».<br />
. . Il nous semb<strong>le</strong> aussi que la logique de promotion à l’œuvre dans ce groupe scolaire<br />
(éco<strong>le</strong> « expérimenta<strong>le</strong> » selon <strong>le</strong> souhait des maîtres) n’est pas sans sou<strong>le</strong>ver certains<br />
problèmes :<br />
– moindre attention (très relative cependant comparativement à d’autres éco<strong>le</strong>s) aux élèves à certains<br />
moments (lors de la venue de représentants des médias, par exemp<strong>le</strong>) ;<br />
– relations parfois tendues avec <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s du voisinage qui se sentent mises en cause, moins suivies,<br />
et surtout en concurrence ;<br />
–<br />
sensibilité exacerbée aux incidents avec <strong>le</strong>s parents (qui, dans ce cadre, paraissent susceptib<strong>le</strong>s<br />
de porter atteinte à l’image de l’éco<strong>le</strong> que <strong>le</strong>s enseignants cherchent à construire et qui provoquent de<br />
douloureuses remises en question, bien plus marquées qu’ail<strong>le</strong>urs).<br />
. . On peut encore re<strong>le</strong>ver quelques zones plus incertaines dans <strong>le</strong>s apprentissages<br />
disciplinaires. Cela concerne, par exemp<strong>le</strong>, la mise en texte (dans ses dimensions<br />
syntaxique, orthographique et <strong>le</strong>xica<strong>le</strong>), la forte ritualisation de certains dispositifs de<br />
production ora<strong>le</strong> qui engendre des interactions parfois rigides et routinisées, la maîtrise de<br />
la formalisation « académique » des pratiques (faib<strong>le</strong>sse dans <strong>le</strong> <strong>le</strong>xique ou <strong>le</strong>s codages<br />
disciplinaires en grammaire ou en mathématiques ; flottements dans la mise en œuvre de<br />
notions mathématiques moins immédiatement contextualisab<strong>le</strong>s dans la vie quotidienne ;<br />
déstabilisation face à des exercices métalinguistiques…).<br />
. . On peut enfin repérer une hétérogénéité dans <strong>le</strong>s évolutions (par exemp<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s<br />
relatives stagnations ou régressions lors de la seconde année de l’expérimentation) et<br />
dans <strong>le</strong>s effets plus ou moins accentués selon <strong>le</strong>s niveaux.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
C’est pourquoi en fonction de ces constats, nous continuons à travail<strong>le</strong>r sur <strong>le</strong>s relations<br />
entre solidité et fragilité de ce qui se construit ; entre espace d’autonomie, d’autorisation,<br />
de liberté d’une part et établissement de limites d’autre part ; entre développement d’une<br />
attitude réf<strong>le</strong>xive d’un côté et problèmes de formalisation « académique » d’un autre<br />
côté.<br />
3. La diffici<strong>le</strong> question de la transférabilité<br />
Reste la question de la transférabilité qui est particulièrement comp<strong>le</strong>xe à traiter tant,<br />
en l’absence d’expérimentation à grande échel<strong>le</strong> et sur une durée conséquente, el<strong>le</strong><br />
s’accompagne de dimensions spéculatives, croisant de surcroît <strong>le</strong> possib<strong>le</strong> et <strong>le</strong> souhaitab<strong>le</strong>.<br />
Aussi, <strong>le</strong>s quelques réf<strong>le</strong>xions qui suivent, fruits de longues réf<strong>le</strong>xions col<strong>le</strong>ctives au sein de<br />
l’équipe, méritent d’être reçues avec précaution.<br />
0<br />
3.1. La transférabilité : hypothèses sur <strong>le</strong> possib<strong>le</strong> et <strong>le</strong> souhaitab<strong>le</strong><br />
Il nous parait a priori possib<strong>le</strong> et souhaitab<strong>le</strong> de transférer certains principes et certains<br />
dispositifs de travail dans la mesure où, soit ils sont attestés dans d’autres établissements<br />
(avec des effets similaires associés), soit des remplaçants ou des maîtres autres que <strong>le</strong>s<br />
enseignants « permanents » ont pu s’en emparer et <strong>le</strong>s faire fonctionner, soit encore ils<br />
nous semb<strong>le</strong>nt appropriab<strong>le</strong>s par d’autres maîtres, de tel<strong>le</strong> sorte que l’importance des<br />
bénéfices retirés compense largement et rapidement <strong>le</strong> coût de certaines modifications<br />
pédagogiques.<br />
Ainsi quant aux principes de fonctionnement – et sans vouloir reprendre l’intégralité du<br />
premier chapitre de ce rapport – nous mettrions volontiers l’accent sur :<br />
– la solidarité de l’équipe (accompagnée par une concertation constante associant<br />
maîtres de maternel<strong>le</strong> et du primaire) ;<br />
– la construction col<strong>le</strong>ctive et récurrente des règ<strong>le</strong>s de fonctionnement ainsi que <strong>le</strong>ur<br />
respect scrupu<strong>le</strong>ux (de la part des élèves et des maîtres) ;<br />
– <strong>le</strong> respect des élèves et l’attention constante à <strong>le</strong>ur cheminement, aux questions et<br />
aux problèmes qu’ils peuvent sou<strong>le</strong>ver ;<br />
– <strong>le</strong> souci d’informer <strong>le</strong> plus précisément possib<strong>le</strong> et d’impliquer <strong>le</strong>s parents ;<br />
– l’accent mis sur la coopération et l’entraide ainsi que l’articulation entre reconnaissance<br />
des sujets dans <strong>le</strong>ur singularité et construction d’une col<strong>le</strong>ctivité ;<br />
– l’importance accordée à la notion de travail et à sa conscientisation accompagnée<br />
d’une valorisation des efforts de chacun ;<br />
– l’articulation forte entre production (diversifiée, fréquente…) et construction d’une<br />
attitude réf<strong>le</strong>xive ;<br />
– la diversité des catégories d’activités et de positions face aux savoirs, associée au<br />
tissage incessant de relations entre el<strong>le</strong>s ;<br />
– l’établissement d’un climat propice aux apprentissages (sérénité, droit à l’erreur,<br />
encouragement des essais, appui sur <strong>le</strong> questionnement des élèves, écoute de <strong>le</strong>urs<br />
interrogations, réponses à <strong>le</strong>urs demandes de clarification…) ;<br />
– la recherche constante de clarté quant aux cadres, règ<strong>le</strong>s, tâches, objectifs…<br />
– la place importante attribuée au temps (pour <strong>le</strong> cheminement de chacun, pour mener<br />
à terme ses recherches…), très fortement structuré tout en restant « ouvert »…<br />
–<br />
la construction d’une culture commune à la classe, transaction entre cultures scolaire<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
et extra scolaire, patrimoine commun et base des recherches…<br />
Du côté des dispositifs, on peut sans doute mentionner – outre <strong>le</strong>s textes libres et <strong>le</strong>s<br />
« quoi de neuf » (dans <strong>le</strong>s formes pratiquées ici et non dans <strong>le</strong>ur vulgate) – <strong>le</strong>s recherches<br />
et créations mathématiques (que nous n’avons pas rencontrées ail<strong>le</strong>urs), <strong>le</strong>s dictées<br />
coopératives (activant l’entraide et <strong>le</strong>s postures métalinguistiques), <strong>le</strong>s modes d’intégration<br />
de l’outil informatique, <strong>le</strong>s dispositifs de socialisation (expositions, présentations aux<br />
parents <strong>le</strong> samedi…), <strong>le</strong>s conseils réguliers et fréquents, <strong>le</strong>s métiers (avec <strong>le</strong>s différentes<br />
responsabilités attribuées aux enfants), <strong>le</strong>s multip<strong>le</strong>s types de relance (image ou texte donné<br />
par <strong>le</strong> maître en écho à la réalisation de l’élève ; questions pour approfondir ou socialiser<br />
une recherche individuel<strong>le</strong>…) ; la gestion publique des problèmes de conduite ; la mise en<br />
œuvre de plans de travail individualisés ; <strong>le</strong>s situations diversifiées de prises de paro<strong>le</strong> ora<strong>le</strong><br />
et publique, fréquentes et précoces, accompagnées d’un contrô<strong>le</strong> de l’écoute ; <strong>le</strong>s <strong>le</strong>ctures<br />
régulières effectuées aux élèves de maternel<strong>le</strong> par ceux de primaire…<br />
On se permettra d’ail<strong>le</strong>urs ici de regretter d’un côté, qu’aucun instrument d’exposition claire<br />
de ces techniques ne soit à la disposition des enseignants et, de l’autre, l’absence de<br />
recherches précises sur chacun de ces dispositifs.<br />
3.2. La transférabilité : de quelques problèmes en suspens<br />
3.2.1. Les frontières du possib<strong>le</strong><br />
Quatre catégories de problèmes, au moins, méritent qu’on <strong>le</strong>s prenne en considération. En<br />
premier lieu, il est clair que la « réussite » constatée ici dépend d’un mode de constitution<br />
de l’équipe – par cooptation sur projet – dont on perçoit bien la légitimité et la justification en<br />
l’occurrence, c’est-à-dire dans <strong>le</strong> cas d’une éco<strong>le</strong> en péril au sein d’un milieu particulièrement<br />
défavorisé, mais dont on peut aussi très faci<strong>le</strong>ment envisager <strong>le</strong>s dérives si ce système se<br />
généralisait en dehors de projets d’action ciblés et justifiés.<br />
En second lieu, trois ingrédients sont ici – comme dans nombre d’expérimentations – très<br />
fortement à l’œuvre : l’investissement prodigieux des enseignants (qui, par certains aspects,<br />
excède <strong>le</strong> choix professionnel pour devenir, quasiment, un choix de vie), la compétence<br />
professionnel<strong>le</strong> de haut niveau tant sur certains contenus que sur <strong>le</strong>s dispositifs (par exemp<strong>le</strong><br />
pour atteindre une gestion, évitant la dilution, de la déséquentialisation des contenus et<br />
de l’hétérochronie des apprentissages…) et la croyance dans <strong>le</strong>s principes et démarches<br />
mis en œuvre, croyance qui est sans doute ici un des moteurs principaux de l’action. Dès<br />
lors, on peut faci<strong>le</strong>ment concevoir que nombre d’enseignants ne soient pas disposés à<br />
s’engager dans un tel investissement, que cette compétence ne soit pas excessivement<br />
répandue et qu’el<strong>le</strong> nécessite du temps pour se construire et enfin que cette croyance soit<br />
jugée discutab<strong>le</strong>, pour de multip<strong>le</strong>s raisons, aussi bien par d’autres enseignants que par<br />
l’institution el<strong>le</strong>-même.<br />
En troisième lieu, un problème classique demeure à résoudre. Si l’on accepte de considérer<br />
que <strong>le</strong>s divers éléments précédemment mentionnés fonctionnent en système, jusqu’où<br />
l’extraction d’un d’entre eux – principe ou dispositif – peut, isolé de son contexte et réinscrit<br />
dans un autre système, continuer à fonctionner de façon identique et en produisant des<br />
effets similaires ? Dans nombre de cas, <strong>le</strong>s comparaisons que nous avons effectuées sur<br />
<strong>le</strong>s dispositifs (par exemp<strong>le</strong> sur <strong>le</strong>s conseils, <strong>le</strong>s débats…) manifestent clairement des<br />
fonctionnements et des effets différents, au travers notamment de dérives formalistes. Et,<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
en ce qui concerne <strong>le</strong>s principes, lorsqu’ils ne sont pas étayés par des dispositifs aussi<br />
construits, ils relèvent très fréquemment plus du discours d’intention que d’une quelconque<br />
réalité observab<strong>le</strong>. Tout ceci incite donc à la prudence.<br />
Enfin, nous nous arrêterons sur une dernière question. Jusqu’où tout cela est réalisab<strong>le</strong><br />
dans une éco<strong>le</strong> « ordinaire », c’est-à-dire sans volonté d’expérimentation et de promotion<br />
(institutionnel<strong>le</strong>, socia<strong>le</strong>…), sans contacts particuliers avec l’IEN, des chercheurs, des<br />
mouvements pédagogiques, des médias etc., sans <strong>le</strong>s discussions, <strong>le</strong>s renvois et <strong>le</strong>s<br />
gratifications (symboliques) associés à ces échanges ? D’une certaine manière cela n’est<br />
pas sans sou<strong>le</strong>ver un paradoxe : plus une éco<strong>le</strong> fonctionne de manière expérimenta<strong>le</strong>, plus<br />
el<strong>le</strong> met en péril la transférabilité qu’el<strong>le</strong> cherche à promouvoir…<br />
3.2.2. Les limites du souhaitab<strong>le</strong><br />
Sans ignorer que <strong>le</strong> souhaitab<strong>le</strong> appartient plus à la nation, aux politiques et aux décideurs<br />
institutionnels, nous aimerions cependant effectuer deux remarques à ce propos.<br />
La première relève à la fois du politique (jusqu’où est-il souhaitab<strong>le</strong> de tenter d’unifier des<br />
fonctionnements scolaires ?) et de la recherche dans la mesure où l’état des lieux sur <strong>le</strong>quel<br />
se fonderait de tel<strong>le</strong>s décisions demeure encore, à notre sens, bien trop lacunaire :<br />
– il convient en effet d’approfondir <strong>le</strong> fonctionnement et <strong>le</strong>s effets de ce mode de travail<br />
pédagogique en étudiant notamment <strong>le</strong>urs différences selon <strong>le</strong>s niveaux scolaires et <strong>le</strong>s<br />
catégories d’élèves (CSP, genres…) ;<br />
– il est tout aussi nécessaire d’approfondir ces questions en prenant en compte d’autres<br />
modes de travail pédagogique (par exemp<strong>le</strong> en projet) ;<br />
– il est encore indispensab<strong>le</strong> de préciser ces questions en ce qui concerne ce que l’on<br />
regroupe dans la catégorie de mode de travail « classique » ou « traditionnel », avec<br />
des enseignants compétents et respectueux des élèves, afin de ne pas enterrer trop<br />
vite des fonctionnements parfois hâtivement agglomérés et critiqués en s’appuyant sur<br />
certaines dérives…<br />
La seconde remarque concerne <strong>le</strong>s limites du mode de travail que nous avons étudié,<br />
notamment en ce qu’il peut exclure a priori certains possib<strong>le</strong>s, intéressants au travers de la<br />
littérature théorique existant par ail<strong>le</strong>urs (travail en petits groupes, individualisation autour<br />
des problèmes orthographiques, consignes d’écriture col<strong>le</strong>ctive, écriture longue…), ou en ce<br />
que certaines accentuations (<strong>le</strong>s recherches et créations en mathématiques par exemp<strong>le</strong>)<br />
se paient de certains déséquilibres (absence de dispositifs similaires en grammaire ou en<br />
sciences, par exemp<strong>le</strong>). Cela soulève de nouveaux problèmes que nous comptons d’ail<strong>le</strong>urs<br />
explorer dans <strong>le</strong>s années à venir :<br />
– jusqu’où et comment ces possib<strong>le</strong>s (ici exclus) seraient intéressants ?<br />
– jusqu’où et comment serait-ce intégrab<strong>le</strong> sans modifier <strong>le</strong> mode de travail pédagogique<br />
lui-même ?<br />
–<br />
jusqu’à quel point peut-on penser ou espérer transformer / améliorer des pratiques<br />
qui tiennent déjà compte d’autant de dimensions…<br />
Comme on peut s’en apercevoir de multip<strong>le</strong>s questions demeurent en suspens. Nous<br />
tenterons d’y apporter des éléments de réponse complémentaires au travers des recherches<br />
en cours. Néanmoins nous ne saurions conclure ce rapport sans souligner deux constats. Le<br />
premier consiste en un rappel : au regard de l’état antérieur de l’éco<strong>le</strong>, des élèves concernés<br />
et du milieu environnant, cette expérience est indéniab<strong>le</strong>ment une réussite, quels que soient<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
<strong>le</strong>s problèmes mentionnés. Le second risquerait, en fonction de notre mode de traitement<br />
de la question de la transférabilité, de passer inaperçu. D’une certaine manière, au travers<br />
de cette expérience, et à l’encontre de nombre de discours en circulation, <strong>le</strong> mode de travail<br />
pédagogique « Freinet » a manifesté ses potentialités et son adaptabilité au delà des classes<br />
uniques, du milieu rural ou des élèves « non défavorisés ». Cela mérite d’être noté.<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais
Institut Universitaire de Formation des Maîtres<br />
Arras<br />
, rue du Temp<strong>le</strong><br />
BP - 0 Arras Cedex<br />
Tél. : 0 00<br />
Fax : 0 0<br />
Gravelines<br />
0, rue Victor Hugo<br />
Résidence des Dunes<br />
BP - 0 Gravelines<br />
Tél. : 0 0<br />
Fax : 0<br />
Outreau<br />
0, rue Hippolyte Adam<br />
BP - 0 Outreau<br />
Tél. : 0<br />
Fax : 0 0<br />
Vil<strong>le</strong>neuve d’Ascq<br />
, rue Ju<strong>le</strong>s Guesde<br />
Vil<strong>le</strong>neuve d’Ascq Cedex<br />
Tél. 0 0<br />
Fax : 0 0<br />
OUTREAU<br />
GRAVELINES<br />
PAS DE CALAIS<br />
DIRECTION DE L'<strong>IUFM</strong><br />
CENTRE DE FORMATION DE L'<strong>IUFM</strong><br />
Direction<br />
Douai<br />
, rue d’Esquerchin<br />
BP 0 - 0 Douai Cedex<br />
Tél. : 0 00<br />
Fax : 0<br />
Lil<strong>le</strong><br />
, rue de Londres<br />
BP - 00 Lil<strong>le</strong> Cedex<br />
Tél. : 0 0 0 00<br />
Fax : 0 0 0 0<br />
Va<strong>le</strong>nciennes<br />
Campus universitaire du<br />
Mont Houy BP 0<br />
0 Famars Cedex<br />
Tél. : 0<br />
Fax : 0<br />
ARRAS<br />
LILLE<br />
VILLENEUVE D'ASCQ<br />
NORD<br />
bis rue Ju<strong>le</strong>s Guesde - BP 0<br />
Vil<strong>le</strong>neuve d’Ascq Cedex<br />
Tél. : 0 0 00 - Fax : 0 0 0<br />
www.lil<strong>le</strong>.iufm.fr<br />
DOUAI VALENCIENNES<br />
<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais