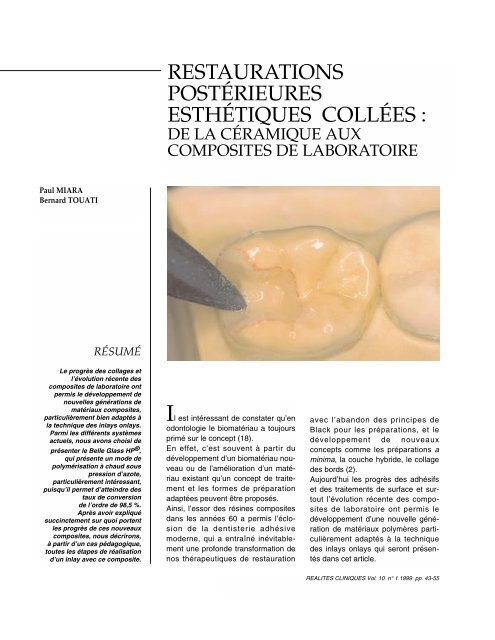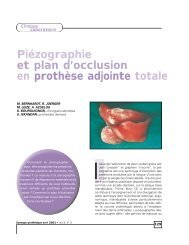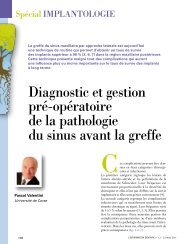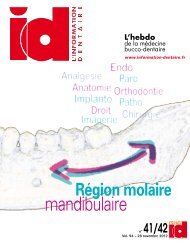restaurations postérieures esthétiques collées - Information dentaire
restaurations postérieures esthétiques collées - Information dentaire
restaurations postérieures esthétiques collées - Information dentaire
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Paul MIARA<br />
Bernard TOUATI<br />
RÉSUMÉ<br />
Le progrès des collages et<br />
l’évolution récente des<br />
composites de laboratoire ont<br />
permis le développement de<br />
nouvelles générations de<br />
matériaux composites,<br />
particulièrement bien adaptés à<br />
la technique des inlays onlays.<br />
Parmi les différents systèmes<br />
actuels, nous avons choisi de<br />
présenter le Belle Glass HP ® ,<br />
qui présente un mode de<br />
polymérisation à chaud sous<br />
pression d’azote,<br />
particulièrement intéressant,<br />
puisqu’il permet d’atteindre des<br />
taux de conversion<br />
de l’ordre de 98,5 %.<br />
Après avoir expliqué<br />
succinctement sur quoi portent<br />
les progrès de ces nouveaux<br />
composites, nous décrirons,<br />
à partir d’un cas pédagogique,<br />
toutes les étapes de réalisation<br />
d’un inlay avec ce composite.<br />
RESTAURATIONS<br />
POSTÉRIEURES<br />
ESTHÉTIQUES COLLÉES :<br />
DE LA CÉRAMIQUE AUX<br />
COMPOSITES DE LABORATOIRE<br />
Il est intéressant de constater qu’en<br />
odontologie le biomatériau a toujours<br />
primé sur le concept (18).<br />
En effet, c’est souvent à partir du<br />
développement d’un biomatériau nouveau<br />
ou de l’amélioration d’un matériau<br />
existant qu’un concept de traitement<br />
et les formes de préparation<br />
adaptées peuvent être proposés.<br />
Ainsi, l’essor des résines composites<br />
dans les années 60 a permis l’éclosion<br />
de la dentisterie adhésive<br />
moderne, qui a entraîné inévitablement<br />
une profonde transformation de<br />
nos thérapeutiques de restauration<br />
avec l’abandon des principes de<br />
Black pour les préparations, et le<br />
développement de nouveaux<br />
concepts comme les préparations a<br />
minima, la couche hybride, le collage<br />
des bords (2).<br />
Aujourd’hui les progrès des adhésifs<br />
et des traitements de surface et surtout<br />
l’évolution récente des composites<br />
de laboratoire ont permis le<br />
développement d’une nouvelle génération<br />
de matériaux polymères particulièrement<br />
adaptés à la technique<br />
des inlays onlays qui seront présentés<br />
dans cet article.<br />
REALITES CLINIQUES Vol. 10 n° 1 1999 pp. 43-55
1<br />
3<br />
44<br />
Fig. 1 - Les composites de première<br />
génération présentaient des propriétés<br />
mécaniques insuffisantes,<br />
ce qui entraînait très rapidement des<br />
dégradations importantes (fractures<br />
partielles, abrasions, colorations...),<br />
comme le montre cet inlay<br />
Fig. 2 - Les revêtements réfractaires à<br />
base de quartz ont permis<br />
le développement des <strong>restaurations</strong><br />
en céramique<br />
Fig. 3 - Sur ce modèle de démonstration<br />
on peut apprécier les possibilités<br />
<strong>esthétiques</strong> et la précision de ces<br />
<strong>restaurations</strong> <strong>collées</strong> en céramique<br />
HISTORIQUE<br />
Sans entrer dans les détails historiques<br />
des <strong>restaurations</strong> indirectes.<br />
Il parait important de rappeler que les<br />
premiers essais remontent à 1882 : il<br />
s’agissait d’inlays céramique en verre<br />
coulé réalisés par Herbst (3). Dès<br />
1886, Land proposa une technique<br />
d’inlay céramique cuit sur une feuille<br />
de platine (4).<br />
Ces <strong>restaurations</strong> céramiques étant<br />
scellées sans adhésion à la dent se<br />
sont très rapidement fracturées ou<br />
descellées signant ainsi progressivement<br />
leur abandon.<br />
2<br />
En 1907, Taggart (12) adapte la technique<br />
de coulée à cire perdue et c’est<br />
le début des inlays onlays en or coulé<br />
(12).<br />
Il faudra attendre les années 80 pour<br />
voir véritablement se dessiner un<br />
nouveau concept de restauration<br />
basé sur l’adhésion, l’économie tissulaire<br />
et l’esthétique. Les premiers<br />
essais ont été faits par Mormann en<br />
Suisse (10), et Touati en France (13<br />
et 14) avec un matériau composite<br />
destiné au recouvrement des couronnes<br />
et bridges à armature métallique<br />
: le Dentacolor®.<br />
A la même époque, d’autres matériaux<br />
comme le Visiogem® ou l’Isosit<br />
N® ont aussi été essayés par<br />
d’autres équipes.<br />
Malheureusement ces composites de<br />
première génération aux propriétés<br />
mécaniques insuffisantes ont très vite<br />
montré leurs limites, particulièrement<br />
dans le domaine des inlays et des<br />
onlays, avec une abrasion trop rapide,<br />
des fractures diverses, une<br />
ouverture des joints marginaux, des<br />
colorations dans la masse ou marginales<br />
(fig. 1).<br />
Malgré leurs qualités <strong>esthétiques</strong> prometteuses<br />
ces composites de laboratoire<br />
dits de première génération ont<br />
progressivement été abandonnés au<br />
profit d’un autre matériau : la céramique.
LES CÉRAMIQUES<br />
En effet, presque cent ans plus tard<br />
les inlays et les onlays en céramique<br />
retrouvent de nouvelles indications en<br />
raison de leurs qualités <strong>esthétiques</strong> et<br />
de leur biocompatibilité.<br />
L’essor de cette “nouvelle” technique<br />
de restauration a été rendu possible<br />
grâce à la conjonction de certaines<br />
améliorations ou découvertes :<br />
• la mise au point de revêtement à<br />
base de quartz permettant la cuisson<br />
directe des poudres de céramique sur<br />
un modèle en revêtement (fig. 2) ;<br />
• le développement des traitements<br />
de surface de la céramique (mordançage,<br />
silanisation ...) ;<br />
• le progrès constant des matériaux et<br />
des procédures de collage (adhésifs<br />
amélo-dentinaires, composites de collage<br />
...) ;<br />
• la mise au point de nouvelles céramiques<br />
comme l’In ceram®,<br />
l’Empress® ou les céramiques basse<br />
fusion type Ducera LFC® ;<br />
• une meilleure compréhension des<br />
principes de préparation des cavités.<br />
Pendant quelques années cette technique<br />
s’est imposée lorsqu’il fallait<br />
rétablir fonction et esthétique (fig. 3).<br />
Néanmoins, ce type de restauration<br />
reste une technique très délicate et<br />
onéreuse. La céramique ne présente<br />
aucune élasticité susceptible de tolérer<br />
les microdéformations des dents<br />
soumises aux contraintes occlusales<br />
physiologiques.<br />
De plus, si les procédures cliniques et<br />
de laboratoire ne sont pas parfaitement<br />
respectées, elles peuvent induire<br />
des défauts d’ajustage, des fêlures,<br />
voire des fractures de la restauration.<br />
Ce matériau cuit à haute température<br />
ne permet en fait aucune retouche<br />
additive : une fracture d’un bord ou<br />
bien un défaut de point de contact ne<br />
peuvent pas être durablement réparés.<br />
Les fractures sont généralement le<br />
résultat de forces mécaniques qui<br />
6<br />
dépassent la cohésion interne des<br />
matériaux de restauration employés<br />
ou la force d’assemblage des différents<br />
composants.<br />
Ces forces issues de la fonction ou de<br />
parafonctions sont cliniquement difficilement<br />
quantifiables. Par contre, les<br />
caractéristiques des divers matériaux<br />
sont généralement connues et peuvent<br />
donner lieu à des comparaisons.<br />
Toutefois, ces dernières ne sont pas<br />
toujours faciles à interpréter, car si la<br />
résistance à la pression, à la traction,<br />
à la flexion, ou au cisaillement sont<br />
souvent connues, la résistance à la<br />
fatigue, pour sa part, est difficile à<br />
quantifier (1). De plus, l’évolution des<br />
défauts de surface l’est encore moins<br />
et c’est pourtant à partir de micro,<br />
voire de nano défauts que la fracture<br />
se propage dans la masse du matériau<br />
céramique (6).<br />
L’expérience clinique et le suivi du<br />
comportement in vivo des différents<br />
matériaux sont les éléments primordiaux<br />
de l’évolution de la qualité à<br />
long terme des matériaux en dentisterie<br />
restauratrice.<br />
5<br />
Fig. 4, 5, 6 - Onlay à recouvrement<br />
total réalisé sur une dent non vitale.<br />
Ce type de restauration -<br />
où les épaisseurs disponibles<br />
sont importantes,<br />
les limites simples et en dehors<br />
de tout point d’occlusion -<br />
reste une excellente indication<br />
du matériau céramique<br />
45<br />
4
7<br />
Fig. 7 - Les inlays en céramique,<br />
surtout lorsque les isthmes sont<br />
étroits, les porte à faux importants, les<br />
limites complexes, restent des<br />
<strong>restaurations</strong> fragiles, difficiles à<br />
réaliser au laboratoire de prothèse,<br />
délicats à coller.<br />
Le taux d’échec de ces <strong>restaurations</strong><br />
nous incite à leur préférer les<br />
composites de seconde génération<br />
46<br />
Le recul clinique que nous avons<br />
aujourd’hui sur ces prothèses <strong>collées</strong><br />
en céramique nous permet mieux<br />
d’apprécier les indications et les<br />
limites de ces <strong>restaurations</strong>. Si elles<br />
trouvent encore d’excellentes indications<br />
pour la technique des onlays<br />
avec un recouvrement partiel ou total<br />
des cuspides lorsque l’épaisseur disponible<br />
est supérieure à 1,5 millimètre<br />
(fig. 4, 5, 6) elles nous paraissent<br />
beaucoup plus discutables pour les<br />
inlays deux faces et contre-indiquées<br />
pour les inlays trois faces (fig. 7),<br />
notamment lorsque la largeur de<br />
l’isthme ne peut pas être supérieure à<br />
1,5 millimètre, ce qui est fréquemment<br />
le cas au niveau des prémolaires.<br />
Quant aux inlays céramique de classe<br />
I leur mise en œuvre et leur coût<br />
nous semblent disproportionnés par<br />
rapport au service rendu ; néanmoins,<br />
c’est certainement la meilleure indication<br />
sur le plan mécanique.<br />
LES RÉSINES COMPOSITES<br />
L’évolution récente des résines composites<br />
de laboratoire a permis le<br />
développement de nouvelles générations<br />
de matériaux composites qui<br />
s’avèrent aujourd’hui en concurrence<br />
directe avec la céramique, notam-<br />
ment pour la technique des inlays<br />
onlays (7, 8).<br />
En raison des performances de ces<br />
nouvelles générations de matériaux,<br />
de leur simplicité de mise en œuvre et<br />
des possiblités de réparation en<br />
bouche, nous limitons en clinique de<br />
plus en plus nos indications d’onlays<br />
et surtout d’inlays céramique.<br />
Afin de mieux apprécier les qualités<br />
de ces nouveaux polymères il est<br />
intéressant de les comparer sur trois<br />
plans aux composites dits de première<br />
génération.<br />
Structure et composition<br />
Tous les composites de première<br />
génération étaient des microchargés,<br />
ceux dits de seconde génération sont<br />
des microhybrides avec des charges<br />
minérales de faible dimension.<br />
La forme, la répartition et surtout la<br />
proportion des charges sont toujours<br />
différentes d’un composite à l’autre,<br />
mais ceux de seconde génération<br />
présentent tous en volume deux tiers<br />
de charges pour un tiers de matrice<br />
organique ; ces proportions étaient<br />
inversées pour les premières générations.<br />
Cette inclusion importante de charges<br />
minérales, associée à une diminution<br />
de la partie organique qui sert de liant<br />
aux charges, a une incidence directe<br />
sur les propriétés mécaniques, le<br />
retrait de polymérisation et sur les<br />
phénomènes de dégradation du composite<br />
en bouche.<br />
Photopolymérisation<br />
C’est elle qui permet le durcissement<br />
de la matrice et par voie de conséquence<br />
la fixation des charges minérales.<br />
Sur le plan mécanique il est indispensable<br />
d’avoir une photopolymérisation<br />
maximale. Avec les composites de<br />
première génération les enceintes<br />
lumineuses ne permettaient pas
d’avoir un taux de conversion suffisant<br />
; grâce à l’introduction récente<br />
d’enceintes lumineuses plus performantes,<br />
de techniques de post polymérisation<br />
à chaud, de fours hautes<br />
températures sous pression d’azote...<br />
on peut atteindre des taux de conversion<br />
très élevés jusqu’à 98,5 % avec<br />
les composites Belle glass HP® par<br />
exemple, selon les données du fabricant<br />
(Kerr).<br />
Inclusion de fibres<br />
Le renforcement des composites de<br />
seconde génération par l’inclusion de<br />
fibres de verre ou de polyéthylène<br />
permet d’augmenter considérablement<br />
certaines propriétés mécaniques<br />
(9).<br />
Ce renforcement peut s’avérer très<br />
utile dans la technique des onlays,<br />
lorsqu’il existe par exemple des porte<br />
à faux importants.<br />
Ils permettent surtout d’envisager des<br />
reconstructions prothétiques plus<br />
étendues : couronnes, attelles,<br />
bridges ...<br />
Toutes ces améliorations au niveau<br />
de la structure et de la composition, et<br />
paticulièrement du système de polymérisation,<br />
ont entraîné une nette<br />
augmentation des qualités mécaniques,<br />
afin de pallier les défauts des<br />
composites de première génération<br />
qui possédaient notamment un module<br />
d’élasticité trop faible, une dureté<br />
de surface insuffisante et un taux<br />
d’abrasion trop important ...<br />
Nous avons réuni dans le tableau I<br />
l’ensemble des propriétés mécaniques<br />
des principaux composites de<br />
laboratoire dits de seconde génération<br />
(15, 16).<br />
Il est intéressant de constater qu’ils<br />
se caractérisent par :<br />
• une résistance à la flexion comprise<br />
entre 110 et 160 MPa, c’est-à-dire<br />
supérieure à celle de céramique felspathique<br />
qui est de 90 MPa ;<br />
• un module d’élasticité compris entre<br />
8 et 12 GPa ;<br />
• une résistance à l’abrasion voisine<br />
de celle de l’émail (inférieure à 10<br />
microns par an, en l’absence de parafonctions<br />
occlusales).<br />
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DE CINQ COMPOSITES DE LABORATOIRE<br />
Propriétés mécaniques<br />
Résistance à la<br />
flexion (MPa)<br />
Résistance à la<br />
compression (MPa)<br />
Module d’élasticité (GPa)<br />
Dureté Vickers<br />
Abrasion (µm/an)<br />
Artglass<br />
110<br />
390/410<br />
10<br />
590<br />
8<br />
Belle Glass<br />
HP<br />
NB - ces chiffres sont des valeurs moyennes et peuvent être légèrement différents d’un laboratoire d’essais à l’autre ; de<br />
plus il existe certaines différences entre les “dentines” et les “enamels” dont nous n’avons pas toujours tenu compte.<br />
142<br />
413/442<br />
13,1<br />
770<br />
1,2<br />
Colombus Conquest Targis<br />
155<br />
350<br />
8,5<br />
610<br />
8<br />
144<br />
447<br />
13<br />
775<br />
0,9<br />
160<br />
420/450<br />
12<br />
775<br />
10<br />
47
48<br />
Bien qu’il existe des différences de<br />
composition, de structure et de mode<br />
de polymérisation, la plupart des composites<br />
modernes, répondent au<br />
cahier des charges d’un biomatériau<br />
de restauration moderne (17).<br />
Au lieu de décrire un ou plusieurs<br />
systèmes par le détail nous avons<br />
préféré, à partir d’un cas théorique,<br />
décrire l’ensemble des étapes cliniques<br />
et de laboratoire pour la réalisation<br />
d’inlays et d’onlays collés. Ils<br />
devraient pouvoir servir de guide pour<br />
optimiser l’utilisation des composites<br />
de laboratoire modernes.<br />
CAS PÉDAGOGIQUE<br />
DE DÉMONSTRATION<br />
Sur un modèle de démonstration,<br />
nous avons reproduit une situation clinique<br />
classique, afin de suivre méthodiquement<br />
les différentes étapes du<br />
traitement.<br />
Il s’agit d’une mandibule de squelette<br />
sur laquelle il existe quatre <strong>restaurations</strong><br />
à l’amalgame (fig. 8). Le but est<br />
de remplacer ces obturations par<br />
quatre <strong>restaurations</strong> composite en faisant<br />
appel à des techniques indirectes.<br />
Nous savons aujourd’hui que les<br />
risques liés aux amalgames se situent<br />
pour le patient et l’équipe soignante<br />
lors de la mise en œuvre et surtout<br />
lors de l’élimination.<br />
Il est prudent, surtout lorsque nous<br />
avons comme ici plusieurs amalgames<br />
à déposer, d’isoler le site avec<br />
une digue afin de protéger le patient<br />
des risques d’ingestion ou d’inhalation<br />
de particules d’amalgame.<br />
Une fois les amalgames déposés, les<br />
préparations sont mises en forme à<br />
l’aide d’instruments diamantés tronconiques<br />
de large diamètre à angles<br />
internes arrondis. Nous utilisons successivement<br />
des grains normalisés,<br />
puis, pour finir les préparations (cof-<br />
fret TPS 2), des bagues rouges puis<br />
jaunes (fig. 9).<br />
Au niveau de la prémolaire nous<br />
effectuerons une cavité occluso-proximale<br />
distale au niveau de la molaire,<br />
une cavité MOV pour onlay à recouvrement,<br />
une cavité occlusale sur la<br />
47 et une cavité composée occluso<br />
vestibulaire sur la 48 (fig. 10 et 11).<br />
Critères de préparation<br />
Les principes sont les mêmes que<br />
ceux préconisés pour les inlays<br />
onlays en céramique (18) (fig. 12 et<br />
13) :<br />
• éviter les angles vifs,<br />
• les isthmes, notamment au niveau<br />
des boîtes proximales doivent être<br />
suffisamment larges (1,2 à 1,5 millimètre),<br />
• les épaisseurs ne doivent jamais<br />
être inférieures à 1,5 millimètre,<br />
• pas de congé ou de chanfrein au<br />
niveau des limites occlusales et cervicales,<br />
• rechercher une bonne stabilisation<br />
et une bonne sustentation de la restauration,<br />
• toutes les parois axiales de la cavité<br />
doivent avoir une légère divergence<br />
(de l’ordre de 10 degrés),<br />
• essayer de toujours situer les limites<br />
dans l’émail. Au niveau de la limite<br />
cervicale une épaisseur de 0,5 millimètre<br />
est suffisante pour assurer une<br />
bonne étanchéité,<br />
• éviter de situer une limite marginale<br />
au niveau d’un contact occlusal.<br />
Une fois les préparations terminées et<br />
contrôlées au niveau de la forme, des<br />
épaisseurs, de l’occlusion ... nous<br />
réalisons au niveau de l’onlay une<br />
restauration provisoire. Pour les<br />
petites cavités, prémolaires et<br />
molaires, on pourra utiliser une résine<br />
d’obturation provisoire prête à<br />
l’emploi. Différents produits peuvent<br />
être employés pour la réalisation de<br />
ces onlays provisoires, soit un composite<br />
classique qui sera photopolymérisé,<br />
soit une résine ; aujourd’hui
nous préférons utiliser les résines en<br />
cartouche comme le Provipont ®<br />
(Vivadent) ou le Temphase ® (Kerr)<br />
(fig. 14).<br />
Hybridation<br />
Avant de prendre l’empreinte et de<br />
mettre en place les obturations provisoires,<br />
il reste une étape importante<br />
qui consiste à créer une couche hybride<br />
de protection, afin de protéger la<br />
dentine, donc la pulpe de toutes les<br />
agressions physiques, chimiques ou<br />
microbiennes jusqu’à l’étape finale de<br />
collage des <strong>restaurations</strong> indirectes.<br />
Pour cela nous réalisons un mordançage<br />
de l’ensemble de la cavité à<br />
l’aide d’un acide phosphorique à 37 %<br />
pendant quinze secondes (fig. 15).<br />
Après un rinçage soigneux d’une trentaine<br />
de secondes, nous séchons<br />
légèrement l’ensemble des cavités en<br />
laissant une certaine humidité ou en<br />
réhumidifiant avec du sérum physiologique.<br />
Sur les surfaces <strong>dentaire</strong>s légèrement<br />
humides nous appliquons une couche<br />
d’un adhésif amélo-dentinaire (Optibond<br />
FL ® , One step ® , Gluma one ®<br />
(fig. 16), laissé en place une vingtaine<br />
de secondes, séché et polymérisé.<br />
Cette étape permet de désinfecter la<br />
cavité et de sceller les canalicules dentinaires<br />
par une couche hybride étanche.<br />
Empreinte<br />
L’empreinte est prise à l’aide d’un silicone<br />
polymérisant par addition en utilisant<br />
une technique d’empreinte en<br />
double mélange.<br />
L’onlay provisoire sera scellé à l’aide<br />
d’un ciment photopolymérisable, Provilink<br />
® , ou de Temp Bond Clear ® .<br />
Pour les autres cavités on peut utiliser<br />
une résine molle photopolymérisable<br />
de type Fermit N ® ou même un IRM<br />
(fig. 17).<br />
Séquence de laboratoire<br />
Au laboratoire l’empreinte est coulée<br />
en plâtre dur, puis montée sur un sys-<br />
tème Pindex, afin de pouvoir séparer<br />
chaque dent (fig. 18).<br />
La technique de montage des composites<br />
utilise le principe de la stratification<br />
classique, le type de polymérisation<br />
dépendant du système utilisé<br />
(fig. 19) dans le respect des instructions<br />
du fabricant.<br />
La plupart du temps elle s’effectue<br />
dans une enceinte lumineuse pendant<br />
quelques minutes, afin d’augmenter le<br />
taux de conversion final des <strong>restaurations</strong><br />
composite. La plupart des systèmes<br />
utilisent la lumière (énergie<br />
photonique) mais aussi la température,<br />
comme le Belle glass ® (Kerr), qui<br />
propose une thermopolymérisation à<br />
135 degrés sous pression d’azote, qui<br />
permet d’atteindre, selon le fabricant,<br />
des taux de conversion de l’ordre de<br />
98,5 % et de limiter la couche superficielle<br />
normalement inhibée par l’oxygène<br />
de l’air.<br />
Les <strong>restaurations</strong> sont ajustées,<br />
réglées en occlusion et polies sur le<br />
même maître-modèle en plâtre.<br />
Une fois terminé, l’intrados des <strong>restaurations</strong><br />
est sablé à l’alumine 50<br />
micromètres sous une pression de<br />
3 bars.<br />
Procédure de collage<br />
La première étape consiste à isoler<br />
les dents par un champ opératoire le<br />
plus hermétique possible, afin d’éliminer<br />
toute pollution par la salive au<br />
moment du collage.<br />
Les obturations provisoires sont éliminées<br />
puis les cavités sont nettoyées à<br />
l’aide d’instruments à main (excavateurs,<br />
sondes) (fig. 20). Pour éliminer<br />
les restes de ciment provisoire nous<br />
utilisons des instruments ultrasonores<br />
ou sonores (fig. 21) suivis d’un nettoyage<br />
plus fin à l’aide d’un spray<br />
abrasif à base d’alumine 25 microns<br />
(Air Flow Prep K 1®) fig. 22. Un rinçage<br />
soigneux et prolongé doit être<br />
effectué, afin d’éliminer toutes les particules<br />
d’alumine.<br />
49
Fig. 8 - Modèles de démonstration sur lesquels<br />
nous allons suivre toutes les étapes importantes<br />
pour réaliser quatre <strong>restaurations</strong> composites<br />
<strong>collées</strong> sous la forme d’inlays onlays<br />
Fig. 11 - …Remarquez l’absence d’angle vif et la<br />
largeur des isthmes<br />
Fig. 14 - L’onlay provisoire est réalisé à l’aide<br />
d’une résine type Provipont (Ivoclar), Temphase<br />
(Kerr)... après avoir pris soin d’isoler la<br />
préparation au moyen d’un lubrifiant gras<br />
(Xynon)<br />
50<br />
Fig. 9 - Pour préparer les cavités d’inlay ou<br />
d’onlay il est préférable d’utiliser des instruments<br />
diamantés tronconiques de large diamètre,<br />
à angles arrondis. Pour la finition, il est conseillé<br />
d’utiliser des instruments diamantés bague rouge,<br />
voire jaune, de même profil<br />
Fig. 10 - Les préparations sont terminées …<br />
Fig. 12 et 13 - Sur ces macro modèles on peut apprécier les caractéristiques des préparations pour inlays<br />
et onlays collés. Tous les bords sont arrondis, les limites sont nettes, sans aucun congé ni chanfrein.<br />
Les isthmes larges, au minimum 1,5 millimètre, les parois des cavités sont légèrement divergentes,<br />
les épaisseurs sont toujours supérieures à 1,5 millimètre<br />
Fig. 15 - Une fois les cavités terminées, il est<br />
conseillé de remordancer à l’aide d’acide<br />
phosphorique l’ensemble des dents par la<br />
technique du mordançage total pendant quinze<br />
secondes, afin d’éliminer les boues amélodentinaires<br />
Fig. 16 - Après avoir légèrement séché les cavités,<br />
on applique une couche d’adhésif amélodentinaire,<br />
type Optibond FL (Kerr) que l’on<br />
photopolymérise, afin de créer une couche<br />
hybride de protection
Fig. 17 - Une fois l’onlay scellé les autres<br />
<strong>restaurations</strong> sont obturées provisoirement à<br />
l’aide d’une résine molle type Fermit N (Ivoclar)<br />
ou Temphase Clear (Kerr)<br />
Fig. 20 - A l’aide d’un excavateur l’onlay est<br />
déposé<br />
Fig. 23 - Toutes les <strong>restaurations</strong> sont essayées,<br />
afin de vérifier leur adaptation au niveau des<br />
limites et surtout des surfaces de contact<br />
Fig. 18 - Sur un maître-modèle en plâtre où<br />
chaque dent a été séparée, nous traçons à la mine<br />
de cire les limites des préparations.<br />
Toutes les étapes de laboratoire seront effectuées<br />
sur ce maître-modèle<br />
Fig. 21 - Les instruments sonores et ultrasonores<br />
sont indispensables pour éliminer les restes<br />
souvent invisibles de résine ou de ciment de<br />
scellement, en prenant soin de ne pas fracturer<br />
les bords de préparation déjà enregistrés<br />
Fig. 24 - Après avoir mordancé les surfaces<br />
cavitaires on applique successivement les<br />
différents composants de l’adhésif sélectionné,<br />
ici les 3 composants du Nexus ®<br />
Fig. 19 - La technique de montage des composites<br />
de laboratoire reprend le principe de la<br />
stratification des poudres de céramique.<br />
Toutes les caractérisations sont possibles et<br />
beaucoup plus simples à réaliser, car on peut,<br />
grâce à des photopolymérisations successives,<br />
figer chaque colorant<br />
Fig. 22 - L’aéropolisseur ou, mieux, les sprays<br />
abrasifs à base d’alumine 25 microns, (Air Flow<br />
Prep K 1 EMS) permettent d’obtenir une surface<br />
parfaitement propre en quelques secondes<br />
Fig. 25 - Avant de photopolymériser le composite<br />
de collage il est indispensable de nettoyer la zone<br />
cervicale à l’aide d’un fil de soie (Superfloss®)<br />
et d’éliminer les gros excès de composite<br />
51
Fig. 26 - La prise du composite de collage dual,<br />
type 2 Bond 2 (Heraeus Kulzer) Variolink<br />
(Ivoclar) ou Nexus (Kerr), nécessite une<br />
photopolymérisation prolongée de deux minutes,<br />
en prenant soin de changer l’incidence du rayon<br />
lumineux. L’onlay étant parfaitement maintenu<br />
en place lors de la séquence de polymérisation<br />
Fig. 29 - …puis on applique une couche fine de<br />
résine liquide type Fortify (Bisico) ou Optiguard<br />
(Kerr) qui sera photopolymérisée une trentaine de<br />
secondes. Cette étape est réalisée avant toute<br />
utilisation des instruments silicone…<br />
52<br />
Fig. 27 - Les excès sont éliminés à l’aide<br />
d’instruments rotatifs en tungstène ou diamantés<br />
à grains fins<br />
Fig. 28 - Le scellement des limites nécessite un<br />
mordançage à l’acide phosphorique de toutes les<br />
zones accessibles pendant dix secondes<br />
Fig. 30, 31, 32 - La technique des inlays et onlays en composite permet, lorsque toutes les étapes sont bien respectées, de s’adapter à tout type de cavité.<br />
De plus, ces matériaux, grâce à leurs excellentes qualités optiques, peuvent, au plan esthétique, rivaliser avec les inlays onlays de céramique, pendant une<br />
durée cliniquement acceptable et en augmentation
Après avoir essayé les <strong>restaurations</strong><br />
(fig. 23) et réglé les contacts proximaux,<br />
on peut entreprendre la procédure<br />
de collage.<br />
Pour ce collage nous avons à notre<br />
disposition une grande variété<br />
d’adhésifs amélo-dentinaires. Bien<br />
qu’il existe une tendance récente<br />
dans l’utilisation des adhésifs monocomposants<br />
à base d’acétone, nous<br />
restons le plus souvent fidèles aux<br />
adhésifs éprouvés à deux, voire à<br />
trois composants, ayant pour solvant<br />
l’eau et l’alcool.<br />
En effet, les adhésifs à base d’acétone<br />
demandent de la part du praticien<br />
un contrôle rigoureux de l’humidité,<br />
qui est difficile à réaliser, surtout pour<br />
les cavités profondes.<br />
Un manque ou un excès d’eau peuvent<br />
compromettre la formation de la<br />
couche hybride et par voie de conséquence<br />
l’étanchéité et l’adhésion des<br />
<strong>restaurations</strong>.<br />
Avec les adhésifs à base d’eau et<br />
d’alcool comme l’Optibond FL ® ou le<br />
Nexus® on peut sans grand danger<br />
sécher sans déshydrater la totalité de<br />
la cavité, c’est-à-dire émail et dentine.<br />
La réhydratation du réseau collagénique<br />
est alors réalisée par le solvant<br />
aqueux de l’adhésif.<br />
Chaque cavité est mordancée à l’aide<br />
d’un gel d’acide phosphorique à 37 %<br />
pendant 20 secondes, suivi d’un rinçage<br />
prolongé, puis d’un séchage<br />
modéré à la soufflette à air.<br />
L’intrados des inlays est de nouveau<br />
sablé légèrement à l’alumine 50<br />
microns, puis mordancé pendant une<br />
minute à l’aide d’un gel d’acide fluorhydrique.<br />
Après un rinçage soigneux, on dépose<br />
une couche de silane qui sera<br />
laissée en place une minute, puis<br />
séchée.<br />
Pour le composite de collage nous<br />
avons là aussi une gamme importante<br />
de produits, comme le Variolink II ® ,<br />
Bond 2 ® , Choice ® , Nexus ® ... La plu-<br />
part sont à la fois chémo et photopolymérisables<br />
et possèdent deux types<br />
de catalyseurs : un haute viscosité,<br />
un basse viscosité. Pour les inlays,<br />
nous préférons utiliser un catalyseur<br />
haute viscosité, afin d’éviter les<br />
mélanges trop fluides qui sont toujours<br />
plus difficiles à nettoyer.<br />
Après avoir étalé l’adhésif amélodentinaire<br />
(fig. 24), on enduit la cavité<br />
d’un film de composite de collage,<br />
puis l’inlay est mis en place, les excès<br />
importants sont éliminés, notamment<br />
dans la zone cervicale (fig. 25).<br />
La photopolymérisation avec les<br />
lampes conventionnelles doit être<br />
longue, environ deux minutes, en<br />
changeant d’incidence (fig. 26).<br />
Ce protocole est répété pour chaque<br />
restauration.<br />
Une fois l’ensemble des inlays collés<br />
on élimine les excès à l’aide de lames<br />
de bistouri ou d’instruments tungstène<br />
ou diamantés grains fins (fig. 27)<br />
(Coffret TPS Compofine ® ).<br />
Avant de procéder aux manœuvres<br />
de finition et de réglage de l’occlusion<br />
on procède au scellement des<br />
marges et à la fermeture des défauts<br />
de surface de la restauration.<br />
Pour cela, on mordance à nouveau<br />
les limites accessibles à l’acide phosphorique<br />
à 37 % pendant une quinzaine<br />
de secondes (fig. 28), puis après<br />
avoir rincé et séché l’ensemble de la<br />
dent, on applique sur l’ensemble des<br />
<strong>restaurations</strong> et sur les limites mordancées<br />
une résine liquide (fig. 29)<br />
(Optiguard ® , Fortify ® ) qui est photopolymérisée<br />
pendant vingt secondes.<br />
Il est important de répéter que la fermeture<br />
des canalicules (ouverts par le<br />
mordançage) par une couche hybride<br />
étanche et le scellement des marges<br />
et des défauts de surface du composite<br />
par une résine liquide sont les<br />
deux étapes fondamentales pour<br />
garantir la pérennité du collage.<br />
Une fois cette étanchéification réalisée<br />
on peut procéder au réglage de<br />
53
33 34<br />
54<br />
Fig. 33 - Inlay mésio-occlusal<br />
composite collé Belle Glass HP®<br />
sur 36<br />
Fig. 34 - Quadrant de 4 inlays en<br />
composite de laboratoire de<br />
2 ème génération<br />
(Conquest Sculpture®)<br />
sur 24 (MOD),<br />
25 (MOD), 26 (MOD), 27 (OD)<br />
l’occlusion, ainsi qu’aux manœuvres<br />
de finition, à l’aide de meules silicone<br />
utilisées sous pression, et de pâtes<br />
diamantées pour le brillantage final<br />
(fig. 30, 31, 32).<br />
CONCLUSION<br />
Au cours des années 80 et 90 la dentisterie<br />
restauratrice a connu une véritable<br />
mutation qui a bouleversé nos<br />
procédures de traitement dans le respect<br />
de 6 principes fondamentaux :<br />
fonction, longévité, biocompatibilité,<br />
économie tissulaire, esthétique et prévention.<br />
Les deux derniers critères s’imposent<br />
dernièrement, d’une part comme une<br />
exigence de nos patients et, d’autre<br />
part, comme notre obligation d’ordre<br />
éthique (11).<br />
Trop souvent invasives et in<strong>esthétiques</strong><br />
la dentisterie restauratrice et la<br />
prothèse ont longtemps procédé de<br />
réflexes interventionnistes qui ne prenaient<br />
pas assez en compte le “primum<br />
non nocere”. L’orientation<br />
moderne de ces disciplines est la prévention<br />
et le recours à des bio-matériaux<br />
intelligents (5).<br />
Lorsque des <strong>restaurations</strong> coronaires<br />
partielles indirectes sont indiquées<br />
dans les secteurs postérieurs, les<br />
composites de laboratoire de seconde<br />
génération sont à l’heure actuelle les<br />
bio-matériaux de choix en raison de<br />
l’ensemble de leurs propriétés physiques,<br />
de leur simplicité de mise en<br />
œuvre, des possibilités de réparation<br />
et/ou de remarginage en bouche, de<br />
leur coût et de leurs qualités <strong>esthétiques</strong><br />
(fig. 33-34).<br />
Cependant la pertinence de l’indication,<br />
le dessin des préparations <strong>dentaire</strong>s<br />
et le respect des protocoles cliniques<br />
sont les paramètres essentiels<br />
de la réussite de ces <strong>restaurations</strong><br />
indirectes : c’est pourquoi, dans cet<br />
article, nous avons souhaité clarifier<br />
ces protocoles au moyen d’un temps<br />
par temps largement iconographié.<br />
Dans l’attente de matériaux bioactifs<br />
qui freineront, ou même inhiberont, la<br />
formation de la plaque bactérienne<br />
cariogène les composites de laboratoire<br />
sont à la lumière de notre expérience<br />
clinique les matériaux les<br />
mieux adaptés actuellement à la réalisation<br />
des inlays et onlays <strong>esthétiques</strong><br />
collés.
1. CHALIFOUX P.R. - Treatment consideration<br />
for posterior laboratory fabricated composite<br />
resin restorations. Pract. Period. and Aesthet.<br />
Dent. 10 : 969-978, 1998.<br />
2. DIETSCHI D. et SPREAFICO R. - Restaurations<br />
<strong>esthétiques</strong> <strong>collées</strong> : composites et céramiques<br />
dans les traitements <strong>esthétiques</strong> des<br />
dents <strong>postérieures</strong>. Quintessence International.<br />
Paris 1997.<br />
3. JONES D.W. - Development of dental ceramics.<br />
Dent. Clin. North Am. 29 : 621-644, 1985.<br />
4. LAND C.H. - A new system of restoring<br />
badly decayed teeth by means of an enameled<br />
coating. J Independ. Pract. 7 : 407-413, 1886.<br />
5. LASFARGUES J.J. - Evolution des concepts<br />
en odontologie conservatrice. Du modèle chirurgical<br />
invasif au modèle médical préventif<br />
Inf. Dent. 80 : 3111 -3124, 1998.<br />
6. MAC LEAN J.W. - The science and art of<br />
dental ceramics. Quintessence, London 1980.<br />
7. MIARA P. et ZYMAN P. - Nouvelles générations<br />
de <strong>restaurations</strong> <strong>esthétiques</strong> en composite<br />
au secteur postérieur. Le Point 131 :<br />
24-31, 1998.<br />
8. MIARA P. - Aesthetic guidelines for second<br />
generation indirect inlay and onlay composite<br />
restorations. Pract. Periodont. Aesthet.<br />
Dent. 10 : 423-431, 1998.<br />
9. MIARA P. - Intérêt des composites renforcés<br />
par fibres dans la contention collée. Le<br />
Monde Dentaire 90 : 41-54, 1998.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
10. MORMANN W.W.H., AMEY C., LUTZ F. -<br />
Kornposit Inlays : Marginale Adaptation,<br />
Randdichtigkeit, Porositat und okklusaler, Verschleiss.<br />
Dtsch Zahnärztl Z. 37 : 43 8-41, 1982.<br />
11. SPREAFICO (5) et DIETSCHI D. - Concepts<br />
et matériaux modernes pour le traitement<br />
conservateur des dents <strong>postérieures</strong> en technique<br />
adhésive. Réalités Cliniques 9 : 363-<br />
375, 1998.<br />
12. TAGGART M. - A new and accurate method<br />
of making gold inlays. Dent. Cosmos 49 :<br />
1117-1123, 1907.<br />
13. TOUATI B. - Une nouvelle application du<br />
collage en prothèse conjointe. Inlays-onlays<br />
et couronnes jackets en résine composite.<br />
Revue Odont. Stomatol. 3 : 180-191, 1984.<br />
14. TOUATI B. et PISSIS P. - L'inlay collé en résine<br />
composite. Cahiers Prot. 48 : 29-59, 1984.<br />
15. TOUATI B. - The evolution of aesthetic restorative<br />
materials for inlays and onlays : a<br />
review. Pract. Periodont. Aesthet. Dent. 8 :<br />
657-666, 1996.<br />
16. TOUATI B. et AIDAN N. - Les composites<br />
de laboratoire de seconde génération. Inf.<br />
Dent. 3 : 175- 183, 1996.<br />
17. TOUATI B. et AIDAN N. - Second generation<br />
laboratory composite resins for indirect<br />
restorations. J Esth. Dent. 9 ; 1 08- 118, 1997.<br />
18. TOUATI B., MIARA P., NATHANSON D. -<br />
Esthetic dentistry and ceramic restorations.<br />
Martin Dunitz Publisher. London 1998.<br />
ABSTRACT<br />
BONDED POSTERIOR ESTHETIC RESTORATIONS :<br />
FROM CERAMIC TO LABORATORY COMPOSITES<br />
RESUMEN<br />
RESTAURACIONES ESTETICAS POSTERIORES ADHESIVAS :<br />
DE LA CERAMICA A LA RESINA COMPUESTA DE LABORATORIO<br />
Correspondance :<br />
Paul Miara<br />
24, rue du Rocher<br />
75008 Paris<br />
FRANCE<br />
The progress in bonding techniques and the recent evolution of laboratory composites have permitted the<br />
development of new generations of composite materials which are particularly well adapted to inlay-onlay techniques.<br />
Among the various systems currently available, we have chosen to present the Belle Glass HP system, which offers a<br />
type of heat-polymerization under nitrogen pressure. This is particularly interesting since it allows us to reach<br />
conversion rates of the order of 98.5%. After a brief explanation of the significance of these new composites, we will<br />
describe, using a clinical case, all the steps in the realization of an inlay using this material.<br />
El progreso de los adhesivos y la reciente evolución de las resinas compuestas de laboratorio, permitieron el<br />
desarrollo de nuevas generaciones de materiales compuestos, particularmente adaptados a la técnica de inlays<br />
onlays. Entre los diversos sistemas existentes actualmente hemos elegido presentar Belle Glass HP, cuyo modo de<br />
polimerización es en caliente bajo presión de nitrógeno, sistema particularmente interesante ya que permite alcanzar<br />
tasas de conversión de unos 98,5%. Tras explicar detalladamente en que consiste el progreso de estas nuevas resinas<br />
compuestas, y tomando como base un caso clínico describiremos todas las etapas de realización de un inlay.<br />
55