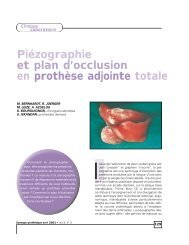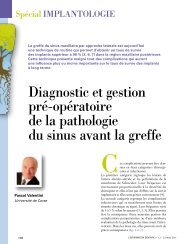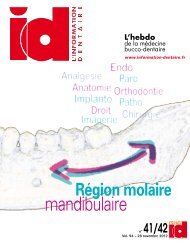Programmation d'un articulateur à partir d'enregistrements ...
Programmation d'un articulateur à partir d'enregistrements ...
Programmation d'un articulateur à partir d'enregistrements ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Stratégie prothétique février 2007 • vol 7, n° 1<br />
Cabinet Laboratoire<br />
<strong>Programmation</strong> d’un <strong>articulateur</strong><br />
<strong>à</strong> <strong>partir</strong> d’enregistrements<br />
dynamiques intra-buccaux<br />
G. DUMINIL, O. LAPLANCHE,<br />
G. TOQUE et D. TARDIVO<br />
Chirurgiens-dentistes<br />
M. HEREMANS<br />
Prothétiste dentaire<br />
Pourquoi programmer un<br />
<strong>articulateur</strong> en prothèse amovible<br />
complète ?<br />
Comment réaliser simplement<br />
l’enregistrement des trajectoires<br />
condyliennes du patient ?<br />
Quels en sont les avantages<br />
pour l’équilibration des prothèses<br />
complètes ?<br />
Les <strong>articulateur</strong>s ont été imaginés il<br />
y a presque un siècle par des<br />
praticiens désireux d’optimiser les<br />
résultats de l’élaboration des<br />
prothèses amovibles complètes.<br />
Le principe initial est de reproduire des<br />
équivalents géométriques du déplacement<br />
mandibulaire. Utilisés au laboratoire<br />
de prothèse, ils permettent d’organiser<br />
l’occlusion thérapeutique de manière <strong>à</strong><br />
solliciter le moins possible l’adaptation du<br />
patient lors de la mise en fonction des<br />
prothèses. Ces appareils sont plus ou<br />
moins paramétrables, offrant ainsi des<br />
capacités variées de reproduction des<br />
mouvements.<br />
5
<strong>Programmation</strong> d’un <strong>articulateur</strong> - G. Duminil et coll.<br />
6<br />
Les <strong>articulateur</strong>s sont classés en plusieurs<br />
catégories en fonction des<br />
possibilités de réglage.<br />
On distingue :<br />
• des <strong>articulateur</strong>s présentant des paramètres<br />
prédéterminés,<br />
• des <strong>articulateur</strong>s semi adaptables<br />
permettant le réglage de la pente condylienne<br />
et de l’angle de Bennett , intégrant<br />
ou non le paramétrage du déplacement<br />
initial de Bennett,<br />
• des <strong>articulateur</strong>s entièrement ajustables<br />
: les boîtiers condyliens présentent<br />
de nombreux réglages et pouvant être<br />
munis d’inserts interchangeables présentant<br />
des surfaces courbes.<br />
Quel que soit le type d’<strong>articulateur</strong> choisi,<br />
l’utilisation d’un arc de transfert est indispensable<br />
pour situer le modèle maxillaire<br />
correctement par rapport <strong>à</strong> l’axe transverse<br />
de rotation.<br />
Les méthodes destinées <strong>à</strong> enregistrer la<br />
cinématique mandibulaire du patient sont<br />
adaptées au type d’<strong>articulateur</strong> utilisé.<br />
Pour un <strong>articulateur</strong> semi-adaptable, la<br />
méthode la plus courante consiste <strong>à</strong> réaliser<br />
des mordus dans des positions de<br />
diduction gauche et droite et éventuellement<br />
de propulsion mandibulaire. Il est<br />
également possible de réaliser des enregistrements<br />
graphiques para-condyliens,<br />
ce qui procure une information plus<br />
complète sur l’amplitude, la régularité, et<br />
la courbure des trajets dans un plan para<br />
sagittal.<br />
En ce qui concerne les <strong>articulateur</strong>s entièrement<br />
ajustables, la cinématique est<br />
enregistrée au moyen de d i s p o s i t i f s<br />
complexes : les pantographes dont la mise<br />
en œuvre est longue et difficile. Une<br />
alternative proposée par Swanson (11)<br />
consiste <strong>à</strong> mouler les boitiers condyliens<br />
d’un <strong>articulateur</strong> (le TMJ ® ) <strong>à</strong> <strong>partir</strong> d’enregistrements<br />
intrabuccaux. Inspirés de ce<br />
principe, nous décrivons un système<br />
d’enregistrement intra-buccal de la cinématique<br />
mandibulaire permettant sur<br />
l’<strong>articulateur</strong> la confection par moulage<br />
des fosses condyliennes et d’une table<br />
incisive personnalisée.<br />
Les mouvements reproduits par l’<strong>articulateur</strong><br />
favorisent la réalisation d’un<br />
montage équilibré au plus proche de la<br />
physiologie du patient.<br />
MOYENS ET MÉTHODES<br />
L’<strong>articulateur</strong> utilisé est un Denar ®<br />
Modèle Combi ® , avec l’arc facial<br />
Slidematic ® .<br />
Le cas clinique illustrant cette méthode<br />
est une situation d’édentement complet<br />
bi-maxillaire.<br />
La méthode de travail pour la réalisation<br />
prothétique comprend des empreintes<br />
primaires et secondaires. Un arc facial<br />
est utilisé pour transférer le modèle<br />
maxillaire dans l’<strong>articulateur</strong>. Lors du<br />
montage du moulage maxillaire, des<br />
inserts <strong>à</strong> 20° sont mis en place dans les<br />
boîtiers condyliens pour assurer le maximum<br />
de stabilité <strong>à</strong> la branche supérieure<br />
de l’<strong>articulateur</strong>. La confection de bases<br />
stabilisées sur moulages conduit <strong>à</strong> la<br />
mise en <strong>articulateur</strong> des moulages dans<br />
la relation maxillo-mandibulaire choisie.<br />
Les maquettes sont réglées en bouche<br />
pour déterminer l’orientation du plan<br />
occlusal maxillaire et la dimension verticale<br />
de reconstruction. Les modèles sont<br />
montés en <strong>articulateur</strong> (fig. 1).<br />
Les bourrelets en résine sont réduits de<br />
façon <strong>à</strong> recevoir le dispositif d’enregistrement<br />
entre les bases (fig. 2).<br />
Ce dispositif se compose de deux<br />
plaquettes en plastique (fig. 3 et 4). La<br />
plaquette maxillaire comporte trois zones<br />
destinées <strong>à</strong> l’enregistrement. La plaquett<br />
e mandibulaire comporte trois pointeaux<br />
mousses et une vis réglable servant de<br />
point d’appui central.<br />
Les deux plaquettes sont solidarisées<br />
avec de la cire collante et disposées<br />
entre les moulages de façon <strong>à</strong> centrer et<br />
orienter horizontalement le dispositif. De<br />
la résine permet de les solidariser aux<br />
deux bases (fig. 5).<br />
La séance clinique débute par l’essayage<br />
du système et l’entraînement du patient.<br />
Le patient est invité <strong>à</strong> exécuter des<br />
mouvements de diduction et de propulsion,<br />
l’opérateur contrôle l’absence<br />
d’interférence entre les bases dans ces<br />
mouvements et en cas de besoin, active<br />
la vis de centrage pour modifier l’espace<br />
disponible (fig. 6 et 7). L’ o p é r a t e u r<br />
indique verbalement au patient « en<br />
avant , en arrière … En avant » pour obtenir<br />
la propulsion puis « en avant, en<br />
arrière …<strong>à</strong> droite », « en avant, en arrière<br />
…<strong>à</strong> gauche » pour les mouvements de<br />
Stratégie prothétique février 2007 • vol 7, n° 1
1 2 3<br />
4 5 6<br />
7 8 9<br />
diduction, un guidage de l’opérateur<br />
accompagne cette répétition. L’objectif<br />
est d’obtenir les mouvements excursifs<br />
limites. Lorsque le patient est familiarisé<br />
avec cet exercice, l’enregistrement peut<br />
avoir lieu.<br />
Les bases sont sorties de la bouche, les<br />
pointeaux enregistreurs vaselinés, et les<br />
zones d’enregistrement garnies de résine<br />
( P i - k u - P l a s t ® ) en phase plastique (fig. 8 et<br />
9 ) . Les bases éventuellement enduites<br />
d’adhésif sont placées en bouche, le<br />
patient guidé dans la position arrière<br />
exécute plusieurs fois les mouvements.<br />
Chaque enregistrement débute depuis la<br />
position la plus postérieure qui est obtenue<br />
par « en avant, en arrière ».<br />
Stratégie prothétique février 2007 • vol 7, n° 1<br />
Cabinet Laboratoire<br />
F i g . 1 Les moulages sont montés en relation centrée dans l’<strong>articulateur</strong> après<br />
avoir déterminé sur les maquettes, l’orientation du plan d’occlusion et la DVO.<br />
Fig. 2 Sur l’<strong>articulateur</strong>, les maquettes sont préparées <strong>à</strong> recevoir le dispositif<br />
d’enregistrement.<br />
F i g . 3 La plaquette mandibulaire comporte trois pointeaux mousses et une vis de<br />
réglage, sur la plaquette maxillaire, on distingue les trois zones d’enregistrement.<br />
Fig. 4 Les deux plaquettes sont assemblées et solidarisées <strong>à</strong> la cire collante<br />
avant d’être positionnées entre les maquettes en résine.<br />
Fig. 5 Le dispositif est solidarisé aux maquettes avec de la résine auto-polymérisable.<br />
Fig. 6 Essayage en bouche et entraînement du patient.<br />
Fig. 7 La vis est réglée de telle sorte que les deux parties n’interfèrent pas<br />
dans les mouvements limites.<br />
Fig. 8 Les pointeaux enregistreurs sont vaselinés.<br />
Fig. 9 De la résine en phase pâteuse est déposée sur les zones d’enregistrement<br />
de la plaquette maxillaire.<br />
7
<strong>Programmation</strong> d’un <strong>articulateur</strong> - G. Duminil et coll.<br />
10 11<br />
12 13<br />
F i g . 1 0 Les pointeaux<br />
impriment dans la résine<br />
plastique les trajets durant<br />
le déplacement mandibulaire.<br />
F i g . 1 1 L’ e n r e g i s t r e m e n t<br />
est interrompu lorsque la<br />
plasticité de la résine<br />
augmente.<br />
Fig. 12 Aspect des trajets<br />
enregistrés au maxillaire.<br />
F i g . 1 3 Les maquettes<br />
sont mises en relation<br />
dans les enregistrements<br />
réalisés.<br />
Fig. 14 L’opérateur reproduit<br />
sur l’<strong>articulateur</strong> les<br />
trajets enregistrés en<br />
bouche pour modeler les<br />
fosses condyliennes et la<br />
table incisive.<br />
8<br />
14<br />
Stratégie prothétique février 2007 • vol 7, n° 1
15 16<br />
17 18<br />
Lors des déplacements, les pointeaux<br />
impriment dans la résine des trajets tridimentionnels<br />
(fig. 10). Lorsque la résine<br />
commence <strong>à</strong> prendre, les maquettes<br />
sont retirées de la bouche pour<br />
permettre la fin de la polymérisation (fig.<br />
11 et 12).<br />
Sur l’<strong>articulateur</strong> des inserts condyliens <strong>à</strong><br />
0° sont mis en place.<br />
Les maquettes sont replacées sur les<br />
moulages qui sont mis en relation par les<br />
enregistrements réalisés (fig. 13). Les<br />
boules condyliennes et l’extrémité de la<br />
tige incisive sont vaselinées. De la résine<br />
en phase plastique est déposée dans les<br />
boîtiers condyliens et sur la table incisive.<br />
Les deux branches de l’<strong>articulateur</strong> sont<br />
actionnées par l’opérateur et guidées par<br />
les trajets fonctionnels enregistrés (fig.<br />
14). La table incisive et les boîtiers condyliens<br />
sont ainsi modelés en fonction des<br />
paramètres obtenus sur le patient (fig. 15<br />
et 16). Nous aboutissons <strong>à</strong> un <strong>articulateur</strong><br />
complètement personnalisé (fig. 17). Au<br />
laboratoire, le montage des dents respecte<br />
les critères esthétiques au niveau des<br />
Stratégie prothétique février 2007 • vol 7, n° 1<br />
19<br />
Cabinet Laboratoire<br />
F i g . 1 5 Le boîtier condylien après<br />
modelage.<br />
Fig. 16 La table incisive participe au<br />
guidage de la branche supérieure de<br />
l’<strong>articulateur</strong>.<br />
Fig. 17 L’<strong>articulateur</strong> est apte <strong>à</strong> reproduire les déplacements enregistrés sur<br />
le patient.<br />
Fig. 18 Le montage des dents antérieures répond aux impératifs esthétiques<br />
et phonétiques.<br />
Fig. 19 Les secteurs postérieurs sont agencés.<br />
9
<strong>Programmation</strong> d’un <strong>articulateur</strong> - G. Duminil et coll.<br />
20 21 22<br />
23 24<br />
Fig. 20 Obtention sur l’<strong>articulateur</strong><br />
des contacts<br />
équilibrants.<br />
F i g . 2 1 Essayage et<br />
contrôle en bouche des<br />
montages en cire.<br />
Fig. 22 Après polymérisation,<br />
les prothèses<br />
retournent dans l’<strong>articulateur</strong><br />
pour contrôle.<br />
F i g . 2 3 Contrôle des<br />
mouvements de diduction.<br />
F i g . 2 4 Visualisation des<br />
contacts équilibrants ainsi<br />
obtenus.<br />
F i g . 2 5 Validation finale<br />
lors de la mise en bouche.<br />
10<br />
25<br />
dents antérieures. L’occlusion dans les<br />
secteurs postérieurs est organisée en<br />
établissant des contacts équilibrants<br />
dans les mouvements de diduction et de<br />
propulsion (fig. 18, 19 et 20).<br />
Le montage est essayé sur le patient, les<br />
contacts sont testés en occlusion<br />
centrée et dans les excursions (fig. 21).<br />
Après polymérisation, les prothèses sont<br />
de nouveau équilibrées sur l’<strong>articulateur</strong><br />
(fig. 22, 23, 24).<br />
La mise en bouche des prothèses est<br />
faite, les tests sont effectués et la stabilité<br />
vérifiée (fig. 25).<br />
Stratégie prothétique février 2007 • vol 7, n° 1
DISCUSSION<br />
Choix d’un type d’<strong>articulateur</strong><br />
La mise en œuvre de l’un ou de l’autre de<br />
ces appareils va dépendre du type d’organisation<br />
occlusale <strong>à</strong> réaliser sur la<br />
prothèse (8).<br />
Une idée communément répandue en<br />
prothèse est que la prothèse fixée sur<br />
denture naturelle réclame un paramétrage<br />
précis (et donc une forte adaptabilité<br />
des déterminants postérieurs sur l’<strong>articulateur</strong>)<br />
alors que la prothèse amovible<br />
complète peut se contenter de paramètres<br />
standards.<br />
Cette position ne résiste pas <strong>à</strong> l’analyse<br />
précise des objectifs prothétiques et du<br />
contexte occlusal et ostéo articulaire et<br />
ce pour 3 raisons principales :<br />
Besoin de précision dans la programma -<br />
tion<br />
La prothèse en denture naturelle fait<br />
généralement et préférentiellement<br />
appel <strong>à</strong> un concept occlusal de protection<br />
mutuelle dans lequel le guidage antérieur<br />
provoque une désocclusion postérieure<br />
qui limite les contraintes sur les secteurs<br />
cuspidés et optimise le fonctionnement<br />
neuro musculaire. La désocclusion postérieure,<br />
qui est l’objectif recherché, est<br />
davantage dépendante du guidage antérieur<br />
que de l’effet des déterminants<br />
postérieurs (5, 9).<br />
A <strong>partir</strong> des valeurs obtenues par enregistrement,<br />
des valeurs de sécurité<br />
peuvent être introduites au niveau de l’<strong>articulateur</strong><br />
en diminuant la valeur de la<br />
pente condylienne et en augmentant<br />
l’angle de Bennett ou l’amplitude du<br />
déplacement latéral initial (6, 7).<br />
A contrario, dans les cas de prothèse<br />
complète, l’objectif de stabilité des<br />
prothèses lors des mouvements excentrés<br />
nous impose une occlusion<br />
bilatéralement équilibrée, qui ne peut se<br />
satisfaire du 1/10 de mm d’imprécision,<br />
le guidage des mouvements mandibulaires<br />
devant alors être des plus précis.<br />
Chez le patient édenté, cela nous conduit<br />
<strong>à</strong> paramétrer avec précision les déterminants<br />
postérieurs par enregistrement<br />
graphique ou intermaxillaire, mais nous<br />
nous heurtons alors <strong>à</strong> 2 autres difficultés :<br />
Problèmes d’enregistrement des mouve -<br />
ments mandibulaires<br />
Ces complications sont liées :<br />
Stratégie prothétique février 2007 • vol 7, n° 1<br />
• <strong>à</strong> la difficulté de stabiliser l’appareillage<br />
mandibulaire qui permet l’enregistrement<br />
graphique,<br />
• <strong>à</strong> la multiplication des bases d’occlusion<br />
dans les enregistrements intermaxillaires<br />
des positions excentrées (10),<br />
• aux dyskinésies souvent présentes<br />
chez les édentés complets (2).<br />
Particularités anatomiques liées au<br />
vieillissement des articulations temporomandibulaires<br />
L’âge des sujets et leur dentition pathologique<br />
augmentent la prévalence des<br />
remaniements articulaires et de leurs<br />
conséquences cinématiques : mouvement<br />
de Bennett accru, jeu articulaire,<br />
cône de Guichet modifié (1, 3). La perte<br />
de dimension verticale d’occlusion très<br />
souvent observée, conduit aussi <strong>à</strong> une<br />
position mandibulaire très avancée.<br />
Des besoins prothétiques accrus, des particularités<br />
cinématiques plus complexes qui<br />
s’éloignent de la normalité pour laquelle<br />
les <strong>articulateur</strong>s sont conçus justifient<br />
l’utilisation de méthodes particulières de<br />
paramétrage des <strong>articulateur</strong>s en prothèse<br />
amovible complète.<br />
Le montage de dents réalisé au laboratoire<br />
requiert un <strong>articulateur</strong> capable de reproduire<br />
au plus près les déplacements<br />
mandibulaires du patient. La méthode<br />
d’enregistrement des positions excentrées<br />
ne donne qu’un instantané du déplacement,<br />
le réglage est réalisé en extrapolant<br />
par une droite le trajet réellement exécuté<br />
par le patient. Les enregistrements<br />
graphiques para-condyliens permettent<br />
d’observer les trajets curvilignes du déplacement,<br />
mais la reproduction au niveau de<br />
l’<strong>articulateur</strong> reste en général limité <strong>à</strong> des<br />
moyennes rectilignes. De plus, la stabilisation<br />
de ce type d’enregistreur sur l’arcade<br />
mandibulaire est difficile, ce qui entache la<br />
précision recherchée.<br />
CONCLUSION<br />
La technique de programmation que<br />
nous présentons est simple et rapide <strong>à</strong><br />
mettre en œuvre, elle réclame une séance<br />
clinique supplémentaire, mais permet<br />
la réalisation au laboratoire d’un montage<br />
précis qui réduit les corrections <strong>à</strong> apporter<br />
lors des essayages et optimise le<br />
confort du patient dès la mise en bouche<br />
des prothèses.<br />
Cabinet Laboratoire<br />
11
<strong>Programmation</strong> d’un <strong>articulateur</strong> - G. Duminil et coll.<br />
AUTO-ÉVALUATION<br />
1. L’<strong>articulateur</strong> préréglé est préférable au semi adaptable dans le<br />
cas de prothèse amovible totale ❏ Vrai ❏ Faux<br />
2. L’élaboration de prothèse fixée justifie l’utilisation d’un <strong>articulateur</strong><br />
entièrement ajustable ❏ Vrai ❏ Faux<br />
3. L’état de santé du système manducateur peut être évalué <strong>à</strong><br />
<strong>partir</strong> d’enregistrements graphiques de la dynamique mandibulaire<br />
❏ Vrai ❏ Faux<br />
4. L’arc de transfert permet d’enregistrer la relation intermaxillaire<br />
❏ Vrai ❏ Faux<br />
5. L’occlusion en prothèse complète est bilatéralement équilibrée<br />
❏ Vrai ❏ Faux<br />
Adresse des auteurs :<br />
Gérard DUMINIL (gduminil@mac.com), Olivier LAPLANCHE, Gaël TOQUE, Delphine TARDIVO<br />
UFR d’Odontologie 24 avenue des Diables Bleus 06357 Nice Cedex 04<br />
Michel HEREMANS TAD 5, rue Professeur Maurice Sureau 06000 Nice<br />
12<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
1 . Dabadie M, Jacquemond D, Louis JP.<br />
Préparation neuro-musculaire et neuro<br />
articulaire chez l’édenté total. Cah<br />
Prothese. 1986 ; 14(56) : 101-22.<br />
2. Dabadie M, Le Bourhis F. Axe charnière et<br />
enregistrement des mouvements condyliens<br />
en prothèse adjointe. Cah Prothese.<br />
1988 ; (64) : 24-33.<br />
3. Dabadie M, Renner RP. Mechanical evaluation<br />
of splint therapy in treatment of the<br />
edentulous patient. J Prosthet Dent.<br />
1990 ; 63(1) : 52-5.<br />
4. Dabadie M. Rôle et utilisation de l’<strong>articulateur</strong><br />
en prothèse amovible complète. In :<br />
Occlusodontie pratique pp. 195-203 Ed.<br />
CdP Paris 2000.<br />
5 . Gibbs CH, Lundeen HC, Mahan PE,<br />
Fujimoto J. Chewing movements in relation<br />
to border movements at the first<br />
molar. J Prosthet Dent. 1981 ; 46(3) : 308-<br />
22.<br />
6 . Giraudeau A, Laplanche O. Enregistrements<br />
des déplacements condyliens.<br />
In : Occlusodontie pratique pp. 117-128<br />
Ed. CdP Paris 2000.<br />
7. Giraudeau A, Brocard D. <strong>Programmation</strong><br />
de l’<strong>articulateur</strong>. In : Occlusodontie<br />
pratique pp. 141-152 Ed. CdP Paris 2000.<br />
8. Guichet N. Procedures for occlusal treatment.<br />
Synopsis Denar Corp. Anaheim<br />
California USA 1978.<br />
9. Lundeen HC, Shryock EF, Gibbs CH. An<br />
evaluation of mandibular border movements<br />
: their character and significance. J<br />
Prosthet Dent. 1978 ; 40(4) : 442-452.<br />
10. Manary DG, Holland GA. Evaluation of<br />
mandibular movement recording and<br />
programming procedures for a molded<br />
condylar control articulator system. J<br />
Prosthet Dent. 1984 ; 52(2) 275-280.<br />
11. Swanson KH. Complete dentures using<br />
th TMJ articulator. J Prosthet Dent. 1979 ;<br />
41(5) 497-506.<br />
Stratégie prothétique février 2007 • vol 7, n° 1