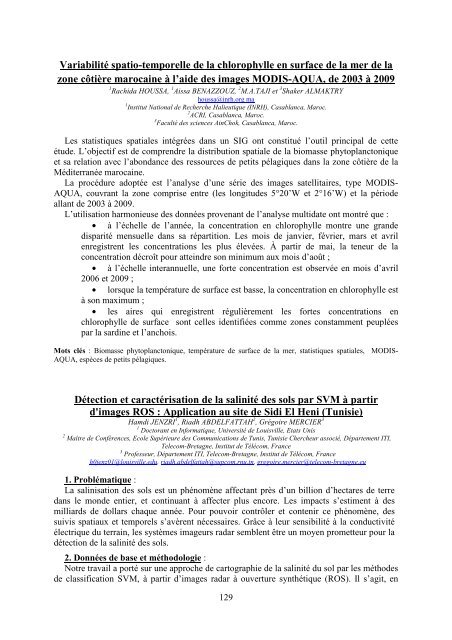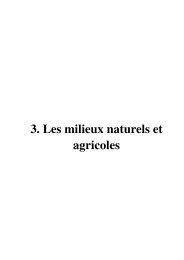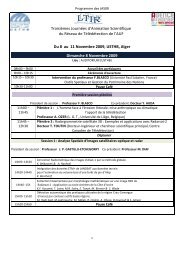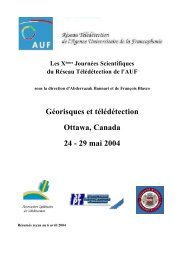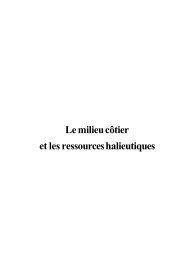Variabilité spatio-temporelle de la chlorophylle en surface de la mer ...
Variabilité spatio-temporelle de la chlorophylle en surface de la mer ...
Variabilité spatio-temporelle de la chlorophylle en surface de la mer ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Variabilité</strong> <strong>spatio</strong>-<strong>temporelle</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>chlorophylle</strong> <strong>en</strong> <strong>surface</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mer</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
zone côtière marocaine à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s images MODIS-AQUA, <strong>de</strong> 2003 à 2009<br />
1 Rachida HOUSSA, 1 Aissa BENAZZOUZ, 2 M.A.TAJI et 3 Shaker ALMAKTRY<br />
houssa@inrh.org ma<br />
1 Institut National <strong>de</strong> Recherche Halieutique (INRH), Casab<strong>la</strong>nca, Maroc.<br />
2 ACRI, Casab<strong>la</strong>nca, Maroc.<br />
3 Faculté <strong>de</strong>s sci<strong>en</strong>ces AinChok, Casab<strong>la</strong>nca, Maroc.<br />
Les statistiques spatiales intégrées dans un SIG ont constitué l’outil principal <strong>de</strong> cette<br />
étu<strong>de</strong>. L’objectif est <strong>de</strong> compr<strong>en</strong>dre <strong>la</strong> distribution spatiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasse phytop<strong>la</strong>nctonique<br />
et sa re<strong>la</strong>tion avec l’abondance <strong>de</strong>s ressources <strong>de</strong> petits pé<strong>la</strong>giques dans <strong>la</strong> zone côtière <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Méditerranée marocaine.<br />
La procédure adoptée est l’analyse d’une série <strong>de</strong>s images satellitaires, type MODIS-<br />
AQUA, couvrant <strong>la</strong> zone comprise <strong>en</strong>tre (les longitu<strong>de</strong>s 5°20’W et 2°16’W) et <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> 2003 à 2009.<br />
L’utilisation harmonieuse <strong>de</strong>s données prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> l’analyse multidate ont montré que :<br />
• à l’échelle <strong>de</strong> l’année, <strong>la</strong> conc<strong>en</strong>tration <strong>en</strong> <strong>chlorophylle</strong> montre une gran<strong>de</strong><br />
disparité m<strong>en</strong>suelle dans sa répartition. Les mois <strong>de</strong> janvier, février, mars et avril<br />
<strong>en</strong>registr<strong>en</strong>t les conc<strong>en</strong>trations les plus élevées. À partir <strong>de</strong> mai, <strong>la</strong> t<strong>en</strong>eur <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
conc<strong>en</strong>tration décroît pour atteindre son minimum aux mois d’août ;<br />
• à l’échelle interannuelle, une forte conc<strong>en</strong>tration est observée <strong>en</strong> mois d’avril<br />
2006 et 2009 ;<br />
• lorsque <strong>la</strong> température <strong>de</strong> <strong>surface</strong> est basse, <strong>la</strong> conc<strong>en</strong>tration <strong>en</strong> <strong>chlorophylle</strong> est<br />
à son maximum ;<br />
• les aires qui <strong>en</strong>registr<strong>en</strong>t régulièrem<strong>en</strong>t les fortes conc<strong>en</strong>trations <strong>en</strong><br />
<strong>chlorophylle</strong> <strong>de</strong> <strong>surface</strong> sont celles i<strong>de</strong>ntifiées comme zones constamm<strong>en</strong>t peuplées<br />
par <strong>la</strong> sardine et l’anchois.<br />
Mots clés : Biomasse phytop<strong>la</strong>nctonique, température <strong>de</strong> <strong>surface</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mer</strong>, statistiques spatiales, MODIS-<br />
AQUA, espèces <strong>de</strong> petits pé<strong>la</strong>giques.<br />
Détection et caractérisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> salinité <strong>de</strong>s sols par SVM à partir<br />
d'images ROS : Application au site <strong>de</strong> Sidi El H<strong>en</strong>i (Tunisie)<br />
Hamdi JENZRI 1 , Riadh ABDELFATTAH 2 , Grégoire MERCIER 3<br />
1 Doctorant <strong>en</strong> Informatique, Université <strong>de</strong> Louisville, Etats Unis<br />
2 Maître <strong>de</strong> Confér<strong>en</strong>ces, Ecole Supérieure <strong>de</strong>s Communications <strong>de</strong> Tunis, Tunisie Chercheur associé, Départem<strong>en</strong>t ITI,<br />
Telecom-Bretagne, Institut <strong>de</strong> Télécom, France<br />
3 Professeur, Départem<strong>en</strong>t ITI, Telecom-Bretagne, Institut <strong>de</strong> Télécom, France<br />
h0j<strong>en</strong>z01@louisville.edu, riadh.ab<strong>de</strong>lfattah@supcom.rnu.tn, gregoire.<strong>mer</strong>cier@telecom-bretagne.eu<br />
1. Problématique :<br />
La salinisation <strong>de</strong>s sols est un phénomène affectant près d’un billion d’hectares <strong>de</strong> terre<br />
dans le mon<strong>de</strong> <strong>en</strong>tier, et continuant à affecter plus <strong>en</strong>core. Les impacts s’estim<strong>en</strong>t à <strong>de</strong>s<br />
milliards <strong>de</strong> dol<strong>la</strong>rs chaque année. Pour pouvoir contrôler et cont<strong>en</strong>ir ce phénomène, <strong>de</strong>s<br />
suivis spatiaux et temporels s’avèr<strong>en</strong>t nécessaires. Grâce à leur s<strong>en</strong>sibilité à <strong>la</strong> conductivité<br />
électrique du terrain, les systèmes imageurs radar sembl<strong>en</strong>t être un moy<strong>en</strong> prometteur pour <strong>la</strong><br />
détection <strong>de</strong> <strong>la</strong> salinité <strong>de</strong>s sols.<br />
2. Données <strong>de</strong> base et méthodologie :<br />
Notre travail a porté sur une approche <strong>de</strong> cartographie <strong>de</strong> <strong>la</strong> salinité du sol par les métho<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification SVM, à partir d’images radar à ouverture synthétique (ROS). Il s’agit, <strong>en</strong><br />
129
abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> mesures sur terrain et <strong>en</strong> abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> modèles physiques adaptés aux données<br />
disponibles, <strong>de</strong> calculer <strong>de</strong>s signatures <strong>de</strong> terrain à partir <strong>de</strong>s images ROS, et d’y appliquer<br />
une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification SVM permettant ainsi l’extraction <strong>de</strong> l’information <strong>de</strong> salinité.<br />
Nous disposons <strong>de</strong> 3 images radar du site d’étu<strong>de</strong>, acquises respectivem<strong>en</strong>t le 24 décembre<br />
2008, le 15 janvier 2009 et le 4 mars 2009. Ce sont <strong>de</strong>s images d’amplitu<strong>de</strong> issues du capteur<br />
ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar) du satellite ENVISAT dans les <strong>de</strong>ux<br />
po<strong>la</strong>risations HH et VV, avec une résolution <strong>de</strong> 12,5 m et selon les mo<strong>de</strong>s IS1 (pour <strong>la</strong><br />
première et <strong>la</strong> troisième image) et IS4 (pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième image).<br />
⎫ Cartographie <strong>de</strong> <strong>la</strong> salinité <strong>de</strong>s sols par SVM<br />
• Prétraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s images :<br />
Les trois images que nous disposons ne représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t pas exactem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> même zone <strong>de</strong><br />
terre. Il y a un déca<strong>la</strong>ge <strong>en</strong>tre les trois. Afin <strong>de</strong> remédier à ce problème et d’adopter le même<br />
référ<strong>en</strong>tiel, nous avons procédé à un reca<strong>la</strong>ge <strong>de</strong>s images <strong>en</strong> utilisant une interpo<strong>la</strong>tion<br />
bilinéaire. Pour ce faire, nous avons utilisé le logiciel ENVI puisque l’application <strong>de</strong> reca<strong>la</strong>ge<br />
disponible sur OTB ne permet pas <strong>la</strong> sélection <strong>de</strong> points d’intérêt facilitant <strong>la</strong> tâche <strong>de</strong> calcul.<br />
• Extraction <strong>de</strong>s signatures :<br />
Nous avons créé six signatures pour chacune <strong>de</strong>s trois images. La première est le résultat<br />
d’un filtre moy<strong>en</strong>neur 7x7 sur le canal HH. La <strong>de</strong>uxième est <strong>la</strong> même chose, sauf que c’est<br />
pour le canal VV. Les <strong>de</strong>ux nous inform<strong>en</strong>t sur <strong>la</strong> réflectivité du sol. La troisième signature<br />
est le rapport point par point <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> première et <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième signature que nous v<strong>en</strong>ons <strong>de</strong><br />
calculer. Elle représ<strong>en</strong>te l’information po<strong>la</strong>rimétrique <strong>de</strong>s données. Elle peut être considérée<br />
comme une mesure <strong>de</strong> contraste <strong>en</strong>tre un effet purem<strong>en</strong>t horizontal et un effet purem<strong>en</strong>t<br />
vertical, ce qui ti<strong>en</strong>dra compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> rugosité <strong>de</strong> <strong>surface</strong>. De plus, ça aura un effet <strong>de</strong><br />
simplification du bruit multiplicatif prés<strong>en</strong>t dans les images radar. La quatrième signature est<br />
le rapport <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> variance et <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne du canal HH <strong>de</strong> l’image <strong>en</strong> question. Ce rapport<br />
constitue une spécificité <strong>de</strong>s images radar. Il r<strong>en</strong>seigne sur l’importance du speckle dans<br />
l’image. La cinquième signature est le gradi<strong>en</strong>t selon les lignes puis les colonnes du canal HH<br />
<strong>de</strong> l’image <strong>en</strong> question. Elle représ<strong>en</strong>te une information <strong>de</strong> texture. Il est <strong>de</strong> même pour <strong>la</strong><br />
sixième signature, sauf que c’est pour le canal VV.<br />
Une fois les six signatures calculées, nous procédons à leur normalisation afin d’avoir <strong>de</strong>s<br />
ordres <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur semb<strong>la</strong>bles.<br />
• C<strong>la</strong>ssification par SVM :<br />
En abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> points étiquetés pour <strong>la</strong> phase d’appr<strong>en</strong>tissage du c<strong>la</strong>ssificateur SVM, nous<br />
nous sommes p<strong>la</strong>cés dans l’hypothèse disant que le c<strong>en</strong>tre du <strong>la</strong>c salé sur l’image est <strong>la</strong> région<br />
<strong>la</strong> plus salée, et nous l’avons utilisée comme une c<strong>la</strong>sse unique pour l’appr<strong>en</strong>tissage du SVM<br />
ONE_CLASS [4] avec un noyau RBF (Radial Basis Function).<br />
Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification, le SVM ONE_CLASS distingue <strong>en</strong>tre les points appart<strong>en</strong>ant à cette<br />
c<strong>la</strong>sse et ceux qui n’y apparti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t pas. Donc, normalem<strong>en</strong>t, il affectera <strong>de</strong>ux étiquettes<br />
différ<strong>en</strong>tes, une pour <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse <strong>en</strong> question et une autre pour tous les points n’appart<strong>en</strong>ant pas à<br />
cette c<strong>la</strong>sse. Ce qui va nous créer <strong>de</strong>ux c<strong>la</strong>sses <strong>en</strong> tout. Mais pour cartographier <strong>la</strong> salinité,<br />
nous avons besoin <strong>de</strong> détecter les différ<strong>en</strong>ces <strong>en</strong>tre les t<strong>en</strong>eurs <strong>en</strong> sel du sol. Pour ce<strong>la</strong>, nous<br />
avons modifié le principe d’action du SVM ONE_CLASS afin qu’il affecte à tous les points<br />
hors <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse c<strong>en</strong>trale, non pas une étiquette unique, mais chacun une étiquette propre à lui,<br />
qui sera <strong>la</strong> distance qui le sépare <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse c<strong>en</strong>trale.<br />
3. Résultats :<br />
Les résultats obt<strong>en</strong>us sembl<strong>en</strong>t être cohér<strong>en</strong>ts, prés<strong>en</strong>tant <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong> <strong>la</strong> salinité qui<br />
varie <strong>en</strong>tre le c<strong>en</strong>tre du <strong>la</strong>c salé et les champs avoisinants. En partant <strong>de</strong> l’hypothèse que le<br />
c<strong>en</strong>tre du <strong>la</strong>c est <strong>la</strong> région <strong>la</strong> plus salée, nos résultats se prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t sous <strong>la</strong> forme d’une<br />
dégradation <strong>de</strong> couleurs, montrant <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong> <strong>la</strong> t<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> sels <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone imagée. La<br />
130
couleur b<strong>la</strong>nche fait référ<strong>en</strong>ce aux portions les plus salées, <strong>la</strong> couleur noire aux celles les<br />
moins salées, et les nuances <strong>de</strong> gris correspon<strong>de</strong>nt à un niveau <strong>de</strong> salinité intermédiaire. La<br />
zone toute noire du <strong>la</strong>c est une exception à cette interprétation puisqu’elle est inondée d’eau.<br />
Le c<strong>en</strong>tre du <strong>la</strong>c étant sec, il parait <strong>en</strong> b<strong>la</strong>nc donc c’est le plus salée. Les al<strong>en</strong>tours sont<br />
sombres vu <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l’eau. Donc, on ne peut pas juger sur le niveau <strong>de</strong> salinité sur ces<br />
régions inondées. Les champs d’agriculture d’à côté pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s nuances <strong>de</strong> gris, donc<br />
prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t le phénomène <strong>de</strong> salinisation avec <strong>de</strong>s niveaux variés. Le résultat <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
cartographie est illustré sur <strong>la</strong> figure 1.<br />
Fig. 1. Résultat <strong>de</strong> <strong>la</strong> cartographie<br />
Mots clés : Salinité du sol, Cartographie, Conductivité électrique, ROS, SVM, ONE_CLASS<br />
Bibliographie<br />
- Metternicht G.I. and Zinck J.A. Remote s<strong>en</strong>sing of soil salinity: pot<strong>en</strong>tials and constraints. Remote S<strong>en</strong>sing<br />
of Environm<strong>en</strong>t, 85:1–20, 2003.<br />
- Confér<strong>en</strong>ce électronique sur <strong>la</strong> salinisation : Ext<strong>en</strong>sion <strong>de</strong> <strong>la</strong> salinisation et Stratégies <strong>de</strong> prév<strong>en</strong>tion et<br />
réhabilitation. FAO, Février-Mars 2006.<br />
- Bell D. Method of <strong>de</strong>termining salinity of an area of soil. World Intellectual Property Organization, No WO<br />
03/005059 A1, 2003.<br />
- Schölkopf B. and Smo<strong>la</strong> A. J. Learning with Kernels: Support Vector Machines, Regu<strong>la</strong>rization,<br />
Optimization, and Beyond. MIT Press Edition, 2002.<br />
Elém<strong>en</strong>ts opérationnels d’analyse <strong>de</strong> l’érosion <strong>de</strong>s sols dans <strong>la</strong> région <strong>de</strong><br />
Kara au Togo<br />
Dodé JOHNSON; Joseph OLOUKOI<br />
Regional C<strong>en</strong>tre for Training in Aerospace Surveys (RECTAS).<br />
johnson@rectas.org; johnson do<strong>de</strong>@yahoo.fr<br />
1. Problématique<br />
Il s’agit <strong>de</strong> proposer pour <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>la</strong> Kara située sur le socle granito-gneissique au<br />
Nord-est du Togo soumise à <strong>la</strong> dégradation du milieu, <strong>de</strong>s outils et élém<strong>en</strong>ts d’analyse <strong>de</strong><br />
l’érosion <strong>de</strong>s sols.<br />
Les particu<strong>la</strong>rités r<strong>en</strong>contrées dans <strong>la</strong> zone concern<strong>en</strong>t aussi bi<strong>en</strong> le milieu naturel que les<br />
activités humaines. La re<strong>la</strong>tive longueur <strong>de</strong> <strong>la</strong> saison sèche et <strong>la</strong> conc<strong>en</strong>tration du cumul<br />
pluviométrique au cours <strong>de</strong> l’année constitu<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s contraintes importantes pour <strong>la</strong> stabilité<br />
<strong>de</strong>s sols. Même si, dans les secteurs à fort relief, <strong>la</strong> nature basique <strong>de</strong>s formations rocheuses<br />
131
soumises à l’altération fournit <strong>de</strong>s sols bruns et ferralitiques à stabilité structurale superficielle<br />
assez élevée (Faure, 1985), <strong>la</strong> déstructuration pédologique sur les pénép<strong>la</strong>ines et p<strong>la</strong>ines aux<br />
sols ferrugineux, peu humifères défavorise <strong>la</strong> stabilité <strong>de</strong>s horizons <strong>de</strong> <strong>surface</strong>. De même, ces<br />
conditions climatiques <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t l’érosion sélective <strong>de</strong>s matériaux fins dans les sols<br />
graveleux à texture peu argileuse, ce qui les appauvrit considérablem<strong>en</strong>t (Lévèque, 1969).<br />
L’action anthropique est caractérisée non seulem<strong>en</strong>t par une longue exploitation agricole <strong>de</strong><br />
ces sols à faible taux d’humus, mais égalem<strong>en</strong>t par <strong>la</strong> forte <strong>de</strong>nsité rurale à vocation agricole<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, ce qui exerce une pression int<strong>en</strong>se <strong>en</strong> réduisant les jachères. Ces conditions<br />
<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong>ux grands problèmes : celui <strong>de</strong> l’érosion dans un secteur à relief et à forte<br />
<strong>de</strong>nsité rurale et celui <strong>de</strong> sources d’information géographique nécessaire à <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> cet<br />
<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t.<br />
2. Données <strong>de</strong> base et méthodologie<br />
Plusieurs sources <strong>de</strong> donnes ont été utilisées pour cette étu<strong>de</strong>. Les données radar SRTM ont<br />
permis l’é<strong>la</strong>boration d’un modèle numérique <strong>de</strong> terrain (MNT) et le calcul <strong>de</strong> certains produits<br />
dérivés, ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> carte <strong>de</strong>s p<strong>en</strong>tes et celle <strong>de</strong> l’indice topographique. La carte <strong>de</strong><br />
l’indice <strong>de</strong> bril<strong>la</strong>nce (IB = [TM3 2 + TM4 2 ] 0.5 ), très utile pour l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s sols nus et<br />
celle <strong>de</strong> l’occupation du sol ont été é<strong>la</strong>borées à partir <strong>de</strong>s données multidate (MSS, TM et<br />
TM) <strong>de</strong> Landsat. L’indice topographique qui est un indice géomorphologique dérivé du<br />
modèle hydrologique TOPMODEL (Bev<strong>en</strong> & Kirkby, 1979) pr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> compte <strong>la</strong> p<strong>en</strong>te locale<br />
(β), <strong>la</strong> <strong>surface</strong> spécifique (a) ( = l’aire contributive / <strong>la</strong> longueur du côté d’un pixel) : i = ln (a<br />
/tan β). Le pot<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> saturation augm<strong>en</strong>te avec <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> cet indice.<br />
3. Résultats<br />
La figure 2, une carte binaire est le résultat du seuil<strong>la</strong>ge effectué sur le calcul <strong>de</strong> l’indice <strong>de</strong><br />
bril<strong>la</strong>nce Elle porte sur les valeurs les plus élevées (plus <strong>de</strong> 85% <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur maximale) et fait<br />
ressortir l’occupation humaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone remarquable par l’agglomération <strong>de</strong> ces pixels<br />
"b<strong>la</strong>ncs" à proximité <strong>de</strong>s voies <strong>de</strong> communication est un indicateur <strong>de</strong> l’emprise humaine.<br />
La figure 3 se rapporte à l’indice topographique. La distribution <strong>de</strong> cet indice dans <strong>la</strong> zone<br />
d’étu<strong>de</strong> est intrinsèquem<strong>en</strong>t liée à celle <strong>de</strong>s p<strong>en</strong>tes. En d’autres termes, les zones <strong>de</strong> départ <strong>de</strong>s<br />
sédim<strong>en</strong>ts (ou zones probablem<strong>en</strong>t érodées) correspon<strong>de</strong>nt aux zones à fort relief et vice<br />
versa. Les zones d’accumu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> sable correspon<strong>de</strong>nt aux secteurs ayant <strong>de</strong>s fortes valeurs<br />
d’indices topographiques (> à 6). La proximité remarquable <strong>de</strong>s zones à forte bril<strong>la</strong>nce (sols<br />
nus et affleurem<strong>en</strong>ts rocheux) révélées par le calcul d’indice <strong>de</strong> bril<strong>la</strong>nce souligne qu’<strong>en</strong> plus<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>en</strong>te topographique, l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> végétation est un facteur important <strong>de</strong> <strong>la</strong> dégradation<br />
132
<strong>de</strong>s terres, notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre Pya et Niamtougou. La superposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> carte <strong>de</strong> matériaux<br />
d’altération à celle <strong>de</strong> l’indice topographique situe les matériaux d’altération ferralitique et<br />
kaolinique dans les zones à indice topographique bas.<br />
Cette étu<strong>de</strong> offre <strong>de</strong>s pistes nouvelles <strong>de</strong> réflexion concernant l’érosion <strong>de</strong>s sols dans <strong>la</strong><br />
région <strong>de</strong> Kara, notamm<strong>en</strong>t pour une meilleure i<strong>de</strong>ntification et hiérarchisation <strong>de</strong>s <strong>surface</strong>s<br />
plus vulnérables. Des possibilités <strong>de</strong> prévisions du phénomène exist<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t par<br />
l’utilisation <strong>de</strong>s données multidate.<br />
Mots clés : Indice topographique, Landsat, érosion <strong>de</strong>s sols, vulnérabilité.<br />
Bibliographie<br />
- Bev<strong>en</strong> K. & Kirkby, M. J. (1979): A physically based, variable contributing area mo<strong>de</strong>l or basin hydrology.<br />
Hydrol. Sci. Bull., 24, 43-69.<br />
- Brabant, P. ; Darracq, S. ; Simonneaux, V. (1997): Togo : état <strong>de</strong> dégradation <strong>de</strong>s terres. ORSTOM<br />
Actualités, No 54, 29-34.<br />
- Faure, P. (1985): Les sols <strong>de</strong> <strong>la</strong> Kara, nord-est-Togo. Re<strong>la</strong>tions avec l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. Collection Travaux et<br />
Docum<strong>en</strong>ts No 183. Editions <strong>de</strong> l’Orstom, Paris. 290 pages.<br />
- Lévèque, A. (1969): Les principaux événem<strong>en</strong>ts géomorphologiques et les sols sur le socle granitogneissique<br />
du Togo. Cah. ORSTOM, sér. Pédol., vol. VII, n o 2, 203-224.<br />
Etu<strong>de</strong> comparative <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> séparation <strong>de</strong> sources basées sur <strong>de</strong>s<br />
représ<strong>en</strong>tations parcimonieuses<br />
Emna KARRAY* 1 — Mohamed Anis LOGHMARI** 1 — Mohamed Saber NACEUR*** 1<br />
1 Laboratoire <strong>de</strong> Télédétection et <strong>de</strong>s Systèmes d'Informations à Référ<strong>en</strong>ces Spatiales (LTSIRS), Ecole Nationale d’Ingénieurs<br />
<strong>de</strong> Tunis (ENIT)<br />
*ekarray@yahoo.fr , ** MohamedAnis.Loghmari@isi.rnu.tn, ***Saber.naceur@insat.rnu.tn<br />
1. Problématique :<br />
Dans ce travail, nous prés<strong>en</strong>tons <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> séparation aveugle <strong>de</strong> sources qui sont<br />
fondées sur <strong>de</strong>s représ<strong>en</strong>tations parcimonieuses <strong>de</strong>s images hyperspectrales <strong>de</strong> télédétection.<br />
L’imagerie hyperspectrale consiste à acquérir <strong>de</strong>s images sur un grand nombre <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>s<br />
spectrales fines et contiguës et offre <strong>de</strong> ce fait, une information à <strong>la</strong> fois volumineuse et <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong> dim<strong>en</strong>sion. Cep<strong>en</strong>dant, l’acquisition d’un grand nombre <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>s spectrales pose<br />
<strong>de</strong>ux problèmes majeurs. Le premier consiste au fait que <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> taille <strong>de</strong> ces images r<strong>en</strong>d<br />
difficile leurs traitem<strong>en</strong>t par ordinateur. Le <strong>de</strong>uxième se pose dans <strong>la</strong> phase <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification<br />
thématique <strong>de</strong> <strong>la</strong> scène. En effet, l’augm<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sionnalité s’accompagne d’un<br />
133
accroissem<strong>en</strong>t du nombre <strong>de</strong> paramètres du modèle et <strong>de</strong> surcroit par une baisse <strong>de</strong> précision<br />
<strong>de</strong> leurs estimations. Afin <strong>de</strong> tirer profit <strong>de</strong> ces images, nous proposons d’établir une métho<strong>de</strong><br />
facilitant <strong>la</strong> discrimination, <strong>la</strong> quantification et l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> l’image et qui est<br />
susceptible d’avoir <strong>de</strong> bonnes performances dans le processus <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification pour<br />
minimiser le risque d'erreurs <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification.<br />
2. Données <strong>de</strong> base et méthodologie :<br />
De ce fait, nous allons utiliser <strong>de</strong>s images d'observation extraites <strong>de</strong>s capteurs CASI et<br />
Hymap, respectivem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre les longueurs d'on<strong>de</strong> <strong>de</strong> 551,1 à 799,9 nanomètres et <strong>en</strong>tre 438<br />
à 2483 nanomètres (Figure (1)).<br />
(a) (b)<br />
Figure 1. Images composites <strong>de</strong> trois couleurs (RVB), (a) Image CASI (9 ban<strong>de</strong>s spectrales avec 16 c<strong>la</strong>sses (512*512)). (b) Image Hymap<br />
avec 5 c<strong>la</strong>sses (126 ban<strong>de</strong>s spectrales (512*512)).<br />
Notre approche consiste à utiliser <strong>la</strong> parcimonie <strong>en</strong> s’appuyant sur <strong>de</strong>s supports <strong>de</strong><br />
décomposition (dictionnaires) afin <strong>de</strong> mieux extraire les différ<strong>en</strong>tes sources <strong>de</strong>s données<br />
d’observation. En fait, <strong>la</strong> séparation dans le domaine transformée permet <strong>de</strong> retrouver une<br />
représ<strong>en</strong>tation <strong>en</strong> exploitant peu <strong>de</strong> coeffici<strong>en</strong>ts significativem<strong>en</strong>t non nuls. L'effet positif<br />
d'une transformation dans le domaine <strong>de</strong> fréqu<strong>en</strong>ce, est l'élimination <strong>de</strong> <strong>la</strong> redondance <strong>en</strong>tre<br />
les pixels voisins et les ban<strong>de</strong>s adjac<strong>en</strong>tes <strong>de</strong>s données hyperspectrales. En effet, le problème<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> séparation <strong>de</strong> sources sera considéré soit directem<strong>en</strong>t dans le domaine d'origine<br />
d'observations (domaine spatial) ou dans un domaine transformé. Nous allons donc appliquer<br />
certaines transformations pour illustrer l'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> données avec un minimum <strong>de</strong><br />
composants et un maximum d'informations ess<strong>en</strong>tielles. Ainsi, <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> bases <strong>de</strong><br />
décomposition sont adoptés dans ce travail : <strong>la</strong> transformée <strong>en</strong> cosinus discrète (TCD) et <strong>la</strong><br />
transformée <strong>en</strong> paquets d’on<strong>de</strong>lettes DWT. Le but <strong>de</strong> ce travail est <strong>de</strong> faire une étu<strong>de</strong><br />
comparative <strong>en</strong>tre ces différ<strong>en</strong>tes techniques <strong>de</strong> transformations associées à <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
séparation <strong>de</strong> sources. La métho<strong>de</strong> proposée décrite dans <strong>la</strong> figure (2), montre une<br />
méthodologie pour l'utilisation <strong>de</strong> l'imagerie hyperspectrale afin d’évaluer <strong>de</strong>ux techniques <strong>de</strong><br />
séparation <strong>de</strong> sources: <strong>la</strong> première est dans le domaine spatial et <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> est dans le<br />
domaine transformé.<br />
Nous considérons dans <strong>la</strong> première partie que les données hyperspectrales d’observation<br />
sont parcimonieuses dans <strong>la</strong> base DCT. Cette transformation permet <strong>de</strong> convertir les données<br />
<strong>en</strong>tières à partir du domaine image à une représ<strong>en</strong>tation i<strong>de</strong>ntique dans le domaine fréqu<strong>en</strong>tiel<br />
avec très peu <strong>de</strong> coeffici<strong>en</strong>ts et correspondant à <strong>de</strong>s fréqu<strong>en</strong>ces assez faibles [1]. Dans <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>uxième partie, nous considérons <strong>la</strong> représ<strong>en</strong>tation parcimonieuse <strong>de</strong>s données<br />
hyperspectrales dans <strong>la</strong> base DWT. Cette transformation permet le déploiem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s échelles<br />
d’informations, ce qui explique <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> coeffici<strong>en</strong>ts significatifs. Les grands coeffici<strong>en</strong>ts<br />
d’on<strong>de</strong>lettes sont ainsi situés dans <strong>la</strong> zone <strong>de</strong>s bords irréguliers et <strong>de</strong>s textures. Dans ce<br />
contexte, une représ<strong>en</strong>tation <strong>de</strong>s directions indép<strong>en</strong>dantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> matrice <strong>de</strong> mé<strong>la</strong>nge sera<br />
i<strong>de</strong>ntifiée à partir <strong>de</strong> leur parcimonie dans <strong>la</strong> base DCT ainsi que dans <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s on<strong>de</strong>lettes.<br />
134
Figure 2. Méthodologie <strong>de</strong> l’approche proposée<br />
3. Résultats :<br />
Nous montrons alors comm<strong>en</strong>t l’approche <strong>de</strong> séparation <strong>de</strong> sources basée sur le concept <strong>de</strong><br />
parcimonie peut être un complém<strong>en</strong>t intéressant <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’analyse <strong>en</strong> composantes<br />
indép<strong>en</strong>dantes. Nous décrivons <strong>la</strong> technique <strong>de</strong> séparation <strong>de</strong> sources à partir <strong>de</strong> m processus<br />
aléatoires notés Xi (i =1...m) qui résult<strong>en</strong>t d'un mé<strong>la</strong>nge linéaire <strong>de</strong> n processus aléatoires ou<br />
<strong>de</strong>s sources notés Si (i = 1...n). Par hypothèse, A est <strong>la</strong> transformation linéaire <strong>en</strong>tre les<br />
sources et les observations. Les signaux reçus par les capteurs peuv<strong>en</strong>t être modélisées par <strong>la</strong><br />
source <strong>de</strong> signaux dans <strong>la</strong> forme générale suivante X = AS + N . Dans cette étu<strong>de</strong>, nous<br />
utilisons le critère <strong>de</strong> séparation <strong>de</strong> sources dans le domaine fréqu<strong>en</strong>tiel [2, 3]. Par conséqu<strong>en</strong>t,<br />
<strong>la</strong> particu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong> notre approche consiste à mettre <strong>en</strong> œuvre le DCT et le DWT afin d'<strong>en</strong><br />
extraire <strong>de</strong>s sources indép<strong>en</strong>dantes <strong>en</strong> fréqu<strong>en</strong>ce. Cette métho<strong>de</strong> peut être modélisée<br />
T<br />
T T<br />
par X = AS + N , avec T est le nombre <strong>de</strong> pixels <strong>de</strong> l’image originale. En négligeant le<br />
T ' T '<br />
bruit, nous pouvons modéliser notre approche par le mo<strong>de</strong>l suivant X = AS , avec T’
CASI. D’où l’idée <strong>de</strong> concevoir un dictionnaire appris qui <strong>en</strong> résulte du critère <strong>de</strong> fréqu<strong>en</strong>ce<br />
<strong>en</strong> joignant <strong>de</strong>s sous-dictionnaires tels que DCT, on<strong>de</strong>lettes, curvelettes… qui <strong>de</strong>vront être<br />
bi<strong>en</strong> choisis selon les caractéristiques <strong>de</strong>s données d’observations.<br />
Mots clés: images hyperspectrales, représ<strong>en</strong>tation parcimonieuse, domaine spectrale, base DCT et DWT et<br />
c<strong>la</strong>ssification supervisée.<br />
Bibliographie :<br />
- Bobin J., Starck J.-L , Fadili J., and Moud<strong>de</strong>n Y., Sparsity and Morphological Diversity in Blind Source<br />
Separation. IEEE Trans. on Image Processing, vol. 16, pp. 2662-2674, Nov. 2007.<br />
- Georgiev P. G., Theis F., and Cichocki A., Sparse compon<strong>en</strong>t analysis and blind source separation of<br />
un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined mixtures. IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 16, no. 4, pp. 992–996, 2005.<br />
- Bobin J., Moud<strong>de</strong>n Y., Starck J.-L., and E<strong>la</strong>d M., “Morphological diversity and source separation” IEEE<br />
Signal Processing Letters, vol. 13, no. 7, pp. 409–412, 2006.<br />
Morpho paysages et géodynamiques au fil <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fossa Regia <strong>en</strong> Tunisie<br />
telli<strong>en</strong>ne<br />
Mohamed Raouf KARRAY 1 , Hayet BEN JMAA-FRIDHI 2 , Raoudha HABOUBI 3<br />
Faculté <strong>de</strong>s Sci<strong>en</strong>ces Humaines et Sociales, Université <strong>de</strong> Tunis 1, directeur du <strong>la</strong>boratoire CGMED.<br />
De Thabraca au NO <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tunisie telli<strong>en</strong>ne, sur <strong>la</strong> rive africaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> Méditerranée<br />
occi<strong>de</strong>ntale, à Tha<strong>en</strong>ea au SE <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tunisie steppique <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t ouverte sur <strong>la</strong> rive ouest <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Méditerranée ori<strong>en</strong>tale, les traces <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fossa Regia cour<strong>en</strong>t sur près <strong>de</strong> 400 km. Cette limite<br />
territoriale fut édictée par Scipion Emili<strong>en</strong> vers -146 à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> chute <strong>de</strong> Carthage ; elle<br />
démarque les terres - et dép<strong>en</strong>dances du royaume vaincu - conquises par les romains <strong>de</strong> celles<br />
<strong>la</strong>issées aux regards <strong>de</strong>s rois numi<strong>de</strong>s alliés. La Fossa Regia a été matérialisée par <strong>de</strong>s<br />
ouvrages divers (fossés simples ou multiples, murets, p<strong>la</strong>ces fortes et lieux fortifiés, …)<br />
profitant au passage <strong>de</strong> lignes et <strong>de</strong> discontinuités physiographiques (crêtes, barres,<br />
escarpem<strong>en</strong>ts, axes <strong>de</strong> drainage, aires inondables, sebkhas, …). Conçue comme démarque et<br />
ligne <strong>de</strong> contrôle, mais fonctionnant davantage <strong>en</strong> frange <strong>de</strong> transition ou <strong>de</strong> communication<br />
<strong>en</strong>tre <strong>de</strong>ux peuplem<strong>en</strong>ts, cette limite a été revisitée, <strong>de</strong>ux siècles plus tard, sous Vespasi<strong>en</strong> lors<br />
d’une campagne <strong>de</strong> bornage.<br />
Difficile à établir par les <strong>la</strong>borieuses prospections archéologiques, avec un tracé incertain à<br />
hypothétique au nord-ouest comme au sud-est, le tronçon c<strong>en</strong>tral <strong>en</strong>tre Oued Medjerda et <strong>la</strong><br />
Dorsale tunisi<strong>en</strong>ne <strong>en</strong> est communém<strong>en</strong>t arrêté grâce <strong>de</strong>s bornes au sommet <strong>de</strong> Jbel Cheïd, un<br />
diapir <strong>en</strong>core <strong>en</strong> montée. Dans ce secteur c<strong>en</strong>tral, <strong>de</strong> part et d’autre <strong>de</strong> cette Fossa, les<br />
morpho-paysages, les géodynamiques <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales, les organisations spatiales et les<br />
signatures agraires et/ou rurales recèl<strong>en</strong>t quelques nuances et différ<strong>en</strong>ces détectées par<br />
l’analyse sous SIG <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>ts multi dates (1909, 1930, 1948, 1963, 1975, 2000, 2010) et<br />
multi sources (docum<strong>en</strong>ts cartographiques, thématiques, photographiques et imagiers).<br />
Les résultats obt<strong>en</strong>us par l’approche géomorphologique jusque là peu ou prou utilisée et,<br />
étayés par l’analyse <strong>de</strong>s docum<strong>en</strong>ts et données, confort<strong>en</strong>t pour ce secteur le tracé établi par<br />
les travaux anci<strong>en</strong>s. Ils permett<strong>en</strong>t d’appréh<strong>en</strong><strong>de</strong>r <strong>la</strong> nature et les interre<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s<br />
composantes géoarchologiques <strong>de</strong> ce discontinuum territorial. Ce travail propose in fine<br />
d’essayer cette approche géomorphologique et géodynamique pour initier, <strong>en</strong> préa<strong>la</strong>ble, les<br />
prolongem<strong>en</strong>ts pot<strong>en</strong>tiels du tracé et <strong>de</strong>s traces <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fossa, soit vers le nord, soit vers le sud.<br />
Mots clés : Fossa Regia, Jbel Cheïd, Archéopaysages, Tunisie, Tell, Erosion, Géomorphologie.<br />
136
La détection <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>ts à partir d’imagerie satellitales <strong>en</strong> se basant<br />
sur une approche a contrario<br />
Fat<strong>en</strong> KATLANE, Mohamed Saber NACEUR et Mohamed Anis LOGHMARI<br />
Laboratoire <strong>de</strong> Télédétection et système d’informations à référ<strong>en</strong>ce spatiales -Ecole National d’Ingénieurs <strong>de</strong> Tunis BP37,<br />
Tunis le belvédère, 1002 Tunisie<br />
Fat<strong>en</strong>.Kat<strong>la</strong>ne@<strong>en</strong>it.rnu.tn ; MohamedSabeur.Naceur@insat.rnu.tn ; MohamedAnis.Loghmari@isi.rnu.tn<br />
Les métho<strong>de</strong>s automatiques <strong>de</strong> détection <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> imagerie satellitales font<br />
l’objet d’un intérêt croissant, notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> raison <strong>de</strong>s nombreuses applications liées à<br />
l’analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>surface</strong> terrestre ou <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t (suivi <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation, mise à jour<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cartographie, gestion <strong>de</strong>s risques, etc.). La détection <strong>de</strong>s changem<strong>en</strong>ts consiste dans<br />
<strong>la</strong> localisation <strong>de</strong> zones ayant évoluées <strong>en</strong>tre <strong>de</strong>ux ou plusieurs observations d’une même<br />
scène. De nombreuses métho<strong>de</strong>s ont été utilisées notamm<strong>en</strong>t par (Coppin et al, 2003) et<br />
(Lu et al, 2004). Et c<strong>la</strong>ssées par (Hall et al, 2003) selon leurs niveau d’interv<strong>en</strong>tion, nous<br />
trouvons au niveau pixel, l’analyse par vecteurs <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>t, les détecteurs simples et<br />
<strong>la</strong> régression, au niveau caractéristique l’analyse <strong>de</strong> texture, l’analyse <strong>en</strong> composantes<br />
principales, l’analyse <strong>de</strong> formes, <strong>la</strong> différ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l’indice <strong>de</strong> végétation, et les wavelets et<br />
finalem<strong>en</strong>t au niveau objet les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification multi-dates directes, <strong>de</strong><br />
comparaison post c<strong>la</strong>ssification et <strong>de</strong> comparaison post c<strong>la</strong>ssification flou, d’intellig<strong>en</strong>ce<br />
artificielle, <strong>de</strong> réseaux artificiels <strong>de</strong> neurones et <strong>de</strong>s systèmes experts.<br />
1. Problématique :<br />
L’objectif <strong>de</strong> ce travail est <strong>la</strong> détection <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> se basant sur une approche a<br />
contrario dont le principale but est <strong>de</strong> créer une carte <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>ts et <strong>de</strong> calculer un<br />
taux <strong>de</strong> bonne i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>ts (TBC) <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>s seuils significatifs. le<br />
raisonnem<strong>en</strong>t que nous proposons pour <strong>la</strong> détection <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>ts sur <strong>de</strong>s images<br />
satellitales basée sur l’approche a contrario, répond à <strong>la</strong> question <strong>de</strong> savoir à partir <strong>de</strong> quels<br />
seuils <strong>la</strong> différ<strong>en</strong>ce calculée <strong>en</strong>tre <strong>de</strong>ux pixels est significative ?<br />
2. Données <strong>de</strong> base et méthodologie :<br />
La zone d’étu<strong>de</strong> choisie est située au nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Tunis, elle est bordé par<br />
Sebkhet Ariana à l’Est et par le <strong>la</strong>c <strong>de</strong> Tunis et l’aéroport <strong>de</strong> Tunis-Carthage au Sud-Est, <strong>en</strong><br />
s’éta<strong>la</strong>nt au Nord-Ouest jusqu’au voisinage <strong>de</strong> <strong>la</strong> Soukra. Cette zone est caractérisée par<br />
l’hétérogénéité <strong>de</strong> son milieu, surtout par <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sebkha, d’une zone urbaine plus<br />
ou moins <strong>de</strong>nse, <strong>de</strong> zone verte et <strong>de</strong> routes. Les images sélectionnées pour l’étu<strong>de</strong> : SPOT4<br />
(256X256) multispectrale qui date <strong>de</strong> 2000, prés<strong>en</strong>tant une résolution <strong>de</strong> 20m et une image<br />
SPOT5 (1024X1024) panchromatique qui date <strong>de</strong> 2003 ayant une résolution <strong>de</strong> 5m.<br />
La détection a contrario consiste à déterminer le seuil à partir duquel on considère que<br />
ce n’est pas le modèle a priori qui est observé, mais bi<strong>en</strong> un événem<strong>en</strong>t et qu’un<br />
événem<strong>en</strong>t est détecté comme un écart par rapport au modèle a priori (Desolneux et al,<br />
2002). Le modèle d’observations <strong>en</strong> l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>ts est appelée modèle a<br />
contrario. Dans ce modèle, les changem<strong>en</strong>ts significatifs sont définis comme étant <strong>de</strong>s<br />
événem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> faible probabilité d’occurr<strong>en</strong>ce : un événem<strong>en</strong>t est dit ε-significatif si<br />
l’espérance du nombre d’occurr<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> cet événem<strong>en</strong>t est inférieur à ε dans le modèle a<br />
contrario (Desolneux et al, 2003). La méthodologie a contrario est <strong>en</strong> fait reliée au cadre<br />
c<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong>s tests d’hypothèses. L’approche a contrario consiste à rejeter l’hypothèse H0<br />
si <strong>la</strong> différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre <strong>de</strong>ux pixels (diff) est ε-significative. Si on considère l’événem<strong>en</strong>t «<strong>la</strong><br />
probabilité <strong>de</strong> n’avoir aucun changem<strong>en</strong>t ». L’estimation sous l’hypothèse a contrario se<br />
fait tel que H0 : « <strong>la</strong> probabilité P <strong>de</strong> <strong>la</strong> (diff) pour <strong>de</strong>ux pixels donnés soit inférieur à un<br />
137
seuil Ű ». Sachant que <strong>la</strong> probabilité d’obt<strong>en</strong>ir un changem<strong>en</strong>t selon une distribution<br />
binomiale dans une série <strong>de</strong> k tirages : ⎛n<br />
⎞ k n−k<br />
.Le NFA <strong>de</strong> cette différ<strong>en</strong>ce<br />
P(<br />
x = k)<br />
= ⎜ ⎟P<br />
( 1−<br />
k)<br />
⎝k<br />
⎠<br />
est sa probabilité d’apparition dans un <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t aléatoire uniforme tel qu’on a une<br />
chance sur <strong>de</strong>ux pour qu’elle se réalise : NFA(diff)=P k N , où N : le nombre d’élém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> différ<strong>en</strong>ce.<br />
3. Résultats :<br />
Nous avons testés cette démarche pour différ<strong>en</strong>tes valeurs <strong>de</strong> seuils, al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> 1 à 10 -85.<br />
Et <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>s résultats obt<strong>en</strong>us, d’abord nous avons établies <strong>la</strong> carte <strong>de</strong>s changem<strong>en</strong>ts<br />
(fig.1), <strong>en</strong>suite nous avons tracés <strong>la</strong> courbe re<strong>la</strong>tive aux taux <strong>de</strong> bonne i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s<br />
changem<strong>en</strong>ts (TBC) <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>s seuils Ű-significatifs (Fig.2), ainsi que <strong>la</strong> courbe<br />
représ<strong>en</strong>tant le taux <strong>de</strong> fausses i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s changem<strong>en</strong>ts (TFC) <strong>en</strong> fonction du<br />
nombre d’itérations(Fig.3). Nous constatons que plus le seuil est petit plus le taux <strong>de</strong> bonne<br />
i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s changem<strong>en</strong>ts s’approche <strong>de</strong> 1. En ce qui concerne le TFC, il <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t<br />
presque nul après un certain nombre d’itérations.<br />
Fig.1 : Carte <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>ts-<br />
SPOT4 (2000)-SPOT5(2003)<br />
Fig.2 : Taux <strong>de</strong> bonne<br />
i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s<br />
changem<strong>en</strong>ts<br />
138<br />
Fig.3 : Taux <strong>de</strong> fausse<br />
i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s<br />
changem<strong>en</strong>ts<br />
La détection <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>ts basés sur l’approche a contrario nous a permis <strong>de</strong> calculer<br />
<strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>ts globaux, une étu<strong>de</strong> plus approfondies nous permettra d’avoir <strong>de</strong>s<br />
taux <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>t re<strong>la</strong>tif à chaque thème. Ainsi que l’intégration d’informations<br />
complém<strong>en</strong>taires dans le processus <strong>de</strong> détection <strong>de</strong>s changem<strong>en</strong>ts que nous avons établies<br />
nous permettrons <strong>de</strong> perfectionner notre approche.<br />
Mots clés : Détection <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>t a contrario, changem<strong>en</strong>t ε-significatif , taux <strong>de</strong> bonne i<strong>de</strong>ntification<br />
<strong>de</strong>s changem<strong>en</strong>ts et taux <strong>de</strong> fausses i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s changem<strong>en</strong>ts.<br />
Bibliographiques :<br />
- Coppin et al, 2003: P. R. COPPIN, I. JONCKHEERE AND K. NACHAERTS, 2003. Digital change<br />
<strong>de</strong>tection in ecosystem monitoring. a review, Int. J. of Remote S<strong>en</strong>sing, vol. 24, pp. 1–33 (2003).<br />
- Desolneux A., Moisan L., and MOREL J-M, 2002. Gestalt theory and computer vision. Technical<br />
report, preprint CMLA N o 2002-06, 2002.<br />
- Desolneux A., Moisan L., and Morel J.-M, 2003: A grouping principle and four applications. IEEE<br />
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intellig<strong>en</strong>ce, 25(4) :508–513, April 2003.<br />
- Lu D., Mausel P., Brondizio E.and Moran E., 2004, “Change <strong>de</strong>tection techniques’’, Int. J. of Remote<br />
S<strong>en</strong>sing, vol. 25, no. 12, pp. 2365–2407 (2004).
Cartographie et suivie <strong>de</strong> <strong>la</strong> variabilité saisonnières et spatiales <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>chlorophylle</strong> à partir <strong>de</strong>s données MODIS dans le golfe <strong>de</strong> Gabès<br />
Rim. KATLANE a et Fouad. ZARGOUNI a<br />
a Faculté <strong>de</strong>s Sci<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> Tunis,<br />
Kat<strong>la</strong>nerim@yahoo.fr ; fouadzargouni@yahoo.fr<br />
1. Problématique<br />
La ban<strong>de</strong> littorale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tunisie mesure plus <strong>de</strong> 1300Km, d’où <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> <strong>la</strong> surveiller,<br />
<strong>de</strong> gérer et réhabiliter ses zones côtières. En particulier le golfe <strong>de</strong> Gabès où l’activité<br />
industrielle a débuté <strong>de</strong>puis les années 70. La pèche int<strong>en</strong>sive, les déchets anthropiques et<br />
naturels ont contribué à <strong>la</strong> dégradation <strong>de</strong> <strong>la</strong> biodiversité <strong>de</strong> l’écosystème. Cette situation a<br />
<strong>en</strong>trainé <strong>de</strong>s problèmes d’eutrophication et <strong>la</strong> disparition <strong>de</strong> certaines espèces b<strong>en</strong>thiques et<br />
p<strong>la</strong>nctoniques, avec une perte du couvert végétal <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 90% conduisant à l'instal<strong>la</strong>tion<br />
<strong>de</strong> biocénoses caractérisées par une faune et une flore <strong>de</strong> milieux <strong>en</strong>vasés et dégradés (B<strong>en</strong><br />
Mustafa et al. 1999).<br />
Pour un suivi continu <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’eau du golfe <strong>de</strong> Gabés, nous avons adoptée <strong>la</strong><br />
métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> télédétection aquatique basée sur l’exploitation <strong>de</strong>s propriétés optiques <strong>de</strong><br />
l’eau. L’objectif est d’extraire les informations qualitatives et quantitatives <strong>de</strong>s composants<br />
physiques et biologiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone côtière, ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> matière <strong>en</strong> susp<strong>en</strong>sion, <strong>la</strong><br />
turbidité, les substances jaunes, <strong>la</strong> <strong>chlorophylle</strong> et <strong>la</strong> température.<br />
L’objectif <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> est l’exploitation <strong>de</strong>s produits MODIS, le suivi <strong>de</strong> <strong>la</strong> variation<br />
spatiale et saisonnière <strong>de</strong> <strong>la</strong> conc<strong>en</strong>tration <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>chlorophylle</strong> <strong>en</strong> détectant les blooms d’algues<br />
<strong>en</strong> appliquant l’algorithme semi analytique <strong>chlorophylle</strong> a du nouveau procès 2009 qu’offre <strong>la</strong><br />
NASA.<br />
OC3 chl a (µg/L) = 10^(a0 + a1R + a2R2 + a3R3 + a4R4) (Oreilly et al ,2000)<br />
Ban<strong>de</strong> Ratio : R=log [(max (Rrs443, Rrs488))/Rrs555)<br />
Coeffici<strong>en</strong>ts: a= [0.283, -2.753, 1.457, 0.659, -1.403]<br />
1. Données <strong>de</strong> base et méthodologie<br />
Des mesures in situ du taux <strong>de</strong> <strong>chlorophylle</strong> CHL (µg/l), <strong>de</strong> turbidité TU (NTU), <strong>de</strong><br />
matière <strong>en</strong> susp<strong>en</strong>sion TSM (mg/l), <strong>de</strong> transpar<strong>en</strong>ce(m) et <strong>de</strong> température T (°C) ont été<br />
réalisées dans le secteur d’étu<strong>de</strong>s le 24 Mars 2009, <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> du 5 au 7 Juillet 2009 et les 6, 8<br />
et 19 Octobre 2009 au mom<strong>en</strong>t du passage du satellite MODIS (Tableau 1).<br />
Tableau 1- Résumé <strong>de</strong>s mesures in situ dans le golfe <strong>de</strong> Gabès<br />
Localisation<br />
TU (NTU)<br />
min, max<br />
TSM (mg/l)<br />
min, max<br />
CHL (µg/l)<br />
min, max<br />
T°C<br />
min, max date<br />
Nombre<br />
<strong>de</strong> station<br />
Port Gannouch 1.88, 3.88 2.2, 5 0.5, 1<br />
14.8, 28.1 04/07/09<br />
et 06/10/09<br />
26<br />
Jerba 0.5, 2.12 1.4, 2.8
Un programme a été développé sous Envi et IDL et appliqué sur les données du niveau 1 et<br />
2; toutefois ces <strong>de</strong>rniers ont été traités <strong>en</strong> appliquant les masques (f<strong>la</strong>gs) sur les pixels douteux<br />
dus aux nuages (Cldice), aux mauvaises corrections atmosphériques (Atmwarn), aux pixels<br />
appart<strong>en</strong>ant à <strong>la</strong> terre (Land) et ceux du produit <strong>de</strong> l’algorithme OC3 chl a (Chlfail et<br />
Chlwarn).<br />
3. Résultats<br />
La cartographie et l’analyse <strong>de</strong>s données MODIS CHL a, presque journalière <strong>de</strong> l’année<br />
2009 a montré <strong>de</strong>s variations <strong>spatio</strong><strong>temporelle</strong>s importantes dans les eaux case II du golfe <strong>de</strong><br />
Gabès (Figure 1).En effet durant les mois <strong>de</strong> Décembre Janvier, Février, Mars et Avril nous<br />
avons <strong>en</strong>registrées <strong>de</strong>s valeurs assez faibles <strong>en</strong> conc<strong>en</strong>tration <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>chlorophylle</strong> au c<strong>en</strong>tre du<br />
golfe <strong>de</strong> Gabès et aux al<strong>en</strong>tours <strong>de</strong>s îles Kerk<strong>en</strong>nah, Kneiss et Jerba. En revanche <strong>la</strong> Lagune<br />
<strong>de</strong> Bougrara prés<strong>en</strong>te les valeurs les plus fortes <strong>de</strong> CHL. P<strong>en</strong>dant les mois <strong>de</strong> Mai, Juin,<br />
Octobre et Novembre <strong>la</strong> conc<strong>en</strong>tration augm<strong>en</strong>te ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t aux al<strong>en</strong>tours <strong>de</strong>s îles<br />
Kerk<strong>en</strong>ah et Kneiss. Les mois <strong>de</strong> Juillet Aout et Septembre montr<strong>en</strong>t les valeurs les plus<br />
élevées <strong>en</strong> CHL pour toute l’année 2009 avec <strong>de</strong>s blooms d’algue aux al<strong>en</strong>tours <strong>de</strong> l’île <strong>de</strong><br />
Kerk<strong>en</strong>nah et au Sud du golfe <strong>de</strong> Gabés, précisém<strong>en</strong>t à l’Est <strong>de</strong> l’île <strong>de</strong> Jerba surtout les mois<br />
d’Aout et Septembre.<br />
Malgré <strong>la</strong> cohér<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s données satellitaires CHL <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>s saisons et <strong>de</strong>s localités,<br />
il existe une différ<strong>en</strong>ce avec les mesures in situ. Cette différ<strong>en</strong>ce met <strong>en</strong> doute <strong>la</strong> performance<br />
<strong>de</strong> l’algorithme OC3 pour les eaux côtières du golfe <strong>de</strong> Gabès.<br />
Ainsi il est nécessaire d’é<strong>la</strong>borer un nouvel algorithme pour les eaux côtières du golfe <strong>de</strong><br />
Gabès. En t<strong>en</strong>ant compte <strong>de</strong>s paramètres du secteur d’étu<strong>de</strong> ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t l’effet <strong>de</strong>s rejets<br />
industriels, les apports <strong>de</strong>s oueds, <strong>la</strong> marée, <strong>la</strong> faiblesse <strong>de</strong> <strong>la</strong> tranche d’eau, <strong>la</strong> réflexion du<br />
fond marin dans certaines régions tel que Kerk<strong>en</strong>nah et Kneiss et <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> plusieurs<br />
compagnes <strong>de</strong> mesures saisonnières.<br />
Kneiss<br />
Sfax<br />
P.Gannouche<br />
Jerba<br />
L Bougrara<br />
Kerk<strong>en</strong>nah<br />
Masque<br />
0-1 µg/l<br />
1-2 µg/l<br />
2-5 µg/l<br />
5-10<br />
µg/l<br />
10-15 µg/l<br />
15-20<br />
µg/l<br />
20-50<br />
µg/l<br />
Figure-1- Répartition <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>chlorophylle</strong> montrant un bloom d’algue dans golfe <strong>de</strong> Gabès le 18 Septembre 2009<br />
à 12 :40 UTC à gauche et le 10 Aout 2009 à 12 :35 UTC à droite<br />
Mots clés: télédétection aquatique, <strong>chlorophylle</strong>, golfe <strong>de</strong> gabés et MODIS<br />
Référ<strong>en</strong>ces<br />
- B<strong>en</strong> Mustafa K., Hattour, A., Mehetli, M., El abed, A. et Tritar, B. (1999): Etat <strong>de</strong> <strong>la</strong> bionomie b<strong>en</strong>thique<br />
<strong>de</strong>s étages infra et circalittoral du golfe <strong>de</strong> Gabès. Bull. Ins. Natn. Sci<strong>en</strong>. Tech. Mer <strong>de</strong> Sa<strong>la</strong>mmbô, Vol.26, 1999.<br />
- O’Reilly, J.E. and 21 co-authors, (2000): Ocean color chlorophyll a algorithms for SeaWiFS,OC2, and<br />
OC4: Version 4. In: O’Reilly, J.E. and 24 co-authors, 2000: SeaWiFS post<strong>la</strong>unch calibration and validation<br />
analyses, part 3.NASA Tech. Memo. 2000-206892, Vol. 11, S.B.Hooker and E.R. Firestone, Eds., NASA<br />
Goddard Space Flight C<strong>en</strong>ter, Gre<strong>en</strong>belt, Mary<strong>la</strong>nd, 9-23.<br />
140<br />
Kneiss<br />
Sfax<br />
P.Gannouche<br />
Jerba<br />
L. Bougrara<br />
Kerk<strong>en</strong>nah
Modélisation <strong>de</strong>s échos <strong>de</strong> précipitations observés par un radar Côtier par<br />
<strong>de</strong>s processus autorégressifs<br />
Dal<strong>la</strong>l KEMIKEM & Boualem HADDAD<br />
Université <strong>de</strong>s Sci<strong>en</strong>ces et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Technologie Houari Boumedi<strong>en</strong>e (U.S.T.H.B.)-Alger-Algerie<br />
Email : h boualem@hotmail.com<br />
1. Problématique :<br />
Ces <strong>de</strong>rnières années, les inondations, les feux <strong>de</strong> forêts, l’explosion démographique nous<br />
conduit à réfléchir quant à <strong>la</strong> gestion rationnelle et l’utilisation efficace <strong>de</strong>s ressources <strong>en</strong> eau<br />
à l’échelle p<strong>la</strong>nétaire. L’évaluation et <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> ce capital précieux, qui est l’eau, est<br />
r<strong>en</strong>due complexe à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> variation <strong>spatio</strong>-<strong>temporelle</strong> <strong>de</strong>s perturbations, <strong>de</strong> l’influ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> topographie du terrain et <strong>de</strong>s obstacles locaux]. De nos jours, le radar météorologique<br />
s’avère l’unique instrum<strong>en</strong>t capable d’assurer une couverture continue dans l’espace et dans le<br />
temps <strong>de</strong>s champs <strong>de</strong> précipitation. Souv<strong>en</strong>t, les précipitations annuelles assur<strong>en</strong>t une quantité<br />
d’eau globale qui peut couvrir les besoins <strong>de</strong> l’être humain. Cep<strong>en</strong>dant, <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong> cette<br />
eau dans le temps pourrait poser un problème. Par conséqu<strong>en</strong>t, une compréh<strong>en</strong>sion <strong>de</strong> ce<br />
phénomène climatique ai<strong>de</strong>rait au moins à program<strong>mer</strong> <strong>de</strong>s interv<strong>en</strong>tions visant <strong>la</strong><br />
stabilisation et l’augm<strong>en</strong>tation <strong>de</strong>s r<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts. C’est ainsi que les p<strong>la</strong>nificateurs sont <strong>de</strong>v<strong>en</strong>us<br />
<strong>de</strong> plus <strong>en</strong> plus intéressés par l’estimation et <strong>la</strong> prévision <strong>de</strong> cette variable aléatoire qui<br />
permettrait une gestion rationnelle <strong>de</strong>s ressources hydriques. La prévision <strong>de</strong> <strong>la</strong> variabilité<br />
climatique ne manque pas d’intérêt dans <strong>la</strong> mesure où <strong>de</strong>s informations sur ces variables<br />
aléatoires pourrai<strong>en</strong>t donner l’occasion <strong>de</strong> mieux ajuster l’effici<strong>en</strong>ce productive <strong>de</strong>s<br />
exploitations agricoles par exemple et probablem<strong>en</strong>t contribuer à améliorer son rev<strong>en</strong>u.<br />
Plusieurs modèles stochastiques ont été proposés dans <strong>la</strong> littérature. Les processus AR et<br />
ARIMA ont connu une utilisation concrète suite à leurs performances jugées satisfaisantes.<br />
L’objectif recherché est <strong>de</strong> détecter s’il existe une év<strong>en</strong>tuelle différ<strong>en</strong>ce dans le comportem<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong>s précipitations sur terre et sur <strong>mer</strong> due à <strong>la</strong> salinité <strong>de</strong> l’eau <strong>de</strong> <strong>mer</strong>. En outre, nous avons<br />
modélisé les échos parasites <strong>en</strong> prov<strong>en</strong>ance <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre pour <strong>la</strong> région sétifi<strong>en</strong>ne.<br />
2. Données <strong>de</strong> base :<br />
Deux sites radar sont considérés dans cette étu<strong>de</strong>. Il s’agit <strong>de</strong>s régions <strong>de</strong> Sétif et <strong>de</strong><br />
Bor<strong>de</strong>aux. Des images radar collectées durant l’année 2001 à Sétif et durant l’année 1996 à<br />
Bor<strong>de</strong>aux sont analysées. Aussi, nous avons étudié <strong>de</strong>ux zones, l’une sur terre et l’autre sur<br />
<strong>mer</strong> pour les sites choisis.<br />
3. Résultats :<br />
Les modèles que nous avons développés, sont basés sur <strong>la</strong> méthodologie <strong>de</strong> Box-J<strong>en</strong>kins.<br />
En outre, on a utilisé les logiciels MATLAB, STATISTICA et XLSTAT qui offr<strong>en</strong>t <strong>de</strong> très<br />
nombreuses fonctionnalités qui répon<strong>de</strong>nt à <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong> besoin <strong>en</strong> analyse <strong>de</strong> donnée et<br />
modélisation. Nous avons subdivisé notre <strong>surface</strong> d’étu<strong>de</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong>ux zones, l’une correspond à<br />
<strong>la</strong> <strong>mer</strong> et l’autre au contin<strong>en</strong>t. D’autre part, afin <strong>de</strong> m<strong>en</strong>er une étu<strong>de</strong> fine, nous avons<br />
considéré au niveau <strong>de</strong> chaque zone <strong>de</strong>s f<strong>en</strong>êtres <strong>de</strong> 5*5 pixels. Puis, nous avons analysé pour<br />
chaque f<strong>en</strong>être le facteur <strong>de</strong> réflectivité moy<strong>en</strong> radar.<br />
A titre d’illustration, les courbes <strong>de</strong> variations <strong>de</strong>s coeffici<strong>en</strong>ts d’autocorré<strong>la</strong>tion (FAC) et<br />
<strong>de</strong>s coeffici<strong>en</strong>ts d’autocorré<strong>la</strong>tion partielle (FACP) sont données par les figures (1.a ,1.b) pour<br />
<strong>la</strong> <strong>mer</strong> et par les figures (2.a, 2.b) pour <strong>la</strong> terre pour <strong>la</strong> région sétifi<strong>en</strong>ne, l’intervalle <strong>de</strong><br />
confiance étant matérialisé par l’espace compris <strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>ux trais <strong>en</strong> pointillés.<br />
141
Fig 1.a : Evolution du FAC <strong>en</strong><br />
<strong>mer</strong> <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée p<br />
Fig 2.a : Evolution du FAC <strong>en</strong> terre<br />
<strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée p<br />
Fig 1.b : Evolution du FACP <strong>en</strong><br />
<strong>mer</strong> <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée p<br />
D’après les figures (1.a ,1.b) et les figures (2.a, 2.b), nous remarquons que les coeffici<strong>en</strong>ts<br />
d’auto corré<strong>la</strong>tion décroiss<strong>en</strong>t <strong>de</strong> façon expon<strong>en</strong>tielle d’une part et que les coeffici<strong>en</strong>ts d’auto<br />
corré<strong>la</strong>tion partielle se trouv<strong>en</strong>t à l’intérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> confiance. Par conséqu<strong>en</strong>t, nous<br />
pouvons admettre que les échos <strong>de</strong> précipitations form<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> un modèle autorégressif du<br />
premier ordre. Ayant i<strong>de</strong>ntifié le modèle pour chaque zone, puis estimé les paramètres, il est<br />
nécessaire <strong>de</strong> vérifier l’adéquation du modèle ret<strong>en</strong>u avec les observations. L’hypothèse<br />
fondam<strong>en</strong>tale à tester est l’indép<strong>en</strong>dance <strong>de</strong>s erreurs ε t Comme ces erreurs ne sont pas<br />
∧<br />
observables, on les remp<strong>la</strong>ce par <strong>de</strong>s erreurs ε t , estimées à partir <strong>de</strong>s paramètres du modèle<br />
ΑR( p)<br />
ret<strong>en</strong>u. Pour ce faire, on utilise <strong>la</strong> distribution statistique <strong>de</strong> Box et Pierce. On<br />
montre alors que les erreurs sont indép<strong>en</strong>dantes <strong>en</strong>tre elles. On peut alors affir<strong>mer</strong> que les<br />
échos <strong>de</strong> précipitations sont bi<strong>en</strong> décrits par un modèle autorégressif du premier. La même<br />
démarche est utilisée pour modéliser les échos parasites <strong>en</strong> prov<strong>en</strong>ance <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>surface</strong> terrestre.<br />
Ces <strong>de</strong>rniers sont bi<strong>en</strong> décrits par un ARIMA (1,1,0).<br />
Ces résultats peuv<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> servir à l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s échos parasites dans les banques <strong>de</strong><br />
données radar, au choix <strong>de</strong>s emp<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> barrage et <strong>la</strong> prévision <strong>de</strong> catastrophe pour <strong>de</strong>s<br />
lieux bi<strong>en</strong> i<strong>de</strong>ntifiés.<br />
Mots Clés : Radar ; Précipitation ; Modélisation autorégressive ; Modèle A.R. ; Modèle ARIMA<br />
Amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> carte d’occupation <strong>de</strong>s sols <strong>en</strong> combinant une colonie <strong>de</strong><br />
fourmis à <strong>la</strong> modélisation markovi<strong>en</strong>ne. Application au milieu urbain <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ville d’Alger<br />
Radja KHEDAM, Aichouche BELHADJ-AISSA<br />
Laboratoire <strong>de</strong> Traitem<strong>en</strong>t d’Images et Rayonnem<strong>en</strong>ts (LTIR), Faculté d’Electronique et d’Informatique (FEI), Université<br />
<strong>de</strong>s Sci<strong>en</strong>ces et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Technologie Houari Boumedi<strong>en</strong>e (USTHB). BP. 32, El Alia, Bab Ezzouar, 16111, Alger, Algérie.<br />
Téléphone : +213(21)247950, poste 806, Télécopieur : +213(21)247187<br />
rkhedam@yahoo.com<br />
1. Problématique :<br />
La c<strong>la</strong>ssification d'images satellitaires est l’une <strong>de</strong>s opérations d’analyse quantitative <strong>de</strong>s<br />
données <strong>de</strong> télédétection. Elle consiste à déterminer <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses thématiques (végétation,<br />
urbain, eau, sol, etc.) à partir d'une série d’images multispectrales brutes. Une image<br />
142<br />
Fig 2.b : Evolution du FACP <strong>en</strong><br />
terre <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée p
c<strong>la</strong>ssifiée, appelées aussi « carte thématique », trouve une <strong>la</strong>rge utilisation dans différ<strong>en</strong>ts<br />
domaines ; <strong>en</strong> agriculture pour le repérage <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s cultures, <strong>en</strong> urbanisme pour<br />
l’évaluation <strong>de</strong> l’étalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’urbain, <strong>la</strong> protection civile pour <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s catastrophes<br />
naturelles (les séismes, les inondations, les glissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> terrains, les grands feux <strong>de</strong> forêts,<br />
etc.), etc. Dans ce travail, nous proposons l’étu<strong>de</strong> et <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre d’une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
c<strong>la</strong>ssification supervisée contextuelle basée sur le modèle aléatoire <strong>de</strong> Markov MRF (Markov<br />
Random Field) associé à une colonie <strong>de</strong> fourmis (Le Hégarat-Mascle, 2005), (Ouadfel, 2003).<br />
Le MRF, très <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t utilisé pour l’intégration <strong>de</strong> l’information contextuelle dans le<br />
processus <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification, prés<strong>en</strong>te un inconvéni<strong>en</strong>t majeur. Il s’agit <strong>de</strong> <strong>la</strong> topologie du<br />
système <strong>de</strong> voisinage requis par le modèle. En effet, l’adoption <strong>de</strong>s systèmes 4-connexités ou<br />
8-connexités pour tous les sites <strong>de</strong> l’image (voisinage stationnaire) n’est pas toujours justifié,<br />
spécialem<strong>en</strong>t dans le cas d’une image riche <strong>en</strong> texture et prés<strong>en</strong>tant <strong>de</strong>s structures linéaires<br />
importantes. De là est v<strong>en</strong>ue l’idée d’utiliser un voisinage spatial non stationnaire. En fait, il<br />
s’agit <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r le nombre <strong>de</strong> voisins constant (4 ou 8 voisins), mais <strong>de</strong> relâcher <strong>la</strong> contrainte<br />
concernant <strong>la</strong> disposition <strong>en</strong> forme <strong>de</strong> carré c<strong>en</strong>tré autour du pixel d’intérêt. Ce <strong>de</strong>rnier va<br />
émettre une colonie <strong>de</strong> fourmis pour visiter aléatoirem<strong>en</strong>t ses voisins. En exploitant <strong>la</strong> faculté<br />
d’une fourmi à se rappeler un chemin visité grâce à <strong>la</strong> phéromone qu’elle a déjà déposé sur ce<br />
chemin, on peut aboutir après un certain nombre d’itérations à une meilleure image c<strong>la</strong>ssifiée.<br />
La métho<strong>de</strong> proposée est appliquée sur une image multispectrale couvrant le milieu urbain et<br />
péri urbain <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville d’Alger. Cette image est acquise <strong>en</strong> juin 2001 par le capteur ETM+ du<br />
satellite Landsat-7. Une évaluation qualitative et quantitative est m<strong>en</strong>ée pour démontrer<br />
l’apport <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong>s fourmis dans le processus <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification.<br />
2. Données <strong>de</strong> base et méthodologie :<br />
Dans <strong>la</strong> nature, il existe <strong>de</strong> nombreux systèmes collectifs capables d'accomplir <strong>de</strong>s tâches<br />
<strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification difficiles dans <strong>de</strong>s <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>ts dynamiques et variés, et ce<strong>la</strong> sans pilotage<br />
ni contrôle externe, et sans coordination c<strong>en</strong>trale. En effet, les fourmis réelles offr<strong>en</strong>t un<br />
modèle stimu<strong>la</strong>nt pour le problème du partitionnem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification (Monmarché,<br />
2004). La constitution <strong>de</strong> cimetières, le tri collectif du couvain quand il est dérangé, et le<br />
rassemblem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s œufs <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> leur état <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t, sont les exemples les plus<br />
marquants. Aussi, les <strong>en</strong>tomologistes ont analysé <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration qui s’établit <strong>en</strong>tre les<br />
fourmis pour aller chercher <strong>de</strong> <strong>la</strong> nourriture à l’extérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> fourmilière; il est remarquable<br />
que les fourmis suiv<strong>en</strong>t toujours le même chemin, et que ce chemin soit le plus court possible.<br />
En fait, chaque fourmi dépose, le long <strong>de</strong> son chemin, une substance chimique vo<strong>la</strong>tile,<br />
dénommée « phéromone » ; tous les membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> colonie perçoiv<strong>en</strong>t cette substance et<br />
ori<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t préfér<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t leur marche vers les régions les plus « odorantes ». Ainsi, plus les<br />
fourmis emprunt<strong>en</strong>t un chemin, plus il y’aura <strong>de</strong> fourmis attirées par cet itinéraire. Il <strong>en</strong><br />
résulte notamm<strong>en</strong>t <strong>la</strong> faculté collective <strong>de</strong> retrouver rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t le plus court chemin, si celuici<br />
se trouve obstrué fortuitem<strong>en</strong>t par un obstacle. Dans le but <strong>de</strong> contourner <strong>la</strong> contrainte liée à<br />
<strong>la</strong> stationnarité du voisinage dans les métho<strong>de</strong>s markovi<strong>en</strong>nes c<strong>la</strong>ssiques, nous proposons une<br />
nouvelle approche qui exploite les principes exploratoires <strong>de</strong>s fourmis lorsque celles-ci se<br />
dép<strong>la</strong>c<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre une source <strong>de</strong> nourriture et leur nid. D’une manière générale, le principe <strong>de</strong><br />
base <strong>de</strong> notre approche est le dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t aléatoire <strong>de</strong>s fourmis, <strong>en</strong> ce<strong>la</strong>, on peut dire qu’elles<br />
sont aveugles, mais sont attirées par les chemins <strong>de</strong> phéromones déposées par d’autres<br />
fourmis. Les chemins les plus courts <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> fourmilière et <strong>la</strong> source <strong>de</strong> nourriture verront<br />
donc les phéromones s’accumuler plus rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t que les autres, les r<strong>en</strong>dant par là <strong>en</strong>core<br />
plus attractifs pour les fourmis, ce qui conduira finalem<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> converg<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s<br />
fourmis vers ces chemins « optimaux » du point <strong>de</strong> vue du temps <strong>de</strong> trajet. Pour construire <strong>de</strong><br />
façon dynamique <strong>la</strong> forme <strong>de</strong>s voisinages, nous avons émis les hypothèses suivantes : 1) les<br />
pixels appart<strong>en</strong>ant à un même voisinage sont connexes, 2) chaque pixel a le même nombre <strong>de</strong><br />
143
voisins. Ainsi, notre approche permet <strong>de</strong> s’affranchir <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> l’initialisation tout <strong>en</strong> se<br />
dirigeant vers <strong>la</strong> solution optimale et <strong>de</strong> ce fait évite le piégeage dans un minimum local. La<br />
fonction d’énergie (énergie initiale) d’un pixel<br />
stationnaire V s , est <strong>la</strong> suivante :<br />
x s ayant l’étiquette c s dans un voisinage<br />
⎩ ⎨⎧<br />
1<br />
2<br />
T −1<br />
( c s x ) = ( x s − µ c ) . ∑ c . ( x s − µ c ) + ln ⎨ ∑ ⎬ + β ∑ 1 − δ ( c s , c r )<br />
s<br />
s<br />
s<br />
c<br />
U s<br />
144<br />
1<br />
2<br />
⎧<br />
⎩<br />
s<br />
⎭ ⎬⎫<br />
⎫<br />
⎭<br />
r∈V<br />
s<br />
( )<br />
La fonction d’énergie d’une fourmi émise par le pixel x s , transportant l’étiquette c f et<br />
parcourant un chemin aléatoire V ns (voisinage non stationnaire), est donnée comme suit :<br />
⎧<br />
⎪ 1<br />
T −1<br />
1<br />
⎪<br />
( c s x ) = ⎨ ( x s − µ c ) . ∑ c . ( x s − µ c ) + ln ⎨ ∑ ⎬ ⎬ + β ∑ ( 1 − δ ( c f , c r ) )<br />
s<br />
s<br />
s<br />
c<br />
U s<br />
⎩ 2<br />
2<br />
⎧<br />
⎩<br />
s<br />
⎫ ⎫<br />
⎭ ⎭<br />
r∈V<br />
sn<br />
Avec µ c et ∑ s c sont respectivem<strong>en</strong>t le vecteur moy<strong>en</strong>ne et <strong>la</strong> matrice <strong>de</strong> covariance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
s<br />
c<strong>la</strong>sse cs au site s, déterminés à partir <strong>de</strong>s échantillons d’<strong>en</strong>traînem<strong>en</strong>t. β est un paramètre <strong>de</strong><br />
régu<strong>la</strong>risation et δ est le symbole <strong>de</strong> Kro<strong>en</strong>eker. A cause du dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t aléatoire <strong>de</strong>s<br />
fourmis, le critère d’arrêt généralem<strong>en</strong>t adopté est un nombre d’itérations fixé au préa<strong>la</strong>ble<br />
par l’utilisateur.<br />
3. Résultats :<br />
En appliquant l’approche proposée sur limage multispectrale couvrant <strong>la</strong> région nord-est <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> ville d’Alger, nous avons obt<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s résultats satisfaisants et très <strong>en</strong>courageants. En effet,<br />
contrairem<strong>en</strong>t au résultat obt<strong>en</strong>u par <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> markovi<strong>en</strong>ne c<strong>la</strong>ssique (ICM) qui prés<strong>en</strong>te<br />
une dégradation et une perte <strong>de</strong>s contours et <strong>de</strong>s segm<strong>en</strong>ts, dû principalem<strong>en</strong>t à l’adoption<br />
d’un voisinage stationnaire, les fourmis arriv<strong>en</strong>t à retrouver les voisins optimaux permettant<br />
ainsi <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> continuité, notamm<strong>en</strong>t au niveau <strong>de</strong>s segm<strong>en</strong>ts et <strong>de</strong>s structures<br />
linéaires<br />
Mots-clés : images, c<strong>la</strong>ssification, colonie <strong>de</strong> fourmis, champs aléatoires <strong>de</strong> Markov (MRF).<br />
Bibliographie<br />
- Le Hégarat-Mascle, S., Kallel, A., & Descombes, X. (2005). Ant colony optimization for image<br />
regu<strong>la</strong>rization based on a non-stationary Markov mo<strong>de</strong>lling. IEEE Transactions on Image Processing, submitted<br />
on April 20, 2005.
- Monmarché, N. (2004). Algorithmes <strong>de</strong> fourmis artificielles : applications à <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification et à<br />
l’optimisation. Thèse pour obt<strong>en</strong>ir le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> Docteur <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Tours. Discipline : Informatique.<br />
Université François Rabe<strong>la</strong>is, Tours, France, 231 p.<br />
- Ouadfel, S., Batouche, M. (2003). MRF-based image segm<strong>en</strong>tation using Ant Colony System. Electronic<br />
Letters on Computer Vision and Image Analysis, pp. 12-24.<br />
Apports <strong>de</strong> <strong>la</strong> télédétection et du MNE SRTM à l’Analyse<br />
morphostructurale et à l’étu<strong>de</strong> d’impact sur <strong>la</strong> variation du comportem<strong>en</strong>t<br />
hydrosystème du fossé d’effondrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> Foussana (Tunisie c<strong>en</strong>trale)<br />
Sami KHEMIRI a , Kais ARIDHI a , Sabri ARIDHI a , Hafedh Hamza a , Fouad ZARGOUNI a<br />
a : Faculté <strong>de</strong>s sci<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> Tunis<br />
khemirisami geo@yahoo.fr ; aridhikais@gmail.com ; aridhisabri@yahoo.fr ; hafedh hamza@yahoo.fr ;<br />
fouadzargouni@yahoo.fr<br />
1. Problématique :<br />
L'image satellite est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue, <strong>de</strong>puis quelques années un docum<strong>en</strong>t incontournable pour<br />
extraire <strong>de</strong> les informations géologiques, pour produire <strong>de</strong>s cartes topographiques,<br />
lithologiques, structurales et <strong>de</strong>s cartes d’occupation du sol, pour analyser l’aspect structural<br />
et morphologique d’un secteur déterminé. Aussi pour compr<strong>en</strong>dre le fonctionnem<strong>en</strong>t du<br />
réseau hydrologique d’un secteur, telle que <strong>la</strong> délimitation <strong>de</strong>s bassins versants et <strong>de</strong>s sous<br />
bassins, <strong>la</strong> cartographie du réseau, l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s secteurs ayant une <strong>de</strong>nsité forte, <strong>la</strong><br />
détermination <strong>de</strong>s principaux zones d’alim<strong>en</strong>tation <strong>de</strong>s nappes souterraines.<br />
Fig.1 : Image TM Landsat <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Foussana avant traitem<strong>en</strong>t<br />
C’est dans ce contexte que se prés<strong>en</strong>te ce travail, qui consiste à utiliser <strong>la</strong> télédétection<br />
pour <strong>de</strong>s analyses morphostructurales, l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion (AHMAD BILAL et OSAMA<br />
AMMAR .2003) <strong>de</strong> comportem<strong>en</strong>t du bassin versant <strong>de</strong> Foussana, et <strong>de</strong> monter l’impact <strong>de</strong>s<br />
structures géologiques (cassantes, ductiles, déformations, plis, grab<strong>en</strong>…) sur <strong>la</strong> variation <strong>de</strong><br />
son hydrosystème.<br />
2. Données <strong>de</strong> base et méthodologie :<br />
Tout le long <strong>de</strong> ce travail on a eu recours à <strong>de</strong>s images TM et ETM+ (Fig.1) <strong>de</strong> Landsat<br />
égalem<strong>en</strong>t, on a utilisé le modèle numérique <strong>de</strong> terrain <strong>de</strong> SRTM (Shuttle Radar Topography<br />
Mission) dont <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sion <strong>de</strong>s pixels est <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 90 (Fig.2) et <strong>de</strong> 30m.<br />
145
Fig.2 : SRTM 90 m illustrant une bonne vision <strong>de</strong>s reliefs et <strong>de</strong> <strong>la</strong> morphologie du fossé d’effondrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
Foussana et les anticlinaux qui l’<strong>en</strong>tour<strong>en</strong>t<br />
Les images Landsat 7 TM et ETM+ sont d’un apport considérable pour l’établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
cartes lithostructurales. les techniques <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t utilisées (S. GUILLOBEZ, F. BORNE,<br />
P. FOL. 1996) , à savoir les différ<strong>en</strong>tes compositions colorées réalisées sur les images<br />
originales, les rapports <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>s et l’analyse <strong>en</strong> composante principale, ainsi que les divers<br />
filtres directionnels à 0,45° et 90° ont permis, dans <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Foussana, <strong>de</strong> déterminer une<br />
excell<strong>en</strong>te discrimination lithologique <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>tes unités géologiques, ainsi que<br />
l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s linéam<strong>en</strong>ts majeurs, interprétés comme d’origine tectonique, après<br />
contrôle sur le terrain. Les p<strong>la</strong>ns d’informations tirés suite au traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces images<br />
satellites, sous Envi 4.5 et Erdass 2010, ont été consolidés par d’autres résultats, obt<strong>en</strong>us par<br />
l’analyse et le traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s MNT <strong>de</strong> SRTM (www.usgs.com) eux aussi é<strong>la</strong>borés sous Envi<br />
4.5.<br />
Résultats :<br />
L’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s résultats obt<strong>en</strong>us, a été introduit et exporté vers <strong>de</strong>s logiciels SIG : ArcGis<br />
9.2, ce qui a permis <strong>de</strong> déterminer le régime <strong>de</strong> déformation qui contrôle les différ<strong>en</strong>ts<br />
panneaux et blocs structuraux du secteur d’étu<strong>de</strong>, ainsi que les différ<strong>en</strong>ts paramètres<br />
hydrologiques qui caractéris<strong>en</strong>t ce bassin. Enfin un essai <strong>de</strong> corré<strong>la</strong>tion structural-hydrologie,<br />
vise à dégager l’influ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> ces structures sur <strong>la</strong> variation du comportem<strong>en</strong>t hydrologique du<br />
bassin (H. RAHOUI 1977).<br />
Mots clé : Landsat TM et ETM+, SRTM, Linéam<strong>en</strong>t, hydrologie, SIG.<br />
Bibliographie :<br />
- Bi<strong>la</strong>l A., Ammar O., 2003: Un Modèle <strong>de</strong> recharge pour l’aménagem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s ressources <strong>en</strong> eau dans les pays<br />
semi-ari<strong>de</strong> et ari<strong>de</strong>s à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’image satellitaire, Télédétection, 1, 49-58.<br />
- Guillobez S., Borne F., Folp P., 1996: Des données satellitaires à <strong>la</strong> cartographie <strong>de</strong>s sols, utilisation <strong>de</strong><br />
l’outil informatique, exemple au Botswana. ORSTOM, 1996,8 p.<br />
- Rahoui H., 1977: Etu<strong>de</strong> géologique et hydrogéologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> cuvette <strong>de</strong> Foussana, Thèse <strong>de</strong> doctorat, 302p.<br />
146
Apport <strong>de</strong> <strong>la</strong> télédétection dans l’évaluation participative <strong>de</strong>s risques<br />
d’inondation liés à l’imp<strong>la</strong>ntation du barrage <strong>de</strong> Yakouta au Burkina Faso.<br />
Nico<strong>la</strong>s KONE (1) , Patrick MOUKETOU (2) , Joachim BONKOUNGOU (1) et Paul W. SAVADOGO (2) .<br />
(1) Cellule <strong>de</strong> télédétection et SIG – INERA – 03 BP 7192 Ouagadougou 03 – BURKINA FASO<br />
Téléphone : (226) 50 31 92 02 / 08 – télécopieur : (226) 50 34 02 71<br />
kone.nico<strong>la</strong>s@yahoo.fr ; joachbonk@yahoo.fr<br />
(2) Institut du Génie <strong>de</strong> l’Environnem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> Développem<strong>en</strong>t Durable<br />
Université <strong>de</strong> Ouagadougou, UFR/SEA<br />
03 BP 7021 Ouagadougou 03 – BURKINA FASO<br />
Téléphone: (226) 50 39 38 15 - télécopieur : (226) 50 39 33 37<br />
mouketou.patrick@yahoo.fr ; paul.savadogo@univ-ouaga.bf<br />
1. Problématique :<br />
1) Pour ai<strong>de</strong>r à l’approvisionnem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> eau potable <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Dori au Burkina Faso, un<br />
barrage a été imp<strong>la</strong>nté <strong>en</strong> 2005 dans un <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t sableux d’erg anci<strong>en</strong> et <strong>de</strong> systèmes<br />
dunaires, près <strong>de</strong> <strong>la</strong> localité <strong>de</strong> Yakouta. Ce barrage s’ét<strong>en</strong>d sur près <strong>de</strong> 25 km, <strong>en</strong> drainant<br />
onze vil<strong>la</strong>ges riverains sur un bassin versant <strong>de</strong> 1660 km 2 . .<br />
2) Une bouffée d’oxygène qui risque <strong>de</strong> ne pas durer pour cet <strong>en</strong>semble <strong>de</strong> communautés<br />
vil<strong>la</strong>geoises à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> forte pression animale et <strong>de</strong> l’exploitation anarchique <strong>de</strong>s berges. De<br />
fait, les problèmes subséqu<strong>en</strong>ts sont :<br />
- l’<strong>en</strong>sablem<strong>en</strong>t et <strong>la</strong> pollution <strong>de</strong>s eaux qui m<strong>en</strong>ac<strong>en</strong>t <strong>la</strong> survie même <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource ;<br />
- <strong>la</strong> méconnaissance <strong>de</strong>s impacts et l’inadaptation aux changem<strong>en</strong>ts climatiques.<br />
3) Des risques d’inondation dus au dépassem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité maximale du barrage <strong>de</strong>puis<br />
sa mise <strong>en</strong> eau, suite à une pluviométrie supérieure jusque là observée.<br />
2. Données <strong>de</strong> base et méthodologie :<br />
- Mosaïques d’images satellitaires <strong>de</strong> très haute résolution tirées <strong>de</strong> GoogleEarth<br />
(datées du 28 janvier 2007) ;<br />
- Reconstruction <strong>de</strong> <strong>la</strong> toponymie et photo interprétation ;<br />
- Outils d’évaluation participative <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> désastres (EPRD) évaluer l’aléa,<br />
les vulnérabilités et les capacités (<strong>la</strong> carte vil<strong>la</strong>geoise et le c<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s aléas ; le<br />
cal<strong>en</strong>drier saisonnier ; <strong>la</strong> chronologie <strong>de</strong>s aléas passés ; le diagramme <strong>de</strong> V<strong>en</strong>n ;<br />
l’interview <strong>de</strong>s informateurs ess<strong>en</strong>tiels ; <strong>la</strong> randonnée <strong>de</strong> transect et l’observation<br />
directe très facilitée par l’imagerie satellitaire.).<br />
3. Résultats :<br />
1. Les vil<strong>la</strong>ges situés au nord du barrage sont tous sur les dunes et les concessions sont <strong>en</strong><br />
hauteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> côte <strong>de</strong> l’eau. Seuls les champs aux abords du barrage sont exposés<br />
p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> saison <strong>de</strong>s pluies, mais ces parcelles sont très recherchées p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> saison<br />
sèche. Durant toute <strong>la</strong> saison <strong>de</strong>s pluies, les animaux sont <strong>en</strong>voyés dans les zones <strong>de</strong><br />
pâturage <strong>en</strong> <strong>de</strong>hors du vil<strong>la</strong>ge, ce qui limite toute perte dans les aires <strong>de</strong> parcage.<br />
2. Certains vil<strong>la</strong>ges ont été dép<strong>la</strong>cés <strong>en</strong> partie pour <strong>la</strong> construction du barrage : ce sont<br />
Dani, Dangadé, Oulo et Péoukoye. La <strong>de</strong>uxième partie <strong>de</strong> Dani qui se retrouve au sud<br />
du barrage, sur <strong>de</strong>s g<strong>la</strong>cis <strong>de</strong> l’erg anci<strong>en</strong>, connaît <strong>de</strong>s champs et quelques concessions<br />
exposées à l’inondation. De même pour Oulo dont une partie est sur dunes <strong>en</strong> hauteur,<br />
et l’autre <strong>en</strong> contrebas, exposée.<br />
3. Une composition couleur avec le canal proche infrarouge ou moy<strong>en</strong> infrarouge serait<br />
plus indiquée que l’imagerie <strong>en</strong> couleurs naturelles pour cerner les zones inondables.<br />
147
Spatiocarte <strong>de</strong> l’extrait d’images mosaïques sur GoogleEarth : <strong>en</strong> triangle rosé, les lieux d’<strong>en</strong>quête participative<br />
avec <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion locale.<br />
Barrage <strong>de</strong> Yakouta est avec déversoir <strong>de</strong> type<br />
Creager<br />
Mots clés : Barrage, systèmes dunaires, risque, inondation, outils participatifs<br />
Bibliographie :<br />
- ACCA-VICAB, 2008. Diagnostic participatif <strong>de</strong> Yakouta. http://acca-vicab.bf refer.org//, 33p.<br />
- Africa Business Consult – Assistance & Building Capacities, 2009. Etu<strong>de</strong> pour l’é<strong>la</strong>boration du p<strong>la</strong>n <strong>de</strong><br />
gestion <strong>de</strong> l’eau <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone <strong>de</strong> compet<strong>en</strong>ce du comité local <strong>de</strong> l’eau <strong>de</strong> Yacouta. Tome II : P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> gestion 2010 –<br />
2012. Rapport final. Comité Local <strong>de</strong> l’Eau du Barrage <strong>de</strong> Yakouta, Burkina Faso, 57p.<br />
- V<strong>en</strong>ton P. and Hansford B., 2006. Reducing risk of disaster in our communities. TearFund Publications,<br />
80p.<br />
148
Modélisation du stress hydrique dans <strong>la</strong> Kroumirie par télédétection et<br />
spatialisation <strong>de</strong> données climatiques.<br />
Souhail KRICHEN * , Hédia CHAKROUN** et Flor<strong>en</strong>t MOUILLOT***<br />
* et **ENIT ***IRD<br />
krich<strong>en</strong>s2003@gmail.com<br />
Problématique :<br />
Situées au nord ouest <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tunisie, les forêts <strong>de</strong> Kroumirie prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t <strong>la</strong> zone <strong>la</strong> plus <strong>de</strong>nse<br />
<strong>en</strong> termes <strong>de</strong> végétation par <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> vastes <strong>surface</strong>s occupées par <strong>la</strong> forêt <strong>de</strong>nse <strong>de</strong><br />
chêne liège. L’étage bioclimatique humi<strong>de</strong> et sub-humi<strong>de</strong> fait que cette région constitue le<br />
château d’eau <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tunisie ; il existe plusieurs barrages et sources naturelles d’eau qui<br />
alim<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t une bonne partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tunisie.<br />
Vu les changem<strong>en</strong>ts climatiques globaux, qui peuv<strong>en</strong>t avoir une influ<strong>en</strong>ce importante sur le<br />
régime hydrique et les écosystèmes forestiers, l’objectif <strong>de</strong> ce travail est <strong>de</strong> spatialiser le stress<br />
hydrique dans les forêts <strong>de</strong> Kroumirie par l’utilisation d’outils <strong>de</strong> télédétection et par le biais<br />
<strong>de</strong> spatialisation <strong>de</strong> données multi-sources.<br />
Méthodologie :<br />
Après une prés<strong>en</strong>tation du cadre du projet, <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone d’étu<strong>de</strong> et <strong>de</strong>s notions hydrologiques<br />
(évapotranspiration, flux d’eau et stress hydrique), nous prés<strong>en</strong>tons les outils <strong>de</strong> spatialisation<br />
<strong>de</strong> plus <strong>en</strong> plus utilisés dans le cadre <strong>de</strong> modélisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynamique <strong>de</strong>s écosystèmes. La<br />
démarche adoptée dans ce travail repose ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t sur <strong>de</strong>s traitem<strong>en</strong>ts d’images satellite<br />
(SPOT) acquises <strong>en</strong> 2006. Après les traitem<strong>en</strong>ts préliminaires <strong>de</strong> ces images, nous avons<br />
calculé l’indice <strong>de</strong> végétation NDVI. Nous avons <strong>en</strong>suite établi une re<strong>la</strong>tion empirique <strong>en</strong>tre le<br />
NDVI et le LAI (indice foliaire) qui a été mesuré <strong>en</strong> 2006 sur certaines parcelles<br />
expérim<strong>en</strong>tales dans <strong>la</strong> forêt <strong>de</strong> Kroumirie. Cette re<strong>la</strong>tion a permis <strong>de</strong> spatialiser le LAI pour<br />
l’intégrer ultérieurem<strong>en</strong>t dans le bi<strong>la</strong>n hydrique. D’autre part, nous avons utilisé un modèle<br />
numérique d’altitu<strong>de</strong> (MNA) afin <strong>de</strong> déterminer les paramètres du relief qui intervi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t<br />
dans <strong>la</strong> modélisation spatiale du flux d’eau. La modélisation spatiale du stress hydrique a<br />
été basée sur <strong>la</strong> spatialisation <strong>de</strong>s données climatiques (Précipitations, température et<br />
rayonnem<strong>en</strong>t so<strong>la</strong>ire). Le bi<strong>la</strong>n d’eau a été spatialisé par l’intégration <strong>de</strong>s données climatiques,<br />
physiques et biotiques dans le calcul <strong>de</strong> l’évapotranspiration, et <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité <strong>en</strong> eau du sol<br />
sur une base journalière.<br />
Résultats :<br />
Ainsi, nous avons établi le stress hydrique par le calcul <strong>de</strong> <strong>la</strong> t<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> eau du sol et ce sur<br />
une pério<strong>de</strong> annuelle. Les résultats <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> ont montré <strong>la</strong> possibilité d’exist<strong>en</strong>ce d’une<br />
pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> stress hydrique subie par <strong>la</strong> végétation pouvant aller jusqu’à une c<strong>en</strong>taine <strong>de</strong> jours<br />
par an et ce dép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécheresse <strong>de</strong> l’année d’étu<strong>de</strong>.<br />
149
Carte <strong>de</strong> Lai <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone d'étu<strong>de</strong> (Nord ouest <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tunisie)<br />
Mot clés : Télédétection, NDVI, LAI, bi<strong>la</strong>n hydrique, stress hydrique.<br />
Bibliographie :<br />
- Davi H., Soudani K., Deckx T., Dufrêne E., Le Dantec V. & François C. 2006. Estimation of forest Leaf<br />
Area In<strong>de</strong>x from SPOT imagery using NDVI distribution over homog<strong>en</strong>eous stands. International Journal of<br />
Remote S<strong>en</strong>sing, 27: 885-902.<br />
- Priestley, G. B. H & Taylor, R.J., 1972.On the assessm<strong>en</strong>t of <strong>surface</strong> heat flux and evaporation using <strong>la</strong>rge<br />
scale parameter.Month. Wather Rev.100, p81-92.<br />
Utilisation <strong>de</strong>s données hyperspectrales hyspex swir-320m pour<br />
l’i<strong>de</strong>ntification et <strong>la</strong> cartographie <strong>de</strong>s minéraux et <strong>de</strong>s roches carbonates <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> formation d’Ankloute (bassin d’agadir, maroc)<br />
Kamal LABBASSI a, * , Rachid BAISSA a, b, , Patrick LAUNEAU b ,<br />
a Laboratoire <strong>de</strong> Géosci<strong>en</strong>ces et Environnem<strong>en</strong>t, Faculté <strong>de</strong>s Sci<strong>en</strong>ces, Université Chouaïb Doukkali,<br />
El Jadida, Maroc.<br />
b Laboratoire <strong>de</strong> P<strong>la</strong>nétologie & Géodynamique/ UMR-CNRS 6112/, Université <strong>de</strong> Nantes, France<br />
Travail réalisé dans le cadre du programme volubilis, Action Intégrée N°: MA/07/171.<br />
Kamal <strong>la</strong>bbassi@yahoo fr / <strong>la</strong>bbassi@ucd.ac ma<br />
1- Problématique :<br />
De nos jours le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s capteurs d’acquisition <strong>de</strong>s images hyperspectrales a<br />
contribué <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t à l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts constituants <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>surface</strong> terrestre et par<br />
conséqu<strong>en</strong>t, à l’amélioration <strong>de</strong>s produits cartographiques. Les roches carbonatées sont le<br />
siège <strong>de</strong> processus <strong>de</strong> diag<strong>en</strong>èse et d’altération, qui peuv<strong>en</strong>t atteindre <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong> <strong>la</strong> roche.<br />
Ces processus conduis<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> néoformation <strong>de</strong> minéraux carbonatés avec une gran<strong>de</strong><br />
variabilité <strong>de</strong> phases <strong>de</strong> cristallisation. Fréquemm<strong>en</strong>t, au microscope optique, l’i<strong>de</strong>ntification<br />
précise et <strong>la</strong> discrimination <strong>de</strong> ces phases échapp<strong>en</strong>t au pouvoir séparateur <strong>de</strong> l’œil, ce qui<br />
r<strong>en</strong>d <strong>la</strong> cartographie minéralogique <strong>de</strong> microfaciès, difficile. Elle nécessite, au préa<strong>la</strong>ble,<br />
l’utilisation <strong>de</strong> techniques <strong>de</strong> coloration.<br />
150
Ce travail, se propose d’étudier les faciès carbonatés d’âge jurassique dans le bassin<br />
d’Agadir, par l’utilisation <strong>de</strong>s images hyperspectrales fournies par <strong>la</strong> caméra HySpex SWIR-<br />
320m, dans les longueurs d’on<strong>de</strong>s al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> 1300 à 2500 nm. Ces images offr<strong>en</strong>t <strong>la</strong> possibilité,<br />
d’i<strong>de</strong>ntifier avec une gran<strong>de</strong> précision les différ<strong>en</strong>ts minéraux carbonatés pour permettre ainsi<br />
<strong>la</strong> caractérisation diagénitique <strong>de</strong>s faciès.<br />
2. Données <strong>de</strong> base et méthodologie :<br />
L’approche adoptée consiste à calculer un indice <strong>de</strong>s carbonates « Normalized Differ<strong>en</strong>ce<br />
Carbonate In<strong>de</strong>x » (NDCI) pour étudier l'approfondissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> ban<strong>de</strong> principale <strong>de</strong>s<br />
carbonates et une c<strong>la</strong>ssification supervisée s'appuyant sur <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> « Spectral Angle<br />
Mapper » (SAM) pour étudier <strong>la</strong> forme globale <strong>de</strong>s spectres <strong>de</strong> réflexion <strong>de</strong>s carbonates et<br />
accessoirem<strong>en</strong>t cartographier les autres minéraux prés<strong>en</strong>ts.<br />
3. Résultats :<br />
Cette métho<strong>de</strong> a permis l’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s cartes minéralogiques complétées par leurs<br />
<strong>de</strong>grés <strong>de</strong> cristallinité.<br />
La combinaison <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> <strong>la</strong> position du minimum d’absorption (λBmin) avec celle <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> profon<strong>de</strong>ur (NDCI), permet <strong>de</strong> déduire <strong>de</strong>s informations utiles à <strong>la</strong> compréh<strong>en</strong>sion <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
variation <strong>de</strong> <strong>la</strong> minéralogie par rapport à <strong>la</strong> cristallinité. Pour l’échantillon Ank04, par<br />
exemple on peut dire qu’il prés<strong>en</strong>te une minéralogie plus ou moins homogène avec une<br />
t<strong>en</strong>dance dolomitique et une cristallinité très homogène. Par contre l’échantillon Ank05<br />
prés<strong>en</strong>te <strong>de</strong>ux parties qui peuv<strong>en</strong>t se différ<strong>en</strong>cier <strong>de</strong> point <strong>de</strong> vue minéralogique, une partie<br />
calcitique et l’autre calcito-dolomitique. De point <strong>de</strong> vue cristallinité <strong>la</strong> partie calcitodolomitique<br />
est très homogène, par contre <strong>la</strong> partie calcitique prés<strong>en</strong>te quatre phases <strong>de</strong><br />
cristallinité correspondant <strong>en</strong> fait à <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> p<strong>la</strong>quages secondaires. Pour l’échantillon<br />
6a, il a une minéralogie mixte <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> phase dolomitique et calcito-dolomitique et avec une<br />
cristallinité à trois phases dont les valeurs <strong>de</strong> l’NDCI sont faibles.<br />
En conclusion partielle on peut dire que :<br />
- <strong>la</strong> cristallinité évolue indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> minéralogie.<br />
- les p<strong>la</strong>quages calcitiques <strong>de</strong> failles prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t un <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> cristallinité plus élevé que<br />
les faciès calcaires et dolomitiques.<br />
Les différ<strong>en</strong>ts états <strong>de</strong> <strong>surface</strong> <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drés par les phénomènes d’altération superficielle <strong>de</strong>s<br />
carbonates, caus<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s effets perturbant <strong>la</strong> signature spectrale <strong>de</strong>s faciès. Le calcul <strong>de</strong> l’indice<br />
NDCI prés<strong>en</strong>te l’avantage d’être applicable directem<strong>en</strong>t sur les patines <strong>de</strong>s roches sans<br />
préparation aux préa<strong>la</strong>bles <strong>de</strong>s échantillons et sans passé par <strong>la</strong> confection <strong>de</strong>s <strong>la</strong>mes minces.<br />
L’indice NDCI est efficace pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s phases <strong>de</strong> cristallisation <strong>de</strong>s textures sans être<br />
gêné ni par les différ<strong>en</strong>ts états <strong>de</strong> <strong>la</strong> géométrie <strong>de</strong> <strong>surface</strong> <strong>de</strong>s échantillons ni par l’état <strong>de</strong><br />
cristallinité <strong>de</strong> l’espèce minérale carbonatée lorsque <strong>la</strong> résolution spectrale <strong>de</strong> 5nm permet <strong>de</strong><br />
bi<strong>en</strong> déterminer <strong>la</strong> position <strong>de</strong>s ban<strong>de</strong>s d’absorption <strong>de</strong> calcite et dolomite à 2340 et 2320 nm.<br />
L’image représ<strong>en</strong>tant le minimum d’absorption, permet ainsi <strong>de</strong> mettre <strong>en</strong> évi<strong>de</strong>nce <strong>la</strong><br />
prés<strong>en</strong>ce et/ou l’abondance <strong>de</strong> <strong>la</strong> calcite par rapport à <strong>la</strong> dolomite, <strong>la</strong> répartition spatiale <strong>de</strong> ses<br />
minéraux sur chaque échantillon et <strong>la</strong> détection <strong>de</strong> <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce d’autres minéraux.<br />
L’apport <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification supervisée (SAM) est d’i<strong>de</strong>ntifier et <strong>de</strong> cartographier les<br />
minéraux qui ne sont pas pris <strong>en</strong> compte par le calcul <strong>de</strong> l’indice NDCI à savoir le gypse et les<br />
minéraux argileux très répandues dans <strong>la</strong> Formation d’Ankloute.<br />
151
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation <strong>de</strong> l’arganeraie (Sud-ouest du Maroc)<br />
à partir <strong>de</strong> données <strong>de</strong> télédétection multisources<br />
Bernard LACAZE 1 et Ahmed EL ABOUDI 2<br />
1 CNRS-UMR8586, Pôle Image & Campus Spatial, Université Paris Di<strong>de</strong>rot-Paris7, Paris, France<br />
2 Faculté <strong>de</strong>s Sci<strong>en</strong>ces, Départem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> Biologie, Rabat-Agdal, Maroc<br />
<strong>la</strong>caze.bernard@gmail.com, e<strong>la</strong>boudi@gmail.com<br />
1. Problématique :<br />
L'arganier [ Argania spinosa (L.) Skeels] est un arbre <strong>en</strong>démique du Sud-ouest marocain,<br />
s'ét<strong>en</strong>dant actuellem<strong>en</strong>t sur une superficie d'<strong>en</strong>viron 800 000 ha dans <strong>de</strong>s zones semi-ari<strong>de</strong>s et<br />
ari<strong>de</strong>s, où il joue un rôle crucial dans l'économie agro-sylvo-pastorale et constitue un rempart<br />
contre <strong>la</strong> désertification. Malgré <strong>la</strong> <strong>la</strong>bellisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>en</strong> réserve <strong>de</strong> Biosphère<br />
UNESCO (1998), l'arganier est <strong>en</strong> régression continue <strong>en</strong> raison d'une surexploitation<br />
(surpâturage, exploitation excessive du bois, etc.), et, pour les zones <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ine, par l’ext<strong>en</strong>sion<br />
<strong>de</strong>s <strong>surface</strong>s agricoles irriguées. En l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> cartographie précise <strong>de</strong> l’arganeraie et<br />
d’évaluation <strong>de</strong>s changem<strong>en</strong>ts surv<strong>en</strong>us dans <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> réc<strong>en</strong>te, nous proposons <strong>de</strong> tester<br />
l’utilisation <strong>de</strong> données <strong>de</strong> télédétection multisources pour <strong>la</strong> cartographie <strong>de</strong> l’utilisation du<br />
sol et l’analyse diachronique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>nsité du couvert arboré.<br />
2. Données <strong>de</strong> base et méthodologie :<br />
La zone d’étu<strong>de</strong> est située dans <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Ait-Baha (30° 4’ 18’’ Nord ; 9° 9’ 42’’Ouest) qui<br />
a fait l’objet d’une cartographie <strong>de</strong>s groupem<strong>en</strong>ts végétaux (El Aboudi et al., 1992). Les<br />
images-satellite utilisées sont les suivantes :<br />
- photographie panchromatique KH-9 du 18 mai 1978 (imagerie satellite U. S.<br />
déc<strong>la</strong>ssifiée)<br />
- images SPOT panchromatiques et multiban<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 1989, 1993 et 2006<br />
- images ASTER <strong>de</strong> 2002<br />
-images IKONOS <strong>de</strong> 2003<br />
- images réc<strong>en</strong>tes figurant dans Google Earth<br />
Les métho<strong>de</strong>s utilisées sont celles <strong>de</strong> <strong>la</strong> visualisation <strong>en</strong> compositions colorées, du<br />
calcul d’indices <strong>de</strong> végétation, <strong>de</strong> filtrages passe-haut <strong>de</strong> type <strong>la</strong>p<strong>la</strong>ci<strong>en</strong>, <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssifications<br />
dirigées pixel par pixel et <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssifications-objets à l’ai<strong>de</strong> du module Feature Extraction<br />
du progiciel ENVI Zoom (ITTVIS).<br />
3. Résultats :<br />
La cartographie <strong>de</strong> l’utilisation du sol repose ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t sur <strong>la</strong> détection <strong>de</strong>s cultures<br />
au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> leur croissance printanière : <strong>la</strong> comparaison <strong>de</strong>s indices <strong>de</strong> végétation SPOT ou<br />
ASTER obt<strong>en</strong>us au printemps et <strong>en</strong> été permet une évaluation <strong>de</strong> l’ext<strong>en</strong>sion <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
céréaliculture pluviale et une év<strong>en</strong>tuelle comparaison pluriannuelle. La cartographie du<br />
couvert arboré effectuée à partir du seuil<strong>la</strong>ge du résultat du filtrage <strong>de</strong>s images SPOT<br />
panchromatiques <strong>de</strong> résolution spatiale 10m et 5m a donné <strong>de</strong>s résultats satisfaisants dans le<br />
cas <strong>de</strong> <strong>surface</strong>s peu acci<strong>de</strong>ntées et <strong>de</strong> diamètre <strong>de</strong> couronnes d’arbres du même ordre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
résolution <strong>de</strong>s images. Cep<strong>en</strong>dant, il est nécessaire <strong>de</strong> compléter les résultats par le recours à<br />
<strong>de</strong>s opérateurs <strong>de</strong> morphologie mathématique pour éliminer les objets non arbres ret<strong>en</strong>us par<br />
le filtrage (bords <strong>de</strong> routes, haies <strong>de</strong> figuiers <strong>de</strong> barbarie, etc.), et <strong>la</strong> détermination du seuil à<br />
appliquer reste délicate. Une solution beaucoup plus efficace est le recours à <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssificationobjet<br />
<strong>de</strong>s images à très haute résolution spatiale <strong>de</strong> type IKONOS (voir figure 1). L’analyse<br />
diachronique reste difficile <strong>en</strong> raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> diversité <strong>de</strong>s images utilisées ; néanmoins on peut<br />
conclure à une re<strong>la</strong>tive stabilité du couvert arboré, confirmant ainsi les résultats <strong>de</strong> El Aboudi<br />
(2000) et contrastant avec <strong>la</strong> rapi<strong>de</strong> diminution du couvert arboré constatée dans d’autres<br />
secteurs (El Yousfi & B<strong>en</strong>chekroun, 1992). Compte-t<strong>en</strong>u du besoin <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce du couvert<br />
152
arboré <strong>de</strong> l’arganeraie, on peut préconiser le recours aux images Google Earth, avec<br />
cep<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> faire face aux problèmes d’hétérogénéité <strong>de</strong>s images affichées<br />
(SPOT, Digital Globe) et <strong>de</strong> leur fugacité (nécessité d’effectuer un archivage).<br />
Figure 1. Cartographie <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>nsité d’arbres à partir d’image IKONOS<br />
Mots clés arganier, couvert arboré, télédétection, analyse diachronique<br />
Bibliographie<br />
El Aboudi A., 2000 : Application <strong>de</strong> <strong>la</strong> télédétection spatiale à <strong>la</strong> cartographie <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation <strong>de</strong><br />
l’arganeraie (Sud Maroc). Thèse doctorat d’Etat, Université Mohammed V, Rabat.<br />
El Aboudi A., Peltier J.-P., Doche B., 1992 : La carte <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation <strong>de</strong>s Aït-Baha (Anti-At<strong>la</strong>s occi<strong>de</strong>ntal)<br />
et son intérêt pour l’édaphologie. Fed<strong>de</strong>s Repertorium, 103, 121-126.<br />
El Yousfi S. M. & B<strong>en</strong>chekroun F., 1992 : La dégradation forestière dans le Sud marocain. Exemple <strong>de</strong><br />
l’arganeraie d’Admine (Souss) <strong>en</strong>tre 1969 et 1986. Annales <strong>de</strong> <strong>la</strong> Recherche Forestière (Maroc), 26<br />
Caractérisation <strong>de</strong> l’aléa pluvieux <strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne Majerda (Nord-Ouest <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Tunisie) : approche historico-statistique.<br />
Lotfi LAHMAR<br />
Faculté <strong>de</strong>s Sci<strong>en</strong>ces Humaines et Sociales <strong>de</strong> Tunis, Laboratoire <strong>de</strong> CGMED.<br />
<strong>la</strong>hmar2010@gmail.com<br />
1. Problématique :<br />
Les évènem<strong>en</strong>ts pluvieux majeurs surv<strong>en</strong>us <strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne Majerda, surtout <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> fin du<br />
XIXe siècle et <strong>la</strong> première moitié du XXe, sont restés jusqu’à prés<strong>en</strong>t très peu connus. Or, leur<br />
analyse à partir <strong>de</strong>s données <strong>de</strong>s archives sur plus d’un siècle souligne une t<strong>en</strong>dance au<br />
groupem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> séries d’inondations.<br />
2. Données <strong>de</strong> base et méthodologie :<br />
Le travail repose sur l’exploitation d’une base <strong>de</strong> données assez complètes et actualisées<br />
<strong>de</strong>s pluies journalières pour 46 stations. Le but est égalem<strong>en</strong>t d’examiner <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion <strong>en</strong>tre <strong>la</strong><br />
répartition <strong>de</strong>s inondations <strong>en</strong>registrées et <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s pluies au cours du temps.<br />
153
3. Résultats :<br />
Six séries y ont été dégagées dont <strong>la</strong> récurr<strong>en</strong>ce est <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans et sept mois. La durée<br />
moy<strong>en</strong>ne <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s d’accalmie qui les sépar<strong>en</strong>t est d’<strong>en</strong>viron onze ans et dépasse, <strong>en</strong> tout<br />
cas, les sept ans. De tels résultats vont <strong>de</strong> pair avec les fluctuations du régime pluviométrique,<br />
fait bi<strong>en</strong> établi déjà non seulem<strong>en</strong>t ici mais dans tout le pays. Dans notre cas d’étu<strong>de</strong>,<br />
l’évolution <strong>temporelle</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s pluies montre, <strong>en</strong> gros, cinq phases d’alternance<br />
<strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s sèches et autres humi<strong>de</strong>s. Mais cette alternance n’a cep<strong>en</strong>dant pas <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>rité<br />
d’un cycle puisque sa pério<strong>de</strong> varie très fortem<strong>en</strong>t. En conclusion, étant certains gros<br />
événem<strong>en</strong>ts se sont produits <strong>en</strong> année humi<strong>de</strong> comme <strong>en</strong> année sèche, il est c<strong>la</strong>ir que l’aléa<br />
inondation prés<strong>en</strong>te un régime particulier qui est bi<strong>en</strong> différ<strong>en</strong>t <strong>de</strong> celui <strong>de</strong>s précipitations ; ce<br />
qui r<strong>en</strong>d sa prévision <strong>en</strong>core plus délicate. Le propos <strong>de</strong> ce papier est donc <strong>de</strong> contribuer à<br />
restituer <strong>la</strong> variabilité pluviométrique dans un contexte historique sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> quelques<br />
indices statistiques.<br />
Mots clés : régime pluviométrique ; variabilité ; archives ; inondation ; statistique.<br />
Référ<strong>en</strong>ces bibliographiques :<br />
- Bargaoui. Z.K. 1989 ; Occurr<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s sécheresses dans le bassin <strong>de</strong> <strong>la</strong> Medjerdah (Tunisie) ; revue <strong>de</strong>s<br />
sci<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> l’eau ; p 429-447.<br />
- H<strong>en</strong>ia.L (1993)- Climats et bi<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> l’eau <strong>en</strong>Tunisie. Essai <strong>de</strong> régionalisation climatique par les bi<strong>la</strong>ns<br />
hydriques. Publications <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Tunis I ; 391p.<br />
- Neppel.L et al. (1997)- Caractérisation <strong>de</strong> l’aléa climatique pluvieux <strong>en</strong> régions méditerrané<strong>en</strong>ne : analyse<br />
statistique <strong>de</strong>s <strong>surface</strong>s pluvieuses. Revue <strong>de</strong>s sci<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> l’eau ; p 155-174.<br />
Évaluation <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>ts mo<strong>de</strong>s po<strong>la</strong>rimétriques <strong>en</strong> ban<strong>de</strong> L pour <strong>la</strong><br />
stratification forestière <strong>en</strong> milieux tropical<br />
C. LARDEUX 1 ,D. NIAMEN 2 ,J.B ROUTIER 3 ,A.GIRAUD 3 ,P.L FRISON 2 ,E. POTTIER 1 ,J.P RUDANT 2<br />
1 Université <strong>de</strong> R<strong>en</strong>nes 1, UFR-SPM, 263 Av<strong>en</strong>ue Général Leclerc, CS 74205,35042 R<strong>en</strong>nes Ce<strong>de</strong>x. c<strong>la</strong>r<strong>de</strong>ux@univ-r<strong>en</strong>nes1.fr<br />
2 Université Paris-Est, Laboratoire G21, 5, boulevard Descartes, 77 454 Marne <strong>la</strong> Vallée Ce<strong>de</strong>x 2, France.<br />
1 ONF-International, 2 av<strong>en</strong>ue <strong>de</strong> Saint-Mandé, 75570 Paris Ce<strong>de</strong>x 12, France.<br />
Cédric Lar<strong>de</strong>ux c<strong>la</strong>r<strong>de</strong>ux@gmail.com<br />
1. Problématique<br />
La régression <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie <strong>de</strong>s principaux massifs forestiers comme <strong>en</strong> Amazonie ou<br />
dans le bassin du Congo ne <strong>la</strong>isse personne indiffér<strong>en</strong>t tous particulièrem<strong>en</strong>t dans le contexte<br />
post-kyoto qui nécessite d'esti<strong>mer</strong> leur biomasse. Cette situation r<strong>en</strong>d nécessaire <strong>la</strong><br />
surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> ces forêts. En raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> vaste ét<strong>en</strong>due <strong>de</strong> ces forêts, l'utilisation <strong>de</strong>s données<br />
satellitales s'impose tout naturellem<strong>en</strong>t, tout particulièrem<strong>en</strong>t l'utilisation <strong>de</strong>s données radar à<br />
cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce d'une importante et fréqu<strong>en</strong>te couverture nuageuse.<br />
Depuis fin 2006 sont apparu <strong>de</strong> nouveaux radars comme ALOS PALSAR (ban<strong>de</strong> L),<br />
RADARSAT 2 (ban<strong>de</strong> C) et TERRASAR-X (ban<strong>de</strong> X) permettant l'acquisition dans<br />
différ<strong>en</strong>ts mo<strong>de</strong>s po<strong>la</strong>rimétrique, améliorant pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> discrimination <strong>de</strong>s <strong>surface</strong>s<br />
observées.<br />
Le but <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> est <strong>de</strong> comparer et d'évaluer le pot<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>ts mo<strong>de</strong><br />
po<strong>la</strong>rimétriques (pleinem<strong>en</strong>t po<strong>la</strong>rimétriques, hh/hv, vv/hv, hh/vv, lh/lv) pour <strong>la</strong> stratification<br />
forestière <strong>en</strong> milieu tropical avec pour finalité d'é<strong>la</strong>borer une cartographie d'occupation du sol.<br />
Le site d'étu<strong>de</strong> choisit se situe dans le nord du Mato Grosso au Brésil. Il s'agit d'une zone qui a<br />
été déforesté dans les années 1990 puis rep<strong>la</strong>nté par l'ONFI <strong>de</strong>puis 1999 à partir <strong>de</strong> 50 espèces<br />
natives différ<strong>en</strong>te. Il y a donc <strong>de</strong>s inv<strong>en</strong>taires annuels garantissant une vérité terrain<br />
pertin<strong>en</strong>te.<br />
154
2. Donnée utilisé et méthodologie<br />
Les données pleinem<strong>en</strong>t po<strong>la</strong>rimétrique conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t toutes l'information po<strong>la</strong>rimétrique <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> scène permettant ainsi l'analyse <strong>de</strong>s effets géométriques <strong>de</strong>s mécanismes <strong>de</strong> rétrodiffusion<br />
qui se produis<strong>en</strong>t au sein d'une cellule <strong>de</strong> résolution. Par conséqu<strong>en</strong>t, ces données peuv<strong>en</strong>t être<br />
très utiles pour <strong>la</strong> discrimination <strong>de</strong> l'occupation du sol. En plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> matrice <strong>de</strong> <strong>la</strong> cohér<strong>en</strong>ce<br />
<strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>ts représ<strong>en</strong>tant l'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> <strong>la</strong> mesure po<strong>la</strong>rimétrique, d'autres paramètres<br />
cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s informations po<strong>la</strong>rimétriques y sont combinés. Ces paramètres compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t,<br />
notamm<strong>en</strong>t, les paramètres H / A / α issus <strong>de</strong> <strong>la</strong> décomposition <strong>de</strong> Clou<strong>de</strong> et Pottier, ceux<br />
fondés sur le formalisme Pauli, ou le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> cohér<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre les po<strong>la</strong>risations linéaires et<br />
circu<strong>la</strong>ires.<br />
Toutefois, <strong>en</strong> raison <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>tes contraintes du système, les données pleinem<strong>en</strong>t<br />
po<strong>la</strong>rimétriques SAR ont une fauchées <strong>de</strong>ux fois plus faible que les données double<br />
po<strong>la</strong>risations, ce qui réduit par conséqu<strong>en</strong>t le temps <strong>de</strong> revisite. En outre, le mo<strong>de</strong> pleinem<strong>en</strong>t<br />
po<strong>la</strong>rimétrique, n'étant qu'expérim<strong>en</strong>tal, voit son nombre d'acquisition prévue réduit dans le<br />
p<strong>la</strong>n d'observation. Par conséqu<strong>en</strong>t, dans notre étu<strong>de</strong>, nous avons égalem<strong>en</strong>t évalué l'intérêt du<br />
mo<strong>de</strong> Dual Pol hh/hv <strong>de</strong>s données PALSAR qui représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t un point <strong>de</strong> vue réaliste pour le<br />
suivi <strong>de</strong> l'occupation du sol. De plus, nous avons évalué d'autres mo<strong>de</strong>s existant sur différ<strong>en</strong>t<br />
capteur comme vv/hv, hh/vv, mais aussi le mo<strong>de</strong> expérim<strong>en</strong>tal appelé po<strong>la</strong>rimétrie compact<br />
lh/lv. Ce <strong>de</strong>rnier, par l'émission <strong>de</strong> <strong>la</strong> po<strong>la</strong>risation circu<strong>la</strong>ire à pour avantage <strong>de</strong> préserver, a<br />
priori, plus d'information po<strong>la</strong>rimétrique que les autres mo<strong>de</strong>s double po<strong>la</strong>risation évalué. En<br />
outre, il s'agit d'un mo<strong>de</strong> po<strong>la</strong>rimétrique dont l'implém<strong>en</strong>tation dans le contexte <strong>de</strong> <strong>la</strong> mission<br />
BIOMASS <strong>de</strong> l'ESA (SAR <strong>en</strong> ban<strong>de</strong> P) <strong>en</strong> complém<strong>en</strong>t du mo<strong>de</strong> pleinem<strong>en</strong>t po<strong>la</strong>rimétrique<br />
est <strong>en</strong>visagée. Comme dans le cas <strong>de</strong>s données pleinem<strong>en</strong>t po<strong>la</strong>rimétriques, nous avons extrait<br />
différ<strong>en</strong>ts indicateurs re<strong>la</strong>tifs au mo<strong>de</strong> Dual Pol comme les paramètres H/A/α et le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong><br />
cohér<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre les po<strong>la</strong>risations hh et hv.<br />
Dans chacun <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s évalués, nous procédons d'abord par une analyse <strong>de</strong> photointerprétation<br />
<strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts indices pour évaluer le pot<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> chacun. Ensuite, afin <strong>de</strong><br />
généraliser les observations <strong>de</strong> <strong>la</strong> photo-interprétation, nous utilisons <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
c<strong>la</strong>ssification SVM (Support à Vastes Marges). En effet, cette métho<strong>de</strong> est particulièrem<strong>en</strong>t<br />
bi<strong>en</strong> adaptée pour traiter les données non séparables dans l’espace <strong>de</strong>s données grâce à<br />
l'utilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> du noyau. Cet algorithme est plus couramm<strong>en</strong>t appliqué à <strong>de</strong>s<br />
données <strong>de</strong> télédétection hyperspectrale, mais <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s antérieures ont égalem<strong>en</strong>t montré<br />
son aptitu<strong>de</strong> à <strong>de</strong>s données SAR. Des résultats significatifs ont été obt<strong>en</strong>us pour les données<br />
SAR pleinem<strong>en</strong>t po<strong>la</strong>rimétriques car cette algorithme est particulièrem<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> adapté à <strong>la</strong><br />
c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong> données ayant un grand nombre d'indices.<br />
3. Résultats<br />
Les résultats montr<strong>en</strong>t que le mo<strong>de</strong> pleinem<strong>en</strong>t po<strong>la</strong>rimétrique obti<strong>en</strong>t <strong>de</strong> bonne capacité <strong>de</strong><br />
discrimination avec 93% <strong>de</strong> bonne c<strong>la</strong>ssification moy<strong>en</strong>ne. Ces performances sont toutefois<br />
moins bonne pour les c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> végétations <strong>de</strong>nses.<br />
Par ailleurs, les mo<strong>de</strong>s double po<strong>la</strong>risation montre une parte significative <strong>de</strong> performances,<br />
tout particulièrem<strong>en</strong>t sur les c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> végétation <strong>de</strong>nse, avec <strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne 80% <strong>de</strong> bonne<br />
c<strong>la</strong>ssification. Enfin, le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> po<strong>la</strong>rimètre compacte à montrer les meilleures performances<br />
(82%) contrairem<strong>en</strong>t au mo<strong>de</strong> vv/hv. De plus, le mo<strong>de</strong> hh/hv à montré les meilleurs capacités<br />
<strong>de</strong> discrimination <strong>de</strong>s végétations <strong>de</strong>nse parmi les différ<strong>en</strong>ts mo<strong>de</strong>s double po<strong>la</strong>risation.<br />
Finalem<strong>en</strong>t, les mo<strong>de</strong>s hh/hv et <strong>de</strong> po<strong>la</strong>rimétrie compact constitue une bonne alternative au<br />
mo<strong>de</strong> pleinem<strong>en</strong>t po<strong>la</strong>rimétriques lorsqu'une fauchée importante est nécessaire.<br />
Mots clef : po<strong>la</strong>rimétrie, c<strong>la</strong>ssification SVM, stratification forestière<br />
155
É<strong>la</strong>boration et comm<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s cartes <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation mogodi<strong>en</strong>n<br />
Mourad LARIBI<br />
Faculté <strong>de</strong>s Lettres, <strong>de</strong>s Arts et <strong>de</strong>s Humanités <strong>de</strong> Mannouba, marsaf2000@gmail.com<br />
1. Problématique :<br />
La photo-interprétation est <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> cartographie c<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation. Cet outil<br />
peut être remp<strong>la</strong>cé par les images satellitales <strong>de</strong> Google Earth utilisées comme photographies<br />
aéri<strong>en</strong>nes. A quel point ce remp<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t est –il pertin<strong>en</strong>t ?<br />
2. Données <strong>de</strong> base et méthodologie :<br />
La cartographie <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation mogodi<strong>en</strong>ne nécessite l’utilisation <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>tes échelles<br />
selon le besoin. Dans ce poster, on a utilisé une petite échelle <strong>de</strong> 1/250000, conv<strong>en</strong>able à<br />
représ<strong>en</strong>ter l’importante <strong>surface</strong> mogodi<strong>en</strong>ne étudiée dépassant 1250 Km 2 . Cette échelle<br />
permet <strong>de</strong> représ<strong>en</strong>ter <strong>de</strong>s cartes générales <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation concernant les types <strong>de</strong> végétation<br />
et les espèces dominantes, mais pour <strong>la</strong> lisibilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> carte, on est obligé <strong>de</strong> négliger quelques<br />
données physionomiques et floristiques, telles que <strong>la</strong> <strong>de</strong>nsité horizontale, les strates, les<br />
faciès, etc.<br />
La représ<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> ces données exige l’utilisation d’une échelle plus gran<strong>de</strong>, comme<br />
1/60000 qui nous permet d’é<strong>la</strong>borer <strong>de</strong>s cartes physionomiques détaillées <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation<br />
mogodi<strong>en</strong>ne. L’apport <strong>de</strong>s images satellitales réc<strong>en</strong>tes et <strong>de</strong> haute résolution <strong>de</strong> Google Earth<br />
était très important pour <strong>la</strong> délimitation <strong>de</strong>s unités végétales homogènes. Ces images,<br />
utilisées comme photographies aéri<strong>en</strong>nes, nous ont permis <strong>de</strong> remp<strong>la</strong>cer les photographies<br />
aéri<strong>en</strong>nes du ministère <strong>de</strong> l’Agriculture datant <strong>de</strong> 1988 et <strong>de</strong> mauvaise qualité.<br />
Quelque soit l’apport <strong>de</strong> ces images, le relevés <strong>de</strong> terrain et l’utilisation <strong>de</strong>s autres<br />
docum<strong>en</strong>ts cartographiques, pour <strong>la</strong> vérification et <strong>la</strong> comparaison rest<strong>en</strong>t inévitables.<br />
3. Résultats :<br />
L’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> ces cartes, généralisées et détaillées, permet d’analyser<br />
biogéographiquem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> végétation mogodi<strong>en</strong>ne, <strong>de</strong> schématiser <strong>de</strong>s coupes topo-botaniques<br />
et <strong>de</strong> comparer les différ<strong>en</strong>ts secteurs et montagnes.<br />
Mots-clés : Mogodie, cartographie <strong>de</strong> végétation, photo-interprétation Google-Earth,<br />
Bibliographie :<br />
- C<strong>en</strong>tre National <strong>de</strong> <strong>la</strong> Recherche Sci<strong>en</strong>tifique, 1961, Métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> cartographie <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation,<br />
Colloques internationaux du CNRS, Toulouse, 322 p.<br />
- Direction Générale <strong>de</strong>s Forêt, 1990, Objectifs et méthodologie d'inv<strong>en</strong>taire forestier et pastoral national.<br />
Rapport, DGF, Tunisie.<br />
- Laribi M. 2010 : L’espace forestier et l’Homme dans <strong>la</strong> Mogodie. 529 P + ANNEXES.<br />
-UNESCO, 1992, Cartographie intégrée <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t : un outil pour <strong>la</strong> recherche et pour<br />
l’aménagem<strong>en</strong>t. Notes techniques du MAB 16, 55 p + annexes.<br />
156
Dynamique réc<strong>en</strong>te <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation du Moy<strong>en</strong>-At<strong>la</strong>s c<strong>en</strong>tral (Maroc) à<br />
partir <strong>de</strong> photographies aéri<strong>en</strong>nes (1962) et d’images satellites SPOT XS<br />
(2002)<br />
Sébasti<strong>en</strong> LEBAUT 1 , Mohamed LABHAR 2 , Luc MANCEAU 1<br />
1 C<strong>en</strong>tre d’Etu<strong>de</strong>s Géographiques <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Metz, France.<br />
2 Départem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> Géographie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Faculté Dhar El Marhaz <strong>de</strong> l’Université Sidi Mohamed B<strong>en</strong> Ab<strong>de</strong><strong>la</strong>h <strong>de</strong> Fès, Maroc.<br />
lebaut@univ-metz.fr, <strong>la</strong>bhar1@hotmail.com, manceau@univ-metz.fr<br />
1. Problématique :<br />
Les forêts du Maroc sont localisées pour une gran<strong>de</strong> partie dans <strong>la</strong> montagne, espace dont<br />
elles constitu<strong>en</strong>t une <strong>de</strong>s principales composantes naturelles. L’aménagem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s ces<br />
ressources naturelles est re<strong>la</strong>tivem<strong>en</strong>t anci<strong>en</strong> puisqu’il a comm<strong>en</strong>cé au début du 20 ème Siècle,<br />
mais l’approche strictem<strong>en</strong>t conservatrice du patrimoine forestier s’est vue contrariée par <strong>de</strong>s<br />
conditions parfois contraignantes (pression anthropique croissante, aggravé par une<br />
sécheresse qui a marqué les 2 déc<strong>en</strong>nies précé<strong>de</strong>ntes) qui ont <strong>en</strong>traînées <strong>de</strong>s dégradations<br />
irréversibles voir le recul <strong>de</strong>s superficies initiales. Ainsi chaque année le Maroc perd <strong>en</strong>viron<br />
31000 ha <strong>de</strong> forêt.<br />
Les ressources forestières du Moy<strong>en</strong>-At<strong>la</strong>s c<strong>en</strong>tral, patrimoine naturel fragile, s’inscriv<strong>en</strong>t<br />
dans ce schéma national. Dans le cadre d’un développem<strong>en</strong>t durable <strong>de</strong> cette moy<strong>en</strong>ne<br />
montagne marocaine, l’analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynamique réc<strong>en</strong>te (40 <strong>de</strong>rnières années) au regard <strong>de</strong>s<br />
mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s espaces est d’un intérêt majeur. A partir <strong>de</strong> trois secteurs témoins <strong>de</strong><br />
physionomie différ<strong>en</strong>te, <strong>la</strong> cartographie diachronique <strong>de</strong>s formations forestières et préforestières<br />
par <strong>la</strong> télédétection est prés<strong>en</strong>tée et son analyse comm<strong>en</strong>tée <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> l’impact<br />
humain et <strong>de</strong>s caractéristiques écologiques spécifiques à chaque secteur.<br />
2. Données <strong>de</strong> base et méthodologie :<br />
Ces travaux s’appui<strong>en</strong>t sur <strong>de</strong>s photographies aéri<strong>en</strong>nes prises au 1/25000 <strong>en</strong>viron par<br />
l’IGN <strong>en</strong> 1962 et sur <strong>de</strong>s images SPOT XS d’une résolution <strong>de</strong> 10 mètres pour 2002. Les <strong>de</strong>ux<br />
couvertures sont acquises <strong>en</strong> fin <strong>de</strong> « saison sèche », <strong>en</strong> octobre.<br />
Les images satellitaires réc<strong>en</strong>tes ont fait l’objet d’une c<strong>la</strong>ssification supervisée reposant sur<br />
un échantillonnage <strong>de</strong> valeurs seuils dans les canaux et néo-canaux pour établir les c<strong>la</strong>sses<br />
principales <strong>de</strong> végétation. La carte définitive <strong>de</strong>s faciès forestiers et pré-forestiers est obt<strong>en</strong>ue<br />
par un zonage manuel s’appuyant sur <strong>de</strong>s relevés <strong>de</strong> terrains (campagnes GPS et<br />
photographies ori<strong>en</strong>tées). Au final, une dizaine <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sses sont obt<strong>en</strong>ues <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
physionomie d’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation végétale, le recouvrem<strong>en</strong>t globale et l’espèce<br />
dominante.<br />
3. Résultats :<br />
La cartographie <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation <strong>de</strong> 1962 repose sur les photographies IGN numérisées à<br />
600 dpi soit une résolution spatiale <strong>de</strong> 1 mètre <strong>en</strong>viron. En l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> certificat <strong>de</strong> vol<br />
l’étape d’orthorectification s’est avérée délicate ; Néanmoins une RMSE comprise <strong>en</strong>tre 5 et<br />
15 unités pixel r<strong>en</strong>d acceptable <strong>la</strong> comparaison surfacique avec l’image <strong>de</strong> 2002. Les types<br />
d’occupation du sol sont dérivés à partir <strong>de</strong>s mosaïques <strong>de</strong> photographies par un zonage<br />
manuel s’appuyant sur les techniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> photo-interprétation et sur <strong>de</strong>s données exogènes.<br />
Les lég<strong>en</strong><strong>de</strong>s harmonisées <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux cartographies permett<strong>en</strong>t l’analyse diachronique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
végétation.<br />
La confrontation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux cartes sur chacun <strong>de</strong>s secteurs a permis <strong>de</strong> mettre <strong>en</strong> évi<strong>de</strong>nce<br />
une transformation profon<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation tant dans sa répartition spatiale que dans sa<br />
structure. Le trait dominant est une diminution <strong>de</strong>s <strong>surface</strong>s végétalisées (jusqu’à 15% <strong>de</strong><br />
perte dans un secteur) et une matorralisation importante <strong>de</strong>s formations restantes (le matorral<br />
élevé pouvant augm<strong>en</strong>ter <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 50%). Cette régression touche particulièrem<strong>en</strong>t les<br />
cédraies qui ont perdu 37,5% <strong>de</strong> leur <strong>surface</strong>, dans un secteur, <strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>ux dates.<br />
157
Mots clés (5): Maroc, Moy<strong>en</strong>-At<strong>la</strong>s, végétation, étu<strong>de</strong> diachronique, photographie aéri<strong>en</strong>ne<br />
Bibliographie :<br />
-Labhar M., 1998 : Les milieux forestiers et pré-forestiers du Moy<strong>en</strong> At<strong>la</strong>s c<strong>en</strong>tral nord-occi<strong>de</strong>ntal :<br />
approche géographique, phytoécologique et dynamique. Thèse <strong>de</strong> Doctorat d’Etat <strong>en</strong> Géographie. Université<br />
Libre <strong>de</strong> Bruxelles, 404 pages + cartes <strong>en</strong> couleurs <strong>en</strong> annexes. Belgique.<br />
-Labhar M. Lebaut S. et. Manceau L, 2007 : Evolution réc<strong>en</strong>te <strong>de</strong> l’occupation <strong>de</strong>s sols et <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation<br />
dans le bassin Zraa-Tazouta, Moy<strong>en</strong>-At<strong>la</strong>s C<strong>en</strong>tral). In Actes du colloque international : Dynamique <strong>de</strong>s<br />
territoires : <strong>de</strong>s pot<strong>en</strong>tialités au développem<strong>en</strong>t durable. Fès, avril 2007.<br />
-Lecompte M., 1969 : La végétation du Moy<strong>en</strong> At<strong>la</strong>s c<strong>en</strong>tral: esquisse phytoécologique et carte <strong>de</strong>s séries <strong>de</strong><br />
végétation au 1/200000. R.G.M. n° 16 ; pp: 3 - 34. Rabat.<br />
-Nejjari A., Gille E. et François D., 2001 : Les longues séries pluviométriques et <strong>la</strong> caractérisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
sécheresse réc<strong>en</strong>te au nord du Moy<strong>en</strong> At<strong>la</strong>s (MAROC). In Actes du colloque franco-marocain : Eaux et Sociétés<br />
dans les montagnes du Maroc et <strong>de</strong>s pays voisins. MOSELLA T. XXV N° 3 - 4, pp : 37 - 54. Université <strong>de</strong> Metz<br />
France.<br />
L’approche du soectral angel mapper sur les donnees multi- et<br />
hyperspectral pour <strong>la</strong> discrimination <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses d’occupation du sol dans <strong>la</strong><br />
region du Hindukush (Nord du Pakistan)<br />
Syed A<strong>mer</strong> MAHMOOD 1,2 , Veraldo LIESENBERG 2 , Moncef BOUAZIZ 2 , Richard GLOAGUEN 2<br />
1 University of the Punjab, New Campus, Lahore, Pakistan.<br />
2 Technische Universität Bergaka<strong>de</strong>mie Freiberg, Bernhard von Cotta Str. 2, 09599, Freiberg (Sachs<strong>en</strong>), Germany.<br />
E-mail: moncef.bouaziz@gmail.com<br />
Le but <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> est d'évaluer à quel <strong>de</strong>gré les différ<strong>en</strong>tes c<strong>la</strong>sses d’occupation du sol<br />
aussi bi<strong>en</strong> que les caractéristiques <strong>de</strong> géomorphologie peuv<strong>en</strong>t être caractérisées par les<br />
données multi et hyper spectrales dans <strong>la</strong> Région Chitral, Hindukush (nord-ouest du Pakistan).<br />
Nous avons appliqué <strong>la</strong> Transformation du MNF (Minimum Noise fraction) pour l'évaluation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s données et <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong>s erreurs spectrales. La technique du Spectral<br />
Mapping Angel (SAM) est appliqué dans cette étu<strong>de</strong> dans le but d’obt<strong>en</strong>ir une c<strong>la</strong>ssification<br />
plus précise <strong>de</strong> l’occupation du sol dans <strong>la</strong> zone d’étu<strong>de</strong>.<br />
Les données satellitaires <strong>de</strong> notre méthodologie ont été corrigées atmosphériquem<strong>en</strong>t et<br />
géométriquem<strong>en</strong>t. Les différ<strong>en</strong>tes sources <strong>de</strong> données satellitaires utilisées pour atteindre nos<br />
objectifs sont: ASTER/TERRA, SPOT-5, Hyperion/EO-1, ALI/EO-1, TM/Landsat-5,<br />
ETM+/Landsat-7. La sélection <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses a été basée sur l'inspection <strong>de</strong>s cartes géologiques<br />
publiées auparavant et sur le travail <strong>de</strong> terrain dans <strong>la</strong> région d'étu<strong>de</strong> sout<strong>en</strong>u par<br />
l'interprétation visuelle <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> haute résolution spatiale SPOT-5.<br />
Les résultats préliminaires ont montré que les données Hyperion étai<strong>en</strong>t très utiles pour <strong>la</strong><br />
lithologie aussi que l’analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> structure géologique combinée avec les données <strong>de</strong> haute<br />
résolution nous a permis <strong>de</strong> caractériser quelques unités lithologiques principales. D’ailleurs,<br />
les résultats <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong> l’occupation du sol ont été affectés par <strong>la</strong> topographie<br />
acci<strong>de</strong>ntée du terrain qui a beaucoup influ<strong>en</strong>cé les changem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> réflectivité.<br />
158
Détection <strong>de</strong>s changem<strong>en</strong>ts dans les oasis péruvi<strong>en</strong>nes.<br />
Analyse multi <strong>temporelle</strong> à partir <strong>de</strong> l’indice <strong>de</strong> végétation NDVI.<br />
Anaïs MARSHALL ; Frédéric BERTRAND<br />
Départem<strong>en</strong>t Paysage, AgroCampus Ouest-Angers et PRODIG ; PRODIG<br />
anais.marshall@agrocampus-ouest.fr ; fre<strong>de</strong>ric.bertrand@paris-sorbonne.fr<br />
1. Problématique :<br />
Au Pérou, les oasis du piémont côtier connaiss<strong>en</strong>t, <strong>de</strong>puis une vingtaine d’années, <strong>de</strong><br />
profon<strong>de</strong>s mutations paysagères, <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales et sociales. Depuis les années 1990, le<br />
gouvernem<strong>en</strong>t péruvi<strong>en</strong> favorise l’ext<strong>en</strong>sion <strong>de</strong> périmètres irrigués dans les interfluves<br />
désertiques par une politique libérale d’ouverture <strong>de</strong>s marchés économiques et fonciers. La<br />
transformation d’espaces désertiques <strong>en</strong> champs agricoles exige d’importants investissem<strong>en</strong>ts.<br />
Dans un souci <strong>de</strong> r<strong>en</strong>tabilité, les nouveaux domaines agricoles produis<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s cultures à<br />
hautes valeurs ajoutées pour les marchés mondiaux.<br />
Quelles sont les métho<strong>de</strong>s pertin<strong>en</strong>tes pour prés<strong>en</strong>ter, cartographier et quantifier les<br />
dynamiques foncières ? Comm<strong>en</strong>t abor<strong>de</strong>r les terrains d’étu<strong>de</strong> suivant une analyse multi<br />
échelles ?<br />
2. Données <strong>de</strong> base et méthodologie :<br />
Notre objectif est <strong>de</strong> proposer une métho<strong>de</strong> simple à mettre <strong>en</strong> œuvre et peu coûteuse, dont<br />
les résultats sont facilem<strong>en</strong>t interprétables. La disponibilité <strong>de</strong> nombreuses images satellite<br />
gratuites sur Internet permet une analyse régionale multi-<strong>temporelle</strong>. Dans un premier temps,<br />
un état <strong>de</strong>s lieux du couvert végétal est réalisé à partir <strong>de</strong> l’indice <strong>de</strong> végétation NDVI. A<br />
partir d’observations et d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>s, le travail <strong>de</strong> terrain permet <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r et <strong>de</strong> compléter les<br />
résultats du traitem<strong>en</strong>t d’image. L’analyse rétrospective est <strong>en</strong>suite possible à partir <strong>de</strong><br />
l’analyse d’images plus anci<strong>en</strong>nes et <strong>de</strong> témoignages recueillis sur le terrain. Pour chaque<br />
année étudiée, l’indice <strong>de</strong> végétation NDVI est calculé et les résultats sont <strong>en</strong>suite comparés.<br />
Une première interprétation visuelle à l’ai<strong>de</strong> d’une composition colorée <strong>de</strong>s NDVI <strong>de</strong>s<br />
différ<strong>en</strong>tes années permet <strong>de</strong> détecter <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>ts. Une c<strong>la</strong>ssification supervisée<br />
permet <strong>en</strong>suite une quantification <strong>de</strong> ces résultats.<br />
- Ré-échantillonage<br />
- Recadrage<br />
- NDVI : 2005, 2000, 1987<br />
- Composition colorée <strong>de</strong>s NDVI<br />
- C<strong>la</strong>ssification supervisée<br />
Images brutes<br />
2005 – 2000 – 1987<br />
Prétraitem<strong>en</strong>ts<br />
Traitem<strong>en</strong>ts<br />
Résultat<br />
- Carte <strong>de</strong>s dynamiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> couverture végétale <strong>en</strong>tre 1987, 2000 et 2005.<br />
3. Résultats :<br />
La détection <strong>de</strong>s changem<strong>en</strong>ts est réalisée sur <strong>de</strong>s images indiciaires (NDVI) à trois dates<br />
réparties sur 18 années. La composition colorée <strong>de</strong>s NDVI <strong>de</strong>s trois années est c<strong>la</strong>ssifiée. On<br />
159
obti<strong>en</strong>t alors une carte <strong>de</strong>s dynamiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> couverture végétale <strong>en</strong>tre 1987, 2000 et 2005<br />
avec neuf c<strong>la</strong>sses, qui sont <strong>en</strong>suite simplifiés <strong>en</strong> six c<strong>la</strong>sses.<br />
Cette c<strong>la</strong>ssification permet d’exposer les différ<strong>en</strong>ts types d’évolution possibles au cours <strong>de</strong>s<br />
trois pério<strong>de</strong>s étudiées. L’analyse spatiale met <strong>en</strong> avant <strong>de</strong>s espaces où le couvert végétal<br />
régresse et <strong>de</strong>ux types d’espaces où le couvert végétal progresse. Les résultats font ressortir<br />
les différ<strong>en</strong>tes phases d’évolution, avec une accélération <strong>de</strong>s dynamiques <strong>de</strong> couvertures<br />
végétales sur les <strong>de</strong>rnières années. Ensuite, l’analyse est focalisée sur l’évolution observée<br />
<strong>en</strong>tre 2000-2005 pour prés<strong>en</strong>ter les différ<strong>en</strong>ts états végétatifs apparus <strong>en</strong> 2005 tant<br />
anthropiques que naturels.<br />
Mots clés : Détection <strong>de</strong>s changem<strong>en</strong>ts, NDVI, oasis, piémont, Pérou.<br />
Bibliographie :<br />
- Aboudi, A. E., 2001. Cartographie <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation à partir <strong>de</strong> l'analyse <strong>de</strong>s données multidates : télédétection<br />
du changem<strong>en</strong>t. IXe journées du Réseau Télédétection, Yaoundé, Ca<strong>mer</strong>oun.<br />
- Gomez, O. F., 1999. Change <strong>de</strong>tection of vegetation using <strong>la</strong>ndsat imagery. GIS Hydro '99 - GIS and<br />
Hydrology PreConfer<strong>en</strong>ce Seminar, San Diego, California.<br />
- Lee, S.-H., C.-M. Kim, et al., 2002. Ecological Change Detection of Burnt Forest Area using Multitemporal<br />
Landsat TM Data. 22nd Annual ESRI International User Confer<strong>en</strong>ce. July 8–12, 2002.<br />
- Lu, D., et al., 2004. Change <strong>de</strong>tection techniques. International Journal of Remote S<strong>en</strong>sing 25. pp 2365-240.<br />
- Marshall A., 2009. S’approprier le désert. Agriculture mondialisée et dynamiques socio-<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales<br />
sur le piémont côtier du Pérou. Thèse <strong>de</strong> Doctorat, Université <strong>de</strong> Paris1 – Panthéon-Sorbonne. 494 p.<br />
- Pham, T. T. H., F. Bonn, et al. 2007. Démarche méthodologique pour <strong>la</strong> détection <strong>de</strong>s changem<strong>en</strong>ts d'un<br />
milieu morcelé <strong>en</strong> utilisant <strong>de</strong>s images à moy<strong>en</strong>ne résolution spatiale : application à une région littorale au Viêt-<br />
Nam. Télédétection 7 (1-2-3-4). pp 303-323.<br />
Métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fusion d’images par l’égalisation <strong>de</strong>s statistiques locales :<br />
Application aux zones urbaines et péri urbaines<br />
S. MASSOUT, Y. SMARA, S. AGUAGUNA & S. OURABIA<br />
Laboratoire <strong>de</strong> Traitem<strong>en</strong>t d’Images et Rayonnem<strong>en</strong>t, Faculté d’Électronique et d’Informatique<br />
Université <strong>de</strong>s Sci<strong>en</strong>ces et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Technologie Houari Boumedi<strong>en</strong>e<br />
BP 32 El-Alia Bab-Ezzouar 16111 Alger Algérie<br />
af samia@yahoo.com ; yousmara@yahoo.com<br />
Les satellites d’observation <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre emport<strong>en</strong>t à leur bord <strong>de</strong>s capteurs actifs (radar) ou<br />
<strong>de</strong>s capteurs passifs (optique). Les capteurs optiques fourniss<strong>en</strong>t <strong>de</strong>ux types d’images<br />
différ<strong>en</strong>tes. Le premier type est une image monochrome, elle permet une distinction <strong>de</strong>s<br />
structures géométriques <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> résolution spatiale, et le <strong>de</strong>uxième type est image<br />
multispectrale (plusieurs ban<strong>de</strong>s) qui permet une meilleure distinction <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature d’objet<br />
observé. Le rapport <strong>de</strong> résolution <strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>ux types d’images varie d’un satellite à l’un et il<br />
peut être égal à 2 ou 4, comme est le cas pour le satellite SPOT (2) et le satellite QuikBird<br />
(4).<br />
La fusion d’images est une technique qui permet <strong>la</strong> combinaison <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>te<br />
source afin d’avoir <strong>de</strong> nouvelle images plus riche <strong>en</strong> information et ainsi leurs meilleur<br />
exploitation. La fusion d’image <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>te résolution permet <strong>de</strong> synthétiser <strong>de</strong> nouvelle<br />
image à haute résolution spatiale et spectrale. De nombreuses métho<strong>de</strong>s ont été développées<br />
dans ce s<strong>en</strong>s par exemple fusion par l’utilisation <strong>de</strong> IHS, ACP et les on<strong>de</strong>lettes, etc.<br />
Dans cet article, une méthodologie originale <strong>de</strong> fusion est proposée. Elle est basée sur<br />
l’égalisation <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>nes et <strong>de</strong>s variantes locales <strong>de</strong> l’image à Haute Résolution (HR) à<br />
celles du canal à Basses Résolution (BR) à l’ai<strong>de</strong> d’une f<strong>en</strong>être <strong>de</strong> convolution carrée <strong>de</strong><br />
160
<strong>la</strong>rgeur impaire [DON 98]. Cette <strong>de</strong>rnière est calculée <strong>en</strong> exploitant l’équation suivante [COR<br />
03] :<br />
I’ = ((pan-moypan) * vari / varpan) + moyi<br />
Cette formule n’est applicable que si <strong>la</strong> variance locale <strong>de</strong> l’image PAN est non nulle.<br />
L’algorithme effectue une égalisation <strong>de</strong>s histogrammes locaux <strong>de</strong> I’ image à PAN-HR<br />
avec ceux du canal à XS-BR, et les différ<strong>en</strong>ces qui subsist<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>ux images<br />
correspon<strong>de</strong>nt à l’information spatiale intégrée <strong>de</strong> l’image à PAN-HR.<br />
Lorsque <strong>la</strong> f<strong>en</strong>être <strong>de</strong> convolution croit <strong>de</strong> façon importante, on peut considérer que l’égalisation<br />
<strong>de</strong>s paramètres statistiques n’est plus réalisée à l’échelle locale mais plutôt à l’échelle globale, dans ce<br />
cas l’algorithme peut être fortem<strong>en</strong>t simplifié puisque les variances et moy<strong>en</strong>nes ne sont plus <strong>de</strong>s<br />
images mais <strong>de</strong>s sca<strong>la</strong>ires (moy<strong>en</strong>nes et variances <strong>de</strong> l’image <strong>en</strong>tière indép<strong>en</strong>dantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> position).<br />
On parlera alors <strong>de</strong> l’Egalisation <strong>de</strong>s Statistiques Globales (ESG) [COR 03].<br />
La métho<strong>de</strong> développée a été exploitée pour <strong>la</strong> fusion <strong>de</strong>s images panchromatique et<br />
multispectrales issues <strong>de</strong> capteur HRV <strong>de</strong> satellite SPOT représ<strong>en</strong>tant <strong>la</strong> région d’Alger et celles du<br />
satellite IKONOS 2 représ<strong>en</strong>tant une zone <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Barcelone <strong>en</strong> Espagne.. Les résultats<br />
obt<strong>en</strong>us ont été évalués <strong>de</strong> manière qualitative <strong>en</strong> utilisant <strong>la</strong> composition colorée et <strong>de</strong> manière<br />
quantitative <strong>en</strong> utilisant les paramètres statistiques.<br />
Les résultats obt<strong>en</strong>us pour les <strong>de</strong>ux zones d’Alger et <strong>de</strong> Barcelone sont représ<strong>en</strong>tés sur <strong>de</strong>s<br />
zooms afin <strong>de</strong> mieux appréh<strong>en</strong><strong>de</strong>r <strong>de</strong> manière visuelle l’amélioration effectuée par chaque<br />
algorithme :<br />
161