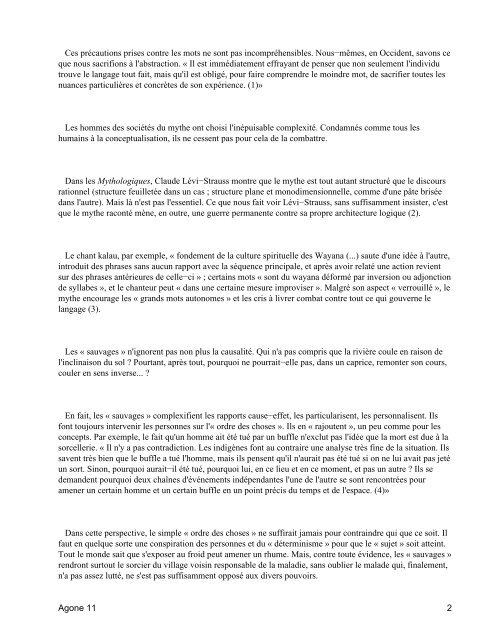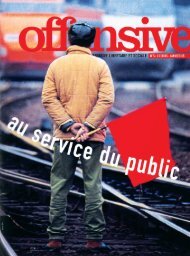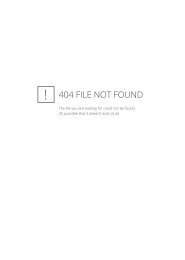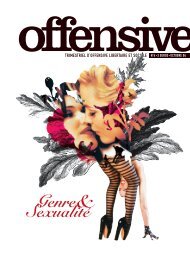You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ces précautions prises contre les mots ne sont pas incompréhensibles. Nous−mêmes, en Occident, savons ce<br />
que nous sacrifions à l'abstraction. « Il est immédiatement effrayant de penser que non seulement l'individu<br />
trouve le langage tout fait, mais qu'il est obligé, pour faire comprendre le moindre mot, de sacrifier toutes les<br />
nuances particulières et concrètes de son expérience. (1)»<br />
Les hommes des sociétés du mythe ont choisi l'inépuisable complexité. Condamnés comme tous les<br />
humains à la conceptualisation, ils ne cessent pas pour cela de la combattre.<br />
Dans les Mythologiques, Claude Lévi−Strauss montre que le mythe est tout autant structuré que le discours<br />
rationnel (structure feuilletée dans un cas ; structure plane et monodimensionnelle, comme d'une pâte brisée<br />
dans l'autre). Mais là n'est pas l'essentiel. Ce que nous fait voir Lévi−Strauss, sans suffisamment insister, c'est<br />
que le mythe raconté mène, en outre, une guerre permanente contre sa propre architecture logique (2).<br />
Le chant kalau, par exemple, « fondement de la culture spirituelle des Wayana (...) saute d'une idée à l'autre,<br />
introduit des phrases sans aucun rapport avec la séquence principale, et après avoir relaté une action revient<br />
sur des phrases antérieures de celle−ci » ; certains mots « sont du wayana déformé par inversion ou adjonction<br />
de syllabes », et le chanteur peut « dans une certaine mesure improviser ». Malgré son aspect « verrouillé », le<br />
mythe encourage les « grands mots autonomes » et les cris à livrer combat contre tout ce qui gouverne le<br />
langage (3).<br />
Les « sauvages » n'ignorent pas non plus la causalité. Qui n'a pas compris que la rivière coule en raison de<br />
l'inclinaison du sol ? Pourtant, après tout, pourquoi ne pourrait−elle pas, dans un caprice, remonter son cours,<br />
couler en sens inverse... ?<br />
En fait, les « sauvages » complexifient les rapports cause−effet, les particularisent, les personnalisent. Ils<br />
font toujours intervenir les personnes sur l'« ordre des choses ». Ils en « rajoutent », un peu comme pour les<br />
concepts. Par exemple, le fait qu'un homme ait été tué par un buffle n'exclut pas l'idée que la mort est due à la<br />
sorcellerie. « Il n'y a pas contradiction. Les indigènes font au contraire une analyse très fine de la situation. Ils<br />
savent très bien que le buffle a tué l'homme, mais ils pensent qu'il n'aurait pas été tué si on ne lui avait pas jeté<br />
un sort. Sinon, pourquoi aurait−il été tué, pourquoi lui, en ce lieu et en ce moment, et pas un autre ? Ils se<br />
demandent pourquoi deux chaînes d'événements indépendantes l'une de l'autre se sont rencontrées pour<br />
amener un certain homme et un certain buffle en un point précis du temps et de l'espace. (4)»<br />
Dans cette perspective, le simple « ordre des choses » ne suffirait jamais pour contraindre qui que ce soit. Il<br />
faut en quelque sorte une conspiration des personnes et du « déterminisme » pour que le « sujet » soit atteint.<br />
Tout le monde sait que s'exposer au froid peut amener un rhume. Mais, contre toute évidence, les « sauvages »<br />
rendront surtout le sorcier du village voisin responsable de la maladie, sans oublier le malade qui, finalement,<br />
n'a pas assez lutté, ne s'est pas suffisamment opposé aux divers pouvoirs.<br />
<strong>Agone</strong> <strong>11</strong> 2