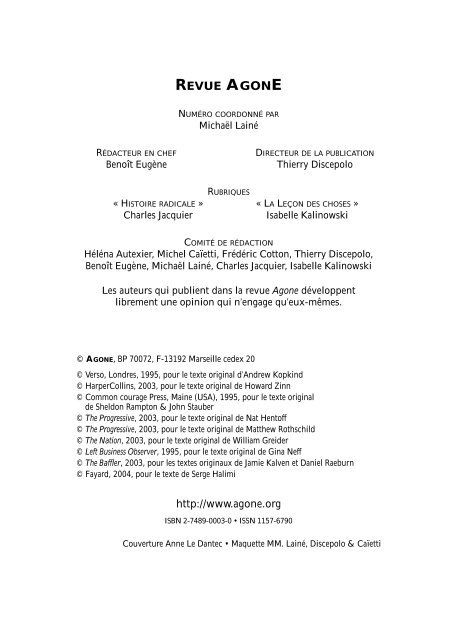You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REVUE AGONE<br />
NUMÉRO COORDONNÉ PAR<br />
Michaël Lainé<br />
RÉDACTEUR EN CHEF DIRECTEUR DE LA PUBLICATION<br />
Benoît Eugène Thierry Discepolo<br />
RUBRIQUES<br />
« HISTOIRE RADICALE » « LA LEÇON DES CHOSES »<br />
Charles Jacquier Isabelle Kalinowski<br />
COMITÉ DE RÉDACTION<br />
Héléna Autexier, Michel Caïetti, Frédéric Cotton, Thierry Discepolo,<br />
Benoît Eugène, Michaël Lainé, Charles Jacquier, Isabelle Kalinowski<br />
Les auteurs qui publient dans la revue <strong>Agone</strong> développent<br />
librement une opinion qui n’engage qu’eux-mêmes.<br />
© AGONE, BP 70072, F-1<strong>31</strong>92 Marseille cedex 20<br />
© Verso, Londres, 1995, pour le texte original d’Andrew Kopkind<br />
© HarperCollins, 2003, pour le texte original de Howard Zinn<br />
© Common courage Press, Maine (USA), 1995, pour le texte original<br />
de Sheldon Rampton & John Stauber<br />
© The Progressive, 2003, pour le texte original de Nat Hentoff<br />
© The Progressive, 2003, pour le texte original de Matthew Rothschild<br />
© The Nation, 2003, pour le texte original de William Greider<br />
© Left Business Observer, 1995, pour le texte original de Gina Neff<br />
© The Baffler, 2003, pour les textes originaux de Jamie Kalven et Daniel Raeburn<br />
© Fayard, 2004, pour le texte de Serge Halimi<br />
http://www.agone.org<br />
ISBN 2-7489-0003-0 • ISSN 1157-6790<br />
Couverture Anne Le Dantec • Maquette MM. Lainé, Discepolo & Caïetti
AGONE<br />
Histoire, Politique & Sociologie<br />
numéro <strong>31</strong>/<strong>32</strong>, 2004<br />
7. Liberté d’expression. Le Premier Amendement en question<br />
Howard Zinn<br />
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton<br />
Le Premier Amendement avait été adopté en 1791 et intégré à la<br />
Déclaration des droits afin de répondre aux critiques adressées à la<br />
Constitution au moment de sa ratification par l’opinion publique. On promit<br />
alors qu’à la mise en place du premier gouvernement une Déclaration<br />
des droits accompagnerait la Constitution, et c’est ce qui fut fait. Depuis<br />
lors, cette Déclaration est célébrée comme le fondement même de nos libertés.<br />
Pourtant, comme je vais tenter de le montrer maintenant, penser que<br />
la seule existence du Premier Amendement garantit notre liberté d’expression<br />
est une profonde erreur. Une erreur qui peut, parfois, nous coûter non<br />
seulement la liberté mais également, dans certaines circonstances, la vie.<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (I)<br />
Textes traduits de l’anglais par Michaël Lainé<br />
28. Big government is watching, Nat Hentoff<br />
30. Militarisme messianique, Matthew Rothschild<br />
37. Refouler le XX e siècle, William Greider<br />
53. La parenthèse populiste. Comment la gauche abandonne le peuple<br />
Serge Halimi<br />
Des ménagères antiféministes qui, par peur d’un monde qu’elles ne comprennent<br />
plus, se raccrochent désespérément à la famille traditionnelle ;<br />
des ouvriers et des employés blancs qui n’apprécient pas les leçons de tolérance<br />
raciale que leur donnent des privilégiés. Au total, des millions d’individus<br />
obscurs « qui souffrent et qui confondent ceux qui souffrent<br />
comme eux avec ceux qui les tourmentent » ont déserté les rangs d’une
4<br />
gauche qui paraît les avoir abandonnés, et avec eux l’idée de bien commun.<br />
Quiconque cherche à expliquer l’essor du conservatisme américain ne peut<br />
que buter sur ce changement de camp d’une fraction des catégories populaires.<br />
L’explication vaudra pour d’autres pays, dont la France. Ceux qui<br />
sont en colère se trompent parfois de colère.<br />
75. Racisme blanc en col bleu, Andrew Kopkind<br />
Traduit de l’anglais par Michaël Lainé<br />
Les tentatives des militants syndicaux visant à former des groupes politiques<br />
en dehors du parti démocrate – ou de s’opposer aux positions<br />
orthodoxes – sont rapidement étouffées. Un responsable syndical rapporte<br />
: « Le sommet craint en fait la naissance d’une nouvelle organisation.<br />
Ils ont peur que les membres votent “mal”. » Les coups de sabre des<br />
centrales en direction des initiatives politiques indépendantes sont<br />
effroyables et rapides : quand une organisation non affiliée au parti, fondée<br />
pour faire campagne pour le non lors d’un référendum sur le droit au<br />
travail en Ohio, essaya de poursuivre sur cette voie victorieuse dans le<br />
domaine électoral, les dirigeants syndicaux nationaux et locaux coupèrent<br />
tout soutien. Ainsi fut tuée dans l’œuf la force politique la plus prometteuse<br />
qu’ait connue l’Ohio pendant toute une génération.<br />
85. Stratégies des multinationales & ripostes ouvrières aux États-Unis<br />
Marianne Debouzy<br />
Après la Seconde Guerre mondiale, les multinationales apparaissaient<br />
comme le fer de lance de la nation américaine et le plus sûr garant de sa<br />
prospérité. Tel était bien le sens de la formule du PDG de l’industrie automobile<br />
devenu ministre de la Défense : « Ce qui est bon pour General<br />
Motors est bon pour l’Amérique. » Qui, dans la classe ouvrière, prendrait<br />
aujourd’hui au sérieux cette affirmation ? Pour avoir subi licenciements<br />
massifs, dislocations et déclassements en tous genres, les ouvriers ont de<br />
quoi être sceptiques quant au souci qu’auraient les multinationales du bien<br />
commun. Mais ont-ils les moyens de les combattre ? Car si les travailleurs<br />
américains sont capables de mener des luttes dures, elles n’impliquent<br />
qu’un nombre limité d’ouvriers et restent presque toujours locales. Et il est<br />
rare qu’elle devienne un mouvement social politiquement significatif.<br />
105. Le contrôle de la société civile, Sheldon Rampton & John Stauber<br />
Traduit de l’anglais par Yves Coleman<br />
L’EXEMPLE AMÉRICAIN<br />
La dégradation du milieu politique a créé un vaste éventail de possibilités<br />
pour l’industrie des relations publiques. Au fur et à mesure que les citoyens
SOMMAIRE 5<br />
s’éloignent avec dégoût du processus politique, les agences-conseil prennent<br />
leur place et inversent le sens de la « politique citoyenne ». Ils créent<br />
ainsi, ex nihilo, en fonction des besoins de leurs clients, des « associations<br />
de base » qui servent les intérêts des élites. Le terme de « lobbying synthétique<br />
» désigne les associations écran qui peuvent désormais être créées<br />
sur mesure. Le magazine Campaigns & Elections définit « la démocratie synthétique<br />
» comme un « système où l’on crée artificiellement un courant<br />
d’opinion favorable à un point de vue donné. L’objectif étant soit d’imposer<br />
ce point de vue à des militants non informés, soit de diffuser des techniques<br />
de manipulation servant à les recruter ».<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
Textes traduit de l’anglais par Frédéric Cotton & Benoît Eugène<br />
124. Sous la culture des fondations, Gina Neff<br />
1<strong>32</strong>. Points de vue de la rue, Jamie Kalven<br />
141. In memoriam Henry Louis Mencken, Daniel Raeburn<br />
155. Le populisme de marché, Thomas Frank<br />
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton<br />
Si la Nouvelle Économie a pu nous hypnotiser pendant un temps, il est<br />
maintenant évident qu’il n’existe pas sur cette terre de théorie sociale,<br />
exceptée celle du droit divin des monarques, qui puisse justifier l’écart<br />
phénoménal entre les salaires des dirigeants et ceux des travailleurs (plus<br />
de 500 fois). Selon les gourous, le marché est capable de résoudre seul<br />
tous les conflits sociaux – avec justice et équité. Et pourtant, ce dont nous<br />
avons désespérément besoin pour restaurer le sens de la justice et de<br />
l’équité en économie, c’est bien d’une force qui soit capable de s’opposer<br />
aux marchés, de refuser de se penser en termes de Marque. Une force qui<br />
ne se contente pas de partir en quête d’authenticité. En effet, au bout du<br />
compte, il importera fort peu à celui qui paiera l’addition de la « révolution<br />
entrepreneuriale » que le type qui le licenciera porte un costume bien<br />
coupé ou arbore un piercing à la narine.<br />
177. La « réforme » de l’aide sociale comme instrument de discipline<br />
Loïc Wacquant<br />
Le but de la « réforme » des aides sociales – discipliner les pauvres – est<br />
conforme à l’histoire de l’assistance aux États-Unis sur la longue durée<br />
comme à celle de la prison à sa naissance. Il ne doit cependant pas masquer<br />
la fonction que la transition du « welfare state » au « workfare state »<br />
remplit à l’égard des Américains plus fortunés : la mutation punitive de la
6<br />
politique sociale signifie sans équivoque que nul ne saurait se soustraire au<br />
salariat sans encourir une véritable dégradation matérielle et symbolique.<br />
Jeter les pauvres en pâture permet de réaffirmer avec éclat le primat idéologique<br />
de l’individualisme méritocratique au moment où la généralisation<br />
de l’insécurité salariale frappe de plein fouet les classes moyennes salariées<br />
et managériales et menace d’ébranler durablement la croyance pratique<br />
dans le mythe national du « rêve américain ».<br />
LA LEÇON DES CHOSES<br />
197. Les effets délétères des « réformes » universitaires,<br />
Christophe Gaubert<br />
209. Les fondements économiques de « l’impérialisme », Max Weber<br />
Traduit de l’allemand et présenté par Isabelle Kalinowski & Reinhard Gresse<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
221. Empire & ses pièges. Toni Negri et la déconcertante trajectoire<br />
de l’opéraïsme italien, Claudio Albertani<br />
Traduit de l’espagnol par Miguel Chueca<br />
259. MARCEL MARTINET, CONTRE LE COURANT<br />
Dossier présenté par Charles Jacquier<br />
263. Civilisation française en Indochine<br />
273. Vous avez cessé d’être « l’un contre tous ».<br />
Lettre ouverte à Romain Rolland<br />
279. Le 30 juin de Staline. Qu’avez-vous fait de la<br />
révolution d’Octobre ?<br />
L’EXEMPLE AMÉRICAIN
HOWARD ZINN 7<br />
Liberté d’expression<br />
Le Premier Amendement en question<br />
TOUS CEUX QUI GRANDISSENT AUX ÉTATS-UNIS apprennent que ce pays<br />
a le bonheur infini de jouir de la liberté d’expression. Et nous<br />
devons cette chance au fait que notre Constitution contient une<br />
Déclaration des droits dont le premier amendement s’ouvre sur cette<br />
affirmation décisive : « Le Congrès ne fera aucune loi relativement à l’établissement<br />
d’une religion ou en interdisant le libre exercice ; ou restreignant<br />
la liberté de parole ou de la presse ; ou le droit du peuple de<br />
s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement<br />
pour une réparation de ses torts. »<br />
L’idée selon laquelle le Premier Amendement garantit effectivement<br />
notre liberté d’expression est un élément de l’idéologie de notre société.<br />
D’ailleurs la foi dans les serments écrits noir sur blanc et l’aveuglement à<br />
l’égard des réalités politiques et économiques semblent profondément<br />
ancrées dans cet ensemble de croyances propagé par les faiseurs d’opinion<br />
américains. La ferveur quasi religieuse qui s’exprima à l’occasion de<br />
l’année du bicentenaire de l’élaboration de la Constitution en a livré<br />
suffisamment de témoignages.<br />
En 1987, que ce soit dans les journaux, à la télévision, à la radio, en<br />
chaire, sur les estrades des salles de classe, au Congrès ou à la Maison-<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 7-26
8<br />
LE PREMIER AMENDEMENT EN QUESTION<br />
Blanche, on n’a cessé de chanter les louanges de ce document rédigé par<br />
les Pères fondateurs. Le magazine Parade, dont les lecteurs se comptent<br />
par millions, publia un court texte du président Reagan dans lequel on<br />
pouvait lire : « Je ne peux m’empêcher de m’émerveiller du génie des<br />
Pères fondateurs. […] Ils ont inventé – avec une sûreté de jugement et<br />
une inventivité si grandes qu’il m’est impossible de ne pas y deviner la<br />
volonté divine – le premier système politique à affirmer que le pouvoir<br />
émane du peuple et s’impose à l’État et non l’inverse. »<br />
Cette même année, les journaux publiaient des encarts publicitaires<br />
émanant de la Commission officielle du bicentenaire qui vantaient les<br />
mérites de la « Coupe de la Constitution » faite « du plus fin ivoire de<br />
Chine » représentant les blasons officiels des treize États originels et sertie<br />
« d’or pur de 24 carats. […] Un chef-d’œuvre digne de l’occasion ».<br />
On pouvait se la procurer pour 95 dollars. Une jolie coupe assurément,<br />
et si parfaitement représentative de la Constitution elle-même : élégante<br />
mais vide et susceptible de contenir le pire comme le meilleur, selon la<br />
personnalité de celui qui a le pouvoir et les moyens de la remplir.<br />
C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé avec le Premier Amendement. Ce<br />
dernier avait été adopté en 1791 et intégré à la Déclaration des droits afin<br />
de répondre aux critiques adressées à la Constitution au moment de sa<br />
présentation pour ratification à l’opinion publique. Il fallait l’accord d’au<br />
moins neuf des treize États originels pour permettre cette ratification et<br />
la Constitution fut acceptée à une très courte majorité par trois des États<br />
les plus importants : la Virginie, le Massachusetts et New York. On<br />
promit alors qu’à la mise en place du premier gouvernement une<br />
Déclaration des droits accompagnerait la Constitution et c’est ce qui fut<br />
fait. Depuis lors, cette Déclaration est célébrée comme le fondement<br />
même de nos libertés.<br />
Pourtant, comme je vais tenter de le montrer maintenant, penser que<br />
la seule existence du Premier Amendement garantit notre liberté d’expression<br />
est une profonde erreur. Une erreur qui peut, parfois, nous coûter<br />
non seulement la liberté mais également, dans certaines<br />
circonstances, la vie.
HOWARD ZINN 9<br />
« SANS CONTRAINTE PRÉALABLE »<br />
Le texte du Premier Amendement semble décisif. « Le Congrès ne fera<br />
aucune loi […] restreignant la liberté de parole. » Pourtant, en 1798,<br />
sept ans à peine après son adoption, c’est exactement ce que fit le<br />
Congrès. Il vota des lois limitant la liberté de parole : les Alien et<br />
Sedition Acts.<br />
L’Alien Act conférait au président le pouvoir d’expulser « tout individu<br />
étranger qu’il jugera dangereux pour la paix et la sécurité des États-Unis ».<br />
Quant au Sedition Act, il prévoyait que « quiconque écrira, imprimera,<br />
exprimera ou diffusera […] un texte mensonger, scandaleux ou perfide,<br />
ou des écrits contre le gouvernement, le Congrès ou le président des<br />
États-Unis, dans l’intention de les diffamer […] ou d’intenter à leur réputation<br />
et au respect qui leur est dû » pourra se voir condamner à payer<br />
une amende de deux mille dollars ou à deux ans d’emprisonnement.<br />
La Révolution française avait eu lieu neuf ans auparavant et la jeune<br />
nation américaine, qui en était à cette époque à son deuxième président,<br />
le conservateur John Adams, n’était plus aussi favorable aux idées révolutionnaires<br />
qu’elle avait pu l’être en 1776. Une fois parvenus au pouvoir,<br />
les révolutionnaires semblent en effet perdre tout goût pour la révolution.<br />
Les Français immigrés aux États-Unis étaient soupçonnés d’être favorables<br />
à la révolution qui se déroulait en France et de propager les idées<br />
révolutionnaires en Amérique. La peur inspirée par ces Français (qui,<br />
pour la plupart, avaient pourtant fui la révolution) tourna à l’hystérie. La<br />
Gazette of the United States accusait les précepteurs français de corrompre<br />
la jeunesse américaine, « pour lui faire boire, à la mamelle, le poison de<br />
l’athéisme et du mécontentement ». 1<br />
La Porcupine’s Gazette affirmait de son côté que le pays grouillait<br />
« d’apôtres français de la sédition en assez grand nombre […] pour<br />
incendier nos villes et en égorger tous les habitants ».<br />
De leur côté, les révolutionnaires irlandais, qui poursuivaient leur<br />
éternel combat contre les Anglais, bénéficaient de quelques soutiens aux<br />
États-Unis. On aurait pu penser que les Américains, tout juste libérés de<br />
1. La plupart de mes données sur l’Alien Act et le Sedition Act ainsi que les<br />
vives critiques dont ils font ici l’objet me viennent de John C. Miller, Crisis in<br />
Freedom, Atlantic Little-Brown, 1952.
10<br />
LE PREMIER AMENDEMENT EN QUESTION<br />
la tutelle anglaise, éprouveraient de la sympathie pour ces rebelles. Au<br />
lieu de cela, le gouvernement de John Adams considéra les Irlandais<br />
comme des fauteurs de troubles à la fois en Europe et aux États-Unis.<br />
Le politicien Harrison Gray Otis déclara pour sa part qu’il « ne<br />
souhaitait pas plus convier les hordes d’Irlandais sauvages que tous les<br />
autres semeurs de troubles et apôtres du désordre du monde entier à<br />
venir saper notre tranquillité après avoir renversé leurs propres gouvernements<br />
». Il redoutait que les nouveaux immigrants et leurs idées politiques<br />
« ne commencent, à peine débarqués aux États-Unis, à s’en<br />
prendre au gouvernement et n’en appellent à un état plus parfait de la<br />
société » 2 .<br />
Le parti fédéraliste de John Adams et le parti républicain de Thomas<br />
Jefferson s’affrontaient. Nous étions là à l’origine du système bipartisan.<br />
Leur désaccord remontait à l’adoption de la Constitution et de la<br />
Déclaration des droits ainsi qu’aux luttes qui avaient eu lieu au Congrès<br />
autour du programme économique de Hamilton. Les tensions de la vie<br />
politique intérieure étaient en outre exacerbées par l’épidémie de fièvre<br />
jaune qui frappait alors le pays et les émeutes qui mobilisaient nombre<br />
de citoyens mécontents.<br />
Jefferson, ancien ministre délégué des États-Unis en France, soutenait<br />
la Révolution française alors qu’Adams y était hostile. Le président<br />
Adams était clairement du côté des Anglais dans le conflit qui débutait<br />
entre la France et l’Angleterre à cette époque, et un historien a pu considérer<br />
le Sedition Act comme une « mesure de sécurité intérieure adoptée<br />
pendant la guerre larvée qui opposait l’Amérique et la France 3 ».<br />
La presse républicaine critiquait durement le gouvernement Adams.<br />
Le journal Aurora de Philadelphie (dirigé par Benjamin Bache, petit-fils<br />
de Benjamin Franklin), accusa le Président de pratiquer le népotisme, de<br />
dilapider l’argent public, de souhaiter l’institution d’une monarchie et de<br />
vouloir la guerre. Avant même que le Sedition Act ne fût voté, Bache avait<br />
été arrêté au nom de la common law et accusé de diffamation à l’encontre<br />
de la présidence, d’incitation à la sédition et à la désobéissance aux lois.<br />
2. Lire Leonard Levy, Freedom of Speech and Press in Early American History,<br />
Harper and Row, 1963.<br />
3. James Morton Smith, « Political Suppression of Seditious Criticism : A<br />
Connecticut Case Study », The Historian.
HOWARD ZINN 11<br />
L’adoption du Sedition Act fut l’occasion de dénoncer ceux qui critiquaient<br />
le gouvernement. Un membre du Congrès informa ses collègues<br />
que « les philosophes [étaient] les avant-coureurs de la Révolution. Ils<br />
[…]ouvrent la voie en prêchant la trahison et en sapant le respect populaire<br />
vis-à-vis de nos antiques institutions. Ils invoquent la perfectibilité<br />
de l’homme, la dignité de la nature humaine et, négligeant ce qu’il est<br />
effectivement, débattent interminablement de ce qu’il devrait être 4 ». Le<br />
passage sur ce que l’homme « est effectivement » pourrait sortir tout<br />
droit de l’œuvre de Machiavel.<br />
L’atmosphère qui régnait à l’époque à la Chambre des représentants<br />
manquait singulièrement de dignité. Un congressiste du Vermont,<br />
l’Irlandais Matthew Lyon, se battit avec Griswold, du Connecticut. Lyon<br />
avait craché à la figure de Griswold, lequel répliqua à coups de canne<br />
avant que Lyon ne lui tombât dessus avec un tisonnier et qu’ils ne roulassent<br />
tous deux à terre. Les autres congressistes, s’étant d’abord contentés<br />
d’observer la scène, se décidèrent finalement à les séparer. Un<br />
Bostonien s’emporta contre Lyon : « Je suis outré que la salive d’un<br />
Irlandais ait pu souiller le visage d’un Américain. 5 »<br />
Lyon avait écrit un article dans lequel il affirmait que, sous la présidence<br />
d’Adams, « le bien-être de la population passait après la quête<br />
incessante de pouvoirs, l’instauration de cérémonies d’une pomposité<br />
ridicule, l’adulation délirante et la cupidité égoïste ». Accusé d’avoir violé<br />
le Sedition Act, Lyon fut condamné et passa quatre mois en prison.<br />
On emprisonna peu de gens au nom du Sedition Act – dix en tout –<br />
mais, par nature, les lois répressives n’ont pas besoin d’être appliquées à<br />
un grand nombre de personnes pour créer une atmosphère dans laquelle<br />
les esprits potentiellement critiques à l’égard du gouvernement hésitent<br />
à s’exprimer.<br />
Tout individu doté d’une intelligence normale pourrait penser, à la<br />
simple lecture du Premier Amendement (« Le Congrès ne fera aucune<br />
loi […] restreignant la liberté de parole ou de la presse »), que le<br />
Sedition Act violait clairement la Constitution. Mais c’est là, justement,<br />
qu’apparaît le premier indice de l’inanité de mots couchés sur le papier<br />
quand il s’agit de garantir les droits des citoyens. Ces mots, aussi puissants<br />
qu’ils puissent paraître, sont interprétés par les hommes de loi et<br />
4. Miller, Crisis in Freedom, op. cit.<br />
5. Ibid.
12<br />
LE PREMIER AMENDEMENT EN QUESTION<br />
les juges dans le cadre d’un monde politique fondé sur les rapports de<br />
forces où dissidents et rebelles ne sont pas bienvenus. Et c’est exactement<br />
ce qui se produisit dès le début de l’histoire américaine. Le<br />
Sedition Act entra en collision avec le Premier Amendement et celui-ci<br />
s’avéra une bien piètre protection 6 .<br />
Les membres de la Cour suprême, siégeant en tant que simples juges<br />
de district (le nouveau gouvernement n’avait pas assez d’argent pour<br />
mettre sur pied le niveau intermédiaire de cours d’appel tel que nous le<br />
connaissons aujourd’hui) condamnèrent systématiquement tous ceux<br />
qui étaient accusés d’avoir enfreint le Sedition Act. Ils le faisaient en se<br />
fondant sur la common law anglaise. Le président de la Cour suprême,<br />
Oliver Ellsworth, déclara dans l’une de ses décisions de 1799 : « La loi<br />
commune de ce pays reste ce qu’elle était avant la Révolution. 7 »<br />
Ce fait mérite qu’on s’y arrête un peu. La loi commune anglaise ?<br />
Mais n’avions-nous pas combattu contre l’Angleterre pour imposer une<br />
révolution ? Restions-nous sous la juridiction de la loi commune<br />
anglaise ? La réponse est oui. Il semble bien qu’il y ait des limites aux<br />
révolutions et qu’elles tiennent plus au passé que ne le croient leurs<br />
adeptes les plus fervents. La loi commune anglaise concernant la liberté<br />
d’expression est explicitée dans les quatre volumes des Commentaries de<br />
Blackstone consacrés à ce sujet. Selon Blackstone, « la liberté de la presse<br />
est bien évidemment essentielle à la nature d’un État libre, mais cela<br />
consiste surtout à ne pas imposer de contrainte préalable aux publications<br />
et non à interdire toute censure à l’encontre des propos criminels<br />
lorsqu’ils sont rendus publics. Tout homme libre jouit du droit indiscutable<br />
d’exprimer les opinions qu’il désire en public. Interdire cela c’est<br />
détruire la liberté de la presse. Mais s’il publie des propos incorrects, préjudiciables<br />
ou illégaux, il doit assumer les conséquences de sa propre<br />
témérité 8 ».<br />
Nous sommes là devant l’astucieuse doctrine dite de la « contrainte<br />
non préalable ». Vous pouvez dire et imprimer ce qu’il vous chante. Le<br />
gouvernement ne peut pas vous en empêcher par avance. Mais quand<br />
6. Pour l’analyse des premières interprétations du Premier Amendement, lire<br />
Levy, Freedom of Speech and Press, op. cit.<br />
7. Ibid.<br />
8. William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, vol. IV, Beacon<br />
Press, 1962.
HOWARD ZINN 13<br />
vous aurez exprimé oralement ou publié votre opinion, si le gouvernement<br />
décide de juger certains de vos propos « illégaux », ou de les qualifier<br />
de « préjudiciables », voire simplement d’« incorrects », il peut<br />
vous expédier en prison.<br />
Un citoyen ordinaire, même peu versé dans les questions juridiques,<br />
pourrait rétorquer : « Vous dites que vous ne m’empêcherez pas d’exprimer<br />
mon opinion – pas de contrainte préalable donc. Mais si je sais<br />
que cela risque de me causer des ennuis et qu’en conséquence je reste<br />
silencieux, ne s’agit-il pas tout de même d’une “contrainte préalable” ? »<br />
Quoi qu’il en soit, il est vain de répondre à la loi commune armé du seul<br />
sens commun.<br />
Cette interprétation quasi immédiate du Premier Amendement qui<br />
limite son application à l’absence de « contrainte préalable » vaut encore<br />
aujourd’hui. C’est celle qu’avança, en 1971, l’administration Nixon pour<br />
tenter de faire interdire par la Cour suprême la publication dans le New<br />
York Times des Pentagon Papers (histoire officielle mais secrète de la<br />
guerre américaine au Vietnam) 9 .<br />
La Cour refusa d’interdire la publication de ces documents. Mais l’un<br />
des juges prévint, menaçant, que cette décision se fondait sur l’absence<br />
de contrainte préalable. Pourtant, si le Times s’obstinait et publiait finalement<br />
ces documents, il risquait d’être poursuivi.<br />
C’est ainsi que, selon la doctrine de l’absence de contrainte préalable,<br />
le droit garanti par le Premier Amendement se trouva dès l’origine sérieusement<br />
limité. Les Pères fondateurs, qu’ils fussent libéraux ou conservateurs,<br />
fédéralistes ou républicains – de Washington à Hamilton et de<br />
Jefferson à Madison –, pensaient que les propos séditieux étaient intolérables<br />
et que tout ce que nous pouvions attendre de la liberté de parole<br />
c’est qu’elle ne souffre aucune contrainte préalable 10 .<br />
9. New York Times vs U.S., 1971.<br />
10. Remarquons que lorsque Thomas Jefferson devint président en 1801,<br />
même si le Sedition Act n’était plus de mise, des poursuites contre les critiques<br />
antigouvernementales au titre des propos séditieux continuèrent.<br />
Jefferson avait répondu à Madison en 1788 qu’il admettait l’interprétation de<br />
la liberté de parole sous les restrictions apportées par la loi commune comme<br />
consistant essentiellement dans l’absence de contrainte préalable. Il ajouta<br />
que les individus devraient répondre juridiquement du fait de tenir des « allégations<br />
mensongères ». Pour une analyse de l’attitude de Jefferson vis-à-vis
14<br />
LE PREMIER AMENDEMENT EN QUESTION<br />
« C’est déjà ça », pourrait soupirer un adepte optimiste du Premier<br />
Amendement : au moins ne peuvent-ils pas attenter par avance à la liberté<br />
d’expression. Pourtant, cet optimisme est lui aussi totalement injustifié.<br />
Prenons le cas du livre intitulé The C.I.A. and the Cult of Intelligence, coécrit<br />
par Victor Marchetti, ancien agent de la CIA, et le journaliste John<br />
Marks. Ce livre dévoilait un certain nombre d’opérations de la CIA qui ne<br />
semblaient ni servir les intérêts démocratiques ni employer des méthodes<br />
dont un Américain pourrait être fier. La CIA demanda à la justice d’interdire<br />
la publication de ce livre ou, à tout le moins, que l’on fasse retirer<br />
225 passages supposés menacer la « sécurité nationale » (ou, selon<br />
Marchetti et Marks, embarrassants pour la CIA).<br />
Les juges invoquèrent-ils dans cette affaire la doctrine de l’absence de<br />
contrainte préalable en déclarant : « Nous ne pouvons pas censurer ce<br />
livre par avance ; poursuivez donc les auteurs après publication si vous<br />
le souhaitez » ? Non. Le juge déclara qu’il n’interdirait pas les 225 passages<br />
incriminés mais seulement 168 d’entre eux.<br />
Exemple d’un autre coup porté à la confiance ingénue accordée par<br />
les citoyens américains au fait que le Premier Amendement signifierait<br />
bien ce qu’il est censé signifier, le livre parut en 1972 avec les coupes<br />
ordonnées par le tribunal. Mais l’éditeur y laissa des espaces vides et parfois<br />
même des pages intégralement blanches aux endroits où le livre avait<br />
été censuré. La lecture de ce livre est donc non seulement intéressante<br />
pour ce qu’il dit de la CIA mais aussi pour ce qu’il révèle de l’efficacité<br />
du Premier Amendement 11 .<br />
LE CONTRÔLE DE L’INFORMATION<br />
Nous n’avons pas encore évoqué ce qui est peut-être la question la plus<br />
importante de toutes quand on en vient à s’interroger sur la liberté d’expression<br />
et la liberté de la presse aux États-Unis. Supposons que toutes<br />
les restrictions imposées à la liberté d’expression soient soudainement<br />
des lois civiques, lire Leonard Levy, Jefferson and Civil Liberties, Quadrangle,<br />
1973. Notons que Levy n’hésite pas à provoquer nombre des admirateurs de<br />
Jefferson au travers de ses critiques.<br />
11. Victor Marchetti et John Marks, The C.I.A and the Cult of Intelligence,<br />
Knopf, 1972.
HOWARD ZINN 15<br />
levées – restrictions imposées au Premier Amendement par la Cour<br />
suprême, pressions exercées par les polices locales sur les individus qui<br />
souhaitent s’exprimer, peur de perdre son travail en parlant librement, et<br />
l’ombre que fait planer la surveillance secrète des citoyens par le FBI.<br />
Admettons que nous puissions vraiment dire tout ce que nous souhaitons<br />
sans crainte. Il resterait néanmoins deux problèmes. Et deux problèmes<br />
de taille.<br />
Le premier : d’accord, supposons que nous puissions dire tout ce<br />
que nous avons envie. À combien de gens sommes-nous en mesure de<br />
faire passer notre message ? Une centaine ou dix millions ? La réponse<br />
s’impose : cela dépend du budget dont nous disposons.<br />
Admettons que rien ne puisse nous empêcher de monter sur une<br />
caisse et d’exprimer le fond de notre pensée. Peut-être pourrons-nous<br />
atteindre une centaine de personnes de cette manière. Mais si, par<br />
exemple, nous sommes l’entreprise Procter & Gamble, qui fabrique la<br />
caisse, nous pourrions nous payer un spot publicitaire en prime time à la<br />
télévision, acheter de pleines pages dans les journaux et atteindre ainsi<br />
des millions de personnes.<br />
En d’autres termes, la liberté d’expression n’est pas une simple question<br />
de permission ou d’interdiction. C’est également une question de<br />
« quantité ». Et notre quantité de liberté dépend de la quantité d’argent<br />
dont nous disposons ; des pouvoirs dont nous jouissons et des possibilités<br />
que nous avons d’atteindre un grand nombre d’individus. Un pauvre,<br />
aussi intelligent et éloquent puisse-t-il être, verra sa liberté d’expression<br />
réellement très limitée.<br />
A. J. Liebling, qui s’intéressait à la liberté de la presse, en parle en ces<br />
termes : « Celui qui jouit de la liberté de la presse est celui qui en possède<br />
un organe. 12 » Détenir un journal vous confère une bien plus grande<br />
liberté d’expression que d’avoir à écrire au courrier des lecteurs d’un journal<br />
local en espérant que le rédacteur publiera votre lettre. Il faut de plus<br />
en plus d’argent pour posséder un organe de presse, et même si c’est dans<br />
vos moyens, il est de plus en plus difficile d’éviter qu’il soit racheté par<br />
une grande entreprise. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de<br />
80 % des quotidiens américains étaient la propriété d’individus indépendants.<br />
Quarante ans plus tard, seuls 28 % des journaux étaient restés<br />
12. Cité par Richard Kluger, The Paper : The Life and Death of the New York<br />
Herald Tribune, Knopf, 1986.
16<br />
LE PREMIER AMENDEMENT EN QUESTION<br />
indépendants, le reste étant détenu par des entreprises. En outre, quinze<br />
entreprises colossales contrôlaient la moitié de la presse nationale 13 . Trois<br />
chaînes de télévision (CBS, ABC et NBC) contrôlent à peu près les trois<br />
quarts du prime time. Quatre-vingt-dix millions de ménages possédant<br />
un téléviseur, ces chaînes ont donc un phénoménal pouvoir d’influence<br />
sur les esprits américains. Dix éditeurs publient la moitié des 10 milliards<br />
de dollars de livres disponibles à la vente aux États-Unis. Quatre<br />
géants dominent l’industrie du cinéma.<br />
Non seulement l’usage effectif du Premier Amendement est fonction<br />
de la fortune, mais lorsque de temps en temps le parlement d’un État<br />
tente de remédier, même légèrement, à cette situation, ce sont les entreprises<br />
qui en appellent à ce même texte. C’est ce qui arriva en 1977 quand<br />
le parlement du Massachusetts décréta que les entreprises ne pouvaient<br />
pas utiliser leur argent pour influencer un référendum public. Cette loi se<br />
fondait sur le sentiment que les entreprises pouvaient à ce point dominer<br />
le débat concernant un problème d’ordre public que la liberté d’expression<br />
des gens non fortunés en serait quasiment réduite à rien.<br />
L’avocat spécialiste du droit des affaires qui plaida devant la Cour<br />
suprême déclara que « l’argent [était] un mode d’expression ». Il aurait<br />
pu ajouter : « Et comme nous avons beaucoup d’argent nous sommes<br />
plus libres de nous exprimer que les autres. » La Cour suprême décréta<br />
héroïquement qu’imposer à la First National Bank de Boston des limites<br />
à l’usage de son argent pour influencer un référendum revenait à la priver<br />
des droits garantis par le Premier Amendement... 14<br />
Le juge constitutionnel rechigne à l’évidence à donner de la consistance<br />
au Premier Amendement en reconnaissant les grandes inégalités de<br />
ressources et en essayant de remédier à ce problème. En 1969, il avait<br />
unanimement soutenu la « doctrine de justice » de la Commission fédérale<br />
sur la communication qui décrétait que toute personne critiquée sur<br />
les ondes pouvait exiger un droit de réponse 15 . Mais depuis cette époque<br />
la Cour a toujours refusé de se mettre au travers de la route des pouvoirs<br />
13. La plupart de ces informations sur la tendance à la concentration et au<br />
monopole dans les médias sont tirées du livre de Ben Bagdikian, The Media<br />
Monopoly, Beacon, 1988.<br />
14. First National bank vs Bellotti, 1978.<br />
15. Red Lion Broadcasting Co. vs FCC, 1969.
HOWARD ZINN 17<br />
de l’argent dans le secteur de la communication et de restreindre leur<br />
aptitude à écarter des ondes les opinions qui leur déplaisent.<br />
En 1973, la Cour suprême décréta que CBS avait le droit de refuser<br />
une publicité émanant d’un groupe d’hommes d’affaires qui s’opposaient<br />
à la guerre du Vietnam. Même le juge libéral William O. Douglas se rallia<br />
à la majorité en prétextant que les autorités ne devaient pas discuter<br />
le fait que CBS pouvait vendre son espace publicitaire à qui elle le souhaitait.<br />
Ce faisant, bien entendu, il reconnaissait à CBS le droit de peser<br />
sur l’accès au canal télévisuel de citoyens engagés 16 .<br />
Le juge Douglas affirma que « la télé et la radio […] ont le droit de<br />
jouir de la doctrine du laissez-faire que préconise le Premier<br />
Amendement ». Il tombait là dans le piège sous-jacent de cette théorie :<br />
elle prétend respecter la liberté des individus en gardant soigneusement<br />
le gouvernement de toute intervention et en négligeant le fait qu’ils se<br />
retrouvent alors à la merci des personnalités les plus riches de la société.<br />
La « doctrine de justice » elle-même, qui constitue un progrès relatif<br />
en exigeant que les médias accordent un certain temps d’expression aux<br />
points de vue contradictoires, fut considérablement affaiblie par le<br />
Congrès lorsqu’il en exclut, en 1959, les débats politiques et les conférences<br />
de presse. Cela signifie que le président des États-Unis ou n’importe<br />
quel membre du gouvernement peut tenir une conférence de<br />
presse et s’adresser comme il le souhaite à une audience phénoménale<br />
sans risquer de se faire contredire par les critiques de l’opposition. Cela<br />
signifie aussi que, lors des campagnes présidentielles, les débats entre<br />
prétendants à la fonction peuvent se limiter aux seuls partis démocrate<br />
et républicain à l’exclusion des partis moins puissants. Le parti démocrate<br />
s’opposa à la mesure concernant les conférences de presse mais la<br />
Cour suprême refusa de l’entendre en appel. Le Socialist Workers Party<br />
alla aussi devant les tribunaux en affirmant que son candidat avait<br />
16. Columbia Broadcasting System Unc. vs Democratic National Committee, 1973.<br />
Deux ans plus tard, une décision de la Cour suprême annula un règlement de<br />
Floride qui accordait à un candidat politique attaqué le droit de répondre par<br />
voie de presse. À nouveau, il s’agissait d’une illustration de la doctrine du<br />
laissez-faire par laquelle les autorités gouvernementales sont tenues à l’écart des<br />
affaires du monde de l’information tout en permettant à l’autorité détenue de<br />
facto par un puissant journal de décider quelles opinions politiques doivent<br />
être diffusées. Miami Herald vs Tornillo, 1974.
18<br />
LE PREMIER AMENDEMENT EN QUESTION<br />
également le droit de s’adresser à l’opinion publique. La Cour refusa de<br />
considérer cette demande 17 .<br />
Le second problème de taille concernant la liberté d’expression est le<br />
suivant : supposons que personne, ni le gouvernement, ni la police, ni<br />
notre employeur ne nous empêche de nous exprimer librement mais que<br />
nous n’ayons rien à dire. Autrement dit, que se passe-t-il si nous n’avons<br />
pas d’informations suffisantes sur ce qui se passe dans ce pays ou à<br />
l’étranger et que nous ignorons tout des agissements de notre gouvernement<br />
à l’intérieur comme à l’extérieur ? Sans cette information, la liberté<br />
d’expression ne signifie pas grand-chose.<br />
Il est très difficile pour le citoyen moyen d’apprendre vraiment ce qui<br />
se passe ici ou à l’étranger. Il y a tant à savoir. Les choses sont si compliquées.<br />
Mais qu’en est-il si, outre ces limitations quasi naturelles, on<br />
cherche délibérément à nous empêcher d’en savoir plus ? En fait, c’est ce<br />
qui se passe lorsque le gouvernement pèse sur les médias ou qu’ils pratiquent<br />
l’autocensure (cette fameuse « prudence » dont parlait Mark<br />
Twain) ou bien encore lorsque l’administration nous ment.<br />
La conscience démocratique est niée quand le gouvernement décrète<br />
qu’il lui faut manipuler la presse au nom des impératifs de politique étrangère.<br />
Un journaliste de la Strategic Review (A.G.B. Metcalf, également président<br />
du conseil d’administration de l’université de Boston), une revue<br />
de droite consacrée à la stratégie militaire, prévenait ainsi les médias en<br />
1983 : « Dans une démocratie libre où chaque acte, chaque nomination,<br />
chaque politique est sujet au questionnement et à la pression de l’opinion<br />
publique, les mass medias ont la responsabilité particulière de ne pas nuire<br />
au nom de la liberté d’expression à la crédibilité des dirigeants régulièrement<br />
élus et sur la réussite desquels repose dans un monde périlleux le<br />
17. Analyste de longue date de la liberté de parole dans ce pays, Franklin S.<br />
Haiman, de la North-Western University, suggérait en soulignant le contrôle<br />
exercé par les mass medias que « la liberté d’expression que nous exerçons n’est<br />
qu’une contrefaçon. […] Les débats qui nous agitent sont plus des moyens que<br />
des fins, où la forme importe plus que le fond, et les apparences plus que les<br />
faits. Ils sont limités dans leur ampleur et dans leur profondeur. Et rendus tels<br />
par un lavage de cerveau culturel. […] Aux États-Unis, nous avons notre<br />
propre façon de nous assurer que la diversité des opinions exprimées et transmises<br />
au plus grand nombre reste circonscrite aux limites tolérables aux yeux<br />
de ceux qui détiennent les rènes du pouvoir. » Franklin Haiman, « How Much<br />
of Our Speech is Free ? », Civil Liberties Review, hiver 1975.
HOWARD ZINN 19<br />
maintien de cette liberté. […] C’est une question qui, au nom du Premier<br />
Amendement, est devenue complètement immaîtrisable. 18 »<br />
Retour au sempiternel prétexte de la sécurité nationale.<br />
L’argumentation est la suivante : Nous sommes en lutte contre un ennemi<br />
impitoyable ; nos dirigeants prennent soin de nous dans le cadre de ce<br />
conflit ; aussi ne faut-il pas les critiquer exagérément. Assurément notre<br />
presse est libre, mais elle doit se conduire de manière responsable. Ayez<br />
confiance en vos dirigeants.<br />
Metcalf est une personne privée, mais il reflète indubitablement l’opinion<br />
des plus hautes sphères du gouvernement. Plutôt que de faire<br />
confiance à notre presse nationale pour se conduire naturellement de<br />
manière responsable, notre gouvernement, depuis longtemps déjà, a<br />
tenté de faire de la presse un pilier de la politique officielle. Il lui arrive<br />
d’échouer mais il y réussit parfois. En voici quelques exemples.<br />
En 1954, le gouvernement américain envisageait secrètement de renverser<br />
le gouvernement démocratiquement élu du Guatemala qui avait<br />
décidé de se réapproprier des terres détenues par la United Fruit<br />
Company. Un correspondant sur place du New York Times, Sydney<br />
Gruson, jugea que c’était le devoir de la presse de rapporter ce qu’il y<br />
avait vu. Mais ses reportages dérangèrent rapidement. Allen Dulles, directeur<br />
de la CIA, contacta son vieux compagnon de Princeton, Julius Ochs<br />
Adler, directeur commercial du Times, et Gruson fut expédié à Mexico 19 .<br />
À la fin de 1960, le rédacteur en chef du magazine The Nation, Carey<br />
McWilliams, fut instruit par un spécialiste de l’Amérique latine, enseignant<br />
à la Stanford University et qui venait juste de revenir du Guatemala,<br />
18. Strategic Review, été 1983. Ce point de vue exprimé par une personne privée<br />
est identique à celui de William Westmoreland, qui avait été le commandant<br />
en chef des forces armées américaines au Vietnam pendant la guerre et<br />
qui, le 20 mars 1982 (selon une dépêche de la United International Press),<br />
déclara devant un auditoire universitaire dans le Colorado que les forces armées<br />
ne pouvaient pas l’emporter sans le soutien de l’opinion publique et qu’en<br />
conséquence il fallait contrôler les médias d’information en temps de guerre.<br />
19. Harrison Salisbury, Without Fear or Favor : The New York Times and Its<br />
Times, Times Books, 1980. Ce livre, qui se base sur ses nombreuses années<br />
passées comme correspondant du Times, fournit un bon nombre de renseignements<br />
sur la manière dont les rédacteurs et le propriétaire jouaient à se<br />
renvoyer la balle avec le gouvernement.
20<br />
LE PREMIER AMENDEMENT EN QUESTION<br />
que les exilés cubains étaient entraînés dans ce pays par les États-Unis en<br />
prévision d’une invasion de Cuba. McWilliams écrivit un éditorial sur le<br />
sujet et en adressa des copies aux principaux médias d’information, y<br />
compris l’Associated Press et la United Press International. Ni l’une ni<br />
l’autre de ces agences ne reprirent cette information. Neuf jours plus tard,<br />
le New York Times nous informait que le président du Guatemala niait<br />
toutes les rumeurs concernant une prochaine invasion de Cuba 20 .<br />
La presse continua de jouer le rôle de porte-voix du gouvernement<br />
même lorsque la preuve d’une invasion de Cuba soutenue par les États-<br />
Unis commença à s’imposer. Le magazine Time, qui confirma plus tard<br />
qu’il s’agissait bien d’une opération menée par la CIA, s’amusait au début<br />
du « petit mélodrame continuel de l’invasion » que nous jouait Castro.<br />
Cela collait parfaitement avec la ligne suivie par l’ambassadeur américain<br />
auprès des Nations unies, James J. Wadsworth, selon lequel les allégations<br />
cubaines concernant une tentative d’invasion étaient « vides, sans<br />
fondements, fausses et mensongères ».<br />
La Maison-Blanche demanda au magazine New Republic de ne pas<br />
publier un article sur les préparatifs de l’invasion et le journal accepta<br />
avec complaisance. Arthur Schlesinger qualifia plus tard cet épisode<br />
d’« acte patriotique passablement embarrassant 21 ».<br />
Quatre jours avant le début de l’opération, Kennedy avait déclaré au<br />
cours d’une conférence de presse : « Il n’y aura, sous aucune condition,<br />
d’intervention des forces armées américaines à Cuba. » Kennedy savait<br />
pertinemment que la CIA entraînait des Latino-Américains pour cette<br />
invasion. Mais il savait également que des pilotes américains interviendraient<br />
au cours de cette opération. Quatre de ces pilotes furent abattus<br />
mais on cacha les circonstances de leur mort à leurs familles. À<br />
l’époque de cette conférence de presse, la complicité américaine dans<br />
cette invasion était parfaitement évidente et pourtant la presse ne<br />
contredit jamais Kennedy.<br />
En 1963, à la veille de prendre sa retraite, le directeur général de<br />
l’Associated Press déclara : « Quand le président des États-Unis vous<br />
20. Les détails du black-out de la presse sur l’affaire la Baie des cochons sont<br />
donnés par Victor Bernstein et Jesse Gordon dans l’article « The Press and the<br />
Bay of Pigs », Columbia University Forum, automne 1976.<br />
21. Arthur Schlesinger, A Thousand Days, Houghton Mifflin, 1965.
HOWARD ZINN 21<br />
appelle pour vous dire qu’il s’agit d’une question vitale de sécurité nationale,<br />
vous obéissez. 22 »<br />
La servilité des principaux médias vis-à-vis du pouvoir (à quelques<br />
héroïques exceptions près) et la pression imposée par le gouvernement<br />
permirent longtemps de rendre presque vain le droit garanti par le<br />
Premier Amendement : « La liberté de la presse. » Voici d’autres<br />
exemples de l’influence du gouvernement sur les médias :<br />
1 – Lorsque le correspondant de CBS Daniel Schorr réussit à se procurer<br />
une copie du rapport de la Chambre des représentants sur la CIA<br />
en 1976 (un rapport étouffé et caché à l’opinion publique), il fut<br />
interrogé par le ministère de la Justice puis licencié de CBS.<br />
2 – Il fut un temps où la CIA possédait secrètement des centaines de<br />
supports médiatiques et s’offrait également les services d’une cinquantaine<br />
de personnes travaillant pour des organes d’information aux États-<br />
Unis et à l’étranger comme Newsweek, Time, le New York Times, United<br />
Press International, CBS News et bien d’autres journaux de langue<br />
anglaise à travers le monde 23 .<br />
3 – Après que Ray Bonner, correspondant du New York Times en<br />
Amérique centrale, eut rédigé une série d’articles critiquant la politique<br />
américaine au Salvador en 1982, il fut muté à un autre poste 24 .<br />
4 – En 1981, une nouvelle série d’une heure intitulée Today’s FBI commença<br />
à être diffusée sur la télé nationale. Ce programme avait obtenu<br />
l’accord officiel et le soutien de William Webster, directeur du FBI à qui<br />
avait été en retour accordé un droit de veto sur tous les scénarios 25 .<br />
5 – Une émission de CBS sur la guerre du Vietnam, intitulée Tour of<br />
Duty, se vit accorder par le Pentagone le libre accès à toutes sortes de<br />
moyens militaires, dont des hélicoptères, des avions et du personnel. En<br />
22. Editor and Publisher, 2 février 1963. Cité par Bernstein et Gordon dans<br />
« The Press and the Bay of Pigs », art. cit.<br />
23. Voir le New York Times du 25 décembre 1977. Ainsi que l’article de William<br />
Preston et Ellen Ray, « Disinformation and Cuba : A Case History », in Cuba<br />
Update, Center for Cuban Studies, New York, juin 1983.<br />
24. Mark Hertsgaard, On Bended Knee : The Press and the Reagan Presidency,<br />
Farrar, Straus & Giroux, 1989. Lire aussi Noam Chomsky, Necessary Illusions,<br />
South End Press, 1989.<br />
25. Boston Globe, 24 octobre 1981.
22<br />
LE PREMIER AMENDEMENT EN QUESTION<br />
retour le Pentagone avait un droit de regard et de veto sur le scénario des<br />
émissions. Le producteur de cette émission, Ron Schwary, déclara à cette<br />
occasion : « Les grandes lignes de l’émission sont communiquées à<br />
Washington et, si elles sont approuvées, elles sont scénarisées, l’accord<br />
définitif revenant à notre responsable de projet ici. 26 »<br />
6 – Dans les années 1980, un certain nombre de documentaires<br />
furent qualifiés de propagandes par la U.S. Information Agency (USIA)<br />
et se virent refuser les visas nécessaires à leur diffusion à l’étranger. L’un<br />
d’entre eux parlait des rapports des enfants à la drogue. Ce documentaire<br />
avait remporté un Emmy Award et un prix à l’American Film Festival<br />
mais la USIA décréta qu’« il [déformait] la véritable image de la jeunesse<br />
américaine ». Un autre film sur les racines historiques de la révolution<br />
nicaraguayenne se vit également refuser ces visas parce que, toujours<br />
selon la USIA, il donnait « une idée inexacte de la politique américaine<br />
actuelle vis-à-vis du Nicaragua » 27 .<br />
7 – Le président Jimmy Carter tenta de dissuader le Washington Post<br />
de faire paraître un article sur le financement du roi Hussein de Jordanie<br />
par la CIA 28 .<br />
8 – Également sous la présidence de Carter, une dépêche du New<br />
York Times nous apprit que « la Maison-Blanche [avait] appelé plusieurs<br />
fois la semaine passée les responsables de CBS News pour demander la<br />
suppression d’un long passage du programme “60 minutes” concernant<br />
les relations entre les États-Unis et le Shah d’Iran ainsi que les activités<br />
de la Savak, la police secrète du Shah récemment renversé ». (La CIA<br />
avait participé à la formation de la Savak, bien connue pour sa pratique<br />
de la torture et pour sa brutalité. 29 )<br />
9 – Au printemps 1988, on apprit que le FBI avait demandé à des<br />
bibliothécaires de signaler les usagers des bibliothèques dont le comportement<br />
leur paraîtrait suspect. L’Association américaine des bibliothèques<br />
établit une liste de dix-huit établissements qui, au cours des<br />
deux années précédentes, avaient été approchés par le FBI. Par exemple,<br />
à l’université du Maryland, des agents du FBI avaient demandé des<br />
26. In These Times, 3-9 février 1988.<br />
27. Boston Globe, 5 janvier 1988.<br />
28. Boston Globe, 26 février 1977.<br />
29. New York Times, 7 mars 1980.
HOWARD ZINN 23<br />
renseignements sur les habitudes de lecture de gens portant des noms à<br />
consonance étrangère 30 .<br />
10 – Sous la présidence de Reagan, la direction de CBS News tenta<br />
d’adoucir la couverture du Président par sa correspondante à la Maison-<br />
Blanche, Lesley Stahl. Ses reportages furent modifiés plusieurs fois pour<br />
rendre ses comptes-rendus moins critiques vis-à-vis de Reagan.<br />
11 – Un documentaire réalisé par des scientifiques japonais qui<br />
s’étaient réunis à Hiroshima juste après le bombardement atomique de la<br />
ville afin d’en enregistrer les effets sur les habitants fut confisqué et<br />
achevé par l’armée américaine. Il fut censuré jusqu’en 1967. Au Japon, ce<br />
film fut surnommé « L’Illusion » parce qu’il n’était pas supposé exister <strong>31</strong> .<br />
12 – Lorsque, en 1981, le gouvernement américain organisa la fuite<br />
de documents supposés prouver que les Cubains, soutenus par l’Union<br />
soviétique, se mettaient brusquement à envoyer une quantité phénoménale<br />
d’armes au Salvador – une information qui se révéla être une énorme<br />
supercherie –, la correspondante de CBS, Diane Sawyer, ainsi que d’autres<br />
personnes, reprirent cette information sans l’avoir préalablement passée<br />
au crible de leur esprit critique. Il s’agissait pourtant de faire passer la<br />
révolte salvadorienne pour une opération menée par des pouvoirs étrangers<br />
et non comme une réaction populaire aux terribles conditions de vie<br />
qui existaient dans ce pays. Le National Wirewatch, bulletin professionnel<br />
destiné aux responsables des agences de presse, reprocha sévèrement aux<br />
services de ces agences d’avoir « collé servilement […] au scénario fourni<br />
par Washington concernant une infiltration communiste <strong>32</strong> ».<br />
Selon Mark Hertsgaard, journaliste au Washington Post, la presse, sous<br />
la présidence de Reagan, bien que clamant partout sa grande objectivité,<br />
«était fort éloignée de toute neutralité politique – en particulier parce<br />
qu’elle se reposait exagérément sur les sources d’informations officielles<br />
33 ». Hertsgaard affirmait que la presse et la télévision étaient<br />
« réduites à l’état de […] quasi-accessoires de l’appareil de propagande<br />
30. USA Today, 24 mai 1988.<br />
<strong>31</strong>. New York Times, 18 mai 1967.<br />
<strong>32</strong>. Cité par le North American Coucil on Latin America, The Media Go to War :<br />
From Vietnam to Central America, NACLA, juillet-août 1983.<br />
33. Mark Herstgaard, « How Reagan Manipulated a Passive Press », in Boston<br />
Globe, 2 novembre 1988. Lire aussi Herstgaard, On Bended Knee…, op. cit.
24<br />
LE PREMIER AMENDEMENT EN QUESTION<br />
de la Maison-Blanche ». Le rôle critique de la presse aurait été pourtant<br />
particulièrement important à cette époque parce que la formation prétendument<br />
d’opposition, le parti démocrate, « n’était que l’ombre pathétique<br />
d’un parti d’opposition – timoré, divisé, manifestement dénué de<br />
toute passion, de principes et de vision ».<br />
On possède des preuves patentes que le gouvernement a tenté – et<br />
souvent avec succès – de manipuler la presse. Mais, comme le dit Noam<br />
Chomsky, « il est difficile d’accuser de façon convaincante le gouvernement<br />
de manipuler la presse quand la victime paraît si désireuse de se<br />
laisser manipuler 34 ».<br />
En bref, un Premier Amendement sans information ne sert à rien et<br />
si les médias, qui en sont la principale source pour la plupart des<br />
Américains, déforment ou dissimulent la vérité sous la pression du gouvernement<br />
ou des grandes entreprises qui les contrôlent, alors le Premier<br />
Amendement est tout simplement nul et non avenu.<br />
Malgré tout, il serait faux de dire que nous ne jouissons pas aux<br />
États-Unis de la liberté de parole et de la presse. La différence entre le<br />
contrôle totalitaire de la presse et son contrôle démocratique peut sans<br />
doute se résumer par la remarque que font à ce propos Edward Herman<br />
et Noam Chomsky dans leur livre Manufacturing Consent : au Guatemala<br />
les journalistes dissidents étaient assassinés ; aux États-Unis on les mute<br />
ou on les licencie 35 .<br />
La lecture attentive des principaux journaux (en particulier les pages<br />
intérieures, les petits articles en bas de page, les brèves dont on ne reparlera<br />
plus jamais) permet de comprendre pas mal de choses essentielles.<br />
De temps en temps, on peut assister à quelques actes audacieux, comme<br />
lorsque le New York Times, le Washington Post et le Boston Globe publièrent,<br />
malgré les pressions du gouvernement de l’époque, les Pentagon<br />
Papers qui révélaient des faits extrêmement embarrassants sur la guerre<br />
du Vietnam. De temps en temps, des articles courageux et honnêtes<br />
34. Noam Chomsky, « All the News That Fits », Utne Reader, février-mars<br />
1986. Le Utne Reader est une formidable source d’informations que l’on ne<br />
peut pas obtenir dans la presse dominante. Il donne des résumés d’articles qui<br />
paraissent dans de petites publications partout à travers le pays et il publie<br />
régulièrement des listes descriptives d’importantes publications qui sont ignorées<br />
par la plupart des autres médias.<br />
35. Edward Herman et Noam Chomsky, Manufacturing Consent, Pantheon, 1988.
HOWARD ZINN 25<br />
paraissent dans les grands journaux.<br />
Il existe également des médias dissidents aux États-Unis. Et leurs<br />
rédacteurs et journalistes ne sont pas jetés en prison. Mais ils manquent<br />
de ressources et leur diffusion est limitée. Sur les ondes on perçoit<br />
comme une faible lueur d’indépendance dans le domaine de la télévision<br />
câblée qui, bien entendu, ne s’adresse qu’à une faible part de l’audience.<br />
Il existe également des petites radios locales (par exemple WBAI à New<br />
York et Radio Pacifica sur la côte Ouest) qui diffusent des émissions d’un<br />
genre tout différent de ce que l’on peut entendre sur les ondes nationales.<br />
La radio et la télévision publiques hésitent en permanence entre une<br />
prudence soutenue et des bouffées occasionnelles de courage. Le<br />
MacNeil-Lehrer News Hour, principal programme d’information de la<br />
télévision publique, est un concentré de prudence. Ses programmes ne<br />
présentent que des porte-parole des pouvoirs en place et ne peuvent proposer<br />
aucun problème d’importance sans avoir recours à des membres<br />
du gouvernement ou du Congrès. Il est ouvert aux ultraconservateurs<br />
mais jamais aux progressistes. Par exemple, ils n’ont jamais invité le principal<br />
critique de la politique étrangère américaine, un intellectuel pourtant<br />
mondialement connu, Noam Chomsky. C’est comme si, pendant<br />
toute la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, Jean-Paul Sartre<br />
avait été mis sur liste noire en France et que l’opinion publique n’avait<br />
jamais eu l’occasion de l’entendre. Seul Bill Moyers eut le courage d’interviewer<br />
Noam Chomsky au cours de deux émissions spéciales sur le<br />
réseau de la télévision publique.<br />
Si nous pensons que l’absence de publicités sur la « télévision<br />
publique » apporte la preuve de sa liberté, nous nous trompons gravement.<br />
Ce secteur public dépend du budget alloué par le gouvernement et<br />
courtise les institutions privées pour en obtenir des financements. Selon<br />
une dépêche de l’Associated Press reprise par le New York Times sous le<br />
titre « Le Réseau de télé public fait de l’œil aux généreux donateurs » :<br />
« William Lee Hanlmey Jr, le nouveau directeur de la Corporation for<br />
Public Broadcasting souhaite faire des programmes éducatifs de la radio<br />
et de la télévision des investissements si rentables que le monde de<br />
l’entreprise américain s’empressera de lui consacrer plus d’argent. 36 »<br />
Le problème avec la liberté d’expression aux États-Unis n’est pas tant<br />
36. New York Times, 5 janvier 1987.
26<br />
LE PREMIER AMENDEMENT EN QUESTION<br />
l’accès ou le non-accès à l’information mais le degré d’accès à cette information.<br />
Il existe quelques moyens d’accès à des points de vue dissidents<br />
mais il sont confinés dans un espace restreint. Il existe également<br />
quelques écarts dans les médias dominants par rapport à la politique gouvernementale<br />
officielle mais ils sont rares et extrêmement timides.<br />
Certains sujets se voient réserver une large place dans les médias quand<br />
d’autres sont soit totalement ignorés soit confinés dans les dernières<br />
pages des journaux. Les subtilités du langage, la rhétorique ou le ton<br />
employés pour rendre compte d’un événement font une grande différence<br />
quant à sa réception par le lectorat.<br />
HOWARD ZINN<br />
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton<br />
Ce texte est extrait du chapitre VIII de « Nous, le peuple des États-Unis… »<br />
Essais sur la liberté d’expression et l’anticommunisme, le gouvernement<br />
représentatif et la justice économique, les guerres justes, la violence et la<br />
nature humaine, à paraître aux éditions <strong>Agone</strong>.<br />
Professeur émérite à la Boston University, Howard Zinn est notamment l’auteur de<br />
Une histoire populaire des États-Unis (<strong>Agone</strong>, 2002).
Points de vue américains (I)<br />
Big government is watching, Nat Hentoff p. 28<br />
Traduit de l’anglais par Michaël Lainé<br />
Paru sous le titre « Aschcroft’s War on Judges », in The Progressive, novembre 2003.<br />
Journaliste depuis plus de 50 ans, spécialiste du droit constitutionnel, Nat Hentoff<br />
est connu pour sa défense de la liberté d’expression. Il contribue régulièrement à la<br />
revue militante Village Voice et au New Yorker, qui fut longtemps une revue progressive<br />
de haute tenue intellectuelle.<br />
Messianisme militariste, Matthew Rothschild p. 30<br />
Traduit de l’anglais par Michaël Lainé<br />
Paru sous le titre « Bush’s Messiah Complex », in The Progressive, février 2003.<br />
Matthew Rothschild est rédacteur en chef du Progressive, mensuel pacifiste et<br />
populiste fondé en 1909 par le sénateur Robert La Follette.<br />
Refouler le XX e siècle, William Greider p. 37<br />
Traduit de l’anglais par Michaël Lainé<br />
Paru sous le titre « Rolling Back the XX th Century », in The Nation, 12 mai 2003.<br />
Figure majeure du journalisme militant, William Greider a collaboré, en 40 ans de<br />
carrière, à divers organes de presse, du Washington Post à Rolling Stone.<br />
Actuellement éditorialiste en politique intérieure à The Nation (le plus vieil hebdomadaire<br />
de gauche des États-Unis), il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont<br />
Secrets of the Temple et The Soul of Capitalism.<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 27-52
28<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (I)<br />
Big government is watching<br />
Jusqu’à présent, presque toutes les critiques du USA Patriot Act ont été<br />
dirigées contre le procureur général, faisant ainsi écran au Président.<br />
Mais, le 10 septembre 2003, à la veille du second anniversaire du<br />
11 septembre, George W. Bush, s’exprimant à la FBI Training Academy<br />
à Quantico (Virginie), appela de ses vœux une nouvelle législation qui<br />
autoriserait la plus large moisson de données personnelles jamais vue.<br />
Le Président entend passer au-dessus des juges en donnant à diverses<br />
officines gouvernementales – notamment le FBI – le pouvoir de délivrer<br />
des assignations administratives sans contrôle judiciaire. De telles assignations<br />
ont été autorisées par le passé, mais seulement sous d’étroits<br />
motifs bien spécifiques – en matière de fraude à l’assurance maladie<br />
par exemple. Ces nouvelles assignations extra-judiciaires permettront<br />
d’accéder à une gamme étendue de données personnelles – parmi lesquelles<br />
vos antécédents médicaux, des informations sur votre génome,<br />
le contenu de vos e-mails, ainsi que d’autres documents sur vous et<br />
votre ordinateur.<br />
Ces assignations inquisitoriales pourront vous être adressées personnellement,<br />
accompagnées d’une injonction à comparaître et à se<br />
défendre. Ou bien elles pourront être envoyées à des tiers – cabinets<br />
médicaux, établissements d’enseignement supérieur, banques. Le cas<br />
échéant, vous pouvez très bien ne pas savoir quelle part d’intimité vous<br />
avez encore perdue.<br />
En complément de ces assignations administratives, il y a une procédure<br />
de secrète similaire à celle inscrite à la section 215 du Patriot Act (qui<br />
autorise le FBI à se rendre dans les bibliothèques et les librairies afin de<br />
prendre connaissance de vos lectures). Si le procureur général décide<br />
que l’obtention de ces données pourraient faire peser une menace sur<br />
la sécurité nationale, « nul ne doit divulguer à quiconque qu’une assignation<br />
a été reçue ou des informations fournies ». Cela figure en<br />
toutes lettres dans le texte du projet de loi docilement déposé à la<br />
Chambre par le républicain Tom Feeney, de Floride, lequel a aussi<br />
contribué au projet de loi du ministère de la Justice limitant la latitude
NAT HENTOFF 29<br />
des juges à condamner les prévenus à des peines moins lourdes que<br />
celles requises par les directives du ministère public.<br />
Le projet de loi (HR 3037) a pour titre – dans le style euphémistique<br />
coutumier à l’administration judiciaire – « Loi d’amélioration des<br />
moyens de lutte contre le terrorisme ».<br />
Entre les lignes, quelque part, il doit être possible de contester les assignations<br />
administratives devant la cour – après que les bases de données<br />
gouvernementales ont traité toutes vos informations personnelles.<br />
Même dans ce cas, le secret peut toujours vous être opposé si, selon les<br />
termes de la loi, le juge décide « qu’il peut [en] résulter une menace pour<br />
la sécurité nationale ».<br />
Dans sa volonté de plaider pour l’amélioration des moyens de lutte<br />
contre le terrorisme, le porte-parle d’Aschcroft, Mark Corallo, mit en<br />
avant le cas d’école suivant face à Eric Lichtblau, chroniqueur juridique<br />
au New York Times que sa compétence a toujours signalé à l’admiration<br />
de ses pairs. Imaginons que, au milieu de la nuit, le FBI ait vent d’un<br />
tuyau faisant état qu’un terroriste non identifié a été pisté jusqu’à<br />
Boston, sans que l’agence sache dans quel hôtel il a pu descendre. Sans<br />
devoir attendre un mandat du juge, le FBI assigne tous les hôtels de<br />
Boston afin d’avoir connaissance des registres de toutes les entrées. Les<br />
noms sont ainsi recoupés avec les bases de données gouvernementales<br />
concernant le terrorisme.<br />
Il est loin d’être rare que ces bases de données du FBI contiennent des<br />
informations erronées. Partant, un citoyen américain blanc comme neige,<br />
arrivant en retard à l’aéroport, pourra, au mieux, rater son avion ou être<br />
retenu pour un interrogatoire approfondi, du simple fait de son enregistrement<br />
dans un hôtel de Boston la nuit de cette orgie inquisitoriale.<br />
En tant que reporter, j’ai couvert des affaires où la police avait de temps<br />
en temps besoin rapidement d’une commission rogatoire. Seulement,<br />
les juges, en cet âge de progrès technologiques, sont très disponibles,<br />
même à domicile. Ils ont des téléphones et des ordinateurs portables,<br />
des adresses e-mail et des fax.<br />
Aussi, le Président et son procureur général bardé de récompenses<br />
sont-ils en train de promouvoir une violation sans encadrement légal<br />
de notre vie privée, qui se révèle à la fois inutile et inconstitutionnelle.<br />
NAT HENTOFF, novembre 2003
30<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (I)<br />
Militarisme messianique<br />
En l’an 2000, au cours de sa campagne présidentielle, George W. Bush<br />
déclara que les États-Unis se devaient d’être « humbles » dans le<br />
monde. Aujourd’hui, il s’est défait de toute humilité et l’a remplacée<br />
par de la morgue. Suprêmement confiant dans ses instincts profonds,<br />
emmitouflé dans un système de croyance intégriste, doté d’une suprématie<br />
militaire sans précédent, et bénéficiant d’un blanc seing du<br />
Congrès, Bush se sent en mesure de « débarrasser le monde du mal »<br />
– à la pointe du fusil.<br />
Un portrait émerge des déclarations publiques présidentielles – et même<br />
de comptes rendus aussi hagiographiques que Bush at War de Bob<br />
Woodward et The Right Man de David Frum –, celui d’un Président en<br />
mission divine.<br />
Appelons ça du « militarisme messianique ».<br />
Il peut ne plus employer le terme « croisade » mais c’est bien une croisade<br />
qu’il mène. Comme l’affirme Frum, un ancien rédacteur de ses discours,<br />
« la guerre a fait de lui un croisé, après tout ».<br />
Alors qu’il n’est rien de condamnable au fait qu’un Président essaie de<br />
façonner un monde meilleur, quand l’homme du bureau ovale se sent<br />
investi par Dieu de remodeler le monde par des moyens violents, c’est<br />
une perspective angoissante.<br />
La grandiloquence de la vision de Bush ne peut plus longtemps être niée.<br />
Woodward écrit : « La plupart des présidents nourrissent des ambitions<br />
élevées. Quelques-uns ont des visions grandioses de ce qu’ils<br />
vont accomplir, et il se situait sans conteste parmi ceux-là. » Bush lui<br />
affirma un jour : « Je saisirai l’opportunité de réaliser des objectifs élevés<br />
», ajoutant « il n’est rien de plus important que d’assurer la paix<br />
dans le monde ».<br />
Et il n’est souvent d’autre manière d’accomplir cela, croit-il, que de<br />
recourir à la guerre. « Lorsque nous examinons en détail le cas de l’Irak,
MATTHEW ROTHSCHILD <strong>31</strong><br />
nous pouvons ou non attaquer. Mon opinion n’est pas arrêtée aujourd’hui.<br />
Mais cela se fera dans l’objectif de rendre le monde plus pacifique<br />
», a-t-il affirmé à Woodward. Bush semblait comprendre que cette<br />
politique missionnaire pourrait lui attirer des ennuis (« Condi ne voulait<br />
pas que j’aborde le sujet »), mais il s’obstina, l’invoquant à nouveau au<br />
sujet de l’Afghanistan (« Je voulais que nous soyons vus comme des<br />
libérateurs ») et de la Corée du Nord.<br />
Le commentaire maintenant célèbre de Bush, qu’il prononça devant<br />
Woodward, « Je hais Kim Jong-Il », avait pour toile de fond un dirigeant<br />
nord-coréen affamant son peuple et torturant ses prisonniers. « Cela<br />
m’horrifie », affirma Bush, en ajoutant que sa réaction était « viscérale.<br />
Peut-être est-ce ma religion, peut-être est-ce mon… toujours est-il que<br />
cela me passionne ».<br />
Bien que son administration semble emprunter la voie diplomatique<br />
pour régler la crise nucléaire coréenne, l’impatience de Bush à affronter<br />
Pyongyang ne devrait pas être sous-estimée. « Je ne suis pas idiot »,<br />
affirma-t-il, reconnaissant la capacité de la Corée du Nord à infliger des<br />
pertes massives à son voisin du sud. Mais il minimisa les troubles que<br />
pourrait occasionner un renversement du régime. « Ils me disent :<br />
“Nous n’avons pas besoin de réagir trop vite, parce que les charges<br />
financières qui pèseront sur le peuple seront tellement immenses si nous<br />
essayons de… si ce type venait à tomber. Qui pourrait s’occuper…” Je<br />
n’y souscris tout simplement pas. »<br />
Quand Bush dit de Kim Jong-Il qu’il est un « pygmée » et insiste sur<br />
l’appartenance de la Corée du Nord à « l’axe du mal », un tel lexique<br />
résonne tout au long du chemin qui mène à Pyongyang. Et il n’est pas<br />
rassurant d’entendre Bush évoquer, avec une telle liberté, la possibilité<br />
d’une guerre avec la Corée du Nord. À une conférence de presse tenue<br />
en janvier 2003 à propos de l’Irak et de la Corée du Nord, un journaliste<br />
commença à lui demander : « Si nous devions partir en guerre… »<br />
Il fut interrompu par le Président : « Contre quel pays ? » Une telle<br />
désinvolture vis-à-vis de la guerre n’a plus été vue depuis les jeunes<br />
années Reagan.<br />
Ce que nous savons de Bush est qu’il est homme à avoir une confiance<br />
démesurée en sa présence d’esprit. « Je n’agis pas en fonction des<br />
manuels scolaires. J’agis avec mes tripes », a-t-il confié à Woodward, qui
<strong>32</strong><br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (I)<br />
ajouta que Bush employa des expressions similaires une douzaine de<br />
fois au cours de son entretien avec le Président.<br />
Au Moyen-Âge, la mesure d’un pied dépendait de la taille du propre<br />
pied du roi. On l’appelait le pied régalien ; nous avons maintenant les<br />
tripes régaliennes.<br />
Dans The Leadership Genius of George W. Bush, Carolyn B. Thompson<br />
et James W. Ware écrivent : « Bush a un instinct mystérieux qui lui<br />
indique quand se battre ou céder, quand courir ou attendre, quand initier<br />
un projet. » Et bien que ses échecs en affaires ne paraissent pas justifier<br />
pareil éloge, les auteurs continuent à le déverser : « Une bonne<br />
part de la réussite de Bush en tant que dirigeant s’explique par sa propension<br />
à faire confiance à ses tripes. »<br />
Mais que se passera-t-il si Bush attrape une indigestion ? Que se passera-t-il<br />
si ses tripes lui prodiguent de mauvais conseils ?<br />
Bush bénéficie de deux très larges autorisations de mener la guerre ; la<br />
première, il la tient de septembre 2001 et la seconde d’octobre 2002.<br />
Combinées, elles lui confèrent un pouvoir unilatéral sans précédent de<br />
se projeter où lui ordonnent ses entrailles. C’est trop demander à la<br />
démocratie que d’accorder sa confiance en l’infaillibilité de l’instinct<br />
d’un homme.<br />
Woodward écrit : « Il est pour le moins évident que les différents rôles<br />
de Bush, homme politique, président et commandant en chef ont pour<br />
principe directeur une foi laïque en ses instincts – ses conclusions et<br />
jugements naturels et spontanés. Ses instincts sont comme sa seconde<br />
religion. »<br />
Sa première religion entre en jeu à ce point. Pour sûr, un Président a<br />
droit de pratiquer n’importe quelle religion en laquelle il croît, et George<br />
W. Bush n’est pas le premier Président à parler de Dieu à tout propos ni<br />
à soutenir que les États-Unis sont placés sous les ailes de la Providence.<br />
Mais quand ses croyances religieuses intégristes débordent dans son travail,<br />
et quand il fait usage d’une rhétorique religieuse de manière incendiaire,<br />
nous devons prendre garde.<br />
Depuis le 11 septembre, il s’est rarement écoulé de jours sans que Bush<br />
n’emploie les mots « mal » ou « malfaisant ». Son discours sur l’« axe<br />
du mal » pourrait bien avoir constitué une menace telle envers la Corée<br />
du Nord qu’elle décida d’accélérer l’exécution de ses plans nucléaires.
MATTHEW ROTHSCHILD 33<br />
L’expression « axe du mal » ne s’est pas trouvée là par hasard, pas plus<br />
qu’elle n’a été le terme exact du rédacteur du discours. Le vocable qui<br />
était venu sous la plume de Frum, dans le document qu’il envoya à<br />
Michael Gerson, chef des rédacteurs, était « axe de la haine ». Écoutons-le<br />
: « Gerson voulait se servir du langage théologique que Bush<br />
avait fait sien depuis le 11 septembre – ainsi, “axe de la haine” devint<br />
“axe du mal”. »<br />
Frum est plutôt enclin à reconnaître l’importance de l’intégrisme au sein<br />
de l’administration Bush. Les premiers mots qu’il prétend avoir entendus<br />
à la Maison-Blanche de la part de son locataire étaient : « Je t’ai raté<br />
aux cours de théologie. » Frum écrit : « Bush vient et parle d’une culture<br />
très différente de celle de l’individualiste Ronald Reagan : une culture<br />
d’évangélisme moderne. Pour comprendre la présidence de Bush, vous<br />
devez comprendre sa croyance prédominante. »<br />
Frum cite aussi le discours prononcé par le président à son alma mater,<br />
Yale, le 21 mai 2001. C’était un de ceux que Bush avait le plus travaillé<br />
personnellement et, aux dires de Frum, il figure parmi les plus révélateurs<br />
de sa personnalité. Bush y affirma : « La vie prend ses propres<br />
virages, formule ses propres exigences, écrit sa propre histoire. Et tout<br />
au long du chemin, on commence à prendre conscience que nous n’en<br />
sommes pas l’auteur. »<br />
Il exprima le même sentiment alors qu’il était gouverneur du Texas : « Je<br />
n’aurais pas pu être gouverneur si je n’avais pas cru en un plan divin<br />
supplantant tous les plans humains. »<br />
Lorsqu’il envisagea de se porter candidat à la présidentielle, Bush assista<br />
à une messe en compagnie de sa mère. Le pasteur parla d’un Moïse réticent,<br />
doutant de ses qualités de commandement. Barbara glissa à<br />
George qu’il était cette figure de Moïse. En pleine campagne, il invoqua<br />
lui-même le plan divin. « Ensemble, nous devons nous acquitter d’une<br />
charge », écrivit-il dans son livre de campagne, qui n’était pas trop subtilement<br />
intitulé A Charge to Keep.<br />
Que Bush s’imagine avoir été assigné à la présidence par le Très-Haut<br />
apparaît dans un autre passage de l’ouvrage de Frum. Après son discours<br />
au Congrès du 20 septembre 2001, Gerson l’appela afin de le<br />
complimenter : « Monsieur le Président, quand je vous ai vu à la télévision,<br />
j’ai pensé : “Dieu vous a voulu à ce poste.” »
34<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (I)<br />
À en croire Frum, le Président répondit : « Il nous veut tous ici. »<br />
Bush semble croire qu’il mène à bien la volonté divine en faisant la<br />
guerre. Dans l’ouvrage de Woodward, il affirme : « Il y a une condition<br />
humaine dont nous devons nous préoccuper en ces temps de guerre. Il<br />
est un système de valeurs qui ne peut souffrir le moindre compromis –<br />
les valeurs que nous tenons de Dieu. Celles-ci n’ont pas été créées par<br />
les États-Unis. » Pour être juste, les valeurs auxquelles se référait Bush<br />
étaient « la liberté et la condition humaine et les mères aimant leurs<br />
enfants ». Mais, tout de même, l’idée que le Président croit accomplir<br />
les menées divines en temps de guerre est troublante.<br />
« Il y a cette curieuse religiosité personnelle de Bush », écrit Lou<br />
Dubose, co-auteur (avec Molly Ivins) de Shrub : The Short but Happy<br />
Political Life of George W. Bush. « Et les croyants avec lesquels il était<br />
en relation au Texas n’avaient rien des croyants types – même des<br />
croyants types du Texas. »<br />
Dubose évoque James Robison, télévangéliste de Fort Worth. « Bush fit<br />
une apparition au cours de l’émission télévisée de Robison, « Life<br />
Today », et invita le même Robison à être le principal orateur de l’office<br />
du matin à Austin, le jour de sa seconde investiture comme gouverneur. »<br />
Au cours de cet office, Robison relata la conversation à bâtons rompus<br />
qu’il eut avec Dieu tandis qu’il était en train de conduire sur l’autoroute<br />
entre Arlington et Dallas. Bush est aussi un admirateur de James Dobson,<br />
de la très conservatrice association religieuse Focus on the Family.<br />
Annie Laurie Gaylor, rédacteur en chef de Freethought Today, la publication<br />
de la Freedom from Religion Foundation sise à Madison<br />
(Wisconsin), dit de lui qu’« il est le plus imprudemment dévot des présidents<br />
qu’on ai jamais vu. Il a une mission religieuse, et vous ne pouvez<br />
dissocier la religion de son militarisme. Il croit mener une guerre juste. »<br />
Chip Berlet, analyste émérite du Political Research Associates à<br />
Somerville (Massachusetts), est un expert en organisations religieuses<br />
conservatrices. « Bush partage avec les militants chrétiens évangéliques<br />
beaucoup de leur pensée apocalyptique et messianique », soutient-il.<br />
« Il semble souscrire à la vision du monde selon laquelle il existe une<br />
lutte gigantesque entre le bien et le mal culminant dans une confrontation<br />
finale. Les personnes qui partagent ce type de vision prennent souvent<br />
des risques hors de proportion et effrayants, parce qu’ils les<br />
considèrent comme menant à bien la volonté de Dieu. »
MATTHEW ROTHSCHILD 35<br />
D’autres, à l’instar de Frederick Clarkson, auteur de Eternal Hostility :<br />
The Struggle Between Theocracy and Democracy, mettent en doute la<br />
profondeur des croyances religieuses de Bush et le voient invoquer cette<br />
rhétorique à des fins politiques. « Bush agit en direction d’une base<br />
électorale militante », affirme-t-il. « Beaucoup de ces individus s’imaginent<br />
vivre une fin des temps inspirée de la Bible. »<br />
Étant donné que les États-Unis sont en guerre contre les intégristes islamistes<br />
d’Al-Qaida, cela ne semble pas être le moment le plus propice<br />
pour faire entrer Dieu dans le conflit. Mais c’est ce que Bush a fait,<br />
notamment lorsqu’il a affirmé que « Dieu n’est pas neutre » dans la<br />
guerre au terrorisme. Clarkson croit que le simple usage d’une telle rhétorique<br />
est incendiaire. « À une période où l’islam intégriste est en<br />
marche, jouer sur ce registre explosif est une chose dangereuse. »<br />
Michael Klare, professeur des « études sur la paix et la sécurité mondiales<br />
» au Hampshire College, pense que ce qui motive Bush est « une<br />
combinaison d’impérialisme et de messianisme. Il saisit le besoin pratique<br />
de contrôler le pétrole, pour lequel l’administration est prête à<br />
aller aussi loin que possible, et l’enrobe de ferveur messianique ».<br />
Comme d’autres présidents avant lui, il croit que les États-Unis sont le<br />
plus éminent pays au monde, et l’emploi du lexique théologique aux<br />
fins de justifier l’empire ne lui fait pas peur, tel est du moins l’avis de<br />
Chalmers Johnson, auteur de Blowback : The Costs and Consequences<br />
of American Empire. « L’idéologie est là pour couvrir le militarisme. »<br />
« Ce que j’entends est la sainte trinité du militarisme, de la phallocratie<br />
et du zèle messianique », affirme Lee Quinby, professeur d’études américaines<br />
aux Hobart College et William Smith College à Geneva (New<br />
York). « Elle suit en tout point la logique de la pensée apocalyptique, qui<br />
a une base religieuse mais est maintenant sécularisée sur le mode militariste.<br />
La pensée apocalyptique a toujours un élément qui insuffle l’impuissance<br />
et une victoire prometteuse au regard de cette faiblesse. À cet<br />
égard, Bush exagère la vulnérabilité que nous ressentons du fait du terrorisme<br />
ou de Saddam Hussein et, de là, attire l’attention sur la force<br />
armée comme la garantie que notre impuissance sera transformée. »<br />
Quinby soutient que ce genre de raisonnement est « dangereux parce<br />
qu’il prépare une nation à la guerre sans penser à l’impact sur les civils<br />
et les soldats américains ».
36<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (I)<br />
Il y a aussi le risque que Bush soit si convaincu que Dieu est de son côté<br />
qu’il en devienne susceptible de commettre une bévue aux proportions<br />
effrayantes.<br />
En démocratie, les décisions fatidiques de guerre et de paix ne sont pas<br />
supposées reposer dans les mains d’un seul homme. Aujourd’hui, elles<br />
le sont. Et à quel homme avons-nous confié une telle charge !<br />
Manquant de curiosité intellectuelle, il se targue d’entrailles infaillibles.<br />
Voulant à tout prix ne pas être piégé dans « le truc de la vision » qui a<br />
perdu son père, Bush embrasse une énorme mission mondiale et la traduit<br />
dans le langage intégriste. Et il assigne au Pentagone le rôle principal<br />
dans la conduite de cette mission.<br />
C’est là le moyen de donner trop de pouvoir à n’importe qui, et George<br />
W. Bush a l’arrogance qui accompagne d’ordinaire de telles prérogatives.<br />
« Je n’ai pas besoin d’expliquer pourquoi je dis les choses »,<br />
confia-t-il à Woodward. « C’est la part intéressante du métier de président.<br />
Peut-être quelqu’un a-t-il besoin de m’expliquer pourquoi ils ont<br />
dit quelque chose, mais je ne me sens redevable d’aucune explication<br />
envers quiconque. »<br />
Quand sa croisade prendra des allures de catastrophe, ce qu’elle va probablement<br />
faire, Bush sera redevable d’une explication envers beaucoup<br />
de gens. Pendant ce temps, nous devons faire tout ce qu’il nous<br />
est possible, de façon non violente, pour nous opposer à ce<br />
messianisme militariste.<br />
MATTHEW ROTHSCHILD, février 2003
WILLIAM GREIDER 37<br />
Refouler le XX e siècle<br />
On ne saurait comprendre pleinement George W. Bush si on ne se le<br />
représente pas comme porté par la troisième et plus puissante vague de<br />
l’attaque de longue haleine menée par la droite contre l’ordre dirigeant<br />
créé par le progressisme du XXe siècle. La première vague fut celle de<br />
Ronald Reagan, dont l’élection en 1980 permit aux conservateurs du<br />
mouvement de parvenir au pouvoir (à remonter plus loin, on voit leur<br />
flamme une première fois allumée par Barry Goldwater en 1964).<br />
Reagan déploya beaucoup de vives bannières idéologiques en faveur<br />
d’un programme de réformes ancré à droite et assura la viabilité politique<br />
d’une mise en vigueur de baisses d’impôts régressives, mais ses<br />
réalisations furent bien minces en matière de restructurations gouvernementales,<br />
sans parler du rétrécissement de l’État. La seconde vague<br />
porta Newt Gingrich à la conquête de la majorité à la Chambre des<br />
représentants en 1994 et conféra le contrôle du Congrès aux républicains<br />
pour la première fois en deux générations. En dépit de quelques<br />
victoires marquantes, comme la réforme de l’aide sociale [welfare],<br />
Gingrich se révéla rapidement être, en tant que législateur en chef, un<br />
révolutionnaire aussi zélé qu’inefficace.<br />
Quand bien même George Bush II serait aussi superficiel qu’il semble<br />
l’être, sa présidence représenterait un bien plus redoutable défi que<br />
celles de Reagan et de Gingrich. Son potentiel ne vient pas d’une personnalité<br />
aimable (Al Gore, souvenez-vous, a obtenu plus de voix au<br />
scrutin de l’an 2000) ni même de sa cote de popularité incroyablement<br />
élevée du fait du 11 septembre et de la guerre. L’atout maître de Bush<br />
s’ancre dans la longue et difficile manœuvre de la droite qui détient<br />
maintenant les trois branches de l’État fédéral. L’unité de ses rangs l’autorise<br />
à gouverner de façon agressive, malgré les faibles majorités au<br />
Sénat et à la Chambre des représentants et l’indifférence de l’opinion<br />
publique à son programme de politique intérieure.<br />
La souveraine ambition du mouvement – on ne peut même plus dire<br />
« pompeuse » – est de refouler le XXe siècle, presque littéralement.
38<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (I)<br />
C’est-à-dire de défenestrer le gouvernement fédéral et de ramener sa<br />
dimension et ses pouvoirs à un niveau bien en dessous ce qu’ils étaient<br />
avant la centralisation du New Deal. Une fois cela accompli, l’aile la plus<br />
conservatrice du mouvement imagine une société restaurée dans<br />
laquelle les principales valeurs et les relations de pouvoir ressembleraient<br />
à celles qui avaient cours aux États-Unis aux alentours de 1900, quand<br />
William McKinley était président. L’autorité comme les ressources<br />
publiques seraient disséminées loin de Washington et seraient restituées<br />
aux niveaux locaux mais aussi aux individus et institutions privées – en<br />
particulier les entreprises et les organisations religieuses. Le primat des<br />
droits de propriété serait ré-établi au détriment des priorités publiques<br />
telles qu’elles ressortent des interventions gouvernementales. Par dessus<br />
tout, les fortunes privées – à la fois les entreprises et les individus aux<br />
revenus élevés – seraient continûment protégées des appétits de l’impôt<br />
progressif sur le revenu.<br />
Ces objectifs généraux sembleront réactionnaires et destructeurs – et ils<br />
le sont, d’un point de vue historique –, mais les conservateurs purs et<br />
durs se voient comme des réformistes libérateurs, et non des destructeurs,<br />
qui sauvent les vieilles valeurs américaines de responsabilité et<br />
d’autonomie individuelles de l’emprise de l’action collective et des gauchistes<br />
« étatistes ». Ils ne s’attendent pas à ce que le moindre de ces<br />
buts ambitieux trouve à s’incarner au cours du mandat de Bush, mais ils<br />
croient fermement que l’histoire est de leur côté et qu’une prochaine<br />
vague suivra bientôt – ce qui n’a rien d’une attente déraisonnable étant<br />
donnés leurs grandes victoires de ces trente dernières années. Les<br />
hommes de droite, autrefois portés à la légèreté et au fratricide, comprennent<br />
maintenant que, trois pas en avant et deux en arrière, c’est<br />
encore un progrès. C’est une longue marche, disent-ils. Restons<br />
ensemble, car nous sommes en train de gagner.<br />
Bien des opposants et des critiques, dont je suis, ont toujours trouvé la<br />
vision historique de la droite si improbable que nous tendons à rire aux<br />
éclats et à nous méprendre sur la puissance politique qu’elle a acquise.<br />
Nous devrions nous demander : si ces idées sont aussi évidemment<br />
absurdes et réactionnaires, pourquoi continuent-ils d’avancer ? L’idée<br />
unificatrice de la droite – faire que l’administration sorte de nos vies –<br />
est séduisante aux yeux d’une large fraction de la population, du moins<br />
à un niveau sentimental, parce qu’elle représente une des valeurs fon-
WILLIAM GREIDER 39<br />
damentales authentiques de l’expérience américaine (« Ne me marche<br />
pas dessus » était un des slogans de la Révolution). Mais la véritable<br />
source de sa puissance est à chercher du côté de la plasticité et de la<br />
résistance au temps de son architecture, et non dans les personnalités<br />
éphémères du triptyque Reagan-Gingrich-Bush ni même l’afflux de<br />
financement en provenance du monde des affaires. Une part importante<br />
de la base du mouvement croit en cette vision idéologique – des<br />
gens alarmés par les transformations culturelles ou blessés, en quelque<br />
sorte, par les ingérences étatiques, le tout combiné à des intérêts économiques<br />
qui ont de solides raisons de vouloir une administration moins<br />
intrusive –, et la droite a créé les mécanismes politiques favorables à<br />
l’union de ces éléments disparates. Les cadres dirigeants cosmopolites<br />
du privé y côtoient les militants chrétiens, dont le but est d’éradiquer la<br />
culture progressiste « décadente ». Les ouvriers conservateurs poussés<br />
à bout soutiennent les attaques du monde des affaires contre leur<br />
ennemi commun, l’administration progressiste, alors qu’ils seraient personnellement<br />
lésés en cas de triomphe de ces idées.<br />
Le pouvoir de la droite se nourrit aussi de la décadence générale du système<br />
politique – ces ressentiments largement partagés et souvent justifiés<br />
contre un État fort [big government] qui semble déconnecté des<br />
soucis quotidiens des citoyens ordinaires.<br />
Je ne suis pas en train de prédire que la droite remportera la majorité<br />
gouvernementale nécessaire à la mise en œuvre du programme dans sa<br />
totalité, en une sorte de New Deal conservateur – et je vais en venir à<br />
certaines raisons qui me font penser que leur cause échouera en fin de<br />
compte. Cependant, plus ils avancent et moins inévitable est leur chute.<br />
LE PROJET McKINLEY<br />
Sur le front intérieur, dans les mois qui suivirent les élections de<br />
novembre 2002, l’administration Bush ébranla les sensibilités progressistes<br />
et les plongea dans la crainte par tout un ensemble d’initiatives<br />
politiques audacieuses. On autorisa les églises à inclure les sanctuaires<br />
au nombre des bâtiments ouvrant droit aux allocations logement fédérales.<br />
On coupa brutalement dans les budgets sociaux en faveur des
40<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (I)<br />
pauvres, au moment où les nantis commençaient à sentir les effets des<br />
baisses d’impôts. On poursuivit en justice, sur l’injonction des grandes<br />
entreprises pharmaceutiques, ceux qui aidaient les personnes âgées à se<br />
procurer des médicaments meilleur marché au Canada. On força le<br />
District of Columbia à mener des expériences de « choix scolaire 1 »<br />
financées au niveau fédéral – bien que les habitants du discrict y fussent<br />
largement opposés. On réforma Medicaid en le transférant aux gouvernements<br />
fédérés, qui seront libres d’arrêter leurs propres règles, réforme<br />
qui offrirait beaucoup de ressemblances avec celle de l’aide sociale [welfare]<br />
2 – de même pour l’aide au logement, de coupons alimentaires et<br />
d’autres programmes établis de longue date. On redéfinit des « zones<br />
humides » et des « étendues désertiques » afin que des millions d’acres<br />
protégées soient ouvertes aux promoteurs immobiliers.<br />
Les militants progressistes eurent le souffle coupé en considérant la<br />
variété et la dangerosité des implications de cet ensemble d’initiatives<br />
(l’opinion publique aussi aurait pu en être bouleversée, mais elle était<br />
trop préoccupée par la guerre), tandis que les conservateurs comprirent<br />
que Bush posait, pierre après pierre, les fondations de leur majestueuse<br />
métamorphose de la vie américaine. Voici les éléments concrets<br />
de leur vision.<br />
—1— Se défaire de l’imposition fédérale sur les capitaux privés, voie de<br />
passage obligée vers le démantèlement de l’impôt progressif sur le<br />
revenu. Cela nécessitera une batterie de mesures ; l’une d’entre elles,<br />
l’abrogation des droits de succession, étant déjà accomplie. Le Président<br />
en a proposé plusieurs autres : suppression des taxes sur les dividendes<br />
et élaboration de nouvelles exonérations fiscales sur l’épargne de la<br />
« classe » montante : les investisseurs. Le Congrès ne paraît pas disposé<br />
à avaler ce train de réformes, du moins l’année 2004, mais sa mise en<br />
avant permet d’aller plus loin dans l’agit-prop. Les revenus futurs<br />
1. Le système de « choix scolaire » [school vouchers] permet aux familles pauvres<br />
d’accéder à l’enseignement privé via la remise de bons d’une certaine valeur, monnayables<br />
dans ces seuls établissements. [ndt]<br />
2. Grande loi de refondation sociale, votée en 2002, visant à faire passer les bénéficiaires<br />
de l’aide sociale de l’assistance au travail [from welfare to work]. Elle s’est<br />
accompagnée de transferts de compétences à destination des États fédérés. (Lire<br />
infra Loïc Wacquant, p. 177.) [ndt]
WILLIAM GREIDER 41<br />
seraient moissonnés à partir d’un impôt proportionnel à un chiffre sur<br />
les salaires ou, encore mieux, d’une forte taxe à la consommation. Quoi<br />
qu’il en soit, le travail serait imposé, mais pas le capital. Le rapport économique<br />
2003 du Président, préparé par le Council of Economic<br />
Advisers, se présente comme un bréviaire sur les avantages d’une taxe<br />
à la consommation et la façon dont elle peut fonctionner. Rétrécir la<br />
base fiscale incline naturellement à une administration plus modeste.<br />
—2— Supprimer progressivement l’assurance vieillesse telle que nous la<br />
connaissons, en commençant par la privatisation de Social Security, première<br />
étape vers la destruction des autres grands réservoirs de l’épargne<br />
retraite, jusqu’aux énormes fonds de pension publics, et de leur transformation<br />
en capitalisations individuelles. Les individus seront récompensés<br />
à raison de la prise en charge personnelle de leur retraite par des<br />
exonérations fiscales totales portant sur les sommes placées sur des<br />
comptes « capital vie » [lifetime savings]. À la différence des IRA 3 , qui<br />
font bénéficier de réductions d’impôt sur les contributions personnelles,<br />
les impôts sur les salaires sont prélevés automatiquement, mais exemptés<br />
définitivement quand les montants sont déposés en « capital vie »,<br />
y compris quand l’argent est retiré et dépensé. Aussi cette nouvelle disposition<br />
menace-t-elle inévitablement le système actuel, dans lequel les<br />
employeurs reçoivent des déductions fiscales à raison de leurs abondements<br />
dans les fonds de pension pour leurs employés. La nouvelle alternative<br />
pourrait finalement conduire à l’abrogation de ces déductions et,<br />
par là, soulager les entreprises de toute incitation au financement des<br />
fonds de pension salariaux. Chacun ne s’occuperait que de lui-même.<br />
—3— Retirer à l’État fédéral un rôle direct en matière d’aide au logement,<br />
de santé, de secours aux pauvres et de beaucoup d’autres priorités<br />
sociales établies de longue date, d’abord en déléguant la gestion de<br />
ces programmes aux administrations locales et fédérées ou à des opérateurs<br />
privés, puis en rognant fermement ses engagements budgétaires.<br />
Si les États membres choisissent de mettre un terme à un<br />
programme d’aide plutôt que de le payer, cela confirme qu’il n’y aura<br />
pas d’échappatoire. Chaque personne affaiblie sera prise en charge par<br />
3. Individual Retirement Account. Dispositif fiscal ouvert aux moins de 65 ans destiné<br />
à favoriser la constitution de l’épargne retraite des plus « démunis » (jusqu’à 50 000<br />
dollars de revenus annuels). [ndt]
42<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (I)<br />
le secteur privé, la philanthropie et tout spécialement les institutions religieuses<br />
qui enseignent des valeurs sociales basées sur la foi.<br />
—4— Redonner du lustre aux institutions traditionnelles – Église, famille<br />
et éducation privée dans la vie culturelle nationale – en augmentant<br />
significativement leurs revenus via l’argent public. Quand le « choix scolaire<br />
» sera pleinement garanti, tous les contribuables seront contraints<br />
de participer au financement du réseau éducatif privé, qu’il soit laïque<br />
ou religieux, en y incluant les écoles paroissiales catholiques. En conséquence,<br />
les établissements publics perdront vraisemblablement<br />
quelques-uns de leurs soutiens budgétaires, mais leur recrutement sera<br />
supposé se réduire de toutes les façons, parallèlement au retrait de certaines<br />
familles. Bien que l’essentiel de « l’initiative basée sur la foi » du<br />
Président soit bloquée au Congrès, Bush la fait avancer par de nouvelles<br />
réglementations. La stratégie du financement de l’enseignement privé<br />
par bons [voucher strategy] se heurte à bien des obstacles politiques,<br />
mais la Cour suprême est en première ligne, balayant les objections<br />
constitutionnelles.<br />
—5— Renforcer les entreprises contre le carcan réglementaire, en particulier<br />
en matière de protection de l’environnement, en laissant objectifs<br />
et solutions spontanés émerger du marché. De fait, les décisions<br />
tourneront à la réalisation du progrès maximal sous la férule entrepreneuriale<br />
de préférence à celle des agences de régulation (une approche<br />
également défendue dans le rapport économique de 2003). Au bout<br />
du chemin, lorsque une majorité de droite plus agressive sera établie à<br />
la Cour suprême, les conservateurs envisagent de faire main basse sur<br />
la réglementation étatique en imprimant une nouvelle direction à la<br />
doctrine constitutionnelle. Elle se traduirait par l’obligation faite au<br />
gouvernement d’indemniser les propriétaires, y compris les capitalistes,<br />
dont une nouvelle réglementation accroîtrait les charges ou porterait<br />
atteinte à la rentabilité, une formulation de nature à garantir une faible<br />
activité législative.<br />
—6— Mettre à bas le travail syndiqué. Quoique les syndicats aient<br />
considérablement perdu en influence, ils demeurent un obstacle majeur<br />
à l’incarnation de la vision conservatrice. Les syndicats de fonctionnaires<br />
sont de redoutables opposants sur des sujets tels que la privatisation et<br />
les bons scolaires. Même les syndicats d’une industrie déclinante ont<br />
encore assez de ressources pour se poser en contre-pouvoir significatif.
WILLIAM GREIDER 43<br />
Par-dessus tout, le mouvement ouvrier personnifie l’instrument de pouvoir<br />
par excellence des progressistes : l’action collective. Les mobilisations<br />
citoyennes, au nom de demandes sociales générales, s’opposent à<br />
la vision conservatrice d’individus autonomes, en charge de leurs<br />
propres affaires et agissant seuls. Les syndicats peuvent être démantelés<br />
par des milliers de petites entailles, comme le dépouillement des<br />
« agents de sécurité intérieure » de toute protection syndicale. Ils seront<br />
bien plus sévèrement affaiblis si l’assurance vieillesse, môle de résistance<br />
du pouvoir salarial, est privatisée.<br />
En regardant à nouveau cette liste, on aperçoit plusieurs des sempiternels<br />
ressentiments grognons des conservateurs – Social Security, impôt<br />
sur le revenu, réglementation des affaires, syndicalisme, État fort et centralisé<br />
à Washington – qui représentent les grandes batailles perdues au<br />
cours des premières décennies du XXe siècle. C’est pourquoi l’ère<br />
McKinley est vue comme un paradis perdu que la droite se donne pour<br />
but de restaurer. Grover Norquist, président de l’organisation Americans<br />
for Tax Reform et un des dirigeants les plus en vue du mouvement,<br />
confirme cette observation : « Oui, l’ère McKinley, moins le protectionnisme,<br />
admet-il, est l’objectif. Regardez l’histoire du pays dans ses 120<br />
premières années, jusqu’à Teddy Roosevelt, lorsque les socialistes ont pris<br />
le pouvoir. L’impôt sur le revenu, les droits de succession, les réglementations,<br />
tout ça. » (Dans le domaine de la politique étrangère, au moins,<br />
on peut presque dire de l’administration Bush qu’elle a déjà restauré<br />
l’esprit de cet âge révolu. Justifiant l’annexion des Philippines, McKinley<br />
expliqua, dans un discours resté célèbre, la mission américaine dans le<br />
monde : « Nous n’avions d’autre choix que de les prendre tous et d’éduquer<br />
les Philippins, de les élever, de les civiliser et de les christianiser, et,<br />
par la grâce de Dieu, leur donner le meilleur de nous-mêmes, à l’égal de<br />
nos semblables pour qui le Christ mourut aussi. »)<br />
Mais la mémoire de la droite est bien sélective. Les républicains, sous<br />
McKinley, alignés sur les positions des géants émergents de l’industrie,<br />
ont en effet tenu à distance les partisans de l’impôt fédéral sur le revenu<br />
et d’autres réformes, lors même que des droits de douane élevés étaient<br />
l’équivalent d’une forte taxe à la consommation. De surcroît, sa Cour<br />
suprême réactionnaire bloqua les lois conçues aux fins de protéger la<br />
société et les travailleurs au motif qu’elles contrevenaient au droit de<br />
propriété garanti par la Constitution.
44<br />
Mais la vérité est que le conservatisme de McKinley s’effondra non du<br />
fait des socialistes mais de ce qu’une nation profondément troublée fut<br />
plongée dans une succession de conflits économiques et sociaux générés<br />
par l’industrialisation et l’effrayant pouvoir en voie de consolidation<br />
au cœur du gigantisme industriel (luttes non résolues avant que la crise<br />
économique n’engendrât le New Deal). Réagissant aux demandes<br />
populaires, Teddy Roosevelt promulgua des réformes progressistes qui<br />
firent date, parmi lesquelles les premières réglementations fédérales<br />
protégeant la santé et la sécurité, ainsi que l’interdiction des contributions<br />
des firmes aux campagnes électorales. Roosevelt, comme son successeur,<br />
le républicain William Howard Taft, adhérèrent au concept d’un<br />
impôt progressif sur le revenu ainsi que d’autres mesures contraires à<br />
l’éthique républicaine adoptées plus tard sous Woodrow Wilson.<br />
George W. Bush ne mentionne jamais, bien entendu, les glorieuses réalisations<br />
de l’ère McKinley ni ne reconnaît les objectifs rétrogrades de<br />
son parti (Ari Fleischer ferraillerait contre toute suggestion contraire). Les<br />
conservateurs ont appris, et tout particulièrement de l’implosion de<br />
Gingrich, à éviter les proclamations idéologiques fracassantes. Au lieu<br />
de cela, les grandes lignes ne sont qu’évoquées dans divers textes officiels.<br />
Mais il n’est rien de véritablement secret concernant leurs intentions.<br />
Cela fait des années que les militants de droite et les think tanks<br />
n’ont de cesse d’articuler ouvertement ces finalités. Quelques-unes de<br />
leurs idées, qui paraissaient loufoques, sont maintenant loi.<br />
LA DROITE ŒCUMÉNIQUE<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (I)<br />
Le mouvement « avance à la vitesse d’un glacier », explique Martin<br />
Anderson, professeur émérite à la Hoover Institution de Stanford. Il<br />
servit de foyer intellectuel et de gardien de la foi à Reagan et fit partie<br />
des premiers universitaires à conseiller George W. Bush. « Il bouge très<br />
lentement, s’arrête parfois, recule même, mais c’est pour avancer à<br />
nouveau. Parfois, il butte sur un arbre et semble bloqué, alors l’arbre se<br />
fend et l’on entend des personnes s’exclamer : “Ma parole, c’est une<br />
révolution !” » Poursuivant la métaphore, Anderson pense que le glacier<br />
continuera sa course contre quelques gros rochers qui ne céderont<br />
pas, que la droite sera en fin de compte arrêtée, à cours d’objectifs
WILLIAM GREIDER 45<br />
grandioses tels que l’État minimum ou la suppression de l’impôt sur le<br />
revenu. Mais ils ont réalisé des progrès impressionnants jusqu’ici.<br />
Pour la première fois depuis les années 1920, le Congrès, la Maison-<br />
Blanche et la Cour suprême chantent le même refrain et, en général, se<br />
renforcent mutuellement. La majorité conservatrice de la Cour agit en<br />
vue d’amenuiser l’autorité fédérale, d’étouffer dans l’œuf les contestations<br />
citoyennes visant des institutions importantes et de tailler en<br />
pièces les acquis progressistes en matière de droits civiques, de lois de<br />
régulation et beaucoup d’autres (elle va même jusqu’à décider du sort<br />
d’une élection en sa faveur, quand c’est nécessaire).<br />
En attendant, Bush dispose de ce qui manquait à Reagan – une majorité<br />
reaganienne au Congrès. Quand les vieillards majestueux 4 gagnèrent<br />
en 1980, la plupart des républicains du Congrès étaient encore des<br />
conservateurs traditionnels, pas des réformistes radicaux. La majorité<br />
républicaine de la Chambre bascula vers une identité reaganienne en<br />
1984, celle du Sénat attendit 1994. Les rangs des non-convertis – ceux<br />
qui se refusent à signer l’engagement de Norquist à ne pas augmenter<br />
les impôts – s’élèvent maintenant, selon le calcul de ce dernier, à moins<br />
de 5 % du groupe à la Chambre et 15 % au Sénat.<br />
La solidarité idéologique est un élément clef du magistère de Bush.<br />
Aussi longtemps qu’il peut traiter les affaires d’État en accord avec le<br />
grand projet, la droite ne l’abat pas quand il imprime des déviations sensibles<br />
à sa politique – telles que des quotas d’importations pour l’acier<br />
et un nouveau projet de loi de subventions aux agriculteurs.<br />
Ce qui aide également est la discipline stalinienne que les dirigeants du<br />
GOP imposent à leurs troupes, en particulier à la Chambre. Bush rassure<br />
aussi l’extrême droite en faisant entendre qu’il est un des siens. Reagan,<br />
lui, chaussa les thèmes de la droite chrétienne dans sa rhétorique sociale<br />
mais lui accorda bien peu sur les autres sujets (l’homme venait de<br />
Hollywood, après tout). Bush est un vrai croyant, un chrétien dévot qui<br />
en rajoute en public. Sa principale innovation – qu’il tire du registre de<br />
Bill Clinton – est de brouiller les frontières avec l’opposition en offrant<br />
ses propres alternatives compassionnelles, récupérant ou étouffant les<br />
4. Le Parti républicain répond souvent au surnom de « Grand Old Party » (le « vieux<br />
parti majestueux »). Sous sa forme contractée, GOP, il peut donner lieu à plusieurs<br />
déclinaisons, dont celle-ci, « Gipper ». [ndt]
46<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (I)<br />
initiatives démocrates. Au contraire de Clinton, il n’apaise pas sa base<br />
électorale en multipliant les gestes creux. Son programme est le sien.<br />
Selon Paul Weyrich, dirigeant du Free Congress Foundation et tête de<br />
proue du mouvement, « Reagan était un beau parleur dans les<br />
domaines domestiques mais il n’a pas vraiment accompli grand-chose.<br />
De même, l’ère Gingrich, c’était beaucoup de palabres. Cette administration<br />
est de loin plus sérieuse et disciplinée… ils ont un meilleur<br />
entregent que n’importe quel individu avec qui j’ai pu traiter. Ces<br />
gens-là ont imaginé comment communiquer régulièrement avec leur<br />
électorat, s’assurer qu’il comprend ce qu’ils font. Quand ils doivent<br />
aller à l’encontre de leur base, ils savent comment se protéger de ce<br />
qui pourrait arriver. »<br />
L’ambition de Norquist est de bâtir sur ses forces actuelles une droite<br />
capable de diminuer de moitié l’administration lors de ces vingt-cinq<br />
prochaines années, « d’en venir à la taille où nous pourrons la noyer<br />
dans la baignoire ». L’État fédéral se rétracterait de 20 % du PIB à<br />
10 %, les pouvoirs publics fédérés et locaux passeraient de 12 à 6%.<br />
Quand les bons deviendront disponibles pour tous, il s’attend à ce que<br />
la part des écoles publiques chute de 6 à 3 % du PIB. « Et nous aurons<br />
de meilleures écoles », assure-t-il. Les individus de la trempe de<br />
Norquist jouent le rôle consistant à repousser continûment les limites<br />
du possible. « Je rassemble les soutiens en faveur de l’abolition de l’impôt<br />
minimum parallèle 5 . Bush a-t-il parlé en ce sens ? Non. Je veux<br />
continuer à courir en tête, atteler nos gars à la tâche. Ainsi je serai aux<br />
avant-postes de l’administration Bush, et non en train de l’attaquer.<br />
Fera-t-il tout ce que nous voulons de lui ? Non, mais vous savez quoi ?<br />
Je m’en fiche. »<br />
L’organisation Americans for Tax Reform sert en quelque sorte de clef<br />
de voûte à une nébuleuse d’intérêts conservateurs, comme l’atteste la<br />
provenance de ses fonds : Microsoft, Pfizer, AOL Time Warner, R.J.<br />
Reynolds et l’industrie de l’alcool. Norquist explique : « La question qui<br />
amène les individus à la politique est la suivante : qu’attendent-ils de<br />
l’administration ? Les nôtres veulent que la puissance publique les<br />
laisse tranquilles. Pour être dans cette coalition, vous avez juste besoin<br />
5. Alternative minimum tax, Impôt payé par les contribuables les plus fortunés dans<br />
le but de limiter l’évasion fiscale. [ndt]
WILLIAM GREIDER 47<br />
d’avoir votre pied à l’intérieur du cercle sur une seule question. Vous<br />
n’avez pas besoin d’une Weltanschauung [vision du monde], vous<br />
n’avez pas à être d’accord sur les autres sujets, aussi longtemps que la<br />
coalition est tendue vers cet objectif. C’est pourquoi la bataille redoutée<br />
ne fait pas rage dans les rangs du centre-droit. C’est pourquoi nous<br />
pouvons l’emporter. »<br />
L’une des plus grandes réalisations politiques de la droite est d’avoir<br />
réuni différents sectaires autrefois dressés dans une opposition résolue.<br />
Norquist observe que, « traditionnellement, le parti républicain était<br />
enraciné dans l’orthodoxie protestante et gardait agressivement ses distances<br />
avec les autres religions. Maintenant, nous avons des catholiques<br />
pratiquants, le genre d’individus qui va à la messe tous les dimanches,<br />
des chrétiens évangéliques, des mormons, des juifs orthodoxes et des<br />
musulmans ». Comment cela est-il arrivé ? « La gauche laïque a engendré<br />
une droite œcuménique. » Cette nouvelle tolérance, y compris sur<br />
des questions raciales, pourrait représenter une métamorphose sociale<br />
significative, mais la droite, bien entendu, se nourrit aussi de l’intolérance,<br />
diabolisant ceux dont les valeurs, le style de vie ou le lieu de naissance<br />
n’est pas conforme à leur idée de l’« Amérique ».<br />
Cette propension, Norquist le reconnaît, est une vulnérabilité. Le gonflement<br />
de l’immigration latino-américaine et asiatique pourrait la<br />
constituer en force de changement de la politique américaine, une fois<br />
ces millions de nouveaux citoyens devenus suffisamment confiants dans<br />
les institutions pour participer aux élections (de la même manière que<br />
les immigrés européens se muèrent en force vitale de la réforme progressiste<br />
du début du XXe siècle). Aussi Bush travaille-t-il à reconfigurer<br />
la thématique anti-immigrés du parti – tâche à laquelle il s’attela non<br />
sans succès avec les Américains d’origine mexicaine au Texas.<br />
Norquist préfère porter son attention sur les tendances démographiques<br />
dont il croit qu’elles peuvent assurer le triomphe final de la droite :<br />
quand les enfants du New Deal mourront, ils seront remplacés par de<br />
jeunes conservateurs « laisse-moi-tranquille ». Anderson, l’ancien<br />
conseiller de Reagan, est moins affirmatif. « La plupart des gens approuvent<br />
l’action du gouvernement, observe-t-il. Tant qu’il n’est pas trop<br />
intrusif, ils en sont heureux. »
48<br />
MONTRE-MOI L’ARGENT<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (I)<br />
L’idéologie peut bien procurer le principe unificateur, mais le véritable<br />
ciment du mouvement est la règle d’or de son pragmatisme politique :<br />
chaque mesure qu’il met en œuvre, chaque mouvement infime en direction<br />
de la vision majestueuse doit se traduire en récompenses concrètes<br />
pour une fraction de son électorat, si ce n’est plusieurs – et tout de suite,<br />
pas dans un futur lointain. D’ordinaire, la récompense, c’est l’argent. Il<br />
n’y a là rien d’inhabituel ou d’illégitime, mais cela ressemble à de l’hypocrisie<br />
pure quand on voit quelle débauche d’énergie la droite dépense<br />
à la dénonciation du clientélisme sur sa gauche (enseignants, syndicats,<br />
bureaucrates, Hollywood). Les groupes d’intérêts de la droite jouent de<br />
leurs muscles en faveur de la cause, point par point. Les comptes « capital<br />
vie » [lifetime savings] de Bush constituent une nouvelle ligne de produits<br />
attractifs pour le secteur de la finance, naturellement enthousiaste<br />
à l’idée de commercialiser et gérer ces comptes. Les dispositions du projet<br />
favorisent spécifiquement les nantis, puisqu’un ménage de quatre<br />
personnes pourra mettre à l’abri jusqu’à 45 000 dollars par an – ce qui<br />
est supérieur à ce que gagnent la plupart des familles en une année. La<br />
Maison-Blanche a établi la liste des 500 entreprises les plus prospères<br />
afin qu’elles répandent la bonne nouvelle auprès de la classe des investisseurs<br />
dans leurs envois réguliers de courriers aux actionnaires.<br />
Les réformes de Bush en matière de santé s’effectuant dans le sens du<br />
marché, elles profiteront à deux secteurs de l’économie que de nombreux<br />
consommateurs considèrent avec défiance : les compagnies pharmaceutiques<br />
et les organismes médicaux privés. Les grandes firmes<br />
pharmaceutiques accéderont au meilleur des mondes : une subvention<br />
fédérale à raison des achats de médicaments prescrits pour les personnes<br />
âgées, mais sans aucun contrôle sur les prix. Le secteur de l’assurance<br />
est convié à organiser une version privée de Medicare, qui serait<br />
en concurrence avec le système public (on suppose, par là, qu’il y a suffisamment<br />
de citoyens âgés enclins à prendre le risque).<br />
Certaines récompenses n’ont pas trait à l’argent. Bush a déjà accordé<br />
une victoire aux adversaires de l’avortement avec l’interdiction des avortements<br />
tardifs. Ils sont maintenant devenus réalistes et ne harcèlent plus<br />
le GOP en vue d’un amendement constitutionnel, mais peut-être qu’une<br />
future Cour suprême, grosse de membres franchement conservateurs,
WILLIAM GREIDER<br />
fera le travail à leur place. L’année 2004, les républicains vont s’épuiser<br />
dans un combat sur la question des armes, l’interdiction fédérale portant<br />
sur les fusils d’assaut devant expirer. Les progressistes, espèrent-ils, tenteront<br />
de renouveler la loi, si bien que le GOP pourra distribuer une<br />
récompense visible en l’enterrant en cette année d’élection. (Les tenants<br />
d’une réglementation du port d’armes pensent contraindre Bush à choisir<br />
entre le lobby des armes et l’opinion publique.)<br />
Les plus grosses récompenses, bien sûr, concernent la fiscalité, et l’autodiscipline<br />
des troupes est impressionnante. Quand Reagan proposa ses<br />
énormes baisses d’impôt en 1981, les lobbyistes de K Street 6 chargèrent<br />
la barque de leurs propres listes de cadeaux et la Maison-Blanche perdit<br />
pied ; elles créèrent une hémorragie fiscale bien plus importante que<br />
prévue. Cette fois-ci, les entreprises ont appris à se comporter correctement.<br />
Ainsi, lorsque Bush soumit un train de réduction d’impôts dans<br />
lequel ne figuraient pas ceux de leurs souhaits. « Ils soutinrent les baisses<br />
d’impôts de 2001 parce qu’ils savaient qu’elles seraient suivies d’autres<br />
diminutions chaque année, et si vous ne soutenez pas le lot de cette<br />
année, vous pourrez le faire la fois prochaine », analyse Norquist. Leur<br />
patience a déjà été récompensée. Le mouvement anti-fiscaliste suit un<br />
scénario bien établi pour progresser pas à pas vers le but ultime.<br />
Norquist a organisé cinq groupes parlementaires en vue de rallier les<br />
soutiens et mener une campagne sur les cinq propositions suivantes :<br />
abrogation des droits de succession (déjà promulguée mais toujours vulnérable)<br />
; réformes du système de financement des retraites ; suppression<br />
de l’impôt minimum parallèle ; déductions fiscales immédiates pour<br />
les dépenses d’investissement (au lieu d’un amortissement sur plusieurs<br />
années) ; et pas de taxation des plus-values. Norquist explique : « Si nous<br />
faisons toutes ces choses, il n’y aura pas d’impôt sur le capital et nous<br />
serons très près d’un impôt proportionnel. »<br />
Le chemin qui reste à parcourir est bien plus difficile qu’il n’apparaît à<br />
l’entendre, parce que, au fur et à mesure, beaucoup de gens découvriront<br />
qu’ils ne peuvent qu’y perdre. En fait, la vision McKinley exige de<br />
vastes pans de la société qu’ils paient très cher, et de leurs propres<br />
poches. Martin Anderson a beau travailler l’arithmétique de l’impôt proportionnel,<br />
il y a toujours un perdant. « Tous les conservateurs veulent<br />
6. Rue de Washington où sont concentrés la plupart des courtiers en lobbying. [ndt]<br />
49
50<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (I)<br />
révolutionner le système fiscal ; franchement, parce qu’ils n’y ont pas<br />
trop réfléchi, affirme-t-il. Cela signifie que les individus gagnant entre<br />
zéro et 35 000 dollars ne paieront pas d’impôt et toute personne touchant<br />
plus de 150 000 dollars aura droit à une baisse d’impôt. Entre ces<br />
deux tranches, les contribuables verront leurs contributions augmenter,<br />
sauf à réduire le train de vie de l’État. Et cela n’est pas près d’arriver. »<br />
De même, toute taxe à la consommation de quelque importance lèse<br />
gravement une autre couche importante de la population : les personnes<br />
âgées. Elles ont déjà été taxées étant jeunes, gagnant et épargnant<br />
leur argent, elles le seront à nouveau en le dépensant. Lawrence<br />
Lindsey, un ancien conseiller économique du président, défendit une<br />
taxe proportionnelle à la consommation qu’il serait probablement nécessaire<br />
d’établir à 21 %. Il concède que « cela frappera la génération<br />
actuelle de personnes âgées deux fois. Elle en sera plus dure à vendre ».<br />
Le « choix scolaire » est aussi essentiellement une question d’argent,<br />
bien que cela ait été masqué par des années de diabolisation des écoles<br />
publiques et de leurs professeurs par les républicains. Avec les frais de<br />
scolarité payés par les bons [tuition vouchers], la redistribution des revenus<br />
s’opérera de l’ensemble des contribuables vers la minorité de<br />
familles américaines qui envoient leurs enfants dans des écoles privées,<br />
religieuses comme laïques. Ces enfants représentent moins de 10 % des<br />
52 millions d’écoliers du pays. À suivre le débat sur le « choix scolaire »,<br />
on s’étonnera que la part de marché de l’enseignement privé s’est en<br />
réalité légèrement effrité au cours de la dernière décennie. Le réseau de<br />
paroisses catholiques sort gagnant du financement public, puisque ses<br />
effectifs ont fondu de moitié depuis les années 1960 (pour atteindre<br />
aujourd’hui 2,6 millions d’élèves). Bien que l’on constatât une certaine<br />
croissance dans les années 1990, elle concerna les banlieues, non les<br />
villes. D’autres écoles privées, notamment les établissements religieux<br />
du Sud, virent leurs effectifs augmenter davantage au cours de la dernière<br />
décennie (d’environ 400 000 élèves), mais sans égaler les écoles<br />
publiques, qui gagnèrent 6 millions d’élèves. Le fait est que la base électorale<br />
de la droite en faveur du « choix scolaire » demeure une minuscule,<br />
quoique fervente, minorité.<br />
Les conservateurs ont intelligemment transformé la question du « choix<br />
scolaire » en un enjeu d’égalité raciale – soutenant que les bons constituent<br />
le meilleur moyen de libérer les enfants noirs indigents des
WILLIAM GREIDER<br />
banlieues déshéritées. Quoi qu’il en soit de la qualité de l’éducation, il<br />
ne va pas de soi que les écoles privées, y compris l’ensemble des<br />
paroisses catholiques, soient disposées à résoudre le problème de l’instruction<br />
des minorités, puisque elles appliquent elles-mêmes une forte<br />
ségrégation. Les établissements catholiques n’accueillent que 2,5 % des<br />
étudiants noirs et, plus révélateur encore, seulement 3,8 % des enfants<br />
hispaniques, dont la plupart sont pourtant catholiques. Dans le Sud, des<br />
centaines d’écoles privées s’exonérèrent des obligations d’intégration et<br />
furent initialement soutenues par des subventions de l’État (par la suite<br />
déclarées inconstitutionnelles). Le choix scolaire, pour faire court, pourrait<br />
très bien financer une plus grande ségrégation raciale – le choix des<br />
Blancs de rester entre eux – aux dépens du public.<br />
L’attaque de la droite visant la réglementation environnementale présente<br />
un profil similaire. À sa tête, nous avons une coalition de petits<br />
propriétaires et d’agriculteurs de l’Ouest qui multiplient les vibrants plaidoyers<br />
en faveur de l’autonomie pour jouir de leurs propriétés et en<br />
prendre soin consciencieusement ; et à leurs côtés des entrepreneurs<br />
immobiliers et le gros de l’industrie (polluante), impatients de bénéficier<br />
des mêmes droits, en les obtenant sinon du Congrès, du moins de la<br />
Cour suprême. Mais il y a comme un souci : l’écrasante majorité des<br />
Américains veut des normes environnementales plus contraignantes et<br />
mises en œuvre de façon plus vigoureuse.<br />
ONT-ILS RAISON AU SUJET DES ÉTATS-UNIS ?<br />
« Laisse-moi tranquille » est un slogan qui ne manque pas de charme.<br />
Seulement, la droite méconnaît régulièrement son principe directeur.<br />
Les adversaires de l’avortement entendent se servir des leviers étatiques<br />
pour imposer leurs propres valeurs morales à l’ensemble du corps<br />
social. Les partisans du libre-échange tombent dans le mutisme quand<br />
Bush et le Congrès interviennent en vue de renflouer les compagnies<br />
aériennes, les assurances et les banques – quel que soit le secteur en<br />
crise. Les conservateurs purs et durs sont carrément enthousiastes<br />
lorsque la Cour suprême, conjointement au ministère de la Justice, taille<br />
en pièces nos libertés fondamentales. Le mouvement en faveur du<br />
« choix scolaire » ne cherche pas une administration réduite mais une<br />
51
52<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (I)<br />
extension considérable des obligations des contribuables. Sans doute la<br />
droite ne veut-elle pas être « laissée tranquille » par la puissance<br />
publique mais bien plutôt se servir de celle-ci pour façonner la société à<br />
sa propre image. L’un dans l’autre, le programme de la droite est une<br />
promesse de restructuration qui conduira le pays à de plus grandes segmentations<br />
et ségrégations entre ses nombreuses couches sociales – des<br />
murs plus hauts et une plus grande distance pour ceux qui souhaitent<br />
se protéger d’une souillante diversité. La tendance à la déstructuration<br />
sociale, qui s’est traduite notamment par un éclatement progressif de sa<br />
large classe moyenne, s’est développée pendant plusieurs décennies –<br />
fissures générées par des inégalités croissantes en termes de statut<br />
social et de bien-être. La droite propose de légitimer et d’encourager ces<br />
changements sociaux profonds au nom d’une plus grande autonomie :<br />
démanteler les biens collectifs, rendre aux personnes leurs impôts et<br />
laisser tout un chacun se débrouiller seul.<br />
Est-ce le pays que les Américains veulent pour leurs petits-enfants et<br />
arrière-petits-enfants ? Si l’on met de côté la nostalgie républicaine de<br />
l’ère où l’on s’éclairait au gaz, celle de McKinley, il s’agissait en fait<br />
d’une période trouble et sombre pour bien des Américains et la société<br />
dans son ensemble, déchirée qu’elle était par des conflits économiques<br />
très durs et l’indifférence sociale à l’égard des brutalités quotidiennes.<br />
L’autonomie peut être solitaire et glacée, comme des millions<br />
d’Américains l’ont appris ces dernières années quand leur entreprise a<br />
annulé leurs pensions et la Bourse englouti leurs économies ou que les<br />
intérêts industriels ont ravagé leurs banlieues. Pour la plupart, il ne saurait<br />
y avoir de redressement sans action collective, sans effort commun<br />
basé sur la confiance réciproque et le partage des responsabilités. En<br />
d’autres termes, je ne crois pas à une identité de vues entre la majorité<br />
des Américains et la droite. Mais je pense aussi que beaucoup ne voient<br />
pas clairement les alternatives ou n’en saisissent pas les implications à<br />
long terme pour le pays 7 .<br />
WILLIAM GREIDER, 12 mai 2003<br />
7. Nous avons écourté l’article à partir de ce point, sa conclusion nous semblant<br />
s’adresser essentiellement, sur le mode incantatoire, au lecteur américain ; celle-ci<br />
prenait en outre, dans le cadre de l’alternative fermée démocrate/républicain, le parti<br />
de la prudence réaliste. [ndlr].
SERGE HALIMI 53<br />
La parenthèse populiste<br />
Comment la gauche abandonne le peuple<br />
ÀL’ORIGINE, C’EST-À-DIRE AU XIX e SIÈCLE, le parti démocrate n’était pas<br />
progressiste. Il concourait par exemple bien davantage que les<br />
républicains à l’affirmation de la suprématie raciale des Blancs et<br />
s’opposait aux programmes d’équipements publics lancés par le gouvernement<br />
fédéral : « Tous peuvent être réalisés à moindre coût par les<br />
entreprises privées ou par les autorités locales », expliquait en 1854<br />
Stephen Douglas qui, six ans plus tard, serait le candidat que les démocrates<br />
opposeraient au républicain Abraham Lincoln. En 1888, Grover<br />
Cleveland, démocrate lui aussi, s’offusque que « des allocations sous<br />
forme de retraites soient versées à des demandeurs pour la seule raison<br />
qu’ils se trouveraient dans le besoin […], sans autre motif que leur état<br />
de nécessité 1 ». Au fond, l’idée clé des démocrates du XIX e siècle – le<br />
meilleur État est celui qui gouverne le moins – va résumer plus tard<br />
l’idéologie républicaine (armée, police et prisons non comprises). Une<br />
différence, toutefois, non négligeable : les démocrates ne vénèrent pas le<br />
1. Cette citation et la plupart de celles qui suivent sur ce thème sont tirées de<br />
John Gerring, Party Ideologies in America 1828-1996, Cambridge University<br />
Press, Cambridge, 2001, p. 169.<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 53-74
54<br />
LA PARENTHÈSE POPULISTE<br />
marché et se méfient de la spéculation financière qui selon eux dépouille<br />
le travailleur des fruits de son labeur. Néanmoins, l’État fédéral – parce<br />
qu’il est lointain, généralement entre les mains des républicains, opérant<br />
en symbiose avec les intérêts des « trusts » – est perçu comme plus<br />
spoliateur encore que la main invisible.<br />
Vers la fin du XIX e siècle, il n’y a plus place aux États-Unis pour deux<br />
partis disposés l’un et l’autre à conserver l’ordre social, voire à le<br />
« moderniser » de manière à ce qu’il devienne plus inégalitaire encore.<br />
En Europe, un épuisement du même ordre débouche sur le remplacement<br />
progressif des formations centristes, « radicales » ou agrariennes<br />
par des partis socialistes (voire communistes à partir de 1920). Cette<br />
métamorphose n’interviendra pas aux États-Unis pour un faisceau de<br />
raisons – enracinement des clivages ethniques liés à une immigration<br />
continue, mobilité sociale et géographique procurée par la « frontière »,<br />
poids de la religion, idéologie individualiste, etc. Même au temps de sa<br />
splendeur, le parti socialiste américain (PSA) ne compte que 118 000<br />
membres. Et son candidat, Eugene Debs, n’obtient que 6 % des voix en<br />
1912. Le système électoral à un seul tour est conçu, il est vrai, pour interdire<br />
l’apparition d’une troisième force politique. Mais, au Royaume-Uni,<br />
une contrainte semblable n’empêchera pas le surgissement du parti<br />
travailliste aux dépens du parti libéral.<br />
Le terrain américain de la contestation anticapitaliste ne reste pas en<br />
jachère pour autant. Parallèlement au travail de mobilisation conduit par<br />
les socialistes, tournés vers la classe ouvrière, le parti populiste puis la<br />
tendance « populiste » du parti démocrate ciblent les petits agriculteurs<br />
du type de ceux que John Steinbeck décrit dans Les Raisins de la colère.<br />
Cette orientation s’amplifie à partir de 1896, et elle inspirera la rhétorique<br />
officielle des démocrates, Franklin Roosevelt et Harry Truman<br />
compris, jusqu’au début des années 1950. Si l’on doit évoquer ici cette<br />
phase « populiste », c’est que son abandon progressif, l’effacement du<br />
discours de classe qui la caractérise, l’enfermement dans un univers d’experts,<br />
de technocrates, d’intellectuels et d’artistes de moins en moins<br />
intéressés par la question sociale vont, à partir des années 1960, libérer<br />
un électorat populaire en déshérence pour une mobilisation de type<br />
réactionnaire. D’abord « démocrates pour Nixon », puis « démocrates<br />
pour Reagan » (Reagan Democrats), ces millions d’Américains reprendront<br />
la vieille antienne du « Ce n’est pas moi qui ai abandonné mon<br />
parti, c’est mon parti qui m’a abandonné ». Presque au même moment,
SERGE HALIMI 55<br />
souvent pour des raisons opposées (guerre du Vietnam en particulier),<br />
l’aile la plus à gauche abandonne le parti démocrate elle aussi…<br />
REFUS DU « POPULISME » OU MÉPRIS DU PEUPLE ?<br />
De nos jours, le populisme a d’autant plus mauvaise presse que ceux qui<br />
écrivent (ou réécrivent) l’histoire appartiennent aux milieux privilégiés et<br />
fréquentent souvent, en tant qu’experts et commentateurs, les gouvernants<br />
et les industriels. L’épithète « populiste» – qu’ils dispensent généreusement<br />
à Juan Perón et à Arlette Laguiller, à Benito Mussolini et à<br />
Bernard Tapie, à Margaret Thatcher, Pierre Poujade, Silvio Berlusconi et<br />
Jean-Marie Le Pen – a surtout une fonction politique, celle de disqualifier<br />
tous ceux qui, à des titres infiniment divers, opposés même, ont remis en<br />
cause le consensus centriste, la pensée unique de leur époque, en en tirant<br />
parfois un supplément de popularité. Le lien est forcément ténu entre<br />
tous ces acteurs proclamés populistes par les gardiens de la paix intellectuelle<br />
: discours destiné aux classes populaires et moyennes, opposition<br />
aux « élites » (aristocratiques dans le cas de Margaret Thatcher), capacité<br />
de ciseler une formule qui fait mouche ou d’utiliser les moyens de communication<br />
modernes, volonté de mobiliser politiquement des citoyens<br />
excédés par le « système », la corruption, le crime. Mais si vouloir s’adresser<br />
à la majorité du peuple devient gage de populisme – et à ce titre<br />
marque d’infamie –, mieux vaudrait sans doute en revenir au suffrage censitaire,<br />
ou même ne plus soumettre les questions importantes qu’à l’arbitrage<br />
des élites éduquées. « Seule politique possible » ou populisme :<br />
l’alternative ainsi agencée par une junte inamovible de petits penseurs,<br />
abusivement qualifiés de « grands éditorialistes », a surtout pour fonction<br />
d’interdire de choisir dès lors que les choix et les jeux sont faits. Cette<br />
mise à l’index intellectuelle et technocratique de toute contestation,<br />
« bonne » ou « mauvaise », a perverti la gauche gouvernante américaine<br />
dès les années 1950, avant de contaminer la social-démocratie européenne<br />
trente ans plus tard. Avec les conséquences que l’on sait sur leur<br />
influence respective dans les milieux populaires.<br />
Le peuple et les élites : en matière de « populisme », tout est évidemment<br />
question de définition. Qui est le peuple ? Qui sont les élites ? Aussi<br />
longtemps que la question ne se posa pas vraiment, le populisme ne<br />
constitua une hantise que pour la droite. Car le peuple, c’était d’abord à
56<br />
LA PARENTHÈSE POPULISTE<br />
gauche qu’on le trouvait. Et la « croix d’or », la « presse de Wall Street »,<br />
les « rois de la finance qui achètent le Congrès » (William Jennings Bryan<br />
en 1896), les « cent ou deux cents “je-sais-tout” qui contrôlent les cordons<br />
de la bourse de la Nation » 2 (Franklin Roosevelt en 1936) étaient<br />
surtout repérés dans le camp d’en face.<br />
Les passerelles furent nombreuses entre les socialistes américains et les<br />
populistes. Mais les différences idéologiques de fond imprimaient des<br />
identités fortement distinctes. Les populistes américains ne remettaient<br />
en cause le capitalisme ni dans son ensemble ni dans sa logique. Ils<br />
dénonçaient surtout ce qui faisait obstacle à la promotion sociale de leurs<br />
électeurs dans le système existant : privilèges politiques, cartels, monopoles,<br />
banques, « aristocratie de papier ». La centralisation les effrayait ;<br />
ils lui préféraient l’action des associations ouvrières et des coopératives<br />
d’agriculteurs. À défaut d’une analyse matérialiste de l’histoire, leur<br />
explication de ce qui advenait laissait une large place aux complots et<br />
aux explosions de colère. « Les populistes, écrit Christopher Lasch,<br />
n’imaginaient pas à quel point l’indignation d’un instant retombe vite et<br />
redevient de l’indifférence sitôt que les revendications immédiates sont<br />
satisfaites. Bien davantage que les socialistes, disposés à un travail de<br />
longue durée pour créer une conscience de masse de la supériorité<br />
morale de l’ordre socialiste, les populistes américains ont toujours été<br />
sujets au découragement quand leurs espoirs d’une transformation<br />
rapide se sont métamorphosés en poussière. 3 »<br />
Contrairement à une croyance tenace, c’est à partir de 1896, et non du<br />
New Deal, que le parti démocrate rompt avec la tradition « libérale »<br />
américaine d’un État croupion pour devenir l’avocat d’une politique de<br />
redistribution des revenus. Il le fait en parvenant – comme Ronald<br />
Reagan plus tard, mais en sens inverse – à redéfinir certaines des notions<br />
de base de la culture « politique » des États-Unis : liberté, humanité,<br />
individu, famille. Sans oublier, bien sûr, la religion, dès lors que, pour les<br />
2. Cités in ibid., p. 196. En France, à partir des années 1920 et jusqu’à la<br />
Seconde Guerre mondiale, la gauche stigmatisera les « deux cents familles »,<br />
c’est-à-dire les principaux actionnaires de la Banque de France, semi-publique<br />
jusqu’en 1936. On doit la formule au très peu révolutionnaire Édouard<br />
Daladier, en 1934.<br />
3. Christopher Lasch, The Agony of the American Left, Vintage Books, New York,<br />
1969, p. 9.
SERGE HALIMI 57<br />
« populistes », l’égalité des origines a été détruite par l’introduction de<br />
formes non naturelles d’organisation économique. « Dieu a créé tous les<br />
hommes, explique William Jennings Bryan en 1899, et il n’en a pas créé<br />
certains pour qu’ils rampent et d’autres pour qu’ils leur grimpent sur le<br />
dos. » Franklin Roosevelt n’a qu’à reprendre cette thématique pour justifier,<br />
en 1936, les expérimentations économiques et sociales auxquelles<br />
il va se livrer, et, face aux maîtres de l’« efficience », pour excuser par<br />
avance les erreurs auxquelles ces expérimentations conduiront :<br />
« L’immortel Dante nous dit que la justice divine mesure différemment<br />
les péchés nés du cynisme et ceux qui ont pour motif le désir de bien<br />
faire. Mieux vaut les fautes d’un État qui vit dans un esprit de charité que<br />
les omissions délibérées d’un État gelé dans la glace de son indifférence.<br />
» Il enchaîne : « La liberté réclame la possibilité de gagner sa vie<br />
– une vie décente conforme au niveau général de l’époque, une vie qui<br />
ne procure pas seulement à l’homme les moyens de subsister, mais lui<br />
donne des raisons de vivre. » 4 Quatre ans plus tard, à défaut de promettre<br />
du pain et des roses, comme le fera le Front populaire français, la<br />
plate-forme du parti démocrate s’engage à «œuvrer en permanence pour<br />
une distribution équitable de notre revenu national entre tous ceux qui<br />
travaillent 5 ». Ce rappel souligne assez la plasticité de certains concepts<br />
et, par conséquent, le rôle important de ceux, hommes politiques ou<br />
fondations intellectuelles, qui savent les interpréter de manière à ce qu’ils<br />
favorisent des politiques particulières. Pour les pauvres et les salariés<br />
modestes, la liberté américaine, ce fut tantôt l’assurance qu’on disposerait<br />
à la fois des moyens de subsister et de « raisons de vivre »<br />
(Roosevelt), tantôt la certitude de devoir assumer, durement, seul le cas<br />
échéant, son incapacité à se procurer ces moyens-là (Reagan). En 1984,<br />
républicains et démocrates vont s’opposer, on le verra, autour de la signification<br />
d’un autre mot, également très disputé : celui de « famille »,<br />
métaphore de la solidarité entre parents pour les uns, substitut à l’action<br />
de l’État pour les autres.<br />
« Populiste » ou non, le parti de Roosevelt apprend, au cours des<br />
années 1930, à tirer parti de la catastrophe économique qu’on lui lègue et<br />
du triomphe politique qu’elle lui ouvre (vingt années de présidence<br />
4. Discours du 27 juin 1936, cité in John Gerring, Party Ideologies in America<br />
1828-1996, op. cit., p. 212.<br />
5. Plate-forme du parti démocrate en 1940, citée in ibid., p. 215.
58<br />
LA PARENTHÈSE POPULISTE<br />
ininterrompue) pour transformer le terrain idéologique « de manière à<br />
pouvoir conduire, à l’échelle fédérale, pour la première fois dans l’histoire<br />
des États-Unis, les politiques sociales que les progressistes avaient imaginées<br />
depuis le début du siècle 6 ». Plus généralement, la crise de 1929,<br />
intervenue dans un contexte de capitalisme déréglementé, dissout les<br />
résistances à l’intervention de l’État dans la vie économique : redistribution<br />
des richesses, création monétaire, stimulation de la demande. Cette<br />
intervention peut être plus massive encore, comme dans le cas de la<br />
Tennessee Valley Authority 7 . Et le président démocrate ne s’interdit pas<br />
d’invoquer contre le patronat les souvenirs de la Révolution américaine :<br />
derrière les « royalistes économiques » qu’il fustige, c’est la figure honnie<br />
des anciens tyrans britanniques qu’il veut exorciser. Au début du siècle,<br />
William Jennings Bryan expliquait : « Les grandes entreprises sont des<br />
créatures de la loi. Elles n’ont d’autres droits que ceux que le peuple leur<br />
confère […]. Il peut leur imposer les limitations que requiert la protection<br />
du bien public. » Roosevelt lui fait écho en 1938 : « Lorsque les intérêts<br />
du plus grand nombre sont en cause, les intérêts de quelques-uns doivent<br />
céder. » 8 Quand, avec un aplomb admirable, Ronald Reagan osera revendiquer<br />
dans les années 1980 l’héritage de Roosevelt, il y parviendra en<br />
partie parce qu’il aura alors redéfini avec maestria la figure du Léviathan<br />
contrôlé par quelques-uns, auquel « le peuple » a le droit de s’opposer.<br />
Ce sera l’État. Et Reagan n’oubliera jamais de faire figurer les grandes<br />
entreprises au nombre des rebelles légitimes, puisqu’elles ont été «élues »<br />
par ce peuple qui leur achète leurs marchandises et leurs marques 9 .<br />
6. Ibid., p. 230.<br />
7. Créée en 1933, la Tennessee Valley Authority pilotera, dans sept États du<br />
Sud, un gigantesque programme de barrages publics destiné à maîtriser les<br />
crues, à produire de l’électricité, à développer la navigation, à favoriser la bonification<br />
et la culture des terres. C’est l’un des exemples les plus spectaculaires<br />
et les plus populaires d’une intervention vigoureuse de la puissance publique<br />
dans la vie économique et sociale du pays, l’un des « joyaux » du New Deal.<br />
8. William Jennings Bryan, discours du 20 janvier 1900 ; Franklin Roosevelt,<br />
discours du 21 septembre 1938. Pour ces citations, John Gerring, Party<br />
Ideologies…, op. cit., p. 195.<br />
9. Sur cette thématique du « populisme de marché », lire Thomas Frank, Le<br />
Marché de droit divin. Capitalisme sauvage et populisme de marché, <strong>Agone</strong>,<br />
Marseille, 2003. (De cet auteur, lire infra, p. 155. [ndlr])
SERGE HALIMI 59<br />
LE TEMPS DES RÉVISIONS<br />
Aux yeux d’une coalition offensive, même la Constitution et le droit sont<br />
moins sacrés qu’on l’imagine. Dans les années 1980-1990, les républicains<br />
ne cessent de proposer des amendements constitutionnels destinés<br />
à institutionnaliser leurs préférences politiques et sociales : prière dans<br />
les écoles, imputation de délit (et non plus seulement d’expression discutable<br />
ou offensante) pour ceux qui brûlent des drapeaux américains,<br />
prohibition légale de tout déficit budgétaire, protection juridique du<br />
fœtus, etc. En vain, le plus souvent, mais l’effet de mobilisation est réel.<br />
Au temps de leur élan populiste, c’étaient les démocrates qui avaient<br />
assez d’audace pour discuter le caractère sacré d’une Constitution à vrai<br />
dire fort peu démocratique. Jusqu’au New Deal, ses dispositions sacralisant<br />
la propriété furent d’ailleurs sans cesse invoquées par des juges<br />
conservateurs, y compris ceux de la Cour suprême, afin d’endiguer des<br />
législations progressistes en matière de fiscalité, de droit syndical, de<br />
mise en cause des monopoles, de protection de l’hygiène et de la sécurité<br />
des travailleurs. Car non seulement la Constitution américaine n’assurait<br />
pas l’égalité qu’elle promettait, mais elle protégeait ceux que<br />
Woodrow Wilson appela en 1912 « les maîtres des États-Unis », c’est-àdire<br />
« les capitalistes et les manufacturiers ». L’idéologie dominante<br />
sacralisait l’individualisme ? Qu’à cela ne tienne, les démocrates exaltaient<br />
un type particulier d’individu : « Les hommes qui m’intéressent<br />
sont ceux dont on n’entend jamais la voix, auxquels les journaux ne<br />
consacrent jamais une ligne, qui ne montent jamais sur une tribune, qui<br />
n’ont jamais accès aux responsables des affaires publiques, mais ceux qui<br />
poursuivent dans le silence et dans la patience leur travail de chaque<br />
jour, portant sur eux tout le fardeau du monde. 10 » On ne parle pas de<br />
lutte de classes, bien sûr, on se défend même de « dresser une classe<br />
contre l’autre », mais, dès 1896, on clame que « la société est divisée par<br />
l’argent » et on se propose de « mobiliser tous les gens qui souffrent à<br />
cause des trusts contre les quelques individus qui dirigent les trusts 11 ».<br />
10. Woodrow Wilson, 2 septembre 1912, cité in John Gerring, Party<br />
Ideologies…, op. cit., p. 197.<br />
11. William Jennings Bryan, discours de septembre 1896, cité in ibid.,<br />
p. 197-198.
60<br />
LA PARENTHÈSE POPULISTE<br />
Les syndicats, que les républicains ont sèchement éconduits, savent<br />
désormais à qui s’adresser et pour qui voter.<br />
L’État intervient lui aussi. À la fin du XIX e siècle, les démocrates se<br />
déclarent disposés à remiser au placard, explicitement, l’héritage idéologique<br />
jeffersonien qui voulait que le gouvernement idéal laisse chaque<br />
individu agir à sa guise. « Quand je rencontre un homme qui n’est pas<br />
disposé à supporter sa part du fardeau d’une autorité publique qui le<br />
protège, s’exclame William Jennings Bryan en 1896, j’ai en face de moi<br />
quelqu’un qui ne mérite pas les bienfaits qu’elle lui procure. J’aime la<br />
puissance publique et je veux la rendre si bonne qu’il n’y aura plus un<br />
seul citoyen sur cette terre qui ne sera prêt à mourir pour elle. 12 » Mais,<br />
là encore, pour que le discours ne choque pas trop, il est formulé de<br />
manière à être compris comme l’actualisation, la réinterprétation de la<br />
tradition libérale américaine, et non comme sa réfutation. C’est parce<br />
que le pouvoir des fortunes et des trusts est devenu trop grand que les<br />
démocrates doivent, presque à leur corps défendant, équilibrer cette<br />
puissance en lui opposant celle du gouvernement fédéral. L’État fort<br />
contre l’argent fort, en somme. Plus tard, excédés par le « communautarisme<br />
» qui suivra la contre-culture des années 1960 et qui favorisera le<br />
néolibéralisme en le laissant se déployer tranquillement, certains historiens<br />
américains évoqueront avec nostalgie la phase populiste du parti<br />
démocrate, celle d’un discours tranché, à la fois construit autour d’une<br />
thématique de classe et enraciné dans une longue histoire de protestations<br />
populaires 13 . L’évolution qui, à partir des années 1950, va conduire<br />
les deux grands partis américains à rivaliser de faveurs à destination des<br />
milieux d’affaires justifie assurément ce genre de regrets. On aurait tort<br />
toutefois d’oublier que la priorité accordée à des clivages économiques<br />
eut longtemps pour pendant la mise en veilleuse de thèmes liés à l’égalité<br />
raciale et sexuelle, dont on redoutait qu’ils ne divisent les catégories<br />
populaires auxquelles le parti démocrate entendait s’adresser, en particulier<br />
dans les États racistes (et démocrates) du Sud. Il fallut quand<br />
même attendre 1948 pour que le président Truman proposât au Congrès<br />
une législation protégeant les droits civiques des Noirs, et 1957 pour que<br />
12. Ibid., p. 207.<br />
13. Lire à ce sujet Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis, <strong>Agone</strong>,<br />
Marseille, 2001. Lire aussi Christopher Lasch, Le Seul et Vrai Paradis, Climats,<br />
Castelnau-le-Lez, 2002.
SERGE HALIMI 61<br />
des lois de ce type fussent enfin votées. En cette matière et en quelques<br />
autres, le « retour du refoulé » était prévisible.<br />
LE POPULISME, VOILÀ L’ENNEMI !<br />
Le New Deal aux États-Unis et le Front populaire en France représentent<br />
l’âge d’or des relations entre partis progressistes, ouvriers, paysans,<br />
employés, intellectuels et fonctionnaires. Mais si, en France, les passages<br />
de la gauche au pouvoir furent – jusqu’en 1981 – toujours suffisamment<br />
brefs pour l’obliger à retourner au peuple, la situation américaine va se<br />
caractériser par l’installation à Washington, pendant près de vingt ans<br />
(19<strong>32</strong>-1952), d’une coalition informelle entre parti démocrate, chefs<br />
syndicaux, universitaires et technocrates. Progressivement, parce qu’ils<br />
seront de plus en plus mal placés pour dénoncer l’« élite », ils abandonnent<br />
aux républicains l’usage des bribes les plus réactionnaires d’un discours<br />
« populiste » laissé en jachère. Avec le maccarthysme, son<br />
puritanisme et ses chasses aux sorcières, l’intelligentsia de gauche<br />
découvre apparemment que la droite peut mobiliser une partie du<br />
peuple contre elle. Derrière le cri « Vingt années de trahison ! », le sénateur<br />
républicain du Wisconsin dénonce en effet pêle-mêle l’État, les universités,<br />
les grands journaux, Hollywood, tous infestés de communistes,<br />
de décadents, d’« anti-Américains » – d’ailleurs souvent juifs. En apparence,<br />
les philistins se soulèvent contre l’Amérique progressiste et<br />
savante. Elle les accueille avec mépris. Elle redécouvre le « populisme »,<br />
mais pour le vouer aux gémonies. Car les intellectuels démocrates, au<br />
lieu de s’interroger sur les responsabilités de leur parti qui, à partir de<br />
1945, avait nourri la paranoïa anticommuniste – et donc, par associations<br />
concentriques, le soupçon sur tous ceux qui pendant le New Deal<br />
avaient travaillé avec des communistes –, choisissent de traiter le « problème<br />
» comme s’il était d’abord d’ordre culturel, voire psychiatrique.<br />
Souvent cooptés par la CIA, la Rand Corporation, les instituts de<br />
recherche universitaires, ils ont d’abord servi leurs carrières et cessé à ce<br />
titre d’exercer le rôle de penseurs de la société nouvelle. Quand on ne<br />
comprend pas un peuple qu’on ne fréquente plus, mieux vaut disqualifier<br />
ceux qui l’écoutent encore : le populisme, voilà l’ennemi ! L’un des<br />
historiens américains les plus renommés, Richard Hofstadter, suggère
62<br />
LA PARENTHÈSE POPULISTE<br />
ainsi que le maccarthysme marquait l’aboutissement d’une « tradition<br />
populiste et progressiste qui a tourné, devenant antilibérale et intempérante<br />
». Il ne s’agissait nullement à ses yeux d’une métamorphose : la<br />
« dé-conversion » résultait du « développement de certaines tendances<br />
ayant toujours existé, en particulier dans le Midwest et dans le Sud : l’isolationnisme<br />
et l’ultranationalisme, les phobies religieuses, raciales et<br />
identitaires, le ressentiment à l’encontre des grosses entreprises, des syndicats,<br />
des intellectuels, des États du Nord-Est et de leur culture 14 ».<br />
Commode, l’assimilation entre populisme et maccarthysme était néanmoins<br />
discutable : le populisme fut particulièrement puissant dans le<br />
Sud, le maccarthysme dans le Midwest ; les populistes avançaient un<br />
programme détaillé de réformes économiques, le sénateur du Wisconsin<br />
se contentait de diatribes contre les « subversifs » ; enfin, les partisans de<br />
McCarthy correspondaient à l’électorat qui s’était opposé aux candidats<br />
populistes et progressistes, puis au New Deal. Au demeurant, bien des<br />
intellectuels et syndicalistes proches du parti démocrate avaient euxmêmes<br />
concouru à la chasse aux sorcières ; leur aversion affichée à<br />
l’égard d’une pensée d’État à la soviétique ne les avait pas toujours empêchés<br />
d’encaisser les subsides de la CIA, fût-ce par l’entremise de « fondations<br />
de paille » à peine déguisées. Au fond, le sénateur du Wisconsin<br />
poussa juste un peu plus loin qu’ils ne l’auraient souhaité un « combat<br />
pour la loyauté des intellectuels du monde » que les démocrates s’étaient<br />
fait une fierté de conduire à partir de 1947.<br />
Au lieu d’être soumis au crible d’une analyse sociale ou historique, le<br />
phénomène « populiste » déclenche dès les années 1950 la recension par<br />
les intellectuels et les instituts de recherche démocrates des traits psychologiques<br />
de l’extrémisme : un « style paranoïaque », une « tendance<br />
à vouloir séculariser une vision religieuse du monde », des allergies<br />
raciales et insulaires. Alors que c’était elle qui avait permis toutes les victoires<br />
de la gauche américaine, la classe ouvrière blanche devient suspecte.<br />
Amour de la chasse et des armes à feu, machisme, culte de la force<br />
dans les relations internationales : tout est bon pour disqualifier les nouveaux<br />
gueux. Et, sur ce terrain, chaque année plus marqué par les<br />
« aspects symboliques » que par l’analyse de la distribution du pouvoir,<br />
ce sera la ruée des experts. Le « populisme » se trouve promptement<br />
associé à une « personnalité autoritaire » résultant d’un « retard culturel »<br />
14. Richard Hofstadter, The Age of Reform, Random House, New York, 1955.
SERGE HALIMI 63<br />
auquel on peut remédier par un programme de « rééducation »… Le tout<br />
est apprécié scientifiquement grâce à une panoplie d’entretiens de deux<br />
ou trois heures (« étude clinique intensive »), d’« échelles » (autoritarisme,<br />
antisémitisme, conservatisme, etc.). L’échelle du fascisme, par<br />
exemple, mesure l’agressivité, le cynisme, la rigidité morale, l’intolérance<br />
à l’ambivalence, l’infantilisme sexuel. Comme Christopher Lasch en fait<br />
l’observation, on définit ainsi, à partir des postulats « éclairés » de la<br />
« minorité civilisée », des « critères de santé politique auxquels seuls les<br />
membres d’une avant-garde auto-constituée [répondent] 15 ». Installée au<br />
pouvoir, dorlotée de privilèges, protégée des intempéries sociales, la<br />
haute intelligentsia « progressiste » a fini par trouver le peuple un peu<br />
grossier, irrationnel, rigide, en un mot trop « populiste ». Ayant bien intégré<br />
son propre discours sur la « fin des idéologies 16 » et la légitimité des<br />
experts dans une économie industrielle moderne marquée par la « complexité<br />
» et la spécialisation croissante des problèmes à résoudre, elle en<br />
est venue presque naturellement à envisager le traitement psychologique<br />
et bureaucratique de toute dissidence populaire.<br />
LA RECHERCHE DU CONSENSUS, PRÉLUDE À L’ABANDON DU PEUPLE<br />
À compter des années 1980, l’évolution droitière du Parti démocrate n’a<br />
plus seulement des explications sociales (la rupture avec le monde du travail)<br />
ou idéologiques (la volonté de capter à son profit le vent montant de<br />
l’ethos individualiste). Alors que les campagnes électorales deviennent de<br />
plus en plus coûteuses, l’argent pèse de la manière la plus directe qui soit,<br />
celle de la corruption institutionnalisée 17 . La dépolitisation, en partie<br />
entretenue par les médias (qui en profitent puisqu’elle accroît leur<br />
15. Christopher Lasch, Le Seul et Vrai Paradis, op. cit., en particulier les chapitres<br />
X et XI.<br />
16. Daniel Bell, auteur de The End of Ideology, avait précédemment attribué la<br />
montée de la droite radicale aux « nouvelles angoisses sociales » nées de la<br />
prospérité...<br />
17. En 1992, l’ensemble des campagnes électorales coûte 1 milliard de dollars ;<br />
en 2000, le chiffre dépasse les 3 milliards, largement financés par des lobbys<br />
patronaux. (Lire Serge Halimi et Loïc Wacquant, « Quand les entreprises<br />
“investissent” 4 milliards de dollars », Le Monde diplomatique, décembre 2000.)
64<br />
LA PARENTHÈSE POPULISTE<br />
pouvoir d’influence sur un électorat volage, désaffilié, manipulable),<br />
ouvre une place toujours plus grande aux campagnes de communication,<br />
y compris et surtout via la publicité politique, elle-même indissociable<br />
des ressources gigantesques qui financent la conception et la diffusion<br />
des spots. Le parti « républicrate » qui émerge de ces transformations ne<br />
peut plus alors faire autrement que quémander les dons des lobbys<br />
industriels, et donc devancer les demandes des possédants. Trente ans<br />
plus tôt, nous n’en sommes pas encore là. En 1952, le premier spot politique<br />
à la télévision (« I love Ike » [Dwight Eisenhower]) vient tout juste<br />
de faire son apparition ; les techniques de mobilisation électorale restent<br />
« traditionnelles » (parrainages des « machines » municipales ou associatives,<br />
porte-à-porte, réunions publiques). Mais la rupture des démocrates<br />
avec le discours « populiste » du New Deal, elle, est intervenue.<br />
Il ne s’agit pas ici de caricaturer la posture de Roosevelt (et dans une<br />
large mesure celle de son successeur Harry Truman) afin de mieux accuser<br />
les contrastes avec leurs successeurs démocrates. L’un comme l’autre<br />
s’accommodent d’un discours « expert » et s’entourent des technocrates<br />
qui en général l’incarnent. Pendant leur présidence, la prolifération<br />
d’agences fédérales ne débouche nullement sur la transformation des<br />
caractéristiques sociales de la nouvelle classe dirigeante. Toutefois, à partir<br />
des années 1950, il s’agit de tout autre chose. Alors que Truman nommait,<br />
socialement, ses adversaires et revendiquait, socialement, ses alliés<br />
(« Destinée aux riches, la proposition de loi fiscale des républicains<br />
plante son couteau dans le dos des pauvres », s’exclama-t-il, par<br />
exemple, le 15 juillet 1948), Adlai Stevenson et John Kennedy vont s’efforcer<br />
d’élargir, d’édulcorer, puis de supprimer cette rhétorique de classe,<br />
si générale fût-elle. « Le parti démocrate, souligne John Gerring, abandonne<br />
l’idiome populiste en faveur d’une philosophie universaliste. Un<br />
discours de réconciliation remplace celui du ressentiment ; la thématique<br />
très inclusive du “peuple américain” se substitue à l’évocation des sansgrade<br />
(common man) ; les références aux pratiques illégales des grosses<br />
entreprises sont remplacées par une perspective résolument favorable<br />
aux milieux d’affaires. 1948 sera la dernière campagne de l’ère populiste<br />
du parti démocrate. 18 »<br />
18. John Gerring, The Development of American Party Ideology, 1828-1992, thèse<br />
de l’université de Californie, Berkeley, 1993, chapitre VI.
SERGE HALIMI 65<br />
Pour quelles raisons ? Il est certain que la conduite victorieuse de la<br />
guerre et la formidable prospérité qui a suivi ont, contrairement à ce qui<br />
se passe en Europe à l’époque, relégitimé un système économique dont<br />
la viabilité avait été mise en doute après 1929. L’idée d’un contrôle accru<br />
de l’industrie et du commerce ne semble pas s’imposer avec la même<br />
puissance dans un pays territorialement épargné par les combats et où<br />
les pénuries n’existent pas. Plus encore, la guerre froide joue son rôle.<br />
Alors qu’une « chasse aux sorcières » fait rage, chacun, et surtout les<br />
démocrates, veut se présenter non pas seulement comme l’adversaire des<br />
communistes, mais comme le plus étranger aux thèmes et aux discours<br />
qui leur sont associés de près ou de loin. Puisque des militants communistes<br />
ont soutenu Roosevelt et influencé de grands syndicats ouvriers<br />
(dockers, automobile), les démocrates, comme pour se laver de tout<br />
soupçon de proximité avec les « subversifs », en rajoutent dans le<br />
combat contre les nouveaux « anti-américains ». C’est à partir de cette<br />
époque qu’un petit groupe d’intellectuels de gauche (Norman<br />
Podhoretz, Irving Kristol) s’éloignent des combats progressistes pour privilégier<br />
la grande croisade antisoviétique, avant de finir « démocrates<br />
pour Reagan », puis partisans de George W. Bush. Une décantation de ce<br />
type interviendra à nouveau au moment de la guerre du Vietnam et de<br />
la fracture entre démocrates traditionnels, partisans de la victoire, et<br />
« nouvelle gauche », déchaînée contre la guerre.<br />
Dès le début des années 1950, en tout cas, Adlai Stevenson, candidat<br />
démocrate à la Maison-Blanche en 1952 et en 1956, invoque un « conflit<br />
avec les forces des ténèbres. Nous affrontons un ennemi plus puissant<br />
qu’aucun autre que l’Amérique ait connu. Il ne fait pas de quartier et ne<br />
peut pas être apaisé. Son objectif est la conquête totale, pas seulement de<br />
la planète, mais aussi de l’âme humaine. Il veut détruire l’idée même de<br />
liberté, le concept de Dieu. Et Dieu nous a confié une mission redoutable<br />
: rien de moins que le leadership du monde libre 19 ». La suite ne<br />
ressemble pas forcément à une coïncidence : « Le parti démocrate est<br />
contre le socialisme sous toutes ses formes. Je suis opposé à la médecine<br />
socialisée, à l’agriculture socialisée, à la banque socialisée ou à l’industrie<br />
socialisée. » Une précision en entraînant une autre, Stevenson enfonce le<br />
clou : « L’hostilité des milieux d’affaires aux démocrates est une des<br />
19. Adlai Stevenson, discours du 18 octobre 1952, cité in John Gerring, Party<br />
Ideologies…, op. cit., p. 252.
66<br />
LA PARENTHÈSE POPULISTE<br />
absurdités de notre époque. 20 » Peu à peu, le capitalisme devient sanctifié,<br />
et sa réforme moins urgente. La plate-forme démocrate de 1964 proclame<br />
le système américain de libre entreprise « une des grandes<br />
conquêtes de la pensée et de l’esprit humain 21 ».<br />
La prise de distance avec les syndicats en découle. Pendant près de<br />
cinquante ans, les démocrates avaient admis que le mouvement ouvrier<br />
serait un des principaux acteurs de la dynamique de progrès social. À<br />
partir des années 1950, en partie pour répondre aux charges des républicains,<br />
qui matraquent l’idée que leurs adversaires ne sont que des<br />
appendices de l’AFL-CIO, Stevenson puis Kennedy insistent sur leur<br />
« indépendance ». Et, sans doute pour ne plus provoquer « l’hostilité<br />
des milieux d’affaires », ils s’abstiennent de répliquer que la paille syndicale<br />
qui obscurcirait leur vue n’est rien à côté de la poutre patronale<br />
que leurs adversaires républicains ont dans l’œil. À mesure que le syndicalisme<br />
américain perd en vigueur, les attaques dirigées contre lui<br />
redoublent et le soutien qu’il apporte à ses amis devient perçu comme<br />
un handicap politique, presque une honte. Au nombre des candidats<br />
démocrates à la présidence des États-Unis, seuls Hubert Humphrey en<br />
1968, Edward Kennedy en 1980 et Walter Mondale en 1984 se prévaudront<br />
de l’appui du mouvement ouvrier ; tous trois perdront. Dans les<br />
années 1980, il devient même courant d’entendre certains candidats<br />
démocrates, qu’on nommera d’ailleurs les « néolibéraux », reprocher à<br />
leurs concurrents du même parti d’avoir obtenu l’appui des syndicats.<br />
En revanche, le concours, y compris financier, d’un patronat jugé autrefois<br />
susceptible de planter « son couteau dans le dos des pauvres » ne<br />
pose plus aucun problème.<br />
Au plan du discours, des termes vont logiquement disparaître du<br />
lexique démocrate – « spéculation », « usure », « oppression » –, remplacés<br />
tantôt par des généralités humanistes, souvent proférées sur un ton<br />
geignard douloureusement empreint de bonnes intentions, tantôt par les<br />
exposés hautains et glacés des experts. La peur du « radicalisme » devient<br />
telle qu’on impute ce trait – cette pathologie ? – à l’adversaire en se<br />
réservant la désignation plus apaisante de « conservateurs ». « L’étrange<br />
alchimie du temps, explique Adlai Stevenson en octobre 1952, a d’une<br />
20. Interview de 1952, citée in Herbert Parmet, The Democrats : The Years after<br />
FDR, Oxford University Press, New York, 1976, p. 111.<br />
21. John Gerring, Party Ideologies…, op. cit., p. 237.
SERGE HALIMI 67<br />
certaine manière converti les démocrates en vrai parti conservateur de ce<br />
pays – le parti dédié à conserver tout ce qu’il y a de mieux et à construire,<br />
solidement et tranquillement, sur ces fondations. Les républicains, au<br />
contraire, se comportent comme un parti radical, voué à démanteler les<br />
institutions que nous avons ancrées solidement dans notre tissu<br />
social. 22 » Plus tard, en particulier à l’époque de Jimmy Carter, puis à celle<br />
de Bill Clinton, ce sera avec le terme même liberal (que l’on peut traduire<br />
par « progressiste ») que les démocrates marqueront leurs distances. Cet<br />
affadissement idéologique, cette crainte de paraître plus audacieux qu’ils<br />
ne sont, cette association à l’ordre social et international ne seront pas sans<br />
conséquences au moment qui nous intéresse, celui où cet ordre commence<br />
à être remis en cause. Ils transforment en effet le parti démocrate<br />
en cible presque prioritaire des mouvements radicaux que les années<br />
1960 font surgir des flancs de la jeunesse contestataire. Ainsi, même si la<br />
coïncidence de ces deux évolutions n’implique pas qu’elles soient imputables<br />
aux mêmes facteurs – parfois, ce sera tout le contraire –, l’ancien<br />
parti du New Deal va perdre presque simultanément l’appui de sa base<br />
ouvrière et celui de ses franges les plus radicales.<br />
LA DÉCOUVERTE DE LA QUESTION RACIALE<br />
Les choses n’en restent pas là. Très timidement à partir de la fin des<br />
années 1950, plus ouvertement au cours de la décennie suivante, les<br />
démocrates semblent découvrir que l’égalité raciale ne règne pas aux<br />
États-Unis, et moins que jamais dans les États du Sud, où ils font office<br />
de parti unique depuis Franklin Roosevelt. Pendant que les dirigeants<br />
nationaux se soucient en priorité des « infiltrations communistes » dans<br />
le mouvement des droits civiques, il existe encore des endroits où, au<br />
début des années 1960, 90 % des terres sont la propriété de quelques<br />
dizaines de familles, toutes blanches ; des comtés où, grâce à la couleur<br />
de leur peau, certains morts sont mieux représentés que les vivants. En<br />
1965, par exemple, les listes électorales de Lowndes, en Alabama, ne<br />
recensent aucun des 12 000 résidents noirs, alors qu’y figurent 118 %<br />
des électeurs blancs potentiels 23 … Le parti démocrate, qui s’éloigne des<br />
22. Adlai Stevenson, discours du 3 octobre 1952, cité in ibid., p. 249.<br />
23. Lire l’enquête d’Andrew Kopkind, « The Lair of the Black Panther », The<br />
New Republic, 13 août 1966. Ce texte et des dizaines d’autres du même auteur
68<br />
LA PARENTHÈSE POPULISTE<br />
thèmes économiques et sociaux opposant le « peuple » (implicitement<br />
blanc) aux élites, se penche sur le sort des « minorités », d’abord raciales,<br />
puis sexuelles. Sa plate-forme présidentielle de 1972 proclame fièrement<br />
« le droit d’être différent ». Vingt ans plus tard, devenu « le parti de l’inclusion<br />
», il claironne avec Bill Clinton sa « fierté particulière de l’émergence<br />
dans notre pays de la république multiraciale et multi-ethnique la<br />
plus importante et la plus harmonieuse [most succesfull] du monde », et<br />
il s’engage à « faire comprendre à tous les Américains la diversité de<br />
[leur] héritage culturel » 24 . Il ne s’agit pas de regretter une telle évolution<br />
en soi – la somme de discriminations subies par les Noirs, les<br />
femmes, les homosexuels, les Indiens, les handicapés, etc., imposait<br />
qu’ils bénéficient d’un rattrapage volontariste –, mais plutôt de constater<br />
que la mise à niveau intervient alors que les démocrates paraissent avoir<br />
fait leur deuil d’un discours de mobilisation « populiste ». Or la montée<br />
simultanée d’un unanimisme de classe et d’un communautarisme de<br />
groupe va provoquer des effets politiques délétères.<br />
Se voulant le parangon d’une harmonie multiculturelle, le Parti démocrate<br />
n’invoque pas pour y parvenir le combat social et solidaire d’autrefois,<br />
mais la propagation des idées de communauté partagée, de morale<br />
universelle, voire de simple « décence », autant de sentiments dont il<br />
escompte qu’ils seront imposés par les tribunaux et par les médias<br />
davantage que par les mobilisations populaires. La notion de conflit n’a<br />
pas disparu, seulement sa réalité : « Partageant la langue anglaise entre<br />
mots à connotation positive et mots à connotation négative, ironise John<br />
Gerring, le candidat [démocrate] n’a plus qu’à souligner qu’il soutient<br />
inconditionnellement les premiers et condamne les autres. Les programmes<br />
politiques sont présentés sous forme de “guerres” ou de “croisades”,<br />
mais les ennemis choisis sont également honnis par les<br />
républicains et par les démocrates – l’inflation, le chômage, le déclin<br />
national, la médiocrité rampante, la subversion intérieure. 25 » Quand<br />
qui évoquent les mobilisations politiques des années 1960 ont été rassemblés<br />
in Andrew Kopkind, The Thirty Years’ Wars, Verso, Londres, 1995. En 1964,<br />
seuls 6 % des Noirs du Mississipi participent à l’élection présidentielle. En<br />
1968, grâce au Voting Rights Act de 1965, ils seront près de 60 % à le faire.<br />
24. Plate-forme du parti démocrate pour l’élection présidentielle de 1992, citée<br />
in John Gerring, Party Ideologies…, op. cit., p. 245.<br />
25. John Gerring, The Development…, op. cit., chapitre VI.
SERGE HALIMI 69<br />
elle prendra définitivement le pas sur celle de la justice sociale, la rhétorique<br />
de l’« inclusion » amplifiera l’effet démobilisateur, voire conservateur,<br />
du discours démocrate. Car il s’agit bien d’être inclus, intégré,<br />
dissous dans le monde tel qu’il est, de plus en plus socialement inégalitaire,<br />
et de pouvoir exhiber davantage de femmes, de Noirs, d’homosexuels,<br />
de Latino-Américains dans les corridors du pouvoir. Alors<br />
qu’enflent les voiles de la contre-révolution conservatrice, avec ses composantes<br />
racistes et puritaines, les républicains occupent déjà la position<br />
avantageuse de porte-parole d’une nation américaine que leurs adversaires<br />
prétendent fractionner pour mieux l’inclure dans sa totalité. Étant<br />
constamment minoritaires au Congrès (ils le resteront jusqu’en 1995),<br />
les républicains peuvent aussi se proclamer en partie étrangers au statu<br />
quo politique et à la technocratie qui le gère 26 .<br />
LE SURGISSEMENT DE LA CONTESTATION<br />
Évoquant les dirigeants noirs américains, Erving Goffman a suggéré<br />
qu’avec leur institutionnalisation, dans les États du Nord-Est et du<br />
Midwest en particulier, ils vont cesser de s’adresser à la société au nom<br />
des réprouvés et devenir les avocats de la société – c’est-à-dire des ajustements<br />
qu’elle requiert – auprès des réprouvés 27 . Pour certains, cela<br />
pourra aller jusqu’à concéder que la discrimination dont souffrent les<br />
autres Noirs est plus imaginaire que réelle, provoquée par des<br />
défaillances individuelles – la reconnaissance sociale dont ils jouissent<br />
eux-mêmes prouvant a contrario le caractère démocratique du pays. À<br />
entendre ces porte-parole, il convient alors de « résoudre et de prévenir<br />
les conflits plutôt que de les conduire à leur terme 28 », de définir les intérêts<br />
de leurs mandants de manière tellement restrictive que leur défense<br />
26. Entre 1955 et 1995, les démocrates contrôlent sans interruption la<br />
Chambre des représentants, et le Sénat la plupart du temps. Politiquement, les<br />
choses sont moins claires dans ces enceintes parlementaires, où la discipline de<br />
parti n’existe pas.<br />
27. Erving Goffman, Stigma : Notes on the Management of a Spoiled Identity,<br />
Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1963.<br />
28. Lire Christopher Lasch, « The End of Populism », in The Agony of the<br />
American Left, op. cit., p. 28.
70<br />
LA PARENTHÈSE POPULISTE<br />
n’implique plus la moindre critique du statu quo. Quand la guerre du<br />
Vietnam s’intensifie, les organisations noires les mieux intégrées au jeu<br />
politique et les syndicats traditionnels doivent néanmoins constater que<br />
les marchandages au sommet de ce type suscitent des difficultés croissantes.<br />
Négocier avec une administration démocrate, accepter des compromis<br />
avec elle, c’est prendre le risque de s’aliéner une fraction<br />
radicalisée qui, elle, refuse de se compromettre. Car le parti démocrate a<br />
cessé d’être l’allié, même décevant, des éléments les plus avancés de la<br />
société américaine. Et il s’apprête à devenir leur principal adversaire.<br />
Interrompant la somnolence des années Eisenhower, la présidence<br />
Kennedy (1961-1963) favorise un réveil politique. L’assassinat de Dallas,<br />
en novembre 1963, ouvre la voie à cinq années de mobilisation et de tragédies<br />
exceptionnelles, dissipant pour longtemps les illusions d’une fin<br />
de l’histoire. Le mouvement noir arrache ses plus grandes victoires 29 ,<br />
mais il voit tomber ses plus grands leaders sous les balles des tueurs<br />
(Malcolm X en 1965, Martin Luther King trois ans plus tard) ; la guerre<br />
du Vietnam s’amplifie et s’enlise ; des étudiants lancent un « mouvement<br />
» qui tente de fédérer les contestations. L’opposition entre démocrates<br />
et radicaux de gauche atteint le point de non-retour après le<br />
meurtre de Robert Kennedy (juin 1968). Il prend la forme d’émeutes<br />
raciales à Los Angeles, de manifestations contestataires à Chicago, sauvagement<br />
réprimées par le maire démocrate. En novembre 1968, à<br />
l’issue d’une campagne au cours de laquelle il a martelé son intention de<br />
rétablir « la loi et l’ordre », le républicain Richard Nixon est élu président<br />
des États-Unis. Une fraction appréciable de l’électorat populaire<br />
blanc l’a soutenu, en particulier dans les États du Sud et du Midwest.<br />
Autrefois acquis au discours populiste des démocrates, ces Américains<br />
29. En 1964, la loi sur les droits civiques, le Civil Rights Act, interdit la discrimination<br />
« de race, de couleur, de sexe ou d’origine nationale pour l’ensemble<br />
des pratiques concernant l’emploi : embauche, renvoi, salaire, formation, sanctions<br />
disciplinaires et avantages sociaux ». En 1965, c’est le Voting Rights Act<br />
qui garantit à l’échelle fédérale le droit de vote des Noirs et celui d’être représenté<br />
au Congrès (contrôle du découpage électoral des circonscriptions). En<br />
1967, le programme de discrimination positive est créé. Dans les secteurs où il<br />
emploie un nombre insuffisant de Noirs et de femmes, l’entrepreneur doit<br />
« fixer des objectifs et un calendrier d’application qu’il s’engage à respecter<br />
pour combler ces lacunes ».
SERGE HALIMI 71<br />
ont basculé à droite, effrayés par le « désordre » que provoquent dans<br />
leur existence l’égalité raciale, les manifestations violentes, la « désobéissance<br />
civique », la libération des mœurs. Ce peuple-là, que le déclassement<br />
social (c’est-à-dire souvent, aux États-Unis, l’obligation de vivre à<br />
proximité des Noirs) semble menacer, en a assez des expérimentations<br />
qui se font sur son dos. Quand les murs se referment sur eux, les gens<br />
se retournent les uns contre les autres.<br />
Power to the people : empruntant son slogan aux Black Panthers, la nouvelle<br />
gauche des années 1960, celle dont les parents avaient fait le New<br />
Deal, essaie de contre-attaquer en mobilisant politiquement des groupes<br />
que les démocrates au pouvoir préféreraient voir rester tranquilles –<br />
Noirs, travailleurs agricoles hispaniques, mineurs des Appalaches –,<br />
ayant alors d’autres priorités: l’intensification de la guerre du Vietnam, la<br />
défense du complexe militaro-industriel, la préservation d’un État-providence<br />
« qui maintient les pauvres en vie, à condition qu’ils restent<br />
pauvres et sans pouvoirs 30 ». Involontairement, les étudiants radicaux,<br />
qui escomptent une contagion des soulèvements contre le « système »,<br />
vont accélérer le basculement à droite des « petits Blancs » pris dans l’étau<br />
du déclassement, entre un État qui ne les protège plus et des minorités<br />
raciales dont le contact les terrifie. Une telle évolution était prévisible tant<br />
ces étudiants, socialement privilégiés et sans tradition politique (jusqu’à<br />
cette date, les campus américains n’avaient pas été un lieu de mobilisation<br />
particulier), voyaient dans la classe ouvrière de leur pays une somme<br />
d’embourgeoisement, de matérialisme, de sexisme, de nationalisme et de<br />
racisme. Cette « barrière des valeurs », les républicains en feront le<br />
meilleur usage, de Richard Nixon en 1968 à Ronald Reagan en 1980, puis<br />
à George H. Bush en 1988, avant que son fils n’en profite à son tour <strong>31</strong> .<br />
Tandis qu’ils œuvreront économiquement pour les riches, ils proclameront<br />
leur attachement à une culture populaire que la nouvelle gauche n’a<br />
cessé de brocarder et que les démocrates croient savoir « traiter » par les<br />
médias et par la loi.<br />
30. Andrew Kopkind, The Thirty Years’ Wars, op. cit., p. 30.<br />
<strong>31</strong>. Lire en particulier Thomas Byrne Edsall et Mary Edsall, Chain Reaction :<br />
The Impact of Race, Rights and Taxes on American Politics (Norton, New York,<br />
1991), et Earl et Merle Black, The Vital South : How Presidents are Elected<br />
(Harvard UP, Cambridge, 1992). Sur George W. Bush, lire Tom Frank, « Cette<br />
Amérique qui vote George W. Bush », Le Monde diplomatique, février 2004.
72<br />
LA PARENTHÈSE POPULISTE<br />
Dès la fin des années 1960, les arrangements de l’ordre keynésien se<br />
délitent, les marchandages institutionnels au sommet n’empêchent plus<br />
la mobilisation de la base, la guerre du Vietnam s’enlise, le centre<br />
s’écroule. « No peace, no justice, avait expliqué Martin Luther King lors<br />
des soulèvements urbains, les bombes qui tombent sur l’Indochine<br />
explosent sur nos villes. » Mais le « mouvement » – contestataire, de<br />
gauche, indépendant du parti démocrate –, dont en 1968 l’offensive du<br />
Têt au Vietnam va décupler l’énergie, est encore trop jeune, trop faible,<br />
beaucoup trop méprisant à l’égard du prolétariat blanc et des syndicats<br />
pour cristalliser la coalition « populiste, progressiste et internationaliste »<br />
dont rêvent à l’époque certains intellectuels. Vient l’heure de la réaction,<br />
celle des républicains. « Je ne suis pas contre les gens de couleur, je suis<br />
contre les émeutes », plaideront bon nombre de « petits Blancs » de plus<br />
en plus réceptifs aux discours de la droite <strong>32</strong> . La contagion de l’esprit de<br />
libération s’interrompt pour de bon, remplacée par la fragmentation des<br />
identités particulières. Alors qu’il aurait fallu élargir le mouvement,<br />
mobiliser ceux qui ont baissé les bras, combattre la tentation du repli<br />
racial ou sectaire, les solidarités éclatent. Le système s’enracine, les<br />
contestations lui servant même « d’aphrodisiaques dans la climatisation,<br />
d’hallucinogènes dans l’eau courante 33 ». À défaut d’une révolution politique,<br />
les convulsions des années 1960 débouchent sur un nouveau style<br />
– récupérable, lucratif, amusant et « branché». Et la « grande révolution<br />
culturelle bourgeoise 34 » régénère cahin-caha un système qu’elle entendait<br />
mettre à bas. Économiquement, socialement, politiquement, l’ordre<br />
keynésien a craqué. Mais, déjà aléatoires dans les meilleures des circonstances,<br />
les perspectives d’un dépassement de gauche ont été ruinées<br />
pour des raisons qui seront récurrentes, aux États-Unis et ailleurs : les<br />
contestataires ne savent pas s’adresser à d’autres classes que la leur (ou à<br />
d’autres interlocuteurs que les médias, ce qui revient souvent au même) ;<br />
<strong>32</strong>. Lire, sur le sujet, le beau texte d’Andrew Kopkind, « Blue collars and white<br />
racism », Mayday, 11 octobre 1968 (in Andrew Kopkind, The Thirty Years’<br />
Wars, op. cit., p. 140-145), reproduit dans ce numéro pages 75. Dans cet<br />
article, modèle de journalisme, l’auteur est en effet capable de rentrer dans les<br />
raisons de ses adversaires et, quand ceux-ci sont issus des milieux populaires,<br />
d’éviter de leur opposer mépris de classe ou dédain culturel. L’essentiel de la<br />
presse française, du Monde à Charlie Hebdo, procède de la manière inverse.<br />
33. Ibid., p. 150.<br />
34. Ibid., p. 153.
SERGE HALIMI 73<br />
ils veulent avant tout célébrer leur radicalité, parfois circonscrite à un<br />
petit territoire culturel et « sociétal », leur relativisme des « identités » et<br />
du métissage. S’interdisant tout discours collectif, toute affirmation à<br />
caractère universel, ils ne peuvent pas parler à des groupes dont le<br />
niveau de conscience diffère du leur. Ils n’essaient pas souvent, d’ailleurs.<br />
Le mépris de classe que leur voue une partie de la gauche radicale, son<br />
« complexe de supériorité à l’encontre des masses obscurantistes, un<br />
refus de créditer leurs adversaires d’intentions respectables, une réticence<br />
croissante à soumettre leur politique à l’approbation publique 35 »<br />
précipitent à droite des millions d’Américains : des ménagères antiféministes<br />
qui, par panique identitaire, par peur d’un monde qu’elles ne<br />
comprennent plus, se raccrochent désespérément à la famille traditionnelle<br />
36 ; des ouvriers et des employés blancs qui n’apprécient pas les<br />
leçons de tolérance raciale que des privilégiés, souvent, entendent leur<br />
enfoncer dans le crâne. « Les gens, explique Andrew Kopkind, n’aiment<br />
pas qu’on les traite de “racistes” quand leurs cœurs commencent à soupçonner<br />
que d’autres motifs que celui-ci les anime. 37 » Au total, des millions<br />
d’individus obscurs « qui souffrent et qui confondent ceux qui<br />
souffrent comme eux avec ceux qui les tourmentent 38 » désertent les<br />
rangs d’une gauche qui paraît les avoir abandonnés, et avec eux un discours<br />
sur le bien commun. C’est le long backlash (ou retour de bâton) qui<br />
commence. Quiconque cherche à expliquer l’essor du conservatisme<br />
américain ne peut que buter sur ce changement de camp d’une fraction<br />
des catégories populaires. L’explication vaudra pour d’autres pays, dont<br />
la France, mais deux ans avant l’élection de Reagan, Pierre Dommergues<br />
remarque à propos des États-Unis et de son petit peuple de droite : « Ces<br />
hommes et ces femmes ne sont pas fascistes. Ils ne désavouent pas les<br />
grands principes constitutionnels. Mais, confrontés au chômage et à la<br />
dégradation de leur pouvoir d’achat, ils oublient leurs idéaux, s’accrochent<br />
à leurs maigres privilèges et remettent en question les acquis égalitaires<br />
arrachés par les minorités à une époque de forte croissance. Il<br />
suffit de peu pour que ces victimes de l’austérité nouvelle basculent du<br />
35. Christopher Lasch, Le Seul et Vrai Paradis, op. cit., p. 372.<br />
36. Lire Andrew Kopkind, « Femme, féminisme et droite américaine », <strong>Agone</strong>,<br />
2003, <strong>n°</strong> 28. [ndlr]<br />
37. Andrew Kopkind, The Thirty Years’ Wars, op. cit., p. 143.<br />
38. Ibid., p. 308.
74<br />
LA PARENTHÈSE POPULISTE<br />
côté de la réaction. La gauche n’a pas réussi à leur ouvrir les yeux. La<br />
droite leur offre une explication, des boucs émissaires et des modalités<br />
d’action. 39 » À partir de 1973, le niveau de vie de la majorité des<br />
ménages américains cesse en effet de croître. Au moment où ils ont le<br />
sentiment que l’État les abandonne à leur sort, l’inflation s’envole, précipitant<br />
avec elle des millions de familles dans des tranches d’imposition<br />
plus élevées, ce qui habitue ces contribuables à prêter davantage l’oreille<br />
aux jérémiades antifiscales des républicains. La conversion idéologique<br />
prend souvent un tour racial. Thomas et Mary Edsall rapportent le<br />
témoignage d’un menuisier blanc de Chicago en 1988 : « La plupart des<br />
gens qui ont besoin d’aide sont noirs. Et la plupart des gens qui aident<br />
sont blancs. Nous en avons assez de payer pour les HLM de Chicago et<br />
pour les transports en commun que nous n’utilisons pas. 40 » Ceux qui<br />
sont en colère se trompent parfois de colère.<br />
SERGE HALIMI<br />
Ce texte est extrait du chapitre III de<br />
Le Grand Bond en arrière, Fayard, 2004<br />
39. Pierre Dommergues, « L’essor du conservatisme américain », Le Monde<br />
diplomatique, mai 1978.<br />
40. Thomas et Mary Edsall, Chain Reaction…, op. cit., p. 6. Les quartiers du sud<br />
de Chicago, desservis par des transports publics souvent en mauvais état, étaient<br />
à l’époque noirs à plus de 95 % (lire Serge Halimi, « L’université de Chicago, un<br />
petit coin de paradis au cœur du ghetto », Le Monde diplomatique, avril 1994).
ANDREW KOPKIND 75<br />
Racisme blanc en col bleu<br />
George wallace fut élu gouverneur démocrate de l’Alabama pour la première fois en<br />
1962 sur un programme ouvertement ségrégationniste. Candidat malheureux aux<br />
primaires démocrates de 1964, il se présente à l’élection présidentielle de 1968 sous ses<br />
propres couleurs après avoir fondé l’American Independent Party. Ses thèmes de prédilection<br />
sont le poids du gouvernement fédéral, la stigmatisation des Noirs, des étudiants<br />
et des opposants à la guerre du Vietnam.<br />
C’est le moment où l’attention du journaliste militant Andrew Kopkind commence à se<br />
porter sur ces « petits Blancs » que le mépris de la gauche tend alors à jeter dans les<br />
bras de Wallace, avant de les précipiter à droite. Enquêtant sur l’Amérique profonde,<br />
Kopkind donnera, dans les années 1970, la parole à ceux « qui souffrent et qui confondent<br />
ceux qui souffrent comme eux avec ceux qui les tourmentent ».<br />
Quant à George Wallace, il obtient en 1968 plus de dix millions de voix, soit 13,53 %,<br />
emportant cinq États du Sud (le républicain Nixon battant le démocrate Humphrey<br />
par 43,40 % contre 42,7 2%). Revenu au parti démocrate en 1972, il est victime d’un<br />
attentat qui le laisse définitivement paralysé, en pleine campagne des primaires, qu’il<br />
remporte dans six États en se faisant le champion de l’opposition à la déségrégation de<br />
l’enseignement public. Le phénomène marque ses limites au niveau national lors de la<br />
campagne de 1976, mais Wallace demeure gouverneur de l’Alabama jusqu’en 1987.<br />
Andrew Kopkind (1935-1994) s’est détourné de la carrière dorée que lui promettaient<br />
une formation dans une grande université américaine de la côte Est des États-Unis et<br />
un recrutement au Time pour se consacrer à un journalisme militant.<br />
Pendant trente ans Kopkind est de tous les combats de la gauche américaine (du<br />
Vietnam au Golfe, des Noirs aux homosexuels en passant par le féminisme) ; il en<br />
devient l’un des journalistes importants et, simultanément, l’un des critiques intraitables.<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 75-84
76<br />
RACISME BLANC EN COL BLEU<br />
LEPAYS DE GEORGE WALLACE – dans les marches industrielles du Nord<br />
– est le pays des laissés-pour-compte. Non pas les exclus, les<br />
oppressés ou les dépossédés : le public de Wallace s’est tout simplement<br />
effacé de nos esprits. Tandis que les Noirs sont harcelés, les<br />
pauvres font l’objet de « programmes », les étudiants sont rossés, les élites<br />
honorées et la « nouvelle classe » portée aux nues, les travailleurs blancs<br />
sont ignorés. Ils n’inspirent ni peur ni admiration. À Cleveland, les quartiers<br />
favorables à Wallace s’étendent, hésitant entre les banlieues bien<br />
entretenues et les ghettos sales – pas assez déclassés pour être rasés ou<br />
tout juste bons pour la ségrégation. Autour d’eux, l’atmosphère est épaisse<br />
et lourde – saturée de fumée et de poussière, d’ennui et de frustration.<br />
Pendant une trentaine d’années voire plus, les revendications des travailleurs<br />
en col bleu – en tant que classe – ont été exprimées par deux<br />
institutions : les syndicats et le parti démocrate. Par le biais de l’une ou<br />
de l’autre, les salariés pouvaient élaborer une identité sociale, quoique<br />
incomplète. Désormais, ces deux institutions ne remplissent plus ce rôle<br />
d’aucune façon conséquente. Il serait pour le moins difficile de trouver<br />
un responsable syndical qui n’admette pas, à l’unisson des autres, que les<br />
syndicats ont « perdu contact » avec la base. Comme force de médiation,<br />
le parti démocrate est tombé un peu plus en désuétude. Les sections<br />
locales du parti qui servirent autrefois de vecteurs de mobilité sociale à<br />
une myriade de groupes ethniques sont hors d’état de jouer ce rôle. Ces<br />
dernières années, la politique ethnique s’est coulée dans un schéma de<br />
conscience en noir et blanc : la lutte des races a fondu Polonais, Italiens,<br />
Irlandais et Gitans dans le melting-pot des Blancs. Aujourd’hui, le parti<br />
démocrate est perçu comme un ennemi actif des « gens ordinaires » : il<br />
appelle leurs fils sous les drapeaux pour des guerres inutiles, laboure<br />
leurs quartiers pour construire des autoroutes, laisse les émeutiers écumer<br />
leurs rues et s’approprie leurs salaires par voie fiscale au bénéfice<br />
d’autrui. Le syndicat est considéré comme à peine plus fréquentable : il<br />
sacrifie les enjeux locaux aux négociations nationales, fait le jeu de l’entreprise<br />
en coulisses, et propulse les incompétents et les travailleurs non<br />
qualifiés à des postes bien payés.<br />
Que ces récriminations soient justifiées ou non, elles sont profondément<br />
enracinées. Les avancées « réelles » que les travailleurs blancs ont
ANDREW KOPKIND 77<br />
obtenues grâce aux syndicats et partis politiques ne les portent pas à une<br />
gratitude éternelle, pas plus qu’elles n’atténuent les frustrations objectives<br />
de la vie en col bleu. Aujourd’hui, du puits de ces frustrations jaillissent<br />
des bulles de racisme et d’anticommunisme qui explosent en<br />
surface, et cela n’a rien de surprenant : les États-Unis fournissent ce gaz<br />
empoisonnée à tout un chacun. Mais pour les travailleurs en col bleu, la<br />
campagne électorale de Wallace est le premier moyen d’expression original<br />
à leur disposition depuis des années.<br />
En tant que candidat national dont l’électorat est présent en tout point<br />
du pays, George Wallace peut incarner différentes choses pour différents<br />
publics – même s’il ne tient qu’un discours. Pour Bradley Jefferson,<br />
ouvrier dans l’automobile à l’usine Fisher Body dans la banlieue industrielle<br />
de Cleveland à Euclid, Wallace n’est ni un messie ni un fou. Mais<br />
au moins, il est meilleur que « les autres ». Wallace parle aux gens comme<br />
Bradley Jefferson, et Jefferson lui retourne une attention aussi inhabituelle<br />
en portant sur son lieu de travail un badge à l’effigie du candidat.<br />
« J’étais un démocrate inconditionnel, commença Jefferson au cours de<br />
notre longue conversation. Je croyais qu’il n’existait rien de tel qu’un<br />
démocrate – ils étaient en faveur des petites gens, des travailleurs. […]<br />
Je n’ai jamais voté pour un républicain, pas même Eisenhower : je ne<br />
peux tout simplement pas voir un président républicain. J’ai voté pour<br />
Johnson en 1964 parce qu’il était contre Goldwater, mais j’ai pensé que<br />
c’était un pur politicien, à 100 % pour sa pomme. Maintenant, Nixon,<br />
c’est un toquard ; ce discours de caissier ne sonne pas très bien.<br />
Humphrey ? Il a tout bon : contrôle, contrôle, contrôle. Mais il est trop<br />
léger sur les questions raciales, c’est un inconvénient. (Mince, est-ce que<br />
je deviens raciste ?) Wallace, je ne l’aime qu’à 40 % ; ce n’est pas tant<br />
pour ce qu’il peut vraiment faire s’il devient président, mais le fait qu’il<br />
gagne, ou recueille beaucoup de voix, pourra rassembler les gens. Donc<br />
je suis pour Wallace. Mais vous savez, parfois je ne suis pas sûr de savoir<br />
pourquoi je vote pour quelqu’un. Est-ce que ça a un sens ? »<br />
Selon un sondage réalisé par le journal de Fisher Body avant les<br />
conventions [de 1968], le choix présidentiel de Bradley Jefferson semble<br />
partagé par au moins un tiers des 1 800 employés de l’usine. C’est un<br />
homme doux et calme, père de neuf enfants, qui possède (presque) une<br />
maison, et dont un fils est dans les marines. Quelques autres de ses<br />
enfants se sont mariés et ont quitté la maison. Voilà bien longtemps,<br />
Jefferson et sa femme envisagèrent d’ouvrir un magasin de tissu et
78<br />
RACISME BLANC EN COL BLEU<br />
d’articles de mercerie, mais il dépensa ses économies en Californie pendant<br />
la guerre, et l’idée tomba à l’eau. En 1963, il réussit à acheter une<br />
« petite sandwicherie » dans le quartier, mais pour la perdre – ainsi que<br />
la moitié de son investissement – deux années plus tard. Maintenant, à<br />
ses heures perdues, il bidouille de vieux téléviseurs et regarde le football<br />
sur un nouveau modèle. Il est né à Cleveland, pas loin de sa maison<br />
actuelle, et le voisinage immédiat est encore blanc. À plus de deux kilomètres<br />
de l’avenue commencent les quartiers noirs. Pour une raison ou<br />
une autre, il envisage de quitter la ville.<br />
Pendant des années, Jefferson a travaillé à la chaîne, fixant les planchers<br />
des voitures, à la cadence d’un toutes les 80 secondes. C’était, ainsi que<br />
l’affirmaient tous les ouvriers de la chaîne de montage, « un rythme assassin<br />
». Maintenant, son âge et son expérience lui ouvrent droit à des tâches<br />
plus faciles, hors de la chaîne – assemblant « quatre ou cinq boulons,<br />
quelques écrous et vis, un morceau de caoutchouc et un morceau de<br />
chrome » pour les vitres arrières des Cadillac et Oldsmobile. La convention<br />
collective prévoit que Jefferson réalise 21 montages par heure, ou<br />
189 par jour ; mais il peut en faire plus s’il travaille plus vite, et parfois il<br />
termine en avance et se défile pour jeter un œil au journal ou au Reader’s<br />
Digest. Il n’est pas autorisé à quitter l’usine pendant la journée.<br />
C’est la période haute de la saison, et Jefferson travaille six jours par<br />
semaine. Comme tout un chacun, il compte les heures supplémentaires<br />
en tant qu’élément essentiel du salaire ; la semaine de quarante-huit<br />
heures (ou quel que soit le slogan actuel) est une fiction économique.<br />
Avant, il tenait les finances d’une autre section syndicale de l’usine, et<br />
bien qu’il se considère comme un « militant », il ne prend pas part aux<br />
affaires syndicales à un niveau significatif.<br />
Il est à peine besoin de dire que la vie dans une usine automobile est<br />
complètement déshumanisante ; l’éclairage fluorescent et une convention<br />
collective n’ont rien changé, en pratique, aux effets sociaux du système<br />
industriel depuis l’époque des « moulins noirs sataniques 1 ». Ce<br />
qu’il est difficile aux non-ouvriers de comprendre – à rebours des mythes<br />
sur les conditions pépères et les salaires de cadres –, c’est que le syndi-<br />
1. Nom donné aux usines anglaises à la fin du XVIII e siècle par William Blake<br />
dans un poème resté célèbre à ce jour, Jerusalem. Elles symbolisaient à ses yeux<br />
la déshumanisation et l’aliénation de l’ère moderne ouverte par la révolution<br />
industrielle. [ndt]
ANDREW KOPKIND 79<br />
cat lui-même contribue au processus de déshumanisation. Les responsables<br />
syndicaux de Cleveland pensent que la United Auto Workers est<br />
largement composée de partisans de Wallace, et quoiqu’il y ait bien des<br />
explications possibles, la structure extraordinairement manipulatrice de<br />
la UAW doit être rangée au nombre des facteurs clés. « Tout se passe<br />
presque comme si l’UAW avait été façonnée dans le but de faire taire la<br />
base, me confia un responsable syndical inquiet. Nous ne disons rien à<br />
nos membres et leur demandons seulement de venir à nos réunions afin<br />
d’approuver nos décisions. » Il n’est guère surprenant que les membres<br />
en question refusent jusqu’à cette exigence minimale. Selon l’estimation<br />
de ses dirigeants, dans une grande section syndicale de Cleveland comptant<br />
4 500 membres, seuls 1 % participent à la gestion courante. Dans<br />
une autre section, moins de 10 % font appel à la commission des litiges,<br />
et presque les trois quart ne se sont pas rendus aux urnes aux dernières<br />
élections syndicales. À General Motors, pendant trois mois sans discontinuer,<br />
des réunions durent être annulées, faute d’atteindre le quorum de<br />
50 personnes. Dans le système UAW, les problèmes quotidiens sont pris<br />
en charge directement sur la chaîne par deux douzaines d’intendants et<br />
de superviseurs habilités à changer les affectations de postes à la façon<br />
des experts en management, de sorte que les ouvriers s’adaptent au<br />
règlement de l’usine. Les ouvriers voient « leurs » intendants comme des<br />
bureaucrates apathiques faisant le sale boulot de l’entreprise.<br />
Comme force sociale, le mouvement ouvrier (excepté en quelques<br />
rares secteurs) a cessé d’aller de l’avant voilà bien longtemps, et consacre<br />
maintenant un immense effort à faire du surplace. Ses politiques « progressistes<br />
» sont exprimées dans un flot de rhétorique – et de brochures<br />
– émanant du siège international, mais au niveau local, les quelques progressistes<br />
restants (et les gauchistes, espèce plus rare encore) font tout ce<br />
qu’ils peuvent pour s’affronter à la déferlante raciste et réactionnaire.<br />
Parfois, ils sont noyés. Dans une section syndicale de Chevrolet à<br />
Cleveland, les dirigeants étaient si racistes que le président accrocha un<br />
drapeau confédéré sur le mur de son bureau afin d’afficher ses sympathies<br />
; le quartier général international envoya des hommes de Detroit<br />
pour le déchirer. Dans une autre usine de la General Motors, bien des<br />
cadres sont ouvertement en faveur de Wallace, en dépit de la propagande<br />
contraire venue d’en haut. Le président – à la retraite depuis peu<br />
– de la zone Cleveland UAW (le plus grand syndicat de l’État) tint des<br />
propos racistes à peine voilés contre Carl Stokes, un Noir, au cours de
80<br />
RACISME BLANC EN COL BLEU<br />
sa première campagne, non victorieuse. Par un heureux hasard, l’opposant<br />
blanc à Stokes lors des primaires fut l’homme désigné par les<br />
cadres. Un responsable politique démocrate affirma récemment : « Cela<br />
fait plusieurs années que les dirigeants syndicaux ferment les yeux sur<br />
le racisme. Maintenant, ça leur saute à la figure. »<br />
Les tentatives de certains militants syndicaux visant à former des<br />
groupes politiques en dehors du parti démocrate – ou de s’opposer aux<br />
positions démocrates orthodoxes – sont rapidement étouffées. Un responsable<br />
syndical rapporte : « Le sommet craint en fait la naissance<br />
d’une nouvelle organisation. Ils ont peur que les membres votent “mal”<br />
à la prochaine élection. » Lorsqu’un petit comité électoral de gauchistes<br />
d’une section syndicale UAW de Cleveland commença à s’agiter contre<br />
la guerre [du Vietnam], voilà à peu près un an, un représentant de l’étatmajor<br />
prit l’avion pour juguler la révolte anti-gouvernementale. Il<br />
déclara devant les ouvriers réunis à l’appel du comité : « La moitié<br />
d’entre vous, les gars, n’auront plus de boulot à la fin de la guerre. » Les<br />
coups de sabre des centrales contre les initiatives politiques indépendantes<br />
sont effroyables et rapides : quand une organisation non affiliée<br />
au parti, fondée pour faire campagne pour le non lors d’un référendum<br />
sur la « liberté du travail 2 » en Ohio, essaya de poursuivre sur cette voie<br />
victorieuse dans le domaine éléctoral, les dirigeants syndicaux nationaux<br />
et locaux coupèrent tout financement et soutien. Ainsi fut tuée<br />
dans l’œuf la force politique la plus prometteuse qu’ait connue l’Ohio<br />
pendant toute une génération.<br />
Pour des raisons qu’on n’a pas de mal à imaginer, la direction syndicale<br />
dépense des fortunes pour infliger une défaite à Wallace. Les ouvriers<br />
sont submergés de documents détaillant les actions anti-syndicales<br />
menées par Wallace en Alabama et, en plus des appels à contribution, ils<br />
lancent des appels à la raison. Mais, en un sens, tout l’effort fourni pourrait<br />
être contre-productif. Pour la bonne raison que les gens n’aiment pas<br />
s’entendre dire qu’ils sont « racistes » quand au fond de leur cœur ils<br />
soupçonnent que d’autres motifs sont à l’œuvre. Plus important encore,<br />
l’intransigeante posture anti-Wallace des responsables syndicaux est souvent<br />
ramenée à leur autoritarisme virulent sur d’autres questions. « Les<br />
2. Aux États-Unis, les campagnes contre le droit de grève se mènent au nom de<br />
la « liberté du travail ». [ndt]
ANDREW KOPKIND 81<br />
syndicats ont essayé de faire voter pour des racistes dans le passé avec les<br />
mêmes intonations dont ils usent aujourd’hui contre le racisme, expliqua<br />
un militant à Cleveland. Les dirigeants concluent des accords nationaux<br />
dont la base sait qu’ils l’arnaquent, ou les chefs soutiennent des campagnes<br />
d’intégration que la base croit à ses dépens. Ils se font avoir des<br />
deux côtés, et ils en veulent aux syndicats. Désormais, les syndicats leurs<br />
disent de voter pour Humphrey, et ils sont capables de voter pour<br />
Wallace juste pour faire chier. »<br />
Il est un paradoxe sous-jacent à « l’anti-syndicalisme syndical » qui<br />
peut expliquer une bonne part du syndrome Wallace dans le Nord<br />
industriel. Pour Ben Nash, travailleur à la chaîne à Fisher-Euclid (il<br />
monte des joints en caoutchouc sur les vitres de voitures), on peut facilement<br />
rendre compte du paradoxe. « Je suis membre d’un syndicat, me<br />
glissa-t-il dans un souffle. Je ne pourrais pas faire autrement. Je ne crois<br />
pas qu’il soit possible d’obtenir quoi que ce soit sans syndicat. Mais cela<br />
ne veut pas dire que je dois écouter les propos politiques des dirigeants.<br />
Ils ne savent pas comment ça se passe pour nous. Notre fils est sous les<br />
drapeaux ; il va à Fort Benning et là, pour lui c’est ou le Vietnam ou<br />
l’Allemagne. Je ne veux pas qu’il soit blessé au Vietnam ; cette guerre ressemble<br />
exactement à notre façon de faire marcher les choses – comme<br />
notre Nord contre notre Sud, les Noirs contre les Blancs, l’Ouest contre<br />
l’Est. Nous avons eu beaucoup de gars tués juste pour imposer deux<br />
types de gouvernement dans un pays qui n’en veut qu’un. Ceci dit, j’aurais<br />
bien voulu pouvoir voter pour Bobby Kennedy, parce qu’il est moralement<br />
au-dessus des autres, et il avait un bien meilleur conseiller à ses<br />
côtés que H. H. Humphrey. Notre gouvernement, de nos jours, c’est que<br />
des promesses et pas d’action. Je pensais le plus grand bien de Wallace,<br />
cela remontait à l’époque où il s’est révolté contre l’État fédéral.<br />
Maintenant, je ne suis pas contre les gens de couleur, mais je suis contre<br />
les émeutes. Je me fais vieux ; est-ce que je dois vivre dans la peur de la<br />
prochaine émeute ? Je veux que mon foyer soit aussi près du Ciel que<br />
possible. Je bâtis mon foyer et j’espère que le Seigneur va me laisser la<br />
vie sauve pour que j’en profite. »<br />
En quinze années passées à Cleveland, Ben Nash a vécu dans une douzaine<br />
d’appartements et de maisons, avec et sans sa femme et un nombre<br />
variable de ses onze enfants. Avant ça, il avait rampé dans « 81 centimètres<br />
de charbon » dans les mines de Virginie occidentale ; le salaire<br />
minimum s’élevait à 36 cents la tonne (et l’on extrayait environ 10 tonnes
82<br />
RACISME BLANC EN COL BLEU<br />
par jour en moyenne) – « et tu te fournissais ta propre poussière de<br />
charbon pour ton usage ». Son premier appartement à Cleveland lui coûtait<br />
30 dollars par semaine – la norme usuraire pour les familles de<br />
« péquenauds » à cette époque –, mais il fut contraint de déménager à<br />
cause d’une armée de punaises plutôt agressives qui commencèrent à s’en<br />
prendre à ses enfants. Maintenant, il peut se faire 200 dollars par<br />
semaine, heures supplémentaires incluses, en saison pleine, et il retape la<br />
charpente délabrée d’une maison qu’il a achetée pour 7 400 dollars, il y<br />
a cinq ans. L’autre jour, une famille « noire » a emménagé en bas de la<br />
rue, mais les Nash délibèrent toujours pour savoir s’il s’agit de « personnes<br />
de couleur » ou de « Portoricains ». En tout cas, la menace de la<br />
violence plane – de façon floue – au-dessus du ménage Nash.<br />
Nerveuse, Libby Nash lâche : « Pendant les émeutes de Glenville [en<br />
juillet], je pouvais juste me coucher en me demandant ce que je pouvais<br />
faire si elles arrivaient jusqu’ici. Nous n’avons pas d’armes ou autre. »<br />
Ben Nash pense que tout le monde devrait posséder une arme, mais<br />
pour une raison mystérieuse n’en veut pas dans sa maison. « Nous pensions<br />
que Stokes pouvait les rendre un peu plus calmes, raconte-t-il,<br />
mais il ne l’a pas fait. Je suis à 100 % avec la police, parce qu’ils ont fait<br />
serment de me protéger, et, d’une centaine de manières, ils me protègent<br />
tous les jours. Ce ne sont pas seulement les émeutes, c’est un tout. »<br />
Quiconque, même sans posséder le b. a.-ba de la sociologie, pourra<br />
disqualifier Ben Nash et Bradley Jefferson comme racistes, et il y aurait<br />
là un fond de vérité. Mais le racisme ne constitue qu’un symptôme<br />
d’un syndrome beaucoup plus vaste. « Je ne pense pas que les gars de<br />
l’usine soient de véritables racistes, du moins pas plus que n’importe<br />
qui », me confia un transfuge de l’université qui travaillait dans une<br />
usine automobile proche de Cleveland. « Les gens ont eu très peur<br />
quand ils ont entendu parler des émeutes. Mais, à l’usine, les Noirs<br />
étaient bien traités – mieux même que dans les universités des classes<br />
moyennes. » Les plus vieux ouvriers acquiescent : il n’y a pas de lutte<br />
raciale à l’intérieur de l’usine.<br />
Ce qui est arrivé à la classe ouvrière de Cleveland, comme à presque<br />
chaque secteur institutionnalisé de l’existence sociale aux États-Unis,<br />
c’est que le « centre » progressiste s’est effondré et le tourbillon généré<br />
par ce cataclysme a charrié des débris sociaux. Wallace est en position<br />
d’en ramasser quelques-uns. Dans sa campagne, il fixe des enjeux et une<br />
structure idéologique grossière en grande partie arbitraire. Sur ce terreau,
ANDREW KOPKIND 83<br />
si une autre campagne avait pris les devants, on aurait pu tout aussi bien<br />
assister à d’autres floraisons. En quelque sorte, étudier la campagne de<br />
Wallace ne nous apprend rien : il traîne les mêmes bagages rhétoriques<br />
et politiques au cours de ses nombreuses pérégrinations, et il est trop<br />
tentant de mettre tous ses partisans dans le même sac.<br />
On ne peut pas les catégoriser aussi facilement. Le comité de soutien<br />
typique, dans le Sud, transcende les clivages de classe et de caste, des<br />
péquenauds de la « ceinture noire 3 » aux banlieusards du « nouveau<br />
Sud ». Au-delà de ces régions, les vrais croyants de la John Birch Society 4<br />
et les purs et durs de Goldwater 5 sont au moins aussi importants que les<br />
« oubliés » en cols bleus. Les différentes fractions de cet électorat sont fréquemment<br />
en guerre les unes contre les autres. Dans l’Ohio, Wallace a<br />
mené deux campagnes distinctes : « pour les racistes et les bombardeurs<br />
6 », comme les appellent les démocrates progressistes, de façon un<br />
tantinet simpliste. La campagne à l’adresse des ouvriers de l’industrie se<br />
concentre sur les émeutes, mais en prenant, ici aussi, des allures populistes.<br />
Les anathèmes de Wallace visant directement les banques, les fondations<br />
et les « intellos à lunettes » sont presque aussi attractifs que ses<br />
attaques concernant les Noirs. La campagne à destination des classes<br />
moyennes est plus obsédée par le « communisme ». Alors que bon<br />
nombre de travailleurs qui roulent pour Wallace sont des crypto-démocrates,<br />
les organisateurs de sa campagne pour les classes moyennes sont<br />
des transfuges républicains. Ils furent encore plus transportés d’enthousiasme<br />
quand Wallace choisit le général Curtis LeMay comme candidat à<br />
la vice-présidence, mais ce choix pourrait avoir entraîné la défection de<br />
certains ouvriers. « L’appel de Wallace contre la guerre, me dit un ouvrier,<br />
3. Nom de la douzaine d’États du Sud composés en majorité de Noirs dans<br />
l’entre-deux-guerres. [ndt]<br />
4. Think tank d’extrême droite fondé en 1958 par Robert Welch. Se plaçant<br />
sous le double patronage de Dieu et du marché libre, l’organisation s’est toujours<br />
signalée par un anti-communisme virulent. Son nom lui vient d’un soldat<br />
missionnaire tué par les communistes chinois peu après la Seconde Guerre<br />
mondiale. [ndt]<br />
5. Candidat républicain à l’élection présidentielle en 1964. On lui doit la première<br />
inflexion néolibérale du parti d’après-guerre. [ndt]<br />
6. Rappelons que l’article a été écrit en 1968, en pleine guerre du Vietnam. [ndt]
84<br />
RACISME BLANC EN COL BLEU<br />
lui a attiré bien des sympathies parmi les plus jeunes types à l’usine. Ils<br />
ne veulent pas partir, mais ils sont effrayés à l’idée de se rendre.<br />
Fondamentalement, ils sont aussi terrifiés que les étudiants ; ils ne veulent<br />
pas mourir. » Ils pourraient être plus effarouchés que transportés à<br />
entendre l’anticommunisme fanatique de LeMay.<br />
Les deux extrémités du spectre de la campagne de Wallace semblent<br />
se rejoindre au niveau des artisans spécialisés et des petits hommes d’affaires<br />
en herbe, ceux qui sont tout justes inclus ou exclus de la terre promise<br />
du statut social et de l’accomplissement de soi. Dans les usines<br />
automobiles, le soutien à Wallace est le plus important parmi les jeunes<br />
apprentis, dont beaucoup ont essayé – sans succès – de s’élever en accédant<br />
aux carrières des classes moyennes et se sentent maintenant piégés<br />
à l’usine. Juste au centre du spectre, on trouve le lumpen-salariat et les<br />
indépendants qui tirent le diable par la queue et ont tout juste pu<br />
s’extraire du centre-ville, se réfugiant dans ce camp, la nuque encore<br />
toute chaude du souffle de leurs anciens camarades de classe. Pour le dire<br />
brutalement, Wallace ne peut rien faire pour aucun d’entre eux. Il n’a ni<br />
programme ni plan pour satisfaire ses différents électeurs du Nord. Dans<br />
l’Ohio, beaucoup de politiciens – comme Carl Stokes – croient (espèrent<br />
?) que la candidature de Wallace va perdre de son attrait au dernier<br />
moment, quand les électeurs prendront la pleine mesure de l’horreur et<br />
de la futilité de sa campagne dans l’intimité de l’isoloir. Cela peut se révéler<br />
vrai, mais si la campagne n’est réellement que l’expression d’une<br />
« nouvelle politique » du ressentiment, le phénomène réapparaîtra de<br />
nouveau sous telle ou telle forme monstrueuse. Car Wallace comme ses<br />
électeurs savent que cette campagne leur a, en elle-même, déjà donné un<br />
certain pouvoir auquel ils n’avaient jamais goûté auparavant. Désormais,<br />
on les prend au sérieux, et il n’y a pas moyen de revenir en arrière.<br />
ANDREW KOPKIND<br />
Traduit de l’anglais par Michaël Lainé<br />
Ce texte a paru en octobre 1968 dans Mayday sous le titre « Blue Collars and<br />
White Racism », repris in Joann Wypijewski (dir.), The Thirty Years’ Wars :<br />
Dispatches and Diversions of a Radical Journalist, 1965-1994, Verso, 1995
MARIANNE DEBOUZY 85<br />
Stratégies des multinationales<br />
& ripostes ouvrières aux États-Unis<br />
DES STRATÉGIES GLOBALES des multinationales s’inscrit<br />
dans le contexte de l’introduction de nouvelles technologies<br />
L’ÉVOLUTION<br />
(automation, informatisation) et des restructurations dont elles<br />
sont l’accompagnement, restructurations qui ont pour corollaire l’internationalisation<br />
de la production (délocalisations), la « nouvelle » organisation<br />
du travail (travail d’équipe, coopération, cercles de qualité,<br />
production à flux tendus) et enfin l’action anti-syndicale (unionbusting<br />
1 , procédures juridiques, rôle du National Labor Relations<br />
Board 2 ) qui entraîne en retour des ripostes ouvrières oscillant entre<br />
mobilisation et apathie.<br />
1. Littéralement : démolition des syndicats. Les entreprises utilisent les services<br />
d’avocats spécialisés dans la lutte anti-syndicale. Elles ont également recours à des<br />
méthodes plus musclées (nervis, etc.).<br />
2. Les travailleurs américains ont acquis les droits de s’organiser et de négocier<br />
collectivement avec l’adoption du National Labor Relations Act de 1935. Le<br />
National Labor Relations Board est un service fédéral chargé d’assurer le respect<br />
de cette loi.<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 85-104
86<br />
STRATÉGIES DES MULTINATIONALES & RIPOSTES OUVRIÈRES<br />
ÉVOLUTION DES STRATÉGIES DES MULTINATIONALES<br />
La période 1945-1960 a été marquée par l’expansion du capitalisme<br />
américain et sa conquête de nouveaux marchés. Ministre du travail sous<br />
Bill Clinton, Robert Reich souligne le lien stratégique dans ces années-là<br />
entre la puissance des États-Unis et celle des grandes firmes 3 . Il affirme<br />
que la CIA a joué un rôle actif dans cette expansion et qu’elle « découvrait<br />
» opportunément des « complots communistes » dans les régions<br />
dont les ressources naturelles intéressaient les grandes firmes. De plus, la<br />
conquête des marchés, sous la forme du plan Marshall ou d’interventions<br />
à l’étranger, avait l’assentiment du mouvement syndical qui soutenait<br />
quasi inconditionnellement la politique étrangère du gouvernement<br />
américain et coopérait avec le monde des affaires.<br />
Jusque dans les années 1960, l’hégémonie américaine permettait aux<br />
grandes firmes d’imposer leurs prix. Mais face à la concurrence internationale<br />
croissante, une nouvelle stratégie consista à protéger le marché<br />
américain : introduction de quotas sur les produits textiles, l’acier, les<br />
produits électroniques, etc. À la fin des années 1980, près d’un tiers (en<br />
valeur) des produits manufacturés aux États-Unis étaient protégés contre<br />
la concurrence internationale, de façon souvent indirecte ou non<br />
avouée : protection contre les « pratiques déloyales » des industriels<br />
étrangers, producteurs subventionnés, contrats réservés dans le domaine<br />
de la défense, etc. Il s’agissait bien de protectionnisme, mais présenté<br />
comme « volontairement » accepté par les exportateurs étrangers.<br />
Pour autant, les importations augmentent dans les années 1960-1970<br />
et ce protectionnisme se révèle insuffisant. D’où le recours des grandes<br />
firmes à une nouvelle stratégie : la « rationalisation » de la production,<br />
qui se traduit par la réduction des salaires, la fermeture d’usines aux<br />
États-Unis et la délocalisation vers les pays concurrents. La croissance de<br />
la valeur totale des importations en provenance d’usines américaines<br />
situées à l’étranger passa de 1,8 milliard de dollars en 1969 à près de 22<br />
milliards en 1983. Mais la rentabilité de la plupart des firmes n’en fut pas<br />
pour autant restaurée. Celles-ci multiplièrent alors les opérations financières.<br />
Dans les années 1970-80 des firmes régionales se sont « mondia-<br />
3. Robert Reich, The Work of Nations. Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism,<br />
Vintage Books, 1992.
MARIANNE DEBOUZY 87<br />
lisées », comme l’atteste l’exemple de l’entreprise d’agro-alimentaire<br />
Staley (Decatur, Illinois), rachetée par le conglomérat Tate & Lyle ;<br />
d’autres se sont transformées en holdings financières, en effectuant des<br />
fusions et en manipulant leurs actifs. Des conglomérats ont diversifié<br />
leurs activités en rachetant des firmes qui se livraient à des activités sans<br />
liens entre elles. Ces fusions ont aussi conduit à la liquidation des firmes<br />
non rentables, notamment dans l’acier, les mines, la conserverie de<br />
viande. Les « raids », les « takeovers », les « buyouts » et l’échec de nombreuses<br />
fusions ont généré des endettements considérables pour certaines<br />
sociétés. Selon Robert Reich, les grandes firmes qui se sont<br />
restructurées sont devenues des coquilles vides : elle se sont vidées de<br />
leurs machines et de leur main-d’œuvre en recourant intensivement à la<br />
sous-traitance. Les corporations sont devenues des réseaux, des combinaisons<br />
de groupes d’investisseurs et de strategic brokers (courtiers en<br />
stratégie). La grande firme s’est de plus en plus déconnectée de son pays<br />
d’origine. Cette internationalisation a rendu le mode de production, le<br />
financement, les contrats de travail, la sous-traitance, la répartition des<br />
profits extraordinairement complexes. En 1990, 40 % des employés<br />
d’IBM dans le monde étaient étrangers. Whirlpool employait 43 500 personnes<br />
dans 45 pays, après avoir réduit sa main-d’œuvre américaine de<br />
10 %. En 1999, la Division Packard Electric, devenue Delphi Packard<br />
Electric, employait 40 000 personnes au Mexique et moins de 10 000 à<br />
Warren, Ohio, au nord de Youngstown.<br />
Il s’agit bien de choix stratégiques : au début des années 1980, les<br />
constructeurs automobiles ont ainsi renoncé à fabriquer des petites<br />
voitures aux États-Unis et augmenté leurs participations dans des firmes<br />
japonaises ou ont organisé eux-mêmes l’importation des voitures<br />
japonaises aux États-Unis.<br />
MOYENS AU SERVICE DE CES STRATÉGIES<br />
1) L’innovation technologique<br />
L’automation a été la révolution technologique des années 1950-1960.<br />
Au début, les ordinateurs étaient des machines au fonctionnement lourd,<br />
occupant une place considérable et représentant un investissement
88<br />
STRATÉGIES DES MULTINATIONALES & RIPOSTES OUVRIÈRES<br />
élevé, réservé à l’industrie lourde, avant de gagner le secteur de l’automobile.<br />
Puis la combinaison de la miniaturisation des circuits intégrés et<br />
la chute vertigineuse du prix des ordinateurs et des micro-processeurs a<br />
conduit à l’apparition d’une automation « flexible » adaptée à la production<br />
en petite série. L’informatique permet de « prolonger et renforcer<br />
les tendances de l’organisation scientifique du travail (OST) 4 ». Non<br />
sans réactions : en 1972, l’ouverture d’une chaine robotisée à l’usine<br />
automobile de Lordstown provoque une grève qui marque les annales 5 .<br />
De même, en 1977, des camionneurs approvisionnant les grandes surfaces<br />
se mettent en grève contre les cadences imposées par les ordinateurs<br />
qui calculent le temps de manipulation des cartons.<br />
L’informatique tend aussi à vider de son contenu le travail des ouvriers<br />
qualifiés : c’est le cas des machines-outils à commande numérique utilisées<br />
dans l’usinage du métal : ces machines sont introduites dans l’industrie<br />
automobile « pour fabriquer les outils et matrices des machines<br />
productrices de composants 6 ». Le cœur du métier des machinists est<br />
atteint. La bande magnétique, sur laquelle figure l’information codée<br />
donne les instructions à la machine. L’ouvrier qualifié n’est plus qu’un<br />
surveillant presse-bouton. Il a perdu compétence et autonomie.<br />
L’informatique mine aussi le pouvoir ouvrier collectif dans l’entreprise.<br />
La nouvelle technologie permet une surveillance accrue et devient une<br />
arme anti-grève. On le voit lors d’une grève chez General Motors en<br />
1973 : il a suffi à la direction de transférer vers une autre usine les bandes<br />
magnétiques commandant la fabrication d’un nouveau modèle de<br />
Cadillac, conçu en un temps record, pour assurer la sortie du modèle à<br />
la date prévue… De même, lors du conflit dans l’usine aéronautique<br />
McDonnell Douglas en 1975, l’informatique a permis de maintenir près<br />
de 60 % de la production malgré les piquets de grève.<br />
La stratégie de modernisation était également sélective. À Detroit, dans<br />
les années 1960-1970, les Noirs parlaient de « niggermation » : ils travaillaient<br />
dans les usines vétustes et les ouvriers blancs dans les unités<br />
modernisées.<br />
4. Benjamin Coriat, L’Atelier et le chronomètre, Bourgois, Paris, 1979, p. 219.<br />
5. La grève de Lordstown a exprimé la révolte des ouvriers contre les effets de l’automatisation<br />
et l’accélération des cadences dans cette usine de la General Motors.<br />
Elle est devenue emblématique du « blue-collar blues ».<br />
6. Laurent Cesari, « Les syndicats américains de l’automobile face à l’automation,<br />
1945-77 », mémoire de maîtrise, université Paris-1, 1978, p. 29.
MARIANNE DEBOUZY 89<br />
L’introduction de l’automation avait beau s’accompagner de restructurations<br />
et de suppressions massives d’emplois, elle provoqua des réactions<br />
modérées de la part du mouvement syndical 7 . Le labor pratiquait<br />
alors une politique de coopération avec le patronat 8 . Il avait une vision<br />
étriquée de l’action syndicale, limitée à la négociation de contrats dans le<br />
respect du légalisme, alors même que dans la plupart des cas la clause<br />
du no strike pledge (engagement de ne pas faire grève) était de rigueur.<br />
L’introduction de la technologie relevait d’un droit patronal (managerial<br />
right) incontesté. Le respect de la sacro-sainte entreprise semblait<br />
profondément intériorisé par les dirigeants syndicaux, tout comme la<br />
croyance dans le progrès technique et le productivisme. Face à l’automatisation,<br />
les syndicats se contentaient de rechercher des compensations<br />
et des avantages, comme la garantie de l’emploi pour les ouvriers<br />
sur la base de l’ancienneté et de la qualification. On serait tenté de parler<br />
de fatalisme technologique, mais le contraste entre le mouvement<br />
syndical et la base est frappant. Les années 1960-1970 furent celles du<br />
blue-collar blues et de la rank-and-file rebellion (révolte de la base), qui se<br />
manifestèrent par de multiples formes de résistance au travail. Dans les<br />
usines modernisées, récemment ou non, le turn-over fut énorme.<br />
L’absentéisme, le ralentissement des cadences (slowdown), voire le sabotage,<br />
l’indiscipline et la violation du règlement de l’entreprise étaient<br />
autant de manifestations du rejet de l’éthique du travail si chère au cœur<br />
des moralistes américains. Ces attitudes reflétaient l’air du temps (les sixties)<br />
mais traduisaient aussi une sensibilisation des ouvriers aux « dégâts<br />
du progrès », dans un contexte de concurrence accrue. La mystique syndicale<br />
du progrès technologique et le fatalisme qui l’accompagne ordinairement<br />
étaient remises en cause. Cette prise de conscience influença,<br />
dans une certaine mesure, le syndicat de l’automobile (United<br />
Automobile Workers), qui inclut parmi ses propositions de convention<br />
collective (1979) un ensemble de revendications concernant l’innovation<br />
technologique, au nombre desquelles figuraient l’information du syndicat<br />
avant l’introduction de nouvelles machines et son implication dans<br />
7. Lire Marianne Debouzy, « Les syndicats face à l’innovation technologique »,<br />
Politique Aujourd’hui, janvier-février 1980, p. 44-52, et « Syndicats et mutations :<br />
l’exemple américain », CFDT Aujourd’hui, <strong>n°</strong> 44, juillet 1980, p. 20-34.<br />
8. Jeremy Rifkin, The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn<br />
of the Post-Market Era, Putnam, New York, 1995, p. 84-87.
90<br />
STRATÉGIES DES MULTINATIONALES & RIPOSTES OUVRIÈRES<br />
les négociations portant sur la conception et l’application des nouveaux<br />
systèmes de production.<br />
Les multinationales comme General Motors, Gulf Oil, Texaco, etc.<br />
développèrent aussi le concession-bargaining. Lors de la négociation des<br />
conventions collectives, les firmes exigèrent des concessions : gel ou<br />
réduction des salaires, suppression de jours de vacances, réduction des<br />
avantages sociaux (santé, retraites), etc. À l’argument des difficultés<br />
conjoncturelles (récession de 1980-1981) dans certains secteurs succéda<br />
la généralisation de cette pratique à des branches florissantes. Les syndicats,<br />
affaiblis par la chute de leurs effectifs, minés par leur conception<br />
étroite du syndicalisme, poursuivirent cependant leur politique de<br />
coopération avec le patronat, pratiquant le « syndicalisme d’entreprise »<br />
et tentant de sauver les appareils de la bureaucratie syndicale en fusionnant<br />
à leur tour.<br />
Les années 1980 furent néanmoins marquées par des grèves dramatiques<br />
: celle du syndicat des aiguilleurs du ciel (1981) – dont la dissolution<br />
par Ronald Reagan marquera toute la décennie –, celle des<br />
ouvriers des mines de cuivre du Sud-Ouest (1983), de la conserverie de<br />
viande (Hormel, 1984-1985), de l’industrie du papier (International<br />
Paper Company) et des mines de charbon (Pittston, 1989).<br />
La fin des années 1970 et le début des années 1980 virent aussi des<br />
luttes dans l’industrie de l’acier. Les restructurations qui ont suivi la crise<br />
de l’acier à la fin des années 1970 et au début des années 1980 sont<br />
emblématiques de la stratégie industrielle et financière des multinationales.<br />
On sait que la part mondiale des États-Unis dans la production de<br />
l’acier dégringola de 55 % en 1950 à 16 % à la fin des années 1970. Au<br />
début des années 1980, les importations atteignirent environ 25 % de<br />
l’acier consommé aux États-Unis. Les effectifs du syndicat de la sidérurgie<br />
passèrent de 1,4 million en 1981 à 635 000 en 1983. Les grandes<br />
firmes, sclérosées par leur longue domination de la production mondiale,<br />
avaient négligé les investissements au point que la vétusté des installations<br />
était frappante pour tous les observateurs. Face à la chute de la<br />
rentabilité, les multinationales de l’acier choisirent d’investir non dans<br />
l’outil de production mais dans la diversification de leurs activités<br />
(pétrole, chimie, charbon, uranium, transports ferroviaires et maritimes)<br />
et de recourir aux importations.<br />
Les ouvriers menèrent d’abord la lutte de façon « classique » : pétitions,<br />
piquets de grève, occupation du quartier général de US Steel à Pittsburgh
MARIANNE DEBOUZY 91<br />
et de son administration à Youngstown. Puis une campagne fut lancée<br />
par des unions locales et une coalition de groupes religieux et autres pour<br />
rouvrir une ou deux usines « under worker or community ownership »<br />
[devenues propriétés des ouvriers ou de la collectivité] 9 . Cette campagne<br />
se solda par un échec après le refus de l’État fédéral d’accorder prêts et<br />
subventions et celui des firmes de négocier une vente éventuelle.<br />
La lutte pour sauver les usines sidérurgiques durera des années dans<br />
ce qui deviendra la « Rust Belt» [ceinture de rouille] et les ouvriers furent<br />
marqués par le désespoir, la dépression, l’alcoolisme, le suicide, les<br />
divorces, certains n’ayant d’autre issue que de s’engager dans l’armée 10 .<br />
Malgré tout, certains se sont battus 11 , créant des organisations d’entraide,<br />
inventant de nouveaux modes d’action, cherchant à élaborer une<br />
solution originale aux problèmes de la sidérurgie. Le désastre provoqué<br />
par la fermeture des usines rendait nécessaire des secours immédiats.<br />
Des comités de chômeurs se constituèrent. Le Mon Valley Unemployed<br />
Committee, outre la manifestation contre Reagan en avril 1983 lors de sa<br />
visite à Pittsburgh, organisa des marches et des rassemblements, lutta<br />
contre les expulsions, empêcha la mise aux enchères des maisons des<br />
chômeurs, et créa des banques alimentaires. Malgré la formation d’organisations<br />
nationales lors de la First National Conference of Unemployed<br />
Groups en juin 1983 (Erie, Pennsylvanie), ces comités ne sont pas devenus<br />
une force politiquement significative. Des syndicalistes « dissidents »<br />
des United Steelworkers of America, regroupés autour de Ron Weisen,<br />
jouèrent un rôle actif dans diverses tentatives d’organisation des travailleurs<br />
et de rationalisation de la lutte. Ils n’ont pas réussi pour autant<br />
à surmonter les divisions ni l’hostilité de la majorité des travailleurs à<br />
l’égard des formes d’action radicales prônées par Ron Weisen.<br />
Ce dernier pratiqua l’action directe et la désobéissance civile dans l’espoir<br />
d’abattre le mur du silence qui enfermait les sinistrés de l’acier dans<br />
9. Sur les pièges du système de « reprise par l’entreprise des salariés » – c’est-àdire<br />
« par certains salariés » –, lire Frédéric Lordon, « Comment la finance a tué<br />
Moulinex », Le Monde diplomatique, mars 2004. [ndlr]<br />
10. Judith Modell, A Town without Steel. Envisioning Homestead, University of<br />
Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1988, p. 150 et sq.<br />
11. Dans son enquête, Jack Metzgar se demande pourquoi les ouvriers ont été aussi<br />
soumis, « Plant Shutdowns and Worker Response : The Case of Johnstown, Pa »,<br />
Socialist Review, <strong>n°</strong> 53, septembre-octobre 1980, p. 9-49.
92<br />
STRATÉGIES DES MULTINATIONALES & RIPOSTES OUVRIÈRES<br />
leur malheur. Il voulait obliger la presse à parler du désastre, mobiliser<br />
les travailleurs et réveiller la middle class bien-pensante par des actions<br />
telles que dépôt de poisson pourri dans un coffre de la banque Mellon,<br />
arrosage de l’intérieur de la banque, apparition déguisé en évêque sur le<br />
parvis de la cathédrale pour fustiger l’indifférence de la hiérarchie catholique<br />
à la détresse des sidérurgistes, etc. Il était soutenu par des pasteurs<br />
contestaires de la région de Pittsburgh qui, en 1982, avait constitué la<br />
Denominational Ministry Strategy. Ceux-ci menèrent toutes sortes d’actions,<br />
firent des sermons incendiaires, occupèrent leurs lieux de culte.<br />
Ces actions symboliques qui firent scandale et valurent à leurs auteurs<br />
poursuites, peines d’emprisonnement et renvois visaient la banque<br />
Mellon – bailleuse de fonds de l’industrie de l’acier qui refusait d’investir<br />
pour moderniser les usines et maintenir l’emploi – et les dirigeants de<br />
US Steel, membres respectés des églises qui assistaient le dimanche à<br />
l’office et licenciaient les ouvriers le restant de la semaine.<br />
Parallèlement à ces groupes s’était constituée en, 1979, après l’échec<br />
de la première tentative pour rouvrir les usines, la Tri-State Conference<br />
on Steel, qui élabora un projet original et ambitieux concernant l’industrie<br />
de l’acier dans trois États (Pennsylvanie, Ohio, Virginie Occidentale).<br />
Le projet était piloté par un groupe composé de Staughton Lynd – historien<br />
connu, devenu avocat du travail à Youngstown et activiste infatigable<br />
–, de syndicalistes – dont Ron Weisen, Mike Stout et Charlie<br />
McCollester – et un groupe de religieux, en majorité catholiques, d’universitaires<br />
et d’avocats. Leur projet qui, au début des années 1980, se<br />
recentra sur la Pennsylvanie, proposait que l’État utilise ses prérogatives<br />
pour créer une Steel Valley Authority, version modifiée de la Tennessee<br />
Valley Authority 12 . Ce programme de réindustrialisation par le bas comportait<br />
les points suivants : « Utilisation du domaine public par les institutions<br />
publiques locales afin d’acquérir des établissements que<br />
l’entreprise privée ne veut plus faire fonctionner ; financement fédéral ;<br />
gestion publique décentralisée ou coopérative ; et autonomie économique<br />
locale et régionale maximale. 13 » Lynd a raconté, dans divers<br />
12. Staughton Lynd, « Community Right to Industrial Property in Youngtown »,<br />
Journal of American History, vol. 74, décembre 1987, p. 927. Lire également<br />
Michael Hoyt, « Steelworkers Propose Viable Plant to Revive Dying Plant », In These<br />
Times, 20-26 février 1985.<br />
13. Staughton Lynd, « The View from Steel Country », Democracy, été 1983, p. 28.
MARIANNE DEBOUZY 93<br />
articles et ouvrages, la lutte obstinée menée par tous ceux qui participaient<br />
à la mise en œuvre de ce projet pour sauver des milliers d’emplois,<br />
l’appel à des experts pour établir solidement la faisabilité de l’entreprise<br />
de « réindustrialisation », les heures innombrables passées à convaincre<br />
les politiciens locaux de la nécessité de se battre et de la possibilité de<br />
gagner la bataille, l’acharnement des militants à mobiliser les ouvriers et<br />
à maintenir l’outil de travail en état de marche et empêcher sa destruction.<br />
Un des épisodes les plus dramatiques de la lutte fut la tentative, en<br />
1984-1985, de sauver le haut fourneau « Dorothy Six » de l’usine<br />
Duquesne, tentative appuyée sur une mobilisation sans précédent et qui<br />
suscita d’immenses espoirs après qu’un rapport d’expert eut affirmé que<br />
le haut fourneau pouvait être rentable. Les militants bloquèrent quatre<br />
fois sa destruction. Mais le projet de la Tri-State Conference se heurta à<br />
une hostilité jamais démentie de Wall Street, qui refusait de financer<br />
l’opération, et des dirigeants des firmes sidérurgiques. Selon un des syndicalistes<br />
impliqués dans le projet, « il y a eu une hostilité absolue des<br />
groupes dirigeants de Pittsburgh. Elle a été totale et continue pendant<br />
toute la période. Nous pouvions venir à bout des politiciens et les faire<br />
bouger dans notre direction. Mais nous n’avons rien pu faire avec les<br />
gens de la finance 14 ». Le projet n’a pas non plus trouvé les soutiens politiques<br />
nécessaires au niveau du parti démocrate et de l’État fédéral.<br />
Quelques usines sidérurgiques ont été modernisées par leurs propriétaires,<br />
avec un nombre réduit d’ouvriers, d’autres ont été délocalisées,<br />
aux États-Unis et à l’étranger. Les villes de l’ancien bastion industriel de<br />
l’acier sont devenues des villes fantômes.<br />
2) L’internationalisation de la production : les délocalisations<br />
La stratégie protectionniste n’ayant pu juguler les importations et la<br />
concurrence s’exacerbant, le patronat usa des délocalisations, produisant<br />
à l’étranger pour le marché américain. L’industrie du bois, du cuivre, etc.<br />
importa des matières premières auparavant produites aux États-Unis.<br />
Cette stratégie n’était pas totalement nouvelle. Depuis longtemps, les<br />
runaway shops se déplaçaient, aux États-Unis mêmes, vers les États du<br />
Sud (stratégie « sudiste » des firmes textiles de Nouvelle-Angleterre dans<br />
14. Charlie McCollester, « Mike Stout and the TriState Conference on Steel », in Alice<br />
et Staughton Lynd (dir.), The New Rank and File, Cornell UP, Ithaca, 2000, p. 128.
94<br />
STRATÉGIES DES MULTINATIONALES & RIPOSTES OUVRIÈRES<br />
les années 1930 et de l’industrie automobile dans les années 1960) ainsi<br />
que vers les régions rurales du Midwest. Elles délocalisèrent vers le tiersmonde<br />
(Amérique centrale, Asie du Sud-Est, etc.) et, plus récemment,<br />
vers l’Europe de l’Est (Hongrie, Pologne, Ukraine, etc.). Les délocalisations<br />
pratiquées par les multinationales comme Disney, Wal-Mart,<br />
General Motors, General Electric, Westinghouse, Honeywell, etc. sont<br />
sélectives – selon des critères comme le type de produits, la nature des<br />
fonctions de production, le poids de la main-d’œuvre. Un cas éclaire particulièrement<br />
bien ce processus de migration, c’est celui de RCA, fabricant<br />
de radios, transistors et télévisions, qui transféra sa production du<br />
New Jersey vers l’Indiana, le Tennessee puis Ciudad Juarez (Mexique) en<br />
1968 15 . La firme fut rachetée par General Electric en 1986 et les deux<br />
usines de Bloomington (1 100 emplois) et Indianapolis (420 emplois)<br />
fermées en 1998. C’est la production des éléments qui demandaient le<br />
plus de travail non qualifié qui fut délocalisée. Entre 1974 et 1982, 3 500<br />
emplois ont été éliminés à Bloomington. Ainsi s’opère la division internationale<br />
du travail : qualifié à Bloomington, non qualifié au Mexique.<br />
Les délocalisations ont aussi un caractère disciplinaire, car elles sanctionnent<br />
souvent les grèves. En 1967, la dernière grève chez RCA a été<br />
suivie de la délocalisation au Mexique.<br />
Les délocalisations, qui s’effectuent vers un très grand nombre de pays,<br />
ont leurs lieux de prédilection : le long de la frontière mexicaine, là où<br />
sont installées les maquiladoras, et plus généralement les « zones<br />
franches ». Lancé en 1965, le maquila system 16 a vraiment décollé dans<br />
les années 1980. On dénombrait 620 maquiladoras en 1980, 789 en<br />
1985, 3 508 en 1997. En 2000, les maquiladoras employaient environ<br />
500 000 personnes, en grande majorité des jeunes femmes, dans des<br />
usines de montage et d’assemblage de produits électroniques, vêtements,<br />
pièces détachées d’automobiles, etc. Selon le témoignage d’un ouvrier<br />
mexicain de l’usine Ford de Cuautilàn, en 1993 le salaire des ouvrières<br />
des maquiladoras était couramment de 55 cents de l’heure, celui des<br />
ouvriers oscillant entre 1,40 et 2,80 dollars 17 .<br />
15. Lire Jefferson Cowie, Capital Moves : RCA’s Seventy Year Quest for Cheap Labor,<br />
Cornell UP, Ithaca, 1999.<br />
16. Au Mexique, ce mot, qui vient de « fraisage », est aujourd’hui associé au processus<br />
d’assemblage de composants importés et à l’exportation des produits finis.<br />
17. « Workers for Ford in Mexico » in Alice et Staughton Lynd (dir.), The New Rank<br />
and File, op. cit., p. 177-78.
MARIANNE DEBOUZY 95<br />
Autre lieu privilégié : les « zones franches ». On assiste depuis plusieurs<br />
années à la prolifération des Export Processing Zones (EPZ) où l’on<br />
fabrique vêtements, jouets, chaussures, produits électroniques, machines<br />
et automobiles. La plus grande EPZ se trouve à Cavite aux Philippines<br />
(plastique et aluminium). Selon Naomi Klein, 500 000 personnes travaillent<br />
dans 52 EPZ aux Philippines et 18 millions dans 124 EPZ en<br />
Chine 18 . Selon le Bureau international du travail, il y aurait au moins<br />
850 EPZ dans 70 pays. On a dénombré 225 free-trade zones [zones<br />
franches] au Salvador qui emploient 70 000 jeunes femmes pour un<br />
salaire horaire de 60 cents. Si l’on compte leurs dépenses incompressibles<br />
(transports, nourriture sur le lieu de travail), elles gagnent 1,82<br />
dollar par jour 19 .<br />
On sait qu’aujourd’hui les délocalisations touchent aussi les emplois<br />
de bureau, les services, et l’informatique : traitement des billets d’avions<br />
au Sri-Lanka, réservations aériennes et examen de la validité des réclamations<br />
auprès des assurances en Irlande, confection des annuaires dans<br />
les pays du tiers-monde, services informatiques en Inde.<br />
Qui dit délocalisation dit bien évidemment fermeture d’usines. Y-a-t-il<br />
eu riposte ouvrière sur place et à l’étranger ? Prévenus à la dernière<br />
minute, pas ou peu protégés par la législation, les ouvriers ont eu beaucoup<br />
de mal à riposter. Les réactions ont souvent été nationalistes et<br />
xénophobes, comme à Youngstown 20 . De même à Kenosha (Indiana),<br />
ville de l’American Motors Company où un panneau, dans le parking du<br />
syndicat local, avertissait : « AUTOMOBILES ÉTRANGERES INTERDITES… SAUF<br />
VOLKSWAGEN » 21 . Les ripostes ont pris la forme de manifestations :<br />
marches, rassemblements, comme à Kenosha, lors de la fermeture de<br />
l’usine automobile. Les ouvriers ont aussi voulu faire pression sur les<br />
dirigeants, avec par exemple des piquets de grève devant l’hôtel de<br />
Chicago où était descendu leur patron, et faire connaître leur sort dans<br />
tout le Midwest, en manifestant à Milwaukee, au salon de l’automobile.<br />
18. Naomi Klein, No Logo. La tyrannie des marques, Actes Sud, 2001.<br />
19. Janet Thomas, The Battle in Seattle. The Story Behind and Beyond the WTO<br />
Demonstrations, Fulcrum Publishing, Golden, Colorado, 2000, p.78.<br />
20. Staughton Lynd, « The Fight to Save the Steel Mills », New York Review of Books,<br />
19 avril 1979, p. 37.<br />
21. Kathlyn Dudley, The End of the Line, University of Chicago Press, Chicago, 1997,<br />
p. 154.
96<br />
Ils ont occupé des panneaux publicitaires dans la ville de Detroit et sur<br />
les bus de Madison. Outre les « actions spectacles », comme un avion<br />
déployant une banderole « Keep Kenosha Open » à Calgary, lors des jeux<br />
Olympiques d’hiver, ils ont mené des actions juridiques et syndicales,<br />
négocié un accord [plant-closing deal] consentant un certain nombre de<br />
compensations aux travailleurs (considéré comme une trahison par<br />
beaucoup). Globalement, la mobilisation est restée relativement faible.<br />
3) L’organisation du travail<br />
STRATÉGIES DES MULTINATIONALES & RIPOSTES OUVRIÈRES<br />
En même temps qu’elles ferment les usines aux États-Unis et délocalisent<br />
la production, les multinationales ne cessent de chercher de « nouvelles<br />
» formes d’organisation du travail qui permettent une productivité<br />
accrue, une baisse des coûts du travail et un plus grand contrôle de l’autonomie<br />
ouvrière. Dans les années 1960-1970, en réaction à la révolte<br />
contre le travail taylorisé (voir le blue-collar blues), les industriels ont élaboré<br />
un certain nombre de recettes qui prétendaient remettre en cause<br />
l’OST : cercles de qualité, travail en équipe, coopération (jointness), dans<br />
le but de « récupérer » (co-opting) les travailleurs et d’affaiblir les syndicats<br />
– ce qui n’exclut nullement par ailleurs le recours au bâton sous la<br />
forme, par exemple, du union-busting. Il n’était question que de participation,<br />
d’équipes soudées au service de l’entreprise. Voici ce qu’en pensait<br />
Tony Budak, ouvrier de la Packard Electric Division de GM à Warren<br />
(Ohio) : « Quand vous “participez” avec la direction, vous pensez peutêtre<br />
que vous faites des avancées, mais vous ne gagnez rien de réel. C’est<br />
la direction qui fixe le programme. Vous participez à la décision quant à<br />
la couleur des lignes jaunes sur le sol de l’usine. Et quand la grille des<br />
emplois changent, vous ne faites pas attention. Quand les machines et le<br />
travail s’en vont pas la porte de derrière, vous ne faites pas attention.<br />
Vous perdez le sens de ce qui est important. En participant, vous oubliez<br />
comment vous battre. Quand il s’agit de parler de choses qui importent<br />
vraiment au syndicat, tout ce que vous avez, c’est des réunions de groupe<br />
qui n’ont aucun pouvoir. 22 »<br />
22. Alice et Staughton Lynd (dir.), The New Rank and file : Personal Histories by<br />
Working Class Organizers, Cornell UP, Ithaca, 2000, p. 139. Cet avis est partagé par<br />
Ed Mann, militant syndicaliste de la sidérurgie (ibid., p. 110) ; lire également Michael<br />
Moore, Dégraissez-moi tout ça, La Découverte, Paris, 2000.
MARIANNE DEBOUZY 97<br />
À la vogue du modèle suédois a succédé celle du modèle japonais et<br />
de son fameux kaisen [qualité totale]. La production au plus juste [lean<br />
production], à flux tendus [just in time], la polyvalence, la rotation des<br />
postes, la flexibilité et, cerise sur le gateau, la gestion des compétences<br />
accompagnent la généralisation de la sous-traitance. La production au<br />
plus juste s’effectue sur la base d’économies d’échelle, une flexibilité tous<br />
azimuts des effectifs, des horaires et des fonctions et une décentralisation<br />
de la chaine de production.<br />
D’inspiration japonaise ou non, la flexibilité et la sous-traitance vont<br />
de pair et se déclinent sous toutes les formes, en premier lieu par le<br />
recours aux intérimaires, à temps plein ou à temps partiel. Cette pratique<br />
touche tous les secteurs et tous les emplois. On a évoqué le cas de l’industrie<br />
automobile au Mexique. Dans les télécommunications, AT&T a<br />
créé une filiale non syndicalisée, Transtech, qui sous-traitait à Accustaff,<br />
agence de travail intérimaire, l’emploi de 3 000 personnes dans le télémarketing.<br />
Dans l’industrie, Boeing sous-traite, surtout en Asie, 40 %<br />
d’emplois autrefois assurés aux États-Unis.<br />
Quant à la flexibilité, elle a plusieurs dimensions. Elle vise à remettre<br />
en cause les règles de travail qui, dans les accords collectifs, fixent le<br />
nombre de personnes nécessaires à l’accomplissement d’une tâche. Elle<br />
permet de modifier les « lignes de démarcation » entre les métiers, problème<br />
au centre des préoccupations des ouvriers qualifiés confrontés à<br />
l’innovation technologique. Ce qui les inquiète, c’est la perspective que<br />
les emplois qualifiés soient de plus en plus remplacés par des « emplois<br />
généraux » et qu’il soit beaucoup plus facile pour la direction de licencier<br />
des spécialistes devenus inutiles. Le management cherche à s’affranchir<br />
de la définition des postes, à combiner deux métiers anciens ou plus<br />
pour n’en créer qu’un, par exemple mécanicien/soudeur, à créer de nouvelles<br />
catégories du type « entretien général ». Ainsi Shell a fondu les<br />
qualifications des peintres, monteurs en isolation et charpentiers en une<br />
seule catégorie, et dans les télécommunications les testeurs sont assimilés<br />
à des travailleurs de bureau. Tout cela dans un système où l’on fait de<br />
plus en plus appel à une main-d’œuvre non syndiquée, extérieure à l’entreprise.<br />
Enfin, la flexibilité est un moyen d’éviter de se conformer à certaines<br />
règles de sécurité et d’hygiène. Les contrôles dans beaucoup<br />
d’entreprises deviennent fantômatiques.<br />
Comme l’a bien montré Kim Moody, la production « au plus juste »<br />
combine en réalité des éléments techniques de pointe (informatisation)
98<br />
et des recettes archaïques : précarisation, sous-traitance, réduction des<br />
effectifs, alourdissement des tâches, accélération des cadences, allongement<br />
de la durée du travail, mépris des règles d’hygiène et de sécurité. Il<br />
ne s’agit, pour une large part, que du reclyclage des bonnes vieilles techniques<br />
du fordisme et de l’OST 23 . Ce qui est spécifique à la production<br />
au plus juste c’est « la recherche permanente d’améliorations marginales<br />
en matière de coûts ». C’est un système de « management par le stress ».<br />
Mais la production au plus juste a ses faiblesses. Sa vulnérabilité est<br />
apparue clairement lors de la dizaine de grèves chez General Motors de<br />
1993 à 1998, provoquées par la mise en œuvre de ces procédures. La<br />
grève de mars 1996, qui dura 17 jours, a paralysé la production de 26<br />
des 29 usines de montage nord-américaines de GM et mit 17 500 salariés<br />
au chômage technique. Au cœur de la grève, la sous-traitance. C’était<br />
la réponse de les United Automobile Workers (UAW) à la décision de<br />
General Motors d’acheter à un fournisseur allemand des pièces détachées<br />
d’un modèle nouveau, au lieu d’investir dans cette nouvelle technologie<br />
et de tenir ses promesses concernant le maintien d’un certain nombre<br />
d’emplois. La grève signifiait aussi la volonté du syndicat d’avoir son mot<br />
à dire, lors des négociations collectives, sur les décisions concernant les<br />
investissements 24 . En juin 1998, une grève contre les délocalisations, les<br />
suppressions d’emplois et la flexibilité dura sept semaines. Déclenchée<br />
par les ouvriers de deux usines d’emboutissage et de fabrication de<br />
compteurs de vitesse, elle allait provoquer la paralysie de 19 usines et la<br />
mise au chômage technique de 79 000 ouvriers.<br />
4) L’offensive anti-syndicale<br />
STRATÉGIES DES MULTINATIONALES & RIPOSTES OUVRIÈRES<br />
Un moyen éprouvé de réduire les coûts du travail, d’introduire la flexibilité<br />
et de précariser les travaillleurs, c’est de supprimer la protection<br />
(relative) que leur assure le syndicat. Alors que, dans les années d’aprèsguerre,<br />
les grandes firmes avaient fini par accepter la présence des syndicats<br />
dans l’entreprise, depuis les années Reagan la résistance patronale<br />
à la syndicalisation s’est considéralement renforcée. L’affaiblissement des<br />
syndicats lié au déclin de leurs bastions industriels et le libéralisme<br />
23. Kim Moody, Workers in a Lean World, Verso, New York, 1997, p. 86.<br />
24. John Lippert, « Rough Road Ahead », In These Times, 1 er avril 1996, p. 24-25.
MARIANNE DEBOUZY 99<br />
triomphant ont créé les conditions du déchaînement des forces antisyndicales.<br />
L’agressivité des employeurs s’est accentuée et les firmes spécialisées<br />
dans le union-busting a proliféré. Ces dernières utilisent<br />
l’intimidation et la violence, mais aussi toutes les procédures légales et les<br />
failles du système pour battre en brèche les syndicats, faire obstacle à<br />
leur implantation, entraver leur fonctionnement et remettre en cause<br />
leur légitimité. Nombreux sont les observateurs qui ont décrit le rôle du<br />
National Labor Relations Board dans l’offensive anti-syndicale et les syndicalistes<br />
qui en sont venus à souhaiter sa disparition. Par ailleurs, un<br />
rapport de forces défavorable aux syndicats a permis au concession-bargaining<br />
de remettre en cause les acquis en matière de salaires, d’avantages<br />
sociaux et de garanties de tous ordres. Les multinationales fuient les<br />
zones où les syndicats sont présents et interdisent la syndicalisation là où<br />
elles s’implantent. Leur politique sociale, le long de la frontière mexicaine<br />
par exemple, est claire : on maintient les salaires au minimum et<br />
on s’assure d’un turn-over rapide pour que les ouvrières ne s’organisent<br />
pas. Un système de primes, de récompenses et de pénalités contribue à<br />
diviser les ouvriers et à miner l’action collective.<br />
La situation peut-elle évoluer dans ces usines délocalisées ? Les critiques<br />
du mouvement syndical, et Staughton Lynd en particulier, n’ont<br />
pas manqué de reprocher au business unionism de s’être intéressé exclusivement<br />
aux emplois des travailleurs américains, de les avoir protégés au<br />
détriment des ouvriers d’autres nations. L’activisme international de<br />
l’AFL-CIO (American Federation of Labor-Congress of Industrial<br />
Organisations) à l’époque de la guerre froide, lorsqu’il s’agissait de miner<br />
ou de diviser les syndicats de tendance communiste ou progressiste,<br />
contraste avec son indifférence au sort des travailleurs de la production<br />
internationalisée. Les délocalisations massives de ces dernières décennies<br />
ont cependant fait évoluer les choses.<br />
LE NOUVEL INTERNATIONALISME<br />
Des liens ont été établis entre les travailleurs américains et mexicains. En<br />
reprenant l’analyse de Labor Notes 25 , on peut distinguer trois types<br />
25. Labor Notes, août 1994, .
100<br />
STRATÉGIES DES MULTINATIONALES & RIPOSTES OUVRIÈRES<br />
d’approche de cette solidarité transfrontalière : 1) s’efforcer de syndicaliser<br />
les ouvrières des maquiladoras, dont les effectifs sont aux deux tiers<br />
féminins ; 2) s’appuyer sur les rapports de syndicat à syndicat dans une<br />
entreprise donnée ou sur une stratégie qui vise à syndicaliser tout un<br />
secteur – elle cible alors des firmes ou des industries particulières et<br />
fonctionne grâce à la coopération des syndicalistes américains, canadiens<br />
et mexicains ; 3) s’appuyer sur des comités de soutien des deux<br />
côtés de la frontière, dont certains sont transnationaux, d’autres régionaux<br />
ou locaux. Cette approche s’efforce de soutenir les travailleurs et<br />
les syndicats cherchant à s’organiser au Mexique.<br />
Ces différentes approches ont des points communs : elles mettent l’accent<br />
sur la solidarité mutuelle. Elles impliquent la base et pas seulement<br />
des dirigeants syndicaux. Elles font appel à de nouvelles formes d’organisation,<br />
qui s’appuient sur des alliances avec des associations communautaires,<br />
des militants écologistes et des groupes religieux. Elles essaient<br />
de laisser l’initiative aux travailleurs concernés, de respecter leur autonomie<br />
et non de leur imposer des stratégies pensées par d’autres. Enfin,<br />
elles impliquent une coordination active de leurs actions de chaque côté<br />
de la frontière.<br />
Une illustration parmi d’autres : en 1992, les United Electrical<br />
Workers (UE) et le Frente Auténtico del Trabajo (FAT) ont conclu une<br />
alliance stratégique pour la syndicalisation. En réponse à la délocalisation<br />
de plus de 20 000 postes au Mexique, ils ont mené en commun plusieurs<br />
actions afin d’augmenter les salaires des ouvriers mexicains de<br />
l’usine de moteurs General Electric, à Ciudad Juarez. L’UE a apporté son<br />
aide financière mais laissé les décisions et la stratégie de lutte entre les<br />
mains du FAT et des ouvriers mexicains. On peut citer d’autres exemples<br />
de liens réels entre travailleurs américains et mexicains : la solidarité chez<br />
Ford entre les ouvriers de l’usine de Saint-Paul (Minnesota) et ceux de<br />
Cuautilán ou encore le soutien de l’UAW à la grève des ouvriers de<br />
l’usine Volkswagen à Puebla en octobre 2001.<br />
Parallèlement, des comités de soutien se montent : le Support<br />
Committee for Maquiladoras in San Diego, né de luttes locales, ou<br />
encore The Coalition for Justice in the Maquiladoras (CJM) qui tente<br />
d’aborder des problèmes plus larges, comme la pollution de l’environnement<br />
ou la présence de produits toxiques. La CJM est une cross-border<br />
coalition [coalition transfrontalière] fondée à San Antonio en 1990. Elle<br />
regroupe plus de 60 organisations écologiques, religieuses, communau-
MARIANNE DEBOUZY 101<br />
taires, féministes et syndicales canadiennes, mexicaines et américaines.<br />
L’AFL-CIO, l’UAW, les Teamsters (camionneurs) et d’autres syndicats y<br />
participent. L’activité de la CJM porte surtout sur les problèmes de santé<br />
des ouvrières et de leur communauté. Elle a pour cible, entre autres, les<br />
multinationales de produits chimiques dans la région de Matamoros et<br />
est intervenue dans les assemblées d’actionnaires.<br />
En plus de ce mouvement, il faut évoquer les nouveaux liens qui se<br />
sont établis entre des étudiants et le mouvement syndical 26 . Depuis<br />
1995 s’est développé, en milieu étudiant, un mouvement très actif<br />
contre les multinationales qui font fabriquer dans les pays du tiersmonde<br />
les produits de consommation en vente sur le marché américain<br />
: jouets, vêtements, chaussures, ballons, etc., et tout<br />
particulièrement les vêtements et équipements de sport marqués du<br />
nom et du logo de chaque université. Affiliés ou non à l’organisation<br />
United Against Sweatshops [« unis contre les ateliers de la sueur »], les<br />
étudiants collaborent avec des groupes d’activistes locaux, religieux et<br />
syndicaux, mais aussi des militants d’organisations de défense des droits<br />
de l’homme. Des étudiants, souvent issus de familles syndiquées, font<br />
des stages et participent à diverses activités syndicales. C’est en partie de<br />
cette expérience qu’est né le mouvement étudiant anti-sweatshop. Il a été<br />
aussi financé par le syndicat du textile UNITE. Dans un premier temps,<br />
les pressions exercées sur les multinationales ont conduit un certain<br />
nombre d’entre elles à adopter des « codes de conduite », mais l’organisation<br />
chargée de vérifier leur application était constituée d’hommes<br />
d’affaires et sa légitimité a été rapidement mise en cause. Les étudiants<br />
ont alors cherché à obliger les universités à faire partie du Workers’<br />
Rights Consortium, qui exige des firmes l’engagement de respecter certaines<br />
normes de travail et de se soumettre à des inspections d’experts<br />
indépendants. Le mouvement s’est élargi et a pris pour cibles les firmes<br />
avec lesquelles les universités avaient signé des contrats d’exclusivité,<br />
par exemple, l’université du Virginia Commonwealth avec McDonald’s,<br />
l’université de Madison dans le Wisconsin avec Reebok, de Kent State<br />
26. Je reprends ici des éléments de mon article, « Quelle gauche américaine ? », La<br />
Revue Socialiste, <strong>n°</strong> 5, novembre 2000, p. 68-85. Lire également Jeffrey C. Isaac,<br />
« Thinking about the Anti-Sweatshop Movement » (Dissent, Automne 2001,<br />
p. 100-108) et « Liza Featherstone Responds », p. 109-111 ; de Liza Featherstone<br />
lire aussi Students Against Sweatshops. The Making of a Movement, Verso, Londres, 2002.
102<br />
STRATÉGIES DES MULTINATIONALES & RIPOSTES OUVRIÈRES<br />
avec Coca-Cola, etc. En collaboration avec des groupes d’activistes syndicaux<br />
et autres, les étudiants ont organisé des visites d’experts indépendants<br />
dans les usines situées dans les zones franches du tiers-monde – en<br />
Indonésie et aux Philippines, par exemple. Ils ont mis sur pied des tournées<br />
d’ouvrières afin qu’elles témoignent sur leurs conditions de vie et de<br />
travail, à la fois dans des rassemblements devant les magasins qui vendent<br />
les produits et dans des colloques. Dans certains endroits, les étudiants<br />
ont aussi agi pour que le personnel non qualifié de l’université (par<br />
exemple le personnel de nettoyage des universités Johns Hopkins de<br />
Baltimore et de Wesleyan dans le Connecticut) soit mieux payé et reçoive<br />
« a livable wage », un salaire qui lui permette de vivre.<br />
Toutefois, les tensions entre mouvement étudiant et mouvement syndical<br />
sont réelles : le labor est étroitement lié au parti démocrate et souvent<br />
les étudiants détestent ce dernier. Le labor est favorable au<br />
protectionnisme, et les étudiants y sont opposés. Des désaccords existent<br />
aussi sur les méthodes de travail. Même si le mouvement anti-sweatshop<br />
semble s’être un peu essoufflé, il reste qu’une alliance d’un type nouveau<br />
a été possible qui permettra peut-être un rapprochement plus durable<br />
sur des objectifs précis.<br />
CONCLUSION<br />
Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les multinationales<br />
apparaissaient comme le fer de lance de la nation américaine<br />
et le plus sûr garant de sa prospérité. Tel était bien le sens de la célèbre<br />
formule du PDG de l’industrie automobile devenu ministre de la Défense :<br />
« Ce qui est bon pour General Motors est bon pour l’Amérique. » Qui,<br />
dans la classe ouvrière, prendrait aujourd’hui au sérieux cette affirmation<br />
? Pour avoir subi dégraissages et licenciements massifs, dislocations<br />
et déclassements en tous genres, les ouvriers ont de quoi être sceptiques<br />
quant au souci qu’auraient les multinationales du bien commun. Mais<br />
ont-ils les moyens de les combattre ? Les exemples que nous avons évoqués<br />
suggèrent que des travailleurs américains sont capables de mener<br />
des luttes dures et militantes. Mais elles ne permettent aucun triomphalisme,<br />
car elles n’impliquent qu’un nombre limité d’ouvriers et restent<br />
presque toujours locales. Il est rare qu’une lutte ouvrière rencontre un
MARIANNE DEBOUZY 103<br />
écho dans l’opinion publique et qu’elle devienne une cause nationale ou<br />
un mouvement social politiquement significatif.<br />
Beaucoup de travailleurs touchés par les stratégies des multinationales<br />
semblent résignés et ne protestent pas. Ainsi Jack Metzgar, bon connaisseur<br />
de la région sidérurgique, constate-t-il qu’en Pennsylvanie, dans<br />
une ville sinistrée par la fermeture des usines, « ce qui est le plus remarquable<br />
[…] c’est la soumission presque totale des sidérurgistes et de leur<br />
collectivité à la volonté de Bethlehem Steel. Il n’y a pas eu d’effort organisé<br />
pour arrêter les fermetures, pas d’occupations d’usines, pas de manifestations<br />
de protestation. Depuis 1973, quand a eu lieu l’annonce de la<br />
première fermeture, personne n’a suggéré que Bethlehem Steel n’avait<br />
pas un droit absolu de décider du destin de cette agglomération de<br />
Pennsylvanie occidentale 27 ».<br />
Les cibles des mobilisations sont les politiciens, les bureaucrates et le<br />
gouvernement. À ces réactions se mesure le poids de l’idéologie dominante<br />
: respect de la sacro-sainte liberté d’entreprise et du droit patronal.<br />
Cette idéologie a profondément pénétré le syndicalisme qui, en général,<br />
et dans la sidérurgie en particulier, a recherché la conciliation, le « partenariat<br />
» avec le business. Le fait que si peu de gens tentent d’« influencer<br />
les décisions politiques » exprime certainement un sentiment<br />
d’impuissance, une méfiance à l’égard des politiciens, mais en dit surtout<br />
long sur la marginalisation de la politique et sa diabolisation, soigneusement<br />
entretenue par dirigeants et médias. L’absence de relais politique et<br />
d’un parti qui parle pour la classe ouvrière dans l’arène politique rendent<br />
de toute façon très difficile le combat ouvrier. D’autant qu’il se déroule<br />
dans un climat hostile à l’action collective et aux syndicats, dans une<br />
société « colonisée par les grandes firmes » – pour reprendre l’expression<br />
de Carl Boggs 28 –, qui rend l’individu responsable de sa pauvreté considérée<br />
comme, au mieux, un signe de faiblesse et, au pire, une marque<br />
d’infamie. À quoi s’ajoute le contexte de la mondialisation dominée par<br />
un ultralibéralisme vanté sur tous les tons aux États-Unis.<br />
Tout cela met en perspective les luttes dont ce pays est le théâtre, qui<br />
restent locales, fragmentaires et ne débouchent pas sur des débats<br />
27. Jack Metzgar, « Plant Shutdowns and Worker Response : The Case of<br />
Johnstown, Pa », art. cit.<br />
28. Carl Boggs, The End of Politics. Corporate Power and the Decline of the Public Sphere,<br />
New York, Guilford Press, p. VIII.
104<br />
STRATÉGIES DES MULTINATIONALES & RIPOSTES OUVRIÈRES<br />
politiques de fond dans l’espace public. Un syndicaliste, impliqué dans<br />
une grève suivie de la fermeture de son usine, disait dans une interview<br />
: « Nous avons appris […] que nous avions besoin de quelque<br />
chose de plus que d’une alliance syndicats-communauté-église. […]<br />
Nous avons besoin d’une action radicale pour traiter le problème. 29 »<br />
Mais, depuis de longues années, le « radicalisme » n’est plus de saison<br />
dans la société américaine ni dans le monde ouvrier. À travers de nombreux<br />
témoignages, on peut voir à quel point le red-baiting (la persécution<br />
des rouges) continue à faire des ravages et combien la politique,<br />
même quand elle n’est pas « radicale », est mal vue.<br />
La présence de syndicalistes aux côtés des manifestants « antimondialisation<br />
» lors de la réunion de l’OMC en novembre 1999 a fait<br />
naître bien des espoirs, suivis aujourd’hui d’un certain désenchantement.<br />
Mais la volonté d’un certain nombre de syndicalistes, qui militent pour<br />
le renouveau d’un « syndicalisme qui soit un mouvement social », la<br />
prise de conscience d’une nécessaire solidarité avec les travailleurs du<br />
tiers-monde, les formes d’un nouvel internationalisme que nous avons<br />
évoquées, les liens avec le mouvement étudiant et les coalitions avec<br />
divers groupes d’activistes, ainsi que la participation de nombreux<br />
citoyens aux manifestations « altermondialistes » sont le signe qu’il existe<br />
des forces contestataires toujours vivantes aux États-Unis. Seront-elles<br />
capables non seulement de rallier les énergies anticapitalistes mais aussi<br />
de construire une stratégie politique globale qui, jusqu’à présent, fait<br />
défaut aux travailleurs américains, et pas seulement à eux ?<br />
MARIANNE DEBOUZY<br />
Ce texte est issu d’une communication au colloque tenu à l’université Stendhal de<br />
Grenoble les 11 et 12 janvier 2002 sur le thème « Réflexions sur l’impact des entreprises<br />
multinationales américaines sur la société ».<br />
Professeure émérite d’histoire américaine à l’université Paris-VIII, Marianne<br />
Debouzy a publié, notamment, Le Capitalisme sauvage (Seuil, 1972), et Travail<br />
et travailleurs aux États-Unis (La Découverte, (1984) 1990) ; elle contribue<br />
régulièrement à de nombreuses revues de sciences sociales, de la Revue française<br />
de sociologie à Acoma.<br />
29. Alice et Staughton Lynd (dir.), The New Rank and File, op. cit., p. 1<strong>32</strong>.
SHELDON RAMPTON & JOHN STAUBER 105<br />
Le contrôle de la société civile<br />
Seul le peuple a la compétence pour juger de son propre bien-être.<br />
JOSIAH QUINCY<br />
révolutionnaire américain, 1774<br />
LE 24 FÉVRIER 1995, dans son discours sur l’état de l’Union, Bill<br />
Clinton évoqua la séparation totale entre les citoyens américains<br />
et leur gouvernement : « Il existe aujourd’hui trois fois plus de<br />
lobbyistes dans les rues et les couloirs de Washington que vingt ans<br />
auparavant. Lorsque le peuple américain pense à sa capitale, il visualise<br />
une ville où ceux qui ont des relations et sont bien protégés par leurs privilèges<br />
peuvent faire fonctionner le système, mais où les intérêts des<br />
citoyens ordinaires sont souvent négligés. » Aujourd’hui, même les plus<br />
bruyants avocats du grand patronat admettent l’évidence : « On se rend<br />
compte de plus en plus que le système favorise les individus riches,<br />
célèbres et solidement implantés. […] Vingt-sept sénateurs américains<br />
sont millionnaires : un seul de nos concitoyens croit-il encore qu’il s’agit<br />
d’une coïncidence ? 1 »<br />
Les chefs d’entreprises dominent l’État car ils sont capables de financer<br />
les campagnes électorales, d’acheter les services de lobbyistes très onéreux<br />
et d’offrir des emplois lucratifs à d’ex-hauts fonctionnaires. Pendant<br />
1. Ray Hoewing, membre du Conseil des affaires publiques (Public Affairs Council)<br />
du président Clinton.<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 105-122
106<br />
LE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE<br />
ce temps, la majorité des travailleurs américains ont l’impression que leur<br />
pouvoir économique et politique diminue, voire disparaît. On doit désormais<br />
travailler davantage et dans des conditions plus difficiles pour payer<br />
ses factures et gagner sa vie. Les hommes et les femmes disposent de<br />
moins de temps libre pour s’impliquer dans la vie de leur communauté<br />
et participer à des actions citoyennes. De nombreuses institutions<br />
sociales qui ont nourri et fortifié la démocratie de base – quartiers stables,<br />
syndicats vivants, petites exploitations et petits commerces indépendants<br />
– sont en train de disparaître. Moins de la moitié des Américains ayant<br />
l’âge de voter se préoccupent de se rendre aux urnes, et ceux qui le font<br />
ne croient guère que leur geste aura un résultat positif : ils confient aux<br />
instituts de sondage qu’ils votent souvent pour « le moindre mal ». Les<br />
deux grands partis, démocrate et républicain, dépendent totalement de<br />
l’argent des grandes entreprises pour payer une nouvelle classe de<br />
consultants, de professionnels du marketing et de spécialistes des<br />
sciences humaines. Cette élite gère et promeut les programmes et les candidats<br />
à peu près de la même façon que les agences de publicité vendent<br />
des voitures, des médicaments, des vêtements, etc.<br />
Le rôle prépondérant des relations publiques dans le processus politique<br />
a paradoxalement créé un énorme problème d’image pour les<br />
politiciens qui font confiance aux agences-conseil et à leurs analyses. En<br />
fait, la population estime si peu les hommes politiques que ceux-ci<br />
construisent souvent leurs campagnes électorales autour du fait qu’ils ne<br />
seraient absolument pas des « professionnels de la politique ». Les consultants<br />
expliquent à leurs candidats que la meilleure façon d’intégrer l’élite<br />
de Washington aujourd’hui c’est d’affirmer à leurs électeurs qu’ils<br />
détestent… Washington.<br />
La dégradation du milieu politique a créé un vaste éventail de possibilités<br />
pour l’industrie des relations publiques. Au fur et à mesure que les<br />
citoyens s’éloignent avec dégoût du processus politique, les agencesconseil<br />
prennent leur place et inversent le sens de la « politique<br />
citoyenne ». En effet, ils utilisent des données sophistiquées, en évolution<br />
constante, et des systèmes de communications ultrarapides pour<br />
créer, ex nihilo, en fonction des besoins de leurs clients, des « associations<br />
de base » qui servent les intérêts des élites. Lloyd Bentsen, qui a luimême<br />
travaillé pendant longtemps à Washington et à la Bourse de Wall<br />
Street, a inventé le terme de « lobbying synthétique » pour désigner les<br />
associations écran qui peuvent désormais être créées sur mesure par des
SHELDON RAMPTON & JOHN STAUBER 107<br />
agences comme Hill & Knowlton, Direct Impact, Optima Direct,<br />
National Grassroots & Communications, Beckel Gowan, Burson-<br />
Marsteller, Davies Communications ou Bonner & Associates. Le magazine<br />
Campaigns & Elections définit « la démocratie synthétique » comme<br />
un « système où l’on crée artificiellement un courant d’opinion favorable<br />
à un point de vue donné. L’objectif étant soit d’imposer ce point de vue<br />
à des militants non informés, soit de diffuser des techniques de manipulation<br />
servant à les recruter ».<br />
La « démocratie synthétique » constitue une des tentatives les plus<br />
pernicieuses engagées par les grandes entreprises pour instrumentaliser<br />
les mouvements de base. Même les relationnistes utilisent ce terme de<br />
« synthétique » pour dénigrer leurs concurrents et promettre que leurs<br />
propres projets de création d’associations de base sont plus professionnels<br />
et légitimes. « Pour d’authentiques associations – et non des comités<br />
synthétiques », proclamait en décembre 1995 une publicité d’une<br />
page entière au dos du magazine Campaigns & Elections vantant les<br />
services de l’agence National Grassroots & Communications. Mais<br />
l’« authenticité » pour les consultants n’a pas le même sens que pour le<br />
commun des mortels : ce qui compte à leurs yeux, c’est que les campagnes<br />
de promotion spectaculaires qu’ils orchestrent soient si parfaites<br />
que ses associations paraissent authentiques.<br />
PLUS RIEN NE LEUR ÉCHAPPE<br />
Les campagnes des associations sponsorisées par les entreprises commencent<br />
par des sondages d’opinion, un des outils de base de l’industrie<br />
des relations publiques. La science des sondages fiables a d’abord été<br />
développée à la suite de la crise de 1929 pour des entreprises qui s’inquiétaient<br />
des implications de la victoire écrasante de Franklin<br />
D. Roosevelt. Cette victoire reflétait le désenchantement du peuple américain<br />
vis-à-vis du capitalisme. À partir de 1937, la Psychological<br />
Corporation, société fondée par vingt des « principaux psychologues »<br />
américains, commença à interroger de façon systématique et continue la<br />
population à propos de questions politiquement importantes pour les<br />
chefs d’entreprise. On utilisa d’abord les sondages pour mesurer le pouls<br />
de « l’opinion en général », mais un affinement progressif permit aux
108<br />
LE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE<br />
sondeurs de cerner les attitudes et les pensées de secteurs de plus en plus<br />
limités et précis de la population.<br />
Dans les années 1950, note la Canadienne Joyce Nelson, les chefs<br />
d’entreprise adaptèrent les techniques de la théorie des jeux, utilisée par<br />
l’armée pour mettre au point des simulations complexes de bataille, intégrant<br />
des facteurs comme la densité de la population, les conditions<br />
environnementales et les déploiements des armes pour créer des projections<br />
détaillées des issues probables d’une bataille. Grâce à ces modèles,<br />
les entreprises furent capables d’entrer leurs propres listes de variables<br />
(facteurs démographiques, conditions économiques, résultats des élections)<br />
pour créer des scénarios de marketing 2 .<br />
Alors que les sondages d’opinion fournissaient une carte chaque fois<br />
plus détaillée des mentalités collectives, les banques de données informatiques<br />
se perfectionnaient et devenaient capables de reconstituer les pensées<br />
et les préférences des individus. La pub qui arrive dans les boîte aux<br />
lettres chaque jour résulte de ce qu’on appelle le « marketing direct », qui<br />
permet aux entreprises de cibler leurs clients en choisissant le discours<br />
adéquat. Elles peuvent ainsi détecter les individus dont le passé montre<br />
qu’ils sont les plus susceptibles de réagir positivement. Des listings informatiques<br />
classent les personnes selon leurs caractéristiques : appartenance<br />
à une organisation (politique, religieuse, syndicale, etc.) ; revenus ;<br />
changement d’adresse récent ; abonnements souscrits ; hobbys ; attitudes<br />
face à la criminalité ; origines ethniques ; habitudes de consommation ;<br />
religion ; etc. En fusionnant et croisant les données, les entreprises peuvent<br />
produire des listes hybrides, comme par exemple celle des mâles<br />
blancs partisans du parti démocrate possesseurs d’une arme et qui ont<br />
récemment déménagé ; ou bien celles des féministes aisées abonnées à la<br />
National Review. En combinant ces renseignements avec les cartes psychographiques<br />
produites par les sondages d’opinion, les grandes entreprises<br />
peuvent tracer un portrait remarquablement détaillé de chacun de nous,<br />
qui permet de livrer des pronostics minutieux sur votre attitude par rapport<br />
au contrôle sur les ventes d’armes, la fiscalité, l’énergie nucléaire, ou<br />
n’importe quel autre problème social. Selon le consultant Robert<br />
L. Dilenschneider, Reese Communications (filiale de Hill & Knowlton)<br />
employa cette technique il y a quelques années pour aider la compagnie<br />
2. Joyce Nelson, Sultans of Sleaze, Common Courage Press, Monroe (Maine),<br />
1989, p. 74-75.
SHELDON RAMPTON & JOHN STAUBER 109<br />
de téléphone AT&T à trouver « 1 200 000 personnes qui écrivirent à leur<br />
sénateur pour augmenter leurs factures de téléphone. Ils avaient réussi à<br />
les contacter et à les convaincre en corrélant des caractéristiques, des<br />
valeurs et des données géographiques différentes afin de mener une<br />
campagne d’action directe ciblée 3 ».<br />
« Il ne s’agit pas d’une science miracle, précise Mike Malik, vice-président<br />
d’Optima Direct. En fait, Direct Marketing 101 offre des communications<br />
ciblées sur des thèmes et des mobilisations citoyennes » aux<br />
grandes entreprises qui sont ses clients. « Nous envoyons des prospectus<br />
et faisons de la prospection téléphonique systématique. Tout le<br />
monde déteste ces procédés mais cela marche […]. Nos deux principaux<br />
clients sont Philip Morris et la National Rifle Association 4 . […] Toutes<br />
deux peuvent vous apprendre beaucoup de choses – elles sont très efficaces<br />
sur le terrain. 5 » Malik a passé plus de sept ans chez Philipp Morris<br />
pour développer un lobby d’associations de fumeurs. Pour lui, il s’agit de<br />
« l’un des meilleurs programmes de terrain en Amérique aujourd’hui ».<br />
En décembre 1994, il expliqua son fonctionnement au cours d’un séminaire<br />
réservé à de grands patrons sur le thème « Comment façonner<br />
l’opinion publique : si vous ne le faites pas, un autre le fera ».<br />
Lorsqu’une question est soumise à un vote, Malik se tourne vers ses<br />
centres d’appel : « Les appels téléphoniques sont un moyen d’action<br />
rapide et extrêmement flexible. Lorsque vous envoyez un courrier, vous<br />
obtenez un résultat environ trois semaines plus tard et ensuite vous ajustez<br />
le tir. Avec le téléphone, vous lancez une idée le matin, vous analysez<br />
les résultats le soir, et le lendemain vous changez votre fusil d’épaule et<br />
essayez une nouvelle idée le lendemain. En l’espace de trois jours, vous<br />
pouvez modifier votre projet quatre ou cinq fois, découvrir ce qui<br />
marche vraiment, quels sont les messages qui motivent réellement le<br />
public, et améliorer considérablement vos taux de réponses. 5 »<br />
3. Robert L. Dilenschneider, Power and Influence : Mastering the Art of Persuasion,<br />
Prentice Hall Press, New York, 1990, p. 111.<br />
4. La National Rifle Association est puissant lobby rassemblant les fabricants, les<br />
vendeurs et les fans d’armes à feu. Le documentaire de Michael Moore, Bowling for<br />
Colombine, prend notamment cette association (dont le président est l’acteur<br />
Charlton Heston) pour cible. [ndt]<br />
5. Conférence de Mike Malik au colloque « Shaping Public Opinion : If You Don’t<br />
Do It, Somebody Else Will », à Chicago, le 9 décembre 1994.
110<br />
On peut aussi utiliser efficacement l’arme du téléphone pour inonder<br />
un parlementaire d’appels provenant de ses administrés. Cette technique<br />
s’appelle le « transfert discret » : un centre d’appels travaillant pour un<br />
lobbyiste réalise un contact téléphonique direct entre l’un de ses partisans<br />
et le responsable politique auquel elle veut faire passer un message<br />
personnalisé. Optima Direct possède des dispositifs techniques spécialement<br />
conçus à cet effet. Malik nous en explique le fonctionnement : « Je<br />
vous appelle pour solliciter votre aide : “Bonjour, êtes-vous prêt à me<br />
donner un coup de main sur telle question ?” Nous avons une brève<br />
conversation à l’issue de laquelle vous me dites : “D’accord, je vais parler<br />
à mon député. — Parfait, je vais vous mettre en contact directement<br />
avec lui.” Pour cela, il vous faut une installation spéciale. Vous appuyez<br />
sur un bouton et hop ! vous mettez en contact directement votre premier<br />
interlocuteur et la personne à laquelle vous souhaitez qu’il parle. C’est ce<br />
qu’on appelle les réaiguillages avancés. […] Mais certains offrent de très<br />
mauvais services de transfert, nous avertit Malik [dont le baratin ressemble<br />
furieusement à celui d’un vendeur de voitures]. Optima Direct<br />
effectue un excellent travail : les transferts sont tellement sophistiqués<br />
qu’ils ressemblent à des manifestations spontanées de mécontentement<br />
populaire. Mais attention, il faut espacer les appels durant la journée<br />
pour qu’ils aient l’air vraisemblable. Si vous contactez un lobbyiste,<br />
demandez-lui comment fonctionne son système d’appels et combien de<br />
temps s’écoule entre chacun d’eux. […] Il faut que les appels paraissent<br />
aussi authentiques que possible. 5 »<br />
LE CENTRALISME DÉMOCRATIQUE<br />
LE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE<br />
Les grandes entreprises conçoivent des stratégies pour conquérir « la<br />
base », mobiliser les masses dans des campagnes politiques tout en<br />
contrôlant efficacement les véritables débats politiques, qui sont tranchés<br />
par une élite. Intervenant dans un congrès du Conseil sur les affaires<br />
publiques, Michael Dunn, dont l’agence-conseil est basée à Washington,<br />
a défendu la position suivante : « Un programme destiné aux citoyens de<br />
base ne vise pas à les inciter à s’impliquer davantage dans le système<br />
politique, a-t-il expliqué. Il n’a qu’un seul objectif : influencer la politique<br />
du parlement local. […] Bien sûr, que vous le vouliez ou non, vous
SHELDON RAMPTON & JOHN STAUBER 111<br />
allez être impliqués dans ce processus politique. Mais une seule question<br />
compte : allez-vous gagner ou perdre ? Et si vous n’avez conçu pas un<br />
projet destiné aux électeurs de base, vos chances de gagner sont sacrément<br />
diminuées. 6 »<br />
Selon Dunn, les entreprises doivent systématiquement développer une<br />
propagande politique vis-à-vis de leurs salariés, de leurs retraités, de<br />
leurs vendeurs et de leurs clients. L’objectif de cet endoctrinement est de<br />
sensibiliser la majorité des employés : « L’État exerce une influence sur<br />
leur vie, leur travail, et il faut leur faire comprendre qu’ils doivent jouer<br />
un rôle dans ce processus. 6 » Pour compléter cette « formation » de la<br />
« base », Dunn a proposé aux grandes entreprises de mettre en place un<br />
« programme de contacts clés » afin de recruter, dans chaque service<br />
important, des employés « en vue de développer une relation personnelle<br />
de qualité avec l’élu dont ils sont chargés. Pour parvenir à ce but,<br />
le contact clé doit adhérer à l’organisation politique de son élu local,<br />
réussir à faire partie de son personnel de campagne, intégrer le cercle restreint<br />
auquel il appartient ». Dunn prône une stratégie interne « d’influence<br />
par le haut ». En clair, les grandes entreprises conseillent à leurs<br />
employés, s’ils veulent garder leur boulot et grimper dans la hiérarchie,<br />
de devenir des cadres politiques pour leur boîte, de nouer des relations<br />
amicales avec les élus, de devenir les yeux et les oreilles de leur chef d’entreprise<br />
en ce qui concerne la politique locale. Dunn a même suggéré<br />
que le personnel chargé du recrutement mentionne « les responsabilités<br />
des contacts clés lorsqu’il décrit les attributions des postes à pourvoir » 6 .<br />
Dunn n’a bien sûr pas évoqué ce qui arrive aux salariés qui échouent<br />
à appliquer ce « programme ». Mais une telle disposition touche au statut<br />
des libertés politiques et à l’intégrité des institutions démocratiques.<br />
La « mobilisation des citoyens de base » prônée par Dunn aboutit en fait<br />
à mettre en place un système de commandement extrêmement hiérarchisé.<br />
Les salariés ne sont plus des citoyens qui choisissent et défendent<br />
ce qu’ils considèrent juste ou désirable sur le plan politique mais des<br />
individus qui votent pour les personnes sélectionnées par leur<br />
employeur et défendent des idées correspondant aux intérêts politiques<br />
de leur patron. Pour Dunn, « les agents de terrain » sont en fait les petits<br />
soldats de l’entreprise : leur loyauté joue un rôle essentiel si la firme veut<br />
6. Conférence de Michael Dunn, « Charting a Course for Grassroots Success »,<br />
Conseil sur les affaires publiques, Sarasota (Floride), 7 février 1994.
112<br />
remporter la victoire dans l’environnement concurrentiel actuel. « Il<br />
s’agit d’une bataille, mes amis. Un général allemand a un jour déclaré<br />
que la politique ressemblait à une guerre sans armes. Et si vous pensez<br />
que vous n’êtes pas en guerre en ce moment, c’est que vous n’êtes pas<br />
encore descendus dans les tranchées. Il s’agit bien d’une guerre, a-t-il<br />
proclamé. En dernière instance, chaque entreprise de ce pays doit engager<br />
un programme dirigé vers les masses. Tant que nous n’aurons pas<br />
réussi à nous faire comprendre de la totalité de nos concitoyens, nous<br />
perdrons nos combats sur le marché politique. 6 »<br />
TOUCHE PAS À MON ARRIÈRE-COUR<br />
LE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE<br />
L’organisation des citoyens de base constitue une arme de choix des<br />
industriels contre les mouvements NIMBY [Not In My Back-Yard, littéralement<br />
: « Touche pas à mon arrière-cour », ndt], ces groupes locaux qui<br />
essayent d’empêcher que leur commune accueille des envahisseurs<br />
indésirables du genre décharge de déchets toxiques. Les NIMBYs sont<br />
les « globules blancs » du corps politique démocratique – petits, rapidement<br />
mobilisables et efficaces pour repousser et éliminer les intrusions<br />
extérieures. S’ils attaquent parfois des inconnus inoffensifs, voire<br />
bénéfiques, ils représentent tout de même une expression authentique<br />
de la démocratie, reflétant le droit des citoyens à façonner leur propre<br />
environnement et leur destinée.<br />
John Davies aide à neutraliser ces groupes au nom des grandes entreprises<br />
qu’il a pour clients (Mobil Oil, les hôtels Hyatt, Exxon, American<br />
Express et Pacific Gas & Electric). Il se présente comme « l’un des<br />
consultants les plus qualifiés en matière de travail de terrain » et diffuse<br />
une publicité tapageuse destinée à effrayer même les PDG les plus courageux.<br />
Elle montre une photo de l’« ennemi » – incarné par une « petite<br />
vieille aux cheveux blancs » qui tient entre ses mains une pancarte écrite<br />
à la main : « Pas de ça chez moi ! » En surimpression, on peut lire : « Ne<br />
la laissez pas décider de votre avenir. Les méthodes traditionnelles de<br />
lobbying ne suffisent plus. […] Pour vaincre vos opposants, appelez<br />
Davies Communications. 7 »<br />
7. Publicité dans Campaigns & Elections, décembre-janvier 1995, p. 4.
SHELDON RAMPTON & JOHN STAUBER 113<br />
Le matériel promotionnel de Davies proclame que cette société « peut<br />
concevoir un projet soigneusement planifié et le faire passer pour une<br />
explosion spontanée de soutien populaire. Davies a transformé la communication<br />
de terrain en un art véritable ». S’adressant à un congrès de<br />
consultants en décembre 1994, Davies a déclaré : « [Nos clients] viennent<br />
généralement nous voir quand ils ont vraiment besoin d’un ami.<br />
Une municipalité va vous obliger à fermer votre entreprise et à ce<br />
moment-là vous appelez une agence-conseil et vous vous dites : “Oh,<br />
merde !” Mark Twain l’a parfaitement exprimé : “Lorsque vous avez<br />
besoin d’un ami, il est trop tard pour faire sa connaissance.” 8 »<br />
Davies fabrique à la demande des amis pour ses clients, les grandes<br />
entreprises. Il utilise ses listes de publipostage et ses bases de données<br />
informatiques pour identifier les partisans éventuels. Ses télévendeurs<br />
savent comment transformer des partisans passifs d’une cause en de<br />
vibrants plaideurs qui paraissent suffisamment motivés pour écrire personnellement<br />
à un homme politique, un journal ou un conseiller municipal.<br />
« Nous voulons les aider à écrire des lettres efficaces. Nous leur<br />
téléphonons et leur demandons : “Êtes-vous prêts à écrire une lettre ?<br />
— Oui, bien sûr. — Avez-vous le temps de le faire ? — Pas vraiment.<br />
— Peut-être pourrions-nous l’écrire ensemble ? Si vous me le permettez,<br />
je vais vous passer l’un de nos collaborateurs. Patientez une seconde et<br />
vous serez mis en contact avec lui.” Nous transférons ensuite l’appel à un<br />
autre salarié de Davies qui rédige une lettre apparemment personnelle<br />
destinée à l’élu ciblé. Si possible, nous faisons porter cette lettre. Nous<br />
écrivons à la main sur un papier plutôt démodé s’il s’agit d’une vieille<br />
dame. Et nous utilisons le papier à en-tête d’une société s’il s’agit d’une<br />
entreprise. Nous utilisons différents types de timbres et d’enveloppes.<br />
[…] L’objectif est de créer une bonne pile de lettres personnalisées aussi<br />
différentes que possible entre elles. 8 »<br />
Pamela Whitney, PDG de National Grassroots & Communication, se<br />
spécialise également dans la lutte contre les associations locales. « Ma<br />
société travaille surtout pour les grandes entreprises et nous nous intéressons<br />
au lancement de nouveaux produits sur le marché. […] Wal-<br />
Mart est l’un de nos clients. Nous nous attaquons aux NIMBYs et aux<br />
écologistes. » National Grassroots assiste aussi « les sociétés qui veulent<br />
8. Conférence de John Davies au colloque « Shaping Public Opinion : If You Don’t<br />
Do It, Somebody Else Will », Chicago, 9 décembre 1994.
114<br />
améliorer leur communication avec leurs employés pour éviter l’implantation<br />
d’un syndicat. Ils ne savent pas exactement comment s’y prendre,<br />
alors nous intervenons et les aidons à établir une marche à suivre 9 ».<br />
L’activité principale de National Grassroots consiste « à soutenir (ou à<br />
combattre) des projets de loi au niveau des États ou à l’échelle nationale<br />
». Cette société crée ses propres associations locales en puisant dans<br />
un réseau d’organisateurs professionnels de base. « Nous croyons beaucoup<br />
en l’efficacité de nos “ambassadeurs”. Nous préférons éviter d’utiliser<br />
les services d’une agence-conseil présente sur place. […]<br />
Généralement, ces gars-là ne sont pas vraiment intégrés localement.<br />
Nous embauchons des ambassadeurs sur le terrain, qui connaissent à<br />
fond la communauté où ils vivent, pour qu’ils deviennent nos avocats.<br />
Ils travaillent avec nous et nous envoient des rapports circonstanciés.<br />
Certes cela nous coûte de l’argent, mais il s’agit de sommes ridicules. 9 »<br />
Qui sont ces organisateurs dont on peut louer les services à petit prix ?<br />
« Nous avons découvert que nos meilleurs ambassadeurs sur le terrain<br />
sont les femmes qui ont animé des associations de parents d’élèves – elles<br />
sont très actives sur le plan local – ou des retraitées qui disposent de<br />
beaucoup de temps. Ce sont pour nous les meilleurs militants. » Pour<br />
superviser ces « grands-mères de base », Pamela Whitney embauche des<br />
professionnels « ayant l’expérience du travail d’organisation sur le terrain<br />
» durant les campagnes électorales, des cadres qui peuvent « débouler<br />
dans un coin perdu et, en deux semaines, créer une organisation qui,<br />
ensuite, fonctionnera sans eux » 9 .<br />
CE N’EST PAS À NOTRE PROGRAMME<br />
LE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE<br />
La prolifération d’associations bidon a incité le magazine Consumer<br />
Reports à publier, en mai 1994, un article intitulé « Ceux qui prétendent<br />
défendre l’intérêt général », qui avertit : « L’appellation altruiste de ces<br />
organisations est souvent trompeuse. Autrefois, on pouvait connaître<br />
l’objectif et la nature d’un groupe en se fiant simplement à son nom.<br />
Aujourd’hui, les comités, coalitions, alliances et autres ligues dont le titre<br />
9. Conférence de Pamela Whitney au colloque « Shaping Public Opinion : If You<br />
Don’t Do It, Somebody Else Will », Chicago, 9 décembre 1994.
SHELDON RAMPTON & JOHN STAUBER 115<br />
comporte des mots comme “citoyens” ou “consommateurs” peuvent être<br />
aussi bien des couvertures pour les grandes entreprises et les organisations<br />
patronales que de véritables associations de citoyens ou des<br />
consommateurs. Ces gens qui prétendent défendre l’intérêt de la population<br />
utilisent des moyens si variés – publicité, communiqués de presse,<br />
témoignages publics, sondages douteux, enquêtes bidon, et désinformation<br />
– qu’il est difficile de repérer qui est qui, quel est le véritable but de<br />
tel ou tel groupe. 10 »<br />
Consumer Reports cite l’exemple du Comité pour la santé et la sécurité<br />
sur le lieu de travail [Workplace Health and Safety Council]. En fait, « ce<br />
lobby composé de chefs d’entreprises s’est opposé à plusieurs projets de<br />
loi visant à renforcer les mesures de sécurité pour les ouvriers. De même,<br />
si l’on se fie uniquement au logo de la Coalition nationale des terres<br />
humides [National Wetlands Coalition], logo qui représente un canard<br />
survolant un marais, on ne peut deviner que cette organisation regroupe<br />
des foreurs de pétrole, des promoteurs immobiliers et des compagnies<br />
spécialisées dans la production de gaz naturel. […] La création d’associations<br />
fantômes est devenue un métier à lui tout seul. […] Les relationnistes<br />
ont découvert d’innombrables moyens de faire croire à<br />
l’engagement des citoyens pour une cause 10 ».<br />
Les industries automobile et pétrolière sont aussi très actives sur le terrain<br />
des associations de base. Consumer Reports note que l’Institut américain<br />
du pétrole [American Petroleum Institute] a eu recours à l’agence<br />
Beckel Cowan en 1989 pour créer l’Association des Américains hostiles<br />
aux taxes injustes sur l’essence [Americans against Unfair Gas Tax],<br />
« organisation nationale qui compte quinze mille membres » et qui a<br />
contribué à empêcher une hausse des taxes fédérales sur l’essence. Au<br />
Nevada, l’industrie automobile a créé un groupe bidon, l’Association<br />
pour des critères équitables en matière d’économie d’essence [Nevadans<br />
for Fair Fuel Economy Standards] pour « impressionner le sénateur du<br />
Nevada, Richard Bryan ».<br />
Les compagnies d’assurance se mobilisent elles aussi – selon Barbara Bey,<br />
la directrice des affaires publiques du Comité américain pour l’assurance-vie<br />
[American Council of Life Insurance] à Washington, association<br />
professionnelle regroupant plus de six cents entreprises. Elle a<br />
expliqué dans Impact, bulletin mensuel de cette association, comment<br />
10. « Public Interest Pretenders », Consumer Reports, mai 1994.
116<br />
LE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE<br />
son comité se prépare à agir : « La technologie nous permet de le faire<br />
en alliant qualité et efficacité. Nous sommes en train de construire une<br />
base de données interactive pour le travail de terrain afin d’expliquer nos<br />
préoccupations à nos membres, aux élus et aux autres citoyens concernés<br />
avant que ces préoccupations ne deviennent des problèmes. Nous<br />
développons également un programme de contacts clés pour étendre nos<br />
activités de terrain et les conduire jusqu’à “l’étape suivante”. 11 »<br />
Rien ne remplace les campagnes de terrain – selon Eric Rennie, directeur<br />
de la communication concernant les politiques publiques pour le<br />
groupe d’assureurs ITT-Hartford. Il a déclaré dans Impact : « Dans une<br />
organisation hiérarchisée comme la nôtre, lorsque le directeur local veut<br />
que les employés prennent le temps d’écrire à leurs élus, ils le font souvent<br />
sur le temps de travail. Nous leur fournissons le papier, les stylos,<br />
les timbres et les enveloppes. Nous photocopions ces courriers pour étudier<br />
ensuite leurs répercussions. Parce que nous n’aimons guère faire<br />
cela avec nos clients, nous ne savons pas quelle proportion d’entre eux<br />
répondent ni selon quel schéma. » Et c’est là où la mobilisation à la base<br />
intervient. « Aujourd’hui, continue Rennie, les campagnes de terrain<br />
menées par les grandes entreprises exigent que nous frappions à de plus<br />
en plus de portes, celles de nos clients, distributeurs et fournisseurs,<br />
celles des industries connexes et de tous les autres membres de la<br />
“famille élargie”. 12 »<br />
Robert C. Kirkwood, directeur du secteur des affaires publiques chez<br />
Hewlett-Packard, est un fervent partisan du travail à la base. « Nous<br />
avons eu une révélation […] dans notre campagne pour l’ALENA, a-t-il<br />
déclaré dans Impact. Pour la première fois, nous avons lancé un vaste<br />
programme de terrain mobilisant des centaines de salariés dans tout le<br />
pays. À mon avis, ce type de technique va faire partie de notre arsenal<br />
régulier. […] Le mouvement écologiste sera inquiet, les syndicats seront<br />
perturbés. Toutes les sociétés ne sont pas encore équipées, mais elles s’y<br />
mettront bientôt. 13 »<br />
11. David B. Kinsman, « What’s Ahead for Public Affairs Officers in 94’», Impact,<br />
décembre 1993, p. 2.<br />
12. Eric A. Rennie, « Grassroots : Mobilizing Your ‘Extended Family’ : the Pros and<br />
Cons », Impact, avril 1994.<br />
13. David B. Kinsman, « What’s Ahead for Public Affairs Officers in 94’», Impact,<br />
décembre 1993, p. 3.
SHELDON RAMPTON & JOHN STAUBER 117<br />
LE SABOTAGE DE LA RÉFORME DE LA SANTÉ<br />
Pendant la campagne présidentielle qui commença en 1992, les sondages<br />
d’opinion montraient que les électeurs étaient particulièrement<br />
préoccupés par la hausse vertigineuse des coûts de la santé. Le candidat<br />
Bill Clinton évoquait fréquemment son intérêt pour une « concurrence<br />
contrôlée » en ce domaine. En fait, remarque James Fallows, dans le<br />
numéro de janvier 1995 de The Atlantic, la demande pour une réforme<br />
était si forte que, « durant presque toute l’année 1993, les républicains<br />
la croyaient inévitable et voulaient être du côté des gagnants. Le sénateur<br />
républicain Bob Dole affirma qu’il voulait travailler avec l’administration<br />
démocrate et apparut lors de plusieurs événements aux côtés de Hillary<br />
Clinton pour soutenir le principe de la couverture universelle. Vingttrois<br />
élus républicains déclarèrent que la couverture universelle ferait<br />
partie de la nouvelle loi 14 ».<br />
On a fréquemment souligné les imperfections du plan de Clinton.<br />
Cependant, dans un système démocratique, les propositions initiales<br />
sont souvent imparfaites et peut-être est-ce inévitable. Un processus<br />
démocratique sain rassemble des individus à partir de différentes perspectives<br />
pour débattre et réviser des projets jusqu’à ce qu’un consensus<br />
émerge. Dans le cas du projet de Clinton, le recours à des associations<br />
fantoches (la tactique de la « démocratie synthétique ») – financées surtout<br />
par les compagnes d’assurances et les sociétés pharmaceutiques –<br />
réussit toutefois à étouffer totalement le débat, en éliminant non seulement<br />
le plan de Clinton mais tous les autres projets de réforme du système<br />
de santé américain. La pièce maîtresse de la politique intérieure de<br />
l’administration Clinton tomba dans les poubelles de l’histoire politique.<br />
En 1995, la question disparut totalement de la scène politique.<br />
La première salve fut tirée en 1993, lorsque l’administration Clinton<br />
critiqua les tarifs élevés des médicaments délivrés sur ordonnance et évoqua<br />
la possibilité que le gouvernement fédéral contrôle les prix. Aussitôt,<br />
l’industrie pharmaceutique réagit en embauchant l’agence Beckel Cowan,<br />
dont les dirigeants avaient géré la campagne présidentielle du républicain<br />
Walter Mondale. Beckel Cowan créa une organisation fantôme<br />
14. James Fallows, « A Triumph of Misinformation », The Atlantic, vol. 275, <strong>n°</strong> 1,<br />
p. 28.
118<br />
LE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE<br />
(Rx Partners) et commença à déployer des organisateurs dans chaque<br />
État et dans chaque circonscription pour, comme l’explique une brochure<br />
de la société, « générer et assurer des lettres de haute qualité écrites<br />
par des électeurs influents et destinées à trente-cinq membres du<br />
Congrès, soigneusement sélectionnés. Simultanément, Beckel-Cowan se<br />
livra à une campagne de courrier et d’appels téléphoniques ciblés :<br />
l’agence-conseil envoya des lettres personnelles, des télégrammes et<br />
transféra discrètement des appels aux bureaux locaux et nationaux de ces<br />
élus ». L’agence prétendit que cette campagne avait provoqué « plus de<br />
cinquante mille contacts avec les élus du Congrès » et « consolidé un<br />
réseau de partisans dans trente-cinq circonscriptions et États » 15 .<br />
« La réforme de la santé avançait à l’allure d’un tortillard, explique le<br />
lobbyiste Robert Hoopes. Nous l’avons vu venir dès le discours sur l’état<br />
de l’Union prononcé par Clinton. Nous avons donc eu le temps de nous<br />
organiser à la base, d’envoyer nos lettres, d’informer en détail nos<br />
membres et d’avoir de multiples réunions locales ; j’ai parcouru le pays<br />
et j’ai fait en sorte que nos membres s’intéressent à la question. Lorsque<br />
le temps est venu d’aller voter, nous étions prêts. 16 » Selon le magazine<br />
Campaign & Elections, l’Association des agents d’assurance indépendants<br />
a mobilisé « près de 140 000 agents d’assurance » durant le débat sur la<br />
réforme de la santé, constituant ce que Robert Hoopes appelle la nouvelle<br />
race de lobbyistes de Washington. « Les nouveaux lobbyistes, les<br />
bons lobbyistes, portent des pantalons non repassés, des badges défraîchis<br />
et se rendent au Capitole pour représenter eux-mêmes […] les<br />
300 000 agents d’assurance indépendants à travers le pays. Nos lobbyistes<br />
de Washington ont derrière eux une véritable armée présente<br />
dans chaque État, et les membres du Congrès comprennent tout ce<br />
qu’un lobbyiste peut faire en appuyant sur un bouton pour mobiliser ces<br />
gars contre ou pour eux. Ce changement découle directement d’un<br />
progrès technologique. 16 »<br />
La Coalition pour des choix en matière d’assurance-santé [Coalition for<br />
Health Insurance Choices] – groupe contrôlé en sous-main par les compagnies<br />
d’assurance – a mené la campagne pour liquider la réforme de la<br />
15. « RX Partners », document promotionnel de l’agence Beckel Cowan.<br />
16. Conférence de Robert Hoopes au colloque « Shaping Public Opinion : If You<br />
Don’t Do It, Somebody Else Will », Chicago, 9 décembre1994.
SHELDON RAMPTON & JOHN STAUBER 119<br />
santé. La Coalition a admis que la plupart de ses fonds provenaient de la<br />
Fédération nationale des entreprises indépendantes [National Federation<br />
of Independent Businesses] et de l’Association nationale pour l’assurancesanté<br />
[Health Insurance Association of America], qui regroupe des assureurs.<br />
Selon le magazine Consumer Reports, non seulement cette<br />
association « soutient la Coalition, mais l’a créée de toutes pièces ».<br />
Le grand cerveau de la Coalition, Blair G. Childs, organise le travail de<br />
terrain pour les assureurs depuis une dizaine d’années. Entre 1986 et<br />
1989, il a orchestré une campagne dans les médias, sur le terrain et dans<br />
des associations pour défendre les intérêts des assureurs dans le cadre<br />
notamment de l’Association pour une réforme des lois sur la responsabilité<br />
civile [American Tort Reform Association]. Puis il s’est fait embaucher<br />
par Aetna Life and Casualty, où il a créé l’un des systèmes les plus<br />
sophistiqués d’organisation et d’influence locales. Non seulement il a<br />
brillamment inspiré la campagne contre la réforme de la santé, mais il<br />
peut honnêtement réclamer la dépouille du projet de Clinton. « En combinant<br />
habilement une campagne ciblée dans les médias et le lobbying à<br />
la base, ces groupes ont pu influencer beaucoup plus de gens que le<br />
Président malgré le “tyran” de la Maison-Blanche. […] Jamais auparavant<br />
les intérêts privés n’avaient dépensé autant d’argent et de façon aussi<br />
ostentatoire pour combattre une initiative lancée par un président »,<br />
écrit Thomas Scarlet dans un article intitulé « Comment on a liquidé la<br />
réforme de la santé 17 ».<br />
En 1993, se rappelle Blair G. Childs, « les assureurs étaient très nerveux.<br />
Tout le monde parlait de la réforme. […] Nous avions l’impression<br />
d’avoir le canon d’un fusil pointé sur nous ». La création de multiples<br />
associations, explique-t-il, vous donne la possibilité « de créer une couverture<br />
pour la défense de vos intérêts. Nous avions besoin d’une certaine<br />
discrétion car nous savions qu’on allait nous dépeindre comme des<br />
salauds. Cela permet aussi d’obtenir un soutien de masse. Certaines associations<br />
disposent de la force d’un lobby, d’autres sont bien implantées<br />
localement, et d’autres ont d’excellents porte-parole. […] Il faut commencer<br />
par rassembler vos alliés naturels les plus puissants, s’asseoir<br />
autour d’une table et commencer à construire un mouvement […] pour<br />
donner à votre coalition une image positive ». Pour le débat sur la<br />
17. Thomas Scarlett, « Killing Health Care Reform », Campaigns & Elections,<br />
octobre-novembre 1994, p. 34.
120<br />
LE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE<br />
réforme de la santé, sa coalition mobilisa un éventail extrêmement large<br />
de gens, « des vétérans du Vietnam sans domicile fixe […] jusqu’à certains<br />
groupes très conservateurs. Bien qu’ils fussent étonnamment différents,<br />
chacun apportait sa petite contribution » 18 .<br />
Au lieu de former une seule grande coalition, les opposants à la<br />
réforme payèrent des instituts de sondage afin de déterminer la liste des<br />
points faibles de l’administration Clinton et ils organisèrent plus de vingt<br />
coalitions différentes pour matraquer l’opinion publique sur chaque<br />
question séparément. « Lorsque vous créez une association, […]<br />
donnez-lui un nom contenant quelques-uns des mots que vous avez<br />
repérés dans vos enquêtes d’opinion, explique Blair G. Childs. Certains<br />
d’entre eux […] provoquent une réaction générale positive. Sur ce plan,<br />
les sondages et les groupes témoins peuvent être très utiles. Des termes<br />
comme “équité”, “justice”, “choix”, “coalition”, “alliance” ont une connotation<br />
très positive. » La Coalition pour la liberté de choix en matière<br />
d’assurance-santé (Coalition for Health Insurance Choices), par<br />
exemple, s’opposa au plan de Clinton parce que celui proposait « des<br />
choix obligatoires en matière de santé » 18 .<br />
Pour faire passer son message, cette association finança un spot télévisé,<br />
devenu célèbre depuis, « Harry and Louise ». Ce clip présentait un<br />
couple marié de la classe moyenne qui se plaignait de la complexité du<br />
plan de Clinton et de la menace d’une nouvelle « bureaucratie financée<br />
à coups de milliards de dollars ». Le film avait été produit par Goddard<br />
Claussen/First Tuesday, agence-conseil et société spécialisée dans les<br />
campagnes électorales (Gary Hart, Bruce Babbitt et Jesse Jackson).<br />
Comme le nota le New York Times, le 30 septembre 1994, sous la plume<br />
de Robin Toner, « ”Harry and Louise” symbolisait tous les défauts du<br />
débat sur la réforme de la santé en 1994 : une puissance campagne de<br />
publicité financée par les assureurs qui ont joué sur les peurs de la population<br />
et contribué à liquider le projet de loi. 19 »<br />
Ces coalitions ont combiné l’utilisation massive du courrier et du téléphone<br />
avec des doses quotidiennes de désinformation administrées par<br />
Rush Limbaugh. Cet animateur radio incendiaire prétendait que la<br />
18. Conférence de Blair Childs au colloque « Shaping Public Opinion : If You Don’t<br />
Do It, Somebody Else Will », Chicago, 9 décembre 1994.<br />
19. Robin Toner, «“Harry and Louise” and a Guy Named Ben », New York Times,<br />
9 septembre 1994.
SHELDON RAMPTON & JOHN STAUBER 121<br />
réforme allait ruiner le pays, réduire la qualité des soins et jeter en prison<br />
ceux qui voulaient n’être soignés que par leur médecin de famille.<br />
Chaque jour, vingt millions d’Américains écoutent l’émission de Rush<br />
Limbaugh, diffusée par 650 stations à travers les États-Unis. Cependant,<br />
peu d’entre eux se rendent compte de ce qui sous-tend le pouvoir de cet<br />
animateur. Blair G. Childs a expliqué comment sa coalition a utilisé des<br />
publicités payantes au cours des émissions de Limbaugh pour susciter<br />
des milliers d’appels téléphoniques aux élus afin de stopper la réforme.<br />
Tout d’abord, Rush Limbaugh excitait ses fans et ses groupies en fulminant<br />
contre le projet de Clinton. Ensuite, pendant les pauses commerciales,<br />
il passait une publicité hostile à la réforme, indiquant un numéro<br />
vert qui donnait accès à davantage d’informations. Lorsqu’ils appelaient<br />
ce numéro, les auditeurs étaient mis en contact avec un télévendeur qui<br />
leur parlait rapidement, puis les transférait directement – et discrètement<br />
– au bureau de leur représentant au Congrès. Les équipes des élus ne<br />
savaient pas que ces appels avaient été suscités, subventionnés et transférés<br />
grâce à des publicités payantes lors de l’émission de Rush Limbaugh,<br />
publicités elles-mêmes financées par les compagnies d’assurances, afin de<br />
faire croire à une opposition massive des citoyens à la réforme.<br />
Blair G. Childs a également cherché à fournir des moyens aux grandes<br />
entreprises lorsque les membres de la coalition ne pouvaient agir euxmêmes<br />
: « Avec un groupe, nous avons écrit une grande partie de leur<br />
courrier qui a été envoyé à 4 500 000 personnes et a suscité des centaines<br />
de milliers de contacts. Nous avons travaillé avec plusieurs associations<br />
patronales pour financer les déplacements par avion jusqu’à<br />
Washington, où les électeurs ont rencontré leurs représentants au<br />
Congrès. […] Dans certains cas, nous avons payé la totalité ou une partie<br />
des dépenses, dans d’autres nous n’avons pas eu besoin de le faire,<br />
nous avons seulement fourni l’infrastructure de la campagne et le message.<br />
Dans d’autres cas, nous avons écrit les lettres nous-mêmes. […]<br />
Nous et nos alliés de la coalition étions parfois totalement invisibles […].<br />
Nous avons fini par financer quelques publicités que nos associés de la<br />
coalition ont gérées sous leur propre nom, surtout dans la région de<br />
Washington, pour influencer l’opinion des élus. 20 »<br />
20. Conférence de Blair Childs au colloque « Shaping Public Opinion : If You Don’t<br />
Do It, Somebody Else Will », Chicago, 9 décembre 1994.
122<br />
LE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE<br />
En 1994, le tir de barrage réussit à modifier substantiellement le climat<br />
politique ; les républicains comprirent que le projet de Clinton – en<br />
fait n’importe quel projet – pouvait être battu. Leur stratège, William<br />
Kristol, recommanda de voter les yeux fermés contre toute réforme présentée<br />
par l’administration Clinton. Les républicains qui avaient auparavant<br />
soutenu certains aspects du projet firent marche arrière. Le sénateur<br />
républicain Robert Packwood avait toujours soutenu que les dépenses de<br />
santé devaient être partiellement prises en charge par les employeurs.<br />
Soudain, il annonça qu’il s’opposait à la réforme en 1994, ce qui conduisit<br />
le National Journal à écrire : « Packwood a assumé un rôle essentiel<br />
dans la campagne contre un projet démocrate qui ressemble comme<br />
deux gouttes d’eau à celui qu’il préconisait lui-même peu de temps auparavant.<br />
» Poussé par le désespoir, le chef de la majorité démocrate au<br />
Sénat, George Micthell, annonça un plan purement symbolique, sans<br />
aucune obligation pour les employeurs, et dont le contenu se résumait à<br />
la promesse, à très long terme, d’une couverture universelle. Les républicains<br />
le rejetèrent avec un mépris féroce.<br />
« En 1994, note James Fallow, le Wall Street Journal testa les réactions<br />
d’un panel de citoyens devant différents projets de réforme de la santé, y<br />
compris celui de Clinton. Tout d’abord, les sondeurs décrivirent le<br />
contenu de chaque plan aux sondés et ils découvrirent que les personnes<br />
consultées préféraient celui de Clinton. Mais dès qu’on leur dit que leur<br />
choix s’était porté sur la réforme démocrate, la plupart des sondés changèrent<br />
d’avis et déclarèrent y être opposés. En fin de compte, ils savaient<br />
que le projet de Clinton ne serait jamais appliqué. 21 »<br />
SHELDON RAMPTON & JOHN STAUBER<br />
Traduit de l’anglais par Yves Coleman<br />
Ce texte est extrait du chapitre VII de Des vessies pour des lanternes. Relations<br />
publiques, communication et médias, à paraître aux éditions <strong>Agone</strong>, préfacé,<br />
annoté et actualisé au contexte européen par Roger Lenglet.<br />
21. James Fallows, « A Triumph of Misinformation », op. cit.
Points de vue américains (II)<br />
Sous la culture des fondations, Gina Neff p. 124<br />
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton<br />
Paru sous le titre « Foundation Culture » (signé Gina Graham), in Left Business Observer,<br />
<strong>n°</strong> 70, nov. 1995 (également publié sur Internet : ).<br />
Gina Neff, après avoir travaillé dans le monde des fondations, réalise à l’université<br />
de Columbia une thèse de sociologie intitulée « The Organization of Uncertainty<br />
in New York’s Internet Industry, 1995-2001 ».<br />
Points de vue de la rue, Jamie Kalven p. 1<strong>32</strong><br />
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton<br />
Paru sous le titre « Facts on the Ground », in The Baffler, <strong>n°</strong> 16, 2003.<br />
Jamie Kalven est conseiller auprès du comité d’habitants de Stateway Gardens<br />
Public Housing Development à Chicago et auteur de Working With Available<br />
Light: A Family’s World After Violence. Cet article est disponible en anglais sur<br />
le site , mis en place par The Invisible Institute, un<br />
groupe de défense des habitants de Stateway Gardens.<br />
In memoriam Henry Louis Mencken, Daniel Raeburn p. 141<br />
Traduit de l’anglais par Benoît Eugène<br />
Paru sous le titre « In Memoriam: HLM », in The Baffler, <strong>n°</strong> 16, 2003.<br />
Daniel Raeburn est collaborateur et graphiste de The Baffler. Rédacteur en chef de<br />
The Imp, revue critique auto-éditée consacrée à la bande dessinée (le dernier<br />
numéro paru traite des « historietas » mexicaines).<br />
The Baffler est né en 1988. Il s’inscrit dans une tradition critique américaine,<br />
notamment du monde des affaires, qui s’est développée entre 1910 et 1940. Il souhaite<br />
attaquer « les pompes du pouvoir de la façon la plus directe, dénoncer la<br />
fumisterie et faire éclater la bulle du moment, qu’il s’agisse de la “culture alternative”<br />
ou des prétentions libératrices de la “cyber-culture” ». En effet « pour comprendre<br />
la crise culturelle que nous traversons, on ne peut ignorer que les modes de<br />
contestation culturelle apparus dans les années soixante se confondent désormais<br />
avec la théorie du management ».<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 123-153
124<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
Sous la culture des fondations<br />
La plupart des citoyens ne se font pas une idée très claire du rôle joué<br />
par les fondations dans les affaires publiques. Une nouvelle génération<br />
de fondations situées politiquement à droite a financé la dérive droitière<br />
de l’Amérique. Quant aux fondations classiques ou celles prétendument<br />
« progressistes », elles imposent, malgré leur réputation de générosité<br />
et de libéralisme, un type particulier de contraintes à la vie politique.<br />
Si les fondations dispensent largement leur fortune, leur bourse ne s’ouvrent<br />
pas sans contraintes. Les règles fiscales concernant les exemptions<br />
d’impôts fixent des limites au financement des activités politiques ou<br />
des groupes de pression par les fondations. Mais les limites que cellesci<br />
s’imposent sont plus importantes et plus efficaces encore. Les<br />
bailleurs de fonds parlent de leur décisions en termes de « maximalisation<br />
des retours sur investissements », d’« accroissement d’impact » ou<br />
de « concentration des portefeuilles d’actions ». Du fond de leurs<br />
bureaux douillets, les financeurs prescrivent aux organisations à but non<br />
lucratif comment faire leur travail et façonnent ainsi les politiques en<br />
dictant le type d’activités caritatives, de programmes et de problèmes<br />
sociaux susceptibles d’attirer leurs dollars.<br />
Les fondations prétendent changer la société. Pourtant, le financement<br />
de projets au coup par coup au service de causes exclusives et distinctes<br />
produit fort peu de réels changements. En outre, la préférence affichée<br />
des fondations pour les financements ciblés plutôt que pour l’aide structurelle<br />
en général accroît l’influence des financeurs sur les bénéficiaires.<br />
Il est d’ailleurs difficile de se défaire du sentiment qu’un individu qui<br />
gagne 134 000 dollars par an (salaire moyen d’un PDG d’une fondation<br />
non familiale) et qui distribue sept millions de dollars chaque année<br />
(moyenne pour les fondations indépendantes) n’est pas forcément en<br />
phase avec les militants de terrain qu’il « arrose ». Le spectre politique<br />
des conseils d’administration des fondations s’étendant des libérauxconservateurs<br />
aux ultraconservateurs, ceux-ci sont en général sociale-
GINA NEFF 125<br />
ment fort éloignés des politiques menées sur le terrain par les groupes<br />
qu’ils financent.<br />
La principale motivation que l’on trouve à l’origine des grandes fondations<br />
indépendantes que tout auditeur des chaînes de radio nationales<br />
peut citer – les Pew, Ford, MacArthur ou Robert Wood Johnson 1 – est<br />
rarement l’altruisme. La fondation Ford a été créée pour que l’entreprise<br />
reste aux mains de la famille Ford sans qu’elle eût à s’acquitter des droits<br />
de succession. John D. MacArthur, fondateur de Bankers Life et de<br />
Casualty Company ne fit, de son vivant, aucun don caritatif notable<br />
mais préféra laisser sa fortune évaluée à près d’un milliard de dollars à<br />
une fondation plutôt que de la léguer à ses enfants avec lesquels il était<br />
en bisbille. L’un des trusts fondés par les héritiers de Sun Oil, le J.<br />
Howard Pew Freedom Trust, avait pour objectif premier d’« instruire le<br />
peuple américain des méfaits de la bureaucratie […], des avantages de<br />
l’économie de marché […] et [de] dénoncer les fausses promesses du<br />
socialisme ». Du fond d’un confortable bureau, l’équipe dirigeante des<br />
Pew Charitable Trusts distribue chaque année au nom du J. Howard<br />
Pew Freedom Trust 21 millions de dollars à des organismes de droite tels<br />
que l’Heritage Foundation 2 , le Manhattan Institute et le National Right<br />
to Work 3 ainsi qu’à des groupes aux noms aussi croustillants que la<br />
Tides Foundation et le Pesticide Action Network 4 , satisfaisant ainsi aux<br />
dernières volonté de l’un des héritiers de Pew.<br />
La droite souhaite limiter la durée de vie des fondations. Arguant de la<br />
suprématie des libéraux dans les mégafondations, les réactionnaires<br />
prétendent que les intentions originelles des donateurs seraient mieux<br />
respectées par des fondations dépensant leur capital plutôt que laissant<br />
des responsables de tendance libérale financer des projets avec le<br />
revenu des intérêts. Pourtant, si la culture de fondations présente<br />
quelques dangers ce n’est pas par son libéralisme politiquement correct<br />
mais bien par les changements politiques illusoires qu’elle prétend<br />
1. Sur les fondations indépendantes, ; sur les fondations<br />
citées, Pew , Ford ,<br />
MacArthur , Robert Wood Johnson <br />
2. Heritage Foundation, .<br />
3. Manhattan Institute et National Right to Work .<br />
4. Sur Tides Foundation et Pesticide Action Network .
126<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
entraîner. Illusion qui permet aux libéraux de vivre sereinement sans se<br />
soucier de savoir qu’ils ne sont finalement que de simples médiateurs<br />
des relations publiques du monde de l’entreprise.<br />
RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES ?<br />
Si les fondations étaient aussi progressistes que la droite le pense, se<br />
constitueraient-elles – comme elles le font – d’impressionnants portefeuilles<br />
d’actions ? D’autant que si cette politique d’investissement fait<br />
l’objet d’un examen méticuleux, ce n’est qu’au travers du flou artistique<br />
de la notion de « responsabilité entrepreneuriale ».<br />
La fondation Jesse Smith Noyes, progressiste et écologiste, qui possède<br />
des actions d’Intel, finançait dans le même temps le Southwest<br />
Organizing Project, qui protestait contre la décision d’Intel d’agrandir<br />
une usine grande consommatrice d’eau implantée dans la très aride ville<br />
d’Albuquerque. Le président de la fondation, Stephen Viederman, a<br />
plaidé pour que son conseil d’administration et tous les autres fassent<br />
tomber le « rideau de fer » qui sépare, au profit de ces dernières, les<br />
décisions en matière de gestion du capital, y compris par les actionnaires,<br />
et l’attribution des subsides dans des cas comme celui d’Intel. Il<br />
prônait en outre une part plus large d’investissements à risque dans le<br />
secteur non marchand par des placements ciblés en liaison avec les programmes<br />
de la fondation (prêts à des taux d’intérêts inférieurs ou investissements<br />
directs). Viederman remarquait que le récent rapport du<br />
Comité sur les fondations concernant la gestion du capital passait sous<br />
silence le lien entre la mission spécifique des fondation et leurs choix en<br />
termes d’investissements. Mais la critique de Viederman n’allait quand<br />
même pas jusqu’à remettre en cause le système qui autorise les uns à<br />
gérer de gros portefeuilles d’actions quand les autres en sont réduits à<br />
quémander quelques miettes des dividendes.<br />
Quoi qu’il en soit, Viederman est bien seul. Les grandes fondations investissent<br />
en effet rarement une part de leur capital dans les projets philanthropiques.<br />
MacArthur, par exemple, ne consacre que deux pour cent de<br />
ses quelque trois milliards de dollars de fonds propres au financement de<br />
projets spécifiques.
GINA NEFF 127<br />
AIR DU TEMPS & CONCURRENCE<br />
Le jargon du moment se dépose sur le papier glacé des rapports annuels<br />
des fondations aussi rapidement que s’évanouissent les penchants philanthropiques<br />
qu’elles sont censées incarner : réactivité institutionnelle,<br />
autosuffisance, société civile, résolution pacifique des conflits. Des changements<br />
de cap dans les décisions concernant certains projets obligent<br />
les organismes financés à se battre de plus en plus pour obtenir finalement<br />
toujours moins d’argent – ce qui a parfois entraîné la disparition<br />
d’institutions à but non lucratif. Des régions entières du monde se transforment<br />
en simple bips clignotant sur l’écran de contrôle d’un responsable<br />
de projet – comme c’est arrivé successivement à l’Afrique du Sud,<br />
l’Europe centrale, l’Europe de l’Est ou Haïti.<br />
« Je ne m’investis pas dans le secteur associatif pour mener des projets<br />
qui satisfassent les marchés. Je m’y investis pour faire ce qui doit être<br />
fait », déclarait, quelque peu désabusé, un des administrateurs d’un<br />
programme de développement communautaire en Nouvelle-Angleterre.<br />
Son association était devenue la proie des formules choyées par les fondations.<br />
Les méthodes d’« autonomisation communautaire » qu’ils<br />
avaient jusqu’alors employées n’étaient désormais plus considérées<br />
comme « novatrices », même si, de l’avis de tous – y compris des responsables<br />
de leur projet au sein des fondations qui les avaient financées<br />
antérieurement –, elles étaient efficaces.<br />
Les responsables des fondations débattent entre eux. Ils se réunissent au<br />
sein de structures comme le Réseau national des donateurs (National<br />
Network of Grantmakers) et le Comité des fondations 5 . Pour les financeurs<br />
réunis dans ces réseaux, la « cohérence du projet » se traduit par<br />
une réduction des subventions accordées aux organismes périphériques<br />
par rapport à celui-ci. Ron Arnold, le gourou de Wise Use – ennemi<br />
avéré de l’économie de marché et membre du Sierra Club et autres<br />
grosses organisations écologistes 6 –, a visé juste en faisant circuler la<br />
retranscription de discussions 7 ayant eu lieu au sein de l’Environmental<br />
5. Sur le Comité des fondations, .<br />
6. Sur Ron Arnold .<br />
7. Voir .
128<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
Grantmakers Association 8 . On y complotait clairement pour influencer<br />
le calendrier général du mouvement environnementaliste.<br />
Il arrive aussi que des démarches prospectives sophistiquées accouchent<br />
d’idées parfaitement imbéciles. Lors d’une réunion initiée par une fondation<br />
au printemps dernier, les organisations écologistes et les financeurs<br />
discutèrent des potentialités d’Internet pour le travail de terrain.<br />
L’une des participantes rappela que l’accès à l’informatique seul ne servirait<br />
pas à grand chose pour aider les communautés les plus pauvres.<br />
Une autre affirmait que la plupart des mouvements à la base sont animés<br />
par des femmes et que ces dernières ne représentaient qu’un faible<br />
pourcentage des usagers de l’Internet. Aucun des orateurs invités à<br />
cette réunion, exclusivement des Blancs de sexe masculin, n’avaient<br />
évoqué ces simples faits. En revanche, ils avaient offert l’aide de leurs<br />
conseillers juridiques pour examiner de près les conséquences de l’usage<br />
d’Internet par les associations du point de vue de la définition officielle<br />
du « lobbying » établie par l’administration fiscale.<br />
Les fondations veulent être impliquées dans les projets qu’elles financent.<br />
À la recherche de « partenariat » avec les bénéficiaires de ces<br />
financements, les responsables des fondations aident souvent ces derniers<br />
à réécrire leurs projets afin d’y introduire le vocabulaire, les techniques<br />
et les méthodes que les financeurs considèrent comme essentiels.<br />
Lorsque les rédacteurs des demandes de subsides se rencontrent, ils se<br />
plaignent du rapport de force imposé par les fondations : les argumentaires<br />
des organismes à but non lucratif aident les fondations à rédiger<br />
leurs propres directives programmatiques ; et ces directives sont ensuite<br />
traduites en financements qui ne vont pas nécessairement aux groupes<br />
qui les avaient suggérées. En outre, les fondations gèrent de plus en plus<br />
leurs propres programmes, soit en coopération avec un organisme à but<br />
non lucratif soit au travers d’une sorte de délégation philanthropique.<br />
Commentant une initiative de sa direction, une fondation progressiste<br />
s’attribuait fièrement dans son rapport annuel le titre d’« organisme<br />
partenaire » agissant sur un pied d’égalité avec les deux organisations<br />
financées. Le secteur toujours plus concurrentiel de la collecte de fonds<br />
est un marché d’acheteurs. Et ceux-ci se conduisent habituellement avec<br />
leurs « achats » comme le ferait n’importe quelle entreprise.<br />
8. Voir et .
GINA NEFF 129<br />
Si quelques séances de méditation ou de massage peuvent certes<br />
assouplir la discipline que s’infligent la corporation des costard cravate<br />
(ou des tailleur-talons hauts), l’entreprise n’en demeure pas moins la<br />
culture dominante dans bien des fondations dont la liste des administrateurs<br />
9 – même pour les plus « progressistes » – ressemble fort à un<br />
Who’s Who des milieux patronaux.<br />
Les financeurs transportent cet affairisme jusque dans les projets philanthropiques<br />
qu’ils financent. Ainsi le trésorier du Rockfeller Brothers<br />
Fund affirma-t-il : « Dans certains cas, nous intégrons le conseil d’administration<br />
de l’organisme financé – si nous sommes intéressés par son<br />
développement institutionnel – en y plaçant un membre de notre<br />
équipe. » Les budgets sont examinés à la loupe ligne par ligne par des<br />
responsables de projets qui cherchent à « maximiser les retours sur<br />
investissement ». Responsable de financements, Cynthia Mayeda<br />
déclara par exemple : « Nous nous intéressons toujours aux marges<br />
bénéficiaires, les petites marges font parfois les gros profits. Nous<br />
attendons des organismes à but non lucratif qu’ils y soient eux aussi<br />
attentifs. » Mais les associations institutionnelles disposant de fonds<br />
propres échappent généralement à cette attention.<br />
Le World Wildlife Fund a reçu en 1994 plus de 2<strong>32</strong> 000 dollars de la<br />
Fondation John D. et Catherine T. MacArthur 10 . Même si cela dépasse<br />
de loin ce que bien des petites associations peuvent espérer recevoir en<br />
un an, cette somme couvrait à peine la rémunération et la mutuelle de<br />
sa présidente Kathryn Fuller. La dirigeante de la fondation MacArthur,<br />
Adele Simmons, est bien placée pour comprendre l’équilibre délicat entre<br />
vie agréable et travail bien payé : il apparaît en effet selon la déclaration<br />
fiscale de la fondation qu’elle a touché en 1994 quelque 382 349 dollars<br />
tandis que ses prestations d’assurance sociale dépassaient les 80 000 dollars.<br />
Pour se faire une idée, l’an dernier, les fameux écologistes (néanmoins<br />
très libéraux en matière économique) de la Nature Conservancy,<br />
dans le même temps où ils versaient plus de 330 000 dollars de salaire à<br />
leurs deux plus hauts responsables, recevaient plus de 550 000 dollars de<br />
la fondation MacArthur l’an dernier pour soutenir leur timide politique<br />
de défense de la nature essentiellement illustrée par le rachat à crédit de<br />
9. Voir .<br />
10. Voir .
130<br />
terrains privés. Dans le domaine de la collecte de fonds, les associations<br />
à but non lucratif semblent avoir intérêt à mener des politiques frileuses<br />
et à faire preuve d’une certaine sensibilité entrepreneuriale.<br />
Dans le numéro de Chronicle of Philanthropy dont ces chiffres sont<br />
issus, était également cité un article de Bill Gillford, publié dans le<br />
Washington City Paper, où celui-ci se définit comme un « éco-esclave »<br />
de Greenpeace : « Chaque été des étudiants idéalistes accourent à<br />
Washington dans l’espoir de trouver un travail qui permette de sauver<br />
la planète. Mais, dernièrement, les principales organisations écologistes<br />
ont réduit leurs équipes de manière drastique et la concurrence<br />
pour les postes même les moins intéressants eux-mêmes est devenue<br />
féroce. La plupart de ces malheureux finissent démarcheurs pour le<br />
compte de Greenpeace ». Encore leur demande-t-on de faire rentrer<br />
120 dollars quatre soirs d’affilée pour pouvoir espérer conserver leur<br />
boulot. En décembre dernier, Tony Horwitz, du Wall Street Journal,<br />
révélait qu’une entreprise à laquelle Greenpeace avait sous-traité le service<br />
informatique de vérification des chèques n’était ni plus ni moins<br />
qu’un atelier clandestin moderne alliant salaires ridicules et technologie<br />
extrêmement sophistiquée.<br />
TRAVAILLER POUR LES FONDATIONS<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
Tout rédacteur de projet connaît la chanson : les projets doivent être<br />
aisément évaluables avec une mission précisément définie, des objectifs<br />
clairs, des buts accessibles et une méthode d’évaluation quantifiable<br />
exposée dès les premières lignes. Mais le métier de grain de sable est<br />
loin d’être aussi propre. Parcourez les couloirs de n’importe quelle association<br />
et vous y verrez des piles de dossiers présentant les organismes<br />
du même type, des prospectus et des plans d’action, des appels à former<br />
des plates-formes, des pétitions, des téléphones qui sonnent et des<br />
appels pour des conférences. La politique exige la coopération mais la<br />
collecte de fonds contraint ces structures à garder précieusement pour<br />
elles leurs contacts au sein des fondations. Quand une association en<br />
recommande une autre, c’est toujours auprès d’une fondation auprès<br />
de laquelle elle n’a pas elle-même introduit de demande. En insistant sur<br />
des projets spécifiques au détriment de l’aide structurelle, les fondations
GINA NEFF 1<strong>31</strong><br />
ont ligoté bien des mains qui auraient dû travailler à développer des<br />
alliances. Elles ont poussé à négliger l’approche collective de la résolution<br />
des problèmes sociaux au profit des capacités individuelles à innover,<br />
à générer de nouveaux projets et de nouvelles propositions. Plus<br />
cyniquement, elles ont entretenu un système de concurrence pour les<br />
subsides. Les fondations prétendent fièrement que leur continuel<br />
encouragement à de « nouvelles approches innovantes », leurs programmes-pilotes<br />
ainsi que le fait de chapeauter certains organismes<br />
spécifiques fondent une sorte de nouvelle société. Alors qu’en fait elles<br />
fragilisent et accentuent l’atomisation des résistances.<br />
Rares sont ceux qui, travaillant dans les associations à but non lucratif,<br />
aussi critiques soient-ils à l’égard du fonctionnement des fondations,<br />
osent associer leurs noms à ces critiques de peur que leur financement<br />
n’en pâtisse. Une dirigeante de l’une de ces associations m’a raconté un<br />
jour qu’elle avait reçu un coup de fil d’un responsable d’une fondation<br />
lui déclarant : « J’ai entendu dire que vous n’étiez pas d’accord avec la<br />
position préconisée par notre fondation lors de la conférence… » De<br />
telles histoires peuvent relever de la paranoïa, mais il demeure que les<br />
groupes se battent pour le moindre dollar, surveillent leurs arrières et<br />
mesurent leurs paroles. Reprochant aux fondations libérales de travailler<br />
sur des projets défendant des causes spécifiques plutôt que de suivre la<br />
stratégie des fondations de droite qui consiste à aider les conservateurs<br />
à l’emporter dans le domaine politique, la responsable du financement<br />
de la fondation Robert Sterling Clark, Margaret C. Ayers, voyait ses propos<br />
repris par le Chronicle of Philanthropy : « Je ne connais aucun donateur<br />
se considérant comme libéral ou progressiste qui soit en mesure<br />
d’expliquer à quoi pourrait ressembler un avenir progressiste. »<br />
Nullement contraints par leur manque de vision prospective, les donateurs<br />
ont d’énormes quantités d’argent à distribuer. En vertu de quoi, ils<br />
contribuent à déterminer l’agenda politique et les formes d’organisation.<br />
GINA NEFF, novembre 1995
1<strong>32</strong><br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
Points de vue de la rue<br />
Au matin du 7 janvier, Morton Walker se rendit, comme souvent, à la<br />
Chicago Bee Branch Library, à l’angle de la 36e rue et de State Street, en<br />
traversant la cité HLM de Stateway Gardens. En compagnie d’un de ses<br />
amis, Mike Fuller, il marchait sur State Street quand une voiture de police<br />
banalisée, roulant sur le trottoir, passa à sa hauteur. Trois officiers en<br />
uniforme en sortirent et leur ordonnèrent de mettre les mains sur le capot.<br />
L’un d’entre eux vérifia leurs identités tandis que les deux autres<br />
fouillèrent Morton et Mike. Morton apprit plus tard que les policiers<br />
étaient membres de la « section des opérations spéciales » du département<br />
de police de Chicago. Celui qui l’avait fouillé s’appelait Milton.<br />
Une fois vérifiées leurs identités, l’officier Milton leur intima : « Je vous<br />
laisse passer cette fois-ci, les gars, mais je ne veux pas plus vous voir<br />
dans le coin. Dites-le à vos potes : State Street est fermée. Il n’y aura plus<br />
personne en train de marcher ou de glander dans cette rue. De la 35e à<br />
la 39e rue, c’est zone interdite. »<br />
Morton pensa qu’il s’agissait peut-être d’une mesure de sécurité, vu que<br />
le président Bush était censé faire une apparition devant l’Economic<br />
Club of Chicago cet après-midi-là pour annoncer son projet de baisse<br />
massive des impôts. Morton demanda à l’officier si c’était pour cela<br />
qu’ils nettoyaient les rues.<br />
« Non, c’est comme ça à partir de maintenant, répondit-il. Il n’y aura<br />
plus de passage sur State Street. Allez voir sur Federal Street si vous<br />
voulez glander. — Là-bas il n’y a rien à part une bande de dealers, lui<br />
rétorqua Morton. — Oui, mais nous ne nous intéressons pas à ce coinlà,<br />
répondit Milton. C’est State Street qui nous intéresse. Nous fermons<br />
le quartier. »<br />
Quand la police le relâcha, Morton pénétra dans la bibliothèque et signa<br />
le registre pour travailler sur ordinateur. Il est l’un des habitués de la Bee<br />
Branch. Pour Morton, qui a quarante ans et a grandi à Stateway, la Bee
JAMIE KALVEN 133<br />
Branch lui fournit le cadre à l’intérieur duquel il peut poursuivre l’éducation<br />
entamée en prison. Il a été libéré en 1999, après avoir purgé neuf<br />
années d’une peine de douze ans pour agression sexuelle. (La cour suprême<br />
de l’Illinois avait annulé sa condamnation et ordonné la tenue<br />
d’un nouveau procès ; il accepta un marchandage sur sa peine et fut immédiatement<br />
libéré.) Pendant son incarcération, il obtint son GED [équivalence<br />
d’un diplôme permettant de poursuivre des études supérieures].<br />
Il poursuivit ses études en prison par l’intermédiaire d’un cursus universitaire<br />
ouvert par la Roosevelt University. Quand il sortit de prison, il obtint<br />
son BA [licence] avec la promotion de l’an 2000. Le sujet de son mémoire<br />
était « Le renouveau urbain : un cauchemar pour les minorités ».<br />
Ce jour-là, à la bibliothèque, il rencontra Shawn Baldwin, comme lui du<br />
quartier et également quadragénaire. Actuellement sans domicile fixe, ce<br />
dernier réside dans un foyer du voisinage. Lui et Morton sont devenus<br />
amis ces derniers mois alors qu’ils travaillaient côte à côte sur les terminaux<br />
d’ordinateurs de la bibliothèque et partageaient leur connaissance<br />
de l’Internet. « Il a appris de moi et j’ai appris de lui, me confia Shawn.<br />
C’est comme ça que nous avons appris à nous connaître. »<br />
Morton et Shawn se sentent les bienvenus à la Bee Branch. « Tout le<br />
monde sait qui nous sommes », dit Shawn. Il apprécie plus particulièrement<br />
l’hospitalité de l’agent de sécurité, miss King. « Elle sait qui sont<br />
les fauteurs de trouble et qui vient ici dans le but de rechercher des informations<br />
sur ordinateur ou dans les livres. »<br />
Selon Shawn, L’un des intérêts de la Bee Branch est qu’ils « ont des ordinateurs<br />
Dell munis de processeurs Pentium 4 ». Les deux comparses<br />
s’en servent pour relever leurs courriers électroniques, chercher des emplois<br />
et explorer Internet. Morton aime jouer aux échecs sur l’ordinateur.<br />
Shawn s’est pris de passion pour le jeu Sim City.<br />
Morton et Shawn avaient réservé les ordinateurs de une heure à trois<br />
heures. En attendant son tour, Morton lut des magazines et des journaux.<br />
C’est peut-être à cause d’un commentaire sur l’expérience quotidienne<br />
d’être un homme noir dans les rues d’une cité HLM qu’il ne parla<br />
pas de sa rencontre avec la police à Shawn. « Il n’y avait rien à en dire »,<br />
déclara-t-il plus tard.<br />
À une heure moins dix, les deux hommes sortirent pour partager une<br />
cigarette – il n’en avait qu’une pour deux – avant de débuter leur séance<br />
informatique. Comme il se tenaient devant la porte de la bibliothèque,
134<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
l’agent Milton et son équipe se garèrent sur le trottoir et leur intimèrent<br />
l’ordre de mettre leurs mains contre le mur puis les menottèrent.<br />
Morton et Shawn tentèrent de leur expliquer qu’il était interdit de fumer<br />
dans la bibliothèque et qu’ils n’étaient sortis que pour quelques minutes.<br />
« Je connais un endroit où il n’y pas de risque que vous fumiez », leur<br />
répondit l’un des policiers. « Quand vous étiez à l’école, on ne vous<br />
voyait jamais à la bibliothèque, ironisa l’agent Milton. On pourrait savoir<br />
ce que vous y faites maintenant ? »<br />
Morton et Shawn se retrouvèrent dans un car de police. Trois autres individus<br />
furent arrêtés sur State Street au même moment. Tous étaient<br />
dans la quarantaine. « Les policiers rigolaient en affirmant qu’ils avaient<br />
arrêté le gang des cheveux blancs. »<br />
Tous furent conduits au commissariat du second district, au coin de la 51e et de Wentworth, où ils demeurèrent quatorze heures. Arrêtés à<br />
treize heures, ils ne furent donc relâchés qu’à quatre heures du matin.<br />
Pendant leur détention, d’autres individus accusés de crimes relativement<br />
plus sérieux ne firent que passer au commissariat avant d’être libérés.<br />
« Tout le monde nous connaissait dans ce commissariat, affirma Morton.<br />
Ils ont dû se dire : “Laissons ces types au frais quelque temps.” »<br />
Morton et Shawn furent accusés d’outrage aux bonnes mœurs, délit<br />
qu’un décret de la ville définit comme le refus « d’obéir à un ordre légitime<br />
de circuler émis par une personne dont la qualité de gardien de<br />
la paix est connue de l’intéressé dans des circonstances où trois individus<br />
ou plus présentent une conduite contraire aux bonnes mœurs dans<br />
un voisinage immédiat, conduite susceptible d’entraîner un risque<br />
substantiel ou de sérieux troubles, perturbations ou menaces ».<br />
Dans le cas de Shawn, le rapport des policiers stipulait : «À plusieurs occasions,<br />
les policiers ayant pratiqué l’arrestation ont pu observer Shawn<br />
Baldwin traîner dans la 3 600 South State Street en compagnie de plusieurs<br />
autres individus noirs de sexe masculin. Les mêmes policiers ont<br />
plusieurs fois demandé à ces individus de circuler sans qu’ils obtempèrent.<br />
En conséquence de quoi les agents ont procédé à l’arrestation du<br />
contrevenant. »<br />
Ce qui est sidérant dans ce rapport, c’est que l’agent ayant procédé à l’arrestation<br />
ne prend même pas la peine de qualifier le délit commis – ces<br />
fameuses conduites « susceptibles d’entraîner un risque substantiel ou de
JAMIE KALVEN 135<br />
sérieux troubles, perturbations ou menaces » – plus précisément que la<br />
simple présence d’hommes noirs discutant en marchant dans la rue.<br />
Ce dont Morton et Shawn ne se doutaient pas à ce moment-là, c’est<br />
que leur arrestation sur le perron de la bibliothèque n’était pas un<br />
exemple d’abus de pouvoir policier dont se seraient rendus individuellement<br />
coupables des policiers. C’était en fait le résultat d’un arrêté émanant<br />
directement de la plus haute autorité de la ville : le maire en<br />
personne, Richard M. Daley. Ce n’était que la mise en œuvre d’une<br />
politique officielle de la ville, plus connue sous le nom de « State Street<br />
Coverage Initiative ».<br />
À partir du jour où Morton fut arrêté, la police maintint une présence<br />
continuelle dans la rue. Trois équipes effectuaient des rondes toute la<br />
journée et sept jours sur sept. Cette présence accrue de la police ne visait<br />
pas le commerce de drogues qui s’opérait aux yeux de tous dans les<br />
halls d’entrées des tours mais bien la présence des habitants du quartier<br />
dans les rues. Les policiers affectés au titre de la State Street Coverage<br />
Initiative se livraient à des arrestations pour vagabondage ou distribuaient<br />
des amendes pour déambulation dangereuse sur la chaussée.<br />
Ils pénétrèrent également dans la Bee Branch Library et ordonnèrent aux<br />
bibliothécaires de fermer les toilettes du bâtiment. Des voitures de police<br />
effectuaient des rondes continuelles dans la rue. Le 10 janvier, alors<br />
que la température avoisinait les - 20 °C avec de fortes chutes de neige,<br />
j’ai pu voir cinq voitures de police rien que pour un seul bloc d’habitation<br />
: quatre véhicules avec des gyrophares et une voiture banalisée.<br />
Deux des voitures de service étaient garées cul à cul de façon à bloquer<br />
l’entrée du parc public qui, avec la bibliothèque et la rue elle-même, est<br />
l’un des trois lieux de rendez-vous de la communauté du quartier.<br />
Tout se passait comme si la loi martiale avait été déclarée dans le seul<br />
quartier du South Side Chicago. Le siège ne fut levé que le 21 mars<br />
lorsque, pour la première fois depuis des mois, on n’aperçut aucune<br />
présence policière dans le block 3 700 de South State Street. J’appris<br />
plus tard que les policiers avaient été déployés dans le centre-ville à<br />
cause de manifestations contre la guerre.<br />
Quelques conversations avec la police – des officiers dans les bureaux<br />
aux hommes sur le terrain – permettent d’établir de façon parfaitement<br />
claire les origines de l’opération. Il advint que, se rendant ou retournant<br />
d’une réunion quelconque quelque part dans le South Side, le maire
136<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
Daley passa par State Street. De derrière les vitres de sa limousine, il<br />
aperçut des individus qui traînaient dans la rue mais ne décela aucune<br />
présence policière. Absolument scandalisé, il ordonna au directeur de la<br />
police de la ville, Terry Hillard, de nettoyer South State Street. La motivation<br />
de cette directive du maire, du moins telle qu’elle fut transmise<br />
et comprise par les policiers sur le terrain, n’était pas d’assurer la protection<br />
des habitants du quartier contre le crime mais de rendre le quartier<br />
attractif aux yeux des promoteurs.<br />
La municipalité de Chicago est en pleine opération de révision de sa politique<br />
de logements sociaux. Selon le « plan de transformation » décrété<br />
par la direction du logement de la ville de Chicago, initié en 1999,<br />
les cinquante-trois tours de quatorze cités HLM de la ville doivent être<br />
démolies dans les années à venir. À ce jour, plus de la moitié de ces tours<br />
ont été rasées. À leur place, des « quartiers de mixité sociale » sont<br />
censés être construits par des promoteurs privés.<br />
L’une des plus importante concentration de logements sociaux du pays,<br />
le fameux « corridor » de South State Street, n’est plus désormais<br />
qu’une vaste étendue de prairies urbaines au milieu desquelles s’élèvent<br />
quelques tours isolées comme des navires échoués. Les vingt-huit tours<br />
qui composaient la cité Robert Taylor sont désormais réduites à cinq. Des<br />
huit tours que comptait à l’origine la cité Stateways il n’en reste que<br />
deux et l’une d’entre elles sera murée et démolie à la fin de cette année.<br />
Ce réaménagement de la ville ampute les acquis du renouveau urbain<br />
des années 1950 et 1960. Il implique le relogement forcé de 14 000 familles,<br />
dont certaines devront déménager plusieurs fois. Il aura de profondes<br />
conséquences non seulement pour les habitants de ces quartiers<br />
mais également pour ceux de Chicago en général. Les proclamations<br />
autosatisfaites autour du « développement municipal » cachent un profond<br />
silence sur les questions essentielles qui touchent à l’esprit même<br />
de la démocratie. Lorsque le Housing and Urban Development approuva<br />
le « plan de transformation », il autorisa une série de renoncements par<br />
rapport à certaines règles fédérales qui, globalement, conféraient à la<br />
municipalité une maîtrise locale relativement importante. Et qui dit maîtrise<br />
locale dit responsabilité politique locale. Cependant il n’existe que<br />
peu de mécanismes qui font jouer la responsabilité politique de la municipalité.<br />
Aucun responsable élu ne s’exprime réellement au nom des<br />
habitants de ces logements sociaux. La couverture de la presse est au
JAMIE KALVEN 137<br />
mieux sporadique. Les universitaires se montrent fort peu intéressés par<br />
la question. Les associations et institutions philanthropiques n’ont pas<br />
joué leur rôle pour expliquer en profondeur les enjeux de cette réforme<br />
à l’opinion publique.<br />
Le résultat de tout cela, c’est que les citoyens les plus marginalisés et<br />
privés du droit de vote de cette ville se trouvent confrontés à une forte<br />
concentration de forces économiques et politiques, pratiquement en<br />
l’absence de toute structure pouvant assurer une médiation. Le discours<br />
actuel sur le logement social repose sur une équation symbolique d’une<br />
grande simplicité : les tours de la direction au logement de la ville de<br />
Chicago représentent toutes sortes de maux urbains et les boules de démolition<br />
sont l’image même du « progrès ». Nous sommes là devant une<br />
politique sociale par soustraction. Une cité comme les Stateway Gardens<br />
n’est pas considérée comme une communauté complexe qui s’est développée<br />
selon ses propres voies dans un contexte de terrible abandon mais<br />
comme un « ratage » qu’il faut effacer. La rhétorique publique chante les<br />
bienfait de l’intégration mais, sur le terrain, la réalité c’est l’épuration.<br />
Plusieurs associations citoyennes ont initié des poursuites en justice<br />
contre ce plan de transformation en invoquant que le processus de relogement<br />
renforce le modèle de ségrégation dans cette ville et que les<br />
habitants contraints au relogement n’ont pas bénéficié de mesures d’accompagnement<br />
adéquates. Le rapport d’un observateur indépendant<br />
est très sévère sur le processus chaotique de relogement, l’inefficacité<br />
des aides et sur ce qu’il qualifie de manque de « franchise » de la part<br />
des services de logement de la ville. Le tribunal, comme le rapport, entérinent<br />
les grandes lignes du plan de transformation mais en critiquent<br />
l’application et soulèvent les questions incontournables sur les objectifs<br />
et les fondements de ce projet. En tant que stratégie de réponse aux besoins<br />
des occupants des logements sociaux, il s’est révélé parfaitement<br />
inefficace. En revanche, il a remarquablement réussi en tant que stratégie<br />
visant à faire disparaître les gens, les lieux et les problèmes.<br />
Dans le hall d’entrée de la Chicago Bee Branch Library, une fresque<br />
murale s’étend de part et d’autre de la porte d’entrée. Elle évoque une<br />
rue grouillante de vie à l’époque héroïque de la métropole noire. En observant<br />
de près ce tableau, on s’aperçoit qu’il représente les deux blocs<br />
d’immeubles qui font face à la bibliothèque sur State Street. Au centre<br />
du tableau se trouve la bibliothèque elle-même, un bâtiment art-déco
138<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
d’un beau vert pâle qui était alors le siège du Chicago Bee, l’un des deux<br />
journaux de la communauté afro-américaine du Chicago de l’époque.<br />
Occupant également une place prééminente dans le tableau, on trouve<br />
l’autre symbole de cette rue, l’Overton Hygienic Building, un peu plus au<br />
nord, qui abritait autrefois une entreprise de cosmétiques. Entre ces<br />
deux repères, on peut voir une boutique de cordonnier, un tailleur pour<br />
homme, une teinturerie, un bazar, un restaurant, un bar, une station de<br />
taxis, un atelier de mode, un boucher-volailler, un chapelier, un épicier et<br />
un kiosque à journaux. La rue est pleine de passants faisant leurs<br />
courses, discutant et profitant de la journée. Un camion et des hommes<br />
poussant des carrioles se tracent un chemin à travers la foule. Ce<br />
tableau, plein de couleurs et de mouvement, offre une image de la<br />
vitalité urbaine et de la convivialité du voisinage : les plaisirs de la rue.<br />
Aujourd’hui, lorsque vous sortez de la bibliothèque dans State Street,<br />
vous contemplez une scène incroyablement différente de l’animation<br />
trépidante du tableau. Du côté est de la rue, entre les rideaux de fer<br />
baissés et les terrains vagues, on trouve encore quelques petits commerces<br />
– une laverie automatique, une salle de billard, un snack et un<br />
épicier. De l’autre côté de la rue, les deux tours rescapées des Stateway<br />
Gardens – un immeuble de dix étages sur State Street et un autre de<br />
dix-sept étages sur Federal Street – se dressent, isolées, au milieu des<br />
terrains vagues créés par la destruction des bâtiments voisins.<br />
Je suis toujours époustouflé de lire des études sur tel ou tel aspect de la<br />
vie de la ville – les dynamiques familiales, l’usage de la drogue, les gangs<br />
des quartiers ou autre – dans lesquelles l’impact catastrophique de la<br />
disparition du travail n’est même pas mentionné. Avant le grand incendie<br />
de Chicago, le quartier sur lequel s’élève les tours de Stateway était<br />
le plus peuplé de la ville, le cœur de la métropole noire, « la terre promise<br />
» vers laquelle se dirigeaient les Noirs du Sud pour chercher du travail<br />
et qui en trouvaient effectivement. Un jour, j’ai entendu un membre<br />
du Congrès, Danny Davis, rappeler que, lorsqu’il était arrivé pour la première<br />
fois dans cette ville, « vous pouviez vous réveiller le matin, vous<br />
retourner dans votre lit, penser “travail”, et vous en aviez ».<br />
Aujourd’hui, le chiffre du chômage à Stateway est estimé à près de<br />
90 %. Celui-ci est certes trompeur parce qu’il ne tient pas compte de<br />
l’économie informelle qui mobilise tant de gens, une économie de la<br />
débrouille qui ne se limite pas aux dealers mais compte également des
JAMIE KALVEN 139<br />
ramasseurs d’ordures, des mécaniciens au noir, des revendeurs à la sauvette,<br />
la femme qui tresse les cheveux, celui qui vend des nachos faits à<br />
la maison, ou des entrepreneurs de rue qui refourguent des cigarettes à<br />
l’unité. Mais cela donne quand même une idée de la catastrophe qui a<br />
frappé ce quartier du South Side.<br />
Désormais la « transformation » est en marche. Les tours ghettos de<br />
logements sociaux construites dans les années 1950 et 1960 dans l’ancienne<br />
Black Belt sont en train d’être remplacées par le ghetto invisible<br />
des familles vulnérables, mal-logées mais opportunément déplacées<br />
hors de notre vue. Ce processus d’expulsion et de dispersion a été facilité<br />
par des décennies de criminalisation de lieux tels que Stateway Gardens.<br />
Des décennies d’emprisonnement généralisé pour délits non<br />
violents liés à la drogue, renforcées par la logique de punition collective<br />
qu’incarne la politique d’expulsion menée par le HUD, ont eu pour<br />
conséquence de criminaliser des communautés entières. Nous sommes<br />
conditionnés pour percevoir les habitants de ce genre d’endroits, non<br />
comme des voisins potentiels dans une ville restructurée, mais comme<br />
une population violente qui doit être déplacée avant que le terrain ne<br />
puisse être « colonisé ». C’est en décrivant les exclus comme des « criminels<br />
» plutôt que comme des « Noirs » que nous pouvons refouler la<br />
nature et les précédents de ce que nous sommes en train de faire.<br />
Replacée dans ce contexte, on peut considérer que la State Street<br />
Coverage Initiative constitue, à sa manière, un moment critique qui<br />
offre un aperçu du fonctionnement interne de la grande machine à faire<br />
disparaître. Les tours de State Street ont pratiquement toutes été rasées,<br />
mais, à quelques rues de là, dans ce paysage post-apocalyptique, des<br />
gens qui n’ont pas de place au sein de notre glorieuse renaissance urbaine<br />
continuent de se rassembler. C’est pourquoi le maire, Daley, a<br />
ordonné au chef de la police municipale de les faire disparaître. Leur<br />
crime ? Être à la fois noirs, pauvres et trop visibles.<br />
Ce n’est pas une surprise, ce plan n’a pas eu la faveur des services de<br />
police. La seule personne que j’ai pu rencontrer qui s’y soit montrée<br />
favorable était une femme affectée à la circulation qui, du moins je le<br />
subodore, n’était pas mécontente d’avoir de la compagnie dans son<br />
poste un peu isolé. Les plus anciens parmi les policiers m’ont dit qu’ils<br />
espéraient que les citoyens se plaindraient de cette opération. Un<br />
membre du service du logement social la qualifiait d’« acharnement ».
140<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
Il ne s’agit pas d’appliquer la loi mais de « faire plaisir au patron » – le<br />
maire. Un autre policier affirmait que l’opération sur State Street minait<br />
les efforts qu’il avait entrepris avec ses collègues pour construire des<br />
relations positives avec les habitants du quartier.<br />
Même si Morton Walker ne vit plus à Stateway, ce quartier reste un<br />
morceau de lui-même. Il vit plus au sud avec une femme qu’il a connue<br />
à Stateway étant enfant. Le bâtiment dans lequel il vivait – au 3517<br />
South Federal Street – a été rasé l’an dernier mais son identité reste<br />
enracinée à Stateway.<br />
« Nous avons le sens du territoire, me dit-il. Je reviens chez les gens que<br />
je connais. Les vieux amis. C’est chez moi. »<br />
Je me demande ce que le maire Daley verrait, si passant par là dans sa<br />
limousine, il apercevait Morton discutant avec un ami en face de la Bee<br />
Branch Library ? Verrait-il le citoyen de cette ville faite de vrais quartiers<br />
– l’habitant de Chicago passionnément attaché à ses racines ? Verrait-il<br />
l’usager fidèle du réseau des bibliothèques publiques de Chicago ?<br />
« C’est déchirant, me disait Morton après son arrestation. J’ai arpenté<br />
ces rues pendant quarante ans. Et maintenant voilà ce qu’il m’arrive. Je<br />
ne peux même plus me défendre en disant que je suis du quartier. Alors<br />
quoi ? Avec tout qui s’écroule, je crois même que c’est dangereux de<br />
revenir dans le coin. »<br />
Une semaine et demie après l’arrestation de Morton, Pete Haywood se<br />
trouvait dans State Street près des locaux administratifs de Stateways.<br />
Pete, qui habite Stateway depuis toujours, est également membre du<br />
conseil des locataires et a récemment été engagé pour travailler dans les<br />
services de propreté du quartier. Une voiture de police, avec à son bord<br />
trois policiers blancs, s’est dirigée vers lui. « Qu’est-ce que tu fais là à<br />
rien faire ? » lui a demandé l’un des agents. Mais avant que Pete ne<br />
puisse ouvrir la bouche, le policier a ajouté : « T’es pas au courant ? On<br />
n’est plus dans les trucs sociaux, à Chicago. C’est une terre blanche ici,<br />
maintenant. Tu peux pas rester là. »<br />
JAMIE KALVEN, 2003
DANIEL RAEBURN 141<br />
In memoriam Henry Louis Mencken<br />
Henry Louis Mencken fut le plus grand journaliste américain du XX e<br />
siècle, et peut-être le meilleur écrivain de langue anglo-américaine de<br />
tous les temps. C’était aussi un trou du cul et c’est pour cette dernière<br />
particularité qu’il se rappelle à notre souvenir, du moins pour ceux qui<br />
ne l’ont pas complètement oublié. Évoquez le nom de Mencken devant<br />
une personne un tant soit peu cultivée et il y a des chances que lui revienne,<br />
si elle ose l’avouer, un des aphorismes caustiques de feu notre<br />
libertarien – définition du misogyne : « Un homme qui déteste les<br />
femmes autant qu’elles se haïssent entre elles. » Demandez à n’importe<br />
quel candidat à l’université qui était HLM et vous obtiendrez le minimum<br />
académique requis : Mencken était un vieil homophobe, raciste,<br />
sexiste et antisémite. Et à la vérité, c’est bien ce qu’il était. Mais curieusement,<br />
une minorité d’écrivains persistent à lire ce fils de pute envers<br />
et contre tout. Pire encore, certains de ces écrivains sont de gauche.<br />
Tenez, moi par exemple, et prenez cette revue : le « B » suspendu du logo<br />
du Baffler est pompé sur le double « S » du logo du Smart Set, le magazine<br />
décadent grâce auquel Mencken fit les délices des milieux littéraires<br />
branchés entre 1913 et 1919 ; et les standards typographiques de<br />
cette page du Baffler ont été piqués à l’American Mercury, la vénérable<br />
revue co-fondée par Mencken, depuis laquelle il théorisa toute la décennie<br />
suivante et, par conséquent, définit toute la littérature et la critique<br />
littéraire américaines jusqu’à nos jours. Je plaide coupable dans la mesure<br />
où je suis le maquettiste qui a pompé jusqu’à la dernière couture. Ceux<br />
qui sont bluffés [baffled] par notre admiration pour un conservateur<br />
doivent se rappeler comment Walter Lippman décrivait l’influence de<br />
Mencken : « Il vous traite de pourceau et d’imbécile et ce faisant stimule<br />
votre envie de vivre. » HLM est notre stimulant le plus tonique.<br />
Une gorgée de ce venin faisait du bien là où ça faisait mal dans<br />
l’Amérique des années 1920, quand Mencken chargea à mains nues
DANIEL RAEBURN 143<br />
et remporta une guerre contre les gnan-gnan qui régnaient alors sur<br />
la littérature nationale. Par la force de ses railleries, Mencken déboulonna<br />
les puritains pour les remplacer par une clique plus terre à terre<br />
qui comptait notamment Theodore Dreiser, Willa Carther et Sinclair<br />
Lewis. Ce faisant, il balisait un chemin qui a été suivi depuis par tous<br />
les naturalistes et réalistes américains. Au passage, Mencken a aussi<br />
contribué à dissoudre la prohibition dans le ridicule, récoltant à titre<br />
personnel les hourras des piliers de bar du monde entier. Cette mission<br />
accomplie, Mencken retourna ses flingues vers la politique, où il<br />
avait décelé une autre forme de menace patricienne contre notre<br />
tempérament national.<br />
Mencken entama sa guerre contre Franklin D. Roosevelt en recourant<br />
sensiblement à la même stratégie qu’auparavant. Il décréta qu’en matière<br />
d’économie, comme de littérature, toute tentative d’élever les<br />
masses n’était que fumisterie. Pour Mencken, le New Deal ressemblait<br />
à un livre trop plein de lyrisme : condescendant, oppressif, irréaliste et<br />
contre nature. Mieux valait ne pas réveiller le chat qui dort, laisser le taux<br />
de chômage en l’état, et ne pas toucher, particulièrement, à sa feuille<br />
d’impôts. Évidemment, Mencken n’y alla pas sans panache ni fioritures.<br />
Il travestit son absence de compassion en sens commun et la fit résonner<br />
sur tous les toits. Cependant, ce coup-ci, les troupes de HLM ne le<br />
suivirent pas à l’assaut, sans doute parce qu’elles étaient à la soupe<br />
populaire. Sa popularité s’effondra au point que les rieurs parlèrent de<br />
« feu H. L. Mencken ». Sa mort véritable et la publication de son journal,<br />
indigeste, qui suivit, ne sont pas parvenues à redorer son blason. De<br />
nos jours, en règle générale, les arbitres académiques de la mémoire<br />
culturelle ne veulent rien avoir à faire avec notre homme. Après une ou<br />
deux décennies sur le ring, la réputation de Mencken comme iconoclaste<br />
est au tapis et on a déjà compté jusqu’à huit, bientôt neuf. Mais<br />
avant de prononcer le knock-out de feu HLM, il y a au moins une scène<br />
que nous devons nous repasser comme un flash.<br />
En 1927, un journal de Memphis publia un éditorial dénonçant Mencken.<br />
Jusqu’ici, rien d’exceptionnel : les attaques des éditorialistes contre HLM<br />
étaient si fréquentes qu’en 1928 le Palm Beach News le proclama<br />
« l’homme le plus haï des États-Unis ». C’est du Sud qu’émanait la plus<br />
forte détestation, en grande partie à cause de « The Sahara of the<br />
Bozart », célébre article de 1920 dans lequel Mencken jugeait du niveau
144<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
culturel atteint par leur adoré Dixie 1 : « Ici, un poète est presque aussi<br />
rare qu’un joueur de hautbois, un graveur de métal à la pointe sèche ou<br />
un métaphysicien. En fait, contempler une telle vacuité donne le vertige.<br />
On pense aux espaces interstellaires, à la colossale immensité de cet<br />
éther dont on sait aujourd’hui que c’est un mythe. Presque la totalité de<br />
l’Europe pourrait se couler dans cette région démesurée de fermes<br />
branlantes, de villes de seconde main et d’encéphales figés : on y mettrait<br />
la France, l’Allemagne et l’Italie qu’il resterait encore de la place<br />
pour les îles britanniques. Et pourtant, malgré toute cette place, toute<br />
cette richesse et tous ces “progrès” dont on se gargarise là-bas, c’est<br />
aussi stérile, artistiquement, intellectuellement, culturellement, que le<br />
désert du Sahara. »<br />
La seule raison pour laquelle nous évoquons cette défense du Sud<br />
outragé par le journal de Memphis, c’est qu’il advint qu’un adolescent<br />
pauvre du nom de Richard Wright le lut. Wright n’avait jamais entendu<br />
parler de Mencken auparavant, mais il se dit que si les ploucs blancs du<br />
Sud détestaient autant notre homme, il ne pouvait pas être totalement<br />
mauvais. Wright n’avait pas le droit d’utiliser la bibliothèque de Memphis,<br />
mais il « emprunta » une carte valide et se fabriqua la recommandation<br />
suivante qu’il fit passer le plus tranquillement du monde de<br />
l’autre côté du comptoir à une bibliothécaire soupçonneuse : « Chère<br />
madame, pourriez-vous laisser ce jeune nègre accéder à quelques livres<br />
de H. L. Mencken ? »<br />
Pour le plus grand bénéfice des lettres américaines, la mégère voulut<br />
bien y consentir et prêta à Wright A Book of Prefaces – un mot que<br />
Wright ne savait même pas prononcer – de même qu’un exemplaire de<br />
Prejudices [préjugés]. (Des années plus tard, Wright assura, pince-sansrire<br />
: « Je savais ce que ce mot voulait dire. ») De retour dans sa chambre<br />
de location, Wright ouvrit Prejudices. « J’étais retourné et impressionné<br />
par le style, les phrases claires, nettes, polies, raconta-t-il. Pourquoi écrivait-il<br />
comme ça ? Et comment écrivait-on comme ça ? J’imaginais cet<br />
homme comme un démon fulminant, ferraillant avec sa plume… dénonçant<br />
tout ce qui était américain… riant… raillant Dieu, l’autorité…<br />
Cet homme combattait, combattait avec des mots. Il usait des mots<br />
comme arme, comme on le ferait d’une massue… Je continuai dans ma<br />
1. Nom donné aux États du Sud dans la chanson Dixie de Daniel Emmett (1859). [ndt]
DANIEL RAEBURN 145<br />
lecture et ce qui me sidérait le plus n’était pas tant ce qu’il disait mais<br />
qu’il pût exister sur terre quelqu’un ayant le courage de le dire. » C’est<br />
à ce moment, dit Wright, que je suis né en tant qu’écrivain.<br />
Trente ans plus tard, quand Wright publia Native son, il fut mis à l’index<br />
par les bibliothécaires dans tout le Sud. Lorsque Wright publia son autobiographie,<br />
Black Boy, le Sénat des États-Unis adopta une résolution le<br />
déclarant obscène. De nos jours, si vous vous rendez à la Enoch Pratt<br />
Free Library de Baltimore et feuilletez à la page 217 l’exemplaire personnel<br />
de Mencken de Black Boy, vous pouvez lire les citations qui précèdent,<br />
soulignées de son trait si caractéristique.<br />
La condamnation des censeurs et des membres du Ku Klux Klan était<br />
peut-être la seule opinion qu’eûssent en commun les socialistes noirs et<br />
les conservateurs blancs. Mencken affirma toujours qu’il était allemand,<br />
pas américain, prenant un malin plaisir à regretter d’être né dans ce<br />
pays étranger. Ses railleries les plus célèbres visaient le « un pour cent<br />
d’Américains » et je n’ai sans doute pas besoin de rappeler ses meilleurs<br />
traits contre le règne des couillons [booboisie]. Mais je ne peux pas résister.<br />
Cette salve ouvre le troisième épisode de ses Prejudices : « Me<br />
voici, la foi inébranlable, à jamais optimiste, un Américano loyal et dévoué,<br />
voire chauvin, payant ses impôts sans rechigner, obéissant à<br />
toutes les lois dans la mesure où la physiologie le permet… évitant tout<br />
commerce avec ceux qui ont juré de renverser le gouvernement… Me<br />
voici, transporté voire béat, jubilant derrière la bannière étoilée, un bien<br />
meilleur citoyen, je dois dire, et en tous cas certainement moins persifleur<br />
et revendicateur que des milliers de geignards. Plaçant Warren<br />
Gamaliel Harding 2 à côté de Friederich Barbarossa et de Charlemagne,<br />
considérant que l’esprit saint inspire directement la Cour suprême,<br />
membre ardent de tout Rotary club, Ku Klux Klan et ligue anti-saloon,<br />
asphyxié d’émotion lorsque l’orchestre entonne The Star Spangled<br />
Banner [l’hymne national] et croyant avec la foi du charbonnier que l’un<br />
de Nos Fils, pris au hasard, pourrait défaire à la loyale dix Anglais, vingt<br />
Allemands, trente grenouilles, quarante ritals, cinquante japs ou une<br />
centaine de bolchéviques. »<br />
2.Président (républicain) des États-Unis de 1921 à 1923 (décédé pendant son mandat<br />
d’une crise cardiaque). Notamment connu pour avoir déclaré en 1923 : « Nous avons<br />
besoin de “moins de gouvernement dans le business et de plus de business dans le<br />
gouvernement”. » [ndt]
146<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
Qu’on m’excuse de souligner cette ironie. De nos jours, un auteur aussi<br />
intrépidement sarcastique serait tout sauf un conservateur. Ce qui fait<br />
de Mencken un traître remarquable, son humour mis à part, c’est qu’il<br />
fut non seulement non-américain mais anti-américain ; ce qui, au risque<br />
d’être trop parfait, l’a rendu complètement américain. Mencken n’a jamais<br />
voulu se définir comme un dissident. Il n’a jamais voulu être un héros<br />
aux yeux de la gauche ou de la droite. S’il donna le ton d’une ironie<br />
littéraire féroce, c’est que ses voisins et son gouvernement ne lui laissèrent<br />
pas le choix. Il écrivit les mots rapportés ci-dessus, extraits de « On<br />
Being an American », après la Première Guerre mondiale, durant<br />
laquelle nous avons traité les Germano-Américains comme lui d’une<br />
façon aussi honteuse qu’aujourd’hui les Arabo-Américains.<br />
Fred Hobson s’inspire de la salve ci-dessus pour définir Mencken – à la<br />
dernière page de son pavé qui en compte 650, Mencken, a Life (1994)<br />
– comme « notre Whitman 3 , version langue de pute » [our nay-saying<br />
Whitman]. La conclusion peu orthodoxe de Hobson est séduisante. Le<br />
style emporté du jeune Mencken doit clairement son rythme galopant à<br />
Whitman, même si Mencken relève sa prose avec une bonne dose de<br />
Ring Lardner 4 et en fait beaucoup pour ressembler à son idole, Mark<br />
Twain. Ce qui donne de l’éclat à la comparaison de Hobson est sa<br />
manière de confirmer le préjugé de Mencken, à savoir son homophobie<br />
bien connue, en même temps qu’il souligne son admiration pour ce bon<br />
vieux Walt. Mencken a affirmé que Whitman était « le plus grand poète<br />
que l’Amérique ait jamais produit », mais il doit sans aucun doute<br />
s’arracher les cheveux d’être fait l’égal du sensualiste chevelu.<br />
Hélas, le lecteur ne peut que regretter que Hobson n’ait pas creusé<br />
d’autres filons de ce type. Œil pour œil, Hobson a tout à fait le droit de<br />
lancer des piques à Mencken, puisque ce dernier a passé sa vie à couvrir<br />
de goudron et de plumes des types comme lui – « dans [son] cas,<br />
un sudiste, professeur de littérature, démocrate et admirateur de<br />
Franklin D. Roosevelt », précise lui-même Hobson. HLM n’aurait en effet<br />
3. Poète américain, Walt Whitman (1819-1892) est notamment l’auteur du recueil<br />
Leaves of Grass (Feuilles d'herbe, Gallimard). [ndt]<br />
4. Ring Lardner, nouvelliste satirique américain (1885-1933) ; on peut lire en français<br />
Champion (10/18). [ndt]
DANIEL RAEBURN 147<br />
pu consacrer plus de fiel qu’à un fan de Mary Baker Eddy 5 ou Carry<br />
Nation 6 . C’est ce venin dont Hobson tente de se saisir comme d’un<br />
chardon à pleines mains. « Ce n’est pas tant la pensée de Mencken qui<br />
m’intéresse dans cette biographie, écrit-il ; mais plutôt […] ce que<br />
Mencken appelait lui-même ses “préjugés” [prejudices] et le rôle qu’ils<br />
ont joués dans sa vie. » S’en suivent des centaines de pages qui constituent,<br />
considéré le corpus constitutif des préjugés d’HLM, une synthèse<br />
admirable de concision.<br />
Mencken ne croyait pas en l’égalité entre qui que ce soit ni à la démocratie<br />
du tout. En 1920, il avait défini cette dernière comme « la théorie<br />
selon laquelle les gens ordinaires savent ce qu’ils veulent mais<br />
considèrent que cela ne vaut pas l’effort pour l’obtenir vraiment ».<br />
Trente-six ans plus tard, à la fin de sa carrière, il la décrivait comme un<br />
jeu dans lequel « chaque parti dépense l’essentiel de son énergie à essayer<br />
de prouver que l’autre est inapte au gouvernement, les deux y parvenant<br />
en général, à juste titre ». De nos jours, alors que notre vie<br />
politique est réduite à un système de deux partis à peu près impossibles<br />
à différencier, que notre libre marché est une oligopole, que le vaincu<br />
des élections est proclamé président par les juges, le cynisme de<br />
Mencken frappe juste, il est même comme chez lui.<br />
En lieu et place de la démocratie, Mencken préconisait une sorte<br />
d’aristocratie nietzschéenne – le gouvernement des franches élites –<br />
tout en considérant l’allégeance aux libertés individuelles comme un<br />
garde-fou. Ce brouet de « liberté » antidémocratique et anti-égalitariste<br />
peut paraître familier. En tous cas, il devrait. Branchez-vous sur<br />
Internet, ouvrez votre journal local, écoutez votre patron : aujourd’hui,<br />
nous sommes cernés par ce genre de « liberté ». Elle dirige notre<br />
économie et nos vies.<br />
En ces temps où le laissez-faire est de retour, on peut entendre des thuriféraires<br />
de l’ordre conservateur triomphant entonner un hymne à HLM.<br />
Écoutons Terry Teachout, auteur de The Second Mencken Cresthomathy<br />
5. Fondatrice de Christian Science, Mary Baker Eddy (1821-1910) professait que toute<br />
maladie peut être soignée par des pratiques religieuses. [ndt]<br />
6. Entre 1900 et 1910, la fameuse Carry Nation fut arrêtée plus de trente fois pour<br />
son activisme en faveur de la prohibition de l’alcool, qui s’exprimait à l’aide de pierres,<br />
marteaux et haches pour détruire les saloons. [ndt]
148<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
(« seconde anthologie de Mencken ») et collaborateur régulier de la<br />
National Review et de Commentary. Dans la préface de la biographie<br />
qu’il lui consacre, au demeurant assez mince, The Skeptic (2002), il écrit :<br />
« Les temps ont bien changé : les conceptions politiques et sociales de<br />
Mencken, qui ont pu longtemps paraître définitivement dépassées,<br />
connaissent une résurgence dans la pensée américaine. Qu’on s’en<br />
réjouisse ou non, la Weltanschauung [vision du monde] de Mencken est<br />
de nouveau une force avec laquelle il faut compter et écrire. »<br />
Mais que tout rebelle conservateur ou boursicoteur à la petite semaine<br />
rêvant à longueur de journée que HLM revienne pour l’aider à démasquer<br />
les syndicats et à dénoncer les protocoles des sages de Veblen 7 se<br />
le tienne pour dit : il ferait mieux de troquer sa pipe à rêves bon marché<br />
contre une bonne bouffée bien asphyxiante tirée au narguilé de la réalité.<br />
Comme l’a dit un jour Gore Vidal, « un auteur aussi direct et sans<br />
concessions ne pourrait pas écrire dans les médias dominants d’aujourd’hui<br />
; et ceux qui disent désirer son retour seraient les premiers à le censurer<br />
et à le mettre au ban ». Si Mencken s’aventurait sur la scène<br />
aujourd’hui, les premières têtes qu’il réclamerait seraient celles des économistes<br />
vaudous, des agents de change les plus starifiés et des potentats<br />
survoltés du profit qui sont occupés à ruiner les finances publiques,<br />
à détruire nos libertés civiles, et plus généralement à nous mener en bateau.<br />
À l’image de tous ceux qui disposaient d’un quart de cortex en<br />
état de marche, Mencken savait que le capitalisme et la démocratie ont<br />
toujours été à couteaux tirés.<br />
Certes, Mencken préconisait de bazarder la démocratie, mais cela n’en<br />
fait pas un héraut des partisans du marché. Non monsieur ! « L’Américain<br />
moyen d’aujourd’hui […] est mené par des gens chargés de le faire applaudir,<br />
des agents de presse, des trafiquants du langage, des moralistes<br />
[cheer leaders, press agents, word-mongers, uplifters]. […] Il s’est laissé<br />
7. Économiste de gauche, Thorstein Veblen (1857-1929) est notamment l’auteur de<br />
Theory of the Leisure Class (1899). Il estimait qu’un conflit de classes central existait<br />
entre les affaires (banquiers, avocats, agents de change, managers) et l’industrie (ingénieurs,<br />
techniciens, ouvriers), autrement dit entre ceux qui font de l’argent – et le<br />
dépensent – et ceux qui produisent des biens. De nos jours, les néo-conservateurs<br />
tendent à croire que les gens de gauche participent d’une conspiration menée par<br />
ceux qu’ils appellent « l’élite libérale », imaginant qu’il existe un plan secret pour tout<br />
contrôler, d’où les « protocoles des sages de Veblen ». [ndt, avec Thomas Frank]
DANIEL RAEBURN 149<br />
vendre la dernière guerre avec des méthodes de commissaire-priseur de<br />
bastringue. […] C’est un esclave docile du capitalisme, et toujours prêt<br />
pour aider à mettre à genoux les copains qui se révoltent. Mais cette immense<br />
faiblesse, cette incroyable crédulité et cette indigence d’esprit<br />
pourraient bien, dans un futur qui n’a rien d’irréaliste, en faire un rebelle<br />
d’une espèce particulièrement démente, et la république se retrouver assaillie<br />
par des problèmes aussi incommensurables que ceux qui menacent<br />
de l’extérieur. [… Il] est toujours content de travailler pour le<br />
capitalisme, qui sait le récompenser conformément à son goût. Il est cet<br />
homme d’État éloquent, cet éditorialiste patriote, la source de toute inspiration,<br />
la vache à lait de l’optimisme qui rue. Il devient meneur de<br />
foules, gouverneur, sénateur, président. »<br />
*<br />
* *<br />
Selon moi, aucune de ces biographies n’arrive à la hauteur de notre<br />
homme. Bien que le livre de Hobson soit celui que j’emmènerais sur une<br />
île déserte, c’est sans doute la seule circonstance dans laquelle je pourrais<br />
le relire. Il est pourtant riche et ouvre même des perspectives intéressantes,<br />
mais il est écrit dans une prose laborieuse. Quant au livre de<br />
Teachout, je le conseillerais aux novices. C’est professionnel avec tout ce<br />
que cela implique de superficiel, une tendance à glisser à la surface des<br />
mots et des événements, à éluder les problèmes trop embrouillés, à commencer<br />
par la question la plus épineuse de toutes, j’ai nommé : pourquoi<br />
Mencken était-il un vieil homophobe antisémite, sexiste et raciste ?<br />
Pour être juste, toute personne qui écrit sur Mencken est mise au défi,<br />
et cela vaut tout autant pour moi. D’abord à cause de son style à la fois<br />
relevé et irréprochable, qui rend insipide en comparaison la prose de son<br />
commentateur. Mais le nœud du problème, c’est Mencken lui-même.<br />
Hobson souligne au début de son étude que « ce qu’il y a de plus intriguant<br />
chez Mencken c’est le nombre de ses paradoxes ». Teachout,<br />
quant à lui, annonce gaillardement que « son assurance est une illusion<br />
produite par le panache de sa prose. […] Ce qui lui donne une telle<br />
force n’est pour partie qu’une série de pas de deux liés à l’ambiguïté ».<br />
Des paradoxes, oui, mais de l’ambiguïté, non.<br />
Mencken était un paradoxe vivant, pervers jusqu’à l’hypocrisie. Ce pessimiste<br />
un peu dingue dénigrait la démocratie mais en a fait son miel
150<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
durant quarante ans. (« C’est la seule forme de gouvernement vraiment<br />
divertissante que le genre humain ait connue », concéda-t-il.) Ce libertin<br />
d’un genre unique se gaussait lourdement de la « booboisie » –<br />
peut-être parce qu’il a mené une vie dans le genre victorien et est mort<br />
dans le pavillon de classe moyenne où il est né ; « un petit garçon dans<br />
les jupes de sa mère », persifle Teachout. Mencken fulminait contre tous<br />
les réformateurs sociaux [humanitarians] et les membres de la secte<br />
compassionnelle [members of The Uplist] parce qu’il croyait que seules<br />
la science et la médecine élèveraient le genre humain, et non la justice<br />
et l’égalité, croyance naïve à laquelle il s’est accroché malgré deux<br />
guerres mondiales et l’avènement de l’ère atomique.<br />
Rétrospectivement, même les préjugés de Mencken étaient du flan. Une<br />
théorie commune veut qu’un sale type s’élève par l’écriture, qu’il soit<br />
meilleur comme artiste que lorsqu’il est trivialement humain. Pas dans le<br />
cas de Mencken. Grosso modo, dans ses écrits c’était un ogre, même si<br />
c’était le plus éloquent des ogres. Mais dans la vie, Henry Mencken se<br />
comportait avec une humanité et une générosité qui ne cadre pas avec<br />
son personnage de HLM. Tout en mitraillant de centaines d’insanités<br />
ceux qu’il appelait dans ses bons jours les Afro-Américains et en incitant<br />
à l’eugénisme, il publia plus d’écrivains noirs qu’aucun autre éditeur<br />
blanc de son temps. À la vérité, au cours de ses six dernières années à la<br />
tête de l’American Mercury, il publia plus de textes du journaliste noir<br />
George Schuyler que de tout autre auteur, blanc ou noir. Alors que prenait<br />
de l’ampleur sa réputation de célibataire et de misogyne indécrottable,<br />
il luttait contre l’expulsion d’Emma Goldman et payait ses frais<br />
d’hospitalisation. Et s’il faut parler de son antisémitisme, oui, il y a de<br />
l’antisémitisme. Et pourtant ses meilleurs amis…<br />
À la racine de tous ces paradoxes, il y a la classe sociale, l’épouvantail<br />
américain le plus refoulé, le préjugé fondamental qui fit écrire Mencken<br />
comme un raciste, un sexiste, un antisémite alors même qu’il pourfendait<br />
les bigots de son temps. C’est Hobson qui est parvenu à capturer<br />
ce démon et, ce faisant, il a décroché le pompon. Non qu’il soit nécessaire<br />
d’être un génie pour voir dans la classe sociale l’obsession numéro<br />
un de Mencken. Il avait écrit dans le National Letters que « le défaut majeur<br />
dans la culture de ce pays est l’absence d’une aristocratie policée,<br />
dont la position sociale soit sécurisée, animée par l’esprit et la curiosité,<br />
méfiante à l’égard de toutes les généralisations faciles, émancipée de la
DANIEL RAEBURN 151<br />
sentimentalité du vulgaire, menant avec délices la bataille des idées<br />
pour les idées. Le mot d’aristocratie que j’emploie charrie en lui-même,<br />
malgré l’adjectif “policée”, des significations que je n’endosse, évidemment,<br />
en aucun cas. Tout usage de ce mot devant un public nourri de<br />
trémolos démocratiques évoque inexorablement des images de femmes<br />
d’agents de change affalées avec obscénité dans des loges d’opéra,<br />
d’Anglais hautains massacrant des générations de lagopèdes de façon<br />
désordonnée et incompréhensible, ou de faux nobles usant de leur<br />
charme auprès des petites filles au profit des marchands de petitsdéjeuners<br />
et des rois de la baignoire. Cette confusion appartient à la<br />
tradition américaine. On mesure à quel point elle est profondément<br />
incrustée et répandue quand on peut constater quotidiennement que la<br />
prétendue élite chic qui peuple les grandes villes – en majorité de riches<br />
industriels parvenus au stade culturel de la décoration d’intérieur et du<br />
country-club – passe pour une aristocratie ».<br />
Quand on lit ça, et sachant que Teachout l’a lu et a souligné d’autres<br />
passages de la même veine (et tout aussi judicieux), on se demande<br />
comment l’appartenance de classe a pu échapper à sa recension musclée<br />
des autres travers de Mencken. Peut-être était-il tout simplement<br />
trop occupé à stipendier Mencken pour d’autres manquements au bon<br />
goût pour voir le snobisme qui s’exposait sous son nez. À moins que ce<br />
fut une stratégie de Teachout que de minorer la condescendance de<br />
Mencken qui entre en contradiction avec cette fiction de droite selon laquelle<br />
il était du côté du Volk véritable. Quoi qu’il en soit, Teachout a<br />
laissé passer sa chance d’éclaircir toutes ces savoureuses ambiguïtés.<br />
C’est l’appartenance de classe – qui doit s’entendre au sens de la singulière<br />
notion d’« aristocratie intellectuelle » avancée par Mencken – qui<br />
explique ses contradictions apparentes. C’est à cause de cette appartenance<br />
qu’il déchaînait consciemment les foudres de ses parvenus de voisins<br />
en invitant à dîner des écrivains noirs cultivés. C’est elle encore qui<br />
est à l’origine des noms, tels que « blackamoors », « coons » et « darkies<br />
» [péjoratifs désignant les Noirs, ndt], dont il affublait les pauvres<br />
gens de son voisinage. Dans les deux cas, ils les jugeait inférieurs, mais<br />
pour des raisons différentes. C’est l’appartenance de classe qui lui fit publier<br />
en 1938 un éditorial appelant à ouvrir les frontières sans restriction<br />
aux Juifs allemands cultivés – « un groupe incontestablement<br />
supérieur » – et préconisant avec mépris que les Juifs du lumpen de<br />
Pologne et de Roumanie soient envoyés en Russie. C’est elle toujours qui
152<br />
POINTS DE VUE AMÉRICAINS (II)<br />
le poussait à caricaturer les habitants du Middle-West (« Les Scandinaves<br />
sont des tas d’os dépourvus de cerveaux« ), ceux du Sud (« oakies, têtes<br />
de coton, hill-billies et autres anthropoïdes »), les Yankees (« vieilles bobonnes,<br />
mâles et femelles ») , sans oublier le « scrabbling babbittry », la<br />
classe moyenne conformiste qui s’agite en tous sens. On la trouve aussi<br />
au principe de la haine de Mencken pour Franklin D. Roosevelt. Mencken<br />
avait voté pour l’aristocrate démocrate en 19<strong>32</strong> – FDR est un « gentleman<br />
», avait-il écrit –, mais il l’a pourfendu avec férocité dès que celuici<br />
afficha un autre type de noblesse 8 en initiant le New Deal.<br />
On trouve encore l’appartenance de classe au fondement du conflit de<br />
HLM avec la démocratie. Mencken croyait que la démocratie reposait<br />
sur la concupiscence, la volonté irrépressible du pauvre de mettre la<br />
main sur le portefeuille du bourgeois travaillant dur. Cette absurdité n’a<br />
pas besoin d’être réfutée. Mais l’analyse de Mencken du mécanisme<br />
par lequel la démocratie s’affadit elle-même mérite d’être entendue.<br />
Donc, ouvrez bien vos oreilles : « La démocratie invente en fait sans<br />
cesse de nouvelles distinctions de classe bien qu’en théorie elle les abhorre.<br />
[…] Il y a une forme d’investissement humain avec lequel<br />
l’homme démocratique est en phase… et c’est l’argent. En conséquence,<br />
la ploutocratie, dans un État démocratique, tend inéluctablement,<br />
bien que ce soit théoriquement une infamie, à occuper la place<br />
d’une aristocratie qui fait défaut, et même à être confondue avec elle.<br />
Alors qu’il s’agit, évidemment, de tout autre chose. L’aristocratie dont<br />
il est question ne prête pas d’argent à l’État. Elle n’a pas de charges<br />
publiques. Elle n’est pas héréditaire. »<br />
Remplacez « ploutocratie » par « monde des affaires » et vous entendrez<br />
sonner l’accord juste au milieu de la cacophonie d’absurdités<br />
orchestrées par Mencken. En termes plus simples, la démocratie sombre<br />
quand elle met l’affairisme au-dessus de l’intelligence.<br />
Malheureusement, cet avertissement passera largement au-dessus d’un<br />
conservateur d’aujourd’hui, qui se monte complètement la tête à propos<br />
d’un maléfice libéral qui ensorcellerait nos écoles, nos rédactions et<br />
notre culture. Mais les conservateurs doivent savoir que Mencken détestait<br />
les milieux d’affaires – il les haïssait – encore plus que ses ennemis<br />
officiels. Laissons à Mencken le soin de dissiper toute ambiguïté. Contre<br />
8. En français dans le texte.
DANIEL RAEBURN 153<br />
les businessmen des années 1920, il rugissait : « De tels pourceaux furent,<br />
et sont toujours, mes ennemis à un degré même supérieur aux communistes,<br />
non seulement parce qu’ils ont consacré leur vie à me dévaliser<br />
mais parce que leur gloutonnerie sans limite a provoqué la révolte de la<br />
booboisie, laquelle menace de me ruiner encore plus sûrement. »<br />
Teachout reconnaît que HLM était un apostat du marché, mais pour<br />
ajouter, sans doute à court d’arguments, qu’« il préférait [les businessmen]<br />
aux politiciens ». Si on tient compte des sentiments de Mencken<br />
à l’égard des deux catégories, cela revient plus ou moins à dire que si<br />
Mencken avait eu le choix entre la corde et la chaise électrique, il aurait<br />
opté pour la première. La distinction établie par Teachout est de<br />
toutes façons spécieuse à une époque où notre exécutif porte si bien<br />
son nom 9 , nos politiciens étant des hommes d’affaires et nos hommes<br />
d’affaires des politiciens. Et à qui devons-nous cette foire d’empoigne ?<br />
Aux libertariens : ceux-là mêmes qui prétendent s’inscrire dans le<br />
prolongement de HLM.<br />
Nous n’avons pas besoin de nous perdre en conjectures sur ce que HLM<br />
aurait dit sur l’état de notre démocratie sous la direction de l’actuel chef<br />
de l’exécutif [George Walker Bush, ndt]. Il l’a déjà fait voici trois quarts<br />
de siècle. Et son fiel reste venimeux : « Nul ne peut objectivement observer<br />
[la démocratie] sans être frappé par son curieux manque de<br />
confiance en elle-même, sa tendance apparemment irrépressible à abandonner<br />
la philosophie qui la fonde au premier signe de crise. Je n’ai pas<br />
besoin d’insister sur ce qui se produit invariablement dans les états démocratiques<br />
quand la sécurité nationale est menacée. En de semblables<br />
circonstances, les plus grands tribuns de la démocratie se convertissent,<br />
aussi simplement qu’on reprend son souffle, en despotes d’une férocité<br />
presque mythologique. Mais cette caractéristique n’est pas limitée aux<br />
périodes d’angoisse et de terreur : elle est permanente. La démocratie<br />
donne toujours l’impression d’être condamnée à assassiner ce qu’en<br />
théorie elle chérit. »<br />
DANIEL RAEBURN, 2003<br />
9. Jeu de mot intraduisible entre « executive branch », le pouvoir exécutif, et<br />
« executives », les hommes d'affaires. [ndt]
UNE NATION D’AGENTS INDÉPENDANTS<br />
L’avenir : travailler pour soi<br />
“Qui aurait cru qu’une<br />
puce électronique vous<br />
permettrait de mieux<br />
négocier les virages,<br />
d’éviter les embouteillages<br />
et, par-dessus tout,<br />
de vous passer de Earl<br />
pour les réparations ?”
THOMAS FRANK<br />
Le populisme de marché<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 155-175<br />
155<br />
LES EUROPÉENS ont tendance à considérer les États-Unis comme une<br />
sorte de machine à fabriquer du rêve. Vous ne connaissez pas nos<br />
voitures. Vous ne savez pas à quoi ressemblent nos fermes et<br />
lorsque vous venez chez nous vous n’allez jamais à Detroit ou à Kansas<br />
City. En revanche, vous regardez nos films, vous écoutez notre musique<br />
et vous portez nos logos sur vos vêtements. C’est sans doute pour cela<br />
que vous pensez qu’il s’agit là de l’essentiel de la production américaine :<br />
des rêves, des hallucinations. Et vous avez raison.<br />
Pourtant, la plus grande hallucination produite en Amérique, ce n’est<br />
pas le glamour hollywoodien. Non, c’est le populisme. L’Amérique fantasme<br />
complètement les conflits sociaux, la guerre de classes, le petit<br />
peuple se dressant contre ses ennemis. Depuis quarante ans nous<br />
sommes continuellement sommés de nous enrôler dans telle ou telle<br />
croisade contre les « élites ». De nous révolter contre les snobs, les millionnaires<br />
et diplômés prétentieux de Harvard qui affectionnent tant les<br />
théories littéraires françaises et passent leur temps à déconstruire tout ce<br />
qui peut leur tomber sous la main. Mais, malgré cette comédie longue de<br />
trente ans, les États-Unis pratiquent aujourd’hui la répartition des<br />
richesses la moins démocratique de tous les pays occidentaux. Et cela<br />
s’aggrave chaque année.
156<br />
DU FANTASME À LA RÉALITÉ<br />
LE POPULISME DE MARCHÉ<br />
Penchons nous d’abord sur le fait le plus fondamental, le plus violent<br />
aussi, qui caractérise mon pays. Le grand boom économique des années<br />
1990 est supposé avoir donné naissance à une « Nouvelle Économie »,<br />
une utopie high-tech, et être à l’origine de la plus grande période de prospérité<br />
de l’histoire du monde. Pourtant, pendant ces glorieuses années, le<br />
fossé social n’a cessé de s’élargir aux États-Unis. Pendant les années 1990,<br />
les salaires de la plupart des travailleurs américains ont soit diminué, soit<br />
suivi à grand peine le niveau de l’inflation. En revanche, ce fut pour les<br />
patrons une période véritablement mirifique. Selon Business Week, les<br />
dirigeants d’entreprises américains ont gagné, au cours de l’année 2000,<br />
5<strong>31</strong> fois plus que leurs ouvriers. Alors qu’en 1990 ce chiffre était de 85<br />
fois plus et « seulement » de 42 fois plus en 1980. En comparaison, ce<br />
chiffre est en France de 16 fois le salaire moyen des ouvriers. C’est un peu<br />
moins vrai aujourd’hui, mais la situation reste sensiblement identique.<br />
Ce qui était vrai pour les patrons américains en 1990 l’était également<br />
pour la classe sociale à laquelle ils appartiennent. En 1979, les 1 % les<br />
plus riches détenaient 20 % de la richesse nationale. En 1997, ils en possédaient<br />
près de 40 %. Quelles que soient les méthodes de calcul de la<br />
répartition des richesses, les États-Unis des années 1990 connaissaient<br />
des niveaux d’inégalité non seulement uniques dans les pays industrialisés<br />
mais également inconnus aux États-Unis depuis les années 1920.<br />
Dans le même temps, grâce à l’application résolue de nouvelles techniques<br />
managériales et au recul de la législation sociale américaine, le<br />
patronat américain a accompli un exploit économique digne des travaux<br />
d’Hercule : il est arrivé à découpler totalement la productivité de l’augmentation<br />
des salaires. Qu’est-ce que cela veut dire ? En fait, alors même<br />
que notre économie tournait à plein régime et que la productivité croissait<br />
à pas de géant, les salaires ont stagné : tout les bénéfices économiques<br />
allaient directement dans les poches des actionnaires. Bien<br />
entendu, ces tendances lourdes restent d’actualité : reprise du chômage,<br />
sous-traitance, etc.<br />
Ces développements s’accompagnèrent de l’intrusion du pouvoir<br />
patronal dans un nombre accru d’aspects de la vie quotidienne. Au<br />
cours des années 1990, les Américains travaillèrent plus dur et plus<br />
longtemps que dans les décennies précédentes. Ils virent plus de publicités<br />
sur plus de supports que jamais auparavant. Ils firent plus de tests
THOMAS FRANK 157<br />
de personnalité et prirent plus de drogues que jamais. Ils eurent moins<br />
de prise sur leurs conditions de vie et de travail qu’au cours des<br />
cinquantes années antérieures.<br />
LES PATRONS SONT COOLS<br />
Le monde des affaires devint le monde tout court. « L’entreprise est devenue<br />
l’institution dominante de notre époque », affirmait le magazine Fast<br />
Company il y a quelques années : « Elle occupe la position de l’Église au<br />
Moyen-Âge et celle de l’État-nation au cours des deux derniers siècles. »<br />
Si vous opposez à cela, comme vous le faites généralement en Europe,<br />
que les hommes d’affaires ne forment jamais qu’une bande de Blancs en<br />
costards jouant du fouet et forçant tout le monde à marcher au pas, vous<br />
avez tout faux. Ceux qui faisaient subir ce traitement aux Américains –<br />
comme au reste du monde d’ailleurs – n’étaient ni conformistes ni coincés.<br />
Bien au contraire. Les patrons sont cools. Les patrons sont relax, radicaux,<br />
révolutionnaires même. Les patrons aiment se mêler aux autres et<br />
ont rejoint la joyeuse troupe qui a investi les quartiers bobos que toute<br />
ville américaine se doit d’avoir depuis les années 1990. Le patronnat adorait<br />
positivement la « théorie du chaos », s’offrait les services de l’architecte<br />
Frank Gehry pour édifier des écoles de management et dépensait<br />
des millions de dollars pour construire des musées du rock’n’roll. Le<br />
patronnat était si relax qu’en 1996 un ancien membre du Grateful Dead<br />
rédigea un manifeste à la gloire de la nouvelle économie déréglementée<br />
naissante, depuis le sommet de la « Montagne magique de Davos ».<br />
Dans les années 1990, le monde des affaires aimait se faire passer pour<br />
un mouvement contestataire, le poing dressé contre les structure surannées<br />
du pouvoir. Le monde des affaires était en guerre contre les vieilles<br />
méthodes dans tous les domaines. Il nous offrait de nouvelles marques<br />
de dentifrices qui nous permettaient d’exprimer notre moi profond. Les<br />
producteurs de logiciels confiaient le pouvoir au peuple. Si Nike faisait<br />
fabriquer ses chaussures dans les « ateliers de la sueur » du monde<br />
entier, cela ne l’empêchait pas de diffuser des publicités dans lesquelles<br />
l’entreprise s’autoproclamait « révolutionnaire ». Le courtier en ligne<br />
Datek se dépeignait lui-même comme l’équivalent contemporain de la<br />
Révolution française, véritable sans-culotte dévastant les couloirs de la
158<br />
Bourse de New York et exigeant la réduction des commissions et autres<br />
privilèges du même type. La boisson Seven Up imaginait une conspiration<br />
mondiale fermement résolue à empêcher les gens de boire du Seven<br />
Up. Les Jaguar passaient pour des accessoires punks dans des spots dont<br />
les jingles empruntaient au groupe Clash. Des agences de voyages vantaient<br />
leur produits sur du Iggy Pop et les Toyota sur des chansons de<br />
Buzzcocks. Nous zig-zaguions sur les routes dans nos Cadillac et franchissions<br />
joyeusement les lignes blanches dans nos Nissan.<br />
Quand la Corée du Sud renoua avec les profits en épousant la politique<br />
américain de flexibilité de l’emploi et de guerre contre les syndicats,<br />
Business Week vit dans cette évolution l’essor d’une nouvelle<br />
contre-culture jeune et audacieuse. La Corée n’était pas simplement<br />
« rentable » ou « performante », elle était surtout « cool ».<br />
Toute cette imagerie se retrouve en condensé avec Enron qui s’avéra<br />
être finalement le plus grand de tous les voleurs de la Nouvelle Économie.<br />
Les publicités d’Enron comparaient son programme de dérégulation<br />
au mouvement des droits civiques et nous encourageaient à renverser<br />
l’orthodoxie dominante en demandant simplement : Pourquoi ? Le magazine<br />
Fortune alla plus loin encore en 2000, en mettant en scène Enron<br />
comme le nouvel avènement d’Elvis : « Imaginez une soirée dansante au<br />
country-club local avec les vieilles badernes habituelles accompagnées<br />
de leurs femmes qui danseraient mollement sur le rythme très modérément<br />
endiablé de Gui Lombardo et ses All-Tuxedo Orchestra.<br />
Brusquement le jeune Elvis apparaît dans une lumière éblouissante, vêtu<br />
de son constume lamé or, avec sa guitare éclatante et ses déhanchements.<br />
La moitié des valseurs tombent dans les pommes, d’autres sont scandalisés<br />
ou font franchement la tête. Seuls une poignée d’entre eux découvrent<br />
qu’ils aiment ce qu’ils sont en train d’entendre. Les pieds marquent<br />
le rythme… Puis de nouveaux couples se forment et se mettent à danser<br />
un rock échevelé. Dans le monde sérieux des services et des compagnies<br />
d’énergie, Enron Corp c’est Elvis entrant par effraction. »<br />
LE POPULISME DE MARCHÉ<br />
LE POPULISME DE MARCHÉ<br />
Dans Le Marché de droit divin, j’analyse l’idée centrale qui relie toutes ces<br />
absurdités. Cette idée, je l’appelle « populisme de marché». Du Gratefull
“L’argent.<br />
C’est vraiment plus comme avant.”<br />
LES BONNES RECETTES<br />
POUR SPÉCULER<br />
DES<br />
VIEILLES DAMES DE<br />
BEARDSTOWN<br />
Comment nous avons<br />
vaincu Wall Street<br />
et comment vous pouvez<br />
y réussir aussi
THOMAS FRANK 161<br />
Dead de Davos aux lauréats du prix Nobel, des paléo-conservateurs aux<br />
néo-libéraux, les dirigeants américains des années 1990 finirent par croire<br />
que le marché était un système véritablement populaire, une forme d’organisation<br />
démocratique bien plus démocratique que… la démocratie<br />
elle-même. Non seulement les marchés étaient censés jouer le rôle d’intermédiaire<br />
dans les échanges financiers, mais on nous pria également de<br />
croire qu’ils étaient les médiateurs du consensus populaire. Grâce aux<br />
mécanisme de l’offre et de la demande, aux sondages et aux focus groups,<br />
aux hypermarchés et à l’Internet, les marchés expriment la volonté populaire<br />
de façon bien plus pertinente qu’une élection. La nature même des<br />
marchés leur confére une légitimité démocratique, ils rabattent le caquet<br />
des frimeurs et des suffisants ; les marchés servent les intérêts des plus<br />
humbles ; ils nous donnent ce que nous demandons.<br />
Le populisme de marché était d’emblée présent dans la rhétorique qui<br />
accompagna le dernier grand marché haussier. Où que vous alliez en<br />
Amérique dans les années 1990, vous entendiez parler à un moment ou<br />
un autre de la « démocratisation » de Wall Street. Voici le mythe originel<br />
: au commencement, le monde de la finance était habité par les élites,<br />
les experts, d’abominables snobs, de riches Blancs en costards sombres<br />
méprisant les gens du commun et gardant pour eux seuls ce merveilleux<br />
objet : j’ai nommé le marché boursier. Mais le marché haussier des<br />
années 1990 – continuait le poète – constituait une rupture historique<br />
d’importance. C’était un marché haussier populaire. La grande ouverture<br />
de Wall Street tant attendue. L’individu ordinaire versait l’argent si durement<br />
gagné dans les fonds communs de pension et les actions d’entreprises<br />
aussi sérieuses que Krispy Kreme. Mamie boursicotait sans bouger<br />
de son club de personnes âgées, grand-père achetait et s’accrochait à ses<br />
actions dans le blé du Nebraska et le Nasdaq en ascension permanente<br />
était le symbole même de la solide démocratie des marchés.<br />
Pour illustrer cette morale, les différents courtiers en ligne imaginèrent<br />
des fables étonnantes. J’ai déjà évoqué celle qui mettait en scène une<br />
troupe de petits investisseurs forçant les portes de la Bourse. Une autre<br />
nous apprenait qu’un modeste mécanicien était devenu l’heureux propriétaire<br />
d’une île entière par la seule magie de l’investissement en ligne.<br />
Ailleurs, un punk enseigne à son patron la meilleure manière de devenir<br />
capitaliste. La Bourse était donc devenue l’ami des plus humbles et se<br />
plaisait à humilier les prétentieux. En outre, elle transformait d’un seul<br />
coup les gens ordinaires en millionnaires.
THOMAS FRANK 163<br />
Les manuels d’investissement populaire qui se multiplièrent pendant<br />
cette décennie reprenaient allègrement ces légendes. Peter Lynch, célèbre<br />
dirigeant de fonds de placements, écrivit un best-seller où il proclamait<br />
sa foi dans le petit gars ordinaire qui s’accrochait à son portefeuille de<br />
marques célèbres alors que ces excités d’experts essayaient de resquiller<br />
et finissaient par s’affoler. Nous avons connu les fameuses « Vieilles<br />
Dames de Beardstown » avec leurs conseils d’investissement entrecoupés<br />
des recettes de cuisine. Nous avions également « le millionnaire du<br />
coin » par l’intermédiaire duquel la vague montante des millionnaires de<br />
base mettaient une raclée aux millionaires snobinards.<br />
Et puis il y avait également l’interminable procession des personnalités<br />
médiatiques hyper-optimistes qui péroraient sans se lasser dans les<br />
interminables débats sur la pensée de la Nouvelle Économie et qui nous<br />
juraient, se fondant sur telle ou telle loi économique nouvellement<br />
découverte, que non seulement le marché pouvait aller encore plus loin<br />
mais que ceux qui ne faisaient pas confiance au Dow Jones doutaient du<br />
peuple lui-même. On a vu aussi James J. Cramer nous assurer que les<br />
stock-options pouvaient être les outils de la justice sociale ; que l’Internet<br />
avait aboli les privilèges détenus par les pros de Wall Street. Et ce bon<br />
James Glassman nous disait que les gens ordinaires vivaient une sorte de<br />
révolution des Lumières dans le domaine de la finance, puisque les<br />
actions étaient devenues désormais aussi sûres que les obligations et que<br />
le Dow Jones devait inévitablement atteindre les 36 000 dollars. Sans<br />
oublier notre économiste telévisuel, Larry Kudlow, qui nous promit que<br />
le peuple ne prendrait pas de repos tant que ce même Dow Jones n’atteindrait<br />
pas les 50 000 dollars. Andy Serwer, du magazine Fortune,<br />
déclara à la fin 1999 que « ce à quoi nous avons à faire ici c’est une révolution.<br />
Le pouvoir qui depuis des générations était aux mains d’un petit<br />
millier d’hommes blancs habitant la petite île de New York City est<br />
désormais passé entre les mains de tout un chacun ».<br />
Quelle que soit l’identité de celui qui décrivait le phénomène, il semblait<br />
évident que ce marché haussier représentait bien plus qu’une<br />
petite hausse du prix des actions… Il s’agissait en vérité d’un important<br />
conflit social, une révolution qui apporterait la fortune aux obscurs et<br />
aux humbles.<br />
Et puis, bien sûr, nous avons connu la grande bulle de l’Internet qui,<br />
avant de prendre la mauvaise habitude de nous broyer, avait été présentée<br />
comme le phénomène le plus démocratique de tous les temps.
164<br />
LE POPULISME DE MARCHÉ<br />
L’Internet humiliait les experts, nous disait-on, et il renversait toutes les<br />
hiérarchies. Il déléguait le pouvoir aux gens en délivrant l’information<br />
aux masses. Bien entendu, il fallait investir dans l’Internet quoi qu’il<br />
arrive. Il s’agissait d’une force de démocratisation si fondamentale qu’elle<br />
était à peine imaginable.<br />
Une publicité de l’époque résume à mes yeux tout le sujet. C’était une<br />
pub pour un courtier discount du nom de Suretrade, dans laquelle l’essentiel<br />
était l’initiative individuelle et le mépris moral pour tous les pouvoirs<br />
établis, avec ce slogan : « Nous parions sur nous-mêmes. » Et d’une<br />
certaine manière c’est en effet ce que nous faisions : nous placions notre<br />
argent dans des entreprises qui s’étaient présentées comme des institutions<br />
populistes. Il n’était désormais plus nécessaire de présenter des<br />
bénéfices, ni même un plan de faisabilité pour attirer l’argent sur son<br />
nom. Nous bâtissions nous-mêmes ces entreprises en y contribuant avec<br />
nos dollars et notre indéfectible loyauté à la Marque. La richesse se créait<br />
par simple acclamation. D’autres pouvaient bien comparer ce système à<br />
celui, hasardeux, de la « pyramide » : pour nous il s’agissait de la démocratie.<br />
« Nous, le Peuple », misions notre argent sur nous-mêmes.<br />
Persuadés que toutes les expertises du passé n’étaient finalement que<br />
le produit d’un élitisme mou, nous foncions sans prendre aucune des<br />
précautions traditionnelles. Et dans une sorte d’autosatisfaction ecstatique,<br />
« Nous, le Peuple » écrivions une page glorieuse de l’histoire de<br />
l’économie. En juin 1999, e-Bay multipliait ses bénéfices par 3 991. Et,<br />
assurément, cela n’avait jamais eu le moindre précédent dans toute<br />
l’histoire du monde.<br />
Bien entendu, certains restaient sceptiques. Mais qui s’en souciait ? La<br />
principale leçon des années 1990 fut que la leçon de l’histoire ne comptait<br />
pas. Que les experts n’y connaissaient rien. Que seul le peuple comprenait<br />
le pouvoir de l’Internet. Il le comprenait instinctivement, et<br />
douter du prix élevé que les gens étaient prêts à payer pour leurs actions,<br />
c’était ni plus ni moins douter de la sagesse populaire elle-même. En<br />
outre, à en croire la chaîne CNBC, la fameuse Nouvelle Économie avait<br />
complètement échappé à l’attraction terrestre ! Plus encore, tout le<br />
monde – mais vraiment tout le monde – s’enthousiasmait pour<br />
l’Internet : le plus grand fabricant d’ordinateurs du monde, les créateurs<br />
de logiciels et les entreprises de télécommunications, le Président, le<br />
vice-président et le président de la Chambre des représentants, les directeurs<br />
successifs du Media Lab du MIT, les fondations et les think tanks de
THOMAS FRANK 165<br />
droite ainsi que la quasi-totalité des journalistes du pays. Toutes les<br />
grandes institutions américaines, à l’exception des militaires, se pâmaient<br />
littéralement devant cet instrument. On fit donc tout pour convaincre les<br />
Américains que l’Internet ressemblait fort, aussi bien par ses effets miraculeux<br />
que par ses capacités de rédemption, à un second avénement de<br />
la démocratie.<br />
Bien sûr, tout cela s’est très mal terminé. Les petits investisseurs furent<br />
complètement lessivés alors que les pros sortirent milliardaires de ce<br />
naufrage. Manifestement, et contrairement à ce qu’avait pu prétendre<br />
James Cramer, l’Internet ne vous transformait pas en pro de la Bourse. Si<br />
vous aviez placé votre argent dans les actions phare de cette période,<br />
celles des entreprises qui étaient censées dicter les nouvelles règles, vous<br />
auriez aujourd’hui perdu 90 % de votre investissement.<br />
LA THÉORIE MANAGÉRIALE<br />
Tournons-nous maintenant vers un autre aspect de la pensée entrepreneuriale<br />
: la théorie managériale. Ici aussi, où que l’on regardât à cette<br />
époque il n’était question que de rêves de libération. Cela s’appelait<br />
« révolution entrepreneuriale ». L’Amérique patronale voulait que nous<br />
sachions tous qu’elle avait changé ; qu’elle était devenue cool, elle aussi.<br />
Elle était devenue sensible. Elle était jeune, attentive. Elle avait appris à<br />
danser, à chanter. Les patrons ne portaient plus leurs vieux costumes à<br />
rayures et n’écoutaient plus les vieilles radios de papa. Au cours des<br />
décennies précedentes, le monde des affaires avait sans doute trop<br />
récompensé les prétentieux et les nantis, mais désormais tout était différent.<br />
Dans les années 1990, le monde des affaires servait la vérité, il était<br />
l’ami de l’humanité, le champion du tiers-monde, l’ennemi du mensonge<br />
et de l’arrogance. Le monde des affaires avait finalement déclaré la guerre<br />
à la classe dirigeante occidentale et à l’idée même de hiérarchie sociale.<br />
Et ces révolutionnaires autoproclamés s’obstinaient à nous persuader<br />
qu’ils étaient bien des individus suprêmement subversifs. En 1997, le<br />
magazine Wired publiait un article sur les « rebelles de l’industrie », qu’il<br />
illustrait par des photos de destruction d’œuvres d’art à l’époque stalinienne.<br />
Mais nous pouvions difficilement imaginer les sommets de délire<br />
qu’atteindrait le fabricant de logiciels Oracle dans une publicité diffusée
166<br />
LE POPULISME DE MARCHÉ<br />
pendant le SuperBowl de 1998. L’entreprise s’y comparait ni plus ni<br />
moins aux Khmers rouges, que l’on voyait en train de chasser des réfugiés<br />
comme un troupeau en tirant des rafales de fusil-mitrailleur pour<br />
fêter leur entrée dans une nouvelle ère. Cette pub ne disait quasiment<br />
rien de ce que fabriquait ou vendait l’entreprise Oracle, mais elle ne laissait<br />
aucun doute quant à la victoire du marché sur toute autre forme d’organisation<br />
humaine. Nous étions à l’an 01 de la révolution<br />
entrepreneuriale. Pol Pot siégeait au conseil d’administration et l’histoire<br />
passée était définitivement balayée.<br />
Mais avant de progresser plus avant dans le délire entrepreneurial,<br />
demandons-nous ce qu’il se passait réellement dans les bureaux et les<br />
usines américains pendant la décennie 1990. La réponse est très simple.<br />
Après de nombreuses années de guerre entre dirigeants et travailleurs,<br />
les premiers l’avaient emporté dans presque tous les domaines imaginables.<br />
Les entreprises des années 1990 ne reculaient devant rien pour<br />
maintenir les salaires au niveau le plus bas – quant aux salaires des dirigeants,<br />
c’était toute autre chose. Ce fut une époque de désyndicalisation<br />
rampante. De délocalisation des entreprises vers des pays aux salaires<br />
plus avantageux, comme le Mexique. De recours aux intérimaires souspayés<br />
pour faire le travail dont s’acquittaient autrefois des travailleurs<br />
syndiqués bénéficiant de contrats de travail et d’avantages sociaux, etc.<br />
De sous-traitance via l’Internet. De taylorisation des tâches les plus inattendues<br />
: des chauffeurs routiers aux tâches ménagères. De précarisation<br />
des travaux autrefois les mieux protégés. (Toutes choses se poursuivent<br />
actuellement.) Les années 1990 apportèrent la délégitimation des<br />
travailleurs sur leur lieu de travail.<br />
Dans la théorie managériale, pourtant, on ne parlait que de libération,<br />
d’autonomisation, de responsabilisation et de l’avènement inéluctable<br />
de la démocratie. Le « nouveau paradigme entrepreneurial »,<br />
selon Fast Company, c’était « la démocratie économique ». Des anciens<br />
codes vestimentaires aux plans de retraites, les vieilles règles cédaient<br />
la place à la flexibilité et à la responsabilité. D’ailleurs, le grand ennemi,<br />
le vieil ordre que cette révolution était censée renverser, c’était la grosse<br />
entreprise organisée verticalement pour laquelle les gens travaillaient<br />
autrefois. Un endroit où l’on pouvait avoir un travail sûr pendant des<br />
années, un plan de retraite garanti, des mutuelles de santé et un costume<br />
de flanelle grise. Un endroit comme IBM. Ou la General Motors.<br />
Ou comme toutes les entreprises françaises. C’est ainsi que, pendant les
THOMAS FRANK 167<br />
années 1990, la France devint le type même du pays qui ne jouissait<br />
pas des bienfaits de la Nouvelle Économie. Un ennemi antipopuliste, à<br />
portée de main, susceptible d’être montré du doigt et couvert d’injures.<br />
Le New York Times, le plus important journal du pays, publiait des<br />
articles rigolards sur l’intellectuel français, supposé écrire un livre sur<br />
l’impact de l’Internet… au stylo. Il publiait des photos d’un homme<br />
politique français regardant un ordinateur avec l’air le plus étonné du<br />
monde. Ou bien encore un article sur cet aristocrate français se lamentant<br />
sur la Belle Époque. Thomas Friedman, spécialistes des affaires<br />
étrangères dans ce journal, accusait la France de « faire du pied » aux<br />
« ennemis de la modernité »; et il alla même plus loin, un peu plus<br />
tard, en qualifiant la France d’« ennemie ». Elle ne se contentait pas de<br />
se faire une image surévaluée d’elle-même, de fantasmer sa nature<br />
aristocratique ou simplement d’être raciste, elle s’obstinait de manière<br />
absurde à resister aux impératifs dictés par le libre-échange.<br />
Peter Senge, l’un des plus importants théoriciens du management de<br />
la décennie en question, qualifiait l’entreprise ancienne manière de « hiérarchie<br />
autoritaire ». Ces dirigeants y étouffaient toute initiative, ils<br />
baillonnaient l’individu, étaient sexistes, racistes. Ils ne comprenaient<br />
rien à ce qu’il se passait à l’extérieur et ils passaient leur week-end à jouer<br />
au golf avec leurs anciens camarades d’université qui, de leur côté, commettaient<br />
les mêmes offenses contre la démocratie dans leurs entreprises.<br />
Et vous savez quoi ? Qui n’est pas contre ce genre de chose ? Qui ne<br />
veut pas de la démocratie sur son lieu de travail ? Mais la manière dont<br />
Senge et les autres gourous du management utilisaient ce terme était<br />
purement symbolique. Le vrai problème de l’entreprise traditionnelle,<br />
c’est qu’elle constituait un paravent contre la tornade libre-échangiste.<br />
Elle abritait dans ses murs toutes sortes d’insuffisances. Les salaires y<br />
étaient bien trop élevés et elle offrait toute sorte d’avantage sociaux<br />
extrêmement coûteux. Le vrai problème était surtout que les dirigeants<br />
de ces entreprises ne versaient pas suffisament de dividendes à leurs<br />
actionnaires et insistaient pour faire en interne des tâches pourtant aisément<br />
sous-traitables. En d’autres termes il s’agissait d’« élitistes », de<br />
gens qui pensaient savoir mieux et plus que le marché et qui pensaient<br />
en conséquence en savoir plus que le peuple lui-même. Bref, l’entreprise<br />
n’était pas assez capitaliste. Le fait qu’elle soit taxée de sexisme et<br />
racisme était surtout symbolique de son élitisme, ce péché moral dont<br />
l’expression essentielle était l’attitude hautaine de l’entreprise vis-à-vis
168<br />
du libre marché. (D’ailleurs c’est un point de vue très partagé en<br />
Amérique que plus un pays est socialiste plus il est raciste. En revanche<br />
le libre-échange serait un système censé favorisé la mixité, le multicultutalisme<br />
et la mondialisation. Toutes ces merveilleuses choses que<br />
nous aimons tant.) C’est pourquoi on entendait à longueur d’années des<br />
contes merveilleux sur d’héroïques patrons dont le bureau ressemblait<br />
en tout point à celui des autres membres de leur équipe. Ou qui permettait<br />
que l’on joue au mini-basket dans les bureaux, qui se déplaçait<br />
à vélo pour venir au travail. Le patron nouveau devait être un homme<br />
du peuple. Jeff Brezos d’Amazon était si apprécié de ses employés que le<br />
magazine Time publia une photo de lui en train de signer des autographes<br />
sur leurs casquettes. On parla à cette occasion de<br />
« Communisme.Com »…<br />
LES « TRAVAILLEURS DU SAVOIR »<br />
LE POPULISME DE MARCHÉ<br />
Mais il y avait aussi ceux qui, dans le langage de l’époque, «étaient<br />
complètement à côté de la plaque ». Les Américains ne peuvent évoquer<br />
l’idée d’une « révolution entrepreneuriale » sans pointer du doigt la folie<br />
de ceux qui s’y opposent. C’est pourquoi la littérature sur la Nouvelle<br />
Économie était pleine de récits méprisants sur ces gens qui ne comprenaient<br />
pas que le vieux monde était fichu et qu’ils devaient laisser tomber<br />
des notions comme le syndicalisme et les emplois durables. La<br />
figure la plus classique du genre était bien entendu l’ouvrier supposé ne<br />
rien comprendre à l’Internet et aux joies de ce nouveau monde peuplé<br />
de bas salaires.<br />
Au pays de la révolution entrepreneuriale, l’entreprise se félicitait<br />
d’être la meilleur amie des travailleurs. Pour nombre de gourous, la<br />
« révolution entrepreneuriale » – qui n’est rien d’autre, j’insiste, que la<br />
sous-traitance, la flexibilité, etc. – se présentait comme une sorte de<br />
révolte de classe, un mouvement social que pourraient soutenir les<br />
équipes dirigeantes. Les travailleurs n’étaient pas les victimes des<br />
dégraissages, de la sous-traitance ou de l’intérim. Ils désiraient tout cela,<br />
se battaient pour les obtenir, en avaient besoin pour exprimer leur moi<br />
profond et échapper au conformisme de l’entreprise d’antan. La<br />
Nouvelle Économie aidait les gens à se réaliser. Elle aidait les travailleurs
THOMAS FRANK 169<br />
à lutter contre les équipes dirigeantes. Abandonner les travailleurs à la<br />
merci du marché, ce n’était pas un acte de cruauté digne du XIX e siècle<br />
mais quelque chose qu’il fallait faire si on s’intéressait sincèrement au<br />
sort des gens. Avec l’aide de leur nouvel ami, les travailleurs découvraient<br />
qu’ils pouvaient négocier leur contrat individuellement et gagner à tous<br />
les coups. Ils pouvaient passer d’une entreprise à une autre autant qu’ils<br />
le désiraient pour rechercher l’emploi qui leur convenait le mieux. Mais<br />
quels étaient ces travailleurs dont nous parlaient les gourous du management<br />
? Nous savons bien entendu qu’ils ne pensaient pas à la classe<br />
ouvrière telle que vous et moi l’imaginons. Rappelez-vous que les<br />
ouvriers classiques font partie de ceux qui « sont à côté de la plaque ».<br />
Ils étaient si méprisés par les théoriciens de la Nouvelle Économie que le<br />
gourou suprême, Tom Peters, se permit de dire, en 1997, que les millionnaires<br />
de l’Internet et la classe ouvrière avaient échangé leurs positions<br />
morales au sein de la société. Il allait jusqu’à décrire les ouvriers<br />
comme des « parasites » qui profitaient honteusement du labeur<br />
héroïque des responsables de la Nouvelle Économie.<br />
Non, la classe laborieuse dont tout le monde parlait dans les années<br />
1990 c’était les « travailleurs du savoir », c’est-à-dire les salariés du secteur<br />
tertiaire : les professions libérales, les courtiers, les informaticiens,<br />
les rédacteurs publicitaires, etc. Ce que ces nouveaux héros des classes<br />
laborieuses avaient de formidable, c’est qu’ils n’avaient nul besoin des<br />
syndicats ou de contrats à durée indéterminée pour les protéger de l’exploitation<br />
patronnale. En fait, selon le théoricien britannique du management<br />
Charles Andy, puisque le prolétariat était composé<br />
essentiellement de l’ensemble des travailleurs du savoir, le paradis<br />
marxiste était en fin de compte advenu sur la terre. En effet, pour Handy,<br />
« les moyens de production […] sont désormais littéralement possédés<br />
par les travailleurs puisque ces moyens sont dans leurs têtes et au bout<br />
de leurs doigts ». Si l’on en croit l’article publié en 1998 par le magazine<br />
Fortune et que le journal choisit d’annoncer par ce gros titre « Yo,<br />
Entreprise Amérique ! », ces nouveaux prolétaires effrontés étaient si<br />
autonomes et responsables qu’ils dictaient eux-mêmes les termes de leur<br />
contrat d’embauche aux patrons. « Les entreprises ne sont désormais<br />
plus aux commandes. Ce sont les employés qui maîtrisent la situation. »<br />
Quant à la destruction de la notion de sécurité de l’emploi, il n’y avait<br />
décidément aucune raison de s’en plaindre. Ce n’était rien d’autre que<br />
l’avènement de l’« agent indépendant ».
170<br />
LE POPULISME DE MARCHÉ<br />
Mais l’objectif primordial de la théorie managériale a toujours été de<br />
clarifier nos relations avec l’entreprise aussi bien en tant qu’employés<br />
qu’en tant que citoyens. Au XIX e siècle, l’une des critiques les plus communément<br />
adressées aux entreprises était que, bien qu’elles disposent<br />
de la personnalité juridique, elles étaient dépourvues d’âme.<br />
Aujourd’hui, plus personne ne parle d’« entreprises inhumaines » ou<br />
« sans âme ». Ce dont on nous parlait dans les années 1990, c’était au<br />
contraire de l’incroyable humanité de l’entreprise. D’ailleurs, sur bien<br />
des points, l’entreprise est décidément plus humaine que nous. C’était<br />
là ce que voulait dire la Nouvelle Économie avec la notion d’ « entreprise<br />
existentielle ». Dieu était peut-être mort, mais l’entreprise, elle,<br />
était toujours vivante, et sans doute pour l’éternité. Libre de fixer ses<br />
propres objectifs et d’agir comme bon lui semblait sur cette terre. Un<br />
best-seller de la littérature managériale, paru en 1997, prétendait que<br />
« non seulement l’entreprise est un être vivant » mais que, comme elle<br />
est techniquement immortelle, elle appartient à un ordre d’organismes<br />
vivants bien supérieur à l’espèce humaine.<br />
En fait c’était à nous de nous déterminer par rapport aux produits de<br />
la vie entrepreneuriale. C’était bien là le message explicite du fameux<br />
livre de Tom Peters, paru en 1997, The Brand Called You [« la marque<br />
nommée “Vous”»]. « C’est simple, vous êtes une marque. Vous êtes responsable<br />
de votre propre marque. » Et il n’existait pas d’autre choix<br />
que de se penser comme tel puisque c’est ce que les concurrents – c’està-dire<br />
tous les autres – faisaient en ce moment même. « Commencez<br />
dès aujourd’hui, ou bien… », menaçait Peters. Aujourd’hui, c’est une<br />
des idées les mieux admises de la doxa entrepreneuriale. Il y a quelques<br />
années, j’ai écrit un livre sur la publicité et, de temps en temps, des<br />
gens m’appelaient pour demander si je pensais que tel athlète ou cuisinier<br />
célèbre était devenu une « marque » et avait transcendé ce<br />
monde si tristement matériel. Nous devions nous penser comme des<br />
marques et considérer les entreprises comme des divinités, ni plus ni<br />
moins. Il est très naturel que la fin de la décennie 1990 ait vu une véritable<br />
explosion de livres consacrés à la spiritualité au travail : le mysticisme<br />
au bureau, le jeu de tarot entrepreneurial et même un mince<br />
volume de « prières managériales » que l’un de mes collègues a collecté<br />
dans une église de la banlieue de Chicago. Voici le texte d’une prière<br />
sur la « succession » :
THOMAS FRANK 171<br />
Dieu, aide-moi à ne pas oublier<br />
que je puis être muté, neutralisé ou éliminé<br />
pour mille raisons différentes et à tout moment.<br />
Mon autorité est fragile et ne tient qu’au fil fragile<br />
de la confiance que les gens placent en moi.<br />
Multiples sont les choses hors de mon contrôle<br />
qui peuvent venir trancher ce fil… et me faire disparaître.<br />
Pourtant, il leur faut un guide et, lorsque je serai parti,<br />
il leur faudra quelqu’un vers qui se tourner,<br />
d’autres en qui ils auront confiance<br />
et qui pourront leur dire la vérité.<br />
Oh, Dieu de miséricorde,<br />
ne me laisse pas dans cet emploi un seul jour de trop.<br />
Et ne permets pas que tout se délite après mon départ.<br />
Je ne durerai pas éternellement, mon Dieu.<br />
Et où sont mes successeurs ?<br />
DIEU EST RÉPUBLICAIN<br />
Cela peut paraître parfaitement absurde. Mais ces absurdités ont un<br />
objectif. Quand quelqu’un nous dit que l’organisation verticale est de<br />
type communiste ou que le Dow Jones va grimper jusqu’à 36 000<br />
dollars, ou que la découverte de nouvelles lois naturelles signifie que<br />
nous ne pourons jamais comprendre ce qui se passe dans l’économie,<br />
sans même parler de la maîtriser, il ne parle pas de faits avérés. C’est<br />
exactement comme si quelqu’un venait nous dire que « Dieu est républicain<br />
». Ces gens là ne donnent pas de conseils pratiques sur la manière<br />
dont il faut agir dans notre vie quotidienne. Dans les deux cas, il s’agit<br />
de déclarations politiques. Et c’est ce que nous n’avons pas vu clairement<br />
dans la rhétorique de la Nouvelle Économie. Elle est manifestement<br />
orientée politiquement. Ce n’est pas une coïncidence si, en pratique, la<br />
quasi-totalité des théoriciens de la Nouvelle Économie – de Newt<br />
Gingrich à James Glassman et de Larry Kudlow à Dinesh D’Souza – sont<br />
issus d’une manière ou d’une autre de la droite politique.<br />
Les dirigeants patronaux se sont convertis au populisme de marché<br />
parce que le populisme de marché leur fournissait des armes contre<br />
leurs ennemis traditionnels : l’État et les syndicats. Puisque le marché
172<br />
LE POPULISME DE MARCHÉ<br />
exprimait si bien la volonté populaire, pratiquement toute critique à<br />
l’encontre des marchés pouvait désormais passer pour une démonstration<br />
d’« élitisme » provoquée par un mépris condamnable vis-à-vis des<br />
gens ordinaires. D’ailleurs le mot « élitiste » fut l’un des plus utilisés<br />
durant toute cette décennie. De ce point de vue, les élitistes n’étaient pas<br />
ceux qui passaient leur week-end à bord de leur yacht, ou qui licenciaient<br />
la moitié de leurs employés pour mieux délocaliser la production<br />
dans les pays du Sud. Non, les élitistes étaient toujours ceux qui se trouvaient<br />
de l’autre côté du champ de bataille : les syndicalistes et les diplômés<br />
d’Harvard qui pensaient que la société pouvait être organisée selon<br />
d’autres critères que la simple obéissance aux lois du marché. Puisque,<br />
quoi que fasse le marché – aussi délirant que cela puisse être –, il<br />
exprime la Volonté du Peuple, tout projet de le réguler est contre nature,<br />
dangereux et émane des faux experts.<br />
Et c’est cela le plus formidable dans le populisme de marché : il s’est<br />
finalement emparé du vocabulaire social de la gauche. Être favorable au<br />
patronnat, c’était être avec les gens ordinaires. Les hommes d’affaires et<br />
leurs amis politiciens n’ont pas cessé de protester durant cette décennie<br />
contre l’usage du vocabulaire des « classes sociales » par leurs adversaires<br />
de gauche. Pourtant, c’est exactement ce qu’ils faisaient eux-mêmes en ne<br />
cessant de décrire l’entreprise comme le lieu d’une révolution sociale permanente<br />
qui voyait les entrepreneurs audacieux éjecter les riches oisifs et<br />
inutiles. Les gros et gras héritiers de gigantesques fortunes étaient définitivement<br />
battus par la pratique boursière un peu cavalière du jeune type<br />
de la rue avec son petit bouc à la mode. Le patron autoritaire coincé dans<br />
son costard à rayures était toujours finalement viré par les « agents du<br />
changement ». Les experts arroguants, avec leurs drôles de théories «à la<br />
française », étaient renvoyés à leurs chères études par les gens du commun<br />
qui savaient au plus profond d’eux-mêmes qu’il existait un nouvel ordre<br />
et que les actions promues par la Nouvelle Économie valaient réellement<br />
et effectivement le prix astronomique auquel ils les payaient.<br />
Les conséquences politiques de tout cela auraient dû paraître évidentes.<br />
Pensez au populisme de marché à Wall Street. Que les petits<br />
investisseurs aient réellement réussi à faire une percée sur le marché ou<br />
non, Wall Street avait de toute manière intérêt à les courtiser et à persuader<br />
le monde entier qu’elle servait l’intérêt commun. Pas seulement<br />
parce que Wall Street souhaitait voir grimper le prix des actions mais surtout<br />
parce qu’elle avait une peur panique de voir rejouer le scénario des
THOMAS FRANK 173<br />
années 1930 et que l’État s’intéresse de trop près à ce qu’il se passait<br />
réellement dans les entreprises de courtages. Il n’était pas tant question<br />
de boursicotage que de politique, mais menée par d’autres moyens.<br />
Et le véritable objet de la théorie de la « révolution » managériale qui<br />
advint dans les années 1990 n’était pas l’efficacité, l’excellence, ni même<br />
l’autonomisation des travaileurs. Non, l’objectif était bien plus abstrait :<br />
il s’agissait d’assurer la légitimité sociale et politique des entreprises.<br />
Jetons encore un coup d’œil à ce qu’il s’est passé dans les années<br />
1990. Les syndicats ont été affaiblis et les théoriciens du management<br />
affirmaient que le nouveau monde du travail serait si libre et si démocratique<br />
que l’on n’aurait véritablement plus besoin d’eux. L’État se<br />
déclara lui même hors-jeu et les théoriciens du management proclamèrent<br />
que le meilleur gouvernement était celui du marché, veillant à<br />
satisfaire les besoins de la société et prenant en charge tous les problèmes<br />
imaginables. À mesure que l’Entreprise conquérait la planète,<br />
ces même théoriciens nous expliquaient pourquoi le nouveau monde<br />
du travail serait plus agréable, plus juste, démocratique et que, même<br />
si pour finir tout cela était faux, il n’y avait rien que l’on puisse faire<br />
pour s’y opposer.<br />
Le véritable résultat escompté par la théorie managériale des années<br />
1990 n’était donc certainement pas la qualité du travail mais l’acceptation,<br />
la soumission aux impératifs de l’entreprise, non seulement sur le<br />
lieu même de travail, mais aussi dans le domaine politique. Au vu de cet<br />
objectif, la théorie managériale a parfaitement réussi son coup malgré ses<br />
foutaises, son jargon et ses absurdités. C’est à la prose hyperbolique de<br />
Tom Peters que l’on doit, au moins en partie, le fait que tant de travailleurs<br />
« dégraissés » aient admis que ce qui leur arrivait était bénéfique<br />
et parfaitement justifié. C’est sans doute également grâce à tous ces<br />
livres sur l’humanité des entreprises que tant d’employés ont quitté leur<br />
travail sans faire de vagues et en évoquant avec confiance leur nouvelle<br />
carrière d’ « agents indépendants ».<br />
QUI M’A PIQUÉ MON FROMAGE ?<br />
Lorsque la richesse se trouve si spectaculairement concentrée, il est hautement<br />
prévisible, par une sorte de déterminisme culturel marxiste, que la
174<br />
LE POPULISME DE MARCHÉ<br />
littérature préférée des patrons insiste aussi lourdement sur la nécessité de<br />
voir dans l’entreprise une sorte de divinité démocratique bien au-dessus<br />
de l’État ou des syndicats en termes de légitimité ou de perspectives. Et il<br />
est tout aussi compréhensible que le plus grand best-seller dans ce<br />
domaine ait été un petit livre intitulé Qui m’a piqué mon fromage ? 1<br />
Il s’agit d’une parabole sur l’impuissance des travailleurs expliquée en<br />
termes assez simplistes et en caractères assez gros pour être comprise<br />
même par des élèves d’école primaire. Les travailleurs, plus connus dans<br />
ce livre sous le nom de « petitsbonzhommes », sont comme des souris<br />
de laboratoire. Ils se lèvent tous les jours pour aller chercher leur fromage,<br />
c’est-à-dire pour faire leur boulot. Mais un jour le fromage a disparu<br />
et les petitsbonzhommes doivent décider de la manière dont ils<br />
vont réagir. L’un d’entre eux saisit l’opportunité et s’adapte à la précarité<br />
du travail, s’en allant avec un grand sens du devoir faire ailleurs son fromage<br />
(plus de travail, et moins payé bien sûr). Ce faisant, il découvre que<br />
cette quête est vraiment très satisfaisante et très intéressante intellectuellement,<br />
etc. En revanche, l’un de ses camarades trépigne et se met à hurler<br />
et à se plaindre : « Qui m’a piqué mon fromage ? » Cette attitude,<br />
nous explique clairement le livre, est si évidemment erronée et si scandaleusement<br />
grave que la personne qui se conduit ainsi mérite d’être<br />
virée sur le champ. Vous ne pouvez pas remettre en cause celui qui a<br />
déplacé le fromage (le marché ou le patron). Vous ne pouvez que vous<br />
soumettre. Mais nous n’en sommes qu’aux soixante premières pages du<br />
livre. Après quoi, l’auteur décide de changer de ton et fait quelque chose<br />
qu’aucun autre livre managérial n’avait fait avant lui. Il explique à quel<br />
point son livre pourrait être un outil bien pratique pour pacifier les relations<br />
sociales. Il nous conduit vers un groupes de professionnels du<br />
management assis autour d’une table et débattant du caractère profond<br />
et important de cette « histoire de fromage ». « Vous savez, dit l’un d’eux,<br />
nous avons opéré des “changements” dans notre organisation du travail<br />
et pas mal d’employés n’apprécient pas du tout cela. J’aimerais vraiment<br />
que cette histoire soit racontée dans un livre de manière à ce que je<br />
puisse en acheter quelques exemplaires pour le faire lire à mes<br />
employés. » Le livre se termine brutalement par un bon de commande.<br />
Partout où j’ai pu aller aux États-Unis, j’ai recontré des gens qui avaient<br />
1. Spencer Johnson, Who Moved My Cheese ?, Putnam, New York, 1998.
THOMAS FRANK 175<br />
été contraints de lire ce livre par leur employeur ou de regarder les<br />
vidéos ou même de décorer leur bureau avec du matériel fourni par l’entreprise<br />
Qui m’a piqué mon fromage ? Une personne m’a même raconté<br />
que tout son service avait été contraint de se réunir dans une pièce pour<br />
lire le texte à haute voix. Toutes les personnes avec qui j’ai eu l’occasion<br />
de parler de ce livre l’ont unanimement détesté.<br />
Même si la Nouvelle Économie a pu nous hypnotiser pendant un<br />
temps, je pense qu’il est maintenant évident qu’il n’existe pas sur cette<br />
terre de théorie sociale, exceptée celle du droit divin des monarques, qui<br />
puisse justifier l’écart phénoménal entre les salaires des dirigeants et<br />
ceux des travailleurs (plus de 500 fois). Ou qui puisse expliquer raisonnablement<br />
la concentration d’une décennie de profits sur les comptes<br />
bancaires d’une petite minorité. Selon les gourous, le marché est capable<br />
de résoudre seul tous les conflits sociaux – avec justice et équité. Et<br />
pourtant, ce dont nous avons désespérément besoin pour restaurer le<br />
sens de la justice et de l’équité en économie, ce n’est certes pas d’un<br />
quelconque triomphe final du marché sur le corps et l’esprit humain<br />
mais bien d’une force qui soit capable de s’opposer aux marchés, de<br />
refuser de se penser en termes de Marque. Une force qui ne se contente<br />
pas de partir en quête d’authenticité. En effet, au bout du compte, il<br />
importera fort peu à celui qui paiera l’addition de la « révolution entrepreneuriale<br />
» que le type qui le licenciera porte un costume bien coupé<br />
ou arbore un piercing à la narine.<br />
THOMAS FRANK<br />
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton et Benoît Eugène<br />
À l’origine de ce texte se trouve une série de conférences de Thomas Frank organisée<br />
par les Amis du Monde diplomatique et les éditions <strong>Agone</strong> début avril 2004, à<br />
Bruxelles (au cinéma Le Nova), à Tours, à Paris et à Marseille.<br />
L’auteur revient ici sur une partie des thèmes qu’il traite dans son livre Le Marché<br />
de droit divin. Capitalisme sauvage et populisme de marché (<strong>Agone</strong>, 2003).
En 1996, le président Clinton<br />
promulguait le Personal Responsibility<br />
and Work Opportunity Reconciliation<br />
Act, censé remettre au travail les<br />
allocataires de l’aide sociale et leur<br />
rendre leur dignité en les “libérant” de<br />
la “dépendance” du welfare. En 1997,<br />
des industriels (Burger King,<br />
Monsanto, Sprint, United Airlines et<br />
UPS) fondaient une “ONG” dans le but<br />
de promouvoir la “réforme” et d’aider<br />
le secteur privé à assumer ses<br />
nouvelles responsabilités sociales dans<br />
le cadre du workfare.<br />
La biographie du président de cette<br />
organisation, sorte de success story<br />
typiquement américaine, raconte<br />
l’histoire d’un petit gars du ghetto qui<br />
a renoncé au welfare pour accepter un<br />
emploi de manutentionnaire à temps<br />
partiel, avant de gravir tous les<br />
échelons de l’entreprise et de diriger un<br />
programme d’aide à l’initiative privée<br />
dans son quartier d’origine, financé par<br />
sa société. Le livre, préfacé par Clinton,<br />
s’intitule No Free Lunch (« on n’a rien<br />
pour rien »).<br />
http://www.welfaretowork.org/
LOÏC WACQUANT<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 177-195<br />
177<br />
La « réforme » de l’aide sociale<br />
comme instrument de discipline<br />
Si les gens reçoivent une aide sociale durant des périodes prolongées,<br />
cela inocule une drogue à leur esprit. Cette dépendance à l’égard de<br />
l’aide sociale mine leur humanité et fait d’eux des pupilles de l’État.<br />
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 1935<br />
C’est un jour inouï dans l’histoire de ce pays. Il rentrera sans nul doute<br />
dans l’histoire comme le « Jour de la libération » (Independence Day)<br />
pour tous ceux qui ont été enfermés dans un système qu’on a laissé à<br />
vau-l’eau et qu’on a laissé faire véritablement dégénérer les gens au fil<br />
de générations dépendantes d’une aide sociale qui a corrompu leur<br />
âme et leur a volé leur avenir.<br />
E. CLAY SHAW, JR., 1996<br />
Député afro-américain, coauteur de la loi<br />
sur la responsabilité personnelle et le travail<br />
LA « RÉFORME » DES AIDES SOCIALES votée par le Congrès américain<br />
et paraphée en fanfare par Clinton en août 1996 a fait grand bruit<br />
des deux côtés de l’Atlantique. Aux États-Unis, la décision du<br />
Président de soutenir un train de mesures concoctées par la frange la<br />
plus réactionnaire du parti républicain et qui jette aux orties certains des<br />
acquis les plus précieux du New Deal n’a pas été sans troubler l’establishment<br />
démocrate ni secouer ses alliés. De nombreuses voix se sont<br />
élevées jusqu’au sein du gouvernement pour dénoncer ce revirement<br />
politique et le reniement qu’il implique.
178<br />
UNE VRAIE-FAUSSE RÉFORME<br />
ABAISSEMENT DE L’ÉTAT-PROVIDENCE<br />
Plusieurs hauts responsables du ministère des Affaires sociales ont remis<br />
leur démission en signe de protestation, dont le directeur du Bureau des<br />
études du président Clinton, au motif que toutes les prévisions effectuées<br />
par ses services concluent que ladite « réforme » se traduira par un<br />
accroissement spectaculaire de la misère et de la précarité 1 . La présidente<br />
de la Ligue pour la protection de l’enfance, amie intime des Clinton, a<br />
publiquement coupé les ponts avec le couple présidentiel avant de qualifier<br />
d’« infamie » la décision du leader des « Nouveaux démocrates ». Les<br />
organisations religieuses, les syndicats et les associations caritatives l’ont<br />
condamnée à l’unanimité. Hugh Price, le président de l’Urban League –<br />
une association de défense des intérêts de la communauté noire pourtant<br />
réputée pour sa modération – résumait le point de vue des organisations<br />
progressistes en ces termes : « Cette loi est une abomination pour les<br />
mères et les enfants les plus vulnérables de l’Amérique. Il semble que le<br />
Congrès se soit lassé de la guerre contre la pauvreté et ait décidé de mener<br />
à la place une guerre contre les pauvres. 2 »<br />
Mais le débat a vite été étouffé par les impératifs électoraux : il ne fallait<br />
pas gêner le Président dans sa campagne de réélection. Clinton n’a<br />
d’ailleurs pas hésité à se servir de cette loi comme d’un ultime moyen de<br />
chantage sur l’aile gauche de son propre parti, arguant en substance :<br />
taisez-vous et renvoyez-moi à la Maison-Blanche car je suis le seul qui<br />
puisse adoucir les effets les plus néfastes de cette « réforme ». Quant aux<br />
forces conservatrices du pays, elles ne pouvaient que se réjouir de voir<br />
le Président rallier leurs positions et entériner un texte de loi en tous<br />
points similaire à ceux auxquels il avait par deux fois opposé son veto<br />
quelques mois auparavant (c’était avant que ne s’ouvre la saison électorale).<br />
Ainsi la United States Chamber of Commerce, principale organisation<br />
patronale du pays, s’est-elle félicitée que Clinton ait réaffirmé de<br />
la sorte « l’éthique du travail de l’Amérique », tandis que Newt<br />
Gingrinch, chef de file des républicains au Congrès, évoquait avec<br />
lyrisme un « moment historique où nous avons travaillé ensemble à faire<br />
quelque chose qui est très bon pour les États-Unis ». En Europe, et<br />
1. Le Président avait d’ailleurs refusé de transmettre au Congrès les résultats de<br />
ces études, craignant la publicité négative qui en résulterait.<br />
2. Hugh Price, « Welfare Hysteria», New York Times, 5 août 1996, p. A11.
LOÏC WACQUANT 179<br />
singulièrement en France, il n’a pas manqué de commentateurs aussi<br />
empressés que mal informés (la palme revenant sans doute à Claude<br />
Imbert en raison de ses éditoriaux asiniens dans Le Point) pour présenter<br />
cette mesure comme l’avancée courageuse d’un président « de gauche »<br />
visant à l’« adaptation » nécessaire des systèmes de protection aux nouvelles<br />
réalités économiques. Selon cette vision où l’ignorance des réalités<br />
étasuniennes le dispute à la mauvaise foi idéologique, Clinton<br />
tracerait la voie à suivre aux sociétés sclérosées du Vieux Monde.<br />
L’efficience et le succès dans l’impitoyable compétition économique<br />
mondiale seraient à ce prix.<br />
En fait, ladite « réforme » de l’aide sociale n’a rien d’une réforme puisqu’elle<br />
consiste à abolir le droit à l’assistance pour les enfants les plus<br />
démunis et à lui substituer, à plus ou moins brève échéance, l’obligation<br />
du salariat déqualifié et sous-payé pour leurs parents. Elle n’affecte qu’un<br />
secteur mineur des dépenses sociales de l’État américain – celles ciblées<br />
sur les familles pauvres, les infirmes et les indigents – à l’exclusion des<br />
programmes bénéficiant aux classes moyennes et supérieures – habituellement<br />
regroupés sous l’appellation « social insurance », par opposition au<br />
terme honni de « welfare 3 ». Enfin, loin d’innover, cette « réforme » ne<br />
fait que recycler des remèdes issus tout droit de l’ère coloniale et qui ont<br />
déjà fait la preuve de leur inefficacité par le passé 4 : établir une démarcation<br />
tranchée entre pauvres « méritants » et pauvres indolents, pousser<br />
ces derniers par la contrainte sur les segments inférieurs du marché du<br />
travail, et « redresser » les comportements supposés déviants et dévoyés<br />
qui seraient la cause de la misère des uns et des autres. Sous couvert de<br />
réforme, la « loi sur la responsabilité individuelle et le travail de 1996 »<br />
instaure le dispositif social le plus régressif promulgué par un gouvernement<br />
démocratique au XX e siècle. Son passage confirme et accélère le<br />
remplacement progressif d’un (semi-)État-providence par un État policier<br />
3. C’est là un cas particulier de l’allodoxia favorisée par la réinterprétation incontrôlée<br />
– car le plus souvent inconsciente – qu’un terme du débat sociopolitique<br />
subit en passant d’un cadre national à un autre. Ainsi, les observateurs européens<br />
traduisent « welfare » par « État-providence », vocable qui renvoie à l’ensemble<br />
des systèmes de protection et de transfert sociaux à vocation universelle, alors que<br />
les Américains mettent sous ce terme les seuls programmes catégoriels réservés<br />
aux populations relevant de la charité d’État.<br />
4. Michael Katz, In the Shadow of the Poorhouse : A Social History of Welfare in America,<br />
Basic Books, New York, 1996.
180<br />
ABAISSEMENT DE L’ÉTAT-PROVIDENCE<br />
et carcéral au sein duquel la criminalisation de la marginalité et la contention<br />
punitive des catégories déshéritées font office de politique sociale.<br />
LES FEMMES & LES ENFANTS D’ABORD, LES NOIRS TOUJOURS<br />
L’objectif affiché de cette loi est de résorber non pas la pauvreté mais la<br />
prétendue dépendance des familles assistées à l’égard des programmes<br />
sociaux, c’est-à-dire de dégraisser les effectifs et les budgets des<br />
programmes consacrés aux membres les plus vulnérables de la société<br />
étasunienne : les femmes et les enfants du prolétariat et du sousprolétariat<br />
5 , et secondairement les vieillards sans ressource ainsi que les<br />
immigrés récents.<br />
En effet, la « réforme » de 1996 ne touche ni à Medicare, l’assurance<br />
médicale des salariés retraités, ni aux caisses de retraite Social Security,<br />
qui sont pourtant les principaux postes des dépenses sociales de l’État<br />
américain avec 143 milliards de dollars et 419 milliards respectivement<br />
en 1994. Elle porte exclusivement sur les programmes catégoriels réservés<br />
aux pauvres assistés – AFDC, SSI (Supplemental Security Income,<br />
allocation pour les personnes âgées indigentes et infirmes) et coupons<br />
alimentaires (food stamps). Or ces programmes ne couvrent qu’une fraction<br />
de la population officiellement répertoriée comme démunie : en<br />
1996, 39 millions d’Américains vivaient en deçà du « seuil fédéral de<br />
pauvreté » (soit 15 000 dollars par an pour une famille de quatre personnes)<br />
mais moins de 14 millions (dont 9 millions d’enfants) touchaient<br />
l’allocation AFDC 6 ; et, en 1992, 43 % seulement des familles<br />
officiellement désignées comme pauvres recevaient une aide pécuniaire,<br />
51 % des coupons alimentaires et à peine 18 % bénéficiaient d’une aide<br />
au logement 7 . Ce sont les récipiendaires de l’AFDC et des food stamps<br />
qui feront les frais de la « réforme », bien que ces programmes soient dix<br />
fois moins coûteux que ceux réservés aux classes moyenne et supérieure,<br />
avec 22 milliards annuels pour l’AFDC (en comptabilisant<br />
5. Ruth Sidel, Keeping Women and Children Last, Viking, New York, 1996.<br />
6. En outre, 69 millions d’Américains, dont 6 millions de salariés à plein temps<br />
et 5,5 millions de travailleurs à temps partiel, disposaient de revenus annuels inférieurs<br />
à 150 % dudit seuil.<br />
7. Nancy Folbre et Center for Popular Economics, The New Field Guide to Economic<br />
Life in America, The New Press, New York, 1996, p. 68.
LOÏC WACQUANT 181<br />
ensemble dépenses fédérales et locales) et 23 milliards pour l’assistance<br />
alimentaire. Car la « loi sur la responsabilité individuelle et le travail »<br />
de 1996 entendait économiser 56 milliards de dollars en cinq ans en<br />
réduisant le montant des allocations, en plafonnant leur distribution et<br />
en excluant de leur champ des millions d’ayants droit – dont une majorité<br />
d’enfants et de personnes âgées sans ressources.<br />
Comment une société dans laquelle une mère célibataire sur deux et<br />
un enfant sur cinq (soit plus de 13 millions, dont 10 dépourvus de toute<br />
couverture sociale et médicale) vivaient en deçà du « seuil » officiel de<br />
pauvreté en 1995 peut-elle continuer à se convaincre que la misère qui<br />
frappe tant de ses membres les plus vulnérables est l’inévitable conséquence<br />
de leurs carences individuelles ? La réponse à cette interrogation<br />
est à chercher dans la prégnance de l’idéologie étasunienne de la famille,<br />
l’enfance et la maternité qui font des mères sans mari (et des enfants sans<br />
père) des êtres anormaux, tronqués, suspects, qui menacent l’ordre moral<br />
et que l’État est par conséquent tenu de placer sous une tutelle sévère.<br />
La pauvreté de ces « familles anormales » est perçue comme un<br />
« virus » dont la transmission doit être circonscrite à défaut d’être stoppée,<br />
un « ennemi » auquel on fait « la guerre », le précipité vivant d’une<br />
flétrissure indélébile et contagieuse du soi. Le tintamarre des discours<br />
inlassablement ressassés sur l’immoralité supputée des mères solitaires<br />
n’a d’égal que le silence retentissant sur les inégalités de classe, la discrimination<br />
sexuelle et les exigences perverses d’une bureaucratie paternaliste<br />
qui s’allient pour les maintenir en situation de précarité et de<br />
dépendance permanentes.<br />
L’historienne Linda Gordon a décrit comment le dilemme des mères<br />
célibataires fut, dès le début du XX e siècle, conçu comme un problème clinique<br />
: « Elles sont moralement mauvaises pour elles-mêmes comme<br />
pour leurs enfants et pour la société. 8 » Dans son livre Lives on the Edge,<br />
Valérie Polakow retrace la trajectoire de quinze jeunes mères célibataires<br />
du Michigan et rapporte les récits de vie quotidienne de leurs enfants à<br />
l’école afin de montrer comment ces représentations surannées et les programmes<br />
d’assistance qu’elles informent les enferment dans une nasse<br />
qui fait du mythe de la mauvaise mère une prophétie auto-réalisante :<br />
mauvaises mères elles sont si elles travaillent car elles sacrifient à la quête<br />
8. Linda Gordon, Heroes of their Own Life : The Politics and History of Family<br />
Violence, Penguin, New York, 1988, p. 11.
182<br />
ABAISSEMENT DE L’ÉTAT-PROVIDENCE<br />
de maigres revenus le soin de leur progéniture ; mauvaises mères elles<br />
sont si elles ne travaillent pas car alors elles vivent « aux crochets de<br />
l’État » et inculquent à leur progéniture les manières du parasite social 9 .<br />
La « réforme » des aides sociales de 1996 tranche en faveur de la première<br />
option, l’impératif du travail salarié (ou de ses succédanés et imitations,<br />
cours de remise à niveau, stage en entreprise, ou volontariat<br />
dans le secteur associatif) primant désormais sur le « devoir sacré »<br />
d’élever ses enfants.<br />
Mais surtout, de quelque côté qu’elles se tournent, les femmes déshéritées<br />
se trouvent condamnées à la misère chronique. En 1990, une mère<br />
isolée sur deux ne recevait aucun soutien financier du père de ses<br />
enfants du fait du laxisme et de la désorganisation des services sociaux,<br />
et celles qui touchaient une pension alimentaire devaient joindre les<br />
deux bouts avec 2 100 dollars annuels en moyenne. Une personne travaillant<br />
à plein temps toute l’année au taux horaire minimum gagnait à<br />
peine 700 dollars par mois, soit 20 % de moins que le seuil de pauvreté<br />
pour une famille de trois personnes. Une mère qui optait pour l’AFDC<br />
afin que ses enfants bénéficient d’une couverture médicale recevait 367<br />
dollars par mois en moyenne nationale, montant inférieur de 55 % au<br />
« seuil de pauvreté ». Loin de la soulager, l’État charitable américain est<br />
le principal responsable de la féminisation et de l’infantilisation de la<br />
misère aux États-Unis, dont il perpétue à la fois les mythes et la réalité,<br />
les représentations et la matérialité.<br />
Ces mesures draconiennes sont populaires auprès de l’électorat – des<br />
classes moyennes blanches – parce que le secteur du welfare est perçu<br />
comme profitant essentiellement aux Noirs. Qu’importe que la plupart<br />
de ses bénéficiaires soient de souche européenne (39 % des allocataires<br />
AFDC sont blanches, 37 % sont afro-américaines et 18 % hispanophones).<br />
L’idée fixe demeure que l’assistance aux pauvres ne sert qu’à<br />
entretenir dans l’oisiveté et le vice les habitants du ghetto, chez qui elle<br />
encouragerait ces « comportements antisociaux » que dénote et dénonce<br />
le terme mi-savant, mi-journalistique d’« underclass » 10 . L’association<br />
9. Valérie Polakow, Lives on the Edge : Single Mothers and their Children in the<br />
Other America, University of Chicago Press, Chicago, 1993.<br />
10. Sur ce vrai-faux concept, lire, entre autres, Mead, The New Politics of Poverty,<br />
op. cit. ; William Kelso, Poverty and the Underclass : Changing Perceptions of the Poor<br />
in America, New York UP, New York, 1993 ; et l’essai caricatural, et pour cela même
LOÏC WACQUANT 183<br />
étroite entre aide sociale et couleur de peau rend ces programmes particulièrement<br />
vulnérables au plan politique. Elle permet de mobiliser<br />
contre ce pan de l’État charitable la force des stéréotypes raciaux et des<br />
préjugés de classe qui, en se combinant, font du pauvre du ghetto un<br />
parasite social, voire un véritable « ennemi » de la société américaine. 11<br />
(On doit souligner ici que la dimension raciale de la « réforme » des<br />
aides sociales, euphémisée mais omniprésente dans le débat politique<br />
étasunien – le président Clinton était flanqué d’une forte matronne noire<br />
récipiendiaire de l’AFDC lors de la cérémonie médiatique marquant l’entrée<br />
en vigueur de la loi – est passée complètement inaperçue des commentateurs<br />
européens.)<br />
La justification des coupes brutales est que l’assistance sociale est trop<br />
généreuse, qu’elle sape la volonté au travail de ses bénéficiaires et qu’elle<br />
entretient une culture de « dépendance » délétère tant pour les intéressés<br />
que pour le pays. Justification réitérée à quelques variantes près tout<br />
au long du dernier siècle à chaque fois que la question de la pauvreté a<br />
resurgi sur la scène politique étasunienne 12 . En vérité, la valeur<br />
moyenne de l’allocation AFDC a baissé de moitié en un quart de siècle,<br />
passant de 676 dollars par mois en moyenne en 1970 à quelques<br />
342 dollars en 1995 (en dollars constants d’aujourd’hui), soit moins de<br />
la moitié du seuil de pauvreté. Ce qui signifie que les familles qui la touchent<br />
ne peuvent guère « dépendre » de cette allocation et qu’elles doivent<br />
forcément trouver d’autres revenus pour survivre. De fait, la<br />
majorité des allocataires AFDC exercent une activité pécuniaire, légale<br />
ou illégale, formelle ou informelle, et triment dur pour joindre les deux<br />
bouts 13 . En outre, la moitié des bénéficiaires quittent le programme<br />
dans l’année qui suit leur inscription et les deux tiers sous deux ans.<br />
fort instructif, de Myron Magnet, membre de la rédaction de Fortune Magazine et<br />
fellow au Manhattan Institute, The Dream and the Nightmare : The Sixties’ Legacy to<br />
the Underclass, William Morrow, New York, 1993.<br />
11. Evelyn Z. Brodkin, « The Making of an Enemy : How Welfare Policies<br />
Construct the Poor », Law and Society Inquiry, 18, automne 1993, p. 647-670.<br />
12. James T. Patterson, America’s Struggle Against Poverty, 1900-1985, Harvard UP,<br />
Cambridge, 1986.<br />
13. Mark Robert Rank, Living on the Edge : The Realities of Welfare in America,<br />
Columbia UP, New York, 1994, et Kathryn Edin, There is a Lot of Month Left at the<br />
End of the Money : How AFDC Recipients Make Ends Meet in Chicago, Garland<br />
Press, New York, 1993.
184<br />
ABAISSEMENT DE L’ÉTAT-PROVIDENCE<br />
Autant dire que l’allocation AFDC est loin d’être devenue un « way of<br />
life » comme l’affirment les idéologues néo-conservateurs et leurs épigones<br />
chez les « nouveaux démocrates ».<br />
Sur le papier, la « réforme » engagée par Clinton vise à « faire passer<br />
les gens de l’assistance à l’emploi ». Mais, d’une part, la plupart des mères<br />
assistées exercent déjà une activité rémunérée, bien qu’aux marges du<br />
salariat. D’autre part, et cela est révélateur de l’intention du législateur, le<br />
volet emploi de la loi est totalement inexistant. Aucun budget de formation<br />
professionnelle ni de création de postes n’y figure. Les quatre milliards de<br />
dollars de subventions pour frais de garderie (étalés sur six ans) ne sont<br />
qu’une goutte d’eau dans l’océan des besoins en la matière. Les « opportunités<br />
d’emploi » auxquelles fait généreusement référence le législateur<br />
sont laissées au bon vouloir des entreprises. Lors de la phase finale de la<br />
campagne présidentielle de 1996, Clinton lança un vibrant appel à la<br />
conscience civique du patronat, des Églises et des associations caritatives<br />
afin qu’elles « créent les emplois nécessaires pour que la réforme réussisse<br />
», arguant que les employeurs qui se plaignent sans cesse du welfare<br />
ont l’obligation morale d’embaucher les (ex-)allocataires. Mais on voit<br />
mal comment et pourquoi les entreprises se mettraient soudain à embaucher<br />
à tour de bras une population cruellement sous-qualifiée (la moitié<br />
des allocataires AFDC n’ont pas achevé leurs études secondaires et 1 %<br />
seulement possèdent un diplôme universitaire) et fortement stigmatisée<br />
alors que le marché du travail déqualifié regorge déjà de main-d’œuvre<br />
bon marché.<br />
À partir d’entretiens réalisés par téléphone auprès d’un échantillon<br />
représentatif de 800 employeurs dans chacune des quatre métropoles<br />
sélectionnées pour contrôler les variations régionales et démographiques<br />
(Atlanta, Boston, Detroit et Los Angeles), Harry Holzer a analysé<br />
le volume et la nature des emplois offerts aux travailleurs peu<br />
éduqués, leur distribution spatiale (centre-ville, zones ségréguées, banlieues<br />
prospères proches ou lointaines), le type de qualifications requises<br />
par les firmes qui embauchent, enfin les salaires de départ des travailleurs<br />
recrutés 14 . D’où il ressort que les habitants de couleur des<br />
quartiers ghettoïsés des métropoles cumulent tous les obstacles. Non<br />
seulement il y a moins d’emplois vacants au cœur des villes qu’à la péri-<br />
14. Harry J. Holzer, What Employers Want : Job Prospects for Less-Educated Workers,<br />
Russell Sage Foundation, New York, 1996.
LOÏC WACQUANT 185<br />
phérie et ces emplois sont à 80 % des services requérant un niveau éducatif<br />
et des compétences cognitives excédant largement les leurs, mais<br />
encore ces postes sont pourvus de manière informelle par recommandations<br />
et relations personnelles.<br />
En outre, les employeurs tendent à écarter les postulants ayant un profil<br />
d’emploi intermittent ou possédant des antécédents criminels ou<br />
délictueux. Enfin, la discrimination raciale persiste au détriment notamment<br />
des jeunes Noirs, qui sont les « derniers embauchés et premiers<br />
débauchés » dans presque tous les secteurs, et dont, au demeurant, les<br />
niveaux de rémunération sont particulièrement bas (bien souvent en<br />
deçà du seuil officiel de pauvreté) 15 . On voit à quel brillant avenir socioéconomique<br />
sont promis les bénéficiaires d’aide sociale poussés de force<br />
dans les segments inférieurs de ce secteur de l’emploi précaire et souspayé<br />
sur lequel ils entrent en cumulant tous les handicaps.<br />
De fait, cette législation se garde bien de s’affronter aux causes économiques<br />
de la pauvreté : stagnation du revenu moyen familial depuis<br />
vingt ans et baisse continue du salaire minimum depuis trois décennies ;<br />
croissance explosive du salariat dit « contingent », qui comprend aujourd’hui<br />
un quart de la main-d’œuvre du pays ; érosion de la couverture<br />
sociale et médicale des salariés peu qualifiés ; persistance de taux de<br />
chômage astronomiques dans les quartiers de relégation des grandes<br />
villes mais aussi dans bon nombre de comtés ruraux ; forte réticence des<br />
employeurs à embaucher les habitants des ghettos et les personnes<br />
déqualifiées vivant de l’aide sociale 16 . Il est plus commode, et plus rentable<br />
électoralement, de s’attaquer aux pauvres.<br />
METTRE LES PAUVRES AU PAS<br />
L’énorme pavé de plus de quatre cents pages approuvé par le président<br />
Clinton, dont nul ne maîtrise complètement la logique ni ne saisit toutes<br />
15. Sur ce point, lire Phil Moss et Chris Tilly, Why Black Men are Doing Worse in<br />
the Labor Market : A Review of Supply-Side and Demand-Side Explanations, Social<br />
Science Research Council, New York, 1991.<br />
16. National Research Council, Losing Generations : Adolescents at Risk, National<br />
Academy Press, Washington, 1993.
186<br />
ABAISSEMENT DE L’ÉTAT-PROVIDENCE<br />
les ramifications tant son architecture est complexe, s’appuie sur quatre<br />
principes qui tendent, en se conjuguant, à mettre hors-la-loi la misère et<br />
à reporter son poids sur les familles les plus déshéritées.<br />
Premièrement, cette législation abroge le droit à l’assistance dont jouissaient<br />
les enfants au titre du Social Security Act de 1935. À la place, elle<br />
instaure l’obligation pour les parents assistés de travailler au bout de<br />
deux ans ainsi qu’une durée cumulée maximale de cinq ans d’assistance<br />
sur une vie. Une fois épuisé son « quota », une mère sans ressources<br />
dont les enfants ont cinq ans révolus ne disposera plus d’aucun secours<br />
de la part de l’État : il lui faudra accepter n’importe quel emploi disponible<br />
(s’il en existe) et se tourner vers l’entraide familiale, la mendicité<br />
ou l’économie criminelle de la rue.<br />
En second lieu, le gouvernement fédéral cède la responsabilité des programmes<br />
d’assistance aux cinquante États de l’Union et, par-delà, aux trois<br />
mille comtés chargés de fixer les critères d’éligibilité, de distribuer les<br />
allocations et de mettre en place les éventuels programmes de formation<br />
et d’orientation professionnelles (pour peu qu’ils trouvent des financements)<br />
nécessaires pour « diriger les gens vers l’emploi ». Dans ce cadre<br />
décentralisé, les États et comtés ont toute latitude pour imposer des<br />
conditions d’attribution des aides plus restrictives que celles énoncées par<br />
la loi fédérale. Nombre d’entre eux ont déjà abaissé la durée cumulée<br />
d’assistance sur une vie de cinq à deux ans et supprimé diverses catégories<br />
d’allocation. Quelques semaines après le passage de la « loi sur la responsabilité<br />
individuelle et le travail », le gouverneur du Michigan, qui<br />
entendait faire de son État un « modèle national » dans la réforme des<br />
aides sociales, proposait de supprimer toute aide aux mères déshéritées<br />
qui ne travailleraient pas dans les six semaines suivant la naissance de<br />
leur enfant. Il n’y a là rien de surprenant vu que la loi met en place un<br />
système de primes et de pénalités financières encourageant les juridictions<br />
concernées à éliminer par tous les moyens les assistés, dont 25 %<br />
devaient impérativement être « mis au travail » dans l’année suivant sa<br />
promulgation et 50 % d’ici à l’an 2002. La définition du « travail » en<br />
question (salariat privé, emploi public subventionné, travail d’utilité collective,<br />
stage de formation, etc.) reste floue et doit être fixée par chaque<br />
État dans le cadre d’un accord contractuel avec le gouvernement fédéral.<br />
Le nombre d’heures hebdomadaires à effectuer sera de vingt lors de la<br />
première année et de trente par la suite.
LOÏC WACQUANT 187<br />
Or les budgets sociaux des États sont déjà en forte régression et tout<br />
indique qu’ils vont continuer à baisser 17 . La possibilité de transformer<br />
une partie des allocations sociales en subvention aux employeurs qui<br />
accepteraient d’embaucher des assistés ne résout rien. Elle ne fait que<br />
transférer le peu d’argent public qui circule de la poche des pauvres à<br />
celles des entreprises. Il est donc assuré que, par crainte d’attirer les<br />
assistés des régions avoisinantes tout autant que pour satisfaire au rigorisme<br />
fiscal et moral de leur électorat, les États vont tendre à s’aligner sur<br />
le « moins donnant » social et rogner plus encore leurs programmes<br />
dédiés aux plus défavorisés (qui eux ne votent pratiquement pas). Ceux<br />
qui en douteraient peuvent méditer ce précédent : quand la tutelle des<br />
hôpitaux psychiatriques est passée de Washington aux membres de<br />
l’Union dans les années 1970, les gouvernements locaux se sont empressés<br />
de les fermer et de jeter leurs malades à la rue, gonflant le flot des<br />
sans-abri et des épaves humaines qui hantent depuis les métropoles<br />
américaines. Ainsi on évalue à 80 % le nombre de sans-abri qui sont<br />
passés par un établissement psychiatrique 18 .<br />
« Les patients que nous examinons à la maison d’arrêt aujourd’hui sont<br />
les mêmes que nous avions l’habitude d’examiner dans les hôpitaux psychiatriques<br />
» il y a une vingtaine d’années, explique un ancien responsable<br />
du pavillon psychiatrique de la clinique de Men’s Central Jail à Los<br />
Angeles 19 . Car, suite à la politique de fermeture des grands hospices<br />
publics, le nombre de patients dans les asiles du pays a fondu de 559 000<br />
en 1955 à 69 000 quarante ans plus tard. Ces patients devaient théoriquement<br />
être pris en charge sur le mode déambulatoire par des « centres<br />
communautaires » 20 . Mais les cliniques de proximité supposées rempla-<br />
17. Mark Greenberg, Contract with Disaster : The Impact on States of the Personal<br />
Responsibility Act, Center for Law and Social Policy, Washington, 1994.<br />
18. Martha Burt, Over the Edge : The Growth of Homelessness in the 1980s, New York,<br />
Russell Sage Foundation, 1992, p. 57.<br />
19. Cité in « Asylums Behind Bars : Prisons Replace Hospitals for the Nation’s<br />
Mentally Ill », The New York Times, 5 mars 1998. Le transvasement des malades<br />
mentaux du système hospitalier au système carcéral est confirmé par une analyse<br />
statistique approfondie des données nationales par George Palermo, Maurice<br />
Smith et Frank Liska, « Jails Versus Mental Hospitals : A Social Dilemma »,<br />
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, <strong>n°</strong> 35-2, été<br />
1991, p. 97-106.<br />
20. Les chiffres sur les effectifs des hopitaux publics sont tirés de Andrew Rouse,<br />
Substance Abuse and Mental Health Statistics, Department of Health and Human
188<br />
ABAISSEMENT DE L’ÉTAT-PROVIDENCE<br />
cer les asiles ne se sont jamais développées, par carence de financements<br />
publics, et les centres existants ont périclité au fur et à mesure que les<br />
assurances privées se défaussaient et que la couverture médicale offerte<br />
par l’État fédéral se réduisait – alors même que le nombre d’Américains<br />
dépourvus d’assurance maladie s’enflait jusqu’à battre tous les records ces<br />
dernières années. La « désinstitutionnalisation » des malades mentaux dans<br />
le secteur médical s’est donc traduite par leur « réinstitutionnalisation » dans<br />
le secteur pénal – après qu’ils ont transité plus ou moins longtemps par le<br />
sans-abrisme. La majorité des infractions pour lesquelles ils sont écroués<br />
relève en effet de « troubles à l’ordre public » qui ne sont souvent rien<br />
d’autre que la manifestation de leurs troubles mentaux.<br />
Troisièmement, et c’est là le dispositif à la fois le plus anodin et le plus<br />
conséquent, les budgets de l’assistance sont désormais déterminés non<br />
pas en fonction des besoins des populations mais par dotations fixes<br />
appelées « block grants ». Le montant du programme TANF (Temporary<br />
Assistance to Needy Families, successeur bien nommé de l’Aid to<br />
Families with Dependent Children) pour l’ensemble du pays s’établissait<br />
ainsi à 16,3 milliards de dollars par an jusqu’en l’an 2002. Ce qui veut<br />
dire qu’en cas de montée du chômage et de la pauvreté du fait, par<br />
exemple, d’une récession ou de changements démographiques, les États<br />
doivent faire face à une demande d’aide accrue avec des moyens<br />
constants – sans compter les effets de l’inflation, qui n’entre pas dans le<br />
calcul des dotations TANF. Ce dispositif, dont l’objet est de plafonner le<br />
niveau des aides sociales quelles que soient les pressions à la hausse, ne<br />
manque pas d’aiguiser les tensions entre comtés et villes d’un État<br />
confronté à une résurgence de la misère sans les ressources pour y faire<br />
face. Il ne peut que renforcer la tendance au « localisme défensif », qui<br />
est l’une des causes majeures de l’extrême concentration de la misère<br />
dans les agglomérations américaines 21 .<br />
Enfin, cette législation sur l’aide sociale a exclu purement et simplement<br />
du registre des aides (y compris de l’assistance médicale aux indigents) un<br />
assortiment de catégories sociales privées de moyens de pression<br />
Services, Washington, 1998 ; pour une revue d’ensemble de cette politique de santé<br />
mentale, lire David Mechanic et David A. Rochefort, « Deinstitutionalization : An<br />
Appraisal Of Reform », Annual Review of Sociology, <strong>n°</strong> 16, 1990, p. 301-<strong>32</strong>7.<br />
21. Margaret Weir, « The Politics of Racial Isolation in Europe and America» in Paul<br />
E. Peterson (dir.), Classifying by Race, Princeton UP, Princeton, 1995, p. 217-242.
LOÏC WACQUANT 189<br />
politique : les résidents étrangers arrivés depuis moins de dix ans (qui<br />
pourtant paient impôts et cotisations sociales), les personnes condamnées<br />
pour infraction à la législation fédérale sur les stupéfiants, les enfants<br />
pauvres souffrant de handicaps physiques (<strong>31</strong>5 000 d’entre eux perdront<br />
leur allocation dans les six ans suivant le vote de la loi) et les filles-mères<br />
qui refuseraient de vivre chez leurs parents. Elle ampute également l’allocation<br />
des mères assistées qui rechigneraient à identifier le père naturel<br />
d’un de leurs enfants et interdit à tout adulte sans ressource ni progéniture<br />
de recevoir des coupons alimentaires pendant plus de six mois<br />
cumulés durant une période de trois ans. Et ce ne sont là que les éléments<br />
les plus visibles d’un vaste entrelacs de « stratégies de déni de droit »<br />
(disentitlement), qui ont pour but d’obstruer les canaux de distribution<br />
des aides 22 . L’une d’entre elles consiste à redéfinir dans un sens restrictif<br />
les afflictions médicales considérées comme relevant de l’infirmité : c’est<br />
la tâche à laquelle se sont attelés les bureaux d’aide sociale de plusieurs<br />
États, dans le but explicite de « reclassifier » des milliers d’infirmes<br />
comme aptes au travail, donc interdits d’assistance.<br />
La « loi sur la responsabilité individuelle et le travail » est entrée en<br />
vigueur en juillet 1997, mais n’a commencé à exercer ses effets à plein<br />
qu’à compter de l’automne 2002, lorsque la période-plafond d’aide de<br />
cinq ans a été atteinte pour les bénéficiaires les plus démunis, dont certains<br />
se sont retrouvés de ce fait privés de tout soutien. Ses dispositions<br />
sont si nombreuses, complexes et contradictoires que nul ne sait à ce<br />
jour comment et à quel rythme elles ont été appliquées. D’autant que les<br />
États disposent d’une large marge de manœuvre pour les adapter et que<br />
l’appareil judiciaire a été sollicité pour enrayer leur mise en œuvre par<br />
les organisations de défense des déshérités et par les maires des métropoles<br />
pénalisées par la mesure d’exclusion des aides infligée aux immigrés.<br />
Ainsi le maire (républicain) de New York, Rudolph Giuliani – qui<br />
pourtant a mené tout au long de ses mandats une guerre impitoyable<br />
aux pauvres de sa propre ville 23 – s’était-il élevé dès 1996 contre cette<br />
mesure en arguant qu’elle violait la Constitution fédérale. C’est surtout<br />
qu’elle menaçait de mettre à la rue des dizaines de milliers de New-<br />
22. Michael Lipsky, « Bureaucratic Disentitlement in Social Welfare Programs »,<br />
Social Service Review, <strong>n°</strong> 58, 1984, p. 2-27.<br />
23. Loïc Wacquant, « La mondialisation de la “tolérance zéro”», <strong>Agone</strong>, <strong>n°</strong> 22, 1999,<br />
p. 127-142, .
190<br />
ABAISSEMENT DE L’ÉTAT-PROVIDENCE<br />
Yorkais d’origine étrangère alors que la législation de l’État de New York<br />
fait obligation aux comtés (donc ici à la ville dont il avait la charge) de<br />
porter assistance aux personnes « en détresse ». Les comportements des<br />
administrations, des associations caritatives, des pauvres et de leurs<br />
familles se sont ajustés au nouveau système de contraintes créées par la<br />
« réforme ». On sait qu’en matière de politique sociale, les prévisions ne<br />
sont pas des prédictions 24 . Néanmoins, il n’était guère difficile d’anticiper<br />
les principaux effets de cette loi, toutes choses égales par ailleurs –<br />
et notamment à marché du travail constant.<br />
Elle allait tout d’abord provoquer un nouvel abaissement du niveau de<br />
vie des familles étasuniennes les plus pauvres puisque la valeur monétaire<br />
des aides et leur accessibilité étaient appelées à diminuer. D’après les prévisions<br />
du Bureau des études du ministère des Affaires sociales, entre<br />
2,5 et 3,5 millions d’enfants indigents seraient privés de toute aide en<br />
2002 par la seule application du quota des cinq ans maximum d’assistance,<br />
alors même que les États-Unis ont déjà le taux de pauvreté enfantine<br />
le plus élevé de tous les pays occidentaux : d’après la statistique<br />
officielle, un enfant sur quatre et un petit Noir américain sur deux grandit<br />
en dessous du « seuil de pauvreté » aux États-Unis, contre 6 % des<br />
enfants en France, Allemagne et Italie, et 3 % dans les pays scandinaves<br />
25 . Au 1 er janvier 1997, un demi-million de résidents étrangers perdraient<br />
également les modestes aides qu’ils recevaient jusque-là, telle<br />
l’allocation « Supplemental Security Income » de 420 dollars par mois<br />
accordée aux personnes âgées invalides. Une étude du Center on Budget<br />
and Policy Priorities de Washington calculait que les ménages survivant<br />
en deçà de la moitié du seuil de pauvreté (soit disposant de moins de 7 800<br />
dollars annuels pour quatre personnes) supporteraient la moitié des<br />
coupes dans le programme de coupons alimentaires (23 milliards de<br />
24. Theodor Marmor, Jerry Mashaw et Philip Harvey, America’s Misunderstood<br />
Welfare State : Persistent Myths, Enduring Realities, Basic Books, New York, 1990.<br />
25. Lee Rainwater et Timothy M. Smeeding, Doing Poorly : The Real Income of<br />
American Children in Comparative Perspective, Maxwell School of Citizenship and<br />
Public Affairs, Syracuse, Luxembourg Income Study Working Paper, <strong>n°</strong> 127,<br />
1995 ; Greg J. Duncan et Jeanne Brooks-Gunn, « Urban Poverty, Welfare Reform,<br />
and Child Development », in Fred R. Harris et Lynn A. Curtis (dir.), Locked in the<br />
Poorhouse : Cities, Race, and Poverty in the United States, Rowman & Littlefield,<br />
Lanham (Maryland), 1998, p. 21-<strong>32</strong>.
LOÏC WACQUANT 191<br />
dollars de moins en six ans) et que quelque 300 000 enfants d’immigrés<br />
perdraient de ce fait leur aide alimentaire.<br />
En jetant sur les segments périphériques du marché du travail des<br />
centaines de milliers de postulants supplémentaires corvéables à merci, la<br />
« réforme » de l’aide sociale promettait de déprimer le niveau des salaires<br />
déqualifiés et de contribuer ainsi à grossir les bataillons des working poors.<br />
L’économie informelle de la rue était donc assurée de connaître un regain<br />
de croissance, et avec elle la criminalité et l’insécurité qui rongent le tissu<br />
de la vie quotidienne dans le ghetto. Le nombre des personnes et familles<br />
sans-abri était appelé à se gonfler, de même que celui des indigents et des<br />
malades laissés sans soins, puisque la nouvelle loi interdit par exemple aux<br />
hôpitaux la prise en charge sur aide médicale gratuite des toxicomanes et<br />
le suivi prénatal des femmes condamnées pour possession ou trafic de stupéfiants.<br />
Les villes allaient pouvoir affaiblir les dernières organisations<br />
salariales à conserver un certain poids, les syndicats d’employés municipaux,<br />
en remplaçant progressivement les fonctionnaires locaux tenant des<br />
postes subalternes par la main-d’œuvre gratuite des programmes de travail<br />
forcé (workfare) auxquels les assistés sont tenus de participer.<br />
VERS UN COMPLEXE COMMERCIAL CARCÉRO-ASSISTANCIEL<br />
Au plan idéologique, cette « réforme » remet au goût du jour les stéréotypes<br />
malthusiens les plus éculés des « mauvais pauvres ». Elle réaffirme<br />
la fiction selon laquelle il suffirait de raviver par la contrainte<br />
matérielle les « valeurs familiales » et l’ardeur au travail des assistés pour<br />
vaincre la pauvreté et la « dépendance » dont ils souffrent 26 .<br />
Stéréotypes taillés sur mesure pour légitimer la nouvelle politique de la<br />
misère de l’État, qui pourra ainsi répondre à la montée des dislocations<br />
sociales et de la violence qui leur est étroitement liée dans le contexte<br />
urbain américain en amplifiant le « grand renfermement » des pauvres,<br />
et notamment des jeunes Noirs du ghetto – dont on a vu précédemment<br />
qu’ils sont la cible principale de ses interventions pénales. L’Amérique<br />
consacre d’ores et déjà dix fois plus d’argent à la répression criminelle<br />
qu’elle n’en n’alloue au soutien de ses citoyens déshérités. Tout indique<br />
que cet écart va aller se creusant.<br />
26. Nancy Fraser et Linda Gordon, « A Genealogy of “Dependency” : Tracing a<br />
Keyword of the U.S. Welfare State », Signs, <strong>n°</strong> 19, hiver 1989.
192<br />
ABAISSEMENT DE L’ÉTAT-PROVIDENCE<br />
Une autre conséquence de la « loi sur la responsabilité individuelle et<br />
le travail » est d’accélérer la « marchandisation » rampante de l’aide<br />
sociale. L’historien Michael Katz a montré que l’État charitable américain<br />
a une longue tradition de sous-traitance au privé qui remonte à l’ère<br />
coloniale 27 . Depuis sa phase d’expansion des années 1960, une part<br />
considérable des biens et des services alloués aux pauvres le sont par le<br />
truchement d’associations à but non lucratif et d’entreprises commerciales.<br />
En 1980, 40 % des dépenses sociales des États étaient reversées<br />
aux premières et 20 % aux secondes ; 40 % seulement passaient par le<br />
canal d’administrations publiques 28 . La « réforme » de l’aide sociale<br />
avalisée par Clinton décuple le marché privé des services sociaux car<br />
l’État américain ne possède pas les capacités bureaucratiques requises pour<br />
mettre en œuvre sa nouvelle politique de la misère. En effet, pour appliquer<br />
le « plafond » de cinq ans d’aide sociale à vie ou pour autoriser la<br />
simple attribution de coupons alimentaires, il faut disposer de données<br />
biographiques précises et exhaustives sur la trajectoire des postulants en<br />
matière d’assistance. À ce jour, aucun État ni comté ne possède de telles<br />
informations. Les fichiers administratifs existants ne contiennent que<br />
des données dispersées et fragmentaires, qui sont généralement effacées<br />
au bout de quelques mois. En outre, ces fichiers ne sont ni uniformes ni<br />
compatibles d’un lieu à l’autre ; et dans nombre de régions rurales, les<br />
dossiers des assistés sont encore traités manuellement à partir de fiches<br />
manuscrites. D’après le politologue Henry Brady – chargé par<br />
l’American Academy of Arts and Sciences de rédiger un rapport sur le<br />
sujet –, créer les systèmes informationnels requis pour mettre en application<br />
la nouvelle législation sur l’assistance demandera un effort administratif<br />
et financier colossal de plusieurs années, comparable à celui<br />
exigé par la création du système des caisses de retraite Social Security<br />
lors du New Deal. Or ladite loi ne prévoit aucun budget et n’assigne au<br />
gouvernement fédéral aucune mission de coordination des efforts des<br />
États et comtés en la matière 29 .<br />
27. Michael Katz, In the Shadow of the Poorhouse, op. cit.<br />
28. Lester M. Salamon, « The Marketization of Welfare : Changing Non-Profit and<br />
For-Profit Role in the American Welfare State », Social Service Review, 1993,<br />
<strong>n°</strong> 35, p. 11-28.<br />
29. Henry Brady et Barbara West Snow, Data Systems and Statistical Requirements for<br />
the Personal Responsibility and Work Opportunity Act of 1996, University of California,
LOÏC WACQUANT 193<br />
Pour pallier ces carences de l’appareil public, les mêmes firmes qui se<br />
disputent le florissant marché de l’emprisonnement privé s’offrent de<br />
fournir les systèmes informatiques « clefs en main » et les services administratifs<br />
et humains nécessaires pour appliquer la nouvelle loi. Des<br />
grandes entreprises comme Electronic Data System (la compagnie fondée<br />
et dirigée par le milliardaire texan et ancien candidat à la présidence Ross<br />
Perot), Lockeed Information Services (filiale du géant de l’armement<br />
Lockheed Martin), Andersen Consulting, IBM et Unysis vont faire<br />
concurrence aux associations caritatives et bénévoles sur le marché des<br />
services aux pauvres 30 . Moyennant copieuse rémunération, ces<br />
entreprises prendront en charge le suivi de la population des assistés. À<br />
l’instar de la population carcérale, celle-ci fera dorénavant l’objet d’un<br />
fichage extensif autorisant la multiplication des points de contrôle et de<br />
sanction. Situées au point de recoupement du social et du pénal, ces<br />
entreprises spécialisées dans la tutelle des pauvres et des prisonniers (qui<br />
étaient pauvres au-dehors et le redeviendront en sortant) sont l’élément<br />
moteur non pas d’un « complexe carcéro-commercial » – comme l’ont<br />
suggéré certains criminologues <strong>31</strong> – mais d’un complexe commercial carcéro-assistanciel<br />
sans précédent ni équivalent dans le monde occidental.<br />
Conformément à la tradition politique américaine, cet ensemble institutionnel<br />
composite en gestation se caractérise par l’interpénétration des<br />
secteurs public et privé d’une part, et par la fusion des fonctions de marquage,<br />
de redressement moral et de répression de l’État de l’autre.<br />
Dans The Poverty of Welfare Reform, le juriste Joel Handler relève que<br />
« la politique pénale et la politique sociale ont des allures étrangement<br />
similaires ces temps-ci <strong>32</strong> ». Les développements législatifs de l’été 1996<br />
ont pleinement confirmé cette intuition. Ainsi la vaste campagne d’incarcération<br />
qui a engorgé les prisons américaines a pris pour étendard<br />
UC Data, Berkeley, 1996 (document ronéoté préparé pour le Committee on<br />
National Statistics of the National Research Council, National Academy of Science).<br />
30. « Giant Companies Entering Race to Run State Welfare Programs », New York<br />
Times, 15 septembre 1996, p. 1 et 14 ; Barbara Ehrenreich, « Spinning the Poor<br />
into God : How Corporations Seek to Profit from Welfare Reform », Harper’s<br />
Magazine, <strong>n°</strong> 295, août 1997, p. 44-52 ; Adam Fifield, « Corporate Caseworkers »,<br />
In These Times, 16 juin 1997, p. 14-16.<br />
<strong>31</strong>. J. Robert Lilly et Paul Knepper, « The Corrections-Commercial Complex »,<br />
Crime & Delinquency, avril 1993, <strong>n°</strong> 39-2, p. 150-166.<br />
<strong>32</strong>. Joel F. Handler, The Poverty of Welfare Reform, Yale UP, New Haven, 1995, p. 137.
194<br />
ABAISSEMENT DE L’ÉTAT-PROVIDENCE<br />
le mot d’ordre « three strikes and you’re out » – c’est-à-dire perpétuité<br />
pour double-récidive. 33 Et la « réforme » des aides aux pauvres pourrait<br />
se résumer par le slogan : « Deux ans d’aides et vous êtes out. »<br />
C’est dire qu’on aurait tort de voir dans l’assentiment de Clinton à ce<br />
bouleversement de la politique sociale étatsunienne de la misère une<br />
décision «électoraliste », bien qu’elle soit aussi cela – le New York Times<br />
avait cru y discerner « une maîtresse manœuvre de campagne ». Il ne<br />
s’agit pas non plus d’un simple accident de parcours provoqué par l’accumulation<br />
de bévues tactiques suivies d’un bouleversement imprévu<br />
du paysage politique – comme essayait de s’en convaincre l’économiste<br />
David Ellwood, architecte du plan initial de réforme de Clinton<br />
retourné depuis à ses chères études à Harvard pour mieux y contempler<br />
(de loin) le désastre humain qu’il a contribué à faire advenir 34 .<br />
L’abolition du programme AFDC s’inscrit bien dans un vaste mouvement<br />
de reconstruction de l’État charitable américain qui vise à comprimer<br />
et à remodeler la sphère de la citoyenneté sociale dans un sens<br />
paternaliste et répressif tout en élargissant les prérogatives des entreprises<br />
privées au sein même de l’action publique.<br />
Le but de la « réforme » des aides sociales – discipliner les pauvres –<br />
est conforme à l’histoire de l’assistance aux États-Unis sur la longue<br />
durée comme à celle de la prison à sa naissance 35 . Il ne doit cependant<br />
33. L’expression « Three strikes and you’re out », qui appartient au vocabulaire sportif,<br />
signifie qu’à la troisième faute vous quittez le terrain de jeu… Selon cette loi,<br />
toute personne coupable de trois crimes graves (ou de certaines catégories de délits<br />
comme la simple possession de stupéfiants) est automatiquement condamnée à<br />
la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Certains États comme<br />
la Georgie imposent même la perpétuité pour simple récidive dans le cas d’atteintes<br />
contre les personnes.<br />
34. David Ellwood a notamment introduit au sein de l’administration démocrate<br />
l’idée d’une limitation dans le temps des aides sociales. Il récapitule ses espoirs<br />
et ses déboires dans ce combat-débat dans « Welfare Reform as I Knew It », The<br />
American Prospect, mai-juin 1996, <strong>n°</strong> 26, p. 22-29. Sur la collaboration objective<br />
et subjective des chercheurs dits « liberal » (progressistes) au virage punitif de<br />
la politique sociale étasunienne, lire Mimi Abramovitz et Ann Withorn, « Playing<br />
by the Rules : Welfare Reform and the New Authoritarian State », in Adolph Reed,<br />
Jr. (dir.), Without Justice For All : The New Liberalism and our Retreat From Racial<br />
Equality, Westview, Boulder, 1999, p. 151-173.<br />
35. Piven et Cloward, Regulating the Poor, op. cit. ; David Rothman, The Discovery<br />
of the Asylum : Social Order and Disorder in the New Republic, Little, Brown & Co.,<br />
Boston, 1971.
LOÏC WACQUANT 195<br />
pas masquer la fonction que la transition du « welfare state » au « workfare<br />
state » remplit dans la conjoncture présente à l’égard des Américains<br />
plus fortunés. À ces derniers, la mutation punitive de la politique sociale<br />
signifie sans équivoque que nul ne saurait se soustraire au salariat sans<br />
encourir une véritable dégradation matérielle et symbolique. Et elle rappelle<br />
que chacun ne doit compter que sur lui-même dans cette « guerre<br />
de tous contre tous » qu’est la vie sociale dans une société soumise au<br />
marché. Jeter les pauvres en pâture permet ainsi de réaffirmer avec éclat<br />
le primat idéologique de l’individualisme méritocratique au moment où<br />
la généralisation de l’insécurité salariale frappe de plein fouet les classes<br />
moyennes salariées et managériales et menace d’ébranler durablement la<br />
croyance pratique dans le mythe national du « rêve américain » 36 .<br />
LOÏC WACQUANT<br />
Ce texte est extrait de Punir les pauvres.<br />
La nouvelle politique de l’insécurité sociale,<br />
à paraître aux éditions <strong>Agone</strong><br />
36. Loïc Wacquant, « La généralisation de l’insécurité salariale en Amérique :<br />
restructurations d’entreprises et crise de reproduction sociale », Actes de la<br />
recherche en sciences sociales, novembre 1996, <strong>n°</strong> 115, p. 65-79 ; John E. Schwartz,<br />
Illusions of Poverty : The American Dream in Question, W. W. Norton, New York, 1998.
196<br />
À l’heure de la réforme de l’université française, on est en<br />
droit de s’interroger sur le type d’enseignement supérieur<br />
qui est aujourd’hui imposé, à marche forcée, à la<br />
communauté universitaire.<br />
Ce livre montre que l’ouverture internationale est un<br />
leurre, que les « innovations pédagogiques » autour du<br />
LMD (licence-master-doctorat) ont de très nombreux<br />
effets pervers sur le plan pédagogique et disciplinaire,<br />
que la professionnalisation à outrance se révèle souvent<br />
contraire à son intention, que la transformation des présidents<br />
d’universités en managers, entraîne une dérive<br />
de l’université gérée comme une petite entreprise, qui<br />
définira son offre de formation, sa politique de<br />
recherche, etc., en fonction de critères ne répondant<br />
plus forcément à ceux du service public, ni à ceux d’une<br />
recherche libre et autonome, liberté qui est pourtant au<br />
fondement même de l’idée d’université.<br />
Au final, les étudiants, que les modernisateurs disaient<br />
vouloir replacer « au centre », se trouvent relégués à<br />
la périphérie, victimes de réformes dont ils étaient<br />
censés être les premiers bénéficiaires.<br />
LA LEÇON DES CHOSES<br />
Abélard est un collectif composé de Luigi Del Buono, Christophe Gaubert, Frédéric Lebaron, Frédéric<br />
Neyrat, Fabienne Pavis, Maryse Ramambason, Charles Soulié et Sylvie Tissot, membres de la<br />
Coordination nationale recherche et enseignement supérieur. Ce travail a été réalisé en<br />
association avec des informateurs appartenant à différents établissements d’enseignement<br />
supérieur et de plusieurs disciplines. www.editionsducroquant.org
CHRISTOPHE GAUBERT<br />
Les effets délétères<br />
des « réformes » universitaires<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 197-208<br />
197<br />
FRANÇOIS FURET (s’adressant à Raymond Barre) : « Prenons l’Éducation<br />
nationale. Le système ne vous paraît-il pas démesurément<br />
centralisé, et tel que, profondément ingérable ? Par exemple, dans<br />
l’enseignement supérieur, faut-il conserver la collation nationale des<br />
diplômes ? […] Prenons le problème de l’enseignement, qui me paraît<br />
l’un des points les plus faibles de la gestion du pays par la majorité<br />
depuis 1981. L’effort de réforme a été particulièrement peu clair. Est-ce<br />
que vous êtes prêt à restituer à la société une partie de l’enseignement,<br />
par exemple dans l’enseignement supérieur, où c’est le plus facile et le<br />
plus évident, en appliquant vraiment la loi d’autonomie des établissements<br />
sur le plan financier, de gestion intellectuelle, etc. […] Jusqu’où<br />
peut aller le dessaisissement de l’État ? […]<br />
MICHEL ROCARD : « Je crois là [dans l’enseignement supérieur] à la nécessité<br />
d’une plus grande compétition ; je crois que l’autonomie des établissements<br />
universitaires accroît la qualité de l’enseignement et de la<br />
recherche et qu’une responsabilité de gestion est utile, y compris dans<br />
l’obtention d’une part des ressources, sous la forme de contrats avec le<br />
monde de la production. […] »<br />
FRANÇOIS FURET : « Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, pour introduire<br />
plus de compétition entre les établissements d’enseignement
198<br />
LA LEÇON DES CHOSES<br />
supérieur, à remettre en cause la notion de diplôme national ? Êtes-vous<br />
prêt à vous en prendre au mythe selon lequel tous les diplômes ont la<br />
même valeur ? » 1<br />
Il fallait sans doute toute l’assurance des dominants pour oser annoncer<br />
sans fard, au début des années 1980, mais il est vrai au public restreint<br />
des « lecteurs éclairés » du Débat 2 , le programme de destruction<br />
d’un système public d’enseignement supérieur dont les difficultés, en<br />
matière de fonctionnement, de production de connaissances ou de transmission<br />
des savoirs, n’étaient pas dénoncées pour elles-mêmes mais<br />
comme prétexte à l’imposition d’un programme de libéralisation et de<br />
marchandisation de l’enseignement supérieur et de la recherche. Depuis<br />
lors, l’université française a été soumise beaucoup plus explicitement à<br />
un programme de transformation à marche forcée, qui s’inscrit dans un<br />
système cohérent de réformes d’inspiration néolibérale destiné à redéfinir,<br />
à l’échelle internationale, le rôle de l’enseignement dans « l’économie<br />
du savoir » 3 : réforme « LMD » (licence, master, doctorat ou « 3-5-8 »,<br />
projet d’alignement sur le modèle anglo-saxon dominant – bachelor,<br />
master, PhD), « modernisation » (ex-« autonomie ») des universités,<br />
« projet Belloc » (qui prévoit une refonte des statuts des personnels universitaires<br />
et l’affectation d’une partie de ces derniers à la fonction exclusive<br />
d’enseignant, et non plus d’enseignant-chercheur) 4 . Toutes ces<br />
1. François Furet,« Une certaine idée de la France, Raymond Barre : entretien<br />
avec François Furet », Le Débat, <strong>n°</strong> 26, 1983, p. 27 ; « Une méthode en politique,<br />
Michel Rocard : entretien avec François Furet », Le Débat, <strong>n°</strong> 38, 1986,<br />
p. 34-35. Cité par Laurent Bonelli, in Le Passé d’une fondation. Projet intellectuel,<br />
groupes mobilisés et conditions sociales de la naissance de la fondation Saint-Simon,<br />
DEA de sciences politiques, université Paris X - Nanterre, 1997, p. 43.<br />
2. Sur la rhétorique des réformes caractéristique de la revue Le Débat, lieu de<br />
production de l’idéologie dominante, lire Le « Décembre » des intellectuels français,<br />
Raisons d’agir, Paris, 1998, p. 46-52.<br />
3. Lire Christian Laval et Louis Weber (dir.), Le Nouvel Ordre économique mondial,<br />
OMC, Banque mondiale, OCDE, Commission européenne, Syllepse, Paris,<br />
2002. Concernant la diffusion du paradigme de la « nouvelle économie du<br />
savoir », lire Pierre Milot, « La reconfiguration des universités selon l’OCDE.<br />
Économie du savoir et politique de l’innovation », Actes de la recherche en<br />
sciences sociales, <strong>n°</strong> 148, 2003, p. 68-73.<br />
4. Pour une présentation et une analyse critique de l’ensemble de ces réformes,<br />
lire Abélard, Universitas Calamitatum. Le livre noir des réformes universitaires, Le<br />
Croquant, coll. « Savoir / Agir », Broissieux, 2003.
CHRISTOPHE GAUBERT 199<br />
formules sont autant d’étapes sur la voie de la réalisation du programme<br />
esquissé ci-dessus par Michel Rocard et François Furet. Au point que<br />
l’on peut parler de « plan d’ajustement structurel » des universités, par<br />
analogie avec les recettes préconisées et imposées par la Banque mondiale<br />
aux pays sous-développés.<br />
UN PLAN D’AJUSTEMENT STRUCTUREL DES UNIVERSITÉS<br />
Les réformes et projets de réforme engagés successivement par les ministères<br />
Bayrou, Allègre, Lang et Ferry ont renforcé et institutionnalisé des<br />
transformations à l’œuvre au sein de l’enseignement supérieur depuis<br />
une trentaine d’années, marquées par la montée en puissance de disciplines<br />
nouvelles soumises à une demande sociale d’expertise 5 et d’outils<br />
techniques au service des entreprises et des administrations. La gestion,<br />
reconnue discipline d’enseignement supérieur et de recherche en 1968,<br />
en est un exemple paradigmatique 6 . Ces disciplines hétéronomes, structurellement<br />
soumises au monde économique, n’ont pas accédé à une<br />
véritable légitimité scientifique 7 , mais ont progressivement renforcé<br />
leurs effectifs et leur position de pouvoir au sein des universités.<br />
5. C’était déjà le cas des sciences humaines et sociales dont le premier essor<br />
date des années 1960. Pour le cas de la sociologie et de l’économie, lire Michael<br />
Pollak, « L’efficacité par l’ambiguïté. La transformation du champ scientifique<br />
par la politique scientifique : le cas de la sociologie et des sciences économiques<br />
en France », Sociologie et sociétés, vol. VII, <strong>n°</strong> 1, 1975, p. 30-49.<br />
6. Lire Fabienne Pavis, « Les restructurations universitaires à l’aune d’une discipline<br />
hétéronome, les sciences de gestion », journée d’étude de l’association<br />
Droit d’entrée, 29 novembre 2003. Les sciences de gestion et l’informatique<br />
(mais aussi, pour des raisons différentes, les STAPS) sont les disciplines dont le<br />
nombre d’enseignants du supérieur a le plus augmenté ces dix dernières années.<br />
7. Lire le rapport du Comité national d’évaluation (1993) cité par Fabienne<br />
Pavis, Sociologie d’une discipline hétéronome. Le monde des formations en gestion<br />
entre universités et entreprises en France. Années 1960-1990, doctorat de sociologie,<br />
sous la direction de Michel Offerlé, université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne,<br />
2003, p. 36. Dans cette étude (p. 12), on notera le jugement condescendant formulé<br />
en 1995 par l’économiste Edmond Malinvaud sur le gestionnaire comme<br />
« technicien d’analyse financière » et le « risque […] que la théorie soit mal<br />
assimilée par celui qui s’en sert pour des applications […] même quand on est<br />
détenteur d’un diplôme prestigieux ».
200<br />
LA LEÇON DES CHOSES<br />
Trois thématiques majeures ont accompagné ces évolutions de l’enseignement<br />
supérieur 8 . D’une part, dès l’origine, on a invoqué, pour les légitimer,<br />
les contraintes de la compétition économique internationale et<br />
l’impératif de modernisation de l’économie. D’autre part, à la logique du<br />
fonctionnement disciplinaire et de l’évaluation scientifique par les pairs,<br />
les promoteurs de ces transformations ont substitué celle de la gestion des<br />
établissements par un manager. Chaque établissement doit entrer en<br />
concurrence avec d’autres établissements pour l’accumulation de ressources<br />
économiques et institutionnelles, et obtenir la reconnaissance des<br />
entreprises, sources de revenus pour l’institution et de débouchés pour les<br />
étudiants. Le développement des formations « professionnalisées » et de<br />
la formation continue, ainsi que l’orientation vers des contrats de<br />
recherche « appliquée », ont été inspirés par cette logique gestionnaire,<br />
tout comme le projet actuel de recrutement d’étudiants-clients sur un<br />
marché des biens d’éducation. Enfin, c’est le métier même d’enseignantchercheur<br />
qui se trouve redéfini. Ces disciplines ont contribué, pour<br />
partie, à la révision à la baisse du droit d’entrée scientifique dans l’enseignement<br />
supérieur, en favorisant le recours à des « professionnels » (par<br />
opposition aux seuls universitaires), et au développement – dans une<br />
logique de gestion des ressources humaines – de la contractualisation des<br />
emplois. Elles l’ont fait, également, en récompensant la contribution et<br />
l’adhésion des personnels au « projet » de l’établissement, par exemple la<br />
traduction des enseignements en termes de biens marchands susceptibles<br />
d’assurer de nouvelles ressources économiques à l’institution.<br />
Faut-il pour autant regretter les facultés «à l’ancienne » ? En fait, il ne<br />
s’agit pas de déplorer la « fin des humanités ». La sociologie invite à rapporter<br />
ces transformations de l’enseignement supérieur et ces modifications<br />
des rapports de force entre disciplines (qui touchent les sciences de<br />
la nature, les lettres et sciences humaines) aux transformations du champ<br />
économique et à celles qui affectent les modes de reproduction des<br />
classes dominantes. Comme l’a observé Pierre Bourdieu, on assiste avant<br />
8. Elles inspirent également les rapports les plus récents sur la réforme de l’enseignement<br />
supérieur et de la recherche, comme Philippe Aghion et Élie Cohen<br />
(en collaboration avec Éric Dubois et Jérôme Vandenbussche), Éducation et croissance.<br />
Rapport du conseil d’analyse économique, La Documentation française, Paris,<br />
2004 ; Élie Cohen (dir.), « Réformer l’enseignement supérieur et la recherche.<br />
Un pacte pour une nouvelle université», Les Cahiers, <strong>n°</strong> 5, avril 2004.
CHRISTOPHE GAUBERT 201<br />
tout à la substitution d’un mode de reproduction (et de distinction)<br />
sociale à un autre : « La cote des humanités traditionnelles, qui tenaient<br />
leur valeur moins de leur utilité professionnelle ou de leur rentabilité<br />
économique que de l’étroitesse de leur diffusion, donc de leur pouvoir<br />
de distinction, tend à régresser au profit du capital culturel en sa forme<br />
scientifique et technique, et surtout bureaucratico-politique, dont la rentabilité<br />
économique est assurée par l’accroissement des nouvelles<br />
demandes de services symboliques. 9 »<br />
On peut constater, dès à présent, les effets les plus visibles de la mise<br />
en place actuelle de la réforme LMD. Cette réforme est la seule officiellement<br />
en cours : les mobilisations (principalement) étudiantes du<br />
printemps et de l’automne dernier ont, en effet, permis de différer la<br />
« modernisation des universités » (ex-loi « d’autonomie ») et la réforme<br />
du statut des enseignants-chercheurs, auxquelles aspirent toujours leurs<br />
principaux bénéficiaires éventuels, les présidents d’université notamment,<br />
dont les pouvoirs discrétionnaires et l’assise sociale locale pourraient<br />
être considérablement élargis. La réforme LMD, acceptée, au<br />
moins passivement, par la plupart des enseignants-chercheurs, qui n’ont<br />
le plus souvent manifesté aucune opposition et dont certains furent<br />
même atteints d’une frénésie « auto-réformatrice » 10 , constitue le cheval<br />
de Troie des deux autres réformes. En s’appuyant sur la différenciation<br />
déjà existante des établissements d’enseignement supérieur 11 et sur les<br />
effets de la mise en place des nouvelles licences et des masters, diplômes<br />
« nationaux » sans cadrage national, certains experts entendent en effet<br />
reconfigurer la carte universitaire, modifier le mode de gestion des universités<br />
et conduire à une réforme des statuts. Mieux qu’une rupture<br />
brutale, c’est le type de réforme « incrémentale » préconisée par Philippe<br />
Aghion et Élie Cohen : elle aurait, espèrent-ils, le mérite d’éviter de faire<br />
descendre les étudiants dans la rue 12 .<br />
9. Pierre Bourdieu, La Noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Minuit,<br />
Paris, coll. « Le Sens Commun », 1989, p. 484.<br />
10. Lire Abélard, Universitas…, op. cit., p. 101 et sq.<br />
11. La politique de différenciation des établissements d’enseignement supérieurs<br />
est en effet toujours à l’œuvre : un décret présenté en conseil des<br />
ministres le mercredi 25 février 2004 accorde le statut de « grand<br />
établissement » à l’université de Dauphine (sur le modèle de Sciences-po) pour<br />
lui permettre – entre autres – de sélectionner ses candidats à l’entrée.<br />
12. Lire Philippe Aghion et Élie Cohen, Éducation et croissance…, op. cit.
202<br />
LES EFFETS DESTRUCTEURS DE LA RÉFORME LMD<br />
LA LEÇON DES CHOSES<br />
La réforme LMD – supposée unifier l’enseignement supérieur à un niveau<br />
européen et favoriser la « mobilité » des étudiants – est déjà entrée en<br />
application dans certaines universités, sans moyens supplémentaires 13 .<br />
Dans la plupart des autres universités, les négociations avec le ministère<br />
de l’Enseignement supérieur sont entamées, en prévision de la rentrée<br />
prochaine (2004-2005) ou de la suivante et, déjà, certaines maquettes<br />
ont été retournées à l’envoyeur avec des refus d’habilitation dont le principe<br />
reste au demeurant fort obscur. Sans doute, le « diagnostic » du Livre<br />
noir des réformes universitaires, qui mettait l’accent sur les limites (économiques<br />
et linguistiques) restreignant la « mobilité » des étudiants, sur la<br />
différenciation des universités et des filières, sur la promotion d’une<br />
« pluridisciplinarité du pauvre », sans principes ni moyens, sur la difficile<br />
survie des disciplines et des productions disciplinaires, etc., était-il en<br />
deçà de la réalité. Les premiers effets délétères de cette réforme se font<br />
durement sentir, au niveau de la différenciation des institutions tout<br />
d’abord, des relations entre disciplines et de leur recomposition ensuite,<br />
au niveau de la désorientation des étudiants enfin. Parce qu’il n’a jamais<br />
été question de s’attaquer sérieusement aux inégalités sociales et culturelles<br />
d’accès aux différentes filières et établissements d’enseignement<br />
supérieur (grandes écoles et filières universitaires, classes préparatoires,<br />
IUT et petites écoles professionnelles, etc.), ni à la contribution propre du<br />
système d’enseignement au renforcement de l’inégale valeur scolaire des<br />
étudiants, la mise en place de la réforme se traduit d’ores et déjà par un<br />
accroissement des écarts entre les privilégiés et les laissés-pour-compte de<br />
l’enseignement supérieur.<br />
La mise en place des réformes s’opère par vagues d’habilitations successives.<br />
Certaines universités (par exemple Lyon 2, Bordeaux 2, etc.)<br />
ont soumis leurs nouvelles maquettes à l’habilitation ministérielle l’année<br />
dernière et ont pu ouvrir, dès cette année, leurs « nouvelles » licences<br />
(trois années d’études après le baccalauréat) et leurs masters (deux<br />
années d’études après la licence). Il semble que cette minorité d’universités<br />
n’ait pas rencontré de difficultés particulières à faire valider ses projets<br />
par le ministère de l’Éducation nationale. Les refus ou les difficultés<br />
13. Quatre « vagues » d’habilitations sont prévues, à raison d’une par année : la<br />
première fut celle de l’année 2002-2003.
CHRISTOPHE GAUBERT 203<br />
semblent plus nombreux pour la deuxième vague, qui concerne un plus<br />
grand nombre d’établissements. Comment, par ailleurs, ne pas s’étonner<br />
que la plupart des universités parisiennes, dominantes, fassent seulement<br />
partie de l’avant-dernière ou de la dernière vague d’habilitation ?<br />
Disposant ainsi de la durée pour observer les premiers effets de la<br />
réforme, elles seront en mesure d’élaborer et négocier au mieux la mise<br />
en place de leur « offre de formation ».<br />
La hiérarchisation de l’enseignement supérieur s’intensifie également<br />
dans la mesure où l’octroi ou non des masters à tel ou tel établissement<br />
préfigure la coupure entre « collèges universitaires » et « pôles d’excellence<br />
». Les premiers, répartis sur l’ensemble du territoire national, proposeront<br />
une licence à la grande masse des étudiants. Ils sont d’ores et<br />
déjà quasiment considérés comme l’analogue d’un lycée, la licence se<br />
substituant de fait à des baccalauréats qui, avec leur multiplication<br />
récente (baccalauréat technologique et, plus encore, baccalauréat professionnel),<br />
ne jouent plus aussi efficacement leur rôle de filtre à l’entrée<br />
de l’enseignement supérieur, et ne garantissent plus automatiquement la<br />
possession de la culture scolaire minimale permettant orientation et survie<br />
à l’université 14 . Les seconds, pôles d’excellence virtuels, concentrent<br />
déjà les ressources matérielles et intellectuelles les plus importantes. Ils<br />
sont supposés contribuer à assurer le rang de la France dans la compétition<br />
scientifique et économique internationale. Leur constitution est<br />
l’occasion de maintenir ou d’intensifier la sélection à l’entrée de certains<br />
troisièmes cycles.<br />
Au niveau des masters, c’est à la fois un flou grandissant et l’hétérogénéité<br />
la plus totale qui commencent à régner dans la définition des<br />
« disciplines », la multiplication des masters professionnels (comme,<br />
auparavant, des DESS), contribuant à la dissolution des identités<br />
disciplinaires. Dans certaines grosses universités, où les « réforma-<br />
14. Ce « constat » (développé par exemple par Philippe Aghion et Élie Cohen)<br />
repose sur la description sociologique de l’arrivée de « nouveaux publics » au<br />
sein de l’enseignement supérieur, promus par la politique volontariste d’accession<br />
de « 80 % d’une génération » au baccalauréat. La division traditionnelle<br />
du travail entre sociologie et économie permet toutes les méprises et les manipulations,<br />
qui peuvent devoir aussi partiellement aux caractéristiques objectives<br />
des produits scientifiques mobilisés (les études de cas du sociologue) à<br />
l’appui de la « démonstration » de l’économiste.
204<br />
LA LEÇON DES CHOSES<br />
teurs » occupent sans doute une position relativement forte (tel professeur<br />
ou vice-président a été membre du cabinet du ministre de l’Éducation,<br />
tels ou tel enseignant expertise les dossiers pour le compte du<br />
ministère), les mentions disciplinaires sont reconduites et restent visibles<br />
au plus haut niveau des intitulés de formations ou de diplômes.<br />
Au sein des universités aux effectifs plus restreints et au capital social<br />
moins fourni, l’intitulé disciplinaire tend à disparaître ou à se fondre<br />
dans l’ensemble, accompagnant la dissolution des enseignements dans<br />
un amas d’ex-disciplines 15 .<br />
La fabrication de nouveaux cursus (plus ou moins pluridisciplinaires),<br />
l’existence de « crédits » de formation (ou unités capitalisables), la multiplication<br />
de diplômes très différents d’une université à l’autre (sur le<br />
modèle des DESS ou des licences professionnelles – plus récentes) sont<br />
ainsi les instruments qui vont conduire à la désagrégation d’un grand<br />
nombre de disciplines. Mais si toutes les disciplines sont concernées,<br />
elles sont inégalement touchées : on peut s’interroger sur la logique qui<br />
préside à la reconduction quasi à l’identique des formations juridiques,<br />
qui semble aller de soi, et se demander ce qui vaut à la médecine d’être<br />
également épargnée. En outre, cette recomposition conduit à la hiérarchisation<br />
des institutions universitaires, qui vont pouvoir décerner des<br />
diplômes « maison », signant de ce fait la fin du caractère national des<br />
diplômes. Laquelle est également favorisée par la diversification des<br />
parcours étudiants, avec la mise en place des crédits de formation, et par<br />
le niveau inégal de reconnaissance des disciplines selon les masters<br />
proposés dans chaque université.<br />
15. En effet, chaque diplôme se décline selon quatre niveaux hiérarchiques. Du<br />
plus élevé au moins élevé : domaine (tel que « sciences humaines »), mention<br />
(telle que « histoire »), spécialité (telle que « histoire médiévale »), parcours.<br />
Mais si l’on en juge par les retours actuels de maquettes présentées au ministère<br />
pour reconnaissance, dans telle université l’intitulé disciplinaire est situé plutôt<br />
au niveau supérieur de la mention (l’étudiant sera donc titulaire d’un master de<br />
sciences humaines, mention histoire, etc.) tandis que dans telle autre l’histoire<br />
sera ravalée au rang de spécialité, la mention prenant alors la forme d’un intitulé<br />
thématique très général (par exemple « territoires, pouvoirs, cultures, patrimoines<br />
») regroupant sous son aile plusieurs spécialités (histoire, géographie,<br />
etc.). Pour les étudiants, ceci se traduira, de fait, par une inégale valeur des<br />
diplômes (certaines mentions disciplinaires auront disparu où seront moins<br />
visibles), inégalement « lisibles » pour les employeurs sur le marché du travail.
CHRISTOPHE GAUBERT 205<br />
La mutualisation de certains enseignements confronte de fait les universitaires<br />
à une hétérogénéité accrue du niveau de connaissance des étudiants,<br />
issus de plusieurs « disciplines ». Ce qui entraîne, de facto, un<br />
abaissement de la quantité et du niveau « d’information » transmis en<br />
cours, ou une baisse du rendement du travail pédagogique. On ne peut<br />
que constater la distance qui s’instaure chaque jour un peu plus entre les<br />
savoirs disciplinaires les plus récents produits par les chercheurs et enseignants-chercheurs<br />
– et éventuellement transmis dans certains troisièmes<br />
cycles sélectifs – et les enseignements dispensés en premier cycle 16 . La<br />
mutualisation des enseignements induit également le morcellement des<br />
emplois du temps ; de ce fait, elle n’est pas sans effets sur l’organisation<br />
des activités de recherche. Si on y ajoute la part grandissante occupée par<br />
l’organisation de « stages », on peut prédire que c’est dans cette brèche<br />
que s’engouffreront prochainement les promoteurs d’une réforme du<br />
statut d’enseignant-chercheur vouant certains d’entre eux aux premiers<br />
cycles et au seul enseignement. Enfin, la mutualisation s’instaure entre<br />
établissements, associant ici une université catholique et une faculté de<br />
sciences humaines, là une école d’agriculture et une faculté des sciences,<br />
etc. : la seule instauration du LMD modifie ainsi en pratique la politique<br />
des établissements, d’abord dans une optique gestionnaire, sans qu’il ait<br />
été nécessaire de passer par la réforme des structures attendue de la « loi<br />
de modernisation » de l’enseignement supérieur.<br />
Dans certains cas, ce sont des cursus universitaires qui sont menacés<br />
de disparition (par exemple, les sciences du langage) ou qui sont cantonnés<br />
dans les premiers cycles et composés d’enseignements disparates<br />
que l’on ne peut appeler « pluridisciplinaires » que par abus de langage<br />
tant il est vrai que, chaque jour davantage, est refusé aux établissements<br />
universitaires l’octroi de moyens d’inculquer durablement les savoirs et<br />
les savoir-faire constitutifs de chaque discipline : nombre d’heures d’enseignements<br />
disciplinaires revus à la baisse, pénurie de postes d’enseignants-chercheurs<br />
et de personnels administratifs et techniques. Dans<br />
telle ou telle université, la fabrication d’un cursus conjoint à partir de<br />
deux anciennes disciplines ou plus (physique et biologie ou, autre<br />
exemple, l’adjonction de gestion et de droit à une ancienne maîtrise de<br />
chimie) risque de ne constituer que des adaptations à courte vue pour<br />
16. La faiblesse des moyens dont disposent la plupart des bibliothèques universitaires<br />
n’est pas faite pour favoriser l’accès – même formel – à ces savoirs.
206<br />
LA LEÇON DES CHOSES<br />
l’accès éventuel à des emplois intermédiaires sur un segment étroit du<br />
marché du travail. A contrario, elle contribue à lier durablement l’étudiant,<br />
ni biologiste ni physicien (ni gestionnaire et sans doute encore<br />
moins juriste ou chimiste), à sa formation initiale et à son université<br />
d’origine, lui interdisant probablement d’accéder aux cursus disciplinaires<br />
plus valorisés des « pôles d’excellence ».<br />
Au sein de chaque discipline ou presque, des enseignements fondamentaux<br />
sont réduits ou disparaissent au gré des rapports de force<br />
locaux entre présidents d’universités, représentants syndicaux reconvertis<br />
dans la gestion des établissements et représentants des UFR. Ici, c’est<br />
la physique quantique qui fera les frais de la réforme d’un cursus de physique<br />
; là, un enseignement de statistique en sciences sociales ou de<br />
méthodes d’enquêtes qui va être réduit à la portion congrue ; ailleurs, les<br />
langues rares ou anciennes ; etc. Ces coupes drastiques, dictées par les<br />
contraintes réglementaires et budgétaires, entraînent une concurrence<br />
accrue entre départements disciplinaires et enseignants de différentes<br />
disciplines pour leur survie institutionnelle, en terme de postes, de<br />
nombre d’étudiants, d’horaires d’enseignements : l’institution universitaire<br />
s’éloigne chaque jour un peu plus de la coordination rationnelle des<br />
forces pédagogiques dans la construction d’un cursus cohérent. Le calendrier<br />
imposé n’y contribue en rien lui non plus.<br />
Dans ce processus, les langues vivantes deviennent des disciplines<br />
ancillaires, les enseignements de lettres et civilisation laissent progressivement<br />
la place à de l’anglais pour médecin, pour sociologue ou pour<br />
informaticien. De plus, si le nombre d’heures d’enseignement linguistique<br />
en licence ou en master est réduit (et d’autant plus lorsque ces<br />
licences sont supposées pluridisciplinaires), les compétences linguistiques<br />
exigées demeurent les mêmes, rhétorique de l’internationalisation<br />
oblige. À en croire certains préposés à la mise en place des réformes<br />
(directeurs d’UFR, etc.), il suffirait alors de recourir à l’auto-formation.<br />
Dans la novlang réformatrice, il s’agit pour chacun de devenir « acteur de<br />
sa formation », avec tout ce que cela sous-entend d’inégalité des chances<br />
d’accès à des logiciels ou à des cours privés de langue. De leur côté, les<br />
enseignants concernés seront progressivement réduits à la fonction de<br />
certificateurs de compétences (supposées) acquises ailleurs 17 .<br />
17. Sur ces questions, lire Frédéric Neyrat, « De l’éducation permanente à la<br />
certification permanente. La validation des acquis de l’expérience, levier de
CHRISTOPHE GAUBERT 207<br />
L’accent mis sur la nécessité de la « professionnalisation » des étudiants<br />
reproduit, à une autre échelle et à un autre niveau du cursus scolaire, une<br />
opposition séculaire, caractéristique du système scolaire français. D’un<br />
côté, il s’agit d’organiser l’orientation renouvelée vers des métiers pratiques,<br />
plus précoce et opérée par défaut sur la base de la faiblesse des<br />
résultats scolaires antérieurs. Le système d’enseignement, en vouant certains<br />
élèves aux cycles courts (licences professionnelles) et à l’acquisition<br />
de savoirs techniques parcellisés, contribue ainsi à constituer une maind’œuvre<br />
ajustée de « techniciens » (ouvriers, techniciens, cadres d’exécution).<br />
C’est ce que préfigurent les innombrables licences<br />
professionnelles du type « Management des métiers du golf », « Danse<br />
et science », « Animateur de sécurité routière », « Métiers de la médiation<br />
éducative », « Commerce et distribution, mention management de<br />
rayon », parfois directement liées à une entreprise dominante sur un segment<br />
du marché du travail local 18 . Chez les universitaires, cela se traduit<br />
par la distinction négative d’une partie d’entre eux, voués au seul enseignement<br />
(de moins en moins disciplinaire) comme au suivi des stages 19 ,<br />
sans liens assurés avec une activité de recherche. De l’autre côté, c’est<br />
l’accès à des formations où les possibles scolaires et professionnels restent<br />
longtemps très ouverts qui est préservé – dont la forme extrême est<br />
caractérisée par l’accès aux grandes écoles –, ainsi que la reproduction<br />
d’une bourgeoisie en voie d’internationalisation.<br />
La réforme se traduit enfin par la désorientation des étudiants<br />
condamnés à déchiffrer des intitulés de master plus ou moins fantaisistes<br />
et sybillins, dans lesquels on cherche en vain une quelconque cohérence<br />
disciplinaire. Le démembrement des cursus ou des disciplines au profit<br />
d’unités interchangeables est opéré sans aucune réflexion sur ses effets en<br />
matière d’apprentissage intellectuel 20 . En fait, c’est l’idée même de<br />
transformation de l’enseignement supérieur », Cahiers de la recherche sur l’éducation<br />
et les savoirs, <strong>n°</strong> 2, 2003, p. 225-255.<br />
18. Sur ce dernier point, lire Christian de Montlibert, « La “professionnalisation”<br />
des enseignements universitaires », <strong>Agone</strong>, <strong>n°</strong> 29/30, 2003, p. 195-202.<br />
19. Sur la critique de la culture du « stage » et du rapport de stage, comme sur<br />
l’importance tant intellectuelle que directement professionnelle de la transmission<br />
de manières de construire scientifiquement l’objet de connaissance, lire<br />
Yves Winkin, La communication n’est pas une marchandise. Résister à l’agenda de<br />
Bologne, Labor-Espace de Liberté, Bruxelles, 2003.<br />
20. Je reprends ici des éléments du chap. III d’Universitas Calamitatum…, op. cit.
208<br />
LA LEÇON DES CHOSES<br />
cursus, c’est-à-dire d’un cours régulier des études ayant pour fin l’apprentissage<br />
systématique et rationnel d’une discipline donnée, sur un<br />
temps suffisamment long, qui disparaît pour bon nombre d’étudiants. Ils<br />
font les frais de la promotion d’une logique individualiste et éclectique,<br />
évoquant un supermarché du pauvre approvisionné au gré des ressources<br />
académiques locales et des stratégies économiques des investisseurs.<br />
La généralisation de formats pédagogiques très courts (organisés<br />
au maximum sur un semestre) rend impossible la réalisation d’exercices<br />
et le suivi de travaux de recherche sur une année, c’est-à-dire l’apprentissage<br />
du travail intellectuel et une première confrontation à l’exercice<br />
de la recherche. Elle encourage la distribution parcimonieuse de résultats<br />
scientifiques forcément partiels et voués à l’obsolescence à plus ou<br />
moins court terme, la reproduction du canon des œuvres ou des travaux,<br />
plutôt que la transmission active et continue d’un « art d’inventer ».<br />
Avec ces réformes, l’enseignement supérieur français s’éloigne plus que<br />
jamais d’un enseignement réellement démocratique qui se donnerait<br />
pour fin de « permettre au plus grand nombre possible d’individus de<br />
s’emparer dans le moins de temps possible, le plus complètement et le<br />
plus parfaitement possible, du plus grand nombre possible d’aptitudes<br />
qui font la culture scolaire à un moment donné». Le projet de « neutraliser<br />
méthodiquement et continûment, de l’école maternelle à l’université,<br />
l’action des facteurs sociaux d’inégalité culturelle » 21 doit<br />
aujourd’hui être défendu contre tous les promoteurs de cette nouvelle<br />
politique d’inégalités.<br />
CHRISTOPHE GAUBERT<br />
21. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers. Les étudiants et la<br />
culture, Minuit, Paris, 1964, p. 114-115.
ISABELLE KALINOWSKI & REINHARD GRESSEL<br />
Pourquoi les politiques<br />
impérialistes ?<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 209-212<br />
209<br />
Introduction aux « Fondements économiques<br />
de “l’impérialisme” » de Max Weber<br />
LE TEXTE QUI SUIT est un extrait à ce jour inédit en français de l’œuvre<br />
posthume du sociologue allemand Max Weber (1864-1920), Économie<br />
et société 1 . Tiré du chapitre consacré aux « Communautés politiques<br />
», il propose un bref schéma d’explication des politiques<br />
impérialistes des États anciens et modernes. Écrit avant 1914, il est antérieur<br />
à la publication de L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme de<br />
Lénine (paru en russe en 1916 puis, en traduction, à partir de 1920 2 )<br />
et constitue l’un des premiers témoignages d’une prise de position « académique<br />
» sur la question. Le journaliste libéral anglais John A. Hobson<br />
avait lancé la discussion avec son ouvrage de 1902, Imperialism. A Study ;<br />
elle avait ensuite été reprise par deux intellectuels marxistes non<br />
1. Le premier tome de cet ouvrage édité après la mort de Weber à partir d’un<br />
manuscrit inachevé a été publié en français sous le titre Économie et société (traduit<br />
sous la direction de Jacques Chavy et Éric de Dampierre, Plon, 1971 ;<br />
réédition Presses Pocket, 1995, 2 vol.). Le second tome comprend trois chapitres<br />
: le premier est paru sous le titre Sociologie du droit (traduction Jacques<br />
Grosclaude, PUF, 1986) ; les deux derniers, Communautés politiques et Sociologie<br />
de la domination, n’ont pas encore été traduits en français.<br />
2. Lénine, L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme, Éditions sociales, 1979.
210<br />
LA LEÇON DES CHOSES<br />
universitaires enseignant à l’École du parti social-démocrate de Berlin,<br />
Rudolf Hilferding (Le Capital financier, 1910 3 ) et Rosa Luxemburg<br />
(L’Accumulation du capital. Contribution à l’explication économique de l’impérialisme,<br />
1913 4 ). Max Weber ne les cite pas ; son texte se réfère, sans<br />
donner plus de précisions, à la thèse marxiste postulant que « la formation<br />
mais aussi l’expansion des grandes puissances obéissent toujours de<br />
prime abord à des déterminations économiques ».<br />
Max Weber affirme dans un premier temps que « cette conjonction ne<br />
se rencontre pas nécessairement, et que le rapport de causalité n’est en<br />
aucun cas univoque » ; il livre dans la première partie des « Fondements<br />
économiques de “l’impérialisme”» (qui n’est pas reproduite ici) plusieurs<br />
exemples historiques dans lesquels les intérêts politiques priment sur les<br />
intérêts économiques. Mais il ajoute dans un deuxième temps : « Si les<br />
échanges de biens en tant que tels ne constituent en aucun cas le facteur<br />
décisif des mouvements d’expansion politique, la structure de l’économie<br />
en général est cependant très fortement déterminante pour le degré et<br />
pour le mode d’expansion politique. » Sa définition de « l’impérialisme<br />
capitaliste » (qui fait l’objet de l’extrait ci-dessous) met l’accent sur la<br />
diversité des intérêts économiques qui sont en jeu dans les guerres et les<br />
menées impérialistes : les visées marchandes ne sont pas seules en cause,<br />
et elles peuvent s’avérer moins décisives que les intérêts de l’industrie<br />
lourde (productrice d’armements, notamment) et surtout ceux de la<br />
finance capitaliste. Cette puissante conjonction permet d’expliquer pourquoi<br />
des politiques impérialistes sont engagées alors même que leur succès<br />
apparaît aléatoire : « Les banques qui financent des prêts de guerre<br />
et, aujourd’hui, une grande part de l’industrie lourde, et pas seulement<br />
les fournisseurs directs de blindages et de canons, ont dans tous les cas un<br />
intérêt économique à ce que des guerres soient menées ; une guerre perdue<br />
augmente pour eux aussi bien la demande qu’une guerre gagnée, et<br />
les intérêts politiques et économiques que les membres d’une communauté<br />
politique ont à l’existence de grandes usines de machines de guerre<br />
dans leur pays les contraint à tolérer que celles-ci fournissent le monde<br />
entier, y compris leurs adversaires politiques. »<br />
3. Rudolf Hilferding, Le Capital financier, étude sur le développement récent du<br />
capitalisme, trad. Marcel Ollivier, Minuit, 1979.<br />
4. Rosa Luxemburg, L’Accumulation du capital, (trad. Irène Petit, Maspero, 1967)<br />
trad. Irène Petit et Marcel Ollivier, Maspero, 1976.
ISABELLE KALINOWSKI & REINHARD GRESSEL 211<br />
Dans un troisième et dernier temps, Weber complète son analyse des<br />
fondements de l’impérialisme en s’interrogeant sur les modalités de l’adhésion<br />
des différentes classes à ces politiques de violence. C’est dans<br />
cette partie finale qu’il faut sans doute chercher l’apport le plus original<br />
de Weber à la discussion sur les causes de l’impérialisme. La détermination<br />
objective par les intérêts économiques – c’est là une des thèses<br />
majeures de son œuvre – ne s’exerce pas uniformément et uniment sur<br />
tous les groupes sociaux : si la conjonction de l’adhésion idéologique<br />
(aux politiques impérialistes, par exemple) et des profits économiques,<br />
dans le cas des classes dominantes, possède un caractère d’évidence, l’acceptation<br />
par les classes les plus dominées d’une politique dont elles<br />
subissent les effets négatifs sans en retirer les bénéfices est en revanche le<br />
phénomène qui, aux yeux de Weber, réclame explication.<br />
La spécificité de l’impérialisme capitaliste par rapport à d’autres formes<br />
d’impérialisme (par exemple celui de l’Antiquité) est en effet de radicaliser<br />
l’inégalité de la répartition des profits auxquels il donne accès : les<br />
non-possédants ne reçoivent plus leur « part de butin » ou de terres, et<br />
se trouvent exclus des intérêts financiers associés à la production de<br />
guerres, alors même qu’ils en supportent le financement. (« Les moyens<br />
[de production des guerres], écrit Weber, sont réunis sous la forme de<br />
redevances forcées, auxquelles les couches dominantes savent normalement<br />
se soustraire en les faisant peser sur les masses, en vertu de leur<br />
puissance sociale et politique. ») D’un point de vue strictement économique,<br />
les « couches petites-bourgeoises et prolétaires » ont donc structurellement<br />
plutôt intérêt au pacifisme. Pourquoi, demande alors Weber,<br />
ces « intérêts pacifistes » sont-ils « malgré tout très souvent et très facilement<br />
défaillants » ? La réponse livrée en conclusion est seulement esquissée,<br />
et peut prêter à confusion : en soulignant la réceptivité des masses à<br />
« l’émotion » (de la même façon qu’il relève ailleurs, par exemple, le primat<br />
de la « magie » dans la religiosité paysanne), Weber n’entend aucunement<br />
assigner les plus dominés à une forme de pensée « inférieure »,<br />
ni attribuer à l’inverse une plus grande « rationalité» aux idées des dominants.<br />
Il invoque dans d’autres textes le « besoin rationnel » des prolétaires<br />
et, d’un autre côté, les assises irrationnelles de « l’esprit capitaliste ».<br />
L’argument suggéré ici consiste bien plutôt à insister sur les conditions<br />
matérielles et sociales de l’existence d’un pacifisme : l’intérêt rationnel qui<br />
prédispose les masses, plus que tout autre groupe social, à redouter les<br />
guerres et les menées coloniales, peut d’autant plus vaciller sous l’effet des
212<br />
LA LEÇON DES CHOSES<br />
propagandes impérialistes qu’il n’est pas conforté, chez ceux qui n’ont<br />
rien à perdre, par la positivité d’un intérêt économique.<br />
Il ne s’agit pas là, pour Weber, d’énoncer des lois sociales à prétention<br />
universelle ; conformément à la méthode de sa sociologie, l’élaboration<br />
de telles typologies ne vise qu’à établir des modèles abstraits qui ne sont<br />
pas en eux-mêmes leur propre fin, mais fournissent un cadre de probabilité<br />
à partir duquel peuvent être saisies, dans le réel cette fois, des différences<br />
pertinentes, permettant d’échapper à la collecte infinie de faits<br />
contradictoires. L’une des caractéristiques du texte présenté ici consiste<br />
ainsi à fournir un modèle d’explication « tranché» du phénomène impérialiste,<br />
à la différence de l’analyse plus développée et plus « brillante »<br />
publiée par Joseph Schumpeter en 1918 sous le titre Sociologie des impérialismes<br />
5 , et dans laquelle celui qui était alors un collaborateur de la<br />
revue de Max Weber se livre à une vertigineuse énumération de l’histoire<br />
des impérialismes et de leurs moteurs.<br />
Parce qu’il partage sur certains points l’analyse marxiste de l’impérialisme<br />
capitaliste, le texte qui suit met à mal plusieurs images communément<br />
associées à Max Weber. Non marxiste, il fut bien loin d’axer son<br />
travail, comme l’affirment ceux qui ne l’ont pas lu, sur un « renversement<br />
» des théories de Marx ; « patriote » dans ses interventions politiques,<br />
il n’en livra pas moins, dans ses ouvrages scientifiques, les<br />
instruments les plus lucides d’une analyse des politiques de domination.<br />
ISABELLE KALINOWSKI & REINHARD GRESSEL<br />
5. Joseph Schumpeter, « Sociologie des impérialismes », in Impérialisme et<br />
classes sociales, trad. Suzanne de Segonzac et Pierre Bresson, revue par Jean-<br />
Claude Passeron, (Minuit, 1972) « Champs » Flammarion, 1984.
MAX WEBER<br />
Les fondements économiques<br />
de « l’impérialisme » *<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 213-219<br />
213<br />
DE ROME OUTRE-MER, dans la mesure où elle fut soumise<br />
à des déterminations économiques, présente des caractéris-<br />
L’EXPANSION<br />
tiques – qui se manifestèrent alors pour la première fois dans<br />
l’histoire sous une forme aussi marquée et à un degré aussi fort – que<br />
l’on retrouva toujours par la suite et que l’on retrouve encore aujourd’hui<br />
dans leurs grandes lignes. Bien que la frontière qui les sépare<br />
d’autres types demeure très fluide, elles sont typiques d’une forme spécifique<br />
de rapports capitalistes – ou en constituent bien plutôt les<br />
conditions d’existence – que nous appellerons l’impérialisme capitaliste.<br />
Ce sont les intérêts capitalistes de fermiers fiscaux, de créanciers des<br />
États, de fournisseurs des États, de capitalistes actifs dans le commerce<br />
extérieur et bénéficiant de privilèges étatiques, et de capitalistes coloniaux.<br />
Leurs chances de profits se fondent entièrement sur l’exploitation<br />
directe de situations de contrainte politique violente, en l’occurrence<br />
d’une violence orientée vers l’expansion. L’acquisition de « colonies »<br />
* Ce texte est la traduction partielle de Max Weber, « Die wirtschaftlichen<br />
Grundlagen des “Imperialismus” », in Wirtschaft und Gesellschaft [Économie<br />
et société], Mohr, Tübingen, 1972, p. 524-527.
214<br />
LA LEÇON DES CHOSES<br />
outre-mer, pour une communauté politique, offre aux intérêts capitalistes<br />
des opportunités de profits considérables, par la réduction des<br />
autochtones en esclavage forcé ou par leur assignation à une terre et<br />
leur exploitation comme main-d’œuvre dans les plantations (pratique<br />
qui fut semble-t-il organisée pour la première fois à grande échelle par<br />
les Carthaginois, et, en dernier lieu, dans un style des plus grandioses,<br />
par les Espagnols en Amérique du Sud, par les Anglais dans les États<br />
américains du Sud et par les Hollandais en Indonésie), mais aussi par la<br />
monopolisation forcée du commerce avec ces colonies et, le cas<br />
échéant, d’autres parts du commerce extérieur. Les impôts du territoire<br />
nouvellement occupé offrent des chances de profits à des fermiers fiscaux<br />
capitalistes, chaque fois que l’appareil propre de la communauté<br />
politique n’est pas approprié pour les collecter – nous reviendrons plus<br />
tard sur ce point. À supposer que les instruments de production pratiques<br />
de la guerre ne soient pas acquis par l’auto-équipement, comme<br />
dans le pur féodalisme, mais par la communauté politique en tant que<br />
telle, l’expansion violente par la guerre et les armements nécessaires<br />
offrent de loin les occasions les plus profitables de demande en crédits<br />
très élevés, et augmentent les chances de profit des créanciers capitalistes<br />
de l’État : ceux-ci, dès la deuxième guerre punique 1 , dictaient<br />
leurs conditions à la politique romaine. Ou bien, lorsque les créanciers<br />
de l’État sont pour finir devenus une couche massive de rentiers d’État<br />
(détenteurs de titres consolidés) – ce qui est la situation caractéristique<br />
aujourd’hui –, ils offrent des chances de profits aux banques qui «émettent<br />
» ces titres. Les intérêts des fournisseurs de matériel de guerre vont<br />
dans le même sens. Les puissances économiques ainsi créées ont intérêt<br />
à l’émergence de conflits guerriers en tant que tels, quelle qu’en soit<br />
l’issue pour leur propre communauté. Aristophane, déjà, distingue les<br />
métiers de ceux qui ont intérêt à la guerre et de ceux qui ont intérêt à la<br />
paix, même si l’enjeu important – comme on le voit dans son énumération<br />
– résidait encore à l’époque, du moins pour l’armée de terre, dans<br />
l’auto-équipement et, par suite, dans les commandes passées individuellement<br />
par les citoyens auprès des artisans : forgeurs d’épées, fabricants<br />
d’armures, etc. À l’époque, déjà, les grands entrepôts commerciaux privés<br />
qu’on désigne souvent comme des « fabriques » étaient avant tout<br />
1. La deuxième guerre punique opposant Rome et Carthage eut lieu entre 218<br />
et 201 av. J.-C. [ndt]
MAX WEBER 215<br />
des réserves d’armes. De nos jours, les commandes de matériel de<br />
guerre et de machines de guerre ne sont globalement passées que par<br />
un seul client, la communauté politique en tant que telle, ce qui accroît<br />
le caractère capitaliste. Les banques qui financent des prêts de guerre et,<br />
aujourd’hui, une grande part de l’industrie lourde, et pas seulement les<br />
fournisseurs directs de blindages et de canons, ont dans tous les cas un<br />
intérêt économique à ce que des guerres soient menées ; une guerre<br />
perdue augmente pour eux aussi bien la demande qu’une guerre<br />
gagnée, et les intérêts politiques et économiques que les membres d’une<br />
communauté politique ont à l’existence de grandes usines de machines<br />
de guerre dans leur pays les contraint à tolérer que celles-ci fournissent<br />
le monde entier, y compris leurs adversaires politiques.<br />
Les obstacles économiques que rencontrent les intérêts capitalistes<br />
impérialistes tiennent avant tout – à supposer que soient directement en<br />
jeu des motivations purement capitalistes – au rapport entre la rentabilité<br />
des premiers et celle des intérêts capitalistes d’orientation pacifiste, et<br />
ce rapport est étroitement lié à son tour aux rôles respectifs de l’économie<br />
publique et de l’économie privée dans la couverture des besoins.<br />
Celle-ci est par suite également déterminante, dans une large mesure,<br />
pour le type de tendances économiques expansionnistes qui reçoivent<br />
l’appui des communautés politiques. De façon générale, le capitalisme<br />
impérialiste, en particulier le capitalisme de rapine colonial, qui se fonde<br />
sur la violence directe et le travail forcé, est de loin celui qui a de tous<br />
temps offert les plus grandes opportunités de profit, sans commune<br />
mesure, le plus souvent, avec celles des activités d’exportation orientées<br />
vers des échanges pacifiques avec les membres d’autres communautés<br />
politiques. Par suite, ce capitalisme a existé en tous temps et partout où<br />
les besoins économiques publics ont pu être couverts dans une large<br />
mesure par la communauté politique en tant que telle ou bien par ses<br />
subdivisions (les communes). Plus cette couverture était forte et plus le<br />
capitalisme impérialiste a eu d’importance. Dans les pays politiquement<br />
«étrangers », et surtout dans les régions qui connaissent une nouvelle<br />
« ouverture » politique et économique, autrement dit celles où sont introduites<br />
les formes d’organisation spécifiquement modernes des « entreprises<br />
» publiques et privées, les opportunités de gains se multiplient à<br />
nouveau aujourd’hui, sous la forme de « commandes étatiques », qui<br />
concernent les armes, les chemins de fer et les autres travaux publics<br />
financés par la communauté politique ou confiés à des entreprises dotées
216<br />
LA LEÇON DES CHOSES<br />
de monopoles, les organisations ou concessions monopolistiques de la<br />
fiscalité, du commerce et de l’industrie, ou les emprunts d’État. De façon<br />
générale, c’est lorsqu’une importance croissante échoit à l’économie<br />
publique comme forme de couverture des besoins que la prédominance<br />
de ce type de chances de profit s’affirme aux dépens des profits susceptibles<br />
d’être obtenus par les formes communes de l’échange de biens<br />
privé. Parallèlement, l’expansion économique sur une base politique et la<br />
compétition entre les différentes communautés politiques, auxquelles<br />
prennent part des détenteurs de capitaux disponibles pour l’investissement,<br />
tendent elles aussi à créer à leur propre profit ce type de monopoles<br />
et de participations à des « commandes étatiques », tandis qu’est<br />
reléguée au second plan la simple pratique de la « porte ouverte » aux<br />
importations de biens privées. Mais comme le moyen le plus sûr de<br />
garantir que ces chances de profit attachées à l’économie publique du territoire<br />
étranger soient monopolisées par des ressortissants de la communauté<br />
politique nationale est l’occupation politique ou, en tout cas, la<br />
soumission de la puissance politique étrangère par l’établissement d’un<br />
« protectorat » ou d’une structure analogue, l’expansion s’engage sur la<br />
voie d’un « impérialisme » toujours plus affirmé, en rupture avec l’orientation<br />
pacifiste ne réclamant que la « liberté de commerce ». Celle-ci ne<br />
prédomina qu’aussi longtemps que l’organisation de la couverture des<br />
besoins fondée sur l’économie privée faisait pencher la balance des<br />
chances optimales de profit capitaliste du côté de l’échange de biens pacifique,<br />
non monopolisé – du moins par le pouvoir politique. Le renouveau<br />
universel du capitalisme « impérialiste » – qui a toujours été la forme<br />
normale sous laquelle se manifestent les effets exercés par les intérêts capitalistes<br />
sur la politique –, et, avec lui, les impulsions nouvelles d’expansion<br />
politique, ne sont donc pas le produit du hasard, et les pronostics ne<br />
peuvent que leur être favorables dans un avenir prochain.<br />
Il est peu probable que cette situation se modifierait radicalement si,<br />
construisant un instant une expérience de pensée, nous imaginons des<br />
communautés politiques régies d’une manière ou d’une autre par un<br />
« socialisme d’État », autrement dit des regroupements couvrant un<br />
maximum des besoins économiques par l’économie publique. Chacun<br />
de ces regroupements politiques à économie publique chercherait à<br />
acquérir au plus bas prix dans les échanges « internationaux » les biens<br />
indispensables qui ne sont pas produits sur son territoire (le coton par<br />
exemple en Allemagne) auprès des pays qui en possèdent un monopole
MAX WEBER 217<br />
naturel et aspirent à l’exploiter, et il ne serait aucunement invraisemblable<br />
que la violence soit utilisée si elle était le moyen le plus facile pour<br />
obtenir des conditions d’échange favorables. On verrait alors apparaître,<br />
sinon en droit, du moins en fait, une obligation de tribut pour les pays<br />
les plus faibles, et on ne voit au demeurant pas pourquoi les communautés<br />
les plus puissantes régies par le socialisme d’État s’abstiendraient<br />
d’extorquer aux communautés les plus faibles de véritables tributs au<br />
profit de leurs propres membres, partout où elles pourraient le faire,<br />
comme cela se produisait en tous lieux dans un lointain passé. Avec ou<br />
sans « socialisme d’État », les intérêts économiques de la « masse » des<br />
membres d’une communauté politique ne les portent pas plus nécessairement<br />
au pacifisme que n’importe quelle autre couche sociale. D’un<br />
point de vue économique, le demos 2 attique – et pas seulement lui –<br />
vivait de la guerre : elle lui assurait des soldes militaires et, en cas de victoire,<br />
les tributs des vaincus, qui, en pratique, étaient répartis entre les<br />
citoyens de plein droit sous la forme à peine dissimulée de subsides versés<br />
dans les assemblées populaires, les sessions de tribunal et les fêtes<br />
publiques. L’intérêt que présentaient une politique et une puissance<br />
impérialistes étaient par suite évidents pour tout citoyen de plein droit.<br />
Les revenus de provenance extérieure que recueillent aujourd’hui les<br />
membres d’une communauté politique – y compris ceux qui ont une origine<br />
impérialiste et présentent, de fait, le caractère d’un « tribut » – ne<br />
présentent pas pour les masses une configuration d’intérêts aussi évidente.<br />
En effet, les tributs versés aux « peuples créanciers » prennent la<br />
forme, dans l’ordre économique actuel, du versement d’intérêts de dette<br />
extérieure ou de profits capitalistiques aux couches possédantes du<br />
« peuple créancier ». Imaginons que ces tributs soient supprimés : cela<br />
impliquerait, pour des pays comme l’Angleterre, la France, l’Allemagne,<br />
par exemple, un recul très sensible du pouvoir d’achat, y compris en<br />
produits nationaux, dont l’influence sur le marché du travail s’exercerait<br />
au détriment des ouvriers concernés. Si ces derniers ont cependant, pour<br />
une très large majorité d’entre eux, des opinions pacifistes, y compris<br />
dans les pays créanciers, et ne manifestent le plus souvent aucune espèce<br />
d’intérêt pour la perpétuation de l’extorsion forcée de tributs de ce type<br />
auprès de communautés étrangères débitrices et en retard de paiement,<br />
2. Demos : terme grec désignant le « peuple ». [ndt]
218<br />
LA LEÇON DES CHOSES<br />
ni pour une participation forcée à l’exploitation de territoires coloniaux<br />
et de commandes étatiques en provenance de ces territoires étrangers,<br />
c’est d’abord là le produit tout naturel de leur situation immédiate de<br />
classe et de la situation politique et sociale interne des communautés<br />
dans une époque d’économie capitaliste. Le droit d’encaisser les tributs<br />
revient à la classe adverse, qui exerce aussi sa domination sur la communauté<br />
politique, et toute politique impérialiste qui réussit à s’imposer<br />
à l’extérieur par la contrainte renforce normalement aussi « à l’intérieur<br />
», au moins dans un premier temps, le prestige et par conséquent<br />
la position de pouvoir et l’influence des classes, Stände 3 , partis, sous la<br />
direction desquels le succès a été obtenu. À ces sources de sympathies<br />
pacifistes, plutôt conditionnées par la configuration sociale et politique,<br />
s’ajoutent, chez les « masses », surtout les masses prolétariennes, des<br />
motifs économiques. Tout investissement de capitaux dans la production<br />
de machines de guerre et de matériel de guerre crée il est vrai des opportunités<br />
de travail et de profit ; toute commande étatique peut être, dans<br />
le détail, un élément d’amélioration directe de la conjoncture ; enfin, surtout<br />
indirectement, par l’augmentation de l’intensité de l’aspiration au<br />
profit et par l’augmentation de la demande, elle peut être à la source<br />
d’une confiance accrue dans les chances économiques des industries qui<br />
y participent et, par suite, produire une atmosphère de hausse. Mais cet<br />
investissement empêche d’autres modes d’utilisation des capitaux, et<br />
rend plus difficile la couverture des besoins dans d’autres domaines ; et<br />
surtout, les moyens sont réunis sous la forme de redevances forcées, aux-<br />
3. Le concept wébérien de Stand (pl. Stände) se définit dans son rapport à la<br />
« classe » : « Qu’est-ce qu’un “Stand” ? Les “classes” sont des groupes de gens<br />
dont la situation économique est identique, du point de vue de certains intérêts.<br />
La possession ou la non-possession de biens matériels ou de qualifications professionnelles<br />
d’un certain type sont constitutifs du “statut de classe”. Le Stand<br />
est une qualité d’honneur ou de privation d’honneur social et, pour l’essentiel, il<br />
est à la fois conditionné et exprimé par un certain type de conduite de vie.<br />
L’honneur social peut être directement attaché à un statut de classe et il est le<br />
plus souvent tributaire du statut moyen de classe des membres du Stand. Mais<br />
ce n’est pas nécessairement le cas. L’appartenance à un Stand, d’un autre côté,<br />
influence par elle-même le statut de classe, dans la mesure où la conduite de vie<br />
conforme à un Stand privilégie certains types de possession ou d’activité professionnelle<br />
et en récuse d’autres » (Max Weber, Hindouisme et bouddhisme, trad.<br />
I. Kalinowski et R. Lardinois, « Champs » Flammarion, 2003, p. 123). [ndt]
MAX WEBER 219<br />
quelles les couches dominantes savent normalement se soustraire en les<br />
faisant peser sur les masses, en vertu de leur puissance sociale et politique<br />
– sans parler des limites imposées à l’emploi des fortunes au nom<br />
de considérations « mercantilistes ». Il n’est pas rare que les pays peu<br />
grevés par des dépenses militaires (Amérique), mais aussi et surtout les<br />
petits États – les Suisses, par exemple – connaissent une expansion économique<br />
plus forte, en valeur relative, pour leurs ressortissants, que les<br />
grandes puissances ; en outre, il arrive qu’on les laisse plus facilement<br />
exploiter économiquement des pays étrangers, parce qu’on ne redoute<br />
pas que leur intervention économique soit suivie d’une intervention<br />
politique. Si les intérêts pacifistes des couches petites-bourgeoises et prolétaires<br />
sont malgré tout très souvent et très facilement défaillants, les raisons<br />
en sont – abstraction faite des cas particuliers, comme l’espoir<br />
d’accéder à des territoires d’immigration dans le cas des pays surpeuplés<br />
– pour une part le fait que les « masses » non organisées sont toujours<br />
plus réceptives à l’émotion, d’autre part le fait qu’elles se représentent<br />
confusément la guerre comme porteuse d’opportunités inattendues,<br />
enfin le fait que, subjectivement, les enjeux sont moindres, pour elles,<br />
que pour les porteurs d’autres intérêts. Les « monarques » craignent<br />
pour leur trône si la guerre est perdue, les puissants et ceux qui ont intérêt<br />
à l’existence d’un « régime républicain » redoutent à l’inverse la victoire<br />
d’un « général » ; la bourgeoisie possédante, dans sa grande<br />
majorité, craint que les entraves imposées aux profits du travail n’impliquent<br />
des pertes économiques ; la couche dominante des notables peut<br />
redouter, dans certains cas, un renversement brutal du pouvoir en faveur<br />
des non-possédants, pour le cas où une défaite entraînerait une désorganisation<br />
; les « masses » en tant que telles, du moins dans leur représentation<br />
subjective, n’ont pas de crainte directement identifiable, sinon,<br />
dans les cas extrêmes, celle de perdre la vie – un danger dont l’évaluation<br />
et les effets sont sujets à de fortes variations dans la représentation<br />
qu’elles s’en font, et qui peut facilement, en fin de compte, être réduit à<br />
une quantité négligeable si on les soumet à une influence émotionnelle.<br />
MAX WEBER<br />
Traduit de l’allemand par<br />
Isabelle Kalinowski et Reinhard Gressel
220<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
Ce texte a initialement paru dans À contretemps (<strong>n°</strong> 13, 2003) – nos remerciements<br />
à Freddy Gomez de nous en avoir autorisé la reproduction gracieuse.<br />
Les références au livre de Michael Hardt et Antonio Negri, Empire (Harvard UP,<br />
2000) suivent l’édition française (Exils, 2000).<br />
L’auteur remercie Gianni Armaroli, Gianni Carrozza, Clara Ferri, Malena<br />
Fierros, John Holloway, Furio Lippi, Raúl Ornelas et Tito Pulsinelli pour leurs<br />
commentaires et leurs suggestions.
CLAUDIO ALBERTANI<br />
Empire & ses pièges<br />
Toni Negri & la déconcertante<br />
trajectoire de l’opéraïsme italien<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 221-258<br />
221<br />
On a cru jusqu’ici que la mythologie chrétienne sous l’Empire<br />
romain ne fut possible que parce qu’on n’avait pas encore inventé<br />
l’imprimerie. C’est tout le contraire. La presse quotidienne et le<br />
télégraphe, qui diffusent leurs inventions en un clin d’œil sur toute<br />
l’étendue du globe, fabriquent plus de mythes en un jour qu’on<br />
pouvait autrefois en fabriquer en un siècle.<br />
Marx à Kugelmann, 27 juillet 1871<br />
BAUDELAIRE QUALIFIAIT LES AUTEURS de traités qui exposent en un<br />
tournemain l’art de devenir riches, savants et heureux, d’« entrepreneurs<br />
de bonheur public ». Il me semble que la définition<br />
pourrait parfaitement s’appliquer aux auteurs d’Empire, lesquels nous<br />
assurent avoir des réponses satisfaisantes aux grandes questions de notre<br />
temps. Présenté comme la bible du mouvement anti-mondialisation, le<br />
livre a fait l’objet d’une opération publicitaire de grande ampleur, aux<br />
États-Unis d’abord (en 2000), puis en France et, enfin, en Italie et dans<br />
le reste du monde. Bénéficiant d’un véritable succès international (avec<br />
plus d’un demi-million d’exemplaires vendus à ce jour), traduit dans de<br />
nombreuses langues – dont le chinois et l’arabe –, Empire a été reçu par<br />
la presse américaine et européenne comme une contribution de premier<br />
ordre à la compréhension du nouvel ordre mondial. Le quotidien néo-
222<br />
conservateur The New York Times n’a pas hésité à le qualifier d’« œuvre<br />
la plus importante de cette dernière décennie », ce qui ne manque pas<br />
de sel si on songe que ses auteurs se tiennent pour des radicaux et se proposaient<br />
de faire rien de moins qu’une actualisation du Manifeste communiste.<br />
En Amérique latine, en revanche, les réactions ont été plus<br />
tièdes et même parfois franchement hostiles – bien que, comme on le<br />
verra plus loin, pour de mauvaises raisons.<br />
UN VERNIS NEUF POUR UNE VIEILLE IDÉOLOGIE<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
Précisons d’emblée que si Empire ne relève en rien du manifeste, il est<br />
encore moins un manuel pour activistes. C’est un livre long (plus de 500<br />
pages) et bourré de concepts obscurs comme « bio-pouvoir », « commandement<br />
global », « souveraineté impériale », « auto-valorisation »,<br />
« déterritorialisation », « production immatérielle », « hybridation »,<br />
« multitude », et beaucoup d’autres, d’accès difficile pour des lecteurs<br />
non initiés. Une compréhension parfaite du livre requiert sans doute<br />
une certaine familiarisation avec diverses écoles de pensée : le poststructuralisme<br />
français, les théories sociologiques d’Amérique du Nord<br />
et, comme on va le voir, l’opéraïsme italien. À tout cela, il convient<br />
d’ajouter, outre la meilleure bonne volonté du monde, une certaine<br />
connaissance de la philosophie politique, d’Aristote à John Rawls, en<br />
passant par Polybe, Machiavel et Carl Schmitt. Je dois avouer que, dans<br />
mon cas, lire l’ouvrage en entier m’a coûté quelques mois d’efforts, y<br />
compris les longues interruptions nécessaires.<br />
Selon ses propres auteurs, Empire se prête à de multiples lectures : les<br />
lecteurs peuvent procéder du début à la fin, de la fin au début ou encore<br />
par thèmes partiels, en divisant l’ouvrage selon leurs centres d’intérêt.<br />
On me permettra d’y ajouter une autre suggestion : la lecture par slogan<br />
ou par mots-clés, ces mots-clés dont le maniement élégant est aujourd’hui<br />
le signe d’appartenance à la nouvelle gauche ou, plus prosaïquement,<br />
celui d’un aggiornamento intellectuel indispensable pour qui veut<br />
faire bonne figure dans les salons littéraires à la mode.<br />
Le livre prétend explorer la nouvelle configuration du système capitaliste<br />
induite par la mondialisation néolibérale et remettre en question les<br />
catégories fondamentales de la politique léguées par la modernité. Les
CLAUDIO ALBERTANI 223<br />
auteurs se situent dans la tradition marxiste, bien qu’ils admettent, sans<br />
le dire explicitement, que le marxisme-léninisme orthodoxe a cessé<br />
d’être pertinent. Si on se doit de saluer ce renoncement à une idéologie<br />
qui servit si bien les intérêts du totalitarisme, comment ne pas s’étonner,<br />
cependant, de constater qu’il manque à ce livre non seulement une analyse<br />
économique sérieuse, mais encore et surtout le point de vue de la<br />
critique de l’économie politique qui demeure, à mes yeux, le seul héritage<br />
vivant de cette même tradition marxiste. En outre, il faut noter que, alors<br />
qu’Empire consacre des dizaines de pages à l’étude de la Constitution des<br />
États-Unis, il ne contient aucune réflexion sérieuse sur la Révolution<br />
russe et sur le léninisme. Pourtant, il est clair aujourd’hui que le modèle<br />
soviétique ouvre et ferme, à la fois, l’espace des révolutions du XX e siècle.<br />
Son échec n’est d’ailleurs pas sans rapports avec le surgissement du<br />
nouvel ordre mondial, qui est précisément le thème de l’ouvrage.<br />
Le débat sur la tragédie des révolutions qui se dévorent elles-mêmes n’y<br />
est pas non plus évoqué, et on n’y trouve aucune tentative pour juger à sa<br />
juste mesure l’apport des courants critiques du socialisme, tant marxistes<br />
que libertaires, passé jusqu’ici sous le boisseau. Dans les rares pages consacrées<br />
à la chute du bloc soviétique, les auteurs se bornent à remarquer que<br />
la discipline y « agonisait » et affirment, sans plus, qu’on n’était pas en présence<br />
de sociétés totalitaires mais d’une dictature bureaucratique 1 .<br />
Procédons par ordre. Empire fut écrit entre 1994 et 1997, c’est-à-dire<br />
après le début de la révolte zapatiste et avant la bataille de Seattle. Une<br />
fois le livre achevé, Negri, dirigeant politique de la gauche extra-parlementaire<br />
italienne des années 1970, professeur d’université, auteur de<br />
volumineux traités sur Marx et sur Spinoza, se livra, après quatorze ans<br />
d’exil en France, à la justice italienne pour répondre devant elle de délits<br />
en rapport avec la lutte armée. Depuis quelques mois, il vit en résidence<br />
surveillée dans son appartement romain, où il travaille au tome II<br />
d’Empire. Hardt, lui, est professeur de littérature à l’université de Duke,<br />
en Caroline du Nord. J’ignore quelle est sa trajectoire, et je ne me propose<br />
donc pas d’analyser ici sa contribution.<br />
Puisque nous nous trouvons en présence d’un livre d’une énorme<br />
ambition, il convient de se demander d’entrée en quoi il pourrait aider à<br />
1. « L’agonie de la discipline soviétique », in Michael Hardt et Antonio Negri,<br />
Empire, Exils, 2000, p. 337-341.
224<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
une meilleure compréhension du monde actuel. Ma réponse est qu’il y<br />
contribue bien peu, en vérité. Sa thèse principale, énoncée dès les premières<br />
lignes, et reprise par la suite de façon presque obsessionnelle,<br />
peut s’énoncer ainsi : avec le surgissement de la mondialisation et la crise<br />
de l’État-nation, apparaissent de nouvelles formes de souveraineté et un<br />
système social inédit, l’« Empire », dont il faut mettre les attributs en<br />
lumière. Nos auteurs expliquent que les États-Unis y occupent une place<br />
importante mais non centrale, pour la simple raison que l’Empire n’a pas<br />
de centre. Il s’agirait en quelque sorte d’un Empire sans impérialisme,<br />
illusion partagée avec la pensée néo-conservatrice. L’Empire, nous<br />
disent-ils en effet, est un non-lieu sans limites, décentralisé et « déterritorialisé<br />
», qui s’approprie la totalité de la vie sociale. Aucune frontière<br />
ne peut restreindre son pouvoir puisqu’il est « un ordre qui suspend<br />
effectivement le cours de l’histoire et fixe par là même l’état présent des<br />
affaires pour l’éternité» 2 . Il ressort de telles affirmations que l’Empire ne<br />
coïncide pas avec le système impérialiste des États souverains en concurrence<br />
entre eux. À la différence de ceux-ci, il n’a ni centre ni périphérie,<br />
et pas plus de « dedans » que de « dehors », ce qui implique qu’on ne<br />
puisse plus parler des vieilles divisions entre premier et tiers monde ou<br />
même de guerres impérialistes. Si Negri et Hardt admettent l’existence de<br />
contradictions inter-impérialistes, ils soutiennent qu’elles ne sont pas<br />
réductibles aux mécanismes classiques. Qu’en est-il, par ailleurs, des<br />
classes sociales dans l’Empire ? Il n’y a plus de prolétariat, et encore<br />
moins de paysannerie 3 . Ce qui existe, en revanche, c’est un nouveau –<br />
et mystérieux – sujet révolutionnaire, la multitude (au singulier, comme<br />
le Saint-Esprit), dont les auteurs célèbrent l’existence dès l’introduction,<br />
sans se soucier de préciser les contours du concept.<br />
Une fois lus ces préambules, plusieurs choix s’offrent au lecteur critique.<br />
Il peut, bien sûr, renoncer à s’attaquer à un texte aussi abscons,<br />
mais il peut aussi s’armer de patience et passer au crible le contenu des<br />
470 pages (sans compter les quelque 40 pages de notes) qui suivent l’introduction.<br />
C’est ce qu’a fait Atilio Boron qui, atterré par les extravagances<br />
2. Ibid., p. 19.<br />
3. Michael Hardt, « Il tramonto del mondo contadino nell’Impero », in Posse.<br />
Política. Filosofia. Moltitudini, Manifestolibri Edizioni, mai 2002.
CLAUDIO ALBERTANI 225<br />
de Negri et Hardt, leur consacre un livre entier 4 . Toutefois, si ce choix a<br />
pour mérite de mettre à la disposition du lecteur un inventaire fourni,<br />
quoique non exhaustif, des sottises du livre, Boron fait fausse route quand<br />
il qualifie les auteurs de post-modernes, alors que, en vérité, s’ils empruntent<br />
des concepts à Foucault (bio-pouvoir, bio-politique) ou à Deleuze<br />
(déterritorialisation, nomadisme), leur argumentation est directement tributaire<br />
de ce qu’on a appelé l’opéraïsme italien, un courant auquel Negri<br />
adhéra dans les années 1960 et qu’il n’a jamais renié.<br />
La réflexion des auteurs de l’ouvrage ne procède ni du désir de<br />
remettre en cause les « grandes narrations » ni d’une sensibilité postmoderne,<br />
« attentive à la singularité des événements » 5 , mais avant tout<br />
d’une vorace et totalisatrice volonté hégélienne : également opposés à la<br />
modernité et à la post-modernité, les auteurs se situent en fait dans une<br />
sorte d’éther « post-marxiste » 6 .<br />
C’est pourquoi, plutôt que de reprendre point par point les thèses du<br />
livre – parfois franchement délirantes –, la critique peut choisir une autre<br />
voie et opter pour l’exploration des origines du champ dans lequel elles<br />
s’inscrivent. La tentative est d’autant moins oiseuse que, après les États-<br />
Unis et l’Europe, l’arsenal idéologique de Negri et Hardt est en train d’envahir<br />
l’Amérique latine. À notre sens, on ne peut comprendre Empire si<br />
on ne connaît pas, au moins dans ses traits les plus significatifs, les forces<br />
et les faiblesses de l’opéraïsme italien.<br />
En des temps déjà lointains, ce courant apporta une contribution indéniable<br />
à la reconstruction de la pratique révolutionnaire et de la pensée<br />
critique. Son interprétation du marxisme a marqué une époque du<br />
conflit social en Italie, mais il existe une assez grande confusion quant à<br />
sa nature profonde. Dans la littérature de langue espagnole, par exemple,<br />
4. Atilio A. Boron, Imperio. Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y<br />
Antonio Negri, CLACSO, Buenos Aires, 2002. Une traduction française de cet<br />
ouvrage vient de paraître, sous le titre Empire. Impérialisme…, L’Harmattan.<br />
5. Michel Foucault, Microfísica del poder, Ediciones de la Piqueta, 1978, p. 7.<br />
6. Negri et Hardt avaient déjà pris leurs distances à l’égard du post-modernisme<br />
dans leur livre Il lavoro di Dioniso. Per la critica dello Stato postmoderno,<br />
Manifestolibri, 1995, p. 25-28. Dans Empire, ils précisent : « Les divers courants<br />
de pensée post-modernistes [sont] les symptômes d’une rupture dans la<br />
tradition de la souveraineté moderne », qui « indiquent le passage vers la<br />
constitution de l’Empire » (p. 186).
226<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
on parle de « marxismo autonomista » et, dans l’anglaise, d’« autonomist<br />
marxism » 7 , termes qui évoquent l’idée d’une revendication de l’« autonomie<br />
» des mouvements sociaux à l’égard des organisations et partis<br />
politiques, ce qui, s’agissant des seuls Toni Negri et Mario Tronti – les<br />
deux représentants les plus connus de ce courant hors d’Italie –, est loin<br />
de correspondre à la vérité.<br />
IL ÉTAIT UNE FOIS LA CLASSE OUVRIÈRE<br />
Le courant marxiste qu’on connaît en Italie sous le nom d’opéraïsme est<br />
né dans les années 1960 autour des revues Quaderni Rossi et Classe<br />
Operaia. Parmi leurs collaborateurs les plus importants, on peut citer<br />
Raniero Panzieri, Romano Alquati, Mario Tronti, Sergio Bologna, Alberto<br />
Asor Rosa, Gianfranco Faina et Antonio Negri lui-même 8 . À l’époque,<br />
l’Italie vivait la fin du capitalisme agraire et du miracle économique.<br />
C’étaient les années sombres de la guerre froide et le pays subissait la<br />
double ingérence des États-Unis et de l’URSS. Derrière une façade menaçante,<br />
le parti communiste italien acceptait de bon gré les règles du jeu<br />
7. Il y a quelques années, Negri était l’auteur de référence de certains marxistes<br />
américains. L’un d’entre eux, Harry Cleaver, écrivit que « si Marx ne voulait pas<br />
dire ce que dit Negri, eh bien, tant pis pour Marx » (sic). (Lire George<br />
Katsiafikas, The Subversion of Politics. European Autonomous Social Movements and<br />
the Decolonization of Everyday Life, Humanities Press International, New Jersey,<br />
1997, p. 226.)<br />
8. Cette brève reconstruction se fonde sur le livre de Nanni Balestrini et Primo<br />
Moroni, L’Orda d’Oro. 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica<br />
ed esistenziale (Feltrinelli, Milan, 1997), et sur celui d’Oreste Scalzone et<br />
Paolo Persichetti, La Révolution et l’État. Insurrections et « contre-insurrection »<br />
dans l’Italie de l’après-68 (Dagorno, 2000). On lira aussi Futuro Anteriore. Dai<br />
Quaderni Rossi ai movimenti globali : ricchezze e limiti dell’operaismo italiano,<br />
Derive/Approdi, Roma, 2002. J’ai également consulté le site (en particulier les excellents écrits de Maria Turchetto et de Damiano<br />
Palano), les revues Vis-à-Vis et Primo Maggio, ainsi qu’un vieil essai que j’avais<br />
publié anonymement sous le titre « Proletari se voi sapeste » dans Al tramonto.<br />
Operaismo italiano e dintorni, supplément de la revue Insurrezione (Renato<br />
Varani editore, Milan, 1982).
CLAUDIO ALBERTANI 227<br />
qu’impliquait son éloignement permanent du pouvoir central, en<br />
échange d’une part (réduite) de pouvoir local.<br />
La figure dominante dans les luttes sociales était l’ouvrier professionnel,<br />
c’est-à-dire ce travailleur qui exerce encore un certain contrôle sur le<br />
processus productif, qui possède un bagage important de connaissances<br />
techniques et qui est conscient de pouvoir administrer l’entreprise mieux<br />
que le patron. On avait affaire en l’occurrence à des travailleurs dotés<br />
d’une forte mémoire et d’une conscience antifasciste très marquée, qui<br />
déclaraient avec fierté « appartenir à la nation ouvrière 9 ».<br />
Les choses ne tardèrent pas à changer. L’exode rural, le décollage industriel,<br />
la croissance du secteur tertiaire et la diffusion de la consommation<br />
de masse, tout cela modifia profondément la structure sociale du pays.<br />
L’existence de secteurs d’ouvriers non qualifiés n’était certes pas une chose<br />
nouvelle, mais à ce moment-là les industries du Nord éprouvaient un<br />
besoin croissant de main-d’œuvre bon marché afin d’impulser le développement<br />
des secteurs automobile et pétrochimique. La production fut<br />
fragmentée et, avec la diffusion de la chaîne de montage, surgit une nouvelle<br />
génération de jeunes émigrants en provenance du Sud, qui n’avaient<br />
ni la culture politique ni les valeurs de la Résistance. Ils vivaient une situation<br />
particulièrement difficile, puisque la société locale ne les acceptait pas<br />
et que le syndicat se méfiait d’eux. Pourtant, ils allaient devenir bientôt les<br />
acteurs d’importants mouvements de protestation sociale.<br />
La réflexion de Quaderni Rossi, dont le premier numéro parut en 1961,<br />
fut consacrée à l’analyse de cette nouvelle et complexe réalité. La revue<br />
était éditée à Turin, centre nerveux de Fiat et des formes inédites<br />
d’organisation du travail. Son directeur, Raniero Panzieri était un exdirigeant<br />
du parti socialiste, de tendance luxemburgiste, qui maintenait<br />
des relations avec la gauche internationale non stalinienne 10 . Quelques<br />
années avant, dans de polémiques Thèses sur le contrôle ouvrier, il avait<br />
défendu l’idée d’une démocratie ouvrière de base et soutenu l’idée que<br />
« le parti, conçu d’abord comme instrument de classe, devient une fin en<br />
lui-même, un instrument pour l’élection de députés […] et un élément<br />
de conservation 11 ».<br />
9. Franco Alasia et Danilo Montaldi, Milano, Corea, Feltrinelli, 1978, p. 184.<br />
10. Panzieri avait dirigé la revue théorique du PSI, Mondo Operaio.<br />
11. Raniero Panzieri, La Crisi del movimento operaio. Scritti, interventi, lettere,<br />
1956-1960, Lampugnani, 1973.
228<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
Panzieri chercha à émanciper le marxisme du contrôle des partis politiques<br />
et à assumer un « point de vue ouvrier » en relisant Marx à partir<br />
de la lutte des classes 12 . Il concentra son attention sur la planification et<br />
interpréta le capital comme pouvoir social et non plus seulement comme<br />
propriété privée des moyens de production. Intervenant directement<br />
dans la production, l’État n’était plus seulement le garant mais l’organisateur<br />
de l’exploitation. Il trouva, dans la quatrième section du tome I du<br />
Capital, les concepts de « commandement capitaliste », d’« ouvrier<br />
social » (« travailleur collectif », dans la traduction espagnole que j’ai<br />
consultée 13 ) et d’« antagonisme », qui sont restés, depuis, des références<br />
théoriques incontournables de l’opéraïsme. Il fut, de surcroît, un des<br />
premiers à étudier des œuvres de Marx jusqu’alors pratiquement inconnues,<br />
comme les Grundrisse (en particulier, le passage sur la machinerie)<br />
et le quatrième chapitre (inédit) du Capital, en récupérant le concept<br />
fondamental de « critique de l’économie politique » et les catégories de<br />
« soumission formelle » et « réelle » du travail au capital 14 .<br />
Alors que la gauche officielle s’embourbait dans l’idéologie du développement,<br />
Panzieri étudia l’entrelacs de la technique et du pouvoir, qui<br />
l’amena à cette idée que l’incorporation de la science dans le processus<br />
productif est un moment-clé du despotisme capitaliste et de l’organisation<br />
de l’État. De la sorte, Panzieri réalisa une inversion du marxisme<br />
orthodoxe – une véritable révolution copernicienne – et ouvrit la voie à<br />
la critique des idéologies sociologiques, de la théorie des organisations<br />
notamment, qu’il interpréta comme des techniques destinées à neutraliser<br />
les luttes ouvrières 15 . Bien plus que d’autres, cet auteur prématurément<br />
disparu (il mourut en 1964) essaya de construire une pensée<br />
politique distincte de la pensée communiste, en s’émancipant du schéma<br />
12. Lire Raniero Panzieri, Spontaneità e Organizzazione. Gli anni dei Quaderni<br />
Rossi. Scritti Scelti, Biblioteca Franco Serantini, 1994.<br />
13. Karl Marx, El Capital, Editorial Librerías Allende, 1977, p. <strong>32</strong>8-330. (C’est<br />
cette même expression de « travailleur collectif » qui figure dans la version<br />
française. [ndt])<br />
14. Karl Marx, Le Capital. Livre I, Chapitre VI (inédit), UGE, 1971.<br />
15. Raniero Panzieri, « Sull’uso capitalistico delle macchine nel<br />
neocapitalismo » et « Plusvalore e pianificazione. Appunti di lettura del<br />
Capitale », in Spontaneità…, op. cit.
CLAUDIO ALBERTANI 229<br />
de l’« intellectuel organique », où l’intellectuel est beaucoup moins<br />
l’expression organique de la classe ouvrière que du seul parti.<br />
Autre personnage important de cette première phase de l’opéraïsme,<br />
Romano Alquati se chargea d’entreprendre des enquêtes empiriques<br />
dans les usines en recourant à la méthode de l’« enquête participative »<br />
(en italien, conricerca), laquelle impliquait une rencontre d’égal à égal<br />
entre le sujet et l’objet de la recherche – c’est-à-dire entre les intellectuels<br />
et les ouvriers – en vue d’une libération commune. Alquati baptisa du<br />
nom d’« ouvrier-masse » (en anglais, unskilled worker ou mass production<br />
worker) le nouveau sujet politique : le travailleur migrant non qualifié et<br />
totalement séparé des moyens de production, lequel était en train de<br />
supplanter l’ouvrier professionnel. L’ouvrier-masse était la concrétisation<br />
de trois phénomènes parallèles : 1) le fordisme, c’est-à-dire la production<br />
de masse et la révolution du marché ; 2) le taylorisme, soit l’organisation<br />
scientifique du travail et la chaîne de montage ; 3) le<br />
keynésianisme, autrement dit les politiques capitalistes à grande portée<br />
de l’État-providence. L’ensemble de ces mesures exprimait la réponse du<br />
capital aux ouvriers qui avaient entrepris de prendre « le ciel d’assaut »<br />
au cours des années 1920-1930.<br />
Les opéraïstes pensaient que, en Italie comme ailleurs, les grandes<br />
transformations fordistes avaient déjà été menées à leur terme et qu’on<br />
était en train de passer à l’étape du « refus du travail », autrement dit à<br />
cette aliénation totale de l’ouvrier à l’égard des moyens de production,<br />
qui débouchait sur l’absentéisme et une remise en question plus radicale<br />
du mécanisme de l’exploitation. De ce point de vue, l’histoire de la classe<br />
ouvrière apparaissait comme un formidable roman épique où les grandes<br />
transformations productives, de la révolution industrielle jusqu’à l’automation,<br />
semblaient promettre la réalisation progressive du plus vieux<br />
rêve de l’humanité : se libérer de l’effort au travail.<br />
Une telle approche s’écartait radicalement de l’éthique du travail, cheval<br />
de bataille du PCI. D’après Sergio Bologna, « Quaderni Rossi a broyé<br />
l’hégémonie sur les presses de Mirafiori », ce qui était une façon de dire<br />
que la revue s’éloignait de la pensée du fondateur du parti, Antonio<br />
Gramsci 16 . À mon sens, la relation des opéraïstes avec Gramsci était plus<br />
16. Sergio Bologna, « Il rapporto fabbrica-società come categoria storica »,<br />
Primo Maggio, <strong>n°</strong> 2, Milan, 1974.
230<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
complexe qu’il n’y paraît : s’ils n’approuvaient guère l’historicisme de ce<br />
dernier (Tronti et Asor Rosa, par exemple, avaient été des élèves de<br />
Galvano Della Volpe, un anti-gramscien convaincu), ils appréciaient les<br />
notes sur « Américanisme et fordisme », où Gramsci pressentait la transition<br />
vers les nouvelles formes de domination capitaliste. Comme lui, ils<br />
suivaient attentivement les transformations du capitalisme américain :<br />
« En Amérique, écrivait Gramsci, la rationalisation a déterminé la nécessité<br />
d’élaborer un nouveau type humain conforme au nouveau type de<br />
travail et de processus productif. 17 »<br />
Bientôt, les opéraïstes eurent la certitude que le phénomène de l’émigration<br />
intérieure tendait à rendre caducs les anciens déséquilibres<br />
entre Nord et Sud, axe des préoccupations de Gramsci. Et ceci non pas<br />
parce que le capitalisme italien les avait supprimés mais, au contraire,<br />
parce que la « question méridionale » était en train de s’étendre au pays<br />
entier, en particulier aux usines du Nord, où s’accumulait la rage de ce<br />
nouveau prolétariat.<br />
Une des réussites de ces auteurs fut l’élaboration du concept de « composition<br />
de classe ». De même que, chez Marx, la composition organique<br />
du capital exprime une synthèse entre composition technique et valeur,<br />
pour les opéraïstes, la composition de classe met l’accent sur le lien entre<br />
traits techniques « objectifs » et traits politiques « subjectifs ». La synthèse<br />
des deux aspects détermine le potentiel subversif des luttes, et cela<br />
permet de découper l’histoire en périodes, chacune d’entre elles étant<br />
caractérisée par la présence d’une figure « dynamique ». Chaque fois, le<br />
capital répond à une certaine composition de classe par une restructuration<br />
à laquelle succède une recomposition politique de la classe, autrement<br />
dit le surgissement d’une nouvelle figure « dynamique » 18 . De<br />
même, les différentes expressions de cette recomposition favorisent une<br />
« circulation des luttes ».<br />
À l’été 1960, on avait pu observer une première manifestation de cette<br />
nouvelle composition quand, à l’occasion d’une convention du parti néo-<br />
17. Antonio Gramsci, « Americanismo e fordismo », in Valentino Gerratana<br />
(dir.) Quaderni del Carcere, Einaudi, Turin, 1977, cahier 22, p. 2146.<br />
18. Romano Alquati, « Composizione organica del capitale e forza-lavoro alla<br />
Olivetti », Quaderni Rossi, <strong>n°</strong> 2, 1962, p. 63-98. En 1975, cet auteur a rassemblé<br />
ses écrits dans Sulla Fiat e altri scritti, Milan, Feltrinelli.
CLAUDIO ALBERTANI 2<strong>31</strong><br />
fasciste – qui participait alors à un gouvernement de centre-droit – devant<br />
se tenir à Gênes, une série de manifestations violentes avaient secoué cette<br />
ville et quelques autres. Elles se soldèrent par plusieurs morts, presque<br />
tous des jeunes gens, et la presse avait parlé, sur un ton méprisant, d’« une<br />
rébellion de rockers criminels » (de « teddy boys », selon l’expression alors<br />
à la mode). En revanche, dans une chronique écrite par un auteur proche<br />
de l’opéraïsme 19 , nous lisons que « les faits de juillet sont la manifestation<br />
de classe de cette nouvelle génération élevée dans le climat de l’aprèsguerre.<br />
[…] Une génération située hors des partis 20 ».<br />
En 1962, éclata l’affaire Fiat. Une fois expirés les contrats de travail du<br />
secteur automoteur, la corporation se trouva au centre d’un grave conflit<br />
du travail, qui déboucha sur les violents affrontements des 7, 8 et 9 juillet<br />
à Turin. Accusées d’avoir signé des contrats-poubelle, les organisations<br />
syndicales officielles furent contestées par des dizaines de milliers d’ouvriers<br />
en grève, lesquels donnèrent l’assaut au siège, situé piazza Statuto,<br />
de l’une d’entre elles, l’UIL (Unione italiana del lavoro), déclenchant une<br />
véritable révolte urbaine. La police ne put reprendre la piazza Statuto<br />
qu’après trois jours d’affrontements et après avoir reçu des renforts en<br />
provenance d’autres villes. Les protagonistes des événements, une fois de<br />
plus, étaient de jeunes méridionaux. Le PCI prit immédiatement position,<br />
en dénonçant les insurgés comme des « provocateurs fascistes ».<br />
C’était le début d’une nouvelle étape de l’histoire italienne : au fur et à<br />
mesure qu’apparaissaient de nouvelles pratiques d’affrontement des<br />
classes, on voyait augmenter la distance entre la gauche historique et les<br />
mouvements contestataires. La discussion fut très vive au sein de<br />
Quaderni Rossi et elle déboucha, en 1963, sur une première rupture. Si<br />
tous ses membres étaient d’accord sur la potentialité révolutionnaire de<br />
la nouvelle situation, il existait de sérieuses différences quant à l’attitude<br />
à adopter. Panzieri optait pour la prudence, quand Tronti, Alquati,<br />
Negri, Bologna, Asor Rosa et Faina voulaient passer à l’action. En 1964,<br />
ces derniers fondèrent Classe Operaia, « périodique politique des<br />
19. Intellectuel libertaire, Danilo Montaldi était proche du groupe Socialisme<br />
ou barbarie ; sans appartenir au réseau, il exerça une forte influence sur les premiers<br />
opéraïstes.<br />
20. Danilo Montaldi, « Il significato dei fatti di luglio », Quaderni di Unità<br />
Proletaria, <strong>n°</strong> 1, 1960.
2<strong>32</strong><br />
HISTOIRE RADICALE<br />
ouvriers en lutte ». Le groupe se proposait non seulement de contribuer<br />
à la recherche théorique mais aussi de consolider le réseau de relations<br />
et de contacts ébauchés les années précédentes 21 .<br />
LES PARADOXES DE MARIO TRONTI<br />
Signé par son directeur, Mario Tronti, l’éditorial du premier numéro de<br />
Classe Operaia – « Lénine en Angleterre » – indiquait le chemin à suivre :<br />
« On voit pointer une nouvelle époque de la lutte des classes. Les<br />
ouvriers l’ont imposée aux capitalistes avec la force objective des forces<br />
organisées en usine. […] La classe ouvrière conduit et impose un certain<br />
type de développement du capital. […] Un nouveau commencement est<br />
nécessaire. 22 »<br />
Penseur discuté et paradoxal, Tronti était convaincu que la récente<br />
intensification des luttes ouvrières ouvrait la voie à une transformation<br />
révolutionnaire. Mais, au lieu de se fier à la spontanéité des masses, à<br />
l’instar de Panzieri, il croyait plutôt à l’intervention du parti. Ses idées<br />
trouvèrent leur formulation définitive en 1966, avec la publication de<br />
Operai e Capitale, un livre plein d’intuitions brillantes et d’images suggestives,<br />
qui condensait les splendeurs et les misères de la seconde étape<br />
de l’opéraïsme.<br />
Alors qu’ailleurs les néo-marxistes se perdaient dans d’interminables<br />
discussions sur les théories de la crise et l’effondrement du capitalisme du<br />
fait de ses propres contradictions, Tronti affirmait la centralité politique de<br />
la classe ouvrière, mettait l’accent sur le facteur subjectif et proposait une<br />
analyse dynamique des relations de classe. L’usine n’était plus le lieu de la<br />
domination capitaliste mais le cœur même de l’antagonisme. Son<br />
21. Outre les protagonistes déjà cités, il faut mentionner, parmi les membres de<br />
Classe Operaia, Giairo Daghini, Luciano Ferrari-Bravo, Guido Bianchini, Enzo<br />
Grillo (traducteur des Grundrisse en italien), Oreste Scalzone, Franco Piperno,<br />
Franco Berardi, Gianfranco Della Casa, Gaspare de Caro, Gianni Amaroli et<br />
Ricardo d’Este.<br />
22. Classe Operaia, <strong>n°</strong> 1, janvier 1964. Repris in Mario Tronti, Operai e Capitale,<br />
Einaudi, Turin, (1966) 1971, p. 89-95. (Une version française de ce texte a<br />
paru chez Christian Bourgois.)
CLAUDIO ALBERTANI 233<br />
approche allait à rebours de la tradition réformiste : la lutte pour le salaire<br />
était considérée comme une lutte immédiatement révolutionnaire dès l’instant<br />
qu’elle parvenait à faire plier le pouvoir du capital. La crise n’était<br />
plus comprise comme le produit d’abstraites contradictions intrinsèques<br />
mais résultait de la capacité ouvrière d’arracher des revenus au capital.<br />
Le discours de Tronti se concentrait sur les tendances, ce qui allait être<br />
à l’avenir une constante de la pensée opéraïste : il s’agissait de construire<br />
un modèle théorique qui permettrait d’anticiper le cours des choses.<br />
C’est pourquoi il fallait mettre « Marx à Detroit », c’est-à-dire étudier les<br />
comportements du prolétariat dans le pays le plus avancé, là où le conflit<br />
apparaissait sous sa forme la plus pure.<br />
Une telle approche pourrait paraître séduisante, mais les propositions<br />
pratiques qu’on en tirait étaient, elles, franchement décevantes : « La<br />
tradition d’organisation de la classe ouvrière américaine est la plus politique<br />
au monde, parce que la force de ses luttes annonce la défaite économique<br />
de l’adversaire et la rapproche non de la conquête du pouvoir<br />
pour construire une autre société dans le vide, mais de l’explosion du<br />
salariat pour réduire le capital et les capitalistes à une position subalterne<br />
dans cette même société. 23 » Défaite de l’adversaire ? Aux États-<br />
Unis ? Non, précisait Tronti : de toute façon, « la pure lutte syndicale<br />
ne peut nous faire sortir du système […], il faut une organisation de<br />
type léniniste 24 ».<br />
Plus intéressante était, en revanche, l’analyse de la relation entre usine<br />
et société : « Au niveau le plus élevé du développement capitaliste, la<br />
société entière devient une articulation de la production. Autrement dit,<br />
toute la société vit en fonction de l’usine, et l’usine étend sa domination<br />
à toute la société. 25 » Contre l’interprétation selon laquelle l’extension du<br />
secteur tertiaire signifiait un affaiblissement de la classe ouvrière, Tronti<br />
soutenait qu’avec la généralisation du travail salarié un nombre toujours<br />
plus élevé de personnes était en voie de prolétarisation, ce qui ne faisait<br />
qu’amplifier l’antagonisme au lieu de le réduire.<br />
Bien qu’Operai e Capitale soit devenu une référence obligée pour les<br />
militants de Mai 68, on peut noter que, curieusement, l’auteur de cet<br />
23. Ibid., p. 298-299.<br />
24. Ibid., p. 81 et 84.<br />
25. Ibid., p. 53.
234<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
ouvrage ne quitta jamais le PCI et qu’aujourd’hui encore il demeure<br />
membre du post-communiste PDS. Mieux même : il y a peu, Tronti a<br />
expliqué que l’interprétation gauchiste de son livre avait été le fruit d’une<br />
erreur. « Je n’ai jamais été spontanéiste. J’ai toujours pensé que la<br />
conscience politique devait venir du dehors. 26 »<br />
Indépendamment des opinions que professe Tronti aujourd’hui, il est,<br />
cependant, évident que, dans les années 1960, lui et les opéraïstes ouvrirent<br />
un front contre la tradition nationale-populaire de la gauche italienne,<br />
qui embrassait non seulement la politique mais aussi la<br />
culture (philosophie, littérature, cinéma et sciences humaines), et qu’ils<br />
donnèrent une première réponse aux théories de la « domination totale »<br />
acceptées par tous, y compris par la gauche critique. Ce qui semble le<br />
plus actuel dans Operai e Capitale, c’est sûrement la critique du logos<br />
technico-productiviste, tant marxiste que libéral, et de l’idée – déjà<br />
présente chez Panzieri – que la connaissance est liée à la lutte, qu’elle<br />
n’est pas neutre mais partisane 27 .<br />
Le livre de Tronti demeure une tentative sérieuse de rénovation du<br />
marxisme, même si elle n’a débouché sur rien 28 . Son « subjectivisme »<br />
exprima une rébellion contre l’objectivisme du marxisme vulgaire, celui<br />
de l’école de Francfort compris, si on excepte Marcuse. Tronti perçut le<br />
« projet » du capital de contrôler la société dans sa totalité, mais, à<br />
rebours d’Adorno, il l’interpréta comme une stratégie pour contenir la<br />
protestation ouvrière 29 . Ce subjectivisme fut, en même temps, la source<br />
de nombreuses erreurs, la plus grave étant de considérer que la logique<br />
du développement capitaliste ne reposait pas sur l’extraction du profit<br />
mais sur la combativité ouvrière. Une telle approche l’éloignait de<br />
Panzieri et du premier opéraïsme, qui concevait le capital et la classe<br />
ouvrière comme deux réalités antagoniques également « objectives ».<br />
26. Mario Tronti, entrevue parue dans L’Unità, Rome, 8 décembre 2001. Dans<br />
un entretien précédent, daté du 8 août 2000, Tronti déclara : « Nous fûmes victimes<br />
d’une illusion optique. »<br />
27. Mario Tronti, Operai e Capitale, op. cit., p. 14.<br />
28. Dans ses Considerations on Western Marxism (New Left Book, Londres,<br />
1976), Perry Anderson ne consacre pas une ligne à l’opéraïsme italien.<br />
29. Dans Dialectique négative, Adorno affirma la suprématie de l’« objet » (traduction<br />
en italien, Einaudi, 1975, p. 156-157).
CLAUDIO ALBERTANI 235<br />
Panzieri, en outre, ne commit pas la bévue de penser que les augmentations<br />
de salaire pouvaient provoquer la rupture du système 30 .<br />
Sans vouloir à tout prix revendiquer un « vrai » marxisme, il semble<br />
évident que l’approche de Tronti repose sur une lecture partielle de Marx<br />
et, davantage encore, sur une grossière simplification de la réalité. S’il est<br />
bien vrai que Marx a écrit que la lutte des classes est le moteur de<br />
l’histoire, son analyse se centre sur la relation sociale entre deux pôles<br />
contradictoires : d’un côté, le capital comme puissance sociale, travail<br />
« mort », objectivité pure, esprit du monde, et, de l’autre, le travail<br />
« vivant », la classe ouvrière qui, partie et fondement de la relation,<br />
fonde, en même temps, sa négation. L’origine de la contradiction est due<br />
à la double nature du travail ouvrier, qui est à la fois travail abstrait, producteur<br />
de plus-value, et travail concret, producteur de valeurs d’usage.<br />
Le problème – ajoutait-il – est que « la valeur ne porte pas inscrite sur<br />
son front ce qu’elle est » <strong>31</strong> . Selon Marx, les antinomies entre « subjectivisme<br />
» et « objectivisme » ne peuvent pas être résolues dans la théorie<br />
mais dans la pratique <strong>32</strong> , puisque seule la création d’un nouveau mode<br />
de production – la fameuse négation de la négation ou expropriation des<br />
expropriateurs – peut y parvenir.<br />
Chez Tronti en revanche, il y a bien hypostase du pôle subjectif : « Le<br />
capital comme fonction de la classe ouvrière. 33 » Cela le conduisit à<br />
transformer la classe ouvrière en fondement ontologique de la réalité. La<br />
subjectivité n’était plus la force concrète d’individus conscients qui s’organisent<br />
pour changer le monde, mais – pour Tronti – une simple catégorie<br />
herméneutique pour la compréhension du capitalisme. Quant au<br />
négatif, il était parti en fumée.<br />
Il convient de signaler que, presque quarante ans plus tard, le même<br />
schéma est constamment à l’œuvre dans Empire. Ici, le subjectivisme<br />
extrême, la lecture de l’histoire à partir de la « puissance » ouvrière,<br />
devient pur délire : « De la manufacture jusqu’à l’industrie à grande<br />
30. Lire par exemple Raniero Panzieri, « Plusvalore e pianificazione », art. cit.,<br />
où l’auteur signale l’unité du capitalisme comme fonction sociale.<br />
<strong>31</strong>. Karl Marx, El Capital, tome I, p. 88.<br />
<strong>32</strong>. Pages de Karl Marx. Choisies, traduites et présentées par Maximilien Rubel.<br />
I. Sociologie critique, Payot, 1970, p. 103.<br />
33. Mario Tronti, Operai e Capitale, op. cit., p. 221.
236<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
échelle, du capital financier à la restructuration transnationale et la mondialisation<br />
du marché, ce sont toujours les initiatives de la main-d’œuvre<br />
organisée qui déterminent les configurations du développement capitaliste.<br />
» Ou encore : « Nous arrivons ainsi au délicat passage par lequel la<br />
subjectivité de la lutte des classes transforme l’impérialisme en Empire. »<br />
C’est pourquoi il est nécessaire de comprendre « la nature mondiale de<br />
la lutte de classe prolétarienne et sa capacité à anticiper et préfigurer les<br />
développements du capital vers la réalisation du marché mondial » 34 .<br />
Dans ce passage, et tant d’autres similaires, la dialectique ouvriers-capital<br />
– cette « grammaire de la révolution », selon la magnifique expression<br />
d’Alexandre Herzen – s’évanouit dans l’apologie d’un présent sans<br />
contradictions. Si les ouvriers sont d’ores et déjà si forts et puissants,<br />
pourquoi devraient-ils faire la révolution ?<br />
RUPTURES<br />
La principale fonction de Classe Operaia fut sans doute d’impulser l’articulation<br />
de divers groupes locaux qui travaillaient sur la question<br />
ouvrière en divers lieux du pays. Le groupe, cependant, eut une vie<br />
brève, puisqu’il se saborda en 1966 35 . Pourquoi ? Au cours d’une<br />
réunion tenue à Florence vers la fin 1966, Tronti, Asor Rosa et Negri luimême<br />
se posèrent la question de l’urgence d’un virage politique. Le thème<br />
central était la relation classe-parti : la classe incarnait la stratégie et le<br />
parti la tactique. Il y avait un problème, néanmoins : si la première était<br />
très consciente du travail de démolition qui l’attendait, le second était en<br />
train de perdre le nord. Dans ces conditions, plutôt que de jeter de l’huile<br />
sur le feu des protestations ouvrières, il fallait faire de l’entrisme dans les<br />
syndicats, et surtout dans le PCI. L’idée était de former une sorte de direction<br />
ouvrière afin de lui faire jouer le rôle de « cale » (telle était l’expression<br />
utilisée) dans le parti et modifier du coup son équilibre interne 36 .<br />
34. Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, op. cit., p. 261 et 291.<br />
35. Le dernier numéro de la revue parut en mars 1967.<br />
36. Gianni Armaroli (collaborateur génois de Classe Operaia), lettre à l’auteur,<br />
30 décembre 2002.
CLAUDIO ALBERTANI 237<br />
Il faut signaler que, jusqu’alors, l’opéraïsme avait été un laboratoire<br />
collectif, une sorte de réseau informel formé d’intellectuels, de syndicalistes,<br />
d’étudiants et de révolutionnaires de tendances diverses qui<br />
avaient tous en commun une sensibilité anti-bureaucratique, et la découverte<br />
d’un nouveau monde ouvrier en lutte. À l’exception de Tronti, personne<br />
n’y avait affronté ouvertement la question du léninisme. On<br />
acceptait le Lénine qui avait compris la convergence entre crise économique,<br />
crise politique et tendance ouvrière vers l’autonomie, mais on<br />
n’abordait pas la question du parti.<br />
Une minorité libertaire – intégrée par Gianfranco Faina, Ricardo d’Este<br />
et d’autres militants de Gênes et de Turin – n’accepta pas ce choix en<br />
faveur de l’entrisme. Tel qu’eux l’entendaient, l’opéraïsme était fondé sur<br />
l’idée que les forces subversives se regroupaient hors de la logique des partis<br />
et des syndicats officiels. Ils trouvèrent une source d’inspiration dans le<br />
communisme des conseils 37 , chez les anarchistes espagnols et chez<br />
Amadeo Bordiga 38 . Les années suivantes, ils partagèrent les positions<br />
libertaires du groupe Socialisme ou barbarie et de l’Internationale situationniste,<br />
et rompirent définitivement avec toute prétention à « diriger »<br />
le mouvement 39 . Une autre tendance, dirigée par Sergio Bologna, essaya<br />
de s’en tenir à l’opéraïsme originel, en revenant à son travail de fourmi au<br />
37. Les principaux théoriciens des conseils ouvriers furent les tribunistes hollandais<br />
(ainsi nommés à cause du périodique, De Tribune, qu’ils éditaient), Anton<br />
Pannekoek et Herman Gorter, à côté des Allemands Karl Korsch, Otto Ruhle et<br />
Paul Mattick.<br />
38. Contrairement à ce qu’on dit souvent (lire, par exemple, Octavio Rodríguez<br />
Araujo, Izquierdas e izquierdismos. De la Primera Internacional a Porto Alegre, Siglo<br />
XXI editores, 2002, p. 115), Bordiga n’était pas un conseilliste mais un partisan<br />
convaincu de l’idée bolchevique de parti. Lire là-dessus la polémique qu’il soutint<br />
avec Gramsci, in Antonio Gramsci-Amadeo Bordiga, Debate sobre los consejos<br />
de fábrica, editorial Anagrama, 1973. Cependant, c’est Bordiga – fondateur et<br />
premier secrétaire du PCI –, et non Gramsci, qui s’opposa à la bolchevisation des<br />
partis occidentaux, imposée par l’Internationale communiste à partir de 1923.<br />
39. Vers 1967 naquirent, à Gênes, le Circolo Rosa Luxemburg, la Lega operaistudenti<br />
et Ludd-consigli proletari (présents aussi à Rome et Milan). À Turin,<br />
l’Organizzazione consiliare naît en 1970 et Comontismo en 1971. Minoritaires,<br />
mais significatifs, ces groupes furent pratiquement effacés des histoires du<br />
mouvement de 1968.
238<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
sein de la Fiat et de quelques usines lombardes 40 . De sorte que le virage<br />
annoncé n’eut pas lieu et que Tronti dut reconnaître qu’on n’était pas parvenu<br />
à « réaliser le cercle vertueux de la lutte, de l’organisation [et non de<br />
l’auto-organisation, nda] et de la possession du terrain politique 41 ».<br />
Au même moment, des événements importants compliquèrent le projet<br />
de convertir le PCI à l’opéraïsme 42 . En 1968, la température sociale<br />
en Italie commença à monter à des niveaux préoccupants. Des ferments<br />
culturels nouveaux et de plus en plus intenses commençaient à se propager.<br />
Les problèmes nationaux se mêlaient à la situation internationale<br />
de la fin des années 1960 (manifestations contre la guerre au Vietnam,<br />
Black Panthers, etc.), en inaugurant une période de grands changements.<br />
Les premiers à entrer en mouvement furent les étudiants, qui occupèrent<br />
les principales universités du pays : Trente, Milan, Turin et Rome. Ils<br />
commencèrent par mettre en cause l’autoritarisme universitaire et terminèrent<br />
par faire la critique du capitalisme, de l’État, de la patrie, de la religion,<br />
de la famille, etc. Ils manifestaient un mépris tout particulier pour<br />
les partis de gauche, qu’ils accusaient d’être devenus des engrenages fondamentaux<br />
du régime. À la fin de l’année 1968, et surtout en 1969,<br />
quand les protestations ouvrières s’intensifièrent, le système entra en crise.<br />
La grande rupture sociale, qui ailleurs s’était consumée en quelques<br />
mois, s’étendit, en Italie, sur près de dix ans, et c’est là que réside sans<br />
doute la singularité de ce mouvement.<br />
Il va sans dire que cette explosion de radicalité légitimait les hypothèses<br />
opéraïstes les plus audacieuses. La « stratégie du refus » était en train de<br />
se réaliser. Pourtant, Tronti affirma alors qu’on n’assistait pas à la naissance<br />
d’une nouvelle époque mais plutôt à la dernière des poussées – et la plus<br />
désespérée d’entre elles – d’un cycle de luttes qui touchait à sa fin.<br />
Il est loisible aujourd’hui de percevoir d’indéniables éléments de vérité<br />
dans ce pessimisme, mais, à l’époque, tout semblait encore en suspens.<br />
40. En 1969, Sergio Bologna et d’autres créèrent La Classe, une revue qui servit<br />
de porte-parole aux luttes ouvrières de Fiat. Bologna participa à la fondation de<br />
Potere operaio, avant d’animer, dans les années 1970 et 1980, la revue Primo<br />
Maggio, un bastion de l’opéraïsme original.<br />
41. Mario Tronti, entrevue citée, 8 août 2000.<br />
42. Entre 1968 et 1971, la tentative déboucha sur la création de la revue<br />
Contropiano, dirigée par Asor Rosa et Cacciari, à laquelle collaborèrent aussi<br />
bien Tronti que Negri.
CLAUDIO ALBERTANI 239<br />
Soudain, Tronti accordait à l’État des attributs qui constituaient la négation<br />
de tout ce qu’il avait écrit jusqu’alors. Il n’y a plus, précisait-il « d’autonomie,<br />
d’autosuffisance, d’autoreproduction de la crise hors du système<br />
de médiation politique des contradictions sociales ». Traduit dans un langage<br />
plus clair, cela voulait dire que la lutte économique ne pouvait plus<br />
être politique, et que la classe ouvrière, considérée jusque-là comme une<br />
force antagoniste, devenait la « seule rationalité de l’État moderne » 43 . En<br />
vérité, aux yeux de Tronti, l’utopie touchait à sa fin, et c’est cela qu’il cherchait<br />
à signifier en parlant d’« autonomie de la politique », une idéologie<br />
qui eut une vie courte, bien qu’elle accompagnât l’évolution d’une partie<br />
des opéraïstes – le critique littéraire Alberto Asor Rosa ou le jeune germaniste<br />
Massimo Cacciari – vers l’académisme et le PCI, où ils furent<br />
accueillis comme des repentis. La croyance en l’existence d’une sphère<br />
politique « pure » à l’intérieur de l’État servit de justification à d’autres<br />
pour entamer une longue marche au sein des institutions.<br />
À l’intérieur du PCI se déroula un (court) débat sur l’opportunité de<br />
chevaucher le tigre du mouvement, mais, à la fin, prévalurent les positions<br />
les plus conservatrices, au point qu’on en vint à exclure le groupe<br />
du Manifesto (Rossanda, Pintor, Magri). C’est ainsi que, de manière peu<br />
glorieuse, se conclut le trajet d’un secteur des « marxistes autonomistes<br />
». Quant aux autres, la majorité d’entre eux, dont Antonio Negri,<br />
vit dans la nouvelle situation la possibilité d’impulser une politique<br />
révolutionnaire hors des partis de gauche, et même contre eux.<br />
En 1969, on assista à la multiplication de groupes et de groupuscules<br />
d’extrême gauche qui se proposaient tous de reproduire en Italie la stratégie<br />
bolchevique – dans ses différentes versions : léniniste, trotskiste, stalinienne<br />
et maoïste –, par la création d’un parti pur et dur visant à la prise<br />
du pouvoir. Les opéraïstes fondèrent Potere operaio et Lotta continua, formations<br />
qui gravitaient également dans l’orbite du marxisme-léninisme,<br />
bien qu’elles n’aient pas manifesté une sympathie particulière pour le<br />
modèle soviétique ni même, reconnaissons-le, pour le chinois.<br />
Si le projet était irréel, les conflits, eux, étaient bel et bien authentiques,<br />
et à mesure que les groupes subversifs gagnaient du terrain, l’État<br />
devenait de plus en plus agressif. Le dénouement fut la « stratégie de la<br />
tension », soit une série d’attentats et d’assassinats commis par les<br />
43. Mario Tronti, Sull’autonomia del politico, Feltrinelli, 1977, p. 7, 19 et 20.
240<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
services secrets italiens entre 1969 et 1980 avec la complicité des gouvernements<br />
successifs. Il n’y a pas le moindre doute, en effet – et il existe<br />
des dizaines de documents pour le prouver –, que, en Italie, le terrorisme<br />
fut, dans un premier temps, l’apanage de l’État lui-même, et non des<br />
mouvements d’extrême gauche 44 .<br />
L’histoire de ces événements tragiques étant hors des objectifs de la<br />
présente étude 45 , je me contenterai ici de signaler les trois points suivants<br />
: 1) en adoptant en 1974 la stratégie du compromis historique –<br />
laquelle visait, pour les communistes, à entrer au gouvernement grâce à<br />
une alliance stratégique avec les démocrates-chrétiens –, le PCI se<br />
déplaça encore plus vers la droite, en contribuant ainsi à légitimer la criminalisation<br />
de toute dissidence ; 2) cette évolution ainsi que les massacres<br />
d’État finirent par convaincre un grand nombre de militants que<br />
la seule voie praticable était la voie militaire et qu’il fallait un parti structuré<br />
de manière verticale, hiérarchique et clandestine ; 3) la lutte armée<br />
fut une erreur aux conséquences incalculables, qui entraîna le mouvement<br />
vers un affrontement sanglant – et voué à l’échec – avec l’État.<br />
LES MÉSAVENTURES DE L’OUVRIER SOCIAL<br />
C’est dans ce contexte que nous devons analyser la pensée de celui qui<br />
prit le relais de l’opéraïsme : Antonio Negri. Il a souvent raconté luimême<br />
sa trajectoire. Originaire d’une famille modeste, il étudia à l’université<br />
de Padoue, où il fit une thèse sur l’historicisme allemand, avant<br />
de prolonger ses études en Allemagne et en France. Il a connu une<br />
brillante carrière universitaire, et a publié quelque vingt livres, ainsi<br />
qu’un nombre impressionnant d’articles dans des revues du monde<br />
entier. À partir de la fin des années 1950, et à côté de ses activités<br />
d’enseignement, il s’engagea dans l’action politique, d’abord dans les<br />
44. Eduardo di Giovanni, Marco Ligini, La Strage di Stato, (Samonà e Savelli,<br />
1970) Avvenimenti, 1993.<br />
45. Parmi les idées les plus curieuses de Negri, on retiendra l’éloge de<br />
l’« absence de mémoire » (Antonio Negri, Du Retour. Abécédaire biopolitique,<br />
Calmann-Lévy, 2002, p. 111).
CLAUDIO ALBERTANI 241<br />
secteurs catholiques, puis au sein du parti socialiste et enfin dans la<br />
mouvance opéraïste 46 .<br />
Dans sa première étape, et jusqu’à Classe Operaia, l’apport de Negri ne<br />
fut pas décisif, mais il devint déterminant avec la fondation de Potere<br />
operaio. Le groupe naquit pendant l’été 1969, dans le contexte d’une<br />
crise du mouvement étudiant, dont la cause, du point de vue marxisteléniniste,<br />
tenait au fait que les révoltes étudiantes n’avaient de sens que<br />
subordonnées à une « hégémonie ouvrière », c’est-à-dire à la ligne de<br />
l’organisation. Il était donc urgent, dans cette optique, de construire une<br />
direction politique pour les canaliser en ce sens. Negri impulsa, alors,<br />
l’idée d’édifier un parti centralisé, « compartimenté» et vertical. « Notre<br />
analyse se fonde sur l’œuvre des classiques, de Marx, de Lénine, de Mao.<br />
Il n’y a pas de place, dans notre organisation, pour les états d’âme ni pour<br />
les velléités », écrivait-il dans un texte qui ne permet guère d’interprétations<br />
« autonomistes » 47 .<br />
Contrairement à Lotta continua (LC), un groupe plutôt porté sur l’activisme,<br />
Potere operaio (PO) accordait une certaine importance à l’élaboration<br />
théorique tournant autour d’une interprétation extrémiste de<br />
l’opéraïsme des origines. La subjectivité ne résidait plus dans la classe<br />
mais dans l’avant-garde communiste, c’est-à-dire dans le groupe PO. Il<br />
convenait donc de centraliser et de radicaliser les antagonismes spontanés<br />
pour les transformer en action insurrectionnelle contre l’État. Une<br />
fois de plus, la tentative échoua. Le cycle de luttes entamé au début des<br />
années 1970 entra dans sa phase déclinante et l’une de ses dernières<br />
manifestations fut l’occupation de la Fiat Mirafiori (à Turin) qui, en mars<br />
1973, mit fin à l’époque des grands affrontements entre les ouvriers et le<br />
capital. Un des legs de cette lutte fut le « statut des travailleurs », un<br />
ensemble de dispositions favorables au monde du travail, aujourd’hui<br />
réduit à une coquille vide.<br />
Pendant la fin de la décennie, les conflits sociaux persistèrent, mais<br />
leur centre de gravité ne se trouvait plus dans les usines. Dans le même<br />
46. Ibid.<br />
47. Antonio Negri, Crisi dello Stato-piano, comunismo e organizzazione rivoluzionaria,<br />
Feltrinelli, 1972, p. 181. Ce « néo-léninisme insurrectionnel » sera systématisé<br />
in Antonio Negri, La Fabbrica della strategia. 33 lezioni su Lenin, Libri<br />
Rossi, 1977.
242<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
temps que les principales formations extra-parlementaires entraient en<br />
crise (PO se dissout en 1973 et LC en 1976) naissait une constellation<br />
de petits groupes autour du slogan « Prenons la ville ». Quelques-uns de<br />
ces groupes prirent le nom d’« Indiens métropolitains » ou de<br />
« Prolétariat juvénile ». Ils occupaient des immeubles, formaient des<br />
centres sociaux, fondaient des revues, mettaient en marche des projets de<br />
communication alternative, créaient des associations féministes et écologistes.<br />
Avec une base militante située tant dans les usines que dans les<br />
quartiers, ces groupes commençaient à abandonner les vieilles conceptions<br />
du parti séparé et du dirigisme léniniste pour aller à la recherche<br />
d’alternatives dans l’organisation d’espaces de coexistence et d’échange<br />
social autonomes par rapport à la légalité dominante. Pour mettre en<br />
valeur leur indépendance politique, ils utilisaient des sigles où apparaissait<br />
le mot « autonome » – par exemple, « Prolétaires autonomes » ou<br />
« Assemblée autonome » – de telle sorte qu’on commença à les identifier<br />
sous le nom de « zone de l’autonomie ouvrière » 48 .<br />
Negri interpréta la nouvelle étape avec un triomphalisme militant qui<br />
était à l’extrême opposé du pessimisme de Tronti (et de son « autonomie<br />
du politique »). Pour lui, il n’y avait plus de retour en arrière possible :<br />
le refus du travail tayloriste avait jeté à bas les murs qui séparaient l’usine<br />
du territoire. Tout le processus social était maintenant mobilisé pour la<br />
production capitaliste, augmentant de la sorte l’importance du travail<br />
productif. Dans cette nouvelle situation, l’ouvrier-masse sortait de l’usine<br />
pour se déplacer vers le territoire, l’usine diffuse, et devenir l’ouvrier social,<br />
le nouveau sujet dont notre auteur commença de proclamer la centralité.<br />
Techniciens, étudiants, enseignants, ouvriers, émigrés, squatters finissaient<br />
tous dans le même sac, sans que Negri porte la moindre attention<br />
à leurs différences, à leurs spécificités et à leurs contradictions. Se proposant<br />
de renverser (en italien, rovesciare) les catégories de Marx, il introduisit<br />
dans son analyse la catégorie d’auto-valorisation (la même que celle<br />
qui réapparaîtra, sans autres explications, un quart de siècle plus tard,<br />
48. Un des groupes les plus connus de cette tendance était le Collettivo di via<br />
dei Volsci, de Rome, qui allait bientôt fonder Radio Onda Rossa, une station du<br />
mouvement qui existe encore.
CLAUDIO ALBERTANI 243<br />
dans Empire) 49 . De quoi s’agit-il ? Alors que la valorisation capitaliste se<br />
fonde sur la valeur d’échange, l’auto-valorisation – pivot de l’édifice<br />
théorique de Negri – serait fondée, elle, sur la valeur d’usage et sur les<br />
nouveaux besoins des prolétaires. Généralisant sur tout le territoire –<br />
l’usine diffuse – les pratiques d’auto-valorisation, l’ouvrier social devait<br />
désormais lutter pour le « salaire garanti ». Dès lors, chez Negri, le noyau<br />
du conflit (et, partant, de l’analyse) se déplaçait vers l’État. Il pensait que<br />
l’État keynésien – qu’il appelait l’État-plan – avait inscrit les acquis de la<br />
révolution d’Octobre au cœur du développement capitaliste, en transformant<br />
le « pouvoir ouvrier » en une « variable indépendante ». Pour<br />
lui, la lutte principale avait lieu maintenant sur le terrain de l’autovalorisation<br />
et, puisqu’il n’y avait plus de reproduction du capital hors<br />
de l’État, la « société civile » cessait d’exister, en laissant seuls, face à face,<br />
deux grands adversaires : les prolétaires et l’État 50 .<br />
En dépit de son apparente cohérence, ce raisonnement partait d’une<br />
interprétation erronée du concept marxiste de valeur. Pour Negri, la<br />
valeur d’usage exprimait la radicalité ouvrière, sa potentialité subjective,<br />
en tant qu’antagoniste de la valeur d’échange. Elle était en quelque sorte<br />
le « bon » côté de la relation. Pourtant, si on adopte le point de vue de<br />
la critique de l’économie politique, une telle approche n’a pas de sens,<br />
car, comme l’expliquait Marx dans le premier chapitre du tome I du<br />
Capital, la valeur d’usage n’est en aucune manière une catégorie morale,<br />
mais la base matérielle de la richesse capitaliste, la condition de son accumulation.<br />
Si, à un moment quelconque du procès de circulation, les<br />
valeurs d’usage ne se transforment pas en valeurs d’échange, elles cessent<br />
d’être des valeurs et, en ce sens, elles limitent et conditionnent le processus<br />
de valorisation.<br />
Une des sources de Negri était Agnès Heller, une des représentantes les<br />
plus connues de l’école de Budapest, laquelle avait mis au centre de sa<br />
réflexion sur Marx le concept de besoins radicaux. Elle se gardait bien,<br />
49. Negri a développé le thème de l’auto-valorisation dans Il dominio e il sabotaggio.<br />
Sul metodo marxista della trasformazione sociale. Feltrinelli, 1978 ; et dans<br />
Empire, op. cit., p. 491 et 493.<br />
50. Antonio Negri, Proletari e Stato. Per una discussione su autonomia operaia e<br />
compromesso storico, Feltrinelli, 1976, p. 30. La question de la dissolution de la<br />
société civile dans l’État est reprise dans Empire, op. cit., p. 51, 398-399.
244<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
toutefois, de tomber dans l’apologie des besoins immédiats. « Le besoin<br />
économique, écrivait-elle, est une expression de l’aliénation capitaliste<br />
dans une société où la fin de la production n’est pas la satisfaction des<br />
besoins mais la valorisation du capital, où le système des besoins repose<br />
sur la division du travail et la demande du marché. 51 » Negri, lui, n’évita<br />
pas l’apologie, et s’écarta ainsi du marxisme critique, en oubliant qu’on<br />
ne peut pas combattre un monde aliéné d’une façon aliénée.<br />
L’autonomie, en outre, ne peut s’exprimer dans la condition immédiate<br />
de la classe. Sous la domination du capital, l’autonomie est un projet,<br />
une tendance ou, plus précisément, une tension. Elle ne peut se constituer<br />
en réalité pratique que dans les moments de rupture, dans les<br />
espaces décolonisés. Quand cette réalité pratique se socialise, viennent<br />
alors les grands moments de crise de l’administration, comme en France<br />
en 1968 ou en Italie en 1977. Contrairement à ce que pense Negri, le<br />
communisme n’est pas « l’élément dynamique constitutif du capitalisme<br />
52 » mais une autre société sans antagonismes de classes, sans<br />
pouvoir d’État et sans fétichisme mercantile.<br />
Et le parti ? « Dans ma conscience et ma pratique révolutionnaire, je ne<br />
peux ignorer ce problème », écrivait celui qui se voyait lui-même comme<br />
le Lénine italien – en précisant qu’il était « urgent de lancer le débat sur<br />
la dictature communiste » 53 . Le parti, en effet, restait une tâche en<br />
suspens, bien qu’il existât déjà en embryon, avec l’Autonomie organisée<br />
(avec une majuscule, pour bien la distinguer de l’autre autonomie), c’està-dire<br />
l’ensemble des organisations semi-clandestines et leurs services<br />
d’ordre militarisés qui, poussés par la répression étatique, pratiquaient la<br />
lutte des classes avec l’intention de « filtrer » et de « recomposer »<br />
l’antagonisme des masses dans l’attente de la lutte finale 54 .<br />
51. Agnès Heller, La Teoria dei bisogni in Marx, Feltrinelli, 1977, p. 26.<br />
52. Antonio Negri, Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse,<br />
Feltrinelli, 1979, p. 194.<br />
53. Antonio Negri, Il dominio…, op. cit., p. 61 et 70.<br />
54. Dans les années 1970, il y eut en Italie des dizaines, et probablement des<br />
centaines, de groupes qui pratiquèrent la lutte armée. Outre les Brigades<br />
rouges, on peut citer, parmi beaucoup d’autres, les Nuclei armati proletari<br />
(NAP), Prima linea, Mai più senza fucile, Azione rivoluzionaria et Proletari<br />
armati per il comunismo.
CLAUDIO ALBERTANI 245<br />
Le résultat fut catastrophique. Le rêve de la prise de pouvoir se heurta<br />
bien vite aux brisants de la réalité. À partir de 1977, dernière grande saison<br />
créative du « laboratoire Italie », le PC fit front uni avec la démocratiechrétienne<br />
au pouvoir. La répression entra dans une nouvelle phase,<br />
écrasant tout ce qui se plaçait au-delà de la gauche parlementaire et annulant<br />
la différence entre terrorisme et protestation sociale. Chacun de son<br />
côté, et souvent en concurrence l’une contre l’autre, l’Autonomie organisée<br />
– ou, plutôt, certaines de ses organisations 55 – et les néo-staliniennes<br />
Brigades rouges continuèrent leur absurde assaut contre le « cœur de<br />
l’État » (comme si l’État avait un cœur !), entraînant dans leur ruine le<br />
riche et complexe tissu de l’autonomie avec un a minuscule 56 .<br />
Encore en 1978, à l’occasion de l’exécution d’Aldo Moro par les<br />
Brigades rouges (une des erreurs les plus néfastes et les plus lourdes de<br />
conséquences négatives jamais commises par un groupe révolutionnaire),<br />
et tout en manifestant son désaccord, Negri pouvait écrire que le côté<br />
positif de l’action était d’avoir imposé au mouvement la « question du<br />
parti 57 ». Le 7 avril 1979, l’hallucination prit fin de la façon la plus tragique,<br />
quand Negri et des dizaines de militants de l’Autonomie furent<br />
emprisonnés sous la (fausse) accusation d’être les idéologues des Brigades<br />
rouges. Ils allaient passer entre deux et sept ans en prison, désignés par la<br />
mesquinerie du pouvoir comme des victimes dignes d’être sacrifiées sur<br />
l’autel de la paix sociale 58 .<br />
En 1980, la dernière tentative d’occupation de l’usine Mirafiori marquait<br />
la fin symbolique d’un long cycle de conflits sociaux où, cas unique<br />
dans l’histoire européenne, les luttes ouvrières et étudiantes, les<br />
55. Contrairement à ce que je lis dans Memoria (janvier 2003, <strong>n°</strong> 167, p. 5), il<br />
n’a jamais existé en Italie un groupe appelé « Autonomie ouvrière ». Negri dirigeait<br />
une des nombreuses organisations qui formaient le camp de l’autonomie<br />
ouvrière.<br />
56. Sur le bilan tragique de la lutte armée, on lira Cesare Bermani, Il nemico<br />
interno. Guerra civile e lotte di classe in Italia (1943-1976), Odradek, 1997.<br />
57. Rosso, mai 1978. La revue, éditée à Milan, était l’organe du Gruppo<br />
Gramsci, une organisation dirigée par Negri.<br />
58. Après deux années d’emprisonnement, Negri fut mis en liberté grâce à son<br />
élection comme député du parti radical. En 1983, il s’exila en France.
246<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
mouvements pour la réinvention de la vie avaient évolué ensemble dans<br />
une formidable tentative de libération collective 59 .<br />
LES EXPLOITS DE LA MULTITUDE<br />
Dans les deux décennies suivantes, Negri n’abandonna pas l’habitude de<br />
lire les mouvements sociaux comme vérification de ses thèses, écrivant<br />
de nombreux (et cryptiques) ouvrages, sans jamais esquisser la moindre<br />
autocritique.<br />
De Foucault, Deleuze et Guattari, notre auteur a hérité une forte aversion<br />
pour la dialectique 60 . Déjà, dans son étude sur les Grundrisse, fruit<br />
d’un séminaire à Paris, il écrivait que « l’horizon méthodique marxien ne<br />
se centre jamais sur le concept de totalité ». Au contraire, il « se trouve<br />
caractérisé par la discontinuité matérialiste des procès réels », de telle<br />
sorte que le matérialisme se subordonne la dialectique à lui-même 61 .<br />
Negri voit la société capitaliste comme un champ de forces en lutte<br />
constante. À la différence des post-structuralistes français, néanmoins, il<br />
pense que le moteur des processus sociaux est la séparation ou, en<br />
d’autres termes, l’antagonisme social. Il revient à la réflexion d’identifier<br />
l’antagonisme déterminant, de scruter ses tendances et de le mener à<br />
l’explosion. Aussitôt après, l’analyse se déplace vers un nouveau champ,<br />
le redéfinit, et ainsi de suite 62 . Le capital n’est plus conçu comme contradiction<br />
en procès (Marx) mais comme l’affirmation progressive d’un sujet<br />
connu à l’avance.<br />
Dans Spinoza, l’anomalie sauvage, écrit en prison, Negri précisa peu à<br />
peu son projet : travailler à la constitution matérielle de la subjectivité<br />
radicale en Occident, en creusant le fossé entre les philosophies du pouvoir<br />
et celles de la subversion. Autour de Spinoza, il voyait se condenser<br />
59. Dans les années 1980 et 1990, le projet d’un opéraïsme libertaire est resté<br />
vivant dans la réflexion de quelques collectifs comme Primo Maggio,<br />
Collegamenti-Wobbly et Vis-à-Vis.<br />
60. Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, op. cit., p. 183 et 187.<br />
61. Antonio Negri, Marx oltre Marx, op. cit., p. 55.<br />
62. Ibid., p. 24-25.
CLAUDIO ALBERTANI 247<br />
une tradition « anomale » qui, affirmant la productivité du sujet, va de<br />
Machiavel à Marx, contre l’axe incarné par la triade Hobbes-Rousseau-<br />
Hegel 63 . Negri trouvait chez Spinoza une critique anticipée de la dialectique<br />
hégélienne, ainsi que la naissance du matérialisme révolutionnaire.<br />
De telle sorte qu’à l’invention stalinienne du diamat, Negri oppose un<br />
nouvel horizon ontologique qui se fonde sur la catégorie spinoziste de<br />
puissance. Cette approche ignore les critiques au marxisme soviétique<br />
formulées cinquante ans avant par les communistes de gauche, à savoir<br />
que le matérialisme marxien n’est ni une philosophie ni une économie,<br />
mais la théorie révolutionnaire du prolétariat en lutte. Le mouvement<br />
dialectique, pour les radicaux de gauche, n’a jamais exprimé une loi de<br />
l’histoire universelle, et encore moins une science, mais « la logique spécifique<br />
d’un objet spécifique », le capitalisme, un système social opaque<br />
qui se fonde sur le « fétichisme » 64 .<br />
C’est dans son livre sur Spinoza qu’apparaît pour la première fois, chez<br />
Negri, le concept de multitude, autrement dit, le nouveau sujet global<br />
qui, peu à peu, va supplanter l’ouvrier social et le transformer, presque<br />
vingt ans plus tard, en héros indiscutable d’Empire 65 . D’où vient-elle,<br />
cette multitude annoncée à grand fracas 66 ? À l’aube de la modernité,<br />
Hobbes et les philosophes de la souveraineté nommèrent ainsi l’ensemble<br />
humain avant qu’il ne devienne peuple 67 . La multitude, cependant,<br />
était pour eux quelque chose de purement négatif, qui renvoyait à<br />
un ensemble humain indifférencié et sauvage, pas encore organisé au<br />
sein d’un État. Negri renverse le concept, le prenant comme fondement<br />
63. Antonio Negri, Spinoza, op. cit., p. 394. Cette édition inclut « L’anomalia<br />
selvaggia » (1980), « Spinoza sovversivo » (1985) et « Democracia e eternità in<br />
Spinoza » (1994), les principaux textes spinozistes de Negri.<br />
64. Lire par exemple Karl Korsch, Karl Marx, Laterza, 1970, p. 101.<br />
65. Antonio Negri, Spinoza, op. cit., p. 35.<br />
66. J’ai cherché, sans succès, une explication satisfaisante du concept de « multitude<br />
» dans l’œuvre de Negri. Un de ses disciples, Paolo Virno, s’est apparemment<br />
chargé de la tâche in Grammatica della moltitudine. Per un analisi delle<br />
forme di vita contemporanee, Derive/Approdi, 2002.<br />
67. Norberto Bobbio-Michelangelo Bovero, Sociedad y Estado en la filosofía<br />
moderna. El modelo iusnaturalista y el modelo hegeliano-marxiano, FCE, México,<br />
1994, p. 94.
248<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
indispensable d’une démocratie radicale 68 . La multitude contemporaine<br />
serait la forme de l’existence sociale et politique des « plus nombreux »,<br />
de « l’ensemble ouvert » qui s’érige en alternative de la constellation<br />
peuple-volonté générale-État. Alors que le peuple tend à l’identité et à<br />
l’homogénéité, explique Negri, la multitude renverrait à cet au-delà de la<br />
nation qui, face à la crise de l’État, serait le sujet pluriel d’un nouveau<br />
pouvoir constituant ouvert, incluant et post-moderne 69 .<br />
Ici, une question se pose : comment notre auteur aborde le problème<br />
du saut du XVII e siècle à nos jours ? Et, plus concrètement, comme passet-on<br />
de l’ouvrier social à la multitude ? De fait, Negri ne se la pose pas.<br />
Il tente, en revanche, de donner un corps et une épaisseur sociologique<br />
à sa nouvelle création, en se servant, d’une part, de Marx et, de l’autre,<br />
de l’abondante littérature qui accompagne la révolution informatique.<br />
Avec la crise du fordisme, argumente Negri, la classe ouvrière industrielle<br />
perd sa position centrale dans la société. Une part consistante de la force<br />
de travail se voue aujourd’hui au travail immatériel, c’est-à-dire à l’ensemble<br />
d’activités consacrées à la manipulation de signes, au savoir<br />
techno-scientifique, aux messages et aux flux de communication 70 .<br />
Progressivement, d’après Negri, l’élément du savoir humain accumulé<br />
tend à devenir prépondérant.<br />
Il n’y a rien à objecter à ces affirmations qui se fondent sur le fameux<br />
fragment des Grundrisse consacré aux machines, où Marx note que, avec<br />
le développement de la grande industrie, la création des richesses « n’entretient<br />
plus de relation avec le temps de travail immédiat nécessaire à sa<br />
production, mais dépend plutôt de l’état général de la science et du progrès<br />
de la technologie ou de l’application de la science à la production<br />
71 ». Et Marx d’ajouter : « Aussitôt que le travail, dans sa forme<br />
immédiate, cesse d’être la source principale de la richesse, le temps de<br />
travail cesse, et doit cesser, d’être sa mesure ; par conséquent, la valeur<br />
d’échange cesse d’être la mesure de la valeur d’usage. Le surplus de travail<br />
de la masse a cessé d’être la condition du développement de la<br />
richesse sociale, de même que le non-travail de quelques-uns a cessé de<br />
68. Michael Hardt et Antonio Negri, Il lavoro di Dioniso, op. cit., p. 27.<br />
69. Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, op. cit, p. 140.<br />
70. Ibid., p. 354-359.<br />
71. Karl Marx, Grundrisse, tome II, p. 228.
CLAUDIO ALBERTANI 249<br />
l’être pour le développement des pouvoirs généraux de l’insecte humain.<br />
De la sorte, la production fondée sur la valeur d’échange s’effondre, et le<br />
procès de production immédiat perd sa forme de besoin urgent et son<br />
antagonisme. 72 » Il est bon de préciser que ces phrases de Marx, souvent<br />
évoquées et incontestablement visionnaires, sont néanmoins quelque<br />
peu obscures. Elles le sont parce que le sens de l’affirmation « la production<br />
fondée sur la valeur d’échange » n’est pas d’une grande clarté. Cela<br />
signifie-t-il que, dépassé par son propre développement, le capitalisme<br />
touche à sa fin ? Ou que l’antagonisme ouvriers-capital est finalement<br />
résolu ? Personnellement, je ne le pense pas, mais la question reste<br />
ouverte. Quant à l’aspect visionnaire de ce passage, il est indéniable. Ces<br />
phrases nous donnent de stimulantes clés pour lire le temps présent et,<br />
en particulier, le sens de la révolution informatique.<br />
Marx continue : les produits de l’industrie deviennent maintenant des<br />
« organes du cerveau humain créés par la main humaine : une force<br />
objectivée de la connaissance. Le développement du capital fixe révèle<br />
jusqu’à quel point la connaissance, ou knowledge, sociale générale est<br />
devenue une force productive immédiate et, par conséquent, jusqu’à<br />
quel point les contradictions du processus de la vie sociale elle-même<br />
sont entrées sous le contrôle du general intellect et (ont été) remodelées<br />
en rapport avec celui-ci 73 ». De ce passage de Marx, on peut comprendre<br />
que les contradictions de la production manufacturière s’étendent à la<br />
sphère du travail « immatériel ». Negri a donc raison quand il affirme<br />
que, dans une telle situation, le problème du sujet révolutionnaire se<br />
pose différemment. Une fois dépassée la centralité de l’usine, les possibles<br />
sujets antagonistes se multiplient, en même temps que tombe<br />
toute idée de « nécessité ». Mais alors, pourquoi proposer une catégorie<br />
unique, la multitude, qui annule forcément toute différence ?<br />
Il y a davantage. Interprétant de façon unilatérale les affirmations de<br />
Marx, Negri semble soutenir que le capitalisme s’est déjà éteint en tant<br />
que mode de production et qu’il survit uniquement comme pure domination<br />
ou « dispositif de contrôle » 74 . Et comme si cela ne suffisait pas,<br />
72. Ibid., p. 228-229.<br />
73. Ibid., p. 230.<br />
74. Consultable sur , Maria Turchetto, « Dall’operaio<br />
massa all’imprenditorialità comune. La sconcertante parabola dell’operaismo<br />
italiano ».
250<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
il lorgne vers toutes les utopies technologiques, depuis la « fin du travail<br />
» jusqu’aux mythes de la société post-industrielle et les anthropologies<br />
du cyberespace. « Dans l’expression de sa propre énergie créatrice,<br />
le travail immatériel semble ainsi fournir le potentiel pour une sorte de<br />
communisme spontané et élémentaire. » 75<br />
Dans l’interprétation de Negri, le communisme ne jaillit plus de l’antagonisme<br />
ou du refus collectif de la coopération capitaliste mais, au<br />
contraire, de sa plus grande extension grâce à la science et à la technique.<br />
Il en vient à soutenir les plus vieilles causes néo-libérales : le nouveau<br />
fédéralisme, l’Union européenne et même les « entrepreneurs socialisés »<br />
(en italien : imprenditorialità comune) de Vénétie, « tous ceux qui ont mis<br />
leur énergie, leur intellectualité, leur force de travail et leur force d’invention<br />
[s’agirait-il là d’une nouvelle catégorie « marxiste » ? nda] au service<br />
de la communauté » 76 . Ainsi, le cercle se referme : l’opéraïsme de<br />
Negri débouche sur une apologie des forces productives très semblable<br />
à celle que Panzieri avait si justement refusée quelque quarante ans auparavant.<br />
Et, exactement comme chez Tronti, disparaît toute notion d’une<br />
autonomie concrète fondée sur l’action indépendante des sujets sociaux<br />
en lutte, de telle sorte que les deux adversaires d’il y a trente ans se<br />
retrouvent à nouveau ensemble 77 .<br />
Il est, enfin, pour le moins cocasse de voir, à la fin de leur livre, Negri<br />
et Hardt évoquer saint François comme figure paradigmatique du nouveau<br />
militant 78 . Dans les mouvements sociaux actuels, on lui préfère le<br />
mot « activiste », qui est moins effrayant et renvoie davantage à l’action<br />
directe. Les actions festives des jeunes (et moins jeunes) qui, depuis les<br />
journées de Seattle, empêchent de dormir les puissants de la terre ont<br />
peu de rapports avec la « militance » 79 . Ce qui les soutient, au<br />
contraire, c’est une volonté ludique de « renverser la perspective », d’en<br />
76. Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, op. cit, p. 359.<br />
76. Lettre de Negri écrite de la prison de Rebibbia (Rome), datée du 10 septembre<br />
1997, d’après la version diffusée sur Internet.<br />
77. Dans Il lavoro di Dioniso (p. 29-30), Negri avoue accepter les théories de<br />
Mario Tronti sur l’autonomie du politique. Dans Empire, en revanche, il nous<br />
informe de la disparition de « la notion de l’autonomie du politique » (p. 375).<br />
78. Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, op. cit, p. 496.<br />
79. D’après le dictionnaire de la Real Academia, un « militant » est quelqu’un<br />
qui se voue à la milice… Les premières critiques de la figure du militant
CLAUDIO ALBERTANI 251<br />
finir avec la politique traditionnelle et de créer de nouvelles formes<br />
communautaires 80 .<br />
Pour en revenir au thème du concept de multitude et mesurer son efficacité,<br />
il importe de signaler que l’ensemble des changements connus<br />
par le capitalisme au cours de ces dernières décennies a entièrement dissous<br />
tout centre de gravité dans les luttes anti-système. Le marxisme luimême<br />
n’est plus qu’une parmi les multiples théories dont peuvent user<br />
les nouveaux mouvements pour s’armer conceptuellement. Il en est<br />
d’autres : l’anarchisme, les cosmo-visions traditionnelles, la théologie de<br />
la libération, etc. L’histoire, par ailleurs, ne se fait plus uniquement en<br />
Occident. Aujourd’hui, les mouvements sociaux sont pluriels par définition.<br />
Qu’ont en commun les indigènes du Chiapas et les ouvriers de Fiat,<br />
les agriculteurs écologistes français et les émeutiers argentins, les paysans<br />
du Karnakata et les cyberpunks des métropoles post-modernes ? Sans<br />
doute beaucoup, comme nous l’explique, par exemple, le commandant<br />
Mister, de l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) : « Les gouvernements<br />
pensent que, nous les Indiens, nous ne connaissons pas le<br />
monde. Eh bien, qu’ils sachent que nous le connaissons et que nous<br />
sommes au courant des plans de mort qu’on dresse contre l’humanité et<br />
aussi des luttes des peuples pour leur libération. Nous connaissons le<br />
remontent à 1966 et sont dues à l’Internationale situationniste (lire De la misère<br />
en milieu étudiant, traduit dans une vingtaine de langues).<br />
80. Ce n’est pas le fait du hasard si les principaux disciples de Negri, les<br />
Désobéissants (connus précédemment sous le nom de Tute bianche – Combinaisons<br />
blanches – ou Association Ya Basta), sont un facteur de grande confusion<br />
dans le mouvement dit altermondialiste. Ils conjuguent le pire de la<br />
politique de la vieille gauche et le pire de l’activisme médiatique. Radicaux à<br />
l’étranger (ils furent expulsés à grand fracas du Mexique en 1998), ils sont disposés<br />
à tous les compromis en Italie ; pacifistes convaincus, ils diffusent de délirantes<br />
déclarations de guerre à l’adresse du gouvernement italien (mais ne savent<br />
pas être conséquents) ; zapatistes déclarés, ils sont à la recherche de charges<br />
électives… Sur les inconséquences des Tute bianche (aujourd’hui Disubbidienti),<br />
on se reportera à « Paint it Black. Blocchi neri, tute bianche e zapatisti<br />
nel movimento contro la globalizzazione », de Claudio Albertani, paru simultanément<br />
dans Collegamenti-Wobbly, <strong>n°</strong> 1, janvier 2002 et, en version française,<br />
dans le <strong>n°</strong> 12 des Temps maudits (janvier-avril 2002). Une version anglaise a paru<br />
dans New Political Science, Londres, décembre 2002). Pour de plus amples informations<br />
sur l’activité des Disobbidienti, voir .
252<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
monde, et même le Japon. Parce que nous connaissons tous ces hommes<br />
et toutes ces femmes qui sont venus dans nos villages et qui nous ont<br />
parlé de leurs luttes, de leurs mondes et de tout ce qu’ils font. À travers<br />
leurs paroles, nous avons voyagé, vu et connu plus de terres que n’importe<br />
quel intellectuel. 81 »<br />
Il importe de refaire au plus vite ce monde qui ne nous appartient pas.<br />
Chaque sujet, chaque mouvement, chaque communauté en lutte<br />
cherche la rencontre avec l’autre, en exigeant dans le même temps de<br />
conserver une perspective et une identité propres. Et cela me paraît un<br />
grand pas en avant. Ce n’est pas par hasard si, par exemple, dans les<br />
mouvements indigènes méso-américains, on parle de moins en moins<br />
d’interculturalité et de plus en plus de multiculturalité. Alors que le premier<br />
concept postule une synthèse obligatoire, le second conserve les<br />
tensions et les particularités.<br />
Il est incontestable que nous avons besoin de concepts nouveaux pour<br />
mettre ces différences en valeur, et c’est à juste titre que Negri critique<br />
celui de « peuple ». Mais, pourquoi, en ce cas, les écraser en les annulant<br />
au sein d’une abstraction philosophique vieille de trois siècles ?<br />
Comme son antécédent, l’ouvrier social, la multitude est un concept<br />
forcé. À la fin de son parcours, Negri en revient au péché originel de<br />
l’opéraïsme italien : la recherche incessante d’une « centralité », quelle<br />
qu’elle soit, le fétichisme du travail productif, l’incapacité de sortir de<br />
l’horizon de l’usine 82 . Le résultat en est un sujet sans histoire, une forme<br />
sans contenu, dernière adaptation de la vieille torsion par laquelle la<br />
classe ouvrière ne cesse jamais de harceler le capitalisme.<br />
81. « Discours zapatistes, manifestation à San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,<br />
1 er janvier 2003 » à consulter sur .<br />
82. Sur le fétichisme du travail chez Negri, lire George Katsiafikas, The<br />
Subversion of Politics, op. cit., p. 225-2<strong>32</strong>.
CLAUDIO ALBERTANI 253<br />
ÉPILOGUE. LA FIN DE L’ÉTAT-NATION ?<br />
Malgré son aversion déclarée pour la pensée dialectique, la construction<br />
théorique de Negri n’a jamais cessé d’être hégélienne 83 . Tant dans Empire<br />
que dans ses livres précédents, on trouve toujours, sous-jacente chez<br />
Negri, l’idée d’une théologie nécessaire, d’un mouvement circulaire et<br />
d’une fin heureuse, déjà présente dans les débuts. On nous y indique,<br />
par exemple, que les révolutions du XX e siècle ne furent jamais vaincues,<br />
mais qu’elles « ont toutes poussé en avant et transformé les termes des<br />
conflits de classe, posant les conditions d’une nouvelle subjectivité politique<br />
84 ». Autrement dit, qu’elles préparèrent l’événement de la réalité<br />
ultime de notre temps, l’Empire, et de son nécessaire ennemi, la multitude.<br />
De la même façon que l’esprit du monde se manifeste progressivement<br />
dans l’histoire en sautant d’un côté à l’autre du monde, l’épiphanie<br />
impériale s’incarne dans des étapes et des figures remarquables qui, à<br />
chaque moment, lui accordent des caractères distinctifs.<br />
L’épopée commence dans la boutique de Spinoza, et l’un de ses épisodes<br />
centraux est, semble-t-il, la Constitution américaine parce qu’elle<br />
repose sur « l’exode, sur des valeurs affirmatives et non dialectiques, et<br />
sur le pluralisme et la liberté 85 ». On assiste ici au retour du vieil attachement<br />
opéraïste pour les États-Unis, assaisonné à présent de<br />
quelques (malheureuses) affirmations de Hannah Arendt sur la révolution<br />
américaine 86 .<br />
Noam Chomsky, sans doute un des meilleurs analystes des États-Unis,<br />
nous a pourtant enseigné que « la Constitution de ce pays n’est qu’une<br />
création conçue pour maintenir la populace à sa place et éviter que, ne<br />
serait-ce que par erreur, elle puisse avoir la mauvaise idée de prendre son<br />
destin entre ses mains 87 ». Dans le même sens, Boron affirme que,<br />
83. Je reprends cet argument de l’essai de Maria Turchetto, « L’impero colpisce<br />
ancora », .<br />
84. Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, op. cit, p. 474.<br />
85. Ibid, p. 459.<br />
86. Hannah Arendt, On Revolution, (réédition : Vicking Press, 1996), surtout le<br />
chapitre III. Negri avait déjà fait l’apologie de la Constitution américaine dans Il<br />
potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, SugarCo, 1992.<br />
87. Cité in Boron, Imperio. Imperialismo, op. cit., p. 110.
254<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
contrairement à ce que croit Negri, ce document nous offre un clair<br />
exemple du haut degré de conscience anti-populaire et anti-démocratique<br />
qu’avaient ses créateurs. Alors, faut-il voir, chez Negri et Hardt, de<br />
l’ingénuité, de l’opportunisme ou un sens du marketing ? Et est-ce qu’au<br />
bout du compte, l’anarchiste Chomsky ne serait pas en train de donner<br />
une leçon de marxisme au bolchevique Antonio Negri ?<br />
Une autre des fantaisies néo-libérales avalisées par les auteurs d’Empire<br />
tient à l’affirmation que l’État-nation serait en voie d’extinction. Avouons<br />
qu’il est pour le moins amusant que Negri – un admirateur de Lénine et,<br />
en outre, un vieux stratège de la prise du pouvoir étatique – tire aujourd’hui<br />
une telle absurdité de sa manche 88 . D’autant qu’au nombre des<br />
rares propositions pratiques d’Empire on retient celles du salaire social<br />
(resucée du vieux « salaire garanti » de Potere operaio) et celle la citoyenneté<br />
globale. Autrement dit, des revenus et des papiers garantis à tout le<br />
monde, indépendamment de la nationalité, de la classe et de la condition<br />
sociale de tout un chacun. Sans vouloir entrer ici dans la discussion<br />
autour du sens politique et de l’opportunité de telles revendications, on<br />
peut néanmoins signaler leur aspect paradoxal : si, d’ores et déjà, l’État<br />
n’existe plus, à qui s’adressent donc Negri et Hardt ?<br />
Le processus d’évolution de l’État est, en réalité, terriblement contradictoire.<br />
D’un côté, la vague de privatisations a érodé ses fonctions redistributives,<br />
et sa crédibilité, détruisant les sphères publiques en faveur<br />
du secteur privé. De l’autre, en élevant le niveau de conflictualité, il a été<br />
contraint d’augmenter ses fonctions répressives. C’est pourquoi nous<br />
n’avons pas affaire aujourd’hui à ces États dégraissés dont parlent les<br />
néo-libéraux avalisés par Negri, mais plutôt à une sorte de keynésianisme<br />
de guerre qui dévore les ressources publiques, ôtant aux pauvres<br />
pour donner aux riches dans des proportions jamais atteintes aupara-<br />
88. Dans une tentative de ménager Dieu et le diable, Negri formule la question<br />
qui suit : « Que faire du léninisme dans les nouvelles conditions de la force de<br />
travail ? […] Quelle subjectivité faudra-t-il produire pour la prise du pouvoir,<br />
aujourd’hui, par le prolétariat immatériel ? » Et il répond : « Il faut mener<br />
Lénine au-delà de Lénine, […] vers la démocratie absolue de la multitude » (!)<br />
Toni Negri, « Che farne del Che fare ? Ovvero il corpo del General Intellect »,<br />
Posse, mai 2002, p. 123-133.
CLAUDIO ALBERTANI 255<br />
vant 89 , et c’est dans ce but qu’on agite éternellement l’épouvantail de la<br />
guerre contre les « États voyous » (Irak, Corée, Libye, Liban, etc.) ou<br />
contre les ennemis de l’intérieur 90 . De tout cela, on peut conclure que,<br />
tant dans les domaine économique que politique, les fonctions remplies<br />
par l’État demeurent indispensables pour le capitalisme, puisque celui-ci<br />
ne pourrait pas survivre une semaine si celui-là cessait de lui fournir non<br />
seulement les garanties politiques et militaires dont il a besoin, mais<br />
aussi d’énormes ressources économiques. De ce point de vue, le cas des<br />
États-Unis est significatif : les astronomiques subsides pour l’agriculture<br />
ou les mesures de soutien au secteur du transport aérien après le 11 septembre<br />
prouvent aisément que l’appétit pour ce genre de subventions n’a<br />
pas l’air de faiblir.<br />
Sur la question de l’impérialisme, la réflexion de Negri part, comme<br />
toujours, d’inquiétudes légitimes. On ne peut être, évidemment, que<br />
d’accord avec lui sur la nécessité de revoir les vieilles théories, mais pour<br />
ce faire, il faudrait d’abord reconnaître que – bien que la dynamique de<br />
leurs rapports change constamment 91 – tous les États sont potentiellement<br />
impérialistes. Ensuite, il faudrait admettre qu’aucun État ne se trouve<br />
aujourd’hui en condition de concurrencer les États-Unis dans les<br />
domaines militaire, économique, politique ou culturel, ce qui rend<br />
caduque une des principales caractéristiques de l’impérialisme classique,<br />
tel que l’analysait Rosa Luxemburg, à savoir l’existence d’un certain<br />
niveau de concurrence entre États pour la conquête de marchés, de territoires<br />
ou de matières premières 92 . Depuis la chute du bloc soviétique,<br />
aucun État ou région géopolitique n’a pu contrecarrer le pouvoir des<br />
États-Unis. Comment désigner cette nouvelle réalité ? Empire ?<br />
89. Voir à ce sujet les récentes mesures de Bush en faveur des spéculateurs<br />
financiers, qui prévoient une réduction de 300 milliards de dollars d’impôts sur<br />
les dividendes des actionnaires.<br />
90. Guerre contre un seul individu, parfois, comme on l’a vu avec Ben Laden.<br />
Si l’on en croit des déclarations récentes de la Maison-Blanche, ce cycle risque<br />
de durer au moins une trentaine d’années.<br />
91. Une des erreurs de Lénine fut de croire que l’impérialisme était simplement<br />
une « étape » du capitalisme alors que, en réalité, il était inscrit dans sa logique<br />
dès le début.<br />
92. Stefano Capello, « L’imperialismo da Disraeli a Bush », Collegamenti <strong>n°</strong> 2,<br />
2002.
256<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
Impérialisme ? Le nom, en fait, importe peu, dès l’instant qu’il apparaît<br />
très clairement qu’un seul pays, les États-Unis, est en train d’imposer un<br />
système planétaire d’États vassaux organisés en souverainetés limitées,<br />
système qui, ironie de l’histoire, ressemble énormément à celui que, pendant<br />
des décennies, l’Union soviétique imposa à ses satellites 93 . Ce système<br />
exige des États qui le composent qu’ils soient faibles vers l’extérieur,<br />
c’est-à-dire malléables et sensibles aux besoins américains, mais forts à<br />
l’intérieur, autrement dit, répressifs et capables d’imposer ces mêmes<br />
besoins à leurs subordonnés.<br />
Ce nouvel ordre mondial ne cesse, cependant, d’engendrer des frictions<br />
et du malaise, en particulier – mais non exclusivement – entre les<br />
« classes dangereuses » d’un monde de plus en plus en proie à la pauvreté,<br />
à l’insécurité et aux problèmes environnementaux. Les zapatistes<br />
du Chiapas, les piqueteros argentins, les cocaleros de Bolivie, Lula au<br />
Brésil, Chávez au Venezuela, le cours nouveau en Équateur, sont autant<br />
de signes de crise dans l’arrière-cour même de l’Empire. En Europe, le<br />
vent de Gênes 2001 n’a pas cessé de souffler et les manifestations contre<br />
la guerre se sont multipliées. Les ruptures, quand il y en a, surgissent des<br />
mouvements sociaux, comme un « ya basta » généralisé, et non par l’entremise<br />
des partis politiques qui, à quelques rares exceptions, acceptent,<br />
même quand ils sont de gauche, l’ordre établi. Nous sommes donc bien<br />
loin de cet Empire dé-centré et déterritorialisant théorisé par nos<br />
auteurs. Les événements du 11 septembre 2001 et la réaction qu’ils suscitèrent<br />
dans l’administration Bush prouvent, une fois de plus, l’échec de<br />
leur modèle théorique : cette réaction est celle d’un État impérialiste qui<br />
prétend ajuster la planète à ses interêts 94 .<br />
93. Tito Pulsinelli, « Sobre el señor y los vasallos. Estados Unidos en el atardecer<br />
del neoliberalismo », .<br />
94. Negri s’est d’ailleurs senti très peu à l’aise face à ces événements. Il a<br />
d’abord interprété la chute des tours jumelles comme une affaire interne à<br />
l’Empire, quelque chose « qui lui appartient » en propre, avant de rectifier, en<br />
soutenant que nous sommes face à une réaction impérialiste contre l’Empire.<br />
Hardt a soutenu, lui, cette seconde version dans un article récent où il exhortait<br />
« les élites à agir dans leur propre intérêt comme réseau impérial dé-centré,<br />
interrompant de la sorte le processus de conversion des États-Unis en un “pouvoir<br />
impérialiste selon le vieux modèle européen” ». Curieux appel, en vérité,<br />
venant d’un prophète de la « multitude » ! Du retour, p. 185 et p. 209.<br />
Entrevue parue dans Il Manifesto, 14 septembre 2002.
CLAUDIO ALBERTANI 257<br />
« Aujourd’hui, note Eric Hobsbawm, de même que tout au long du XX e<br />
siècle, il y a une absence totale d’autorité mondiale effective qui soit<br />
capable de contrôler ou de résoudre des disputes armées. La mondialisation<br />
a avancé dans presque tous les domaines – économique, technologique,<br />
culturel et même linguistique – excepté en un seul, le domaine<br />
militaire et politique. Les États territoriaux sont encore les seules autorités<br />
effectives. 95 » Proclamer la fin de l’État ne nous est donc d’aucune utilité.<br />
C’est même une idée néfaste puisqu’elle ne contribue en rien à<br />
l’action. Et si cette affirmation peut paraître d’une terrible banalité, il<br />
n’est pas inutile de la rappeler quand nous lisons, dans la revue Rebeldía,<br />
que ceux qui la font se sentent partie prenante d’une « gauche qui n’est<br />
plus disposée à continuer de perdre son temps autour de la dispute d’un<br />
pouvoir national qui n’existe plus 96 ». Car rien n’est plus faux. Une chose<br />
est de dire, comme John Holloway – et, avant lui, les zapatistes, et bien<br />
avant encore les libertaires de toutes les tendances –, que le monde ne<br />
peut être changé en « prenant » le pouvoir d’État, et une autre, très<br />
différente, est de déclarer que le pouvoir national n’existe plus 97 .<br />
Qui envoie les tanks au Chiapas ? Qui arme les paramilitaires ? Qui<br />
est derrière le plan Puebla Panamá ? Le fameux appareil dé-centré et<br />
déterritorialisant ? Pas le moins du monde ! C’est bien un pouvoir national<br />
très identifiable : l’État mexicain. Les États-nations continuent d’exister,<br />
et ils sont à la fois nos ennemis et nos interlocuteurs. Face à eux,<br />
nous ne pouvons pas baisser la garde : nous devons faire pression sur<br />
eux, livrer bataille contre eux, les harceler. Nous devrons, à l’occasion,<br />
négocier avec eux, et nous le ferons en toute autonomie. Les zapatistes<br />
ont démontré que cela était possible et, si les résultats obtenus n’ont pas<br />
été à la hauteur de leurs espérances, ils leur ont au moins permis,<br />
contrairement à d’autres, de conserver leur dignité.<br />
Notre voie, celle des mouvements pour l’humanité et contre le néolibéralisme,<br />
n’est pas exempte d’obstacles. Comme le suggère Michael<br />
95. Eric Hobsbawm, « La guerra y la paz en el siglo XX », La Jornada, México,<br />
24 mars 2002.<br />
96. Souligné par moi. Rebeldía, éditorial du <strong>n°</strong> 1, México, nov. 2002.<br />
97. John Holloway, Change the World without Taking Power, Pluto Press, 2002.<br />
C’est à tort que de nombreux commentateurs ont voulu mettre Holloway et<br />
Negri dans le même sac.
258<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
Albert, animateur de la revue Z Magazine (et du site Znet), elle implique,<br />
outre de la radicalité théorique et pratique, de la ductilité, de la patience<br />
et une certaine dose de pragmatisme 98 . Car il faut le répéter encore : le<br />
capitalisme et l’État-nation, ces deux monstres créés par l’Occident, sont<br />
venus ensemble et ils disparaîtront ensemble. Et si nous ne savons pas<br />
les noyer dans un océan de rires, ils nous tiendront encore compagnie<br />
pendant quelque temps, comme le dinosaure de Tito Monterroso 99 .<br />
CLAUDIO ALBERTANI<br />
Tepoztlán, Morelos, México, novembre 2002-janvier 2003<br />
Traduit de l’espagnol par Miguel Chueca<br />
98. Benedetto Vecchi, « Democrazia in Movimento », Il Manifesto, 18 janvier<br />
2003.<br />
99. L’auteur fait ici allusion à une fameuse nouvelle du romancier Tito<br />
Monterroso, qui présente cette particularité de ne contenir qu’une seule phrase<br />
– « Al día siguiente, cuando despertó, el dinosaurio seguía todavía ahí. » –, proprement<br />
intraduisible du reste, puisque le sujet de la subordonnée n’est pas explicité<br />
et qu’on ne sait pas s’il s’agit de « él », de « ella », voire de « Usted » : « Le<br />
lendemain, quand il s’éveilla [ou : « quand elle s’éveilla » ou : « quand vous<br />
vous êtes éveillé» ou «éveillée »], le dinosaure était encore là. » [ndt]
CHARLES JACQUIER<br />
Marcel Martinet,<br />
contre le courant<br />
259<br />
Civilisation française en Indochine p. 263<br />
Édité à Paris en 1933 par le Comité d’amnistie<br />
et de défense des Indochinois et des peuples colonisés<br />
Vous avez cessé d’être « l’un contre tous ».<br />
Lettre ouverte à Romain Rolland p. 273<br />
Paru dans La Révolution prolétarienne, <strong>n°</strong> 195, 25 janvier 1936,<br />
sous le titre « 1922-1935. Réponse à Romain Rolland »<br />
Le 30 juin de Staline. Qu’avez-vous fait<br />
de la révolution d’octobre ? p. 279<br />
Paru dans La Révolution prolétarienne,<br />
<strong>n°</strong> 230, 10 septembre 1936<br />
DURANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, alors que quasi-totalité des<br />
intellectuels et les organisations ouvrières – qui se prétendaient hier<br />
encore pacifistes et révolutionnaires – avaient, toute honte bue, rallié le<br />
camp de l’Union sacrée, Marcel Martinet (1887-1944) s’engagea corps et<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 259-261
260<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
âme dans le petit noyau de militants internationalistes regroupés autour<br />
des syndicalistes révolutionnaires de La Vie ouvrière. Cela caractérise<br />
parfaitement la morale personnelle et la position politique d’un intellectuel<br />
qui fut aussi un militant ayant faite sienne l’éthique du « refus de<br />
parvenir » des syndicalistes ouvriers définie par Albert Thierry. De cette<br />
période terrible, il tira un recueil de poèmes, Les Temps maudits, qui<br />
demeure son livre le plus connu 1 .<br />
Il prolongea ce combat après la guerre dans le mouvement communiste<br />
naissant, devenant le premier directeur littéraire du quotidien<br />
L’Humanité (1921-1923), s’attachant tout particulièrement à définir les<br />
conditions d’une véritable culture autonome du prolétariat, indispensable<br />
à son émancipation 2 . En 1923, la maladie l’obligea à quitter ses<br />
fonctions à L’Humanité, tandis que, parallèlement, il s’éloignait d’un PCF<br />
en voie de rapide « bolchevisation » – c’est-à-dire de soumission aux<br />
intérêts de l’État-Parti soviétique – et que ses amis, notamment Pierre<br />
Monatte, en étaient exclus.<br />
Les années suivantes allaient être marquées par une succession de<br />
défaites et de reculs d’un mouvement ouvrier autonome devant les succès<br />
de la contre-révolution (fascismes, stalinisme) et les progrès de son<br />
intégration aux mécanismes de régulation sociale des différents États.<br />
Martinet allait être, une fois de plus, à contre-courant, s’opposant aussi<br />
bien au fascisme et au colonialisme qu’à la perversion de l’idéal socialiste<br />
par un stalinisme triomphant sur un sixième du globe, et dont l’ombre<br />
portée obérait de plus en plus les chances de renaissance d’un véritable<br />
mouvement ouvrier autonome, indépendant et radical comme avaient<br />
pu l’être, dans le monde d’avant 1914, les différentes formations qui se<br />
réclamaient du syndicalisme révolutionnaire en Europe et en<br />
Amérique 3 . Les articles que nous reproduisons ici même en sont l’illustration.<br />
Le premier dénonçait vigoureusement la répression coloniale<br />
française en Indochine ; le second réfutait les raisons du ralliement de<br />
1. Les Temps maudits, quatrième édition augmentée des Carnets des années de<br />
guerre (1914-1918), <strong>Agone</strong>, coll. « Marginales », Marseille, 2003.<br />
2. Lire Marcel Martinet, Culture prolétarienne, <strong>Agone</strong>, coll. « Mémoires<br />
sociales », Marseille, 2004.<br />
3. Son article de 1926, « Contre le courant », est reproduit dans le dossier<br />
« Marcel Martinet au service de la classe ouvrière », Gavroche, <strong>n°</strong> 134, marsavril<br />
2004.
CHARLES JACQUIER 261<br />
Romain Rolland à la Real Politic stalinienne, tandis que le troisième analysait<br />
à chaud le premier procès de Moscou d’août 1936.<br />
À ceux qui, rétrospectivement, s’étonneraient de cette lucidité minoritaire<br />
et à l’encontre des vents dominants, Pierre Monatte, parlant de<br />
Martinet, avait répondu par avance : « La meilleure boussole, c’est de<br />
n’avoir pas d’autre intérêt que celui de ses idées, pas d’autre désir que<br />
d’être utile à sa classe, pas d’autre ambition que d’avancer avec ses idées,<br />
de reculer avec elles, de tomber même, s’il faut tomber. »<br />
Qui dira, après cela, que Martinet n’est pas un auteur qui continue<br />
aujourd’hui encore à nous parler d’une voix claire et forte ?<br />
Nos remerciements vont à Monette Martinet<br />
de nous avoir autorisés à reproduire ici ces trois textes.<br />
CHARLES JACQUIER
« Devant le crime où roulait, pour tâcher de se<br />
survivre, la vieille société de proie, la démente, par<br />
un suicide devant le crime sacrilège de l’homme<br />
contre l’homme, du pauvre contre le pauvre,<br />
devant l’acceptation du crime, le vautrement de<br />
tous dans le crime, de tous et de ceux d’abord qui<br />
s’étaient donné mission, qui sur les places<br />
publiques vantaient leur mission d’être des<br />
hommes fidèles à l’homme, j’ai écrit – l’ai-je<br />
écrit ? Il est sorti de moi brûlant et tout armé –,<br />
dans la première hantise du sang versé et des<br />
agonies, un livre de poèmes qui n’est qu’un cri de<br />
douleur et de colère. Je n’en renie aujourd’hui pas un mot ; pas une malédiction, pas<br />
une goutte de sang ; car il est aussi plein d’amour, et justifié par chaque nouveau jour<br />
qui s’ajoute au tas monstrueux des jours de guerre. »<br />
Écrits pendant la guerre de 1914-1918, ces « chants d’espoirs désespérés » s’inscrivent<br />
dans la tradition française des grandes protestations lyriques ; ils dénoncent l’absurdité<br />
du massacre mondial et fustigent ceux qui le justifient. Interdit par la censure, Les Temps<br />
maudits fut publié en Suisse (1917) avant d’être édité en France (1920) et traduit en<br />
plusieurs langues.
MARCEL MARTINET<br />
Civilisation française<br />
en Indochine<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 263-271<br />
263<br />
GEORGES DE LA FOUCHARDIÈRE 1 rappelait récemment qu’il existe<br />
deux sortes de nationalismes : le nôtre, le bon – et celui des<br />
autres, particulièrement détestable quand il se dresse contre<br />
« notre » domination, contre la mission « civilisatrice » de la France.<br />
Vercingétorix, révolté contre la civilisation romaine, est un héros, ainsi<br />
que les manuels scolaires l’enseignent aux petits Français, tandis que les<br />
Annamites, s’ils se livrent à des tentatives analogues contre la civilisation<br />
française, sont des criminels de droit commun, et qu’il faut traiter<br />
comme tels.<br />
Comment le César français traite-t-il, en fait, les Vercingétorix<br />
d’Annam ? Les événements des dernières années, des derniers mois,<br />
nous renseignent avec éclat. Il n’est pas inutile que le plus grand nombre<br />
possible de Français sachent un peu ce qu’il fait là-bas en leur nom, le<br />
César français. Ils pourront dire alors s’ils en sont contents et fiers, et s’ils<br />
sont d’avis que cela dure.<br />
1. Journaliste et écrivain, Georges de La Fourchadière (1874-1946) fonda en<br />
1916 avec Gustave Théry le journal L’Œuvre, dont il tint la rubrique humoristique.<br />
Il collabora aussi au Canard enchaîné de Maurice Maréchal dans l’entredeux-guerres.<br />
Son roman, La Chienne, a été porté à l’écran par Jean Renoir<br />
(19<strong>31</strong>).[ndlr]
264<br />
RAPPEL D’UN RÉCENT PASSÉ<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
Il faudrait pouvoir, derrière les beaux décors schématiques de l’histoire<br />
officielle, jeter un regard d’ensemble sur ce qui existait réellement en<br />
Indochine avant la conquête et sur ce qui s’y est réellement passé depuis<br />
1884, où le traité Patenôtre, dûment signé de l’empereur d’Annam, donna<br />
le pays à la France – à charge d’aller le prendre aux Annamites.<br />
On verrait sans doute que l’Indochine est, d’abord, un pays : un pays<br />
homogène et, avant l’arrivée des Français, uni et organisé ; un pays qui<br />
possédait sa civilisation et qui, ethniquement, historiquement et politiquement,<br />
constituait une partie de la Chine. Cela n’est évidemment pas<br />
sans aider à comprendre les résistances que n’a cessé de rencontrer la<br />
domination étrangère, ainsi que sur les répercussions que ne pouvaient<br />
manquer d’avoir sur la population indochinoise les efforts de libération<br />
qui se poursuivaient en Chine depuis dix ans.<br />
Il est bon également de se souvenir que, par sa situation géographique<br />
et climatérique, l’Indochine ne peut être pour les Européens qu’une colonie<br />
d’exploitation ; que, d’autre part, la population y est composée, pour<br />
les dix-neuf vingtièmes, de paysans, de paysans à la fois très pauvres et<br />
très attachés à leurs champs, et exposés, comme dans tous les pays de<br />
monocultures, aux redoutables risques que les conditions de l’économie<br />
moderne n’ont fait qu’aggraver et qui vont jusqu’à l’extrême détresse, à<br />
la famine, à l’impossibilité de payer tout impôt et aux conséquences qui<br />
s’ensuivent, etc.<br />
On entrevoit ainsi que le mécontentement peut être provoqué et entretenu<br />
tant par la misère, par le désespoir physique, que par les sentiments<br />
de fierté d’une race intelligente qui ne se résigne pas à l’asservissement et<br />
à l’humiliation. De fait, misère élémentaire de créatures réduites au<br />
désespoir, et fière revendication d’hommes dont l’esprit demeure libre<br />
sous les chaînes, tels sont les deux caractères que nous retrouvons<br />
constamment dans le long martyrologe que représente l’histoire de<br />
l’Indochine dans les dernières années, l’histoire de ses soubresauts de<br />
révolte, l’histoire de la répression, judiciaire et autre.<br />
L’épisode le plus retentissant de cette histoire, ce fut, au début de 1930,<br />
Yen-Bay 2 . Même en notre époque sanglante, peut-être est-il encore dans<br />
les mémoires.<br />
2. Lire Ngo Van, Viêt-nam 1920-1945. Révolution et contre-révolution sous la domination<br />
coloniale, L’Insomniaque, Montreuil, 1995, p. 141-150. [ndlr]
MARCEL MARTINET 265<br />
À Yen-Bay, clef militaire de la moyenne région tonkinoise, et dans<br />
d’autres postes du Tonkin et de la partie inférieure du delta, il y eut, en<br />
février 1930, un réel soulèvement, dirigé en partie contre des mandarins<br />
qui s’étaient attiré la haine des paysans. En six jours, tout était terminé,<br />
mais quelques Blancs avaient été tués. Villages incendiés, détruits par<br />
bombes d’avions, populations massacrées sans distinction d’âge ni de<br />
sexe, la répression immédiate fut sauvage. Mais elle paraissait insuffisante<br />
aux coloniaux, fous de peur. La justice entra alors en jeu, la justice, c’està-dire<br />
une « commission criminelle » comparable aux cours martiales des<br />
Versaillais en 1871. En quelques heures, des milliers d’années de prison<br />
et de détention frappaient des accusés qui n’étaient pas défendus ; des<br />
centaines de détenus étaient condamnés au bagne, dans des conditions<br />
qui équivalaient à la mort ; 83 condamnations à mort étaient prononcées,<br />
22 aussitôt suivies d’exécution. On gouverne comme on peut.<br />
Pourtant l’opinion, en France, fut touchée. Par les soins de la revue<br />
Europe, une adresse, rapidement couverte d’un nombre considérable de<br />
signatures, demanda au gouvernement des mesures de clémence et de<br />
justice. Parmi les signataires figurait M. Edouard Daladier, hier président<br />
du Conseil, encore ministre dans le gouvernement actuel.<br />
DEPUIS YEN-BAY, LA JUSTICE FRANÇAISE & LES ANNAMITES<br />
Depuis Yen-Bay ? Eh bien, ça a continué. Mais tenons-nous-en à deux<br />
événements récents, à deux événements judiciaires : au verdict par lequel<br />
la cour criminelle de Saïgon a prononcé, le 7 mai dernier, 8 condamnations<br />
à mort, 19 au bagne perpétuel, et 970 années de prison à 79 autres<br />
Annamites ; et à un autre procès, jugé un mois plus tard, mais où les<br />
accusés n’étaient pas des Annamites ; ce que fut ce dernier, nous le verrons<br />
plus loin.<br />
Dans le procès de Saïgon, il y avait 120 inculpés. Ces 120 inculpés<br />
étaient impliqués dans six affaires absolument différentes, sans aucun<br />
lien de connexité. Il n’est pas besoin de connaître un mot de droit pour<br />
sentir l’arbitraire scandaleux d’une telle liaison, contraire à toute règle<br />
judiciaire. Mais il ne s’agit, n’est-ce-pas, que d’Indochinois, et il faut terrifier<br />
une fois pour toutes – éternelle illusion des pouvoirs – une population<br />
rebelle. Cette liaison monstrueuse permettant l’inculpation<br />
d’association de malfaiteurs, elle devient licite et bonne.
266<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
Contre une telle inculpation, les accusés n’ont pas cessé de s’élever, et<br />
rien n’est venu la justifier, ni à l’instruction, ni durant les débats. Mais<br />
l’acte d’accusation affirme, sans témoignage et sans preuves. Ou plutôt,<br />
si : les témoignages, ce sont des rapports de police, et les preuves, c’est<br />
encore la police qui les fournit, ce sont les aveux des accusés. La police<br />
a eu un rôle si extraordinaire dans l’affaire que le président a cru pouvoir<br />
proposer une sorte de marché à deux défenseurs, leur promettant<br />
d’être indulgent s’ils renonçaient à faire le procès de la police au cours<br />
de leurs plaidoiries.<br />
Les aveux obtenus des accusés ont presque toujours été suivis de<br />
rétractations. Ils sont cependant à retenir. En effet, plusieurs inculpés se<br />
sont présentés à l’audience estropiés pour la vie, l’un le bras fracturé, un<br />
autre la colonne vertébrale brisée. Mais le ministère public ne pense pas<br />
que ce soient des tortures. C’est du « passage à tabac », comme en<br />
France, en somme. D’après les marques que l’on n’avait pu faire disparaître<br />
du corps de tous les inculpés, il semble qu’en Indochine le passage<br />
à tabac s’étende un peu loin.<br />
Il semble aussi qu’on y juge avec autant de célérité qu’on apporte de<br />
lenteur à l’instruction. La plupart des accusés étaient en prison préventive<br />
depuis deux et trois ans. Mais il a suffi de cinq jours pour bâcler le<br />
procès de ces 120 inculpés fourrés dans le même sac. Il est vrai que le<br />
président a assuré qu’il était le seul à connaître vraiment le dossier. En<br />
effet, les assesseurs n’avaient pas eu le temps de l’étudier. Les avocats non<br />
plus, car ils avaient été nommés d’office peu de jours avant l’audience.<br />
Toute cette justice n’est-elle pas une étrange justice ?<br />
Plus étrange encore dans ses décisions que dans ses procédés. Nous<br />
avons vu qu’elle avait la main terriblement lourde et nous voudrions<br />
pouvoir reproduire certains jugements où il est reconnu que les condamnations<br />
ne punissent que des délits d’opinion. Mais elle est en même<br />
temps d’une incohérence singulière.<br />
Voici quelques exemples.<br />
L’inculpé <strong>n°</strong> 22 : affilié au Cong-sang-Dang, était chef de cellule d’un<br />
village. Condamné à quinez ans de détention.<br />
L’inculpé <strong>n°</strong> 26 : mêmes inculpations que le précédent. Mais en plus :<br />
faisait partie de la section d’exécuteurs et, à ce titre, a pris part à des<br />
manifestations et à des vols. Acquitté.<br />
Pour des accusations à peu près identiques, le <strong>n°</strong> 96 est condamné à<br />
mort, le <strong>n°</strong> 97 condamné à cinq ans de détention, le <strong>n°</strong> 98 acquitté.
MARCEL MARTINET 267<br />
Pour des faits semblables : au <strong>n°</strong> 70, quinez ans de détention ; au<br />
<strong>n°</strong> 72, rien ; au <strong>n°</strong> 73, vingt ans de prison ; au <strong>n°</strong> 71, la mort. Il est vrai<br />
qu’on reproche au <strong>n°</strong> 71 d’avoir fait partie d’un tribunal révolutionnaire,<br />
mais l’existence de ce tribunal n’a pu être établie.<br />
Et ainsi de suite. Telle est la justice rendue en Indochine, au nom du<br />
peuple français.<br />
UNE JOURNÉE INDOCHINOISE<br />
Passons au verdict rendu le 12 juin par la cour criminelle d’Hanoï. Il<br />
éclaire et renforce le précédent. Nul doute que le rapprochement des<br />
deux ait constitué une mémorable leçon de choses pour la population<br />
annamite.<br />
C’est un verdict d’acquittement pour les cinq accusés. Cinq<br />
Européens, deux sergents et trois soldats de la Légion étrangère. Ils ont<br />
torturé et assassiné des Annamites. Acquitté tous les cinq.<br />
Voici sommairement, dans quelles conditions ils ont tué et dans<br />
quelles conditions ils ont été acquittés.<br />
Depuis le 8 octobre 1930, une note officielle, dont nous parlerons plus<br />
loin, recommande l’exécution sans jugement des « communistes » pris<br />
sur le fait. Cette note, derrière laquelle s’abrite un nombre respectable de<br />
meurtres d’indigènes, terrorise la population.<br />
Le 29 mai 19<strong>31</strong>, le sergent légionnaire Perrier, traversant un marché<br />
indigène où l’on se dispute, descend de bicyclette et rétablit l’ordre à<br />
coups de cravache. Il se trouve que les indigènes sont mal disposés ce<br />
jour-là. Ils finissent par se jeter sur Perrier, le tuent et s’enfuient.<br />
Le même jour, deux légionnaires, le sergent Layon et un soldat, étaient<br />
sur les routes, en service commandé. En chemin, ils s’arrêtent à un poste<br />
où ils apprennent le meurtre de Perrier. Et ils trouvent là, ligoté à un arbre<br />
par le garde du poste, un Annamite à qui on a mis dans les mains la tête<br />
fraîchement coupée d’un autre indigène. Layon interroge l’Annamite, qui<br />
ne répond pas. Layon le tue d’un coup de revolver et, avec son camarade,<br />
jette le cadavre et la tête coupée dans le fleuve voisin.<br />
Ils repartent ensuite et arrivent au poste but de leur étape. Huit<br />
Annamites sont détenus là, incarcérés depuis trois jours, sans que l’enquête,<br />
dit l’acte d’accusation, « ait pu préciser d’une manière indiscutable<br />
les conditions dans lesquelles ils avaient été arrêtés ». Le seul point<br />
précisé par le procès, c’est qu’ils allaient être relâchés le lendemain.
268<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
Layon, qui a rencontré un collègue, le sergent Von Bargen, pénètre<br />
dans la cellule des prisonniers, en ramène un, et ordonne qu’on lui<br />
coupe les cheveux. Avec une scie.<br />
Comme l’opération est difficile, un légionnaire l’achève avec une paire<br />
de ciseaux. En même temps que les cheveux, il coupe un morceau<br />
d’oreille. Par goût de la symétrie, Von Bargen fait trancher un morceau<br />
de l’autre oreille. Le prisonnier tombe. Pour le remettre, Von Bargen lui<br />
tire plusieurs balles dans la hanche et le rejette dans la cellule. Là, sans<br />
doute par esprit d’égalité, les autres légionnaires frappent les autres prisonniers<br />
«à coups de manche de pioche, de nerf de bœuf ou par d’autres<br />
moyens analogues ». Ensuite, on va dîner.<br />
Pendant le repas, Von Bargen, à qui sa conscience reproche peut-être<br />
d’avoir sacrifié le devoir à la soupe, va encore tirer quelques coups de<br />
revolver dans le tas.<br />
On ne peut pas s’amuser tout le temps. Le camion pour le retour est<br />
prêt et on y entasse les prisonniers, tous plus ou moins blessés. Survient<br />
un indigène qui choisit mal son moment : il a vendu des œufs au poste et<br />
vient chercher son dû. Son dû ! Il le reçoit à coups de baïonnette, à coups<br />
de crosse, et de bouteilles qu’on lui casse sur la tête. Et on le jette parmi<br />
ses compatriotes, sans qu’on puisse savoir, dit l’acte d’accusation, « s’il<br />
était déjà mort à ce moment, mais il pouvait être considéré comme tel ».<br />
En route, maintenant ! Mais on ne va pas loin. À une petite distance<br />
du poste, arrêt. Un Annamite est descendu et tué à coups de revolver, le<br />
cadavre jeté aux buissons. Ainsi d’arrêt en arrêt, jusqu’à ce qu’il n’en reste<br />
plus. Pour le dernier, Layon, son revolver s’étant enrayé, le fait tuer à<br />
coups de mousqueton.<br />
Encore un arrêt pour laver le camion et en faire disparaître le sang. Un<br />
dernier, enfin, pour procéder à un tir à volonté sur la voiture et simuler<br />
une attaque « communiste ».<br />
La journée est terminée.<br />
LA JUSTICE FRANÇAISE & LES TUEURS D’ANNAMITES<br />
Peut-être estimera-t-on que le procès du 12 juin, à Hanoï, a révélé un<br />
état de faits plus hideux encore que les atrocités qu’il a évoquées.<br />
Non seulement les tortionnaires assassins ont été acquittés, mais leurs<br />
exploits ont été couverts par leurs chefs, qui, eux-mêmes, se sont récla-
MARCEL MARTINET 269<br />
més des ordres reçus des autorités civiles. Le verdict n’acquitte pas seulement<br />
quelques brutes obscures, il acquitte les chefs militaires et les<br />
chefs civils, jusques et y compris monsieur le gouverneur général Robin.<br />
Je me bornerai à reproduire, au hasard, quelques extraits du compterendu<br />
sténographique des débats. Ils parlent assez haut.<br />
Déposition du légionnaire Lenormand.<br />
« J’ai reçu l’ordre de couper les cheveux aux prisonniers avec la scie.<br />
Layon a dit : “Vas-y. Moi, j’ai coupé plus d’un cou d’un Annamite avec<br />
une scie !” »<br />
Déposition du sergent Von Bargen.<br />
« Je me suis borné à imiter mes supérieurs, qui s’amusaient à couper des<br />
têtes avec le simple couteau réglementaire. »<br />
Déposition du légionnaire Billot.<br />
Le président lui demande quels ordres on lui a donnés au sujet des prisonniers.<br />
Il répond que les ordres qu’on lui a donnés consistaient à tuer<br />
les prisonniers faute de place dans les prisons.<br />
Déposition du légionnaire Pawlowski.<br />
LE PRÉSIDENT : Avez-vous reçu des instructions d’exécuter des prisonniers ?<br />
LE TÉMOIN : Oui, des instructions de M. Robin, lequel, ensuite, nous a<br />
félicités et nous a dit : « Très bien, continuez ! »<br />
Déposition du lieutenant Lemoanne.<br />
LE PRÉSIDENT : Vous avez fait torturer les prisonniers.<br />
LEMOANNE : C’était pour influencer la population.<br />
Déposition du capitaine Doucin.<br />
« Je sais bien qu’ils se sont livrés à des actes sanglants. Mais ils ont fusillé<br />
quoi ? Des communistes ! 3 Eh bien, ils n’en ont pas fusillé assez, voilà<br />
mon opinion. »<br />
Déposition du commandant Lambert.<br />
LE PRÉSIDENT : En dehors de cette note 4 , y aurait-il eu des ordres verbaux ?<br />
3. Il s’agit des hommes tués par les accusés et dont l’acte d’accusation déclare<br />
lui-même qu’on n’a pu établir pourquoi ils avaient été arrêtés. Pour les Français<br />
d’Indochine, on n’est pas arrêté parce qu’on est communiste, on est « communiste<br />
» parce qu’on est arrêté.<br />
4. La note confidentielle <strong>n°</strong> 280, du Résident supérieur, à laquelle nous avons<br />
déjà fait allusion. Elle prescrivait de passer par les armes tout communiste pris<br />
en flagrant délit ou manifestant. Nous venons de voir qu’on est communiste à<br />
bon compte, en Indochine. Tous les tueurs d’Annamites se réclament de la
270<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
COMMANDANT LAMBERT 5 : Parfaitement ! Donnés par M. Robin, au cours<br />
d’inspections. Ils prescrivaient de faire le moins possible de prisonniers.<br />
Des Résidents ont donné cet ordre à des légionnaires.<br />
Du commandant Lambert, encore : « Je n’ai jamais donné les ordres de<br />
tuer. Ce sont les autorités civiles qui ont donné ces ordres. »<br />
Et encore : « Peut-être certains représentants de l’autorité civile ont-ils<br />
formulé des blâmes contre les auteurs de ces faits. Ce sont eux, pourtant,<br />
qui avaient donné l’ordre de tuer les prisonniers. Les responsabilités<br />
incombent à l’autorité civile, qui paraît se dérober aujourd’hui. »<br />
Je pourrais m’arrêter là. Mais, pour parachever cette histoire exemplaire,<br />
le mot de la fin sera fourni, au sommet de la hiérarchie, par la<br />
parole divine elle-même. Voici la bénédiction que le père Gauthier,<br />
missionnaire, est venu apporter aux assassins, à la barre du tribunal : « Il<br />
fallait que quelqu’un vienne avec un peu de poigne pour les 6 remettre à<br />
la raison. Nos légionnaires, je m’en porte garant devant la cour et ces<br />
messieurs, ont fait bonne œuvre, œuvre patriotique, œuvre française, et<br />
remis la paix dans le pays. »<br />
Ainsi, munie de tous les sacrements, militaires, civils et religieux, telle<br />
est la manière dont les conquérants français traitent leurs « protégés »<br />
d’Indochine.<br />
ET MAINTENANT ?<br />
Après Yen-Bay, au président de la Commission criminelle qui lui demandait<br />
pourquoi elle était révolutionnaire, une paysanne de vingt-deux ans<br />
répondait : « Je suis révolutionnaire parce que je suis Annamite ! »<br />
note 280. Elle est du 8 octobre 1930, c’est-à-dire antérieure de plus de six<br />
mois au meurtre du sergent Perrier. Durant ces six mois, combien d’Annamites<br />
ont été tués, en vertu de la note 280 et des ordres verbaux de monsieur le gouverneur<br />
Robin.<br />
5. Le commandant Lambert a sur la conscience deux cadavres d’Annamites,<br />
arrêtés à Vinh, le 9 mars 19<strong>31</strong>, au cours d’une retraite aux flambeaux, et fusillés<br />
séance tenante, toujours en vertu la note 280. Trois autres indigènes, dont deux<br />
enfants, arrêtés en même temps et destinés au même sort, purent s’échapper. Le<br />
Résident supérieur à Hué, M. Lefal, a approuvé le commandant Lambert.<br />
6. « Les », ce sont toujours les « communistes », bien entendu.
MARCEL MARTINET 271<br />
Peut-être comprendra-t-on à présent toute la signification de cette<br />
réponse. Mais nous ne voulons pas poser ici la question du colonialisme<br />
ni chercher à savoir s’il est irrémédiablement voué à de tels procédés.<br />
Comme il ne s’agit que d’Indochinois, nous ne parlerons même pas d’humanité<br />
et de droits de l’Homme. Mais, nous adressant au gouvernement<br />
français, nous disons simplement :<br />
Est-il sage, dans l’état actuel du monde, est-il sage, de la part d’une<br />
puissance européenne qui domine avec quelques milliers d’hommes un<br />
empire asiatique de plusieurs millions d’habitants, est-il sage de ne<br />
régner et de ne gouverner que par la terreur ?<br />
Est-il sage de continuer à tuer ?<br />
Les dossiers du procès de Saïgon sont actuellement soumis à la Cour<br />
de cassation. Les peines monstrueuses prononcées par le tribunal serontelles<br />
appliquées ?<br />
J’ai sous les yeux la copie de lettres déchirantes où des mères, des<br />
femmes de condamnés supplient le comité d’amnisitie et de défense des<br />
Indochinois d’arracher leurs enfants et leurs maris au bagne et à la mort.<br />
Les malheureuses qui les ont écrites ont dépensé, pour les faire traduire<br />
et les expédier, des sommes qui représentent, si l’on tient compte des<br />
salaires indigènes, plusieurs journées de travail et de privation de nourriture.<br />
Je voudrais reproduire des fragments de leurs requêtes. La place<br />
me manque, mais je peux assurer que ces lettres misérables vous font<br />
honte d’être un Blanc.<br />
Ces lettres ont été communiquées au ministère des Colonies et à la<br />
présidence du Conseil. Les membres du gouvernement savent comment<br />
s’est déroulé le procès de Saïgon et ce qu’a dévoilé le procès d’Hanoï. Ils<br />
appartiennent à des groupements où les persécutions des Juifs par les<br />
hitlériens ont soulevé l’indignation. Entre la clémence et la justice, ou la<br />
continuation de la terreur, le président du Conseil et le ministre des<br />
Colonies ont le choix. Si, pour sauver la face à l’infaillibilité française et<br />
aux assassins blancs, il leur plaît de se ranger entre Dieu le Père et monsieur<br />
le gouverneur Robin, on ne les accusera pas d’ignorance.<br />
MARCEL MARTINET, 1933
272<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
« Comme toutes les époques d’écroulement<br />
social, la nôtre pourrait être également une<br />
époque de reconstruction. Cela dépend des<br />
hommes. Mais il faut que ces hommes soient<br />
des hommes : non des machines, non des<br />
soldats, non des esclaves. Il faut que chaque<br />
individu soit une personne libre et voulant<br />
accomplir le maximum de son destin dans une<br />
société riche qui permettra à tous les hommes<br />
ce maximum d’accomplissement. La révolution<br />
prolétarienne, c’est cela. Pour qu’elle triomphe,<br />
il faut que les hommes appelés à sauver le monde en se sauvant eux-mêmes, il faut<br />
que les hommes de la classe ouvrière s’instruisent et s’éduquent, méditent et<br />
développent leur capacité ouvrière et sociale. Pour acquérir cette culture nécessaire,<br />
ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes : “Ni dieu, ni césar, ni tribun.”»<br />
Écrites entre 1918 et 1923, ces pages publiées en 1935 et dédiées à la mémoire de<br />
Fernand Pelloutier, « serviteur de la classe ouvrière », s’inscrivent dans la tradition<br />
d’auto-émancipation du prolétariat du syndicalisme révolutionnaire français. Réédité<br />
en 1976 par François Maspero, et depuis longtemps épuisé, ce livre est « tout entier<br />
occupé par les problèmes que pose cette nécessité de la culture ouvrière ».
MARCEL MARTINET<br />
Vous avez cessé d’être<br />
« l’un contre tous »<br />
Lettre ouverte à Romain Rolland<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 273-278<br />
273<br />
ROMAIN ROLLAND a publié dans les trois derniers numéros d’Europe<br />
une introduction à son prochain recueil d’articles, Quinze ans de<br />
combat. Il vise à expliquer là comment et pourquoi il est passé de<br />
son attitude de 1919 et des années suivantes – où, tout en saluant la<br />
Révolution russe alors en pleine bataille et de partout menacée, il ne lui<br />
ménageait pas les critiques, au nom de la liberté et des droits de l’esprit<br />
– à sa position présente, entièrement dévouée à la Russie actuelle. La<br />
maladie m’empêche de mettre en ordre les notes que j’avais prises pour<br />
établir la réponse que nous devions adresser, dans La Révolution prolétarienne,<br />
à ce plaidoyer.<br />
Peut-être aussi le sentiment qu’après tout il n’est pas très important de<br />
relever l’autocritique que Rolland bolchevisé – ou plutôt stalinisé – fait<br />
en partie sur notre dos, à la mode orthodoxe. Rolland répond à Rolland<br />
mieux que nous ne le ferions.<br />
Il est tout de même dommage de laisser passer l’occasion d’une explication<br />
qui devenait de plus en plus nécessaire. J’en indiquerai donc les<br />
grandes lignes. Bien entendu, il ne s’agit pas de discuter les appréciations<br />
portées par Rolland sur tel ou tel d’entre nous. Dans une affaire qui intéresse<br />
la classe ouvrière et la révolution, nos personnes ne comptent pas.<br />
La personnalité de Rolland lui-même, si haute soit-elle, ne compte pas.
274<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
Mais dans les différents aspects de notre affaire, ce n’est qu’à Rolland,<br />
je le répète, que je demanderais de répondre à Rolland. À Rolland-1935,<br />
qui découvre les nécessités de l’action révolutionnaire, de répondre à<br />
Rolland-1922, qui les méconnaissait en pleine révolution. À Rolland-<br />
1922, qui défendait les vieux droits de l’Homme – même contre la révolution<br />
aux abois, de répondre à Rolland-1935, qui sacrifie ces mêmes<br />
droits à la raison d’État – d’un État qui ne rappelle plus guère l’avantgarde<br />
de la révolution internationale en bataille. J’aurais demandé au seul<br />
Romain Rolland de se réfuter lui-même, et sur ses positions de 1922 et<br />
sur ses positions de 1935 – et de nous justifier, de justifier la continuité<br />
de notre attitude depuis la première heure de la révolution russe.<br />
Elle est bien terre à terre notre attitude, bien sommaire et simpliste. Et<br />
bien dépourvue de fantaisie. Elle n’a même pas attendu la révolution<br />
d’Octobre pour se montrer constante.<br />
Toute notre politique, toute notre philosophie et toute notre morale<br />
ont consisté, dès avant 1914, à tâcher de reconnaître l’intérêt de la classe<br />
ouvrière et à tâcher de la servir, dans les conditions qu’imposaient les circonstances<br />
historiques. Peut-être se trouve-t-il qu’ainsi nous aurons servi<br />
en même temps les intérêts réels de toute l’humanité, de la civilisation<br />
humaine ; si hérétiques que nous soyons, c’est sans doute là notre<br />
manière d’être marxistes. Mais notre préoccupation essentielle, notre<br />
tâche propre se résument en ce point : fidélité à la classe ouvrière.<br />
En août 1914, nous avons été contre la guerre impérialiste parce qu’en<br />
faisant massacrer les prolétariats elle les opposait idéologiquement les<br />
uns aux autres et abîmait ainsi l’internationalisme prolétarien, base de<br />
l’émancipation de la classe ouvrière.<br />
En novembre 1917, et jusqu’à la mort de Lénine, nous avons été, sans<br />
réserves, pour la Révolution qui soulevait la Russie, parce qu’elle entraînait<br />
avec elle toute la pensée prolétarienne ressuscitée, toute l’espérance<br />
de la classe ouvrière.<br />
Dans les années qui ont suivi la mort de Lénine, nous avons vu les<br />
dirigeants de la politique russe – moins de propos délibéré, sans doute,<br />
que par la faute de la situation internationale, mais peu importent les<br />
responsabilités –, nous les avons vu utiliser les prolétariats des autres<br />
nations comme masses de manœuvre dans l’intérêt momentané et<br />
contestable de l’État russe, avec une désinvolture « réaliste » qui n’avait<br />
d’égales que ses balourdises : la manière dont la lutte a été menée, ou<br />
plutôt sabotée, en Allemagne, dans les mois qui ont précédé l’avènement
MARCEL MARTINET 275<br />
de Hitler, la manière dont la classe ouvrière française a été, dix ans de<br />
suite, démoralisée et abrutie, sont des exemples suffisants. De plus, nous<br />
les entendions, ces écuyers de la haute politique, nommer à chaque<br />
coup, glorieusement, « un pas en avant dans l’édification du<br />
socialisme » ce qui était d’évidence un pas en arrière. (Quand il était<br />
acculé à accepter la NEP, Lénine, qui n’était pas un malin, ne prétendait<br />
pas faire un pas en avant.)<br />
La haute politique n’est pas notre fort. D’autre part nous sommes de<br />
ces imbéciles qui ne savent pas changer. Nous avons continué à chercher<br />
l’intérêt de la classe ouvrière et à tâcher de la servir. Et d’abord, platement,<br />
toujours terre à terre, de la classe ouvrière de chez nous : parce<br />
que nous persistons à penser, avec Liebknecht, avec Lénine, que le premier<br />
devoir d’un révolutionnaire est de balayer la neige qui est devant sa<br />
porte. Alors quand nous avons vu les dirigeants de la politique russe traîner<br />
notre classe ouvrière de sottise en cochonnerie, nous avons dit qu’ils<br />
commettaient des sottises et des cochonneries. Le secret de notre hérésie<br />
et de nos crimes n’est pas ailleurs.<br />
Rolland se plaît à imaginer qu’ainsi nous avons, lui et nous, échangé<br />
nos positions et qu’il est devenu révolutionnaire alors que nous cessions<br />
de l’être. C’est une agréable illusion, mais qui ne répond à rien. Nous ne<br />
dansons pas des figures de ballet. En réalité, nous avons tenu en 1922 la<br />
position qu’il aurait dû tenir et, plus encore en 1935, nous tenons la<br />
position qu’il devrait occuper.<br />
Il a besoin de vivre dans des climats héroïques – et il ne reculera certes<br />
pas devant les sacrifices que ce besoin lui imposera. Mais quand l’héroïsme<br />
n’existe pas, il en recherche de spécieuses apparences et il les<br />
appelle réalité. La classe ouvrière, qui est tout pour nous, dans sa faiblesse<br />
et sa misère comme dans sa grandeur, n’existe pour lui que lorsqu’elle<br />
peut se prêter à cette transfiguration héroïque.<br />
Nous nous sommes rencontrés avec Romain Rolland dans les premières<br />
semaines de la guerre. Il a été notre porte-drapeau et notre portevoix,<br />
et ce n’est pas moi qui oublierai rien de la gratitude, de la vénération<br />
affectueuse que nous lui gardons depuis ce temps. Aujourd’hui, il a<br />
découvert que la révolution russe, modèle 1934-1935, était quelque<br />
chose de sublime parce que le fétichisme officiel avait baptisé pic Staline<br />
un sommet du Pamir et parce que l’URSS avait adhéré à la Société des<br />
Nations – à la SDN dont Litvinov dénonçait naguère l’hypocrisie avec des<br />
traits sanglants et où il poursuit à présent une politique de combinaisons
276<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
tortueuses qui n’a rien à envier à la diplomatie d’avant-guerre et qui mène<br />
droit à une nouvelle et plus monstrueuse guerre mondiale.<br />
Assurément, Rolland, vous avez cessé d’être « l’un contre tous ». Vous<br />
avez avec vous Gide, Victor Margueritte et plusieurs centaines de sous-<br />
Barbusse qui volent au secours de ce qu’ils prennent pour le succès. Avec<br />
vous, en 1914, nous étions une poignée. En 1917-1922, nous n’étions<br />
encore qu’une poignée, sans vous. En 1935, sans vous, nous ne sommes<br />
qu’une poignée.<br />
Ne pensez pas que nous soyons fiers et satisfaits d’être si peu nombreux.<br />
Mais nous savons que notre douzaine d’enfants perdus de 1914 a<br />
tout de même fait des petits : elle n’a pas peu contribué à réveiller les sentiments<br />
révolutionnaires et humains, à ressusciter le socialisme en<br />
France. La poignée de 1917 n’a pas non plus travaillé pour rien : sans<br />
elle, le communisme de la grande époque, celui de 1921-1924, n’aurait<br />
pas eu besoin de vos leçons, car il ne serait jamais né. Je suis pareillement<br />
tranquille sur la poignée que nous sommes en 1935. Elle accomplira sa<br />
tâche pour la révolution sociale et pour la civilisation humaine.<br />
Il est un point particulièrement significatif, un point de fait et non plus<br />
d’appréciations, sur lequel j’aurais tenu à m’expliquer sans ambages.<br />
Dans une note de son introduction, Rolland cite un fragment de son<br />
journal intime où il a consigné un entretien qu’il eut avec Monatte et<br />
moi, le 18 mars 1922. « Monatte et Martinet, y dit-il, parlent avec un<br />
amer mépris de ce peuple ouvrier de France qui n’a rien fait, qui n’a rien<br />
voulu faire pour la Révolution », etc. Nous avons lu ces propos, et<br />
d’autres semblables, avec stupeur.<br />
Du mépris pour le peuple, nous ?<br />
Dans sa lettre de démission au Comité confédéral, en décembre 1914,<br />
Monatte écrivait : « C’est au centre que la force, c’est-à-dire la foi, a manqué.<br />
» Dans un article de La Vie ouvrière du 23 juillet 1919, intitulé « La<br />
faute des masses ? », il dénonçait pareillement le pharisaïsme et la malhonnêteté<br />
des « chefs » rejetant sur les « masses » leurs propres erreurs<br />
et leurs propres lâchetés. Et toute sa pensée, toute son action, toute sa<br />
vie ont été de respect de la classe ouvrière, de confiance en elle. De<br />
l’amertume, oui, nous en avons souvent ressenti. Mais du mépris ! De<br />
quel droit ?<br />
Cependant il va de soi que Rolland a cru reproduire avec la plus scrupuleuse<br />
exactitude les sentiments que nous exprimions devant lui…<br />
Mais alors ?
MARCEL MARTINET 277<br />
Eh bien, devant une transcription qui est plus qu’une traduction<br />
inexacte, plus qu’une interprétation tendancieuse, qui est une déformation<br />
et une trahison contre quoi tout notre être proteste, je suis obligé<br />
d’écrire que la seule hypothèse plausible est que Rolland nous a écoutés<br />
sans nous entendre, qu’il nous a écouté parler du peuple en homme qui<br />
n’est pas du peuple et qu’il ne nous a pas compris. Il a compris en intellectuel,<br />
en grand et cordial intellectuel – mais nous croyions parler à un<br />
camarade, à un camarade seulement plus grand que nous et que sa grandeur<br />
même devait préserver de tout contresens.<br />
Le mépris du peuple, le mépris de la classe ouvrière, le mépris du<br />
« matériel humain », le mépris des hommes, c’est justement de ce que<br />
nous ne l’acceptons sous aucune forme et sous aucun masque qu’est<br />
constituée l’unité de notre vie. C’est en protestation contre un tel mépris,<br />
complaisamment pratiqué par toutes les catégories de bureaucrates<br />
« ingénieurs des âmes » (suivant la formule que Rolland admire et qui<br />
nous paraît grotesquement pompeuse et hypocrite), que nous refusons<br />
de voir dans la Russie contemporaine, suivant une autre formule de catéchisme,<br />
« la patrie du socialisme ».<br />
Le régime qui exile Trotski, déporte Riazanov, affame Victor Serge, qui<br />
châtie un meurtre politique, commis dans des circonstances inexpliquées,<br />
par des dizaines d’exécutions sommaires et rend ainsi dérisoires<br />
nos protestations contre les violences fascistes, qui punit de mort les cheminots<br />
quand un accident se produit dans leur service, qui augmente<br />
l’écart entre les salaires, qui soumet les travailleurs au régime de la plus<br />
rigoureuse résidence forcée, et aussi de la plus constante surveillance<br />
policière – un tel régime a pu être imposé par les circonstances, aucune<br />
propagande et aucun bluff ne nous le feront prendre pour du socialisme.<br />
Le socialisme, a dit Lénine, c’est l’électrification s’ajoutant au pouvoir des<br />
soviets. L’électrification et tous les efforts pour activer les progrès matériels<br />
dans un pays de civilisation arriérée, je les vois et personnellement<br />
je me garde d’en sous-estimer l’importance et les bienfaits – mais quand<br />
nous ne voyons plus trace du pouvoir des soviets ailleurs que sur le<br />
papier et dans les discours, quand nous voyons rétrocéder et dépérir le<br />
progrès humain que ces mots représentaient, nous tenons pour une<br />
imposture de parler alors de socialisme : fidèles ainsi à l’enseignement de<br />
Lénine et d’abord à l’enseignement de Rolland, si nous avions besoin de<br />
justifications extérieures.
278<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
Voilà, brièvement indiqués, quelques-uns des points sur lesquels j’aurais<br />
voulu répondre à Romain Rolland, et il en est beaucoup d’autres.<br />
Mais sans doute ce schéma suffira-t-il à préciser notre position et ses raisons.<br />
Puissent seulement les politiciens de toute observance, communistes<br />
et socialistes, cesser à temps d’envisager la réalité sociale et les<br />
intérêts de la classe ouvrière à travers leurs combinaisons de partis et de<br />
sectes – ne pas attendre, comme en Allemagne, qu’il soit trop tard, pour<br />
envoyer promener leurs formulaires et leurs bibles et pour combattre<br />
dans leur être réel, avec des forces réelles, les dangers grandissants qui<br />
menacent le prolétariat et toute l’humanité !<br />
MARCEL MARTINET, 18 mars 1935
MARCEL MARTINET<br />
279<br />
Le 30 juin de Staline<br />
Qu’avez-vous fait de la révolution d’Octobre ?<br />
ALORS QUE TOUTES LES PENSÉES se tournaient vers la lutte héroïque<br />
du prolétariat espagnol, le monde a appris avec stupeur la<br />
brusque mise en scène, l’incroyable déroulement et la conclusion<br />
de ce qu’on a nommé le « procès » de Moscou. L’affaire a été bâclée en<br />
quelques jours. En fait, elle commence à peine et ses suites ne seront pas<br />
liquidées de sitôt.<br />
Devant l’incendie du Reichstag et le procès de Leipzig 1 , devant le massacre<br />
des premiers compagnons de Hitler dans la nuit du 30 juin 1934 2 ,<br />
tous les révolutionnaires du monde ont été saisis de dégoût. Mais<br />
1. Lire Paul Barton, « Marinus Van der Lubbe ou le mythe dans l’histoire »,<br />
<strong>Agone</strong>, <strong>n°</strong> 25, 2001, p. 171-195. [ndlr]<br />
2. Privilégiant depuis 1930 la voie électorale et l’entente avec les grands industriels<br />
et l’armée régulière, la Reichswehr, Hitler, une fois devenu chancelier,<br />
décida purement et simplement d’éliminer la frange extrémiste et socialisante<br />
du mouvement nazi afin de remplacer Hindenburg à la présidence du Reich.<br />
Sous le prétexte d’un imaginaire coup d’État, ses premiers partisans, les SA<br />
(Sturm Abteilung, sections d’assaut) d’Ernst Röhm et de Gregor Strasser, sont<br />
massacrés durant la « Nuit des longs couteaux ». Revenant sur cette comparaison<br />
entre massacres d’opposants, vrais ou supposés, en Allemagne et en URSS,<br />
Boris Souvarine écrira : « Le jour où Hitler a massacré von Schleicher et von<br />
AGONE, 2004, <strong>31</strong>/<strong>32</strong> : 279-285
280<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
l’abjection fasciste ne les surprenait pas, surtout elle ne les atteignait pas :<br />
elle les justifiait.<br />
Devant l’affaire de Moscou, la réaction révolutionnaire est aussi de<br />
stupeur et de dégoût, mais elle s’accompagne de honte. Car cette sanglante<br />
bouffonnerie politicienne a été machinée au pays de la révolution<br />
d’Octobre, par des exécutants qui se donnent pour les pionniers du<br />
socialisme dans le monde. Tous les hommes sentent confusément qu’un<br />
pas de plus vient d’être fait dans l’avilissement où l’humanité risque de<br />
s’enfoncer depuis 1914.<br />
Que savons-nous de l’affaire ? Ce qu’il a plu à la presse russe – c’est-àdire<br />
au gouvernement russe – d’en faire connaître. Et la présentation des<br />
inculpés s’est d’abord opérée comme une entrée de clowns, à la fois<br />
minutieusement réglée et apparemment improvisée. L’art des belles présentations<br />
est un art russe et c’est aussi un art policier. Les plus marquants<br />
d’entre eux, Zinoviev, Kamenev, avaient déjà été « jugés » et<br />
condamnés, au procès déjà scandaleux qui avait suivi le meurtre de Kirov,<br />
en décembre 1934. Toute possibilité d’une action politique quelconque<br />
leur était retirée depuis lors. C’est pourtant des « crimes » pour lesquels<br />
ils avaient été déjà condamnés qu’ils répondaient à nouveau. Et les<br />
condamnations à mort, que les accusés eux-mêmes ont réclamées avec<br />
une unanimité étrange, sont intervenues automatiquement, et les exécutions<br />
leur ont succédé sans délai, dans un étrange mystère.<br />
Voilà tout ce qu’on sait.<br />
Au lendemain du procès Kirov, Romain Rolland, comparant avec les<br />
guillotinades de 1793, admirait la grandeur d’âme des dirigeants qui se<br />
contentaient – plus de quinze années après la prise du pouvoir – d’exécuter<br />
en vrac quelques douzaines de comparses, d’en expédier quelques<br />
milliers en Sibérie, et d’isoler pour un temps les principaux « coupables<br />
» – les coupables moraux !<br />
Bredow, ses contradicteurs de droite, en même temps que Röhm et Heines, ses<br />
contradicteurs de gauche, il a fait une très forte impression sur Staline.<br />
L’exemple a été suivi et systématisé en URSS, à l’échelle du pays et selon un<br />
modus operandi spécifique. » (« Une partie serrée se joue entre Hitler et<br />
Staline », Le Figaro, 7 mai 1939, repris in Boris Souvarine, À contre-courant.<br />
Écrits 1925-1939, Denoël, 1985.) [ndlr]
MARCEL MARTINET 281<br />
Aujourd’hui ce sont ces mêmes « coupables » qui sont exécutés, et pour<br />
les mêmes « crimes ». Et ces hommes furent les compagnons et les amis<br />
de Lénine, les chefs de la révolution militante, les organisateurs de<br />
l’Internationale communiste. Sauf le vieux qui est mort, sauf l’autre vieux,<br />
imprudemment jeté au tombeau peu sûr de la proscription, et sauf un<br />
troisième, l’Unique, qui est triomphant – toute la vieille garde est là :<br />
fusillée par le régime dont elle a forgé la victoire… Ainsi les fondateurs de<br />
la Révolution étaient capables des pires crimes, associés aux pires ennemis<br />
de la Révolution, dans le seul but de détruire les conquêtes de la<br />
Révolution ? Quelle singulière monstruosité collective ! Ou alors… ?<br />
Mais il y a les preuves ! Le gouvernement russe et ses employés nous<br />
répètent, avec une insistance dans l’imprécation qui dissimule mal<br />
l’inquiétude et l’angoisse, qu’elles sont accablantes. Cependant, malgré<br />
toutes les ressources d’une police experte, pas un document, pas un<br />
fait… Alors ? Quelles preuves ?<br />
Une seule, mais il est vrai qu’elle est de taille, probablement unique<br />
dans les annales du crime : les « aveux », stéréotypés et frénétiques, de<br />
ces accusés exemplaires, de ces monstres qui ajoutent à la monstruosité<br />
de leurs crimes la monstruosité plus effarante de tels aveux.<br />
C’est trop beau. Nous ne défendons pas ces condamnés modèles qui,<br />
sans leur furieuse ardeur à se déshonorer eux-mêmes, auraient fait s’écrouler<br />
l’accusation. Nous ne les défendons pas. Dans la lourde atmosphère où<br />
ils ont accepté de jouer leur rôle, ils se sont ensevelis eux-mêmes dans le<br />
mépris de l’histoire… Danton était sans doute un aventurier et<br />
Robespierre un pur révolutionnaire. Mais, quand Robespierre envoyait<br />
Danton à l’échafaud, Danton ne courait pas à la mort en criant : « Le grand<br />
Robespierre a raison ! » – il écumait de rage et d’appels à la vengeance. Ici<br />
nous comprenons. Mais nous ne comprenons pas l’histoire comme on la<br />
fabrique aujourd’hui à Moscou. Les collaborateurs de L’Humanité qui crachent<br />
sur les cadavres ont beau se battre les flancs. Ils n’expliquent rien<br />
parce qu’ils ne peuvent rien expliquer.<br />
Cependant, une ligne générale se dégage clairement. Ceux qu’on vient<br />
de fusiller ont longtemps pratiqué la politique manœuvrière à laquelle<br />
ils succombent en semblant l’approuver encore. D’abdication en abdication,<br />
ils sont tombés jusqu’à cette lâcheté ou à cette lassitude suprêmes.<br />
Après quelles tractations, quelles mystérieuses promesses ? et comment<br />
sont-ils morts ? Là encore tout est sombre… Mais ces hommes furent de<br />
grands révolutionnaires et continuaient à incarner le souvenir d’Octobre
282<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
– et c’est cela qui est clair. Et la clarté augmente lorsque sur le charnier<br />
on voit rester le seul Staline, l’ancien terroriste, authentique celui-là, le<br />
Géorgien secret, le Maître de l’État russe qui, six mois après le meurtre<br />
de Kirov, « comprenait et approuvait » les mesures de défense capitaliste<br />
du renégat Pierre Laval, les mesures qui se trouvaient en même temps<br />
protéger l’État russe. L’opération que constitua le procès de Moscou,<br />
nous n’en distinguons pas nettement les raisons immédiates et le détail,<br />
mais sa signification, nous pouvons la discerner clairement : c’est une<br />
étape décisive vers la fascisation de l’État né de l’héroïsme des combattants<br />
d’Octobre. Et, nous tournant vers les auteurs et les complices, nous leur<br />
posons la seule question valable pour les révolutionnaires prolétariens :<br />
« Qu’avez-vous fait de la révolution d’Octobre ? »<br />
L’ensemble s’éclaire d’une lumière plus accablante encore, quand on<br />
considère que ce n’est pas terminé, que les arrestations et les suicides<br />
continuent au cœur même de l’appareil stalinien, comme si on voulait<br />
éliminer physiquement toute la vieille génération – et que tout est centré<br />
autour de la personne, autour du fantôme de Trotski.<br />
Rayé de l’histoire officielle par une impudente falsification de la réalité,<br />
exilé, pourchassé, isolé, malade, le diable demeure terriblement vivant<br />
malgré tous les efforts, toutes les calomnies, tous les complots et tous les<br />
pièges. Et tant qu’il est vivant, la tradition d’Octobre demeure malgré<br />
tout terriblement vivante. En dehors même de la lutte pour laquelle il est<br />
toujours prêt, le vieil insurgé, qu’on n’a pas osé détruire quand on le<br />
tenait, demeure un symbole insupportable et, pour beaucoup, en Russie<br />
et dans tout l’univers, le visage même de leur remords.<br />
Il importe donc qu’il disparaisse au plus tôt. Si l’on ne parvient pas à<br />
le supprimer physiquement, il faut au moins l’annihiler moralement.<br />
Ceux qui méprisent bien les hommes croient que le mensonge le plus<br />
grossier, le plus grotesque, ils pourront le faire passer pour la vérité à<br />
condition seulement de le soutenir avec assez d’effronterie. Et pourquoi<br />
pas la bouffonnerie la plus énorme ? Pourquoi pas Trotski, le créateur de<br />
l’Armée rouge, l’organisateur de la victoire, pourquoi pas Trotski agent<br />
de la Gestapo hitlérienne ? Évidemment il n’est pas question, pour les<br />
fabricants d’une telle imbécile infamie, d’y apporter le moindre crédit. Il<br />
s’agit seulement de la hurler avec des voix si résolues que les prolétaires<br />
n’aient pas l’audace de la mettre en doute : et alors elle sera vraie. C’est<br />
ainsi qu’on a lu, jour après jour, les déclarations, articles, confessions,
MARCEL MARTINET 283<br />
des inculpés d’abord et ensuite de tous ceux qui étaient suspects ou qui<br />
risquaient d’être suspectés, répétant inlassablement la leçon injurieuse et<br />
monotone : « C’est Lui, c’est Lui, c’est Lui ! » – les anciens amis se distinguant<br />
seulement par de plus bas outrages et par un ton plus cafard de<br />
repentis professionnels d’Armée du Salut.<br />
Nous ne sommes pas politiquement des trotskistes. Mais cette obsession<br />
du trotskisme, qui a dominé et qui continue à dominer l’affaire,<br />
signe l’opération et en révèle le sens exact : il faut détruire ce qui<br />
demeure d’Octobre, sauf l’idolâtrie pétrifiée.<br />
Celle-ci, on la conserve religieusement, car elle est déjà la mort et la<br />
pourriture de l’esprit révolutionnaire. Mais si Lénine ressuscitait, qui<br />
s’était permis dans son « Testament » de conseiller qu’on remplace Staline<br />
au secrétariat du parti par « quelqu’un de plus patient, de plus loyal, de<br />
plus poli et de plus soucieux des camarades, de moins capricieux<br />
aussi…», Lénine ne mériterait évidemment que les honneurs d’une charrette<br />
particulière. Cependant, puisqu’il est heureusement disparu et qu’on<br />
détient les clefs de son mausolée, c’est contre l’autre mainteneur de la tradition<br />
d’Octobre qu’il faut masser les coups, c’est Trotski qu’il faut abattre.<br />
Et ce qu’il faut abattre dans la figure symbolique de Trotski, c’est, nous le<br />
répétons, ce qui s’oppose encore à la fascisation de l’État russe.<br />
« La Révolution russe se défend », imprime L’Humanité en caractères<br />
d’affiches. Non, et quand la Révolution reprendra là-bas force et vie,<br />
elle se défendra par d’autres moyens. Mais l’État qui est né d’elle se<br />
défend, en effet. Nous qui ne sommes pas attachés au nationalisme du<br />
pays où nous sommes nés, nous qui « n’aimons pas notre patrie » –<br />
parce que nous savons qu’aimer sa patrie, à l’époque actuelle, c’est<br />
aimer et aider les maîtres qui exploitent leur peuple, qui l’excitent<br />
contre les autres peuples, qui l’empêchent de s’émanciper –, nous qui<br />
ne sommes attachés qu’à l’émancipation de la classe ouvrière internationale,<br />
nous dénonçons l’odieuse comédie du procès de Moscou<br />
comme une trahison de la Révolution.<br />
Nous dénonçons encore une autre manœuvre, directement dirigée<br />
contre le prolétariat de ce pays.<br />
Tous les complices de l’opération à laquelle vient de procéder la<br />
bureaucratie stalinienne répètent infatigablement les mêmes injures, les<br />
mêmes menaces contre quiconque hésite à glorifier les fusillades de<br />
Moscou : un intensif bourrage de crânes doit amener les travailleurs
284<br />
HISTOIRE RADICALE<br />
français à renoncer à penser par eux-mêmes, les persuader que le catéchisme<br />
est sacré et que s’ils s’en écartent d’une seule ligne, d’un seul<br />
mot, ils deviendront aussitôt des renégats et des traîtres. Le procédé<br />
publicitaire pour la propagation du conformisme n’est pas inventé<br />
d’hier. Il est malheureusement de plus en plus employé, avec une efficacité<br />
de plus en plus redoutable.<br />
D’honnêtes camarades ainsi suggestionnés craignent sans doute, s’ils<br />
bronchent, de tomber automatiquement dans le camp de la contrerévolution.<br />
Nous leur disons seulement : « Jusqu’où descendrezvous<br />
? C’est dès aujourd’hui que vous travaillez, en fait, contre la<br />
révolution sociale. Vous voilà au point où les socialistes félons, les anarchistes<br />
de défense nationale, les syndicalistes d’union sacrée étaient tombés<br />
au lendemain de la déclaration de guerre en août 1914. Ceux-là, du<br />
moins, avaient attendu pour se renier que la guerre ait emporté toutes les<br />
digues. Où serez-vous demain ? »<br />
Mais aux chefs à tout faire qui chloroforment le prolétariat, nous<br />
devons parler autrement : « Votre tactique d’intimidation, d’enthousiasme<br />
de troupeau et de mensonge par persuasion, nous la connaissons<br />
: elle est la méthode même et l’ABC du fascisme. Et elle est la<br />
négation directe de la révolution ouvrière. Pour instituer une société<br />
d’hommes libres, la révolution ne s’adresse qu’à la conscience et à la<br />
volonté réfléchie de l’homme, elle ne commence pas par transformer ses<br />
militants en esclaves. Votre “grande politique” où d’imbéciles flatteries<br />
s’assaisonnent de sourdes menaces, cette épaisse fourberie, héritée des<br />
politicailleurs bourgeois, ne nous effraie ni ne nous trouble. Vous dites<br />
que nous nous rencontrons dans nos critiques avec un Doriot ? La<br />
canaillerie de cet aventurier, formé et corrompu à votre école, ne tient<br />
pas aux arguments qu’il utilise, mais à l’usage qu’il en fait : ainsi il reste<br />
de votre famille, gardez-le. C’est nous qui vous méprisons. C’est nous qui<br />
dénonçons en vous les fossoyeurs de la révolution sociale. »<br />
Mais les fossoyeurs disparaîtront et la révolution sociale s’accomplira.<br />
Nous savons que nous sommes peu nombreux. Quelques-uns d’entre<br />
nous ont lutté dès août 1914 contre la guerre impérialiste : ils étaient<br />
alors moins nombreux et plus faibles que nous ne le sommes aujourd’hui.<br />
Pourtant, ils n’ont pas désespéré et ils ont vu Zimmerwald, la<br />
révolution d’Octobre et le réveil des hommes. Fidèles à la révolution<br />
d’Octobre, nous pouvons nous sentir aujourd’hui déshonorés par des<br />
parodies funèbres qui osent se réclamer d’elle : nous ne désespérons
MARCEL MARTINET 285<br />
aucunement. La justice prolétarienne, la liberté humaine ne succomberont<br />
pas à des commérages de gendelettres vaniteux, à des manœuvres<br />
de politiciens sans scrupules. Mais pour que l’émancipation ouvrière<br />
s’accomplisse sur la déroute du vieux monde, c’est nous qui opposons<br />
aujourd’hui à ces manœuvriers et à ces menteurs notre accusation sans<br />
merci : « Qu’avez-vous fait de la révolution d’Octobre ? »<br />
MARCEL MARTINET, septembre 1936
Abonnement à AGONE<br />
pour deux années & quatre numéros :<br />
Particuliers 55 €<br />
Institutions 65 €<br />
(Majoration pour l’étranger 10 €)<br />
par virement postal sur CCP 8 806 45 M Marseille,<br />
carte bancaire ou chèque à l’ordre des éditions <strong>Agone</strong><br />
Les règlements sont à adresser<br />
BP 70072 • F-1<strong>31</strong>92 Marseille cedex 20<br />
PROCHAINES PARUTIONS<br />
Printemps 2005, numéro 33<br />
Le syndicalisme & ses armes<br />
Automne 2005, numéro 34<br />
Domestiquer les masses<br />
Printemps 2006, numéro 35<br />
Villes & résistances sociales<br />
http://www.agone.org/revueagone