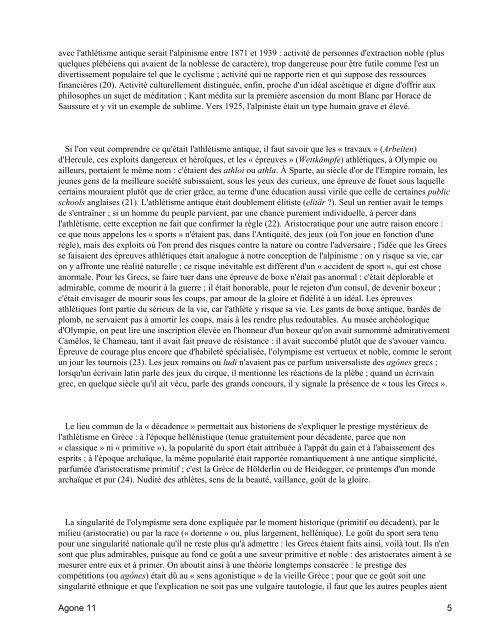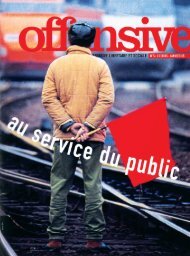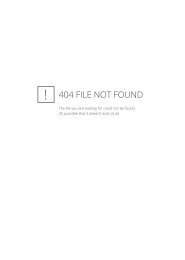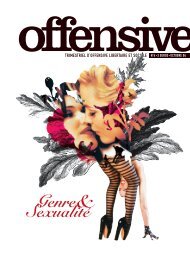Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
avec l'athlétisme antique serait l'alpinisme entre 1871 et 1939 : activité de personnes d'extraction noble (plus<br />
quelques plébéiens qui avaient de la noblesse de caractère), trop dangereuse pour être futile comme l'est un<br />
divertissement populaire tel que le cyclisme ; activité qui ne rapporte rien et qui suppose des ressources<br />
financières (20). Activité culturellement distinguée, enfin, proche d'un idéal ascétique et digne d'offrir aux<br />
philosophes un sujet de méditation ; Kant médita sur la première ascension du mont Blanc par Horace de<br />
Saussure et y vit un exemple de sublime. Vers 1925, l'alpiniste était un type humain grave et élevé.<br />
Si l'on veut comprendre ce qu'était l'athlétisme antique, il faut savoir que les « travaux » (Arbeiten)<br />
d'Hercule, ces exploits dangereux et héroïques, et les « épreuves » (Wettkämpfe) athlétiques, à Olympie ou<br />
ailleurs, portaient le même nom : c'étaient des athloi ou athla. À Sparte, au siècle d'or de l'Empire romain, les<br />
jeunes gens de la meilleure société subissaient, sous les yeux des curieux, une épreuve de fouet sous laquelle<br />
certains mouraient plutôt que de crier grâce, au terme d'une éducation aussi virile que celle de certaines public<br />
schools anglaises (21). L'athlétisme antique était doublement élitiste (elitär ?). Seul un rentier avait le temps<br />
de s'entraîner ; si un homme du peuple parvient, par une chance purement individuelle, à percer dans<br />
l'athlétisme, cette exception ne fait que confirmer la règle (22). Aristocratique pour une autre raison encore :<br />
ce que nous appelons les « sports » n'étaient pas, dans l'Antiquité, des jeux (où l'on joue en fonction d'une<br />
règle), mais des exploits où l'on prend des risques contre la nature ou contre l'adversaire ; l'idée que les Grecs<br />
se faisaient des épreuves athlétiques était analogue à notre conception de l'alpinisme : on y risque sa vie, car<br />
on y affronte une réalité naturelle ; ce risque inévitable est différent d'un « accident de sport », qui est chose<br />
anormale. Pour les Grecs, se faire tuer dans une épreuve de boxe n'était pas anormal : c'était déplorable et<br />
admirable, comme de mourir à la guerre ; il était honorable, pour le rejeton d'un consul, de devenir boxeur ;<br />
c'était envisager de mourir sous les coups, par amour de la gloire et fidélité à un idéal. Les épreuves<br />
athlétiques font partie du sérieux de la vie, car l'athlète y risque sa vie. Les gants de boxe antique, bardés de<br />
plomb, ne servaient pas à amortir les coups, mais à les rendre plus redoutables. Au musée archéologique<br />
d'Olympie, on peut lire une inscription élevée en l'honneur d'un boxeur qu'on avait surnommé admirativement<br />
Camêlos, le Chameau, tant il avait fait preuve de résistance : il avait succombé plutôt que de s'avouer vaincu.<br />
Épreuve de courage plus encore que d'habileté spécialisée, l'olympisme est vertueux et noble, comme le seront<br />
un jour les tournois (23). Les jeux romains ou ludi n'avaient pas ce parfum universaliste des agônes grecs ;<br />
lorsqu'un écrivain latin parle des jeux du cirque, il mentionne les réactions de la plèbe ; quand un écrivain<br />
grec, en quelque siècle qu'il ait vécu, parle des grands concours, il y signale la présence de « tous les Grecs ».<br />
Le lieu commun de la « décadence » permettait aux historiens de s'expliquer le prestige mystérieux de<br />
l'athlétisme en Grèce : à l'époque hellénistique (tenue gratuitement pour décadente, parce que non<br />
« classique » ni « primitive »), la popularité du sport était attribuée à l'appât du gain et à l'abaissement des<br />
esprits ; à l'époque archaïque, la même popularité était rapportée romantiquement à une antique simplicité,<br />
parfumée d'aristocratisme primitif ; c'est la Grèce de Hölderlin ou de Heidegger, ce printemps d'un monde<br />
archaïque et pur (24). Nudité des athlètes, sens de la beauté, vaillance, goût de la gloire.<br />
La singularité de l'olympisme sera donc expliquée par le moment historique (primitif ou décadent), par le<br />
milieu (aristocratie) ou par la race (« dorienne » ou, plus largement, hellénique). Le goût du sport sera tenu<br />
pour une singularité nationale qu'il ne reste plus qu'à admettre : les Grecs étaient faits ainsi, voilà tout. Ils n'en<br />
sont que plus admirables, puisque au fond ce goût a une saveur primitive et noble : des aristocrates aiment à se<br />
mesurer entre eux et à primer. On aboutit ainsi à une théorie longtemps consacrée : le prestige des<br />
compétitions (ou agônes) était dû au « sens agonistique » de la vieille Grèce ; pour que ce goût soit une<br />
singularité ethnique et que l'explication ne soit pas une vulgaire tautologie, il faut que les autres peuples aient<br />
<strong>Agone</strong> <strong>11</strong> 5