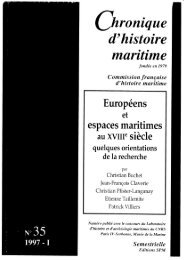CHRONIQUE D'HISTOIRE MARITIME - Société Française d'Histoire ...
CHRONIQUE D'HISTOIRE MARITIME - Société Française d'Histoire ...
CHRONIQUE D'HISTOIRE MARITIME - Société Française d'Histoire ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
les troubles de Smyrne de 1821, les autorités turques dénoncent la<br />
protection consulaire et navale européenne qui encourage les « terreurs<br />
paniques » dans les quartiers arménien et grec et suscite l’indignation<br />
haineuse des « Turcs des classes inférieures » 45 . A la requête du mollah<br />
de Smyrne, les consuls consentent à faire débarquer les Grecs qu’ils<br />
hébergent à terre. Cette mesure s’avère toutefois incapable de prévenir<br />
une nouvelle panique quand, deux jours plus tard, l’annonce de troubles<br />
à Constantinople provoque un regain de violences xénophobes et<br />
antichrétiennes. La protection navale dont bénéficient les Latins de<br />
l’Archipel depuis 1821 y renforce les années suivantes leur espoir d’être<br />
délivrés des pressions fiscales turques. L’importance de la réconciliation<br />
franco-ottomane relancée solennellement en 1816, impose le 15 janvier<br />
1825 une mise au point ministérielle. « Si nous avons le droit de<br />
protéger l’exercice du culte et les Etablissements qui y sont consacrés,<br />
nous ne pouvons prétendre à mettre sous notre sauvegarde la propriété<br />
des habitants et tous leurs intérêts, étrangers à la religion (…)». En dépit<br />
de ces embarras, la légitimité de l’intervention humanitaire n’est jamais<br />
remise en cause. Les instructions de janvier 1825 qui imposent « une<br />
stricte neutralité entre les parties belligérantes », invitent le chevalier de<br />
Rigny à « adoucir les fléaux de la guerre et de rendre aux individus (…)<br />
que l’on peut sauver tout le recours que l’humanité prescrit ». « C’est un<br />
devoir », ajoute non sans emphase le baron de Damas, « que la Marine<br />
Royale a toujours rempli avec autant d’honneur que de zèle ». Cet<br />
excessif « toujours » fait écho à l’engagement humanitaire déjà notable<br />
des forces navales 46 . Dès la fin des Guerres françaises, les Etats<br />
européens ont en effet pris la résolution d’éradiquer la course<br />
barbaresque et d’obtenir la libération des captifs européens. Si le<br />
bombardement d’Alger a été mené en 1816 par les Anglo-Hollandais, la<br />
Marine royale participe en 1819 à une croisière d’intimidation le long<br />
des côtes maghrébines. Parallèlement, la station du Levant est engagée<br />
après 1815 dans la répression de cette basse piraterie que les croisières<br />
estivales de l’escadre ottomane ne parvenaient pas à réduire.<br />
45<br />
BB 3/452, Consul général David, 17 mai 1821 ; LA GRAVIERE (vice-amiral de), op.<br />
cit., vol. 1, Paris, 1878, p. 204-206.<br />
46<br />
BB 3/485, Baron de Damas, Ministre des Affaires Etrangères au comte de Chabrol,<br />
ministre de la Marine, 15 janvier 1825 ; PANZAC (D.), Les Corsaires barbaresques. La<br />
fin d’une épopée 1800-1820, Paris, 1999, p. 101-103 ; 226-244.<br />
32