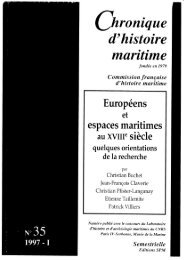CHRONIQUE D'HISTOIRE MARITIME - Société Française d'Histoire ...
CHRONIQUE D'HISTOIRE MARITIME - Société Française d'Histoire ...
CHRONIQUE D'HISTOIRE MARITIME - Société Française d'Histoire ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
égyptiennes (Alexandrie). La généralisation de la propulsion à vapeur au<br />
milieu du siècle, l’établissement d’un réseau télégraphique aérien et<br />
sous-marin cohérent dans les années 1860-1870 donnent à l’outil naval<br />
une souplesse et une rapidité d’action inégalées. En mai 1868, le contreamiral<br />
Moulac justifie son éloignement du Pirée, quartier général à la<br />
Station, en rappelant la présence dans ce port d’une agence consulaire<br />
reliée par câbles télégraphiques aux grands ports du Levant (Smyrne,<br />
Beyrouth) et des Balkans (Salonique). Les entretiens que les officiers de<br />
la Station nouent avec les autorités ottomanes, les agents consulaires et<br />
les notables chrétiens permettent également d’étendre bien au-delà des<br />
côtes le rayon d’influence de la Marine. Durant l’été 1861, l’amiral de<br />
Tinan tente d’encourager les réfugiés maronites, accablés par le départ<br />
du corps expéditionnaire français, en invitant ses officiers à se déplacer<br />
dans l’intérieur en « nombre, en uniforme et armés ». Sans être aussi<br />
marquantes, des mesures similaires sont rapportées pendant la guerre de<br />
Crimée, durant l’insurrection crétoise de 1866-1869 et pendant la crise<br />
d’Orient de 1876-1878. Les visites régulières aux établissements<br />
religieux de la mer Egée, la présidence aux distributions des prix des<br />
collèges catholiques, la participation solennelle aux grandes fêtes<br />
religieuses associent après 1860 dans l’opinion levantine la figure du<br />
missionnaire et du marin, incarnant chacun la France protectrice et<br />
bienfaisante. Irremplaçable, l’instrument naval présente toutefois, une<br />
fois engagé le cycle des violences, des limites que les officiers de<br />
marine sentent avec finesse.<br />
En 1841, en 1845 puis en 1861, les fuyards se dirigèrent vers les ports<br />
pour se placer sous la protection consulaire et navale, mais le régime et<br />
l’orientation du réseau hydrographique syro-libanais interdit toute<br />
opération fluviale, ce qui borne l’activité des patrouilles aux franges<br />
côtières, loin des grandes communautés catholiques et chrétiennes de la<br />
Montagne libanaise et de Syrie. La dispersion des bâtiments interdit<br />
également l’emploi des compagnies de débarquement dont le<br />
déploiement exige la concentration d’une forte escadre et de très<br />
importantes motivations nationales comme l’assassinat d’un<br />
ressortissant français. Tout repose en définitive sur l’effet d’une<br />
démonstration, c’est-à-dire l’interprétation que les autorités et les<br />
populations levantines tant chrétiennes que musulmanes tirent du<br />
déploiement naval et de ses suites. Au-delà des formules<br />
conventionnelles sur « le bon effet » des démonstrations navales, les<br />
42