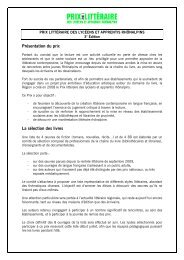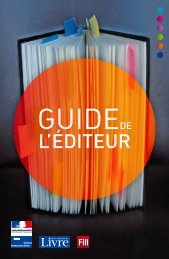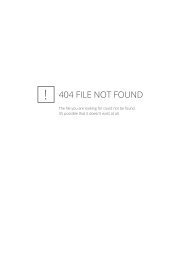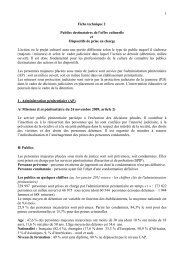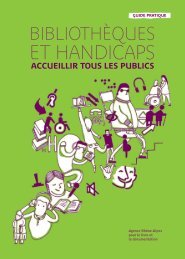Joseph Césarini et Jimmy Glasberg - Arald
Joseph Césarini et Jimmy Glasberg - Arald
Joseph Césarini et Jimmy Glasberg - Arald
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
toire collective à travers une pratique de<br />
cinéma pour mieux se déplacer, se ré-envisager,<br />
rem<strong>et</strong>tre en mouvement ses mécanismes<br />
de pensée.<br />
renversement du regard<br />
Mais toute c<strong>et</strong>te force du cinéma ne réside<br />
pas seulement dans le processus de création.<br />
Ce sont l’activité interprétative des publics, la<br />
réception de ces œuvres au dehors <strong>et</strong> la<br />
“contemplation active”5 qu’elles exigent, qui<br />
contribuent au pouvoir de m<strong>et</strong>tre en mouvement<br />
l’inertie carcérale. Grâce à un véritable<br />
renversement du regard, ces films éveillent en<br />
nous une conscience collective d’appartenir à<br />
un même vivre ensemble. Les lents travellings<br />
d’ombres <strong>et</strong> de lumières de Julien Sallé, les<br />
images du quotidien dans Une Prison dans la<br />
ville dévoilées par Catherine Réchard, le rythme<br />
brutal avec lequel Anne Toussaint <strong>et</strong> Hélène<br />
Guillaume sans Sans elle(s) nous arrachent<br />
aux images du dehors pour nous faire plonger<br />
dans les entrailles de la prison de la Santé,<br />
tous ces choix formels ainsi que la parole affranchie<br />
des personnes détenues qui se saisissent<br />
de c<strong>et</strong>te possibilité d’expression, nous donnent<br />
la certitude que le geste cinématographique<br />
prend tout son sens ici. Le cinéma agit,<br />
cogne, lutte, il ne nous laisse pas confortablement<br />
du bon côté. Et c’est en ce sens qu’il<br />
prend tout son pouvoir, en déconstruisant la<br />
scission, la barrière, la frontière. En montrant<br />
sensiblement <strong>et</strong> intelligiblement la séparation,<br />
il réunit, <strong>et</strong> donne à voir toute la complexité<br />
du monde social <strong>et</strong> de ses parts d’ombre.<br />
Comme l’explique Philippe Combessie :<br />
“La prison est, plus profondément, insupportable<br />
en ce qu’elle cristallise une vision simpliste<br />
<strong>et</strong> dépassée du monde social. C<strong>et</strong>te<br />
vision selon laquelle il y aurait d’un côté, le<br />
bien, la majorité silencieuse, les bons bourgeois,<br />
les intellectuels révérencieux <strong>et</strong> les braves<br />
ouvriers parfois chômeurs, braves tant qu’ils<br />
restent docilement soumis à l’ordre dominant,<br />
<strong>et</strong>, de l’autre côté, une minorité de citoyens du<br />
monde plus ou moins désaffiliés des réseaux<br />
de sociabilité ordinaire, de marginaux, de mal<br />
pensants, qui font autant de boucs émissaires<br />
facilement sacrifiables à l’égoïsme collectif,<br />
pourrait-on dire, en adaptant quelque peu<br />
l’expression de Paul Fauconn<strong>et</strong>.”6<br />
Si ce cinéma est souvent non narratif, c’est<br />
pour mieux redonner à l’image <strong>et</strong> au son toute<br />
leur densité, leur poésie, appeler à une attention<br />
de leur existence pour elle-même <strong>et</strong> non<br />
comme un seul canal de communication, <strong>et</strong><br />
bien entendu démonter avec plus de force la<br />
linéarité du carcéral. A Cherbourg dans Une<br />
Prison dans la ville, les voisins de la prison,<br />
habitants <strong>et</strong> passants de la place Div<strong>et</strong>te, <strong>et</strong><br />
les personnes détenues, tous habitent sur ce<br />
même p<strong>et</strong>it territoire ; chacun d’un côté <strong>et</strong> de<br />
Une Prison dans la ville<br />
l’autre de l’enceinte carcérale se pense, s’imagine,<br />
s’invente. Le cinéma devient alors le lieu<br />
de rencontre, où enfin tous ces gens se croisent<br />
vraiment, appartiennent au même espac<strong>et</strong>emps<br />
; tout le monde ici raconte la prison, qui<br />
ne se regarde jamais comme un “truc ordinaire”.<br />
Le cinéma en prison ne doit pas gommer<br />
les réalités, les souffrances <strong>et</strong> les ruptures,<br />
mais il ne doit pas non plus agir comme<br />
un enfermement de plus. Dans ces films-là, il<br />
ne s’agit pas de montrer des personnes détenues<br />
sur-jouant le rôle du détenu. Il s’agit<br />
avant tout de redonner à ces hommes <strong>et</strong> ces<br />
femmes une place sociale, avec un espace de<br />
parole, une image, une humanité. Affronter le<br />
réel autrement, dire la frontière pour mieux<br />
construire son dépassement. Dire l’inertie<br />
pour mieux la m<strong>et</strong>tre en mouvement. Tels sont<br />
les enjeux de l’image en prison, un lieu doublement<br />
figé, de l’extérieur, par toutes les peurs<br />
sociales qui entourent la figure du détenu, <strong>et</strong><br />
bien sûr de l’intérieur par tous les mécanismes,<br />
visibles <strong>et</strong> invisibles qui immobilisent<br />
les trajectoires de vie. Ces films nous font sentir<br />
tout le poids de c<strong>et</strong>te fixité <strong>et</strong> nous m<strong>et</strong>tent<br />
en mouvement parce qu’ils nous font vivre<br />
l’expérience de l’inertie, celle de la prison mais<br />
aussi celle de notre regard, qu’ils nous amènent<br />
à sa déconstruction.<br />
Dans Or, les murs, l’une des personnes détenues<br />
réfléchit au pardon <strong>et</strong> tente de le définir<br />
ainsi : “Je te réintègre dans le monde, la vie<br />
redevient possible avec toi.” Le cinéma derrière<br />
les barreaux est peut-être cela, non pas<br />
un pardon mais un espace-temps qui, malgré<br />
tout l’enchevêtrement de frontières qui peu-<br />
vent s’exercer entre la prison <strong>et</strong> la société, perm<strong>et</strong><br />
de réintégrer le monde, envisager une<br />
autre vie possible avec l’autre. L. D.<br />
1 Paroles d’une personne détenue, extraites du film<br />
Or, les murs de Julien Sallé.<br />
2 Antoin<strong>et</strong>te Chauven<strong>et</strong>, Corinne Rostaing, Fran-<br />
çoise Orlic, La Violence carcérale en question, PUF,<br />
col. Le lien social, Paris, 2008.<br />
3 Jacques de Baroncelli, “Le cinéma au service<br />
d’une humanité meilleure”, Cahiers du mois-<br />
cinéma, Paris, 1925.<br />
4 Jean-Louis Comolli, Cinéma contre spectacle,<br />
Verdier, Paris, 2009.<br />
5 Dominique Noguez, Cinéma &, Paris Expérimental,<br />
col. Sine qua non, Paris, 2010.<br />
6 Philippe Combessie, “Durkheim, Fauconn<strong>et</strong> <strong>et</strong><br />
Foucault. Etayer une perspective abolitionniste à<br />
l’heure de la mondialisation des échanges”, article<br />
publié dans Les Sphères du pénal avec Michel Fou-<br />
cault. Histoire <strong>et</strong> sociologie du droit de punir,<br />
sous la direction de Marco Cicchini <strong>et</strong> Michel Porr<strong>et</strong>.<br />
Antipodes, Lausanne, 2007.<br />
contrechamp des barreaux 91