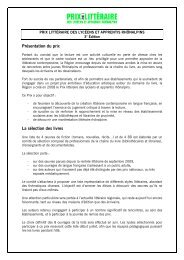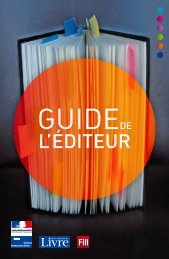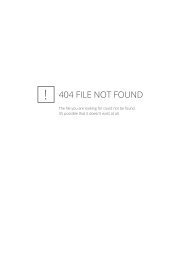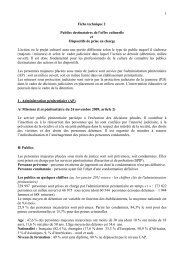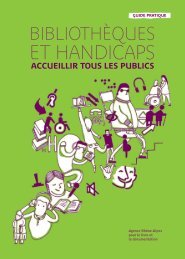Joseph Césarini et Jimmy Glasberg - Arald
Joseph Césarini et Jimmy Glasberg - Arald
Joseph Césarini et Jimmy Glasberg - Arald
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Dernier R<strong>et</strong>our en détention<br />
Dernier R<strong>et</strong>our en détention<br />
2007, 53', couleur, documentaire<br />
réalisation : Hélène Trigueros<br />
production : Dynamo production, France 3<br />
participation : CNC, CR Bourgogne, Procirep,<br />
Angoa-Agicoa<br />
Au centre de détention de Joux-la-Ville,<br />
après plusieurs années d’incarcération,<br />
Claire va être libérée <strong>et</strong> Manon va bénéficier<br />
d’une sortie conditionnelle. Hélène Trigueros<br />
suit leurs dernières semaines de détention.<br />
Dans l’intimité <strong>et</strong> le contre-jour<br />
de leurs cellules, les deux femmes livrent leurs<br />
expériences passées <strong>et</strong> leur appréhension<br />
du futur : la question de la culpabilité, toujours,<br />
<strong>et</strong> la libération, pourtant longuement préparée.<br />
La confiance en soi perdue, les sens mis<br />
en sommeil, le repliement sur soi, Claire<br />
<strong>et</strong> Manon ont les mêmes mots pour décrire<br />
leur début de détention. Chacune a effectué<br />
un long travail de psychothérapie<br />
pour r<strong>et</strong>rouver la parole, analyser le chemin<br />
qui les a conduites là <strong>et</strong> pouvoir à nouveau<br />
“se regarder en face”, “se reconstruire”.<br />
“Assagies”, “apaisées”, elles ne regr<strong>et</strong>tent<br />
pas ce temps douloureux qu’elles ont passé<br />
face à elles-mêmes. Au r<strong>et</strong>our de sa dernière<br />
permission, Claire s’exprime sur l’angoisse<br />
de sa sortie définitive : “R<strong>et</strong>rouver la relation<br />
avec mes enfants, la difficulté va être là.”<br />
Pour les deux femmes, la perspective<br />
de la sortie c’est “gérer, assumer<br />
une culpabilité qui ne partira jamais.”<br />
On les r<strong>et</strong>rouve quelques temps après<br />
leur libération. Pour chacune, malgré la joie<br />
d’un entourage familial chaleureux,<br />
elles disent leur besoin de s’isoler parfois,<br />
peut-être pour r<strong>et</strong>rouver le cocon de la cellule.<br />
T. G.<br />
Surveillante en prison,<br />
le contrechamp des barreaux<br />
2008, 53', couleur, documentaire<br />
réalisation : Hélène Trigueros<br />
production : Dynamo production, France 3<br />
participation : CNC, Planète Justice,<br />
CR Bourgogne, ministère de la Culture<br />
<strong>et</strong> de la Communication (DAPA-mission<br />
du patrimoine <strong>et</strong>hnologique)<br />
Depuis 2000 en France, les femmes ont fait<br />
leur entrée dans les équipes de surveillants<br />
des quartiers hommes des maisons d’arrêt.<br />
A celle de Dijon, 11 femmes (<strong>et</strong> 86 hommes)<br />
y travaillent – en plus des surveillantes<br />
du quartier femmes, qui témoignent aussi<br />
dans le film. En suivant leur quotidien,<br />
Hélène Trigueros enquête sur ce qui a<br />
évolué dans ce métier ces dernières années<br />
<strong>et</strong> comment les femmes l’abordent<br />
spécifiquement.<br />
Curiosité pour ce milieu particulier<br />
ou reconversion (Patricia était coiffeuse),<br />
elles reviennent sur ce qui les a motivées<br />
pour ce métier. Corinne appréhendait<br />
d’abandonner sa féminité sous l’uniforme,<br />
il n’en est rien. Les détenus la complimentent<br />
parfois, elle apprécie mais veille à m<strong>et</strong>tre<br />
rapidement des limites. Les surveillants jugent<br />
positivement l’arrivée de leurs collègues<br />
femmes <strong>et</strong> leurs témoignages corroborent<br />
ceux des détenus : plus de rondeur<br />
dans les ordres, plus de psychologie,<br />
apaisement des tensions. Patricia, surveillante<br />
de parloirs, répond à ceux qui la critiquent<br />
de faire trop de “social”, qu’elle tâche<br />
simplement de rester humaine. Elle avoue<br />
que là où elle a le plus de mal, c’est avec<br />
les condamnés pour violences sur enfant,<br />
mais elle n’est pas là pour juger.<br />
Toutes s’accordent à dire que le rôle<br />
du “maton” s’est beaucoup humanisé,<br />
qu’il manque encore d’“estime”,<br />
de reconnaissance, <strong>et</strong> qu’il faut, pour le mener<br />
à bien, avoir “à l’extérieur” une vie<br />
très équilibrée. T. G.<br />
mité, sachant que toute la détention allait<br />
découvrir ce qu’elles “avaient dans le bide”. Ce<br />
que l’on m’a rapporté lorsque je suis revenue<br />
en prison est intéressant, à savoir que c<strong>et</strong>te<br />
parole, qui était somme toute personnelle, avait<br />
une portée générale. Certaines sont venues<br />
me voir en me disant : “Je vis la même chose, je<br />
ressens la même chose, mais je ne sais pas le<br />
dire.” Elles étaient heureuses que l’on puisse<br />
voir qu’elles avaient gardé une humanité derrière<br />
les grilles. Les femmes filmées m’ont dit<br />
que je n’avais pas trahi leur parole <strong>et</strong> c’était<br />
très important pour moi. Lorsque quelqu’un<br />
accepte de livrer son intimité, on se doit de<br />
jouer franc jeu.<br />
Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire<br />
un second film avec quelques-unes<br />
d’entre elles ?<br />
H. T. : Quand j’ai tourné Les Résidentes, deux<br />
des cinq femmes détenues allaient sortir l’année<br />
suivante. Comme nous évoquions déjà<br />
l’angoisse de la sortie, des permissions, je me<br />
suis dit que ce pourrait être intéressant d’approfondir<br />
c<strong>et</strong>te question-là. J’en ai parlé avec<br />
mon producteur <strong>et</strong> il m’a dit : “Allons-y, on va<br />
poursuivre ce travail.” Nous avons donc exploré<br />
ce dernier mois de détention avec ces deux<br />
femmes <strong>et</strong> Dernier R<strong>et</strong>our en détention est né.<br />
Dans les deux films, quels sont les thèmes<br />
que vous avez souhaité privilégier ?<br />
H. T. : La féminité surtout, la reconstruction du<br />
corps, la sexualité ; est-ce qu’après toutes ces<br />
années on éprouve encore du désir ? Ces questions<br />
sont totalement niées en prison ; il fallait<br />
en parler. Je ne les ai pas posées systématiquement,<br />
je les ai évoquées quand cela me<br />
semblait pertinent ou bien elles sont arrivées<br />
naturellement au cours des entr<strong>et</strong>iens. Je me<br />
suis adaptée à la sensibilité <strong>et</strong> à la personnalité<br />
de chacune des détenues.<br />
Tout au long des entr<strong>et</strong>iens, elles évoquent<br />
le sens qu’elles souhaitent donner<br />
à leur peine. Comment l’avez-vous interprété?<br />
H. T. : J’avais envie de montrer que, quels que<br />
soient leur niveau d’études <strong>et</strong> leurs origines<br />
sociales, nombre de ces femmes utilisent le<br />
temps de la détention pour faire un travail sur<br />
elles-mêmes. Mais toutes n’en ont pas la capacité,<br />
la force ou tout simplement l’envie. Pour<br />
certaines, l’isolement leur perm<strong>et</strong> d’opérer un<br />
r<strong>et</strong>our sur elles-mêmes en profondeur. Elles<br />
se demandent ce qui a fait que, dans leur parcours,<br />
leur vie a basculé du jour au lendemain.<br />
Elles se sont dit qu’elles n’allaient pas passer<br />
leur temps “à fumer des clopes <strong>et</strong> à regarder la<br />
télé” mais qu’il fallait qu’elles réfléchissent à<br />
toutes ces questions. C’est une étape douloureuse<br />
mais essentielle dans le processus de<br />
reconstruction, la première, fondamentale, étant<br />
contrechamp des barreaux 99