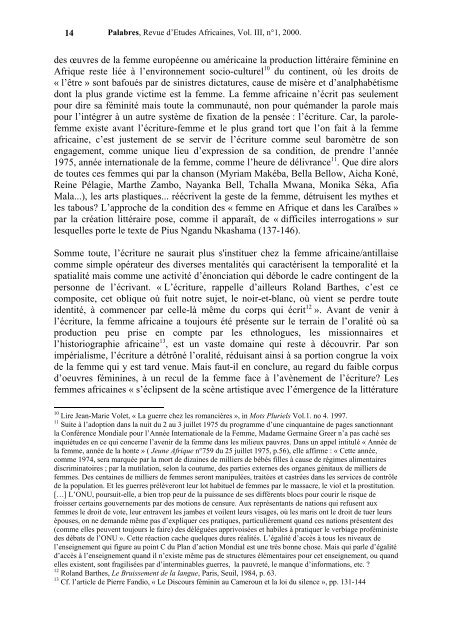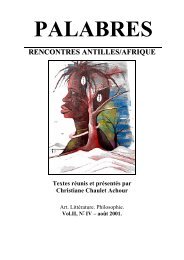Télécharger - Revue Palabres
Télécharger - Revue Palabres
Télécharger - Revue Palabres
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
14<br />
<strong>Palabres</strong>, <strong>Revue</strong> d’Etudes Africaines, Vol. III, n°1, 2000.<br />
des œuvres de la femme européenne ou américaine la production littéraire féminine en<br />
Afrique reste liée à l’environnement socio-culturel 10 du continent, où les droits de<br />
« l’être » sont bafoués par de sinistres dictatures, cause de misère et d’analphabétisme<br />
dont la plus grande victime est la femme. La femme africaine n’écrit pas seulement<br />
pour dire sa féminité mais toute la communauté, non pour quémander la parole mais<br />
pour l’intégrer à un autre système de fixation de la pensée : l’écriture. Car, la parolefemme<br />
existe avant l’écriture-femme et le plus grand tort que l’on fait à la femme<br />
africaine, c’est justement de se servir de l’écriture comme seul baromètre de son<br />
engagement, comme unique lieu d’expression de sa condition, de prendre l’année<br />
1975, année internationale de la femme, comme l’heure de délivrance 11 . Que dire alors<br />
de toutes ces femmes qui par la chanson (Myriam Makéba, Bella Bellow, Aicha Koné,<br />
Reine Pélagie, Marthe Zambo, Nayanka Bell, Tchalla Mwana, Monika Séka, Afia<br />
Mala...), les arts plastiques... réécrivent la geste de la femme, détruisent les mythes et<br />
les tabous? L’approche de la condition des « femme en Afrique et dans les Caraïbes »<br />
par la création littéraire pose, comme il apparaît, de « difficiles interrogations » sur<br />
lesquelles porte le texte de Pius Ngandu Nkashama (137-146).<br />
Somme toute, l’écriture ne saurait plus s'instituer chez la femme africaine/antillaise<br />
comme simple opérateur des diverses mentalités qui caractérisent la temporalité et la<br />
spatialité mais comme une activité d’énonciation qui déborde le cadre contingent de la<br />
personne de l’écrivant. « L’écriture, rappelle d’ailleurs Roland Barthes, c’est ce<br />
composite, cet oblique où fuit notre sujet, le noir-et-blanc, où vient se perdre toute<br />
identité, à commencer par celle-là même du corps qui écrit 12 ». Avant de venir à<br />
l’écriture, la femme africaine a toujours été présente sur le terrain de l’oralité où sa<br />
production peu prise en compte par les ethnologues, les missionnaires et<br />
l’historiographie africaine 13 , est un vaste domaine qui reste à découvrir. Par son<br />
impérialisme, l’écriture a détrôné l’oralité, réduisant ainsi à sa portion congrue la voix<br />
de la femme qui y est tard venue. Mais faut-il en conclure, au regard du faible corpus<br />
d’oeuvres féminines, à un recul de la femme face à l’avènement de l’écriture? Les<br />
femmes africaines « s’éclipsent de la scène artistique avec l’émergence de la littérature<br />
10 Lire Jean-Marie Volet, « La guerre chez les romancières », in Mots Pluriels Vol.1. no 4. 1997.<br />
11 Suite à l’adoption dans la nuit du 2 au 3 juillet 1975 du programme d’une cinquantaine de pages sanctionnant<br />
la Conférence Mondiale pour l’Année Internationale de la Femme, Madame Germaine Greer n’a pas caché ses<br />
inquiétudes en ce qui concerne l’avenir de la femme dans les milieux pauvres. Dans un appel intitulé « Année de<br />
la femme, année de la honte » ( Jeune Afrique n°759 du 25 juillet 1975, p.56), elle affirme : « Cette année,<br />
comme 1974, sera marquée par la mort de dizaines de milliers de bébés filles à cause de régimes alimentaires<br />
discriminatoires ; par la mutilation, selon la coutume, des parties externes des organes génitaux de milliers de<br />
femmes. Des centaines de milliers de femmes seront manipulées, traitées et castrées dans les services de contrôle<br />
de la population. Et les guerres prélèveront leur lot habituel de femmes par le massacre, le viol et la prostitution.<br />
[…] L’ONU, poursuit-elle, a bien trop peur de la puissance de ses différents blocs pour courir le risque de<br />
froisser certains gouvernements par des motions de censure. Aux représentants de nations qui refusent aux<br />
femmes le droit de vote, leur entravent les jambes et voilent leurs visages, où les maris ont le droit de tuer leurs<br />
épouses, on ne demande même pas d’expliquer ces pratiques, particulièrement quand ces nations présentent des<br />
(comme elles peuvent toujours le faire) des déléguées apprivoisées et habiles à pratiquer le verbiage proféministe<br />
des débats de l’ONU ». Cette réaction cache quelques dures réalités. L’égalité d’accès à tous les niveaux de<br />
l’enseignement qui figure au point C du Plan d’action Mondial est une très bonne chose. Mais qui parle d’égalité<br />
d’accès à l’enseignement quand il n’existe même pas de structures élémentaires pour cet enseignement, ou quand<br />
elles existent, sont fragilisées par d’interminables guerres, la pauvreté, le manque d’informations, etc. ?<br />
12 Roland Barthes, Le Bruissement de la langue, Paris, Seuil, 1984, p. 63.<br />
13 Cf. l’article de Pierre Fandio, « Le Discours féminin au Cameroun et la loi du silence », pp. 131-144