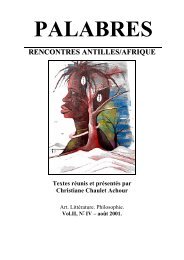Télécharger - Revue Palabres
Télécharger - Revue Palabres
Télécharger - Revue Palabres
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
16<br />
<strong>Palabres</strong>, <strong>Revue</strong> d’Etudes Africaines, Vol. III, n°1, 2000.<br />
littéraire. La critique littéraire semble de plus en plus conjuguer les différents<br />
stéréotypes présents dans certaines œuvres surtout romanesques pour définir des<br />
critères identitaires de l'écriture féminine à partir d’une théorisation de l’écriture dont<br />
les indices caractériels s’articulent autour de la venue héroïque à l’écriture, à la<br />
déconstruction de l’imagerie du « male-made-woman » par des auteures femmes.<br />
Cependant, dans les œuvres littéraires africaines, en dehors de quelques exceptions, la<br />
conscience des classe semble rarement être une motivation, les auteurs s’employant<br />
généralement à dénoncer la dégradation de l’ordre social dans son ensemble (Une si<br />
longue lettre de Mariama Ba, L’Ex-père de la nation de Aminata Sow Fall, Le Crime<br />
de la rue des notables de Ekue Tchotcho, Le Baobab fou de Ken Bugul…) donc à<br />
produire une œuvre potentiellement révélatrice des malaises de la société et non un<br />
enjeu de gendership 17 . « La relation entre écriture et identité est ressentie comme une<br />
nécessité par la femme 18 », remarque judicieusement Béatrice Didier, mais que devient<br />
cette relation quand la société elle-même n’a pas d’identité et qu’elle lutte à s’en<br />
inventer une ? Quand l’homme comme la femme sont victimes à la fois de<br />
contingences historiques de plusieurs ordres, d’un marasme politique et économique<br />
sans fin ? Par-delà les discours politiques et les statistiques inventées de toutes pièces,<br />
la réalité prouve que le taux d’analphabétisme est encore très élevé en Afrique et que<br />
l’école, loin d’être une nécessité, est un luxe qui repousse les masses prolétaires.<br />
On le sait, les transformations qui affectent les discours sur les « écritures-femmes »<br />
semblent le plus souvent ne tenir compte que du « sceau de l’œuvre 19 », de la prise<br />
d’écriture par la femme pour en conclure à l’écriture féminine et/ou féministe sans en<br />
montrer les indices caractériels de l’imaginaire. Or, l'histoire de la littérature prouve<br />
qu'une telle démarche, plutôt sociologique, qui substitue à la nécessaire grammaire du<br />
discours féminin une canonisation du genre féminin comme physiologie du corps, peut<br />
fausser les protocoles d’analyse dès lors que l'identité de l'écrivain peut participer de la<br />
fiction narrative et conduire à des interprétations erronées surtout dans un contexte<br />
social où l’autocensure et la censure d’Etat, l’apologie des mythes poussent l’écriture<br />
et l’écrivant au déguisement. Charlotte Brontë par exemple a publié son roman Jane<br />
Eyre sous le pseudonyme masculin de Currer Bell; Mary Ann Evans est connue sous<br />
le nom de George Eliot 20 . Certes, l’enjeu de la pseudonymie n’est plus le même qu’au<br />
cours des siècles passés où il était systématiquement interdit à la femme de se donner à<br />
des activités intellectuelles telles que la pratique de l’écriture, mais il n’en demeure pas<br />
moins vrai que dans un environnement social encore réticent à l’égalité des sexes, le<br />
jeu dénominationnel reste à l’honneur soit pour se créer une nouvelle identité,<br />
expression de liberté, soit pour se démarquer du nom de famille qui est une sorte<br />
17<br />
Qu’on nous permette ce néologisme pour désigner le transfert de ce que Gérard Leclerc appelle auctorialité<br />
c’est-à-dire « le statut d’auteur d’une œuvre textuelle » (Le Sceau de l’œuvre, Paris, Seuil, 1998, p. 14) vers le<br />
statut sexuel de l’auteur d’une œuvre énonciative. Le Gendership serait donc un autre niveau d’authorship qui<br />
tire sa fonctionnalité de la catégorie sexuelle de celui qui signe l’énoncé textuel. La signature, ce que Gérard<br />
Leclerc appelle « Sceau de l’œuvre », convoquerait de ce fait des modalités de lecture selon qu’elle évoque en<br />
nous des résonances féminines ou masculines.<br />
18 ème<br />
Béatrice Didier, L’Ecriture-femme, Paris, PUF, (1981), 2 édition 1991, p. 34<br />
19<br />
Gérard Leclerc, Le Sceau de l’œuvre littéraire, Paris, Seuil, 1998<br />
20<br />
Cf. La Figure de l’auteur, Maurice Couturier, Paris, Seuil, 1995 ou Lire les Femmes de lettres de Camille<br />
Aubaud, Paris, Dunod, 1993.