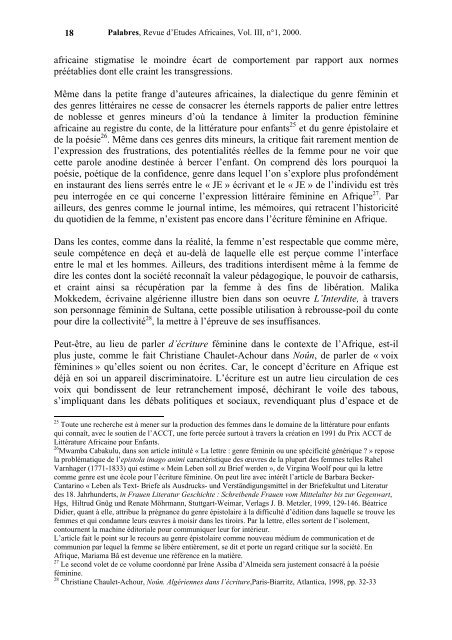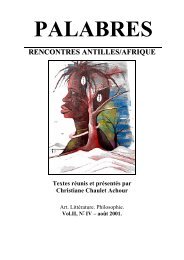Télécharger - Revue Palabres
Télécharger - Revue Palabres
Télécharger - Revue Palabres
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
18<br />
<strong>Palabres</strong>, <strong>Revue</strong> d’Etudes Africaines, Vol. III, n°1, 2000.<br />
africaine stigmatise le moindre écart de comportement par rapport aux normes<br />
préétablies dont elle craint les transgressions.<br />
Même dans la petite frange d’auteures africaines, la dialectique du genre féminin et<br />
des genres littéraires ne cesse de consacrer les éternels rapports de palier entre lettres<br />
de noblesse et genres mineurs d’où la tendance à limiter la production féminine<br />
africaine au registre du conte, de la littérature pour enfants 25 et du genre épistolaire et<br />
de la poésie 26 . Même dans ces genres dits mineurs, la critique fait rarement mention de<br />
l’expression des frustrations, des potentialités réelles de la femme pour ne voir que<br />
cette parole anodine destinée à bercer l’enfant. On comprend dès lors pourquoi la<br />
poésie, poétique de la confidence, genre dans lequel l’on s’explore plus profondément<br />
en instaurant des liens serrés entre le « JE » écrivant et le « JE » de l’individu est très<br />
peu interrogée en ce qui concerne l’expression littéraire féminine en Afrique 27 . Par<br />
ailleurs, des genres comme le journal intime, les mémoires, qui retracent l’historicité<br />
du quotidien de la femme, n’existent pas encore dans l’écriture féminine en Afrique.<br />
Dans les contes, comme dans la réalité, la femme n’est respectable que comme mère,<br />
seule compétence en deçà et au-delà de laquelle elle est perçue comme l’interface<br />
entre le mal et les hommes. Ailleurs, des traditions interdisent même à la femme de<br />
dire les contes dont la société reconnaît la valeur pédagogique, le pouvoir de catharsis,<br />
et craint ainsi sa récupération par la femme à des fins de libération. Malika<br />
Mokkedem, écrivaine algérienne illustre bien dans son oeuvre L’Interdite, à travers<br />
son personnage féminin de Sultana, cette possible utilisation à rebrousse-poil du conte<br />
pour dire la collectivité 28 , la mettre à l’épreuve de ses insuffisances.<br />
Peut-être, au lieu de parler d’écriture féminine dans le contexte de l’Afrique, est-il<br />
plus juste, comme le fait Christiane Chaulet-Achour dans Noûn, de parler de « voix<br />
féminines » qu’elles soient ou non écrites. Car, le concept d’écriture en Afrique est<br />
déjà en soi un appareil discriminatoire. L’écriture est un autre lieu circulation de ces<br />
voix qui bondissent de leur retranchement imposé, déchirant le voile des tabous,<br />
s’impliquant dans les débats politiques et sociaux, revendiquant plus d’espace et de<br />
25<br />
Toute une recherche est à mener sur la production des femmes dans le domaine de la littérature pour enfants<br />
qui connaît, avec le soutien de l’ACCT, une forte percée surtout à travers la création en 1991 du Prix ACCT de<br />
Littérature Africaine pour Enfants.<br />
26<br />
Mwamba Cabakulu, dans son article intitulé « La lettre : genre féminin ou une spécificité générique ? » repose<br />
la problématique de l’epistola imago animi caractéristique des œuvres de la plupart des femmes telles Rahel<br />
Varnhager (1771-1833) qui estime « Mein Leben soll zu Brief werden », de Virgina Woolf pour qui la lettre<br />
comme genre est une école pour l’écriture féminine. On peut lire avec intérêt l’article de Barbara Becker-<br />
Cantarino « Leben als Text- Briefe als Ausdrucks- und Verständigungsmittel in der Briefekultut und Literatur<br />
des 18. Jahrhunderts, in Frauen Literatur Geschichte : Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart,<br />
Hgs, Hiltrud Gnüg und Renate Möhrmann, Stuttgart-Weimar, Verlags J. B. Metzler, 1999, 129-146. Béatrice<br />
Didier, quant à elle, attribue la prégnance du genre épistolaire à la difficulté d’édition dans laquelle se trouve les<br />
femmes et qui condamne leurs œuvres à moisir dans les tiroirs. Par la lettre, elles sortent de l’isolement,<br />
contournent la machine éditoriale pour communiquer leur for intérieur.<br />
L’article fait le point sur le recours au genre épistolaire comme nouveau médium de communication et de<br />
communion par lequel la femme se libère entièrement, se dit et porte un regard critique sur la société. En<br />
Afrique, Mariama Bâ est devenue une référence en la matière.<br />
27<br />
Le second volet de ce volume coordonné par Irène Assiba d’Almeida sera justement consacré à la poésie<br />
féminine.<br />
28<br />
Christiane Chaulet-Achour, Noûn. Algériennes dans l’écriture,Paris-Biarritz, Atlantica, 1998, pp. 32-33