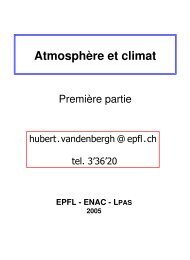MetAir - LPAS - EPFL
MetAir - LPAS - EPFL
MetAir - LPAS - EPFL
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Campagne 1999<br />
76<br />
Projet Modélisation<br />
6. Conclusions et Perspectives<br />
La campagne de mesure 1999 a bénéficié de conditions météorologiques moins propices à la<br />
formation de smog photochimique estival que la campagne 1998. En effet, les résultats de mesure de<br />
l'été 1999 font ressortir une seule journée avec des dépassements de la limite horaire européenne,<br />
fixée à 90 ppb pour l'ozone. Au cours de cette campagne, deux POI ont été réalisées.<br />
La première POI s'est déroulé entre le 24 et le 27 juillet. Elle a bénéficié de l'efficacité de l'ensemble<br />
des moyens de mesure disponibles sur le site. Des conditions météorologiques anticycloniques très<br />
stables ont engendré des concentrations d'ozone supérieures à 90 ppb dans le sud de Grenoble. De<br />
part l'ensemble des mesures disponibles sur cette période et de ses conditions météorologiques<br />
idéales, elle représente le cas de base pour la partie de modélisation.<br />
La deuxième POI s'est déroulée entre le 1 er et le 3 août au cours d'une situation météorologique<br />
moins stable ayant généré des niveaux de concentrations horaires d'ozone inférieurs à 90 ppb. En<br />
comparaison avec le mois d'août 1998, il est intéressant de noter qu'une situation météorologique<br />
similaire, mais de plus longue durée, avait conduit à des pics horaires d'ozone de 110 ppb.<br />
Cette campagne de mesure représente un gros effort de toutes les équipes qui y ont participée. Au<br />
niveau français, c'est à l'heure actuelle une des plus importantes réalisés à l'échelle d'une<br />
agglomération et dans un site avec une topographie marquée. Les résultats de mesures<br />
tridimensionnels montrent clairement l'importance des mécanismes de mélange sur la cuvette<br />
grenobloise, puisqu'ils pilotent le transport et la dispersion des polluants. De plus, l'ensemble de ces<br />
mesures au sol et à la verticale a confirmé que les mouvements atmosphériques au niveau de la<br />
couche limite planétaire sur la ville de Grenoble sont peu sensible au régime synoptique, tout<br />
particulièrement au cours des périodes critiques de pollution. C'est généralement lorsqu'il n'y a plus de<br />
dissociation entre le régime local et synoptique, que l'épisode photochimique se termine.<br />
Ces mesures ont permis de quantifier les apports extérieurs en ozone qui représentent 40 à 50 % des<br />
concentrations d'ozone enregistrées lors des pics de pollution. L'ensemble de l'agglomération, quant à<br />
elle, génère un apport local en ozone compris entre 50 et 60 % pour le même type de situation. Sur<br />
les apports extérieurs seule une diminution de 50 % des émissions des COV, des NOx et du CO sur<br />
l'Europe peut les faire baisser sur le long terme.<br />
Les résultats de cette campagne de mesure sont très importants pour la partie modélisation ultérieure.<br />
En effet ce sont eux qui définissent la période du cas de base à modéliser pour la ville de Grenoble.<br />
Cette période est la première POI. L'ensemble des données au sol et à la verticale obtenues apporte<br />
les informations nécessaires pour initialiser et fixer les paramètres d'entrée du modèle; ensuite elles<br />
vont servir à valider le cas de base au sol et à la verticale par comparaison des simulations et des<br />
mesures. A ce niveau du projet, les mesures DOAS, LIDAR et avion s'avèrent donc des données<br />
d'observations nécessaires pour construire l'outil numérique adapté à Grenoble.<br />
Le modèle utilisé est un modèle photochimique eulérien non hydrostatique. La technique du nesting<br />
est employée, ce qui implique le calcul sur une grande grille qui contient la petite grille centrée sur<br />
Grenoble. Avant de pouvoir entreprendre les calculs sur ces domaines, il faut préparer les paramètres<br />
et les données à entrer, qui sont déterminants pour la vraisemblance des résultats.<br />
Sur la grande grille, le calcul météorologique est initialisé à partir des résultats horaires du modèle<br />
météorologique de l'ISM 7 qui a une résolution de 14 kilomètres. Le calcul chimique, quant à lui, est fait<br />
à partir du cadastre d'émission horaire EMEP 8 avec le module RACM 9 .<br />
7 Institut Suisse de Météorologie<br />
8 Cadastre d'émissions européen<br />
9 Reactiv Atmospheric Chemical Mechanism