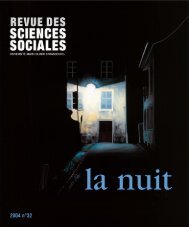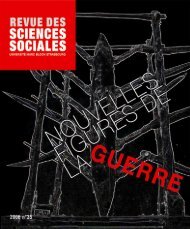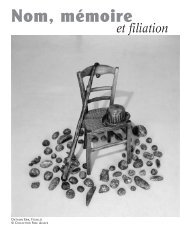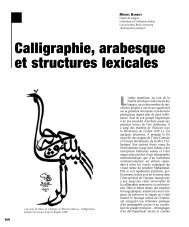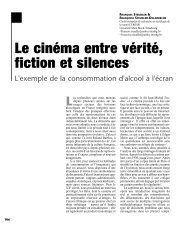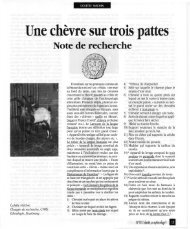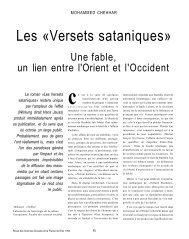la culture, les cultures et le lien social - Revue des sciences sociales
la culture, les cultures et le lien social - Revue des sciences sociales
la culture, les cultures et le lien social - Revue des sciences sociales
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
d’hétérogénéité <strong>et</strong> de dispersion<br />
voire d’invisibilité de l’obj<strong>et</strong> industriel<br />
: dilution <strong>des</strong> situations socia<strong><strong>le</strong>s</strong>,<br />
acculturation, étudiées par l’<strong>et</strong>hnologie<br />
industriel<strong>le</strong>. On passe ainsi d’une<br />
identité <strong>culture</strong>l<strong>le</strong> stab<strong>le</strong> <strong>et</strong> indivisib<strong>le</strong><br />
<strong>des</strong> popu<strong>la</strong>tions exotiques, à <strong>des</strong> formes<br />
d’identités négociées <strong>et</strong> multip<strong><strong>le</strong>s</strong><br />
dans <strong>le</strong> monde moderne <strong>et</strong> selon <strong>des</strong><br />
pluralités d’appartenance (<strong>des</strong> <strong>culture</strong>s<br />
de genre, de générations, <strong>et</strong>hnico-religieuses,<br />
professionnel<strong><strong>le</strong>s</strong> <strong>et</strong>c.). L’approche<br />
<strong>des</strong> <strong>culture</strong>s se modu<strong>le</strong> alors<br />
depuis <strong>le</strong> regard éloigné du chercheur<br />
comme condition de l’enquête dans<br />
l’<strong>et</strong>hnologie « c<strong>la</strong>ssique », jusqu’à l’implication<br />
participante, <strong>et</strong> à <strong>la</strong> conscience<br />
de l’enquêteur dans <strong>le</strong> groupe qu’il<br />
enquête en sociétés industriel<strong><strong>le</strong>s</strong>. L’approche<br />
socio-anthropologique12 a bien<br />
montré à c<strong>et</strong> égard que l’<strong>et</strong>hnologie<br />
apporte à <strong>la</strong> sociologie une dimension<br />
dynamique en lui proposant une<br />
sortie de <strong>la</strong> stratification socia<strong>le</strong> pour<br />
aborder <strong>des</strong> <strong>culture</strong>s <strong>et</strong> <strong>des</strong> groupes<br />
considérés comme milieux d’actions<br />
<strong>et</strong> d’interactions.<br />
Après avoir situé ces quelques<br />
cadres, Nous donnerons une clé de <strong>le</strong>cture<br />
de <strong>la</strong> notion de <strong>culture</strong> apparemment<br />
considérée comme ambiva<strong>le</strong>nte<br />
car partagée entre <strong>la</strong> dimension « d’ordre<br />
du monde », <strong>et</strong> cel<strong>le</strong> de réponse<br />
régu<strong>la</strong>trice à c<strong>et</strong> ordre. Nous montrerons<br />
que c<strong>et</strong>te ambiva<strong>le</strong>nce constatée<br />
ne résulte en fait que d’un changement<br />
de l’échel<strong>le</strong> d’observation de notre<br />
obj<strong>et</strong> « <strong>culture</strong> », <strong>et</strong> d’un dép<strong>la</strong>cement<br />
de <strong>la</strong> foca<strong>le</strong> « macro » socia<strong>le</strong> apte à<br />
cerner un donné sociétal, à <strong>la</strong> foca<strong>le</strong><br />
méso- ou micro-socia<strong>le</strong>, plus habi<strong>le</strong><br />
à détecter un construit en situation <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> interactions sur <strong>le</strong> terrain. Nous<br />
nous appuyons ici sur <strong>la</strong> méthodologie<br />
é<strong>la</strong>borée par Dominique Desjeux<br />
dans son ouvrage Les <strong>sciences</strong> socia<strong><strong>le</strong>s</strong>.<br />
C<strong>et</strong>te méthode repose sur l’idée<br />
que : « en fonction de <strong>la</strong> foca<strong>le</strong> ou<br />
de l’échel<strong>le</strong> d’observation choisie, <strong>la</strong><br />
réalité observée change, <strong><strong>le</strong>s</strong> points de<br />
repère se transforment, <strong>la</strong> question de<br />
<strong>la</strong> rationalité évolue, <strong>et</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> variab<strong><strong>le</strong>s</strong><br />
qui paraissaient indépendantes pour<br />
un économiste, par exemp<strong>le</strong>, peuvent<br />
devenir dépendantes pour un psychologue<br />
à son échel<strong>le</strong> d’observation, <strong>et</strong><br />
vice versa »13. Desjeux distingue une<br />
première échel<strong>le</strong>, macro-socia<strong>le</strong>, qui<br />
traduit « <strong>des</strong> régu<strong>la</strong>rités, <strong>des</strong> gran<strong>des</strong><br />
tendances, <strong>des</strong> appartenances socia<strong><strong>le</strong>s</strong><br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> va<strong>le</strong>urs » beaucoup plus que<br />
<strong>des</strong> actions individuel<strong><strong>le</strong>s</strong>. Ce niveau de<br />
focalisation nous perm<strong>et</strong>tra de définir<br />
<strong>la</strong> <strong>culture</strong> comme ordre <strong>et</strong> vision du<br />
monde. La seconde est micro-socia<strong>le</strong>,<br />
<strong>et</strong> m<strong>et</strong> en scène « <strong>des</strong> acteurs sociaux<br />
en interactions <strong><strong>le</strong>s</strong> uns avec <strong><strong>le</strong>s</strong> autres,<br />
que ce soit à un niveau méso, celui <strong>des</strong><br />
organisations, <strong>des</strong> entreprises <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
systèmes d’action, ou à un niveau très<br />
micro comme celui du quotidien <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> rites d’interaction »14. C<strong>et</strong>te échel<strong>le</strong><br />
nous sera particulièrement propice<br />
pour comprendre <strong><strong>le</strong>s</strong> rapports stratégiques<br />
<strong>et</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> pratiques symboliques<br />
producteurs d’une <strong>culture</strong> de réponse<br />
à l’ordre sociétal formaté.<br />
La <strong>culture</strong> comme<br />
ordre du monde <strong>et</strong><br />
cadre <strong>des</strong> rapports<br />
sociaux, économiques<br />
<strong>et</strong> de développement<br />
n<br />
Le terme de <strong>culture</strong> a été employé<br />
par <strong><strong>le</strong>s</strong> anthropologues pour caractériser<br />
<strong><strong>le</strong>s</strong> sociétés <strong><strong>le</strong>s</strong> unes par référence<br />
aux autres <strong>et</strong> vues sous l’ang<strong>le</strong><br />
de <strong>le</strong>urs acquis : croyances, coutumes,<br />
arts, mora<strong><strong>le</strong>s</strong>, connaissances. Ils ont<br />
défini <strong>la</strong> <strong>culture</strong> comme <strong>la</strong> somme <strong>des</strong><br />
connaissances, attitu<strong>des</strong> <strong>et</strong> modè<strong><strong>le</strong>s</strong><br />
habituels de comportements qu’ont<br />
en commun <strong>et</strong> que transm<strong>et</strong>tent <strong><strong>le</strong>s</strong><br />
membres d’une société particulière.<br />
L’anthropologue Boas a été <strong>le</strong> premier<br />
à dire <strong>la</strong> spécificité de chaque <strong>culture</strong>,<br />
en montrant qu’il était très diffici<strong>le</strong><br />
de trouver <strong>des</strong> lois <strong>et</strong> une unité entre<br />
<strong><strong>le</strong>s</strong> <strong>culture</strong>s. De son côté Lévy-Bruhl a<br />
contribué à édifier <strong>la</strong> <strong>culture</strong> en tant<br />
que système de « mentalités ». Par <strong>la</strong><br />
suite <strong><strong>le</strong>s</strong> travaux de Malinovsky15 ont<br />
contribué à caractériser <strong>la</strong> <strong>culture</strong><br />
comme un ordre du monde, en <strong>la</strong> définissant<br />
comme un système fonctionnel.<br />
Ces travaux représentent <strong>la</strong> <strong>culture</strong><br />
comme totalité fonctionnel<strong>le</strong>, à l’origine<br />
<strong>des</strong> approches systémiques où,<br />
d’une part <strong>la</strong> société est un tout fait de<br />
parties cohérentes, <strong>et</strong> où d’autre part<br />
<strong>la</strong> compréhension d’une partie perm<strong>et</strong><br />
de remonter à <strong>la</strong> totalité. Par <strong>la</strong> suite<br />
l’historien <strong>des</strong> techniques Bertrand<br />
Gil<strong><strong>le</strong>s</strong> a bien montré que <strong><strong>le</strong>s</strong> innovations<br />
s’enracinent dans une <strong>culture</strong><br />
préa<strong>la</strong>b<strong>le</strong> <strong>et</strong> dans un système technique<br />
préexistant. En témoigne par exemp<strong>le</strong><br />
l’automobi<strong>le</strong> <strong>et</strong> tout son équipement :<br />
routes parkings, réseaux de ravitail<strong>le</strong>ment,<br />
signalisation, maintenance.<br />
Ainsi on peut dire que <strong>le</strong> développement<br />
de l’automobi<strong>le</strong> est tributaire de<br />
celui, parallè<strong>le</strong>, d’un « système automobi<strong>le</strong><br />
» prenant assise sur <strong>le</strong> triomphe<br />
du pétro<strong>le</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong> développement du<br />
pneumatique16.<br />
Les travaux de Ruth Bénédict, en<br />
distinguant <strong><strong>le</strong>s</strong> personnalités apolliniènne<br />
<strong>des</strong> Zunis <strong>et</strong> dyonisienne <strong>des</strong><br />
Kwakiutus, ont établi <strong>le</strong> <strong>lien</strong> entre <strong>la</strong><br />
construction de <strong>la</strong> personnalité du<br />
futur adulte <strong>et</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> formes de <strong>la</strong> <strong>social</strong>isation.<br />
On a vu de même avec Linton<br />
que <strong>la</strong> <strong>culture</strong> s’avère extérieure à<br />
l’individu lorsqu’il naît, puis s’intègre<br />
dans sa personnalité lorsqu’il devient<br />
adulte17. De même, <strong>la</strong> psychiatrie<br />
anthropologique <strong>des</strong> années d’entredeux<br />
guerres <strong>et</strong> d’après-guerre, illustre<br />
que « <strong><strong>le</strong>s</strong> institutions avec <strong><strong>le</strong>s</strong>quel<strong><strong>le</strong>s</strong><br />
l’individu est en contact au cours de<br />
sa formation, produisent en lui un<br />
type de conditionnement qui à <strong>la</strong> longue,<br />
finit par créer un certain type de<br />
personnalité »18. La <strong>culture</strong> s’impose<br />
alors comme un ensemb<strong>le</strong> de schémas<br />
de conduite, <strong>et</strong> de modè<strong><strong>le</strong>s</strong> (patterns)<br />
de comportements partagés, que Kardiner<br />
nomme « personnalité de base ».<br />
Citons enfin <strong><strong>le</strong>s</strong> travaux de Margar<strong>et</strong><br />
Mead sur <strong>la</strong> <strong>social</strong>isation, qui posent<br />
<strong>la</strong> question du façonnement de <strong>la</strong> personnalité<br />
<strong>et</strong> de nos comportements<br />
par <strong>la</strong> <strong>culture</strong> comme ordre du monde<br />
préexistant. Ils m<strong>et</strong>tent l’accent sur <strong><strong>le</strong>s</strong><br />
rô<strong><strong>le</strong>s</strong> – par exemp<strong>le</strong> hommes ou femmes<br />
–en tant que construits sociaux<br />
<strong>et</strong> <strong>culture</strong>ls puisque c’est en partant<br />
<strong>des</strong> conduites de l’individu que l’on<br />
va pouvoir expliquer <strong>le</strong>ur univers de<br />
référence19.<br />
La <strong>culture</strong>, en tant qu‘ordre du<br />
monde, est instituée. Comme <strong>le</strong> remarquait<br />
l’anthropologue Mary Doug<strong>la</strong>s,<br />
<strong><strong>le</strong>s</strong> institutions pensent pour nous <strong>et</strong><br />
structurent à notre insu nos démarches20.<br />
Le groupe nous porte <strong>et</strong> nous<br />
c<strong>la</strong>sse. En ce sens Lévi-Strauss montre<br />
que <strong><strong>le</strong>s</strong> structures élémentaires <strong>et</strong><br />
instituées de <strong>la</strong> parenté organisent <strong><strong>le</strong>s</strong><br />
re<strong>la</strong>tions socia<strong><strong>le</strong>s</strong> concrètes de parenté,<br />
162 <strong>Revue</strong> <strong>des</strong> Sciences Socia<strong><strong>le</strong>s</strong>, 2008, n° 39, « Éthique <strong>et</strong> santé »