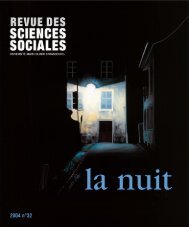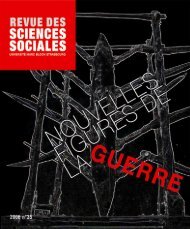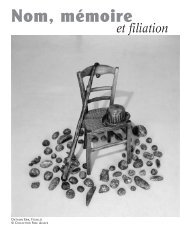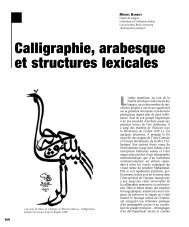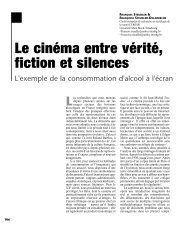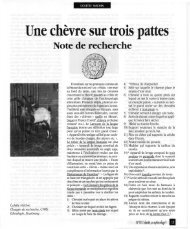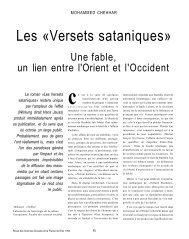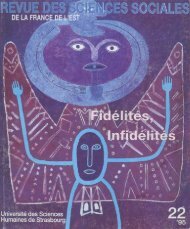la culture, les cultures et le lien social - Revue des sciences sociales
la culture, les cultures et le lien social - Revue des sciences sociales
la culture, les cultures et le lien social - Revue des sciences sociales
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
un fils de tuer son père ou un père de<br />
tuer son fils ; mais obliger ses suj<strong>et</strong>s<br />
de boire du vin il ne <strong>le</strong> peut pas. Il y a<br />
dans chaque nation un esprit général<br />
sur <strong>le</strong>quel <strong>la</strong> puissance même est fondée.<br />
Quand el<strong>le</strong> choque c<strong>et</strong> esprit el<strong>le</strong><br />
se choque el<strong>le</strong>-même, <strong>et</strong> el<strong>le</strong> s’arrête<br />
brusquement »69.<br />
Plus grave toutefois, <strong>et</strong> <strong>la</strong> <strong>culture</strong><br />
c<strong>et</strong>te fois n’en sort pas indemne, est<br />
l’instrumentalisation politique de<br />
<strong>la</strong> <strong>culture</strong> par <strong>la</strong> réification du symbolique,<br />
sa transformation en chose<br />
<strong>et</strong> en rapport <strong>social</strong> dans <strong><strong>le</strong>s</strong> formes<br />
d’intégrisme <strong>et</strong> de totalitarisme. A<strong>la</strong>in<br />
Cambier m<strong>et</strong> c<strong>la</strong>irement l’accent sur<br />
c<strong>et</strong>te pathologie politique de <strong>la</strong> <strong>culture</strong><br />
: « Alors que l’aptitude proprement<br />
humaine à <strong>la</strong> symbolisation consiste<br />
à transformer <strong><strong>le</strong>s</strong> choses en signes, <strong>la</strong><br />
pathologie serait de vouloir convertir<br />
<strong><strong>le</strong>s</strong> signes en choses, de vouloir à<br />
tout prix <strong><strong>le</strong>s</strong> r<strong>et</strong>rouver dans <strong>le</strong> monde<br />
prosaïque, de vouloir <strong><strong>le</strong>s</strong> faire col<strong>le</strong>r à<br />
<strong>la</strong> réalité en déniant toute possibilité<br />
d’interprétation nouvel<strong>le</strong>, <strong>et</strong> en interdisant<br />
toute combinaison inventive <strong>des</strong><br />
symbo<strong><strong>le</strong>s</strong>. Tel est <strong>le</strong> cas de l’intégrisme<br />
qui maintient l’esprit humain dans <strong>le</strong><br />
principe d’une stricte clôture, obturant<br />
toute voie d’accès à l’universel. L’écart<br />
salvateur <strong>et</strong> fécond du symbolique par<br />
rapport au réel est alors gommé <strong>et</strong> avec<br />
lui toute possibilité de distanciation<br />
critique »70.<br />
Nous conclurons sur un cas particulièrement<br />
significatif de <strong>la</strong> rencontre<br />
<strong>des</strong> deux « sens » de <strong>la</strong> <strong>culture</strong>. L’on<br />
peut dire tout d’abord que <strong>la</strong> <strong>culture</strong><br />
de l’imaginaire a pour fonction grammatica<strong>le</strong><br />
de transformer <strong>le</strong> désordre71<br />
en ordre, qu’il s’agisse de l’ordre établi<br />
ou d’un autre inventé comme système<br />
de régu<strong>la</strong>tion. Tel l’exemp<strong>le</strong> de l’ordre<br />
carnava<strong><strong>le</strong>s</strong>que qui m<strong>et</strong> en scène<br />
<strong>la</strong> rencontre de ces deux ordres. Tout<br />
d’abord en ce qui concerne <strong>le</strong> premier,<br />
nous dirons que l’imaginaire mythique<br />
se distancie du rapport <strong>social</strong>. En<br />
témoignent <strong><strong>le</strong>s</strong> analyses menées par<br />
Michel<strong>le</strong> de La Pradel<strong>le</strong> sur <strong><strong>le</strong>s</strong> imaginaires<br />
<strong>des</strong> marchés de Provence, <strong><strong>le</strong>s</strong><br />
interactions rituel<strong><strong>le</strong>s</strong> ou <strong><strong>le</strong>s</strong> détournements<br />
<strong>la</strong>ngagiers entre marchands<br />
forains <strong>et</strong> ménagères72, ou encore <strong><strong>le</strong>s</strong><br />
mythes <strong>et</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> attitu<strong>des</strong> de Carnavals<br />
<strong>et</strong> de fêtes popu<strong>la</strong>ires où <strong>le</strong> pouvoir se<br />
trouve inversé <strong>et</strong> <strong>le</strong> monde transgressé<br />
(on rabaisse <strong>et</strong> on se moque du pouvoir,<br />
du juge, du maître, du mari <strong>et</strong>c.).<br />
Lors de <strong>la</strong> fête <strong>des</strong> fous par exemp<strong>le</strong>,<br />
<strong><strong>le</strong>s</strong> individus simu<strong>le</strong>nt <strong>et</strong> parodient<br />
<strong><strong>le</strong>s</strong> figures de l’autorité ecclésiastique<br />
(évêque, pape), ou juridique (hommes<br />
de lois, de gouvernement). Le monde à<br />
l’envers, celui <strong>des</strong> injures <strong>et</strong> <strong>des</strong> jurons<br />
b<strong>la</strong>sphématoires, celui <strong>des</strong> fausses<br />
mises à mort rituel<strong><strong>le</strong>s</strong>, y apparaît en<br />
fait comme un univers parallè<strong>le</strong>73. Sa<br />
fonction est de perpétuer <strong>le</strong> monde<br />
transgressé, de canaliser l’agressivité<br />
socia<strong>le</strong>, de <strong>la</strong> détourner par l’imaginaire<br />
en échappant à <strong>la</strong> <strong>culture</strong> officiel<strong>le</strong>.<br />
Ces pratiques d’inversion sont<br />
cathartiques <strong>et</strong> sont contenues.<br />
En ce qui concerne <strong>le</strong> second, disons<br />
que l’imaginaire mythique peut se trouver<br />
simultanément pris en otage par <strong>le</strong><br />
rapport <strong>social</strong>. Nous réinterpréterons<br />
une histoire rapportée par Emmanuel<br />
Leroy Ladurie. Celui-ci donne un bon<br />
exemp<strong>le</strong> de ce que l’on considèrera<br />
comme un r<strong>et</strong>our de l’ordre <strong>social</strong>, une<br />
revanche du rapport <strong>social</strong> sur <strong>la</strong> <strong>culture</strong>.<br />
Il décrit <strong>le</strong> carnaval de Romans74<br />
où <strong>le</strong> « monde à l’envers » du peup<strong>le</strong><br />
en quête de transgression imaginaire<br />
<strong>des</strong> va<strong>le</strong>urs établies, débouche sur <strong>des</strong><br />
velléités révolutionnaires, <strong>et</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse<br />
dirigeante ordonne alors un massacre<br />
général où l’on suspend à l’envers,<br />
pieds en l’air <strong>et</strong> tête en bas, l’effigie du<br />
chef rebel<strong>le</strong>. « Ainsi s’achève <strong>le</strong> carnaval<br />
de Romans, acte manqué d’inversion<br />
socia<strong>le</strong> : tout est remis à l’endroit.<br />
Les c<strong>la</strong>sses dominantes un moment<br />
culbutées, r<strong>et</strong>ombent sur <strong>le</strong>urs pieds.<br />
Et pour mieux affirmer c<strong>et</strong>te remise<br />
en ordre <strong><strong>le</strong>s</strong> juges font suspendre à<br />
l’envers, pieds en l’air <strong>et</strong> tête en bas,<br />
l’effigie du chef rebel<strong>le</strong> »75. C’est une<br />
manière de dire, par un r<strong>et</strong>our du symbo<strong>le</strong><br />
<strong>et</strong> dans <strong>le</strong> même codage <strong>culture</strong>l,<br />
que <strong>la</strong> <strong>culture</strong> est bien là mais que c’est<br />
au bout du compte, <strong>le</strong> rapport <strong>social</strong><br />
qui l’emporte puisqu’il a remis chaque<br />
chose <strong>et</strong> l’ordre à <strong>le</strong>ur p<strong>la</strong>ce.<br />
Conclusion :<br />
<strong>la</strong> <strong>culture</strong><br />
comme rési<strong>lien</strong>ce,<br />
« ultime ressource »<br />
<strong>des</strong> « b<strong><strong>le</strong>s</strong>sés de<br />
l’existence »<br />
Nous avons défini <strong>la</strong> <strong>culture</strong> à <strong>la</strong><br />
fois comme ce qui fait règ<strong>le</strong> en tant<br />
qu’ordre du monde dans sa capacité<br />
d’agir <strong>et</strong> d’être agi dans nos usages<br />
quotidiens, puis comme ce qui fait<br />
identité <strong>et</strong> inventivité en tant que système<br />
d’adaptation <strong>et</strong> de régu<strong>la</strong>tion de<br />
c<strong>et</strong>te règ<strong>le</strong>. La <strong>culture</strong> est donc une<br />
expérience ambiva<strong>le</strong>nte : à <strong>la</strong> fois l’ordre<br />
du monde <strong>et</strong> son contournement<br />
créateur.<br />
En ce sens, l’affirmation d’une identité<br />
<strong>et</strong> d’une différence <strong>culture</strong>l<strong><strong>le</strong>s</strong> peut<br />
devenir à <strong>la</strong> fois une ressource <strong>et</strong>/ou<br />
un outil de pression ou de négociation<br />
socia<strong><strong>le</strong>s</strong> (<strong>le</strong> port du fou<strong>la</strong>rd, <strong>la</strong> construction<br />
de mosquées dans <strong>la</strong> communauté<br />
musulmane, <strong>la</strong> connivence <strong>culture</strong>l<strong>le</strong><br />
dans l’<strong>et</strong>hnic business <strong>des</strong> tricoteurs<br />
arméniens ou <strong>des</strong> Chinois à Paris.).<br />
Déjà <strong><strong>le</strong>s</strong> travaux sur <strong><strong>le</strong>s</strong> identités régiona<strong><strong>le</strong>s</strong><br />
en France dans <strong><strong>le</strong>s</strong> années 1970<br />
<strong>et</strong> début 80 avaient bien montré que<br />
<strong><strong>le</strong>s</strong> affirmations <strong>culture</strong>l<strong><strong>le</strong>s</strong> sont souvent<br />
<strong>le</strong> support de <strong>la</strong> lutte <strong>des</strong> groupes<br />
sociaux, de même que l’identité <strong>culture</strong>l<strong>le</strong><br />
loca<strong>le</strong> constituait souvent <strong>le</strong> pilier<br />
<strong>des</strong> mouvements sociaux (travail<strong>le</strong>r<br />
au pays). À c<strong>et</strong> égard, Denys Cuche<br />
explique que l’identité <strong>culture</strong>l<strong>le</strong> résulte<br />
d’une situation de contact entre ce<br />
qu’il nomme une « hétéro-identité »<br />
<strong>et</strong> une « auto-identité ». L’hétéroidentité<br />
est l’identité désignée par <strong>le</strong><br />
groupe <strong>social</strong> dominant, <strong>et</strong> el<strong>le</strong> aboutit<br />
à une identité négative attribuée par<br />
<strong>le</strong> pouvoir. Cuche précise bien que<br />
« l’assignation de différences signifie<br />
moins <strong>la</strong> reconnaissance de spécificités<br />
<strong>culture</strong>l<strong><strong>le</strong>s</strong> que l’affirmation de <strong>la</strong><br />
seu<strong>le</strong> identité légitime, cel<strong>le</strong> du groupe<br />
dominant »76.<br />
Il convient d’autre part d’insister<br />
sur <strong>la</strong> structure dynamique même de<br />
<strong>la</strong> <strong>culture</strong>. Tout d’abord, il ne faut<br />
pas l’enfermer dans <strong>la</strong> stabilité de <strong>la</strong><br />
tradition. Une approche réifiée <strong>et</strong><br />
homogène de <strong>la</strong> <strong>culture</strong> trouve <strong>le</strong> plus<br />
souvent son origine dans l’histoire <strong>et</strong><br />
168 <strong>Revue</strong> <strong>des</strong> Sciences Socia<strong><strong>le</strong>s</strong>, 2008, n° 39, « Éthique <strong>et</strong> santé »