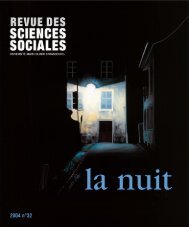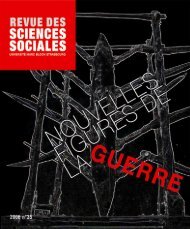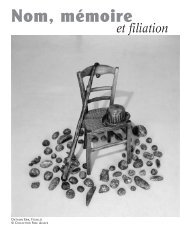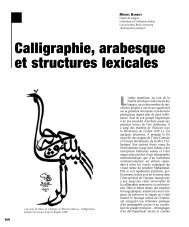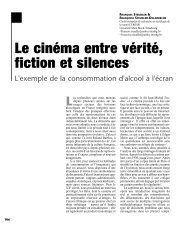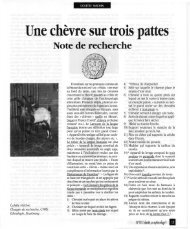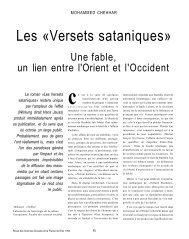Imaginaires du corps social - Revue des sciences sociales
Imaginaires du corps social - Revue des sciences sociales
Imaginaires du corps social - Revue des sciences sociales
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
elle-même à travers ses transformations<br />
maîtrisées.<br />
Elle présente un autre avantage : en elle<br />
se mêle ce qui est et ce qui devrait être. En<br />
contrepoint aux difficultés <strong>du</strong> présent, elle<br />
constitue un appel à l'idéal. Tout organisme<br />
tend à optimiser son propre fonctionnement.<br />
La société elle aussi doit stimuler les<br />
échanges et les communications entre ses<br />
parties afin que chacune remplisse le mieux<br />
possible son office en étant dépendante <strong>des</strong><br />
autres et en le devenant toujours davantage.<br />
La solidarité est ainsi à la fois un fait et une<br />
exigence. Conséquence de la division <strong>du</strong> travail,<br />
elle donne lieu dans tous les groupes<br />
humains à <strong>des</strong> transferts au profit <strong>des</strong> plus<br />
vulnérables et cette entraide doit se développer<br />
avec le procès de civilisation. Elle est<br />
une nécessité puisque dans un <strong>corps</strong> aucun<br />
membre, le plus vil soit-il, ne peut être<br />
abandonné sans secours aux difficultés dont<br />
il ne peut venir à bout. Un tel sacrifice n'affaiblirait<br />
pas seulement l'organisme en le<br />
privant de la contribution d'une de ses composantes,<br />
il compromettrait à terme son intégrité,<br />
sa santé et sa survie. La solidarité est<br />
le mouvement par lequel un groupe affermit<br />
son existence en renforçant sa cohésion. Le<br />
passage de la réalité à l'idéal est ici insensible.<br />
La solidarité organique de Durkheim<br />
est prolongée par le solidarisme de Léon<br />
Bourgeois. A qui répugnerait un tel mélange<br />
<strong>des</strong> genres on pourrait faire remarquer, avec<br />
Castoriadis, qu'un groupe ne définit pas<br />
seulement son identité par son fonctionnement,<br />
mais avant tout par un projet commun<br />
(6) . Certes cette visée collective est de<br />
l'ordre de l'imaginaire. Mais elle relève<br />
aussi <strong>du</strong> réel (qui ne se ré<strong>du</strong>it pas à ce que<br />
les esprits positifs entendent par ce terme)<br />
car elle donne sens et fait agir. Que le <strong>corps</strong><br />
<strong>social</strong> synthétise un ordre complexe et une<br />
orientation vers l'avenir, qu'il soit à la fois<br />
une nécessité et un choix, voilà qui explique<br />
sans doute une part de sa popularité.<br />
Les épreuves <strong>du</strong> temps<br />
La métaphore <strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong> se prête à<br />
la conjonction de ses éléments constitutifs<br />
ainsi qu'à celle <strong>du</strong> présent et de l'avenir,<br />
mais elle s'accommode aussi <strong>des</strong> hiatus et<br />
<strong>des</strong> imperfections. L'organisme diffère de la<br />
machine par ses possibilités supérieures<br />
d'autonomie, de régulation, d'adaptation,<br />
mais le revers de ces qualités est une indéniable<br />
fragilité. Il est vulnérable à toutes<br />
sortes d'agressions qui provoquent en lui <strong>des</strong><br />
altérations passagères ou <strong>du</strong>rables. Un <strong>corps</strong><br />
est sujet à quantité d'épreuves et de maladies<br />
qui entravent ou compromettent l'exercice<br />
de ses talents. Ses limites les plus rigoureuses<br />
ne sont pas celles qui viennent <strong>du</strong> dehors<br />
mais celles qui dérivent de son inscription<br />
dans le temps: tout ce qui vit se<br />
développe puis s'affaiblit. La société n'estelle<br />
pas condamnée à une telle évolution,<br />
certes plus lente que celle que connaissent<br />
les indivi<strong>du</strong>s, mais peut-être tout aussi inéluctable<br />
? Dès lors que la cité <strong>des</strong> hommes<br />
est déconnectée de l'ordre divin et que s'estompent<br />
ses garants méta-sociaux (7) , se ravivent<br />
les craintes quant à sa déchéance. La<br />
métaphore <strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong> a été une expression<br />
privilégiée <strong>des</strong> doutes, <strong>des</strong> désenchantements,<br />
<strong>des</strong> appréhensions à propos <strong>du</strong> <strong>des</strong>tin<br />
collectif.<br />
La conception cyclique est l'une <strong>des</strong> plus<br />
anciennes selon laquelle les hommes se représentent<br />
le devenir de leur société qui demeure<br />
insaisissable pour eux puisqu'il excède<br />
la <strong>du</strong>rée de leur existence indivi<strong>du</strong>elle.<br />
Cette croyance se réfère à un âge d'or mythique<br />
<strong>du</strong>quel on s'éloignerait gra<strong>du</strong>ellement<br />
par un processus de déperdition aboutissant<br />
à une disparition qui achève une<br />
phase de l'histoire et en annonce une nouvelle<br />
(8) . La métaphore <strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong> transporte<br />
ces significations ancestrales jusqu'à<br />
une époque que l'on caractérise généralement,<br />
<strong>du</strong> moins pour ce qui concerne<br />
l'Occident, par sa foi dans le progrès, la<br />
technique et le bonheur. S'agit-il d'une<br />
contrepartie nécessaire à un optimisme excessif<br />
et peut-être superficiel ? Toujours estil<br />
que bien <strong>des</strong> auteurs <strong>des</strong> XIX e et<br />
XX e siècles appliquent à la collectivité le<br />
cycle biologique qui va de la naissance à la<br />
mort en passant par la croissance, la jeunesse,<br />
la maturité, la vieillesse. Ils considèrent<br />
généralement leur propre société<br />
comme parvenue à une étape avancée de<br />
cette évolution et donc vouée à ses sta<strong>des</strong> ultérieurs.<br />
Les épreuves qui marquent leur<br />
temps ou le groupe <strong>social</strong> auquel ils appartiennent<br />
leur paraissent autant de confirmations<br />
d'un âge atteint par la sclérose.<br />
Cela fait plusieurs siècles que chaque génération<br />
s'imagine confrontée à <strong>des</strong> difficultés<br />
sans précédent. Cette impression renforce<br />
le sentiment d'une détérioration accrue<br />
de la vitalité collective qui paraît de plus<br />
conforme aux enseignements de l'histoire<br />
universelle. En particulier l'Europe a été<br />
hantée par l'exemple de la décadence romaine,<br />
invoquée comme la preuve que les<br />
empires les plus soli<strong>des</strong> sont inéluctablement<br />
voués à la décomposition et à la chute.<br />
Certains auteurs font commencer très tôt le<br />
processus de déclin <strong>du</strong> monde antique. Pour<br />
Toynbee il serait avéré dès l'époque hellénistique<br />
(9) . Les considérations sur le caractère<br />
éphémère <strong>des</strong> puissances passées suggèrent<br />
bien <strong>des</strong> parallèles avec le présent.<br />
Aujourd'hui notamment l'effondrement<br />
soudain de pouvoirs qui passaient pour redoutables<br />
peu auparavant incite à renouer<br />
avec les méditations sur la fragilité <strong>des</strong> institutions<br />
humaines. Sous le titre «Fins d'empires»,<br />
le quotidien Le Monde a proposé à<br />
ses lecteurs pendant l'été 1992 un feuilleton<br />
historique dont chaque épisode était marqué<br />
par la dissolution d'un ordre établi. Tant de<br />
cas de déclin incitent à guetter les signes<br />
d'atonie <strong>social</strong>e.<br />
Pathologie <strong>social</strong>e<br />
Bien <strong>des</strong> symptômes ont été invoqués<br />
pour justifier le diagnostic de sénilité collective:<br />
épuisement <strong>des</strong> ressources naturelles,<br />
dégradation irréversible de l'environnement,<br />
renoncement à la transmission<br />
de cultures ou de savoir-faire, montée de<br />
l'indivi<strong>du</strong>alisme, manie commémorative,<br />
etc. L'un d'eux a particulièrement frappé les<br />
esprits: la dégénérescence est devenue au<br />
XIX e siècle une angoisse qui a infléchi dans<br />
un sens biologique l'imaginaire traditionnel<br />
de la décadence. Elle désigne un état chronique<br />
de langueur et de débilité qui rend<br />
ceux qui en sont atteints inaptes ou nuisibles<br />
à toute œuvre collective. Max Nordau, qui<br />
lui consacre tout un ouvrage, considère<br />
qu'elle est <strong>du</strong>e aux conditions de la vie moderne<br />
et qu'elle prend une dimension épidémique<br />
à l'aube <strong>du</strong> XX e siècle. «Nous nous<br />
trouvons actuellement», écrit-il, «au plus<br />
fort d'une grave épidémie intellectuelle,<br />
d'une sorte de peste noire de dégénérescence<br />
et d'hystérie et il est naturel que l'on<br />
se demande de toutes parts avec angoisse :<br />
que va-t-il arriver?» (10) Ce pessimisme à<br />
connotation biologique se retrouve à la<br />
même époque, sous une forme atténuée,<br />
chez <strong>des</strong> auteurs qui trouvent un large public.<br />
Zola, par ailleurs attentif à décrire de<br />
façon méticuleuse les milieux sociaux dans<br />
lesquels ses personnages évoluent (11) ,<br />
194