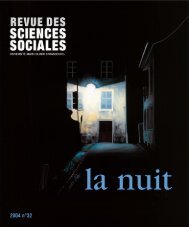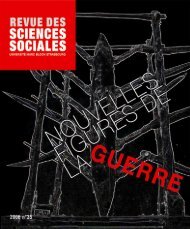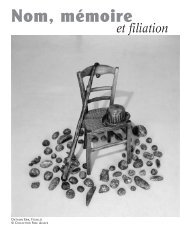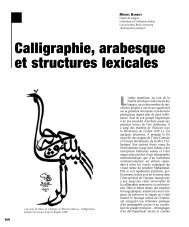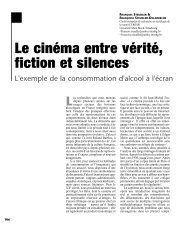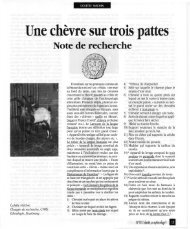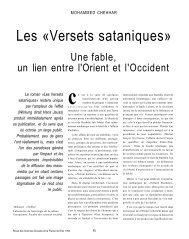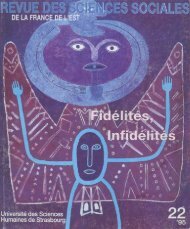Imaginaires du corps social - Revue des sciences sociales
Imaginaires du corps social - Revue des sciences sociales
Imaginaires du corps social - Revue des sciences sociales
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
lorsque L. Pauwels accuse la jeunesse d'être<br />
atteinte de « sida mental » dans <strong>des</strong> termes<br />
qui rappellent les diatribes contre la dégénérescence<br />
(17) . Ainsi se confirme la parenté<br />
entre les maladies <strong>social</strong>es d'hier et d'aujourd'hui<br />
et leur rapport avec la dénonciation<br />
de l'amenuisement de la vitalité <strong>social</strong>e.<br />
Le double <strong>corps</strong> de la société<br />
Si la modernité ne s'est pas affranchie<br />
<strong>des</strong> croyances traditionnelles au sujet <strong>du</strong><br />
<strong>des</strong>tin collectif, elle les a volontiers transcrites<br />
en un langage biologique. Celui-ci<br />
peut se déployer dans deux directions, selon<br />
que l'on considère la vie comme la forme la<br />
plus accomplie de l'ordre ou comme l'expression<br />
de toutes les limites de la condition<br />
humaine soumise aux atteintes imparables<br />
<strong>du</strong> temps et de la mort. L'image de l'organisme,<br />
appliquée au niveau collectif, donne<br />
lieu au double <strong>corps</strong> de la société : d'un côté,<br />
le <strong>corps</strong> glorieux, harmonieux, idéal, <strong>du</strong><br />
fonctionnalisme, où l'unité émane de la différenciation<br />
et la régulation de la maîtrise de<br />
la complexité ; de l'autre, un <strong>corps</strong> souffrant,<br />
déséquilibré, diminué par la maladie et le<br />
vieillissement; d'une part, une orientation<br />
homogénéisante qui prévaut notamment<br />
dans les tentatives de réforme globale et la<br />
logique administrative de hiérarchisation<br />
<strong>des</strong> <strong>corps</strong> professionnels; d'autre part, une<br />
rhétorique de la crise et de la sclérose. La coexistence<br />
de ces deux tendances contrastées<br />
témoigne d'une bipolarisation de l'imaginaire<br />
sur la société. Nos rêveries sur son devenir<br />
oscillent entre le registre de l'utopie et<br />
celui <strong>du</strong> cauchemar. L'expérience <strong>du</strong><br />
XX e siècle a incité la sensibilité contemporaine<br />
à les conjuguer plus systématiquement,<br />
selon un syncrétisme où la tonalité<br />
crépusculaire prend aisément le <strong>des</strong>sus<br />
puisque le meilleur <strong>des</strong> mon<strong>des</strong> peut s'avérer<br />
la forme accomplie <strong>du</strong> pire sans que la<br />
réciproque se vérifie.<br />
Le balancement entre l'idéal et l'épouvante<br />
ne caractérise pas uniquement la<br />
science-fiction, mais l'imaginaire en général.<br />
Celui-ci suit habituellement la pente de<br />
l'excès, ce qui l'empêche de se conformer à<br />
toutes les nuances de la réalité et l'a définitivement<br />
ren<strong>du</strong> suspect à la tradition rationaliste.<br />
Certes il simplifie, mais cela ne présente-t-il<br />
que <strong>des</strong> inconvénients? On se<br />
souvient que, d'après Bachelard, les<br />
connaissances, en se transmettant, se généralisent<br />
et se chargent d'images qui constituent<br />
autant d'obstacles au développement<br />
ultérieur <strong>du</strong> savoir (18) . L'imaginaire biologique<br />
est-il une entrave à l'étude et à l'amélioration<br />
de la société? Sans doute peut-il le<br />
devenir s'il provoque une assimilation pure<br />
et simple entre différents niveaux de réalité.<br />
Il se fige alors en associations obligées qui,<br />
sans cesse répétées, perdent la puissance<br />
heuristique propre aux métaphores qui établissent<br />
un rapprochement entre deux domaines<br />
de signification restant perçus<br />
comme distincts (19) . Sous réserve <strong>du</strong> maintien<br />
<strong>des</strong> différences entre ses références<br />
constitutives et de la préservation de ses<br />
contrastes fondamentaux, l'image <strong>du</strong> <strong>corps</strong><br />
<strong>social</strong> peut éviter de se transformer en métaphore<br />
morte. Tant qu'elle reste paradoxale,<br />
elle stimule la connaissance et l'action<br />
sur la société.<br />
Du point de vue de la connaissance, elle<br />
peut contribuer à faire prendre conscience<br />
que les phénomènes collectifs sont à la fois<br />
emprunts de stabilité et de fragilité. Cette<br />
double détermination est sans doute une<br />
condition de possibilité de leur compréhension.<br />
Elle dérive <strong>des</strong> relations d'interdépendance<br />
qui les constituent et qui expliquent<br />
que, si un groupe, une institution, une entreprise<br />
peuvent subsister indépendamment<br />
<strong>des</strong> dispositions à leur égard de tel indivi<strong>du</strong><br />
en faisant partie, en même temps ils sont<br />
vulnérables aux déperditions de sens susceptibles<br />
de les priver d'une part de leur raison<br />
d'être. La découverte concomitante de la<br />
stabilité et de la fragilité de la société semble<br />
même être à l'origine <strong>du</strong> projet de l'étudier<br />
pour elle-même. Ceux qui s'y consacrèrent<br />
furent à la fois frappés par sa résistance aux<br />
tentatives pour la façonner rationnellement,<br />
ce manque de plasticité révélant une irré<strong>du</strong>ctible<br />
spécificité, et par ses difficultés à<br />
retrouver son équilibre à la suite <strong>des</strong> bouleversements<br />
qui lui avaient été infligés et qui<br />
l'avaient précipitée dans <strong>des</strong> troubles impossibles<br />
à dissiper. Bien sûr, ces deux observations<br />
semblaient difficiles à concilier,<br />
de même qu'il était mal aisé de concevoir un<br />
ordre qui ne se dé<strong>du</strong>ise pas directement <strong>des</strong><br />
catégories de l'esprit humain. Mais ce sont<br />
précisément ces problèmes, rebelles à toute<br />
solution a priori, qui exigeaient d'entreprendre<br />
<strong>des</strong> recherches nouvelles et de les<br />
soutenir par <strong>des</strong> analogies avec le domaine<br />
<strong>du</strong> vivant où étaient attestés <strong>des</strong> processus<br />
d'organisation spécifiques ainsi que leur dérèglement<br />
éventuel ou nécessaire. Comme le<br />
fait remarquer judicieusement N. Elias, «si<br />
l'esprit utilise <strong>des</strong> images pour saisir la réalité<br />
ultime <strong>des</strong> choses, c'est justement parce<br />
que cette réalité se manifeste d'une manière<br />
contradictoire et par conséquent ne saurait<br />
être exprimée par <strong>des</strong> concepts » (20) . La métaphore<br />
biologique aide alors à reconnaître<br />
les contradictions au sein de la société.<br />
Du point de vue de l'action, la métaphore<br />
<strong>du</strong> <strong>corps</strong> <strong>social</strong> a été peut-être plus indispensable<br />
encore. On sait que la politique<br />
moderne est censée se soumettre aux exigences<br />
de la représentation <strong>des</strong> citoyens et<br />
de la séparation <strong>des</strong> pouvoirs. Mais ce que<br />
cela in<strong>du</strong>it comme discordances et comme<br />
conflits est compensé par le recours à deux<br />
principes de légitimité très anciens et toujours<br />
efficaces. Le premier est l'appel à la<br />
concorde, à la cohésion, à la coopération,<br />
afin de faire prévaloir le bien commun (21) par<br />
la soumission de tous à une autorité qui, tel<br />
le cerveau dans l'organisme, coordonne<br />
l'activité <strong>des</strong> différentes parties. Le second<br />
est la justification <strong>du</strong> commandement et de<br />
l'obéissance par le danger réel ou potentiel<br />
que traverserait la société, qui la menacerait<br />
de déclin, de subordination, voire de disparition,<br />
et exigerait un effort concerté sous la<br />
direction de ceux qui sont capables d'affronter<br />
la mort et autorisés, en vue de la survie<br />
collective, à obtenir tous les sacrifices de<br />
ceux qu'ils gouvernent' 22 '. Ces deux principes<br />
se renforcent mutuellement et le second<br />
apporte au premier un appui parfois salutaire;<br />
C'est pourquoi, lorsque le débat<br />
politique devient plus âpre et incertain, il<br />
tend à se dramatiser. Ainsi, la consultation<br />
populaire sur le traité de Maastricht a-t-elle<br />
davantage intéressé l'opinion lorsqu'elle a<br />
quitté le terrain <strong>des</strong> dispositions techniques<br />
de l'Union économique et monétaire pour<br />
rejoindre celui de la vie et de la mort collective,<br />
les uns soutenant que le rejet <strong>du</strong><br />
texte condamnerait l'œuvre de construction<br />
européenne menée depuis près d'un demisiècle<br />
et isolerait le pays dans un monde<br />
plein de dangers, les autres s'opposant à la<br />
ratification pour préserver l'existence même<br />
de la nation, menacée de disparaître dans un<br />
ensemble plus large au profit <strong>du</strong>quel elle renoncerait<br />
à <strong>des</strong> dimensions essentielles de sa<br />
souveraineté. Cet exemple récent rappelle<br />
que dans les décisions importantes les<br />
craintes l'emportent souvent sur les projets.<br />
Si la proportion entre ces deux éléments<br />
varie, l'essentiel est leur <strong>du</strong>alité, la politique<br />
se présentant à la fois comme une mise en<br />
196