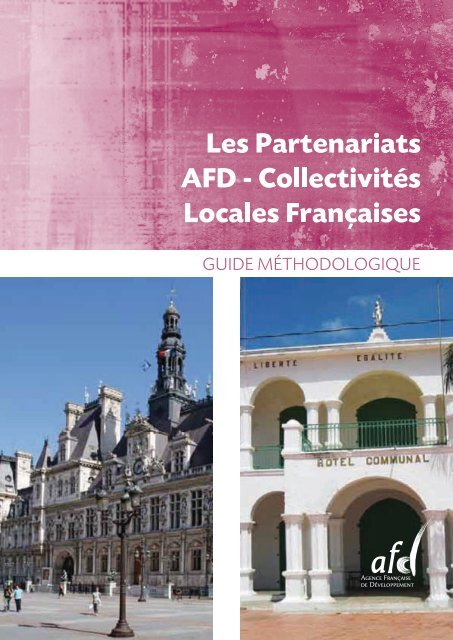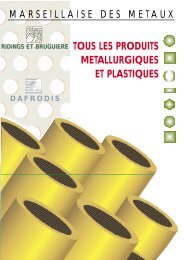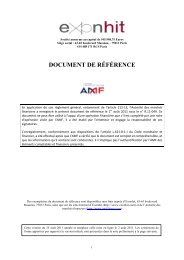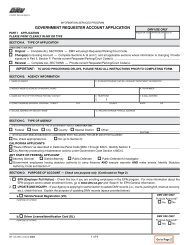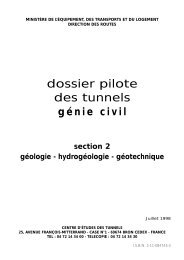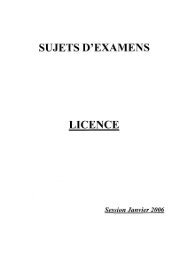GUIDE MÉTHODOLOGIQUE - Agence Française de Développement
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE - Agence Française de Développement
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE - Agence Française de Développement
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>GUIDE</strong> <strong>MÉTHODOLOGIQUE</strong>
Ce gui<strong>de</strong> a été rédigé par Mme Françoise Brunet, consultante, sous la conduite <strong>de</strong> M. Robert <strong>de</strong> La<br />
Rochefoucauld, Chargé <strong>de</strong>s relations avec les collectivités locales.<br />
Les membres du Comité <strong>de</strong> Pilotage :<br />
pour l’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong> :<br />
M. Philippe Chedanne, Chef <strong>de</strong> la division Relations extérieures<br />
M. Roger Goudiard, Directeur du département Asie<br />
Mme. Colette Grosset, Adjointe du Directeur <strong>de</strong>s Opérations<br />
M. Jean-Pierre Lemelle, Division évaluation et capitalisation<br />
M. Louis-Jacques Vaillant, Chef <strong>de</strong> la division Collectivités locales et développement urbain<br />
pour Cités Unies France :<br />
M. Bertrand Gallet, Directeur Général<br />
M. Nicolas Wit, Directeur Général Adjoint<br />
Mme Astrid Frey, Chargée <strong>de</strong> mission Afrique<br />
M. Antoine Joly, Délégué pour l’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités locales, au Ministère <strong>de</strong>s Affaires<br />
étrangères et européennes, a bien voulu relire plusieurs versions provisoires <strong>de</strong> ce gui<strong>de</strong>, et apporter<br />
<strong>de</strong>s observations constructives. Il en est ici remercié.<br />
Des remerciements sont également adressés aux personnes qui ont apporté leur contribution, en<br />
particulier :<br />
Au Ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et européennes :<br />
M. Toussaint Cara<strong>de</strong>c, Chargé <strong>de</strong> mission auprès du DAECL<br />
M. Jérome Duplan, Chargé <strong>de</strong> mission à la communication auprès du DAECL<br />
M. Pierre Laye, Chargé <strong>de</strong> mission pour les politiques <strong>de</strong> décentralisation à la DGCID<br />
M. Pierre Pougnaud, Conseiller technique à la DAECL<br />
Le panel <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong>s collectivités territoriales :<br />
M. Gérard Sournia, Conseil régional Ile-<strong>de</strong>-France<br />
Mme Brigitte Field, Conseil régional Ile-<strong>de</strong>-France<br />
M. Rémi Stoquart, Conseil régional Ile-<strong>de</strong>-France<br />
M. Louis Caudron, Conseil général <strong>de</strong> la Vienne<br />
Mme Estelle Mangold, ville <strong>de</strong> Mulhouse<br />
M. Bruno Leuvrey, AIMF<br />
A l’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong> :<br />
Mme Harriet Barseghian Marsh, département du pilotage stratégique et <strong>de</strong> la prospective<br />
Mme Patricia Bay, responsable <strong>de</strong> la fonction transparence<br />
M. Jean-Francis Benhamou, Collectivités locales et développement urbain (CLD)<br />
Mme Clotil<strong>de</strong> Boutrolle, CEFEB<br />
M. Vincent Joguet, division communication<br />
M. Marc-Antoine Martin, Secrétaire général FFEM<br />
M. Didier Robert, CEFEB<br />
2
Sommaire<br />
SOMMAIRE<br />
Sommaire page 3<br />
Liste <strong>de</strong>s sigles page 4<br />
Introduction page 6<br />
1e partie - L’ai<strong>de</strong> au développement page 9<br />
Fiche 1.1. L’Ai<strong>de</strong> Publique au <strong>Développement</strong>....................................................................................................... page 10<br />
Fiche 1.2. Les financements français <strong>de</strong>stinés à l’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités territoriales .. page 18<br />
Fiche 1.3. Les financements européens accessibles aux collectivités territoriales<br />
en matière d’ai<strong>de</strong> au développement .................................................................................................... page 20<br />
2e partie - L’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong> page 25<br />
Fiche 2.1. Statut, missions et organisation................................................................................................................. page 26<br />
Fiche 2.2. Le cadre d’intervention <strong>de</strong> l’AFD ............................................................................................................. page 30<br />
Fiche 2.3. Les financements proposés par l’AFD aux pays étrangers ........................................................... page 32<br />
Fiche 2.4. Les pays d’intervention ................................................................................................................................. page 33<br />
Fiche 2.5. Les financements <strong>de</strong>stinés aux collectivités étrangères................................................................. page 34<br />
Fiche 2.6. Les approches conjointes avec d’autres bailleurs <strong>de</strong> fonds, bi ou multilatéraux ............... page 36<br />
Fiche 2.7. Les concertations globales avec les collectivités territoriales françaises................................ page 37<br />
Fiche 2.8. Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial .......................................................................... page 38<br />
3e partie - Les collectivités territoriales françaises page 41<br />
Fiche 3.1. L’organisation institutionnelle <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises ................................. page 42<br />
Fiche 3.2. L’organisation financière <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises............................................ page 48<br />
Fiche 3.3. L’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises......................................................... page 52<br />
Fiche 3.4. La participation <strong>de</strong> plusieurs collectivités à un projet..................................................................... page 54<br />
4e partie - Fiches pratiques sur l’AFD page 57<br />
Fiche 4.1. La complémentarité <strong>de</strong>s approches........................................................................................................ page 58<br />
Fiche 4.2. Le contenu du partenariat AFD - collectivité française dans le cadre d’un projet............ page 60<br />
Fiche 4.3. Les conventions AFD - collectivité française....................................................................................... page 62<br />
Fiche 4.4. Le financement par l’AFD <strong>de</strong> projets associant <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />
françaises...............................................................................................................................................................page 64<br />
Fiche 4.5. Le cycle <strong>de</strong>s projets......................................................................................................................................... page 68<br />
5e partie - Informations, formations et concertations proposées. page 73<br />
Fiche 5.1. L’information fournie par le Ministère <strong>de</strong>s Affaires Etrangères (DAECL)............................ page 74<br />
Fiche 5.2. L’information fournie par Cités Unies France.................................................................................... page 75<br />
Fiche 5.3. L’information et les formations fournies par l’AFD......................................................................... page 76<br />
6e partie - Fiches amovibles<br />
Fiche 6.1. Principales questions posées par les collectivités territoriales<br />
Fiche 6.2. Les interlocuteurs <strong>de</strong>s collectivités territoriales à l’AFD<br />
Fiche 6.3. Le réseau <strong>de</strong> l’AFD : agences et bureaux dans les pays étrangers<br />
Fiche 6.4. Les adresses utiles <strong>de</strong> la coopération décentralisée<br />
3
Liste <strong>de</strong>s sigles<br />
ADF<br />
AFCCRE<br />
AFD<br />
AIMF<br />
AMF<br />
AMGVF<br />
APD<br />
APVF<br />
ARF<br />
C2D<br />
CAD<br />
CEFEB<br />
CGLU<br />
CICID<br />
CID<br />
CIP<br />
CIRAD<br />
CIS<br />
CNCD<br />
CNFPT<br />
CNRS<br />
COSP<br />
CPR<br />
CSLP<br />
CUF<br />
DAECL<br />
DCP<br />
DPT<br />
DSP<br />
ETPT<br />
FAO<br />
Assemblée <strong>de</strong>s Départements <strong>de</strong> France<br />
Association <strong>Française</strong> du Conseil <strong>de</strong>s Communes et Régions d’Europe<br />
<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />
Association internationale <strong>de</strong>s maires et responsables <strong>de</strong>s capitales<br />
et métropoles partiellement ou entièrement francophones<br />
Association <strong>de</strong>s Maires <strong>de</strong> France<br />
Association <strong>de</strong>s Maires <strong>de</strong>s Gran<strong>de</strong>s Villes <strong>de</strong> France<br />
Ai<strong>de</strong> publique au développement<br />
Association <strong>de</strong>s Petites Villes <strong>de</strong> France<br />
Association <strong>de</strong>s Régions <strong>de</strong> France<br />
Contrat <strong>de</strong> désen<strong>de</strong>ttement et développement<br />
Comité d’ai<strong>de</strong> au développement <strong>de</strong> l’OCDE<br />
Centre d’Etu<strong>de</strong>s Financières Economiques et Bancaires<br />
Cités et Gouvernements Locaux Unis<br />
Comité interministériel <strong>de</strong> la coopération internationale et du développement<br />
Cadre d’intervention <strong>de</strong> département géographique <strong>de</strong> l’AFD<br />
Cadre d’intervention pays <strong>de</strong> l’AFD<br />
Centre <strong>de</strong> coopération internationale en recherche agronomique pour le<br />
développement<br />
Cadre d’intervention sectoriel <strong>de</strong> l’AFD<br />
Commission Nationale <strong>de</strong> la Coopération Décentralisée<br />
Centre National <strong>de</strong> la Fonction Publique Territoriale<br />
Centre national <strong>de</strong> la recherche scientifique<br />
Conférence d’orientation stratégique et <strong>de</strong> programmation<br />
Contrat <strong>de</strong> plan Etat-région<br />
Cadre stratégique <strong>de</strong> lutte contre la pauvreté<br />
Cités Unies France<br />
Délégation pour l’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités locales<br />
Documents cadres <strong>de</strong> partenariat<br />
Documents <strong>de</strong> politique transversale, dans le cadre <strong>de</strong> la LOLF<br />
Documents <strong>de</strong> stratégie pays du MAEE<br />
Équivalent temps plein travaillé<br />
Food and Agriculture Organization (Organisation <strong>de</strong>s Nations Unies pour<br />
l’alimentation et l’agriculture)<br />
4
Liste <strong>de</strong>s sigles<br />
FED<br />
FEPL<br />
FCI<br />
FFEM<br />
FICOD<br />
FMI<br />
FMVM<br />
FSD<br />
FSP<br />
IFFM<br />
IRCOD<br />
IRD<br />
LOLF<br />
MAEE<br />
NEPAD<br />
NTIC<br />
OCDE<br />
OMD<br />
ONG<br />
ONU<br />
PAS<br />
PMA<br />
POS<br />
Fonds européen <strong>de</strong> développement<br />
Fédération <strong>de</strong>s entreprises publiques locales (ex FNSEM)<br />
France Coopération Internationale<br />
Fonds français pour l’environnement mondial<br />
Fonds d’investissement pour les collectivités décentralisées<br />
Fonds Monétaire International<br />
Fédération <strong>de</strong>s Maires <strong>de</strong>s Villes Moyennes<br />
Fonds social <strong>de</strong> développement<br />
Fonds <strong>de</strong> solidarité prioritaire<br />
Integrated Forest Fire Management<br />
Institut Régional <strong>de</strong> Coopération - <strong>Développement</strong><br />
Institut <strong>de</strong> recherche pour le développement<br />
Loi organique relative aux lois <strong>de</strong> finances<br />
Ministère <strong>de</strong>s Affaires Etrangères et Européennes<br />
Nouveau Partenariat pour le développement <strong>de</strong> l’Afrique<br />
Nouvelles techniques <strong>de</strong> l’information et <strong>de</strong>s communications<br />
Organisation <strong>de</strong> coopération et <strong>de</strong> développement économiques<br />
Objectifs du Millénaire pour le développement<br />
Organisations non gouvernementales<br />
Organisation <strong>de</strong>s Nations Unies<br />
Prêt d’Ajustement Structurel<br />
Pays les moins avancés<br />
Plan d’orientation stratégique <strong>de</strong> l’AFD<br />
PROPARCO Promotion et Participation pour la Coopération économique<br />
RNB<br />
SCAC<br />
SEM<br />
SIVOM<br />
SIVU<br />
TIC<br />
UE<br />
UEMOA<br />
ZSP<br />
Revenu national brut<br />
Service <strong>de</strong> coopération et d’action culturelle (service <strong>de</strong>s ambassa<strong>de</strong>s <strong>de</strong> France)<br />
Société d’économie mixte<br />
Syndicat intercommunal à vocation multiple<br />
Syndicat intercommunal à vocation unique<br />
Techniques <strong>de</strong> l’information e.t <strong>de</strong>s communications<br />
Union Européenne<br />
Union économique et monétaire Ouest-Africaine<br />
Zone <strong>de</strong> solidarité prioritaire<br />
5
Introduction<br />
La décentralisation est <strong>de</strong>venue une tendance<br />
lour<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’organisation institutionnelle ; elle se<br />
traduit, notamment dans les pays dans lesquels<br />
l’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong> (AFD)<br />
intervient, par une montée en puissance <strong>de</strong>s<br />
collectivités locales comme acteurs clés <strong>de</strong> la<br />
gouvernance publique. Les orientations retenues<br />
par le gouvernement français 1 pour l’ai<strong>de</strong><br />
publique au développement ont particulièrement<br />
souligné l’importance <strong>de</strong> la gouvernance<br />
publique, et, notamment, le renforcement <strong>de</strong> la<br />
gouvernance locale. L’AFD elle-même a inscrit<br />
parmi ses orientations stratégiques pour la<br />
pério<strong>de</strong> 2007 - 2011 la mise en place <strong>de</strong> produits<br />
innovants pour les nouveaux clients que<br />
constituent pour elle les collectivités locales <strong>de</strong>s<br />
pays dans lesquels elle intervient traditionnellement,<br />
ainsi que dans un certain nombre <strong>de</strong> pays<br />
émergents.<br />
L’AFD a ainsi commencé à mettre en place<br />
<strong>de</strong>s financements « non souverains », au profit<br />
direct (sans intermédiation <strong>de</strong> l’Etat) <strong>de</strong> collectivités<br />
locales, sous la forme <strong>de</strong> subventions et<br />
par <strong>de</strong>s prêts.<br />
Dans cette démarche, l’AFD souhaite bénéficier<br />
<strong>de</strong> l’expérience et <strong>de</strong> l’expertise <strong>de</strong>s collectivités<br />
territoriales françaises. Depuis une dizaine d’années,<br />
un certain nombre <strong>de</strong> projets bénéficiant<br />
à la fois d’un financement <strong>de</strong> l’AFD et d’une<br />
coopération décentralisée ont été engagés.<br />
Une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> capitalisation <strong>de</strong> ces projets a<br />
été réalisée en 2006 - 2007 (« Les collectivités<br />
territoriales françaises ; l’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Développement</strong> »), et publiée sous le timbre<br />
<strong>de</strong> l’AFD et <strong>de</strong> Cités Unies France (CUF). Elle a<br />
montré la richesse <strong>de</strong> ces expériences, compte<br />
tenu <strong>de</strong> la complémentarité <strong>de</strong>s apports <strong>de</strong><br />
chaque institution : le financement important<br />
et la technicité <strong>de</strong> l’AFD, d’une part, la légitimité<br />
technique et politique, le savoir-faire spécifique<br />
<strong>de</strong> la collectivité et la durée <strong>de</strong> son intervention,<br />
d’autre part.<br />
L’AFD a donc retenu le développement <strong>de</strong> ses<br />
partenariats avec les collectivités territoriales<br />
françaises comme une orientation stratégique,<br />
et a déjà engagé <strong>de</strong>s actions concrètes dans ce<br />
sens :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
<strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> partenariat ont été passés<br />
avec <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s collectivités (régions, départements,<br />
villes et communautés urbaines) ;<br />
<strong>de</strong>s conventions <strong>de</strong> projet tripartites (collectivité<br />
du Sud - collectivité française - AFD) sont<br />
maintenant conclues lorsqu’une collectivité<br />
française est engagée ;<br />
le développement en cours <strong>de</strong> nouveaux<br />
outils <strong>de</strong> financement, plus adaptés aux projets<br />
impliquant <strong>de</strong>s collectivités territoriales ;<br />
la mise en place d’une offre spécifique dans<br />
les domaines <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’assainissement, à<br />
<strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s collectivités qui mobiliseraient<br />
<strong>de</strong>s ressources grâce à la loi Oudin-Santini.<br />
Elle s’efforce par ailleurs d’améliorer l’information<br />
sur ses missions et son activité, et <strong>de</strong><br />
développer la concertation avec les organisations<br />
représentant les collectivités.<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> capitalisation a cependant fait<br />
apparaître, d’une part l’attente <strong>de</strong>s collectivités<br />
françaises, et leur relative méconnaissance <strong>de</strong>s<br />
mo<strong>de</strong>s d’intervention <strong>de</strong> l’AFD, d’autre part le<br />
besoin d’information <strong>de</strong>s cadres <strong>de</strong> l’AFD sur<br />
l’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités territoriales.<br />
A l’intention <strong>de</strong> ces collectivités, le gui<strong>de</strong> leur<br />
apporte une information sur :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
l’ai<strong>de</strong> française au développement, sous ses<br />
différents aspects ;<br />
les financements disponibles pour la coopération<br />
décentralisée, et plus particulièrement<br />
ceux qui sont gérés par l’AFD ;<br />
l’AFD, ses missions, son organisation, et les<br />
appuis qu’elle peut apporter à la coopération<br />
décentralisée ;<br />
les informations et formations proposées aux<br />
responsables <strong>de</strong>s collectivités françaises.<br />
De cette manière, il a pour objet <strong>de</strong> faciliter<br />
l’établissement <strong>de</strong> partenariats entre l’AFD et<br />
les collectivités françaises, et <strong>de</strong> fournir à cellesci<br />
clés et conseils pour améliorer l’exécution <strong>de</strong>s<br />
projets bénéficiant <strong>de</strong> financements <strong>de</strong> l’AFD.<br />
1<br />
CICID du 19 juin 2006<br />
6
Introduction<br />
Le gui<strong>de</strong> est présenté sous forme <strong>de</strong> fiches,<br />
qui pourront être actualisées chaque fois que<br />
nécessaire. Les fiches peuvent être consultées<br />
<strong>de</strong> manière indépendante les unes <strong>de</strong>s autres.<br />
Les fiches sont classées en 6 parties :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
la présentation du contexte : l’ai<strong>de</strong> publique<br />
au développement, et l’action extérieure <strong>de</strong>s<br />
collectivités territoriales ; les financements<br />
français et européens <strong>de</strong>stinés à l’action<br />
extérieure <strong>de</strong>s collectivités territoriales ;<br />
l’AFD : son statut, son organisation, ses<br />
missions ; le cadre, les pays et secteurs <strong>de</strong><br />
son intervention ; les financements qu’elle<br />
propose ; les concertations engagées avec les<br />
collectivités territoriales<br />
<strong>de</strong>s fiches pratiques, <strong>de</strong>stinées à répondre aux<br />
questions précises <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />
: elles portent sur le cadre juridique <strong>de</strong><br />
l’intervention <strong>de</strong> l’AFD, les conventions AFD<br />
- collectivité française, les outils financiers, le<br />
cycle <strong>de</strong>s projets, les différentes catégories <strong>de</strong><br />
projets donnant lieu à partenariat, le contenu<br />
du partenariat AFD - collectivité française<br />
dans le cadre d’un projet, les relations avec<br />
l’AFD, les erreurs à éviter ;<br />
-<br />
-<br />
-<br />
<strong>de</strong>s fiches pratiques sur les collectivités<br />
territoriales, <strong>de</strong>stinées aux chefs <strong>de</strong> projets<br />
<strong>de</strong> l’AFD et, le cas échéant, à leurs autres<br />
partenaires ;<br />
les informations et formations proposées aux<br />
collectivités territoriales, par la CNCD, par<br />
l’AFD, notamment à travers le CEFEB, par<br />
CUF et par les autres associations <strong>de</strong> collectivités<br />
territoriales ;<br />
enfin, un jeu <strong>de</strong> 4 fiches amovibles fournissant<br />
<strong>de</strong>s informations pratiques (questions les<br />
plus fréquemment posées, contacts à l’AFD,<br />
adresses utiles).<br />
7
L’ai<strong>de</strong> au<br />
développement<br />
9
Fiche 1.1. L’Ai<strong>de</strong> Publique au <strong>Développement</strong><br />
L’AIDE PUBLIQUE AU<br />
DÉVELOPPEMENT (APD)<br />
Les pays membres <strong>de</strong> l’Organisation<br />
<strong>de</strong> Coopération et <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />
Economiques (OCDE) se sont donné dans le<br />
cadre du Comité d’ai<strong>de</strong> au développement<br />
(CAD) <strong>de</strong>s règles pour définir l’APD.<br />
Cette définition est susceptible d’évolutions<br />
importantes avec la montée en puissance <strong>de</strong><br />
pays non membres <strong>de</strong> l’OCDE (Chine, Brésil,<br />
Thaïlan<strong>de</strong>…).<br />
Les critères suivants ont été retenus :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
le donateur : il s’agit d’un donateur public <strong>de</strong><br />
l’Etat qui fournit l’APD ;<br />
les modalités : l’ai<strong>de</strong> doit comporter un élément<br />
<strong>de</strong> libéralité 2 d’au moins 25 % ;<br />
les pays bénéficiaires : leur liste est arrêtée<br />
tous les 3 ans par le CAD. La liste actuelle a été<br />
adoptée en décembre 2005, pour s’appliquer<br />
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.<br />
Elle se fon<strong>de</strong> sur les besoins <strong>de</strong>s bénéficiaires,<br />
et inclut tous les pays à faible revenu et à<br />
revenu intermédiaire, sauf les membres du<br />
G8 ou <strong>de</strong> l’Union européenne.<br />
L’ONU a fixé <strong>de</strong> longue date aux pays donateurs<br />
l’objectif <strong>de</strong> porter leur APD à 0,7 % du revenu<br />
national. La Conférence <strong>de</strong> Monterey <strong>de</strong> 2002 a<br />
fixé l’engagement <strong>de</strong> 0,7 % en 2012. Le 24 mai<br />
2005, les pays <strong>de</strong> l’Union européenne se sont<br />
engagés à porter leur APD à 0,56 % du RNB en<br />
2010 et à 0,7 % en 2015.<br />
Par ailleurs, le CAD a adopté en 2001 une<br />
recommandation sur le déliement <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />
aux pays les moins avancés. L’ai<strong>de</strong> est dite liée<br />
lorsque le bénéficiaire est contraint <strong>de</strong> l’utiliser,<br />
en tout ou en partie, pour <strong>de</strong>s comman<strong>de</strong>s aux<br />
entreprises du pays donateur. L’ai<strong>de</strong> bilatérale,<br />
notamment l’ai<strong>de</strong> française, a longtemps été<br />
liée. Depuis le 1er janvier 2002, l’APD aux pays<br />
les moins avancés est déliée dans les domaines<br />
suivants : soutien à la balance <strong>de</strong>s paiements et<br />
ai<strong>de</strong> à l’ajustement structurel, remise <strong>de</strong> <strong>de</strong>tte,<br />
ai<strong>de</strong>-programme sectorielle et pluri-sectorielle,<br />
ai<strong>de</strong> au titre <strong>de</strong>s projets d’équipement, soutien<br />
<strong>de</strong>s importations et ai<strong>de</strong> sous forme <strong>de</strong><br />
produits, contrats <strong>de</strong> services commerciaux et<br />
APD consentie à <strong>de</strong>s ONG pour <strong>de</strong>s activités<br />
impliquant la passation <strong>de</strong> marchés. Selon les<br />
estimations du CAD, environ 70 % <strong>de</strong> l’APD<br />
bilatérale totale <strong>de</strong>stinée aux pays les moins<br />
avancés <strong>de</strong>vrait être déliée.<br />
Les pays donateurs déclarent chaque année<br />
au CAD le montant <strong>de</strong> l’APD versée l’année<br />
précé<strong>de</strong>nte.<br />
En France, l’APD inclut les montants mobilisés<br />
par la coopération décentralisée.<br />
Le niveau et l’affectation <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />
L’APD française s’est élevée, en 2006, à 0,47 %<br />
du revenu national brut (RNB), soit un montant<br />
<strong>de</strong> 10,4 milliards USD. En 2007, elle a été ramenée<br />
à 9,94 milliards USD, soit 0,39 % du RNB.<br />
Néanmoins, la France est passée au 3 e rang <strong>de</strong>s<br />
pays donateurs, alors qu’elle était au 4 e rang en<br />
2006, et du 2 e rang, après le Royaume Uni, au<br />
premier rang <strong>de</strong>s pays du G8.<br />
Complément d’information sur l’APD<br />
<strong>de</strong>s pays du CAD en 2006 :<br />
www.oecd.org/document/17/0,3343,fr_2649_<br />
33721_38341873_1_1_1_1,00.html<br />
Cet effort <strong>de</strong>vrait atteindre 0,7 % du RNB<br />
en 2015, dont 0,15 % consacré aux pays<br />
les moins avancés (PMA). La moitié du<br />
supplément <strong>de</strong> l’APD <strong>de</strong>vra être attribuée à<br />
l’Afrique subsaharienne.<br />
Cette ai<strong>de</strong> se répartit en trois parts :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
L’ai<strong>de</strong> programmable européenne et<br />
multilatérale. Elle représentait environ 34 %<br />
<strong>de</strong> l’APD totale <strong>de</strong> la France en 2007. Elle<br />
inclut les contributions <strong>de</strong> la France au Fonds<br />
européen <strong>de</strong> développement, à la Banque<br />
mondiale, aux Nations Unies, aux fonds<br />
thématiques comme le Fonds mondial Sida,<br />
l’IFFM et l’UNITAID) ;<br />
L’ai<strong>de</strong> bilatérale programmable. Elle représentait<br />
environ 27 % <strong>de</strong> l’APD totale <strong>de</strong> la<br />
France en 2007. Elle inclut les prêts, les dons,<br />
l’assistance technique, l’ai<strong>de</strong> humanitaire<br />
et alimentaire et la recherche en faveur du<br />
développement ;<br />
L’ai<strong>de</strong> bilatérale non programmable. Elle<br />
représentait environ 39 % <strong>de</strong> l’APD totale <strong>de</strong><br />
la France en 2007. Elle inclut les annulations<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>tte, les frais d’accueil <strong>de</strong>s étudiants<br />
étrangers et les frais d’accueil <strong>de</strong>s réfugiés.<br />
L’APD française est prioritairement affectée à<br />
l’Afrique : plus <strong>de</strong> 70 % <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> française lui<br />
est consacrée (hors ai<strong>de</strong> non « géographisée »),<br />
essentiellement pour l’Afrique subsaharienne.<br />
2<br />
part <strong>de</strong> don<br />
10
L’ai<strong>de</strong> au développement<br />
Fiche 1.1. L’Ai<strong>de</strong> Publique au <strong>Développement</strong><br />
PAYS BÉNÉFICIAIRES DE L’APD SELON LE CAD (2004)<br />
Pays les moins avancés Pays à faible revenu<br />
(RNB / hab<br />
< $825 en 2004)<br />
Pays et territoires à<br />
revenu intermédiaire<br />
tranche inférieure<br />
(RNB / hab $ 826 -<br />
$ 3 255 en 2004)<br />
Pays et territoires à<br />
revenu intermédiaire<br />
tranche supérieure (RNB<br />
/ hab $ 3 256 - $ 10 065<br />
en 2004)<br />
Afghanistan Cameroun Albanie Afrique du Sud<br />
Angola Rep Congo. Algérie Anguilla<br />
Bangla<strong>de</strong>sh Rep. dém. Corée Arménie Antigua et Barbuda<br />
Bénin Cote d’Ivoire Azerbaidjan Arabie Saoudite<br />
Bhoutan Ghana Bélarus Argentine<br />
Burkina Faso In<strong>de</strong> Bolivie Barba<strong>de</strong>s<br />
Burundi Kenya Bosnie-Herzegovine Belize<br />
Cambodge Rep. Kyrghize, Brésil Botswana<br />
Cap Vert Moldova Chine Chili<br />
Rép Centrafricaine. Mongolie Colombie Iles Cook<br />
Comores Nicaragua Cuba Costa Rica<br />
Rép. dém. Congo Nigeria Rép Dominicaine Croatie<br />
Djibouti Ouzbekistan Egypte Dominique<br />
Erythrée Pakistan El Salvador Gabon<br />
Ethiopie Papouasie - Nouvelle-Guinée Fidji Grena<strong>de</strong><br />
Gambie Equateur Géorgie Liban<br />
Guinee Tadjikistan Guatemala Libye<br />
Guinée équatoriale Viet Nam Guyana Malaisie<br />
Guinée-Bissau Zimbabwe Honduras Maurice<br />
Haiti Indonésie Mayotte<br />
Kiribati Irak Mexique<br />
Laos Iran Montserrat<br />
Lesotho Jamaïque Nauru<br />
Liberia Jordanie Oman<br />
Madagascar Kazakhstan Palau<br />
Malawi Macédoine Panama<br />
Maldives Maroc Seychelles<br />
Mali Iles Marshall Ste Lucie<br />
Mauritanie Micronésie, Ste-Hélène<br />
Mozambique Namibie St-Kitts et Nevis<br />
Myanmar Niue StVincent Grenadines<br />
Népal Paraguay Trinité et Tobago<br />
Niger Pérou Turks et Caïques<br />
Ouganda Philippines Turquie<br />
Rwanda Serbie et Monténégro Uruguay<br />
Iles Salomon Sri Lanka Vénézuela<br />
Samoa<br />
Suriname<br />
Sao Tomé Principe<br />
Swaziland<br />
Sénégal<br />
Syrie<br />
Sierra Leone<br />
Thaïlan<strong>de</strong><br />
Somalie<br />
Tokelau<br />
Soudan<br />
Tonga<br />
Tanzanie<br />
Turkmenistan Ukraine<br />
Tchad<br />
Wallis & Futuna<br />
Timor-Leste<br />
11
Ai<strong>de</strong> bilatérale et ai<strong>de</strong> multilatérale<br />
La part <strong>de</strong> l’APD française consacrée à l’ai<strong>de</strong><br />
bilatérale tend à se réduire d’année en année.<br />
En 2006, l’ai<strong>de</strong> bilatérale représentait plus <strong>de</strong><br />
70 % <strong>de</strong> l’APD totale. Cependant, une part très<br />
importante <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> bilatérale est affectée aux<br />
remises <strong>de</strong> <strong>de</strong>ttes (32 % en 2006), aux frais<br />
d’écolage (10,5 % en 2006) et aux réfugiés<br />
(4 % en 2006). Il est donc plus logique <strong>de</strong> considérer<br />
le montant « h<strong>de</strong>r »(hors <strong>de</strong>tte, écolage<br />
et réfugiés), qui ne représentait, en 2006, que<br />
32,6 % <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> bilatérale, et 24 % du total <strong>de</strong><br />
l’APD. Toutefois, le montant <strong>de</strong>s remises <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ttes a été ramené <strong>de</strong> 32 % en 2006 à 15 %<br />
en 2007.<br />
L’ai<strong>de</strong> multilatérale, quant à elle, représentait<br />
en 2006, moins <strong>de</strong> 25 % <strong>de</strong> l’APD totale. Mais,<br />
si l’on considère seulement l’APD « h<strong>de</strong>r », ainsi<br />
que d’autres dépenses d’ai<strong>de</strong> non programmables<br />
3 , l’ai<strong>de</strong> multilatérale en absorbait environ<br />
50 %. Au surplus, une partie <strong>de</strong>s crédits classés<br />
dans l’ai<strong>de</strong> bilatérale est en réalité gérée par <strong>de</strong>s<br />
fonds fiduciaires <strong>de</strong>s institutions internationales<br />
(notamment la Banque mondiale et le FMI).<br />
La France octroie environ 20 % <strong>de</strong> son ai<strong>de</strong><br />
au développement à travers le canal communautaire.<br />
Jusqu’au 9 e FED, elle était ainsi le<br />
premier contributeur au Fonds européen <strong>de</strong><br />
développement (FED). Avec l’élargissement <strong>de</strong><br />
l’Union européenne, sa part dans le 10 e FED<br />
est ramenée à 19,55 %, et elle est désormais la<br />
secon<strong>de</strong> contributrice après l’Allemagne.<br />
La France finance également les programmes<br />
d’ai<strong>de</strong> extérieure inscrits au budget <strong>de</strong> l’Union<br />
européenne, pour un montant comptabilisable<br />
en APD <strong>de</strong> 881,2 M€ (voir fiche 1.4.).<br />
Enfin, la France est actionnaire <strong>de</strong> plusieurs banques<br />
multilatérales <strong>de</strong> développement (Banque<br />
mondiale, Banque africaine <strong>de</strong> développement,<br />
Banque asiatique <strong>de</strong> développement, Banque<br />
interaméricaine <strong>de</strong> développement, Banque<br />
européenne pour la reconstruction et le développement,<br />
etc.). Conformément aux priorités<br />
<strong>de</strong> sa politique d’ai<strong>de</strong> au développement, la<br />
France était le premier bailleur du Fonds africain<br />
<strong>de</strong> développement avec un engagement <strong>de</strong> près<br />
<strong>de</strong> 350 M€ lors <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>rnière reconstitution<br />
(couvrant la pério<strong>de</strong> 2005-2007).<br />
Le CICID (voir ci-après) du 19 juin 2006 a<br />
rappelé l’engagement français <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong><br />
l’ai<strong>de</strong> et a précisé que cette croissance <strong>de</strong>vrait<br />
se faire « en veillant à maintenir l’équilibre<br />
entre l’ai<strong>de</strong> bilatérale et l’ai<strong>de</strong> multilatérale <strong>de</strong> la<br />
France tout en renforçant leur complémentarité<br />
et leur articulation. La mobilisation <strong>de</strong>s moyens<br />
bilatéraux et multilatéraux veillera à accroître la<br />
visibilité et l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> française. »<br />
Les objectifs <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />
La politique française en matière <strong>de</strong> coopération<br />
et d’ai<strong>de</strong> publique au développement s’articule<br />
autour d’une volonté forte <strong>de</strong> renforcement <strong>de</strong><br />
l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong>.<br />
La France s’est dotée <strong>de</strong> stratégies pluriannuelles<br />
dans les sept secteurs reconnus comme<br />
prioritaires pour la réalisation <strong>de</strong>s Objectifs du<br />
Millénaire pour le <strong>Développement</strong> (OMD) :<br />
agriculture et sécurité alimentaire, éducation,<br />
eau et assainissement, santé et lutte contre<br />
le Sida, protection <strong>de</strong> l’environnement,<br />
infrastructures en Afrique subsaharienne, développement<br />
du secteur productif. Outre ces sept<br />
secteurs, l’appui à la gouvernance démocratique<br />
constitue également un secteur d’intervention<br />
<strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> française, approuvée par le CICID <strong>de</strong><br />
décembre 2006 ; il regroupe les actions touchant<br />
à la refondation <strong>de</strong> l’Etat et notamment<br />
le renforcement <strong>de</strong> ses capacités humaines et<br />
institutionnelles et l’appui à la décentralisation.<br />
Concernant l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong>, les CICID du<br />
20 juillet 2004 et du 18 mai 2005 ont arrêté<br />
<strong>de</strong>s décisions tendant à recentrer le ministère<br />
<strong>de</strong>s Affaires étrangères et européennes sur<br />
le pilotage stratégique <strong>de</strong> l’APD et confier <strong>de</strong><br />
nouvelles tâches opérationnelles à l’AFD. Ils<br />
confortent le rôle du MAEE, comme celui <strong>de</strong>s<br />
ambassa<strong>de</strong>urs, dans l’animation et la coordination<br />
du dispositif français <strong>de</strong> coopération (voir<br />
ci-après). Le CICID <strong>de</strong> 2005, dans le même<br />
sens, met en place les documents cadres <strong>de</strong><br />
partenariats (DCP - voir ci-après), élaborés<br />
avec les pays bénéficiaires pour accompagner<br />
les initiatives <strong>de</strong> tous les acteurs engagés dans<br />
le développement. Les DCP, «principal outil<br />
<strong>de</strong> dialogue avec chaque Etat <strong>de</strong> la ZSP et <strong>de</strong><br />
programmation indicative à 5 ans », sont soumis<br />
à la Conférence d’orientation stratégique<br />
et <strong>de</strong> programmation (COSP), chargée d’en<br />
examiner le contenu. En 2006, la France a élaboré<br />
un plan d’action en 12 propositions pour<br />
la mise en œuvre <strong>de</strong> la Déclaration <strong>de</strong> Paris sur<br />
l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong>. Ce plan a été validé par la<br />
COSP en décembre 2006. La France s’est faite<br />
l’avocat <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> division du travail ce<br />
qui a contribué à l’adoption en mai 2007 du<br />
Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> conduite sur la division du travail entre<br />
bailleurs européens.<br />
3<br />
dépenses du ministère <strong>de</strong> la Défense à <strong>de</strong>s fins civiles et dépenses diverses<br />
12
L’ai<strong>de</strong> au développement<br />
Fiche 1.1. L’Ai<strong>de</strong> Publique au <strong>Développement</strong><br />
Complément d’information :<br />
www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/<br />
pdf/12_P._SANS_REPERE_BD.pdf<br />
Les formes <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />
La France, comme la plupart <strong>de</strong>s bailleurs <strong>de</strong><br />
fonds internationaux, répond aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> ses partenaires du Sud à travers trois grands<br />
types d’instruments d’ai<strong>de</strong> :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
l’ai<strong>de</strong> projet : Cette ai<strong>de</strong> répond à <strong>de</strong>s<br />
besoins d’investissements ciblés, exprimés<br />
au niveau local comme au niveau national.<br />
Le bailleur <strong>de</strong> fonds s’assure <strong>de</strong> la bonne<br />
affectation <strong>de</strong>s fonds à chaque étape du<br />
projet (mise en œuvre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s, revue <strong>de</strong>s<br />
marchés publics, suivi <strong>de</strong>s travaux, etc.) et<br />
liqui<strong>de</strong> le plus souvent lui-même la dépense<br />
(paiement <strong>de</strong>s fournisseurs) ;<br />
l’ai<strong>de</strong> budgétaire affectée (parfois appelée<br />
ai<strong>de</strong>-programme) : Ce type d’ai<strong>de</strong> consiste<br />
en <strong>de</strong>s financements directs <strong>de</strong> politiques<br />
sectorielles <strong>de</strong>s États bénéficiaires. L’octroi<br />
<strong>de</strong> ce type d’ai<strong>de</strong> nécessite l’existence <strong>de</strong><br />
politiques sectorielles crédibles dans les<br />
secteurs appuyés, ainsi que d’un bon cadrage<br />
macro-économique, et d’un dispositif fiable<br />
<strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> la chaîne <strong>de</strong>s dépenses dans<br />
le budget <strong>de</strong> l’État ou le fonds concerné. Elle<br />
prend souvent la forme <strong>de</strong> versements dans<br />
<strong>de</strong>s pots communs (« basket funding ») <strong>de</strong><br />
programmes sectoriels associant tous les<br />
bailleurs. Ces fonds sont inscrits au budget,<br />
mais peuvent avoir leurs propres règles <strong>de</strong><br />
fonctionnement. C’est l’instrument privilégié<br />
<strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> désen<strong>de</strong>ttement et développement<br />
(C2D) ;<br />
l’ai<strong>de</strong> budgétaire globale : C’est une ai<strong>de</strong><br />
avec versement <strong>de</strong>s fonds directement dans<br />
le compte du Trésor du pays bénéficiaire en<br />
appui à sa politique <strong>de</strong> développement. Cette<br />
ai<strong>de</strong> relève en premier lieu d’une approche<br />
macro-économique : en fonction <strong>de</strong> la politique<br />
économique du pays concerné (niveau<br />
<strong>de</strong>s recettes fiscales, volumes <strong>de</strong> dépenses,<br />
etc.) et <strong>de</strong> sa stratégie <strong>de</strong> développement<br />
et <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong> la pauvreté, elle évalue<br />
le déficit <strong>de</strong> financement du budget sur la<br />
pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> mise en œuvre et contribue à<br />
le combler. Le volume <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> est ensuite<br />
modulé en fonction <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s politiques<br />
économiques et sociales menées par<br />
les pays bénéficiaires. Les indicateurs <strong>de</strong><br />
suivi sont non seulement sectoriels, mais<br />
également macro-économiques. L’octroi <strong>de</strong><br />
ce type d’ai<strong>de</strong> nécessite l’existence <strong>de</strong> poli-<br />
tiques sectorielles crédibles, d’une stratégie<br />
<strong>de</strong> réduction <strong>de</strong> la pauvreté, ainsi que <strong>de</strong><br />
mécanismes permettant <strong>de</strong> s’assurer <strong>de</strong> la<br />
bonne gestion macro-économique du pays<br />
(politique monétaire, budgétaire, <strong>de</strong> change),<br />
approuvée par les institutions multilatérales<br />
(FMI, Banque mondiale).<br />
Par ailleurs, le CICID <strong>de</strong> 2006 a prévu une<br />
contribution <strong>de</strong> solidarité sur les billets<br />
d’avions dont le produit, affecté à un « fonds<br />
<strong>de</strong> solidarité pour le développement » 4 et<br />
estimé à 200 M€ en année pleine, est<br />
<strong>de</strong>stiné à financer <strong>de</strong>s opérations d’ai<strong>de</strong> au<br />
développement dans le secteur <strong>de</strong> la santé.<br />
LE CADRE INSTITUTIONNEL<br />
Le système institutionnel actuel résulte d’une<br />
réforme engagée en 1998, et entrée en vigueur<br />
en 1999. Les principales institutions ont alors<br />
été mises en place, ou leur rôle redéfini. Des<br />
ajustements ont été apportés <strong>de</strong>puis, en particulier<br />
par les décisions <strong>de</strong>s CICID du 20 juillet<br />
2004 et du 18 mai 2005.<br />
Ces institutions sont les suivantes :<br />
-<br />
-<br />
le ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et<br />
européennes, qui est le « pôle diplomatique » ;<br />
le ministère <strong>de</strong> l’Economie et <strong>de</strong>s Finances,<br />
qui est le « pôle financier ».<br />
Ces <strong>de</strong>ux ministères sont chargés <strong>de</strong>s fonctions<br />
<strong>de</strong> définition, <strong>de</strong> gestion ou <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> la<br />
gestion, et <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong> la coopération bilatérale<br />
française.<br />
Le CICID du 20 juillet 2004 a réaffirmé le rôle<br />
du ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et européennes<br />
en matière <strong>de</strong> pilotage stratégique<br />
<strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> publique au développement, et a<br />
défini la mission du ministre délégué chargé<br />
<strong>de</strong> la coopération et du développement : sous<br />
l’autorité du Ministre <strong>de</strong>s Affaires étrangères<br />
et européennes, il coordonne les différents<br />
acteurs <strong>de</strong> la coopération française, veille à la<br />
bonne réalisation <strong>de</strong>s prévisions et informe<br />
régulièrement le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République et<br />
le Gouvernement <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong>s objectifs<br />
quantitatifs et qualitatifs.<br />
4<br />
UNITAID, adopté par 79 Etats lors du sommet <strong>de</strong> New York (14/09/2005) sur la réalisation <strong>de</strong>s OMD - en France : loi <strong>de</strong><br />
finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720) - article 22<br />
13
-<br />
le Comité interministériel <strong>de</strong> la coopération<br />
internationale et du développement<br />
(CICID), qui est chargé <strong>de</strong> la coordination<br />
gouvernementale.<br />
Le CICID 5 a vocation à offrir un cadre <strong>de</strong> coordination,<br />
<strong>de</strong> réflexion, <strong>de</strong> débat et d’orientation<br />
sur la coopération internationale. Il est présidé<br />
par le Premier Ministre, et composé <strong>de</strong>s 12<br />
ministres les plus directement concernés par<br />
les questions <strong>de</strong> développement (tout ministre<br />
du Gouvernement peut être appelé à participer<br />
à une réunion du CICID, en tant que <strong>de</strong> besoin).<br />
Un représentant du Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République<br />
prend part à ses travaux. Le CICID se réunit au<br />
moins une fois par an. Le ministère <strong>de</strong>s Affaires<br />
étrangères et européennes et le ministère<br />
<strong>de</strong> l’Économie, <strong>de</strong>s Finances et <strong>de</strong> l’Industrie<br />
en assurent conjointement le secrétariat<br />
permanent.<br />
Le CICID détermine les axes prioritaires <strong>de</strong> la<br />
politique française d’ai<strong>de</strong> au développement<br />
et, d’une manière plus générale, fixe la doctrine<br />
française en matière <strong>de</strong> coopération. Il<br />
définit la Zone <strong>de</strong> solidarité prioritaire (ZSP)<br />
regroupant les pays <strong>de</strong> concentration <strong>de</strong> la<br />
coopération française. Il fixe les orientations<br />
relatives aux objectifs et aux modalités <strong>de</strong> la<br />
politique <strong>de</strong> coopération internationale et<br />
d’ai<strong>de</strong> au développement dans toutes ses composantes<br />
bilatérales et multilatérales. Il veille<br />
à la cohérence <strong>de</strong>s priorités géographiques et<br />
sectorielles <strong>de</strong>s diverses composantes <strong>de</strong> la<br />
coopération. Il assure une mission permanente<br />
<strong>de</strong> suivi et d’évaluation <strong>de</strong> la conformité aux<br />
objectifs fixés et aux moyens assignés <strong>de</strong>s<br />
politiques et <strong>de</strong>s instruments <strong>de</strong> la coopération<br />
internationale et <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> au développement. Il<br />
définit les secteurs prioritaires d’intervention.<br />
-<br />
la Conférence d’orientation stratégique et<br />
<strong>de</strong> programmation (COSP), qui est chargée<br />
<strong>de</strong> la programmation <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> française.<br />
une programmation indicative <strong>de</strong>s ressources<br />
allouées par pays et par secteur et veille à la<br />
cohérence entre les ai<strong>de</strong>s bilatérales, européennes<br />
et multilatérales, sur la base d’une revue <strong>de</strong><br />
la qualité <strong>de</strong>s opérations réalisées et en prenant<br />
en compte les critères d’allocation <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong>.<br />
Elle examine les projections françaises d’APD<br />
et le document <strong>de</strong> politique transversale. Elle<br />
coordonne les actions <strong>de</strong> communication.<br />
-<br />
l’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />
(AFD), qui est l’opérateur pivot pour l’ai<strong>de</strong><br />
bilatérale au développement.<br />
L’AFD est une institution financière spécialisée,<br />
une banque <strong>de</strong> développement, placée sous la<br />
tutelle <strong>de</strong>s ministères chargés <strong>de</strong> l’Économie et<br />
<strong>de</strong>s Finances, <strong>de</strong>s Affaires étrangères et européennes<br />
et <strong>de</strong> l’Outre mer. L’AFD intervient<br />
dans l’ensemble <strong>de</strong>s collectivités d’outre-mer<br />
(COM) et <strong>de</strong>s pays <strong>de</strong> la zone <strong>de</strong> solidarité<br />
prioritaire.<br />
Les statuts <strong>de</strong> l’AFD ont été modifiés par décret<br />
(2006-530) du 9 mai 2006. Une convention<br />
cadre avec l’Etat et <strong>de</strong>s contrats d’objectifs,<br />
assortis d’indicateurs <strong>de</strong> suivi, ont été signés,<br />
respectivement le 4 et le 12 janvier 2007.<br />
Ils ont pour objectif <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r un dialogue<br />
autour <strong>de</strong>s stratégies <strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong> sur la base<br />
<strong>de</strong>s résultats obtenus. Dans ce cadre l’AFD<br />
a élaboré son second projet d’orientation<br />
stratégique 2007-2011 (POS2) qui constitue<br />
une déclinaison opérationnelle <strong>de</strong>s contrats<br />
d’objectifs.<br />
-<br />
le Conseil Stratégique <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> publique<br />
au développement, qui a remplacé, <strong>de</strong>puis<br />
le 1er avril 2008, le Haut Conseil <strong>de</strong> la<br />
coopération internationale (HCCI), qui était<br />
l’instance <strong>de</strong> concertation <strong>de</strong>s acteurs <strong>de</strong> la<br />
coopération et solidarité internationale avec<br />
la société civile.<br />
Elle a été créée en 1984. Elle est présidée par le<br />
ministre chargé <strong>de</strong> la coopération, et se réunit<br />
au moins une fois par an. Son rôle a été défini<br />
par le CICID du 18 mai 2005.<br />
-<br />
La Commission nationale <strong>de</strong> la coopération<br />
décentralisée (CNCD), qui est<br />
l’instance <strong>de</strong> concertation avec les collectivités<br />
territoriales.<br />
La COSP, préparée par le co-secrétariat du<br />
CICID, réunit les acteurs publics <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />
française. Elle arrête les orientations <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />
française en validant <strong>de</strong>s documents cadres<br />
<strong>de</strong> partenariat pour les pays <strong>de</strong> la ZSP et en<br />
adoptant <strong>de</strong>s stratégies sectorielles. Elle établit<br />
La CNCD 6 rassemble à parité <strong>de</strong>s représentants<br />
<strong>de</strong>s associations nationales <strong>de</strong> collectivités territoriales<br />
et <strong>de</strong> tous les Ministères concernés par<br />
la coopération décentralisée. Elle est présidée<br />
par le Premier ministre et en son absence par le<br />
ministre chargé <strong>de</strong> la coopération.<br />
5<br />
créé par le décret n° 98-66 du 4 février 1998<br />
6<br />
article L 1115-6 du Co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivités territoriales ; décret n° 94-937 du 24 octobre 1994 , modifié par le décret du 9 mai 2006<br />
14
L’ai<strong>de</strong> au développement<br />
Fiche 1.1. L’Ai<strong>de</strong> Publique au <strong>Développement</strong><br />
Elle peut formuler toutes propositions visant à<br />
améliorer et renforcer les modalités d’exercice<br />
<strong>de</strong> la coopération décentralisée. Son secrétariat<br />
est assuré par le Délégué pour l’action<br />
extérieure <strong>de</strong>s collectivités locales (DAECL),<br />
qui est nommé en Conseil <strong>de</strong>s Ministres, et<br />
rattaché au ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et<br />
européennes.<br />
La CNCD est également tenue d’établir et <strong>de</strong><br />
tenir à jour un état <strong>de</strong> la coopération décentralisée<br />
menée par les collectivités territoriales.<br />
A ce titre, l’article 6 du Décret du 24 octobre<br />
1994 prévoit que « les collectivités territoriales<br />
tiennent la Commission informée <strong>de</strong> tout acte<br />
<strong>de</strong> coopération entrant dans le cadre du titre IV<br />
<strong>de</strong> la loi du 6 février 1992 susvisée, conclu avec<br />
les collectivités territoriales étrangères et leurs<br />
groupements. La commission collecte et met à<br />
jour en tant que <strong>de</strong> besoin cette information ».<br />
Outre le secrétariat <strong>de</strong> la CNCD, le DAECL est<br />
chargé <strong>de</strong>s missions ainsi définies :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
recueillir les informations concernant les<br />
relations entretenues par les collectivités<br />
territoriales françaises avec <strong>de</strong>s collectivités<br />
locales étrangères, en faire l’analyse et appeler<br />
l’attention du Gouvernement sur les<br />
problèmes qui peuvent se poser à cet égard ;<br />
apporter un concours aux préfets pour tout<br />
ce qui touche à l’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités<br />
territoriales ;<br />
être, en liaison aves les préfets, le conseil<br />
<strong>de</strong>s collectivités territoriales en matière <strong>de</strong><br />
relations avec l’extérieur ;<br />
assurer une action générale <strong>de</strong> coordination<br />
entre les différents services et administrations<br />
centrales <strong>de</strong> l’Etat, notamment ceux du ministère<br />
<strong>de</strong> l’Intérieur et <strong>de</strong> la Décentralisation et<br />
ceux du ministère <strong>de</strong>s Affaires Etrangères,<br />
pour les problèmes touchant à l’action extérieure<br />
<strong>de</strong>s collectivités territoriales.<br />
Depuis 2007, la Délégation pour l’Action<br />
Extérieure <strong>de</strong>s Collectivités Locales a mis en<br />
place à cette fin une base <strong>de</strong> données en ligne,<br />
qui est alimentée par les collectivités territoriales<br />
elles-mêmes (voir fiche 5.1.).<br />
Le DAECL est enfin chargé d’établir chaque<br />
année un rapport d’activité au Ministre <strong>de</strong> l’Intérieur<br />
et au Ministre <strong>de</strong>s Affaires étrangères et<br />
européennes.<br />
M. Antoine Joly est Délégué <strong>de</strong>puis juillet 2003.<br />
-<br />
France Coopération Internationale (FCI),<br />
qui est un opérateur.<br />
FCI est un groupement d’intérêt public créé en<br />
2002 par le ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et<br />
européennes et placé sous la double tutelle <strong>de</strong><br />
ce ministère et <strong>de</strong> celui <strong>de</strong> la fonction publique.<br />
D’abord limité à la facilitation <strong>de</strong> la présence <strong>de</strong><br />
l’expertise française sur les missions d’assistance<br />
technique <strong>de</strong> courte et moyenne durée et à<br />
l’appui aux opérateurs français publics et privés<br />
travaillant sur <strong>de</strong>s financements multilatéraux,<br />
FCI prend <strong>de</strong>puis 2004 également en charge<br />
l’expertise internationale <strong>de</strong> longue durée.<br />
La répartition <strong>de</strong>s attributions entre<br />
le MAEE et l’AFD<br />
Le MAEE est compétent, pour les opérations<br />
<strong>de</strong> dons et l’assistance technique, dans les<br />
domaines <strong>de</strong> la gouvernance (soutien à l’Etat <strong>de</strong><br />
droit, réforme <strong>de</strong> l’Etat, gouvernance institutionnelle<br />
et financière, définition <strong>de</strong>s politiques<br />
publiques) ; <strong>de</strong> la coopération décentralisée<br />
et non gouvernementale ; <strong>de</strong> l’appui à la francophonie<br />
et à l’enseignement du français ; <strong>de</strong><br />
la coopération culturelle et scientifique ; <strong>de</strong> la<br />
formation, <strong>de</strong> l’enseignement supérieur et <strong>de</strong> la<br />
recherche.<br />
Il gère uniquement <strong>de</strong>s dons et subventions.<br />
L’AFD a vu son champ d’intervention étendu<br />
par le CICID du 20 juillet 2004.<br />
S’agissant <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> dons gérées par le<br />
Fonds <strong>de</strong> solidarité prioritaire (FSP), le domaine<br />
d’intervention <strong>de</strong> l’AFD s’exerce désormais dans<br />
les secteurs suivants (avec l’assistance technique<br />
associée): agriculture et développement rural ;<br />
santé et éducation <strong>de</strong> base ; formation professionnelle<br />
; environnement ; secteur privé ;<br />
infrastructures et développement urbain.<br />
Outre les activités dites pour son propre compte,<br />
l’AFD exerce, dans le cadre <strong>de</strong> l’article 5 <strong>de</strong> ses<br />
statuts, un certain nombre <strong>de</strong> missions dites<br />
« pour le compte <strong>de</strong> l’État ». L’<strong>Agence</strong> assure<br />
ainsi la gestion <strong>de</strong>s prêts et dons du Trésor. Elle<br />
assume également un rôle d’opérateur sur <strong>de</strong>s<br />
projets situés en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la ZSP. Elle assure<br />
le financement <strong>de</strong> la facilité du FMI pour la<br />
réduction <strong>de</strong> la pauvreté et l’amélioration <strong>de</strong><br />
la croissance. Elle gère le Fonds français pour<br />
l’environnement mondial. L’agence s’est en<br />
outre vu confier pour les pays <strong>de</strong> la ZSP la mise<br />
en œuvre <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> désen<strong>de</strong>ttementdéveloppement<br />
(C2D).<br />
15
La revue générale <strong>de</strong>s politiques<br />
publiques (RGPP)<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> la réforme <strong>de</strong> l’État, une revue<br />
générale <strong>de</strong>s politiques publiques a été lancée<br />
en juin 2007. Elle a un objectif général <strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong>rnisation, concernant :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
la simplification du droit et <strong>de</strong>s procédures ;<br />
le développement <strong>de</strong> l’administration<br />
électronique ;<br />
l’amélioration <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong><br />
gestion et <strong>de</strong>s systèmes d’information ;<br />
la réorganisation <strong>de</strong> l’État à l’échelon local ;<br />
et la professionnalisation <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s<br />
ressources humaines.<br />
La revue est placée sous la responsabilité du<br />
Ministre du Budget, <strong>de</strong>s Comptes publics et<br />
<strong>de</strong> la Fonction publique et du Secrétaire d’État<br />
chargé <strong>de</strong> la Prospective économique et <strong>de</strong><br />
l’Evaluation <strong>de</strong>s politiques publiques.<br />
Cette revue porte en particulier sur les politiques<br />
d’ai<strong>de</strong> au développement. Dans ce cadre,<br />
trois catégories <strong>de</strong> transferts d’activités du<br />
MAEE vers l’AFD sont retenues :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
transfert du sol<strong>de</strong> d’activités dans les domaines<br />
du développement économique, social et<br />
environnemental restés sous la responsabilité<br />
du MAEE lors <strong>de</strong> la précé<strong>de</strong>nte réforme <strong>de</strong><br />
2004-2005,<br />
transfert d’une partie <strong>de</strong>s activités relevant <strong>de</strong>s<br />
domaines <strong>de</strong> la gouvernance (gouvernance<br />
financière, décentralisation et gouvernance<br />
locale, environnement <strong>de</strong>s affaires et appuis<br />
au secteur privé)<br />
transfert <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s dispositifs prévus<br />
en matière <strong>de</strong> financement <strong>de</strong>s ONG et <strong>de</strong><br />
fonds post-crise.<br />
Le cadre budgétaire <strong>de</strong> la LOLF<br />
La loi organique sur les lois <strong>de</strong> finances, qui a<br />
profondément réformé l’organisation budgétaire<br />
<strong>de</strong> l’Etat, s’impose à la gestion <strong>de</strong> l’APD.<br />
Trois documents <strong>de</strong> politique transversale<br />
concernent les thèmes <strong>de</strong> ce gui<strong>de</strong> : l’action<br />
extérieure <strong>de</strong> l’Etat, la politique française en<br />
faveur du développement et l’outre-mer.<br />
La politique en faveur du développement<br />
comporte 12 programmes, dont <strong>de</strong>ux relèvent<br />
<strong>de</strong> la DGCID (« Solidarité à l’égard <strong>de</strong>s pays en<br />
développement » et « Rayonnement culturel<br />
et scientifique »), et quatre du Trésor (« Ai<strong>de</strong><br />
économique et financière au développement »,<br />
«Prêts à l’AFD en vue <strong>de</strong> favoriser le développement<br />
économique et social dans <strong>de</strong>s Etats<br />
étrangers », « Prêts à <strong>de</strong>s Etats étrangers, <strong>de</strong> la<br />
Réserve <strong>de</strong>s pays émergents, en vue <strong>de</strong> faciliter<br />
la réalisation <strong>de</strong> projets d’infrastructure »,<br />
« Prêts à <strong>de</strong>s Etats étrangers pour consolidation<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ttes envers la France »).<br />
Le programme « Solidarité à l’égard <strong>de</strong>s pays en<br />
développement » (Programme 209) représente<br />
68 % <strong>de</strong>s crédits <strong>de</strong> la mission interministérielle<br />
« Ai<strong>de</strong> publique au développement ».<br />
Pour chacun <strong>de</strong>s programmes, <strong>de</strong>s objectifs<br />
sont fixés, assortis <strong>de</strong> critères <strong>de</strong> performance.<br />
Par exemple, dans le cadre du programme<br />
« Solidarité à l’égard <strong>de</strong>s pays en développement<br />
», pour l’un <strong>de</strong>s 4 objectifs (contribuer<br />
à la réalisation <strong>de</strong>s Objectifs du Millénaire), 2<br />
indicateurs ont été fixés : proportion <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />
gérée par le MAE dirigée vers l’Afrique subsaharienne,<br />
les PMA et la ZSP ; et amélioration <strong>de</strong><br />
l’accès à l’éducation <strong>de</strong> base.<br />
LES DOCUMENTS CADRES DE<br />
PARTENARIAT (DCP)<br />
Pour donner suite aux engagements pris lors <strong>de</strong><br />
la Conférence <strong>de</strong> Monterey sur le renforcement<br />
du partenariat mondial pour le développement,<br />
les institutions financières internationales et<br />
les représentants <strong>de</strong>s pays donateurs se sont<br />
réunis à Rome en février 2003, et ont adopté<br />
la Déclaration <strong>de</strong> Rome sur l’harmonisation <strong>de</strong><br />
l’ai<strong>de</strong>. A suivi, en mars 2005, la Déclaration <strong>de</strong><br />
Paris sur l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> au développement,<br />
qui comprend 56 engagements réciproques <strong>de</strong>s<br />
bailleurs et <strong>de</strong>s pays partenaires pour améliorer<br />
la qualité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> et son impact sur le développement.<br />
Parmi ces objectifs et engagements,<br />
figure l’harmonisation <strong>de</strong> leurs actions par les<br />
donneurs, et la mise en place <strong>de</strong> dispositifs<br />
d’intervention communs.<br />
Dans le cadre du Plan d‘action français pour le<br />
renforcement <strong>de</strong> l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> et la mise<br />
œuvre <strong>de</strong> la Déclaration <strong>de</strong> Paris, la France a<br />
élaboré <strong>de</strong>s documents cadres <strong>de</strong> partenariat<br />
(DCP), qui se sont substitués, en 2005, aux<br />
documents <strong>de</strong> stratégie pays (DSP), créés en<br />
2000.<br />
Le DCP est un plan d’action, d’une durée <strong>de</strong> 5<br />
ans, conclu entre la France et le pays bénéficiaire.<br />
Outre la coordination entre acteurs français, il<br />
16
L’ai<strong>de</strong> au développement<br />
Fiche 1.1. L’Ai<strong>de</strong> Publique au <strong>Développement</strong><br />
prend en compte les principes d’alignement<br />
sur les priorités <strong>de</strong>s pays partenaires, l’harmonisation<br />
et la complémentarité entre bailleurs,<br />
et la concentration et la prévisibilité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />
française.<br />
Dans les secteurs d’intervention ayant fait<br />
l’objet d’une stratégie approuvée en CICID,<br />
concourant aux OMD (l’éducation ; l’eau et<br />
l’assainissement ; la santé et la lutte contre le<br />
SIDA ; l’agriculture et la sécurité alimentaire ;<br />
les infrastructures ; la protection <strong>de</strong> l’environnement<br />
et <strong>de</strong> la biodiversité ; le développement<br />
du secteur productif), le DCP i<strong>de</strong>ntifie <strong>de</strong> un à<br />
trois <strong>de</strong> ces secteurs qui <strong>de</strong>vront concentrer<br />
80 % <strong>de</strong>s décaissements et <strong>de</strong>s nouveaux engagements<br />
<strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> bilatérale française. Les 20 %<br />
restants peuvent faire l’objet d’interventions<br />
hors <strong>de</strong>s secteurs <strong>de</strong> concentration. Le choix<br />
<strong>de</strong>s secteurs prend en compte la stratégie<br />
<strong>de</strong>s autres bailleurs et notamment <strong>de</strong> l’Union<br />
européenne. Il est à noter que, pour la première<br />
génération <strong>de</strong>s DCP signés, cette répartition a<br />
été appréciée d’une manière assez souple.<br />
Le DCP inclut également les actions dans les<br />
secteurs, dits transversaux, <strong>de</strong> la gouvernance,<br />
<strong>de</strong> la coopération scientifique et universitaire,<br />
<strong>de</strong> la francophonie et <strong>de</strong> la coopération culturelle.<br />
Le DCP doit aussi prendre en compte<br />
les approches régionales et les questions <strong>de</strong><br />
migrations.<br />
En Afrique, les DCP sont établis en conformité<br />
avec les principes du NEPAD.<br />
L’élaboration et l’exécution du DCP sont coordonnées<br />
par l’ambassa<strong>de</strong>ur, au niveau local.<br />
Les acteurs français représentés dans le pays y<br />
sont associés. Il est ensuite soumis à un examen<br />
interministériel, auquel participent <strong>de</strong>s représentants<br />
du Ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères<br />
et européennes du Ministère <strong>de</strong> l’Economie et<br />
<strong>de</strong>s Finances, <strong>de</strong> l’AFD, et <strong>de</strong>s autres ministères<br />
concernés.<br />
Ils sont alors retournés à l’ambassa<strong>de</strong>, qui<br />
engage les négociations avec les autorités du<br />
pays partenaire, en vue <strong>de</strong> leur signature.<br />
-<br />
l’annexe 3 contient la programmation indicative<br />
<strong>de</strong>s actions, en précisant les actions,<br />
les opérateurs, le calendrier, la nature du<br />
financement (don ou prêt), les enveloppes.<br />
Les DCP font l’objet d’un ren<strong>de</strong>z-vous annuel<br />
avec le partenaire. Au bout <strong>de</strong> 2 à 3 ans, une<br />
revue à mi-parcours permettra un bilan plus<br />
complet et l’actualisation si nécessaire du DCP.<br />
34 DCP ont été signés au 15 janvier 2008 (ils<br />
sont publiés sur le site du MAEE, avec leurs<br />
<strong>de</strong>ux premières annexes).<br />
Les collectivités territoriales, qui étaient<br />
associées aux commissions mixtes paritaires<br />
qui avaient une fonction similaire <strong>de</strong> négociation<br />
avec le pays partenaire, ont fortement<br />
exprimé le souhait d’être, sinon associées à la<br />
préparation <strong>de</strong>s DCP, au moins consultées et<br />
informées. Les travaux <strong>de</strong> préparation <strong>de</strong>s DCP<br />
<strong>de</strong> la première génération n’ont pas répondu<br />
à ce souhait. Il est à noter, cependant, que<br />
les collectivités françaises ne sont pas encore<br />
engagées par les DCP, même s’il serait logique<br />
et souhaitable qu’elles le soient à terme. Elles<br />
<strong>de</strong>vraient alors faire figurer leurs projets dans<br />
les annexes <strong>de</strong>s DCP, ce qui les contraindraient<br />
à une programmation aussi rigoureuse que celle<br />
<strong>de</strong>s acteurs étatiques, et à une présentation<br />
<strong>de</strong> leurs différentes actions selon les secteurs<br />
retenus par le DCP <strong>de</strong> chaque pays.<br />
D’ores et déjà, une partie <strong>de</strong>s financements<br />
mobilisés dans le cadre <strong>de</strong> la coopération<br />
décentralisée figure dans les DCP : c’est le cas du<br />
FSD (une ligne <strong>de</strong> l’annexe 3) et <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong><br />
l’AFD associant <strong>de</strong>s collectivités territoriales.<br />
La CNCD tenue le 19 septembre 2007 a<br />
préconisé les <strong>de</strong>ux mesures suivantes, qui<br />
ont été adoptées par le Secrétaire d’État à la<br />
Coopération et à la Francophonie :<br />
-<br />
-<br />
l’ajout aux DCP d’une annexe relative à la<br />
coopération décentralisée ;<br />
l’association <strong>de</strong>s collectivités territoriales à la<br />
revue à mi-parcours.<br />
Le DCP comporte 3 annexes :<br />
-<br />
-<br />
l’annexe 1 présente l’articulation stratégique<br />
<strong>de</strong>s interventions françaises avec les priorités<br />
du pays partenaire ;<br />
l’annexe 2 présente l’articulation <strong>de</strong>s interventions<br />
françaises avec celles <strong>de</strong>s autres<br />
bailleurs et agences <strong>de</strong> développement ;<br />
17
Fiche 1.2. Les financements français <strong>de</strong>stinés à l’action<br />
extérieure <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />
Pour financer leurs actions extérieures, les<br />
collectivités territoriales mobilisent principalement<br />
leurs propres ressources. Elles peuvent<br />
cependant obtenir <strong>de</strong>s cofinancements <strong>de</strong> la<br />
part du Ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et<br />
européennes.<br />
Jusqu’en 2006, trois outils <strong>de</strong> financement<br />
étaient proposés :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
<strong>de</strong>s crédits délégués aux préfets <strong>de</strong>s 17<br />
régions ayant passé avec l’Etat un contrat <strong>de</strong><br />
plan pour accor<strong>de</strong>r aux collectivités <strong>de</strong> chaque<br />
région <strong>de</strong>s cofinancements aux actions<br />
<strong>de</strong> coopération décentralisée <strong>de</strong>stinée à <strong>de</strong>s<br />
pays bénéficiaires <strong>de</strong> l’APD ;<br />
<strong>de</strong>s crédits, également délégués aux préfets,<br />
mais hors contrats <strong>de</strong> plan ;<br />
<strong>de</strong>s crédits « FSP mobilisateurs ».<br />
Par ailleurs, en 2006, une expérimentation<br />
a été tentée. Des crédits ont été délégués<br />
aux ambassa<strong>de</strong>s <strong>de</strong> plusieurs pays , dont ceux<br />
dans lesquels la coopération décentralisée est<br />
la plus développée : le Mali, le Burkina Faso et<br />
le Sénégal. Il est apparu que ce mécanisme est<br />
complexe à mettre en œuvre, et ne répond<br />
pas <strong>de</strong> manière plus appropriée aux besoins <strong>de</strong><br />
cofinancement <strong>de</strong>s collectivités territoriales ;<br />
l’expérience ne sera donc pas reconduite, mais<br />
les cofinancements pluri-annuels déjà accordés<br />
seront exécutés jusqu’à leur terme.<br />
Les appels à projets <strong>de</strong> la DAECL<br />
Les financements du MAEE ont été réorganisés<br />
en 2006, afin <strong>de</strong> substituer une logique <strong>de</strong><br />
partenariat à l’ancienne logique <strong>de</strong> guichet,<br />
<strong>de</strong> donner plus <strong>de</strong> lisibilité aux financements<br />
apportés par le MAEE, et <strong>de</strong> mobiliser plus<br />
efficacement le savoir-faire et les compétences<br />
<strong>de</strong>s collectivités territoriales.<br />
Pour la première fois, trois appels à contrats ont<br />
été lancés le 19 octobre 2006, avec l’agrément<br />
<strong>de</strong> la CNCD : <strong>de</strong>ux d’entre eux concernaient les<br />
pays en développement, l’un pour une pério<strong>de</strong><br />
annuelle, l’autre pour une pério<strong>de</strong> triennale.<br />
(Le troisième appel concernait <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong><br />
coopération européenne.) Les réponses ont<br />
été reçues fin février, et les décisions <strong>de</strong> financement<br />
ont été notifiées fin mai 2007.<br />
Les projets <strong>de</strong>vaient concerner <strong>de</strong>s pays éligibles<br />
à l’APD, et s’inscrire dans les thématiques<br />
suivantes :<br />
-<br />
-<br />
l’appui institutionnel à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s centres<br />
urbains, avec l’objectif <strong>de</strong> favoriser l’échange<br />
<strong>de</strong> savoir-faire et d’éclairer l’approche française<br />
pluridisciplinaire du développement<br />
urbain ;<br />
l’appui institutionnel dans le domaine du<br />
développement rural durable (notamment le<br />
tourisme solidaire).<br />
Les critères <strong>de</strong> sélection <strong>de</strong>s projets étaient en<br />
particulier : l’« effet <strong>de</strong> levier » que la subvention<br />
pourrait avoir, en particulier au regard <strong>de</strong> la<br />
mobilisation <strong>de</strong>s crédits <strong>de</strong> l’Union Européenne<br />
ou <strong>de</strong> l’AFD, les actions innovantes dans le<br />
secteur <strong>de</strong>s TIC, les projets « mutualisés »<br />
(associant plusieurs collectivités).<br />
283 projets ont été déposés, représentant une<br />
dépense globale <strong>de</strong> 79 M€, dont une <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> subvention <strong>de</strong> 24 M€ (soit 34 %).<br />
245 projets ont été retenus, s’inscrivant totalement<br />
ou partiellement dans les thématiques<br />
retenues. Ils représentent une dépense globale<br />
<strong>de</strong> 60 M€, incluant un montant total <strong>de</strong> subvention<br />
<strong>de</strong> 17 M€ (soit 30 %).<br />
Ces projets émanent <strong>de</strong> 19 régions, 30<br />
départements, 88 communes et 29 structures<br />
intercommunales. Ils sont principalement <strong>de</strong>stinés<br />
à l’Afrique subsaharienne (57 %), et, dans<br />
<strong>de</strong>s proportions beaucoup moins importantes<br />
à l’Asie (15 %), à l’Afrique du Nord (8 %) et au<br />
Moyen Orient (4 %).<br />
Les projets concernent principalement l’appui<br />
institutionnel, dans toutes les régions <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>stination, et, dans <strong>de</strong> moindres mesures, le<br />
développement durable et le développement<br />
économique.<br />
Un nouvel appel à propositions pour une<br />
pério<strong>de</strong> annuelle a été lancé fin 2007 pour<br />
2008. Le format est assez similaire au précé<strong>de</strong>nt.<br />
Toutefois, un critère supplémentaire a<br />
été ajouté : seront favorisés les projets <strong>de</strong>stinés<br />
à <strong>de</strong>s pays où il existe un vrai processus <strong>de</strong><br />
décentralisation.<br />
18
L’ai<strong>de</strong> au développement<br />
Fiche 1.2. Les financements français <strong>de</strong>stinés à l’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />
Le Fonds <strong>de</strong> Solidarité Prioritaire<br />
(FSP)<br />
Certains projets d’appui à la gouvernance<br />
locale, financés par le FSP, prévoient un volet <strong>de</strong><br />
soutien à la coopération décentralisée intervenant<br />
dans ce domaine. Le projet emblématique<br />
<strong>de</strong> cette démarche est le Projet d’Appui à la<br />
Décentralisation (PAD) au Maroc (voir encadré<br />
page 55). Ce projet ayant une vocation très<br />
large, les appels à projets lancés par la DAECL<br />
excluent <strong>de</strong> cofinancer d’autres actions <strong>de</strong><br />
coopération décentralisée au Maroc.<br />
D’autres projets, sur <strong>de</strong>s thématiques particulières,<br />
ont également vocation à soutenir<br />
la coopération décentralisée. C’est le cas du<br />
Programme concerté Santé Mali (PCSM - voir<br />
encadré page 54) ou FSP décentralisation Haïti<br />
ouvert à la coopération décentralisée sur la<br />
formation.<br />
Le Fonds social <strong>de</strong> développement<br />
(FSD)<br />
Des crédits déconcentrés sont gérés par certaines<br />
ambassa<strong>de</strong>s dans les pays bénéficiaires <strong>de</strong><br />
l’APD. Ces crédits sont <strong>de</strong>stinés à cofinancer<br />
les projets <strong>de</strong> personnes morales, publiques<br />
ou privées, dont, notamment, les collectivités<br />
locales. Les projets éligibles sont <strong>de</strong>s réalisations<br />
physiques <strong>de</strong> petite dimension dans les secteurs<br />
sociaux et les services collectifs. Les opérations<br />
concourant à la création d’emplois et <strong>de</strong> revenus<br />
sont favorisées.<br />
Le plus souvent, en pratique, les projets bénéficiant<br />
<strong>de</strong> crédits FSD sont <strong>de</strong>s projets isolés.<br />
Leur faisabilité est contrôlée par l’ambassa<strong>de</strong>,<br />
qui peut apporter son appui aux porteurs du<br />
projet pour permettre l’instruction du dossier.<br />
Dans la plupart <strong>de</strong>s pays, un comité consultatif<br />
<strong>de</strong> sélection, comprenant <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong><br />
la société civile (le plus souvent par l’intermédiaire<br />
<strong>de</strong> collectifs d’ONG), a été mis en place<br />
pour examiner les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financement.<br />
Le versement du crédit FSD est, selon la réglementation,<br />
subordonné à une participation <strong>de</strong>s<br />
bénéficiaires, sous forme d’apports financiers,<br />
en nature ou en travail, au moins égale à 30 % du<br />
montant du projet. Cependant, les évaluations<br />
font ressortir que ce critère est généralement<br />
difficile à remplir.<br />
Le montant plafond <strong>de</strong> la subvention est <strong>de</strong><br />
300 000 € (mais les montants moyens accordés<br />
sont beaucoup plus faibles).<br />
Les Fonds bilatéraux <strong>de</strong> coopération<br />
décentralisée<br />
Le premier Fonds <strong>de</strong> cette nature a été créé en<br />
2004 par la France et le Québec. Il est financé à<br />
parité par les <strong>de</strong>ux gouvernements (100 000 €<br />
en 2005, 400 000 en 2006 - 2007). Il a vocation<br />
à soutenir les projets <strong>de</strong> coopération décentralisée<br />
développés dans 4 secteurs retenus <strong>de</strong><br />
commun accord : la culture, la coopération<br />
économique, le développement régional et<br />
local, et la mobilité <strong>de</strong>s 18 - 35 ans. Les projets<br />
sont sélectionnés sur appels à projets. Ils<br />
doivent engager une ou plusieurs collectivités<br />
<strong>de</strong> chaque pays. Trois appels à projets ont déjà<br />
été lancés, en 2005, 2006 et 2007. Ce mécanisme<br />
a permis le développement <strong>de</strong> projets et<br />
d’échanges extrêmement fructueux.<br />
Il a donc été décidé <strong>de</strong> le reproduire avec<br />
certains pays émergents, considérés comme<br />
prioritaires pour la coopération décentralisée,<br />
du point <strong>de</strong> vue économique et culturel. Des<br />
négociations ont été engagées par la DAECL<br />
avec le Mexique (le Fonds est en cours <strong>de</strong><br />
création), le Brésil, le Chili et la Chine. Les discussions<br />
doivent prendre en compte le contexte<br />
particulier <strong>de</strong> chaque pays, et la réceptivité plus<br />
ou moins importante à la démarche <strong>de</strong> la coopération<br />
décentralisée. Ces fonds permettront<br />
cependant à l’Etat d’offrir <strong>de</strong>s financements<br />
incitatifs pour l’intervention <strong>de</strong> collectivités<br />
françaises dans <strong>de</strong>s pays avec lesquels l’Etat<br />
souhaite intensifier les relations bilatérales, tout<br />
en laissant aux collectivités la liberté <strong>de</strong> choisir<br />
l’objet et le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> leur intervention.<br />
Les subventions <strong>de</strong>s ministères<br />
techniques<br />
Les collectivités locales peuvent également<br />
obtenir, pour <strong>de</strong>s opérations particulières, <strong>de</strong>s<br />
subventions <strong>de</strong> certains ministères développant<br />
une action internationale : les ministères<br />
chargés <strong>de</strong>s Finances, <strong>de</strong> l’Agriculture, <strong>de</strong> l’Education,<br />
<strong>de</strong> la Jeunesse et <strong>de</strong>s Sports, <strong>de</strong> la<br />
Culture, <strong>de</strong> l’Aménagement du Territoire, <strong>de</strong><br />
l’Environnement.<br />
19
Fiche 1.3. Les financements européens accessibles aux collectivités<br />
territoriales en matière d’ai<strong>de</strong> au développement<br />
L’évolution <strong>de</strong> la politique européenne<br />
en matière d’ai<strong>de</strong> au développement<br />
La politique <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> l’Union<br />
Européenne est issue du « consensus européen<br />
pour le développement » <strong>de</strong> décembre 2005.<br />
Cette nouvelle politique, qui s’impose non<br />
seulement aux institutions européennes mais<br />
également aux Etats membres, se substitue<br />
à trois politiques précé<strong>de</strong>ntes, qui étaient<br />
<strong>de</strong>stinées à <strong>de</strong>s groupes distincts <strong>de</strong> bénéficiaires<br />
: l’élargissement, le voisinage et le<br />
développement.<br />
La nouvelle politique est <strong>de</strong>stinée à tous les<br />
pays en développement. Elle se fon<strong>de</strong> sur les<br />
principes suivants :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
le partenariat ;<br />
l’appropriation ;<br />
l’alignement ;<br />
le multilatéralisme.<br />
Elle prend en compte les engagements internationaux,<br />
en particulier sur les Objectifs du<br />
Millénaire pour le <strong>Développement</strong> (OMD), et<br />
sur l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> (Déclaration <strong>de</strong> Paris).<br />
Par ailleurs, le Parlement européen sera plus<br />
impliqué dans la définition et le suivi <strong>de</strong> cette<br />
politique.<br />
Les instruments <strong>de</strong> mise en œuvre ont été<br />
simplifiés : 10 nouveaux instruments se substituent<br />
aux 35 précé<strong>de</strong>nts, et le lien entre les<br />
instruments et les politiques est plus explicite.<br />
Parmi les 10 instruments :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
7 sont <strong>de</strong>s instruments géographiques<br />
(supranational/communautaire) : IPA, PEV,<br />
ICD, ICI, stabilité, ai<strong>de</strong> humanitaire, ai<strong>de</strong><br />
macro-financière ;<br />
2 sont <strong>de</strong>s instruments thématiques (supranational/communautaire)<br />
: IEDH, sécurité<br />
nucléaire ;<br />
le FED, qui est financé par les États membres<br />
et a un caractère inter-gouvernemental, est<br />
soumis à ses propres règles financières.<br />
Le 10 e FED<br />
Le Fonds européen <strong>de</strong> développement (FED)<br />
est l’instrument principal <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> communautaire<br />
au développement <strong>de</strong>s pays ACP (Afrique<br />
- Caraïbes - Pacifique) et <strong>de</strong>s PTOM (pays et<br />
territoires d’outre mer). Il est alimenté par <strong>de</strong>s<br />
contributions volontaires <strong>de</strong>s Etats membres,<br />
négociés tous les 5 ans. Le 9e FED, couvrant la<br />
pério<strong>de</strong> 2003 - 2007, et fondé sur l’Accord <strong>de</strong><br />
Cotonou 7 , est venu à échéance fin 2007. Le 10 e<br />
FED s’applique à la pério<strong>de</strong> 2008 - 2013. Il est<br />
régi par « l’Accord <strong>de</strong> Cotonou révisé » 8 .<br />
Son montant a été fixé par le Conseil européen<br />
<strong>de</strong> décembre 2005 à 22,682 milliards d’Euros<br />
(contre 13,8 pour le 9 e ). La clé <strong>de</strong> répartition<br />
du financement entre les Etats membres 9 a<br />
été adoptée par le même Conseil, et par un<br />
accord interne conclu en juillet 2006. Celui-ci a<br />
également arrêté les enveloppes <strong>de</strong>stinées aux<br />
différents pays et aux différents programmes.<br />
Le rôle <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />
Le rôle <strong>de</strong> partenaire dans la coopération au<br />
développement a été reconnu en 2006 :<br />
-<br />
-<br />
en premier lieu par une communication<br />
<strong>de</strong> la Commission, en janvier 2006, sur le<br />
programme thématique « Rôle <strong>de</strong>s acteurs<br />
non-étatiques et <strong>de</strong>s autorités locales dans le<br />
développement » (ANE-AL, voir ci-après) ;<br />
puis par le règlement instituant l’Instrument<br />
<strong>de</strong> Coopération au <strong>Développement</strong> (ICD,<br />
voir ci-après), adopté en décembre 2006.<br />
Plus récemment, une résolution du Parlement<br />
européen, du 15 mars 2007, comporte une<br />
reconnaissance politique du rôle et <strong>de</strong> l’expertise<br />
<strong>de</strong>s collectivités territoriales dans la<br />
coopération au développement, qui doit se traduire<br />
par l’instauration d’un dialogue structuré<br />
entre l’UE et ces collectivités.<br />
Les autorités locales et régionales <strong>de</strong>s Etats<br />
Membres <strong>de</strong> l’UE sont représentées par le<br />
Comité <strong>de</strong>s régions, qui est obligatoirement<br />
consulté par la Commission lors <strong>de</strong>s réflexions<br />
sur 10 thématiques : la cohésion économique<br />
7<br />
conclu le 23 juin 2000<br />
8<br />
février 2005<br />
9<br />
La France elle-même apportera une contribution <strong>de</strong> 19,55 %, soit 4,4 milliards d’Euros. Cette contribution est proportionnellement<br />
plus élevée que la part <strong>de</strong> la France dans le financement <strong>de</strong>s institutions européennes, qui est seulement <strong>de</strong> 15,9 %.<br />
20
L’ai<strong>de</strong> au développement<br />
Fiche 1.3. Les financements européens accessibles aux collectivités territoriales en matière d’ai<strong>de</strong> au développement<br />
et sociale, la santé, l’éducation, la culture et<br />
l’audiovisuel, l’emploi, la politique sociale, les<br />
fonds structurels, l’environnement, la formation<br />
professionnelle, les transports.<br />
Les collectivités françaises sont représentées<br />
par la Maison européenne <strong>de</strong>s pouvoirs locaux<br />
français, mise en place par l’ADF, l’AMF,<br />
l’AMGF, l’APVF et la FMVM, et avec laquelle<br />
CUF coopère. Cette institution a un double<br />
rôle :<br />
-<br />
-<br />
l’information <strong>de</strong> ses membres sur l’actualité<br />
<strong>de</strong>s grands dossiers européens ;<br />
le lobbying en faisant valoir la position <strong>de</strong>s<br />
autorités locales et régionales auprès <strong>de</strong>s<br />
institutions européennes et en relayant les<br />
aspirations <strong>de</strong>s élus locaux.<br />
Cités Unies France milite pour la mise en place<br />
d’une plate-forme <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />
engagées dans la coopération pour le<br />
développement à Bruxelles, pour un dialogue<br />
régulier avec la Commission européenne sur<br />
les questions <strong>de</strong> développement, et ce, dans<br />
le cadre <strong>de</strong> la Commission affaires mondiales<br />
du CCRE (Conseil <strong>de</strong>s Communes et Régions<br />
d’Europe), section européenne <strong>de</strong> CGLU (Cités<br />
et Gouvernements locaux Unis).<br />
L’Instrument <strong>de</strong> Coopération au<br />
<strong>Développement</strong> (ICD)<br />
L’ICD 10 a été élaboré dans le cadre <strong>de</strong> la nouvelle<br />
programmation 2007-2013. Il se substitue, dans<br />
un souci <strong>de</strong> simplification, à plusieurs autres<br />
instruments. Il a pour objectif <strong>de</strong> contribuer<br />
à l’atteinte <strong>de</strong>s Objectifs du Millénaire pour<br />
le <strong>Développement</strong>, en particulier la réduction<br />
<strong>de</strong> la pauvreté. Son budget est <strong>de</strong> 17 milliards<br />
d’Euros.<br />
L’ICD s’applique à 5 zones géographiques :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
l’Amérique latine (18 pays) ;<br />
l’Asie (19 pays) ;<br />
l’Asie centrale (5 pays) ;<br />
le Moyen Orient (5 pays) ;<br />
l’Afrique du Sud.<br />
Il regroupe 5 programmes thématiques :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
le développement humain ;<br />
l’environnement et la gestion durable <strong>de</strong>s<br />
ressources naturelles;<br />
le rôle <strong>de</strong>s acteurs non-étatiques et <strong>de</strong>s autorités<br />
locales dans le développement ;<br />
la sécurité alimentaire ;<br />
la migration et l’asile.<br />
(Un 6 e programme, distinct, concerne le financement<br />
du protocole sucre dans les pays ACP.)<br />
Trois <strong>de</strong> ces programmes sont ouverts aux<br />
collectivités territoriales : l’environnement et<br />
la gestion durable <strong>de</strong>s ressources naturelles,<br />
la migration et l’asile, et le rôle <strong>de</strong>s acteurs<br />
non-étatiques et <strong>de</strong>s autorités locales dans le<br />
développement<br />
Ce <strong>de</strong>rnier est, pour partie, spécifiquement<br />
dédié aux collectivités territoriales. Il a trois<br />
objectifs :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
dans les pays en développement (79,9%<br />
<strong>de</strong>s ressources du fonds), <strong>de</strong> cofinancer les<br />
initiatives proposées ou mises en œuvre par<br />
la société civile ou par les collectivités locales,<br />
et tendant à fournir <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> base aux<br />
populations les plus démunies ;<br />
la sensibilisation et l’éducation au développement<br />
en Europe (17,7% <strong>de</strong>s ressources du<br />
fonds) ;<br />
la mise en réseau <strong>de</strong>s acteurs non-étatiques<br />
et <strong>de</strong>s autorités locales en Europe (2,4% <strong>de</strong>s<br />
ressources du fonds).<br />
Le programme est doté d’un budget <strong>de</strong> 1,6 milliard<br />
d’Euros pour la pério<strong>de</strong> 2007-2013. 15%,<br />
au maximum, <strong>de</strong> ce montant (soit 246 millions<br />
d’Euros) sont réservés aux collectivités territoriales.<br />
Si celles-ci ne consomment pas la totalité<br />
du montant, le sol<strong>de</strong> sera accessible aux autres<br />
acteurs non-étatiques.<br />
Des appels à propositions doivent être lancés<br />
soit par l’office EuropeAid <strong>de</strong> la Commission,<br />
soit par les délégations <strong>de</strong> la Commission européenne<br />
<strong>de</strong> certains pays pour certains volets<br />
du programme ANE-AL. Ils sont établis sur la<br />
10<br />
créé par le Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, portant établissement<br />
d’un instrument <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> la coopération au développement<br />
21
ase <strong>de</strong>s documents <strong>de</strong> programmation pour la<br />
pério<strong>de</strong> 2007-2013 :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
les Documents <strong>de</strong> Stratégie Régionaux (DSR) ;<br />
les Documents <strong>de</strong> Stratégie Pays (DSP) ;<br />
les Programmes Indicatifs Nationaux (PIN) et<br />
Régionaux (PIR) qui couvrent une première<br />
pério<strong>de</strong> courant <strong>de</strong> 2007 à 2010 puis, à l’issue<br />
d’un bilan intermédiaire, ceux couvrant la<br />
secon<strong>de</strong> pério<strong>de</strong> 2010-2013 ;<br />
la stratégie pluriannuelle et les programmes<br />
d’action annuels du programme ICD et du<br />
programme ANE-AL.<br />
Les premiers appels à propositions ont été<br />
lancés en janvier 2008.<br />
Les PIN et PIR précisent les domaines d’intervention<br />
présentés dans les DSR et DSP et fixent<br />
le calendrier annuel <strong>de</strong>s engagements financiers<br />
<strong>de</strong> la Commission. Ils sont complétés par <strong>de</strong>s<br />
documents <strong>de</strong> programmation annuels pour<br />
chaque pays et chaque zone, auxquels sont<br />
annexées les fiches <strong>de</strong> proposition <strong>de</strong> financement<br />
<strong>de</strong> chaque projet. Après leur adoption, ces<br />
propositions <strong>de</strong> financement permettent aux<br />
services <strong>de</strong> la Commission d’élaborer le ou les<br />
appels à propositions relatifs à chaque projet.<br />
Les financements accordés sont <strong>de</strong>s subventions,<br />
c’est-à-dire qu’ils ont vocation à compléter le<br />
financement propre apporté par la collectivité<br />
initiant le projet. Outre les critères généraux<br />
imposés à tous les candidats aux financements<br />
européens, <strong>de</strong>s critères spécifiques sont définis<br />
pour chaque appel à propositions.<br />
La Maison européenne <strong>de</strong>s pouvoirs locaux<br />
français informe ses membres (les associations<br />
ci-<strong>de</strong>ssus mentionnées), ainsi que CUF, <strong>de</strong>s<br />
appels à propositions afin <strong>de</strong> permettre aux<br />
collectivités françaises <strong>de</strong> répondre en temps<br />
utile.<br />
Complément d’information :<br />
http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl<br />
http://ec.europa.eu/external_relations/<strong>de</strong>legations/intro/web.htm<br />
22
L’ai<strong>de</strong> au développement<br />
Fiche 1.3. Les financements européens accessibles aux collectivités territoriales en matière d’ai<strong>de</strong> au développement<br />
23
L’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Développement</strong><br />
25
Fiche 2.1. Statut, missions et organisation<br />
L’AFD est l’opérateur pivot <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> bilatérale<br />
française.<br />
STATUT ET MISSIONS<br />
L’AFD est un Etablissement Public Industriel et<br />
Commercial (EPIC) dont le capital est entièrement<br />
détenu par l’Etat. En tant qu’institution<br />
financière spécialisée, elle est soumise aux<br />
dispositions <strong>de</strong> la loi bancaire. Elle est placée<br />
sous la tutelle principale <strong>de</strong> trois ministères :<br />
le ministère chargé <strong>de</strong>s Finances, le ministère<br />
chargé <strong>de</strong>s Affaires étrangères et européennes<br />
et le ministère chargé <strong>de</strong> l’Outre-mer.<br />
INTERVENTIONS AUPRÈS DES<br />
COLLECTIVITÉS D’OUTRE MER<br />
L’AFD intervient dans l’Outre-mer en application<br />
<strong>de</strong> la loi n°46-860 du 30 avril 1946<br />
tendant à l’établissement, au financement et à<br />
l’exécution <strong>de</strong>s plans d’équipement et <strong>de</strong> développement<br />
<strong>de</strong>s territoires relevant du ministère<br />
<strong>de</strong> la France d’Outre-mer. L’AFD intervient en<br />
synergie avec ses grands partenaires financiers<br />
(comme le groupe <strong>de</strong> la Caisse <strong>de</strong>s Dépôts<br />
et Consignations et OSEO) et non financiers<br />
(comme l’Association <strong>de</strong>s maires <strong>de</strong> France, la<br />
Fédération nationale <strong>de</strong>s sociétés d’économie<br />
mixte).<br />
L’une <strong>de</strong>s modifications apportées en 2006 au<br />
statut <strong>de</strong> l’AFD concerne ses relations avec les<br />
collectivités territoriales (article R 516-8). L’AFD<br />
pouvait déjà « au nom et pour le compte <strong>de</strong><br />
collectivités territoriales d’outre-mer ou <strong>de</strong> leurs<br />
groupements et en vertu <strong>de</strong> conventions <strong>de</strong><br />
mandat, assurer la gestion et le paiement d’opérations<br />
décidées et financées par ces collectivités et<br />
groupements ». Elle peut désormais « au nom et<br />
pour le compte d’autres collectivités territoriales<br />
ou <strong>de</strong> leurs groupements, assurer dans les mêmes<br />
conditions la gestion et le paiement d’opérations<br />
entrant dans <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> coopération<br />
décentralisée décidés et financés par ces collectivités<br />
et groupements ».<br />
Cette modification du statut permet à l’AFD <strong>de</strong><br />
gérer les financements, <strong>de</strong>stinés à <strong>de</strong>s opérations<br />
<strong>de</strong> coopération décentralisée, <strong>de</strong> toutes les collectivités<br />
françaises.<br />
Toute opération <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> fonds pour le<br />
compte d’une collectivité territoriale doit faire<br />
l’objet d’une convention <strong>de</strong> mandat conclue entre<br />
l’AFD et la collectivité. Cette convention doit a<br />
minima préciser :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
la ou les opérations autorisées par la collectivité ;<br />
les modalités <strong>de</strong> versement à l’AFD <strong>de</strong>s fonds<br />
affectés par la collectivité à l’opération ;<br />
les conditions d’intervention <strong>de</strong> l’AFD (instruction<br />
du projet, suivi, paiements à effectuer…) ;<br />
les modalités <strong>de</strong> compte-rendu <strong>de</strong> sa gestion et<br />
<strong>de</strong> reddition au moins annuelle <strong>de</strong>s opérations<br />
dans les comptes <strong>de</strong> la collectivité.<br />
L’objectif est <strong>de</strong> promouvoir la création et le<br />
développement <strong>de</strong>s entreprises, l’amélioration<br />
du cadre <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s populations d’Outre-mer,<br />
le développement durable et l’insertion <strong>de</strong><br />
l’Outre-mer dans son environnement régional.<br />
Dans ce contexte, l’AFD s’attache à respecter<br />
un principe <strong>de</strong> subsidiarité <strong>de</strong> ses interventions<br />
par rapport à celles <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> crédit<br />
<strong>de</strong> la place. Intervenant généralement à moyen<br />
et long termes et <strong>de</strong> façon sélective, l’AFD évite<br />
ainsi <strong>de</strong> se placer en concurrence directe avec<br />
les banques, s’attachant davantage à compléter<br />
le dispositif <strong>de</strong> financement du système bancaire<br />
local.<br />
L’ORGANISATION DE L’AFD<br />
L’AFD est dirigée par un Directeur Général,<br />
assisté d’un Directeur Général Adjoint.<br />
LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL<br />
Il comporte 3 départements :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
le département financier et <strong>de</strong>s risques, qui est<br />
notamment chargé d’émettre une « secon<strong>de</strong><br />
opinion » sur les propositions <strong>de</strong> financement<br />
soumises au conseil d’administration ;<br />
le département <strong>de</strong>s moyens et services<br />
généraux ;<br />
le département du budget et du contrôle <strong>de</strong><br />
gestion.<br />
26
L’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />
Fiche 2.1. Statut, missions et organisation<br />
LA DIRECTION DE LA STRATÉGIE<br />
Elle est subdivisée en 4 départements :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
le département <strong>de</strong> la recherche, auquel est<br />
notamment rattachée la division <strong>de</strong> l’évaluation<br />
et <strong>de</strong> la capitalisation ;<br />
le département du pilotage stratégique ;<br />
le département <strong>de</strong>s relations extérieures et<br />
<strong>de</strong> la communication, auquel est rattaché<br />
le Chargé <strong>de</strong>s relations avec les collectivités<br />
locales françaises ;<br />
le CEFEB 11 , chargé du renforcement <strong>de</strong>s<br />
capacités.<br />
Le secrétariat du Fonds Français pour l’Environnement<br />
Mondial 12 est rattaché à la direction <strong>de</strong><br />
la stratégie.<br />
-<br />
ques et technologiques, universités, gran<strong>de</strong>s<br />
écoles) ;<br />
animer son réseau d’anciens stagiaires et<br />
entretenir <strong>de</strong>s contacts suivis avec leurs<br />
employeurs.<br />
Enfin, le département organise sur l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s sujets traités <strong>de</strong>s rencontres et <strong>de</strong>s<br />
débats entre opérateurs du Nord et du Sud,<br />
notamment dans le domaine <strong>de</strong>s partenariats<br />
publics-privés.<br />
Il fait intervenir <strong>de</strong>s professionnels expérimentés,<br />
issus <strong>de</strong>s services opérationnels <strong>de</strong> l’AFD,<br />
<strong>de</strong> centres <strong>de</strong> recherche (CNRS, CIRAD, IRD…),<br />
d’entreprises majeures, <strong>de</strong> collectivités et <strong>de</strong><br />
l’Etat, ainsi que <strong>de</strong>s experts et institutions du<br />
Sud.<br />
Le CEFEB<br />
L’article 8 <strong>de</strong>s statuts <strong>de</strong> l’AFD dispose que :<br />
« L’établissement fournit <strong>de</strong>s prestations<br />
d’assistance technique, <strong>de</strong> conseil, d’étu<strong>de</strong> et<br />
<strong>de</strong> formation dans les domaines se rattachant à<br />
ses activités ». C’est dans ce cadre qu’intervient<br />
un département spécifique <strong>de</strong> la Direction<br />
<strong>de</strong> la Stratégie, en lien étroit et constant avec<br />
le réseau <strong>de</strong>s <strong>Agence</strong>s et les Départements<br />
du siège : le Centre d’Etu<strong>de</strong>s Financières<br />
Economiques et Bancaires (CEFEB), créé dans<br />
les années 60. Les activités <strong>de</strong> ce département,<br />
situé à Marseille <strong>de</strong>puis 1995 (délocalisation<br />
<strong>de</strong>s services publics) dépassent aujourd’hui les<br />
domaines cités dans son nom, les opérations<br />
conduites dans toutes les géographies où<br />
intervient l’AFD correspondant aux évolutions<br />
<strong>de</strong>s techniques et <strong>de</strong>s stratégies mises en œuvre<br />
par l’AFD (partenariat public-privé, gestion<br />
environnementale, RSE, décentralisation et<br />
action locale …).<br />
Ce département a notamment vocation à :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
favoriser le transfert local <strong>de</strong> ses compétences<br />
et l’action sur le terrain par les liaisons<br />
entretenues avec les agences et autres représentations<br />
(Etats étrangers et collectivités<br />
françaises d’outre-mer) ;<br />
développer l’utilisation <strong>de</strong>s NTIC (cd-rom,<br />
visioconférences, réseaux Internet et<br />
Intranet), tant pour ses besoins propres,<br />
qu’au service <strong>de</strong>s autres départements ;<br />
établir <strong>de</strong>s partenariats extérieurs (centres <strong>de</strong><br />
formation et <strong>de</strong> recherche, instituts scientifi-<br />
Le CEFEB propose surtout <strong>de</strong>s formations<br />
professionnelles, en réponse aux besoins <strong>de</strong>s<br />
employeurs <strong>de</strong>s pays du Sud et plus récemment<br />
du Nord. Celles-ci s’inscrivent en complémentarité<br />
et en appui à l’offre <strong>de</strong> formation <strong>de</strong>s<br />
pays du Sud, et non en concurrence.<br />
Ainsi, le CEFEB délocalise certains séminaires<br />
ou encore apporte <strong>de</strong>s appuis techniques à<br />
<strong>de</strong>s centres <strong>de</strong> formation <strong>de</strong>s pays du Sud avec<br />
lesquels il a noué <strong>de</strong>s partenariats.<br />
Le CEFEB participe également à la formation<br />
continue <strong>de</strong>s personnels <strong>de</strong> l’AFD et d’institutions<br />
ou d’organismes spécialisés français.<br />
Le CEFEB dispense aussi <strong>de</strong>s formations<br />
diplômantes, en particulier un Mastère<br />
professionnel « Analyse Economique et<br />
<strong>Développement</strong> International », <strong>de</strong> la Faculté<br />
<strong>de</strong>s Sciences Economiques et <strong>de</strong> Gestion <strong>de</strong><br />
l’Université d’Auvergne, organisé en partenariat<br />
avec le Centre d’Etu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> Recherches sur le<br />
<strong>Développement</strong> International (CERDI), situé à<br />
Clermont Ferrand. Il participe à un Mastère en<br />
<strong>Développement</strong> durable, créé avec les mêmes<br />
partenaires.<br />
11<br />
voir ci-après et fiche 5.3<br />
12<br />
voir fiche 2.8.<br />
27
LA DIRECTION DES OPÉRATIONS<br />
La Direction <strong>de</strong>s opérations regroupe les services<br />
opérationnels.<br />
Son organisation est fondée sur la coordination<br />
active <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux approches :<br />
-<br />
-<br />
une approche géographique, qui se matérialise<br />
par l’élaboration <strong>de</strong> Cadres d’intervention<br />
pays (CIP) et régional (CIR) ;<br />
une approche sectorielle, qui se matérialise<br />
par l’élaboration <strong>de</strong> Cadres d’intervention<br />
sectoriels (CIS).<br />
Ces approches sont complétées par <strong>de</strong>s<br />
apports concourant à la qualité générale <strong>de</strong> la<br />
production tant intellectuelle que technique,<br />
notamment dans les domaines juridiques et<br />
environnementaux.<br />
Chacune <strong>de</strong> ces approches est légitimée par<br />
la nécessité d’un double approfondissement :<br />
(i) <strong>de</strong> la connaissance politique, macro-économique<br />
et budgétaire <strong>de</strong>s pays et entités<br />
territoriales, et <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> réalisation<br />
<strong>de</strong>s opérations, (ii) d’une réflexion par secteur<br />
technique (enjeux, mo<strong>de</strong>s d’intervention,<br />
capitalisation <strong>de</strong>s expériences) et <strong>de</strong> la confrontation<br />
<strong>de</strong> cette réflexion aux priorités <strong>de</strong>s pays.<br />
La Direction <strong>de</strong>s opérations se compose :<br />
du Département Technique Opérationnel<br />
(DTO), chargé <strong>de</strong> la planification et <strong>de</strong><br />
l’octroi du financement <strong>de</strong>s opérations ;<br />
<strong>de</strong> 4 départements géographiques, auxquels<br />
sont rattachées les 55 agences.<br />
Le Département Technique Opérationnel<br />
comprend 7 divisions techniques 13 :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
eau et assainissement ;<br />
collectivités locales et développement urbain ;<br />
environnement et équipement ;<br />
santé et protection sociale ;<br />
éducation et formation professionnelle ;<br />
développement agricole et rural ;<br />
secteur financier ;<br />
appui au secteur privé.<br />
Les divisions techniques sont responsables <strong>de</strong> la<br />
mise en œuvre <strong>de</strong> la stratégie d’intervention <strong>de</strong><br />
l’AFD dans les Etats étrangers et dans les COM,<br />
tout en contribuant à sa définition.<br />
A ce titre, chaque division technique :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
élabore les cadres d’intervention sectoriels<br />
(CIS) dans ses domaines techniques <strong>de</strong><br />
compétence ;<br />
assure les relations avec les Etats et entités<br />
bénéficiaires, les autres bailleurs <strong>de</strong> fonds, les<br />
tutelles, la Direction générale et tout autre<br />
intervenant interne ou externe à l’AFD sur les<br />
aspects relatifs à ses domaines techniques <strong>de</strong><br />
compétence ;<br />
contribue à l’amélioration <strong>de</strong> la qualité<br />
<strong>de</strong>s opérations, sur la base <strong>de</strong> critères <strong>de</strong><br />
performance ;<br />
assure la maîtrise d’œuvre <strong>de</strong>s opérations<br />
<strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s Départements géographiques,<br />
et ayant trait à son domaine <strong>de</strong><br />
compétence technique.<br />
Les départements géographiques (au nombre<br />
<strong>de</strong> quatre : Afrique, Maghreb, Asie et COM)<br />
regroupent, sous l’autorité d’un Directeur,<br />
d’une part les agences (46 pour les Etats<br />
étrangers et 9 pour les COM) et agents mis<br />
à disposition opérant dans la zone d’action<br />
définie pour chaque département, d’autre part<br />
l’ensemble <strong>de</strong>s agents qui leur sont affectés.<br />
Les départements géographiques sont associés<br />
aux étapes clés du cycle d’instruction et <strong>de</strong><br />
suivi du projet, et ont pour responsabilités<br />
principales :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
l’établissement <strong>de</strong>s cadres d’intervention<br />
pays (CIP) et <strong>de</strong> département (CID) ;<br />
l’établissement <strong>de</strong> la programmation opérationnelle<br />
et la réalisation <strong>de</strong>s objectifs<br />
d’engagements et <strong>de</strong> versements ;<br />
les suites à donner aux documents <strong>de</strong> projet<br />
préparés par les départements techniques ;<br />
la notification <strong>de</strong>s engagements ou <strong>de</strong>s modifications<br />
d’engagements aux bénéficiaires et<br />
la signature <strong>de</strong>s actes correspondants (cette<br />
responsabilité étant, en général, exercée par<br />
délégation par l’agence locale) ;<br />
le bon exercice du suivi <strong>de</strong> la qualité du<br />
portefeuille ;<br />
la définition et la gestion <strong>de</strong>s budgets liés à<br />
l’activité opérationnelle d’instruction et <strong>de</strong><br />
suivi <strong>de</strong>s projets.<br />
13<br />
voir fiche 6.2.<br />
28
L’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />
Fiche 2.1. Statut, missions et organisation<br />
Les 55 agences, rattachées aux Départements<br />
géographiques, qui sont sur le terrain, ont pour<br />
missions :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
<strong>de</strong> contribuer à l’établissement <strong>de</strong>s CIP et <strong>de</strong><br />
la programmation opérationnelle ;<br />
d’initier l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s opérations ;<br />
<strong>de</strong> notifier les engagements ou les modifications<br />
d’engagements aux bénéficiaires et <strong>de</strong><br />
signer les actes correspondants ;<br />
d’assurer le suivi <strong>de</strong>s risques par contrepartie.<br />
Par ailleurs, elles sont associées aux étapes clés<br />
du cycle d’instruction et <strong>de</strong> suivi du projet<br />
Elles sont également chargées, au titre <strong>de</strong> leur<br />
participation aux projets sous la conduite d’un<br />
chef <strong>de</strong> projet « siège », ou en assurant ellesmêmes<br />
cette responsabilité :<br />
-<br />
-<br />
<strong>de</strong> contribuer, en tant que membre <strong>de</strong><br />
l’équipe projet ou, le cas échéant, en tant<br />
que chef <strong>de</strong> projet, à l’instruction <strong>de</strong>s projets<br />
et au suivi <strong>de</strong> leur exécution technique, à la<br />
qualité <strong>de</strong>s opérations aux différentes étapes<br />
du cycle du projet et à la notation <strong>de</strong> cette<br />
qualité ;<br />
d’instruire et d’exécuter (ou <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au<br />
siège d’exécuter) <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> décaissement,<br />
d’en assurer le suivi au regard <strong>de</strong>s<br />
calendriers prévisionnels, et <strong>de</strong> déclencher<br />
une procédure d’alerte en cas <strong>de</strong> dérive<br />
marquée et durable.<br />
PROPARCO développe à cette fin une gamme<br />
d’instruments financiers <strong>de</strong> long terme (fonds<br />
propres, prêts et garanties).<br />
Elle intervient dans un champ géographique<br />
large, allant <strong>de</strong>s grands pays émergents, aux<br />
pays les plus pauvres, tout particulièrement en<br />
Afrique.<br />
Dans les pays <strong>de</strong> la ZSP, PROPARCO concentre<br />
ses interventions sur le financement <strong>de</strong>s<br />
infrastructures et <strong>de</strong>s entreprises territoriales<br />
ou étrangères, la promotion <strong>de</strong>s systèmes<br />
financiers, la préservation <strong>de</strong> l’environnement<br />
local et global, et l’émergence d’une classe<br />
d’entrepreneurs locaux.<br />
Dans les pays émergents (Chine, Thaïlan<strong>de</strong>,<br />
In<strong>de</strong>, Indonésie, Pakistan, Brésil), PROPARCO<br />
concentre ses interventions sur les Biens<br />
Publics Mondiaux, la Responsabilité Sociale et<br />
Environnementale, et sur l’accompagnement<br />
<strong>de</strong>s entreprises françaises.<br />
PROPARCO développe également une activité<br />
soutenue dans les Collectivités d’Outre Mer, où<br />
ses interventions concernent les infrastructures,<br />
les énergies renouvelables, et complètent <strong>de</strong>s<br />
grands projets suivis par l’AFD.<br />
Un organigramme <strong>de</strong> l’AFD et la liste <strong>de</strong>s<br />
contacts figurent sur la fiche 6.2.<br />
PROPARCO ET LE SOUTIEN AU SECTEUR PRIVÉ<br />
PROPARCO, créée en 1977, est une institution<br />
financière <strong>de</strong> développement à actionnariat<br />
public-privé. Son capital social, qui était <strong>de</strong><br />
142,56 M€, a été augmenté <strong>de</strong> 300 M€ en<br />
début d’année 2008. Sa mission est <strong>de</strong> financer<br />
les investissements privés à long terme dans les<br />
pays en développement, pour la croissance, le<br />
développement durable et l’atteinte <strong>de</strong>s objectifs<br />
du millénaire.<br />
Les opérations financées doivent être :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
économiquement viables,<br />
socialement équitables,<br />
soutenables sur le plan environnemental,<br />
financièrement rentables (ce critère essentiel<br />
étant la condition d’un effet d’entraînement<br />
sur d’autres investisseurs privés).<br />
29
Fiche 2.2. Le cadre d’intervention <strong>de</strong> l’AFD<br />
Il est organisé autour <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux axes structurants<br />
déclinés ci-après :<br />
Les orientations du plan d’Orientation<br />
Stratégique (POS)<br />
Les engagements éthiques et responsables<br />
LE PLAN D’ORIENTATION<br />
STRATÉGIQUE (POS)<br />
Le POS actuel (2007 - 2011), qui s’inscrit dans<br />
le cadre <strong>de</strong>s OMD, est le <strong>de</strong>uxième document<br />
stratégique <strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong>. Il définit les orientations<br />
suivantes :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
priorité en faveur <strong>de</strong> l’Afrique subsaharienne ;<br />
croissance économique et préservation <strong>de</strong><br />
l’environnement au Sud <strong>de</strong> la Méditerranée ;<br />
politique d’influence sur les biens communs<br />
<strong>de</strong> l’humanité dans les pays émergents ;<br />
rôle <strong>de</strong> conseil renforcé outre-mer ;<br />
produits innovants (financements, conseil et<br />
expertise) pour <strong>de</strong> nouveaux clients : collectivités<br />
locales (renforcement <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong><br />
maîtrise d’ouvrage) ; secteur privé ; ONG et<br />
fondations ;<br />
renforcement <strong>de</strong> l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />
(Déclaration <strong>de</strong> Paris) ; responsabilité sociale<br />
et environnementale.<br />
SA DÉCLINAISON EN DIRECTION DES ETATS<br />
ETRANGERS<br />
Dans la ZSP, l’intervention <strong>de</strong> l’AFD s’inscrit<br />
dans le cadre du DCP dont elle contribue à<br />
l’élaboration.<br />
Le Département géographique concerné élabore<br />
un document <strong>de</strong> cadrage d’intervention<br />
par pays (CIP) avec les objectifs suivants :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
définir pour un pays donné les orientations<br />
<strong>de</strong> l’AFD propres à cadrer l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s<br />
projets sur une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 3 ans ;<br />
inscrire les interventions <strong>de</strong> l’AFD dans les<br />
stratégies nationales <strong>de</strong>s pays bénéficiaires,<br />
les coordonner avec celles <strong>de</strong>s autres bailleurs<br />
<strong>de</strong> fonds, contribuer aux grands enjeux<br />
internationaux ;<br />
apprécier ex ante les résultats <strong>de</strong> développement<br />
attendus qualitativement et<br />
quantitativement.<br />
LES STRATÉGIES SECTORIELLES<br />
L’élaboration <strong>de</strong> cadres d’intervention<br />
sectoriels (CIS) vise à renforcer la lisibilité et<br />
l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> française. Il s’agit également<br />
<strong>de</strong> permettre un meilleur pilotage et une plus<br />
gran<strong>de</strong> cohérence <strong>de</strong> l’APD française et <strong>de</strong> la<br />
rendre plus visible aux yeux <strong>de</strong>s partenaires.<br />
Tous les ministères concernés sont associés à<br />
cet exercice, la société civile et les collectivités<br />
territoriales françaises sont consultés.<br />
Le CICID <strong>de</strong> juin 06 a fixé les priorités<br />
concernant les grands enjeux mondiaux, et<br />
l’intégration <strong>de</strong>s biens publics mondiaux à la<br />
stratégie française <strong>de</strong> développement : l’apparition<br />
<strong>de</strong> nouvelles maladies contagieuses,<br />
le réchauffement climatique, la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong><br />
la biodiversité, les questions <strong>de</strong> sécurité ou les<br />
déséquilibres commerciaux. Une priorité est<br />
donnée aux pays, notamment en Afrique, qui<br />
sont les plus vulnérables et seront durement<br />
affectés par le réchauffement climatique et la<br />
désertification ou la propagation <strong>de</strong> maladies<br />
contagieuses.<br />
LES ENGAGEMENTS ÉTHIQUES ET<br />
RESPONSABLES DE L’AFD<br />
Signataire du Pacte Mondial, l’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>Développement</strong> a inscrit le développement<br />
durable au cœur <strong>de</strong> sa stratégie et met en<br />
œuvre sa mission à partir <strong>de</strong>s engagements qui<br />
déterminent ses valeurs et finalités d’action :<br />
lutte contre la pauvreté et les inégalités, appui<br />
à la croissance économique et protection <strong>de</strong><br />
l’environnement.<br />
La mise en œuvre <strong>de</strong> cette stratégie se décline<br />
autour trois axes principaux :<br />
LA POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET<br />
ENVIRONNEMENTALE (RSE)<br />
Une politique <strong>de</strong> responsabilité sociale et<br />
environnementale a été élaborée selon les<br />
conventions internationales relatives au<br />
développement durable auxquelles le gouvernement<br />
français a adhéré. Elle se concrétise<br />
par 10 engagements qui concernent aussi bien<br />
le fonctionnement interne <strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong> que la<br />
qualité sociale et environnementale <strong>de</strong>s projets<br />
qu’elle finance.<br />
30
L’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />
Fiche 2.2. Le cadre d’intervention <strong>de</strong> l’AFD<br />
LA POLITIQUE DE TRANSPARENCE<br />
Volet essentiel <strong>de</strong> la politique RSE <strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong>,<br />
la politique <strong>de</strong> transparence trouve ses fon<strong>de</strong>ments<br />
dans les principes d’ouverture et <strong>de</strong><br />
transparence reconnus comme fondamentaux<br />
dans les 2 chartes <strong>de</strong> l’AFD.<br />
Par cette politique, l’<strong>Agence</strong> affirme sa volonté<br />
<strong>de</strong> répondre aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’information et<br />
d’explication formulées par toutes les parties<br />
prenantes (société civile, opinions publiques<br />
françaises ou locales).<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
La politique <strong>de</strong> transparence a pour finalités<br />
d’accroître la crédibilité et la responsabilité <strong>de</strong><br />
l’<strong>Agence</strong> à l’égard <strong>de</strong> ses parties intéressées,<br />
au premier rang <strong>de</strong>squelles ses mandants,<br />
ses partenaires, et l’ensemble <strong>de</strong>s citoyens<br />
français (argument <strong>de</strong> légitimité <strong>de</strong> politique<br />
française d’ai<strong>de</strong> publique au développement<br />
qui sert également les stratégies <strong>de</strong>s collectivités<br />
locales) ;<br />
<strong>de</strong> donner accès à toutes les informations<br />
utiles sur la mise en œuvre <strong>de</strong> sa mission ;<br />
d’instaurer un dialogue avec les parties<br />
intéressées ;<br />
d’accompagner la démarche partenariale<br />
menée par l’<strong>Agence</strong> avec l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
acteurs engagés (société civile, acteurs <strong>de</strong> la<br />
coopération décentralisée, entreprises ou<br />
fondations) ;<br />
<strong>de</strong> conforter l’efficacité et <strong>de</strong> sécuriser l’action<br />
<strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong> comme celle <strong>de</strong> ses parties<br />
intéressées.<br />
-<br />
-<br />
la stratégie <strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong> ;<br />
les opérations <strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong> (à l’exclusion <strong>de</strong>s<br />
informations couvertes par le secret bancaire<br />
et le secret <strong>de</strong>s affaires ou dont le client a<br />
refusé la diffusion) présentées à 3 niveaux<br />
<strong>de</strong>s étapes d’instruction.<br />
Les informations sont diffusées à toute<br />
personne qui en fait la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> par écrit à la<br />
cellule transparence <strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong> (sous réserve<br />
<strong>de</strong>s lois françaises et le cas échéant, <strong>de</strong>s lois<br />
en vigueur dans les pays d’intervention). Une<br />
adresse électronique spécifique <strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong><br />
(transparence@afd.fr) permet d’envoyer à<br />
tout moment <strong>de</strong>s observations à l’<strong>Agence</strong>.<br />
LA DÉMARCHE DE MAÎTRISE DES RISQUES<br />
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX<br />
Elle se caractérise par :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
l’introduction d’une démarche d’évaluation<br />
et <strong>de</strong> maîtrise <strong>de</strong>s risques environnementaux<br />
et sociaux relatifs aux financements ;<br />
l’extension <strong>de</strong> cette démarche aux projets en<br />
intermédiation financière ;<br />
l’application du principe d’évaluation et <strong>de</strong><br />
suivi en continu, <strong>de</strong> l’instruction à l’évaluation<br />
ex post <strong>de</strong>s opérations financées.<br />
-<br />
Champ et plan d’action<br />
La politique <strong>de</strong> transparence s’applique<br />
à l’ensemble <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong> financement<br />
concessionnel <strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong> stricto sensu,<br />
c’est-à-dire son siège et son réseau d’agences<br />
locales. Elle sera progressivement étendue à<br />
ses activités <strong>de</strong> financement non concessionnel<br />
ainsi qu’à ses filiales, dont PROPARCO.<br />
L’accès à l’information :<br />
Les publications accessibles directement sur le<br />
site internet <strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong> portent sur :<br />
-<br />
<strong>de</strong>s données institutionnelles (statutaires,<br />
économiques et financières, procédures,<br />
métho<strong>de</strong>s) et toute information utile relative<br />
à l’<strong>Agence</strong> et son fonctionnement ;<br />
31
L’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />
Fiche 2.3. Les financements proposés par l’AFD aux pays étrangers<br />
Fiche 2.3. Les financements proposés par l’AFD aux pays<br />
étrangers<br />
Dans le cadre général <strong>de</strong>s financements<br />
proposés par la France au titre <strong>de</strong> l’APD (voir<br />
fiche 1.1.), l’AFD dispose d’une gran<strong>de</strong> diversité<br />
d’outils <strong>de</strong> financement, dont elle renforce et<br />
élargit la gamme en fonction <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s<br />
besoins <strong>de</strong>s pays partenaires et <strong>de</strong> ses propres<br />
missions.<br />
Les prêts d’ai<strong>de</strong> à l’ajustement structurel<br />
(PAS) sont octroyés à un taux concessionnel<br />
pour financer les programmes économiques<br />
et <strong>de</strong> redressement financier <strong>de</strong> certains États<br />
étrangers. Ils sont accordés par l’AFD selon ses<br />
propres règles et usages. Ils bénéficient <strong>de</strong> la<br />
garantie <strong>de</strong> l’État français.<br />
L’AFD intervient par <strong>de</strong>s subventions dans les<br />
pays les plus pauvres <strong>de</strong> la Zone <strong>de</strong> solidarité<br />
prioritaire (ZSP). Ces subventions concernent<br />
les secteurs sociaux, les projets d’infrastructures,<br />
<strong>de</strong> développement urbain et rural.<br />
Dans les autres pays, elle consent <strong>de</strong>s prêts à<br />
<strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s Etats, <strong>de</strong>s organismes et collectivités<br />
publics et <strong>de</strong>s entreprises. Sa notation<br />
AAA, meilleure notation possible sur les prêts<br />
à long terme, lui permet d’accor<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s prêts<br />
à <strong>de</strong>s conditions favorables par rapport au<br />
marché.<br />
A cet égard, le CICID <strong>de</strong> juin 2006 a intégré dans<br />
le champ d’intervention <strong>de</strong>s prêts <strong>de</strong> l’AFD l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s pays d’Afrique subsaharienne, afin<br />
d’assurer la cohérence régionale <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong><br />
coopération <strong>de</strong> la France.<br />
Concernant le secteur privé, l’AFD accor<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s prêts bonifiés. En effet, certaines missions<br />
<strong>de</strong> services publics sont parfois assurées par<br />
le secteur privé. Les entreprises se substituent<br />
souvent à l’Etat dans la délivrance <strong>de</strong> prestations<br />
sociales vis-à-vis <strong>de</strong> leurs employés, là où<br />
la puissance publique n’est pas en mesure <strong>de</strong> le<br />
faire. L’AFD encourage ces acteurs à jouer un<br />
rôle <strong>de</strong> développement en leur accordant <strong>de</strong>s<br />
financements avantageux.<br />
L’action <strong>de</strong> l’AFD permet d’accor<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s<br />
concours à long terme, et <strong>de</strong> proposer <strong>de</strong>s<br />
solutions <strong>de</strong> financement innovantes adaptées<br />
au contexte géographique et économique <strong>de</strong><br />
ses pays d’intervention. L’<strong>Agence</strong> vient ainsi <strong>de</strong><br />
mettre en place <strong>de</strong>s prêts in<strong>de</strong>xés sur le cours<br />
<strong>de</strong>s matières premières.<br />
L’AFD octroie <strong>de</strong>s prêts à <strong>de</strong>s États (prêts<br />
souverains), <strong>de</strong>s entités publiques (prêts soussouverains<br />
à <strong>de</strong>s collectivités territoriales ou à<br />
<strong>de</strong>s entreprises para-publiques) ou à <strong>de</strong>s acteurs<br />
privés (prêts non souverains), afin <strong>de</strong> conduire<br />
<strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> développement dans les pays en<br />
développement. L’octroi <strong>de</strong> ces prêts et leur<br />
niveau <strong>de</strong> concessionnalité sont conditionnés<br />
au <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> ces pays, à leur<br />
appartenance ou non à la Zone <strong>de</strong> solidarité<br />
prioritaire (ZSP) et à leur niveau d’en<strong>de</strong>ttement<br />
extérieur et à leur position vis-à-vis du<br />
FMI. Les prêts sous-souverains aux collectivités<br />
territoriales sont encore peu nombreux, mais<br />
sont appelés à se développer.<br />
32
L’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />
Fiche 2.4. Les pays d’intervention<br />
Fiche 2.4. Les pays d’intervention<br />
LES PAYS DE LA ZSP<br />
La ZSP a été créée en 1998. Sa définition<br />
actuelle date du CICID <strong>de</strong> 2002. Elle comporte<br />
55 pays parmi les 77 pays classés les plus<br />
pauvres du mon<strong>de</strong>. Ces pays appartiennent au<br />
Proche Orient, à l’Afrique du Nord, à l’Asie, aux<br />
Caraïbes, à l’Amérique Latine, au Pacifique ; les<br />
plus nombreux sont en Afrique subsaharienne.<br />
Dans la ZSP, les enjeux principaux <strong>de</strong> la politique<br />
française en faveur du développement sont<br />
<strong>de</strong> susciter la croissance, réduire la pauvreté et<br />
faciliter l’accès aux biens publics mondiaux,<br />
contribuant ainsi à l’atteinte <strong>de</strong>s Objectifs du<br />
Millénaire pour le développement (OMD) à<br />
l’horizon 2015. Ces objectifs ont été déclinés<br />
en neuf secteurs, sur lesquels la France concentre<br />
la plupart <strong>de</strong> ses moyens d’intervention :<br />
éducation, eau et assainissement, santé et lutte<br />
contre le sida, agriculture et sécurité alimentaire,<br />
développement <strong>de</strong>s infrastructures en Afrique<br />
subsaharienne, protection <strong>de</strong> l’environnement<br />
et <strong>de</strong> la biodiversité, développement du secteur<br />
productif, gouvernance, enseignement supérieur<br />
et recherche.<br />
La liste <strong>de</strong>s pays figurant dans la Zone <strong>de</strong> solidarité<br />
prioritaire (ZSP) est définie par le Comité<br />
interministériel <strong>de</strong> la coopération internationale<br />
et du développement (CICID).<br />
Cette liste 14 est la suivante :<br />
PAYS APPARTENANT À LA ZSP<br />
Proche et Moyen-Orient :<br />
Liban, Territoires palestiniens, Yémen<br />
Afrique du Nord :<br />
Algérie, Maroc, Tunisie<br />
Afrique subsaharienne et Océan Indien :<br />
Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso,<br />
Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République<br />
Centrafricaine, Comores, Congo Brazzaville,<br />
République Démocratique du Congo, Côted’Ivoire,<br />
Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gabon,<br />
Ghana, Gambie, Guinée, Guinée Bissao, Guinée<br />
Equatoriale, Kenya, Libéria, Madagascar, Mali,<br />
Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger,<br />
Nigéria, Ouganda, Rwanda, Sao-Tome et Principe,<br />
Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Tchad,<br />
Togo, Zimbabwe.<br />
Asie :<br />
Cambodge, Laos, Vietnam<br />
à titre provisoire : Afghanistan<br />
Caraïbes :<br />
Cuba, Haïti, République dominicaine<br />
Amérique latine :<br />
Surinam<br />
Pacifique :<br />
Vanuatu<br />
LES AUTRES PAYS<br />
Le CICID <strong>de</strong> juin 2006 a prévu que la France<br />
renforcerait également sa coopération avec les<br />
grands pays émergents, dont le développement<br />
rapi<strong>de</strong> constitue un enjeu majeur pour l’équilibre<br />
<strong>de</strong> la planète. En travaillant avec eux sur<br />
ces problèmes d’intérêt commun, elle pourrait<br />
peser pour une meilleure gouvernance mondiale,<br />
un développement durable et réduire les<br />
impacts négatifs <strong>de</strong>s problèmes communs <strong>de</strong><br />
l’humanité sur les pays les plus pauvres.<br />
L’action française <strong>de</strong>vrait être ciblée sur<br />
trois priorités : la lutte contre les maladies<br />
transmissibles et émergentes, la lutte contre le<br />
changement climatique et la préservation <strong>de</strong> la<br />
biodiversité.<br />
L’AFD a mandat pour intervenir sous forme<br />
<strong>de</strong> prêts dans un nombre limité <strong>de</strong> pays émergents<br />
dans ces trois domaines, qui touchent à<br />
la protection <strong>de</strong>s biens publics mondiaux, en<br />
particulier la protection <strong>de</strong> l’environnement.<br />
La politique française d’ai<strong>de</strong> au développement<br />
souhaite par ailleurs s’appuyer sur les capacités<br />
<strong>de</strong>s pays émergents, notamment en termes<br />
<strong>de</strong> cofinancement, pour mener avec eux <strong>de</strong>s<br />
actions communes en pays tiers.<br />
14<br />
mise à jour au 1er juillet 2004<br />
33
Fiche 2.5. Les financements <strong>de</strong>stinés aux collectivités étrangères<br />
LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES<br />
L’AFD intervient en appui aux collectivités<br />
urbaines au travers <strong>de</strong> sa division « Collectivités<br />
locales et développement urbain » (CLD).<br />
Celle-ci est dotée d’un Cadre d’intervention<br />
sectoriel qui décline les gran<strong>de</strong>s orientations <strong>de</strong><br />
l’<strong>Agence</strong> (POS 2) <strong>de</strong> la manière suivante.<br />
FINALITÉS PROPRES À LA STRATÉGIE CLD<br />
La volonté affichée d’i<strong>de</strong>ntifier la collectivité<br />
locale comme le nouvel acteur clé <strong>de</strong>s politiques<br />
<strong>de</strong> développement durable conduit la stratégie<br />
CLD à se structurer autour <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux finalités qui<br />
lui sont propres. Fortement complémentaires,<br />
<strong>de</strong> plus en plus souvent imbriquées l’une dans<br />
l’autre du fait <strong>de</strong>s processus parallèles d’urbanisation<br />
et <strong>de</strong> décentralisation, ces <strong>de</strong>ux finalités<br />
sont les suivantes.<br />
Conforter la mise en œuvre <strong>de</strong> l’autonomie<br />
locale<br />
Dans la poursuite <strong>de</strong> cette finalité, simple déclinaison<br />
d’une volonté affichée dans le POS 2,<br />
l’AFD intervient auprès <strong>de</strong>s partenaires locaux<br />
en bonne intelligence et coordination avec le<br />
MAEE, compétent en matière <strong>de</strong> gouvernance.<br />
Elle n’a pas vocation à défendre en toutes<br />
circonstances ni à inciter les gouvernements<br />
<strong>de</strong>s pays partenaires à la décentralisation. Elle<br />
se contente au contraire d’accompagner par<br />
ses financements et ses conseils, à l’échelle <strong>de</strong>s<br />
collectivités, <strong>de</strong>s processus définis et mis en<br />
œuvre localement - mo<strong>de</strong> opératoire d’ailleurs<br />
conforme aux préconisations <strong>de</strong> la Charte<br />
européenne <strong>de</strong> l’autonomie locale.<br />
Promouvoir le développement durable<br />
<strong>de</strong>s territoires urbains<br />
Cette finalité est poursuivie au travers d’une<br />
approche globale <strong>de</strong>s territoires urbains, à<br />
l’échelle <strong>de</strong>squels sont déclinés les grands<br />
principes du développement durable : croissance<br />
économique, développement social et<br />
durabilité.<br />
Pour atteindre ces <strong>de</strong>ux finalités, les trois objectifs<br />
suivants sont i<strong>de</strong>ntifiés :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Renforcer les capacités financières, <strong>de</strong> gestion<br />
et <strong>de</strong> maîtrise d’ouvrage <strong>de</strong>s collectivités<br />
partenaires ;<br />
Favoriser l’accès au logement, à l’emploi<br />
et aux services essentiels <strong>de</strong>s populations<br />
urbaines ;<br />
Favoriser un aménagement <strong>de</strong>s territoires<br />
urbains qui réduise leur empreinte écologique<br />
et atténue les externalités négatives <strong>de</strong> la<br />
croissance urbaine.<br />
34
L’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />
Fiche 2.5. Les financements <strong>de</strong>stinés aux collectivités étrangères<br />
LES DOMAINES DANS LESQUELS<br />
LES COLLECTIVITÉS FRANÇAISES<br />
PEUVENT INTERVENIR EN<br />
PARTENARIAT AVEC L’AFD<br />
La plus forte <strong>de</strong>man<strong>de</strong> actuelle <strong>de</strong>s collectivités<br />
avec lesquelles l’AFD est en relation concerne<br />
le développement urbain. La participation<br />
possible <strong>de</strong>s collectivités territoriales dans les<br />
domaines <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’assainissement, pour<br />
lesquels elles peuvent mobiliser <strong>de</strong>s financements<br />
spécifiques grâce à la loi Oudin Santini, à<br />
<strong>de</strong>s projets mis en œuvre par l’AFD concernent<br />
aussi, pour l’essentiel, le champ urbain.<br />
Pour le montage <strong>de</strong> projets dans ce domaine,<br />
<strong>de</strong>ux catégories <strong>de</strong> situations se présentent :<br />
-<br />
-<br />
dans les capitales ou les très gran<strong>de</strong>s villes,<br />
les partenariats sont plus faciles à mettre en<br />
place, quel que soit le contenu du DCP : <strong>de</strong><br />
nombreux champs sont explorés dans ces villes<br />
par les collectivités françaises, et un projet<br />
<strong>de</strong> l’AFD, qui comporte souvent plusieurs<br />
composantes <strong>de</strong> soutien au développement<br />
urbain et à la gestion <strong>de</strong>s services publics,<br />
peut aisément tirer parti <strong>de</strong>s actions déjà<br />
expérimentées, ou trouver <strong>de</strong>s complémentarités<br />
efficaces ;<br />
dans les petites villes, comme dans les zones<br />
rurales, les partenariats sont plus difficiles à<br />
construire : soit l’AFD soutient une politique<br />
nationale, par exemple en finançant un<br />
fonds d’appui à la décentralisation, ou au<br />
développement urbain, et il est difficile aux<br />
collectivités françaises <strong>de</strong> s’intégrer dans<br />
ce processus ; soit l’AFD monte <strong>de</strong>s projets<br />
ciblant plusieurs villes, ou un réseau <strong>de</strong> villes<br />
secondaires, ou <strong>de</strong>s zones rurales, mais elle ne<br />
se limite pas à un projet concernant une seule<br />
ville ; dans ce contexte, il est plus difficile <strong>de</strong><br />
trouver <strong>de</strong>s collectivités intéressées, ou, pour<br />
l’AFD, <strong>de</strong> moduler ses actions en fonction <strong>de</strong><br />
partenariats pré-existants.<br />
Les partenariats dans ce cadre-là sont plus difficiles<br />
à établir. Les projets <strong>de</strong> développement<br />
rural <strong>de</strong> l’AFD, s’ils n’ont pas une dimension<br />
nationale, concernent généralement <strong>de</strong>s zones<br />
territoriales importantes, plus vastes que celles<br />
avec lesquelles même les régions françaises<br />
établissent <strong>de</strong>s partenariats. Dans ce contexte,<br />
l’association <strong>de</strong> plusieurs collectivités françaises<br />
paraît nécessaire, mais elle nécessite du temps<br />
(voir fiche 3.4.).<br />
Certaines collectivités importantes développent<br />
une coopération dans le domaine rural. L’AFD<br />
met en œuvre <strong>de</strong> nouveaux types d’interventions<br />
dans le secteur rural, en particulier dans<br />
les zones géographiques <strong>de</strong>s grands fleuves,<br />
et dans le cadre <strong>de</strong>s parcs naturels régionaux.<br />
Dans ces <strong>de</strong>ux cas, l’expérience <strong>de</strong>s collectivités<br />
françaises pourrait être utilement recherchée.<br />
35
L’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />
Fiche 2.6. Les approches conjointes avec d’autres bailleurs <strong>de</strong> fonds, bi ou multilatéraux<br />
Fiche 2.6. Les approches conjointes avec d’autres bailleurs <strong>de</strong><br />
fonds, bi ou multilatéraux<br />
L’AFD a déjà appuyé <strong>de</strong>s ONG pour accé<strong>de</strong>r à<br />
<strong>de</strong>s financements européens (cf fiche 4.4.). Des<br />
opérations <strong>de</strong> même nature pourraient être<br />
lancées en direction <strong>de</strong>s collectivités locales,<br />
pour faciliter leur accès à d’autres financements,<br />
ou pour les associer à <strong>de</strong>s projets d’autres<br />
bailleurs.<br />
Par exemple, lorsque l’AFD soutient la décentralisation<br />
dans un pays, avec d’autres bailleurs, elle<br />
pourrait mobiliser <strong>de</strong>s collectivités françaises<br />
pour apporter <strong>de</strong>s contributions complémentaires<br />
et ciblées, bénéficiant spécifiquement à<br />
<strong>de</strong>s collectivités <strong>de</strong> ce pays.<br />
Exemples :<br />
- l’appui à la décentralisation au Mali : le<br />
financement principal est fourni par l’Union<br />
Européenne (2 financements successifs, le<br />
2 e <strong>de</strong>puis 2006) ; l’AFD apporte également<br />
un financement, comme d’autres agences<br />
multilatérales (la Banque mondiale, <strong>de</strong>puis<br />
peu), et plusieurs coopérations bilatérales. De<br />
nombreuses collectivités françaises se sont<br />
déjà mobilisées, dans le cadre <strong>de</strong> coopérations<br />
décentralisées préexistantes, et apportent<br />
leur appui à <strong>de</strong>s collectivités maliennes, pour<br />
partie sur financement européen, en adhérant<br />
au dispositif d’appui adopté par le<br />
Gouvernement malien.<br />
-<br />
l’appui à la décentralisation en Tunisie : l’AFD<br />
a un projet conjoint avec la Banque mondiale,<br />
dont l’objet est <strong>de</strong> refinancer la Caisse <strong>de</strong><br />
Prêts et <strong>de</strong> Soutien aux Collectivités Locales<br />
(CSPCL), et d’apporter un appui institutionnel<br />
aux communes et à l’institut <strong>de</strong> formation<br />
<strong>de</strong> leurs agents (le CFAD). Des collectivités<br />
françaises pourraient être sollicitées pour<br />
apporter un appui complémentaire à certaines<br />
villes tunisiennes, dans <strong>de</strong>s domaines<br />
précisément i<strong>de</strong>ntifiés : développement<br />
urbain ; gestion <strong>de</strong>s services locaux, tels que<br />
la collecte et le traitement <strong>de</strong>s déchets ;<br />
formation <strong>de</strong>s cadres.<br />
36
L’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />
Fiche 2.7. Les concertations globales avec les collectivités territoriales françaises<br />
Fiche 2.7. Les concertations globales avec les collectivités<br />
territoriales françaises<br />
L’AFD a déjà engagé une concertation avec les<br />
associations <strong>de</strong> collectivités territoriales, pour<br />
mieux se faire connaître, renforcer la transparence<br />
<strong>de</strong> ses interventions, et mobiliser à la fois<br />
<strong>de</strong>s coopérations décentralisées, et les citoyens<br />
autour <strong>de</strong> ses interventions.<br />
Elle a un partenariat privilégié avec CUF, matérialisé<br />
par une convention conclue début 2006.<br />
Dans ce cadre, les responsables géographiques<br />
participent aux groupes pays <strong>de</strong> CUF. Une<br />
étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> capitalisation a été réalisée sous le<br />
timbre <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux institutions. Le présent gui<strong>de</strong><br />
est rédigé en concertation avec CUF.<br />
L’AFD entretient par ailleurs une concertation<br />
avec les gran<strong>de</strong>s associations <strong>de</strong> collectivités<br />
territoriales françaises :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
l’Association <strong>de</strong>s Maires <strong>de</strong> France (AMF) ;<br />
l’Assemblée <strong>de</strong>s Départements <strong>de</strong> France<br />
(ADF) 15 ;<br />
l’Association <strong>de</strong>s Régions <strong>de</strong> France (ARF).<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
<strong>de</strong> mieux faire connaître les stratégies et le<br />
mo<strong>de</strong> d’intervention <strong>de</strong> l’AFD, ses interventions<br />
dans les différents pays, ses projets,<br />
ses partenariats avec d’autres agences <strong>de</strong><br />
développement ;<br />
<strong>de</strong> favoriser les partenariats avec les collectivités<br />
territoriales ;<br />
tout particulièrement dans ses nouveaux<br />
pays d’intervention (Turquie, Thaïlan<strong>de</strong>,<br />
Brésil), ainsi que dans les pays considérés<br />
comme moins attractifs par les collectivités<br />
françaises ;<br />
d’informer le réseau <strong>de</strong> l’AFD <strong>de</strong>s réalités<br />
et <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />
françaises.<br />
Enfin, l’AFD a engagé un dialogue avec les<br />
associations <strong>de</strong> collectivités francophones :<br />
-<br />
-<br />
l’Association internationale <strong>de</strong>s maires et<br />
responsables <strong>de</strong>s capitales et métropoles<br />
partiellement ou entièrement francophones<br />
(AIMF) ;<br />
l’Association internationale <strong>de</strong>s régions francophones<br />
(AIRF).<br />
Ce dialogue lui permet d’entretenir <strong>de</strong>s échanges<br />
avec les collectivités étrangères, dans le<br />
cadre <strong>de</strong> la francophonie.<br />
L’AFD organisera chaque année, à l’occasion<br />
<strong>de</strong>s journées du réseau, qui se tiennent en début<br />
d’année, <strong>de</strong>s rencontres entre les représentants<br />
<strong>de</strong>s associations françaises <strong>de</strong> collectivités territoriales<br />
et les directeurs <strong>de</strong> ses agences.<br />
Cette démarche <strong>de</strong> concertation <strong>de</strong>vrait<br />
permettre :<br />
-<br />
<strong>de</strong> fournir aux collectivités territoriales une<br />
information plus complète et plus organisée<br />
sur les conventions internationales et les<br />
engagements pris sur les grands enjeux<br />
mondiaux ;<br />
15<br />
avec laquelle une convention <strong>de</strong> partenariat a été signée le 15 avril 2008<br />
37
L’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />
Fiche 2.8. Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial<br />
Fiche 2.8. Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial<br />
Le FFEM est un instrument financier public français<br />
qui contribue, sous forme <strong>de</strong> subventions,<br />
au financement <strong>de</strong> projets <strong>de</strong> développement<br />
ayant un impact durable sur l’une ou l’autre <strong>de</strong>s<br />
cinq gran<strong>de</strong>s composantes <strong>de</strong> l’environnement<br />
mondial :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
la protection et la gestion <strong>de</strong> la biodiversité,<br />
la lutte contre le réchauffement climatique,<br />
la protection et la gestion <strong>de</strong>s eaux internationales<br />
continentales ou marines,<br />
la lutte contre la dégradation <strong>de</strong>s terres<br />
(désertification et déforestation),<br />
la protection <strong>de</strong> la couche d’ozone<br />
stratosphérique,<br />
les luttes contre les polluants organiques<br />
persistants.<br />
L’AFD assure la gestion <strong>de</strong>s financements du<br />
FFEM pour le compte <strong>de</strong> l’Etat français.<br />
Le FFEM s’appuie sur quatre grands principes :<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Il intervient en appui <strong>de</strong> projets à finalité<br />
<strong>de</strong> développement économique et social<br />
dont il finance les coûts liés directement,<br />
ou indirectement, à une préoccupation<br />
d’environnement mondial.<br />
Il appuie en priorité <strong>de</strong>s réalisations concrètes<br />
dans les pays bénéficiaires, donc en aval<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong> diagnostic.<br />
Il soutient <strong>de</strong>s approches ou thèmes novateurs,<br />
encore peu ou mal pris en compte<br />
dans un grand nombre <strong>de</strong> pays en développement<br />
ou en transition.<br />
Enfin, il est un outil additionnel <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />
extérieure française ; il apporte son soutien<br />
à <strong>de</strong>s projets s’inscrivant en cohérence,<br />
en synergie et en complément avec les<br />
autres programmes et instruments <strong>de</strong><br />
l’intervention française dans les pays en<br />
développement et en transition.<br />
Avec les collectivités locales françaises y compris<br />
les collectivités d’outre mer, le FFEM peut<br />
établir <strong>de</strong>s partenariats à plusieurs niveaux :<br />
institutionnel, financier, ou d’expertise.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
partenariat institutionnel : le partenaire est<br />
le bénéficiaire <strong>de</strong> la convention <strong>de</strong> financement<br />
du FFEM ; c’est le cas <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong><br />
biodiversité ;<br />
partenariat financier : le partenaire cofinance<br />
le projet ;<br />
partenariat d’expertise technique : c’est le cas<br />
<strong>de</strong> l’agence d’urbanisme <strong>de</strong> Chinon au Laos,<br />
ou <strong>de</strong>s parcs naturels régionaux en Amérique<br />
latine, ou dans le tourisme durable avec<br />
l’Université <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux au Vietnam.<br />
Enfin, la loi Oudin-Santini ouvre <strong>de</strong>s perspectives<br />
intéressantes <strong>de</strong> cofinancement entre<br />
les collectivités territoriales et le FFEM dans le<br />
domaine <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s ressources en eau.<br />
Complément d’information :<br />
Le site Internet du FFEM précise les<br />
objectifs, l’organisation, les activités et<br />
les ressources du Fonds.<br />
www.ffem.fr<br />
Les pays éligibles au FFEM sont tous les pays en<br />
développement et à économie <strong>de</strong> transition.<br />
Cependant, la priorité du FFEM va aux pays <strong>de</strong><br />
la zone <strong>de</strong> solidarité prioritaire (ZSP) ; en pratique,<br />
les 2/3 <strong>de</strong> ses ressources bénéficient à<br />
l’Afrique et à la zone méditerranéenne, le tiers<br />
restant concerne l’Asie, le Pacifique, l’Amérique<br />
latine et la Caraïbe et l’Europe <strong>de</strong> l’Est (hors<br />
Union Européenne).<br />
39
Les collectivités<br />
territoriales françaises<br />
41
Fiche 3.1. L’organisation institutionnelle <strong>de</strong>s collectivités<br />
territoriales françaises<br />
Le régime <strong>de</strong>s collectivités territoriales a fortement<br />
évolué <strong>de</strong>puis 25 ans : une trentaine <strong>de</strong><br />
lois et plusieurs centaines <strong>de</strong> décrets, ont été<br />
pris, et une révision <strong>de</strong> la Constitution a été<br />
opérée en 2003 16 .<br />
En quelques étapes :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
La loi du 2 mars 1982, relative aux droits et<br />
libertés <strong>de</strong>s communes, <strong>de</strong>s départements et<br />
<strong>de</strong>s régions (« la gran<strong>de</strong> charte <strong>de</strong>s collectivités<br />
locales »), complétée par la loi du 22 juillet<br />
1982, a supprimé la tutelle administrative a<br />
priori, qui a été remplacée par un contrôle<br />
juridictionnel a posteriori, a créé la collectivité<br />
régionale, avec <strong>de</strong>s conseillers élus au<br />
suffrage universel comme ceux <strong>de</strong>s autres<br />
collectivités, a renforcé le département en<br />
conférant au prési<strong>de</strong>nt du conseil régional la<br />
fonction d’exécutif (précé<strong>de</strong>mment exercée<br />
par le préfet).<br />
Les lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983<br />
ont défini la répartition <strong>de</strong>s compétences<br />
entre l’Etat et chaque niveau <strong>de</strong> collectivité<br />
territoriale.<br />
La loi d’orientation relative à l’administration<br />
territoriale <strong>de</strong> la République, du 6 février<br />
1992 a renforcé la déconcentration, ouvert<br />
<strong>de</strong> nouvelles formes <strong>de</strong> coopération intercommunale,<br />
et développé la démocratie<br />
locale.<br />
La loi du 12 juillet 1999 (dite « loi<br />
Chevènement ») a <strong>de</strong> nouveau réorganisé la<br />
coopération intercommunale.<br />
La loi du 28 février 2002 a aménagé la<br />
« démocratie <strong>de</strong> proximité ».<br />
La réforme constitutionnelle, quant à elle, a en<br />
particulier posé les principes <strong>de</strong> « l’organisation<br />
décentralisée » <strong>de</strong> la République et donné valeur<br />
constitutionnelle aux principes posés par les lois<br />
<strong>de</strong> 1982 (la libre administration) et 1992 (le<br />
principe <strong>de</strong> subsidiarité 17 , qui confère aux collectivités<br />
une compétence <strong>de</strong> droit commun).<br />
Trois lois organiques, relatives au référendum<br />
local, à l’expérimentation par les collectivités<br />
territoriales et à leur autonomie financière ont<br />
été adoptées en 2003 et 2004 pour mettre en<br />
œuvre les dispositions constitutionnelles.<br />
Tous ces textes ont été codifiés dans le co<strong>de</strong><br />
général <strong>de</strong>s collectivités territoriales (CGCT),<br />
dont la partie législative a été publiée en 1996,<br />
et la partie réglementaire en avril 2000. Il est<br />
constamment actualisé.<br />
L’ARCHITECTURE TERRITORIALE<br />
L’organisation administrative locale <strong>de</strong> la France<br />
se caractérise par une superposition <strong>de</strong>s niveaux<br />
administratifs et un nombre très élevé <strong>de</strong> collectivités<br />
territoriales. Depuis la décentralisation, il<br />
existe trois niveaux <strong>de</strong> collectivités locales : la<br />
commune, le département et la région.<br />
A ces trois niveaux s’ajoutent les structures <strong>de</strong><br />
coopération intercommunale.<br />
La commune est la plus petite subdivision<br />
administrative et aussi la plus ancienne 18 . On en<br />
dénombre 36 778 19 , dont 162 dans les collectivités<br />
d’outre-mer.<br />
Le département a été créé par la Révolution<br />
française ; il est <strong>de</strong>venu une collectivité locale<br />
autonome en 1871. Mais son autonomie<br />
complète (avec un organe exécutif élu) lui a été<br />
reconnue seulement en 1982.<br />
On compte 100 départements, dont 4 d’outre<br />
mer.<br />
La région est l’institution la plus récente<br />
<strong>de</strong> l’administration locale française : elle est<br />
<strong>de</strong>venue collectivité territoriale en 1982. La<br />
première élection <strong>de</strong>s conseillers régionaux a<br />
eu lieu le 16 mars 1986.<br />
Il y a en France 26 régions dont 4 d’outre mer.<br />
LES COLLECTIVITÉS À STATUT PARTICULIER<br />
Des statuts particuliers ont été définis pour différentes<br />
catégories <strong>de</strong> collectivités territoriales,<br />
16<br />
Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée <strong>de</strong> la République.<br />
17<br />
« Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble <strong>de</strong>s compétences qui peuvent le mieux<br />
être mises en œuvre à leur échelon. »<br />
18<br />
Elle a succédé aux villes et paroisses du Moyen Âge ; elle a été instituée en 1789 avant <strong>de</strong> connaître un début d’autonomie<br />
avec la loi du 5 avril 1884.<br />
19<br />
dont 5 n’ont aucun habitant, 4 000 moins <strong>de</strong> 100, et plus <strong>de</strong> 10 000 moins <strong>de</strong> 2 000 habitants<br />
42
Les collectivités territoriales françaises<br />
Fiche 3.1. L’organisation institutionnelle <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises<br />
en raison <strong>de</strong> leur situation géographique ou <strong>de</strong><br />
leur démographie.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
La ville <strong>de</strong> Paris : son statut actuel a été fixé par<br />
la loi du 2 mars 1982. La ville <strong>de</strong> Paris est à la fois<br />
une commune et un département. Le conseil <strong>de</strong><br />
Paris exerce donc les attributions <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux<br />
catégories <strong>de</strong> collectivités. La ville est subdivisée<br />
en 20 arrondissements ; chacun d’eux est doté<br />
d’un conseil et d’un maire, mais leurs attributions<br />
sont limitées, et principalement orientées<br />
vers l’animation <strong>de</strong> la vie locale.<br />
Les villes <strong>de</strong> Lyon et Marseille : leur statut a<br />
également été fixé par la loi du 2 mars 1982 ;<br />
elles sont subdivisées en arrondissements.<br />
La Corse : son statut actuel a été fixé par la loi<br />
du 22 janvier 2002, qui renforce ses compétences,<br />
et lui reconnaît un pouvoir d’adaptation <strong>de</strong>s<br />
règlements nationaux sur habilitation préalable<br />
du législateur.<br />
Les collectivités d’outre mer : leur régime<br />
actuel est fixé par la loi d’orientation pour<br />
l’outre mer du 13 décembre 2000.<br />
- les 4 départements d’outre mer (DOM :<br />
Gua<strong>de</strong>loupe, Guyane, Martinique,<br />
Réunion) sont soumis au droit commun <strong>de</strong>s<br />
départements, sous réserve <strong>de</strong> « mesures<br />
d’adaptation nécessitées par leur situation<br />
particulière ;<br />
- Mayotte, dotée par la loi du 11 juillet<br />
2001 d’un statut provisoire pour 10 ans,<br />
<strong>de</strong>vra se prononcer à cette échéance sur<br />
son indépendance ou sur son maintien dans<br />
la République française comme DOM ;<br />
- les îles <strong>de</strong> Saint Pierre et Miquelon ont<br />
également un statut particulier, proche <strong>de</strong><br />
celui <strong>de</strong> DOM ;<br />
- les 3 territoires d’outre mer (TOM : la<br />
Nouvelle Calédonie, la Polynésie, Wallis et<br />
Futuna) ont chacun un statut propre ; celui<br />
<strong>de</strong> la Nouvelle Calédonie, fixé par la loi du<br />
19 mars 1999, prévoit l’établissement <strong>de</strong><br />
la « pleine souveraineté » à l’échéance <strong>de</strong><br />
2018 ;<br />
- les Terres australes et antarctiques,<br />
dépourvues d’habitants, sont gérées par<br />
un administrateur établi à Saint Denis <strong>de</strong> la<br />
Réunion.<br />
LES STRUCTURES DE COOPÉRATION<br />
INTERCOMMUNALE<br />
L’émiettement communal a poussé à imaginer<br />
<strong>de</strong>s formes très diverses <strong>de</strong> structures <strong>de</strong><br />
coopération, les établissements publics <strong>de</strong><br />
coopération intercommunale (EPCI). Ceux-ci<br />
réunissent aujourd’hui 91 % <strong>de</strong>s communes et<br />
87 % <strong>de</strong> la population française.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
les syndicats <strong>de</strong> communes : c’est la forme la<br />
plus ancienne et la plus souple ; le syndicat a<br />
« une vocation unique » (SIVU), pour gérer<br />
un seul service d’intérêt commun, ou « une<br />
vocation multiple » (SIVOM), pour en gérer<br />
plusieurs ; les communes membres fixent les<br />
compétences qu’elles délèguent, et versent<br />
une contribution financière au budget du<br />
syndicat ; il existe environ 17 000 syndicats,<br />
dont 15 000 SIVU ;<br />
les syndicats mixtes, qui associent exclusivement<br />
<strong>de</strong>s communes (syndicats mixtes<br />
fermés), ou <strong>de</strong>s communes et d’autres collectivités<br />
(syndicats mixtes ouverts) ;<br />
le pays, « espace pertinent <strong>de</strong> projet », créé par<br />
la loi <strong>de</strong> 1995, et relancé par la loi <strong>de</strong> 1999 20 ;<br />
son périmètre respecte celui <strong>de</strong>s autres EPCI,<br />
auxquels il se superpose pour la mise en œuvre<br />
<strong>de</strong> projets <strong>de</strong> développement durable dans le<br />
cadre d’une « charte <strong>de</strong> pays » ;<br />
la communauté urbaine 21 , formule ancienne<br />
dont le régime a été aménagé en 1999 ;<br />
elle regroupe une population d’au moins<br />
500 000 habitants ; c’est une forme <strong>de</strong><br />
coopération très structurante, avec <strong>de</strong>s<br />
compétences obligatoires (aménagement,<br />
environnement et cadre <strong>de</strong> vie, développement<br />
économique, politique <strong>de</strong> la ville,<br />
habitat, services d’intérêt collectif) et d’autres<br />
facultatives (décidées par les communes<br />
membres), et <strong>de</strong>s ressources propres (taxe<br />
professionnelle unique, surtaxes à la taxe<br />
d’habitation et aux taxes foncières, contributions<br />
<strong>de</strong>s communes votées par le conseil<br />
communautaire) ;<br />
la communauté d’agglomération 22 , créée par<br />
la loi <strong>de</strong> 1999 ; elle regroupe une population<br />
d’au moins 50 000 habitants, autour d’une<br />
ville d’au moins 15 000 habitants ; elle a<br />
également <strong>de</strong>s compétences obligatoires<br />
(aménagement, développement économique,<br />
politique <strong>de</strong> la ville, habitat, services d’intérêt<br />
collectif) et d’autres facultatives (3 parmi<br />
les 5 suivantes : voirie, assainissement, eau,<br />
environnement, équipements culturels et<br />
sportifs) ; sa principale ressource est la taxe<br />
professionnelle unique ;<br />
20<br />
relative à l’aménagement et au développement durable<br />
21<br />
14 communautés urbaines regroupant 6,2 millions d’habitants<br />
22<br />
169 communautés d’agglomération regroupant 21,2 millions d’habitants<br />
43
- la communauté <strong>de</strong> communes 23 , créée par la<br />
loi <strong>de</strong> 1992 ; elle est créée par arrêté préfectoral<br />
à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’une <strong>de</strong>s communes, mais<br />
une commune peut se retirer <strong>de</strong> la communauté<br />
si 1/3 <strong>de</strong>s conseillers <strong>de</strong>s communes<br />
membres ne s’y oppose pas ; la communauté<br />
<strong>de</strong> communes a <strong>de</strong>ux compétences obligatoires<br />
: l’aménagement et le développement.<br />
est assez stable, mais la proportion <strong>de</strong>s titulaires<br />
s’accroît d’année en année. Près <strong>de</strong> 46 % <strong>de</strong>s<br />
agents sont <strong>de</strong>s techniciens, environ 26 % <strong>de</strong>s<br />
agents administratifs, 14 % <strong>de</strong>s agents du secteur<br />
médico-social. Les autres se répartissent<br />
en catégories très diverses : culture, animation<br />
et sport, sécurité, incendie et secours, etc.<br />
Environ 8 % <strong>de</strong>s agents sont <strong>de</strong>s cadres A,<br />
14 % <strong>de</strong>s cadres B. Ce taux d’encadrement est<br />
très inférieur à celui observé dans la fonction<br />
publique <strong>de</strong> l’Etat (52 % <strong>de</strong> cadres A, et 22 %<br />
L’ADMINISTRATION DES<br />
hors enseignants).<br />
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />
L’administration <strong>de</strong> la collectivité est exercée<br />
par un conseil élu au suffrage universel direct<br />
(l’organe délibérant) et un organe exécutif<br />
(maire, prési<strong>de</strong>nt du conseil général ou du<br />
conseil régional), élu par le conseil en son sein.<br />
Les conseils municipaux, généraux et régionaux<br />
sont élus pour 6 ans.<br />
L’organe exécutif représente la collectivité,<br />
et il est re<strong>de</strong>vable <strong>de</strong> la politique menée et<br />
<strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers publics <strong>de</strong>vant les<br />
citoyens. Il gère le budget adopté par l’organe<br />
délibérant (voir fiche 4.2.), et il est l’employeur<br />
du personnel <strong>de</strong> la collectivité.<br />
Le maire est également le représentant <strong>de</strong> l’Etat<br />
pour les fonctions d’état civil, d’ordre public,<br />
d’organisation <strong>de</strong>s élections et <strong>de</strong> délivrance <strong>de</strong><br />
certains titres réglementaires.<br />
Depuis 1982, les collectivités sont soumises au<br />
contrôle <strong>de</strong> légalité : les actes (délibérations<br />
du conseil, arrêtés du maire ou du prési<strong>de</strong>nt)<br />
sont immédiatement exécutoires, mais transmis<br />
au préfet, qui peut les déférer au tribunal administratif,<br />
dans un délai <strong>de</strong> 2 mois, s’il les estime<br />
illégaux. La seule survivance <strong>de</strong> la tutelle est le<br />
pouvoir <strong>de</strong> substitution, qui permet au préfet,<br />
dans <strong>de</strong>s cas limitativement énumérés, et après<br />
mise en <strong>de</strong>meure, <strong>de</strong> se substituer à l’autorité<br />
locale défaillante.<br />
Les agents <strong>de</strong>s collectivités territoriales :<br />
Créée par la loi du 26 janvier 1984 qui a<br />
posé les principes généraux définissant son<br />
cadre d’action et son organisation, la fonction<br />
publique territoriale regroupe les personnels<br />
<strong>de</strong>s collectivités territoriales, <strong>de</strong>s structures<br />
intercommunales, <strong>de</strong>s établissements publics et<br />
<strong>de</strong>s offices publics d’HLM.<br />
L’effectif total est d’environ 1,7 million, dont 1,2<br />
million <strong>de</strong> fonctionnaires titulaires. Cet effectif<br />
Le Centre national <strong>de</strong> la fonction publique<br />
territoriale (CNFPT) a été créé par la loi<br />
n°84-53 du 26 janvier 1984, récemment modifiée<br />
par la loi du 19 février 2007.<br />
C’est un établissement public, paritaire et<br />
déconcentré, chargé <strong>de</strong>s missions suivantes :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
la formation et la professionnalisation <strong>de</strong><br />
l’ensemble <strong>de</strong>s personnels <strong>de</strong>s collectivités<br />
territoriales ;<br />
l’organisation <strong>de</strong> certains concours et examens<br />
<strong>de</strong> la fonction publique territoriale ;<br />
la régulation <strong>de</strong> l’emploi et <strong>de</strong>s carrières <strong>de</strong>s<br />
cadres <strong>de</strong>s collectivités territoriales.<br />
Il est financé par une cotisation obligatoire <strong>de</strong>s<br />
collectivités (1 % <strong>de</strong> leur masse salariale).<br />
LES COMPÉTENCES DES<br />
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />
Les lois <strong>de</strong> 1982, qui ont opéré <strong>de</strong> larges transferts<br />
<strong>de</strong> compétences, ont posé les principes<br />
suivants :<br />
-<br />
-<br />
les compétences ont été transférées « en<br />
bloc », chaque niveau <strong>de</strong> collectivité disposant<br />
d’une plénitu<strong>de</strong> d’attribution dans les<br />
matières transférées ;<br />
les transferts <strong>de</strong> compétences ont été<br />
accompagnés du transfert concomitant <strong>de</strong>s<br />
ressources propres à assurer « la compensation<br />
intégrale » <strong>de</strong>s charges, et <strong>de</strong> la mise à<br />
disposition <strong>de</strong>s services et biens meubles et<br />
immeubles utilisés par l’Etat pour l’exercice<br />
<strong>de</strong>s compétences transférées.<br />
L’application du principe <strong>de</strong> subsidiarité, la<br />
clause <strong>de</strong> compétence générale, et ces transferts<br />
ont conduit à reconnaître à chaque niveau<br />
<strong>de</strong> collectivité les compétences résumées sur le<br />
tableau ci-après.<br />
23<br />
2 400 communautés <strong>de</strong> communes regroupant 26,5 millions d’habitants<br />
44
Les collectivités territoriales françaises<br />
Fiche 3.1. L’organisation institutionnelle <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises<br />
LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE : EVOLUTION HISTORIQUE<br />
La coopération décentralisée est née <strong>de</strong>s jumelages. Son développement est favorisé, dans le mon<strong>de</strong> par les progrès <strong>de</strong> la<br />
décentralisation, en France par un cadre juridique <strong>de</strong>venu très favorable, après une longue méfiance <strong>de</strong> l’Etat.<br />
A l’origine, le jumelage est une métaphore et non un concept politique. Le mot « jumelage » n’existe pas avant la première<br />
guerre mondiale. Les premiers jumelages « interalliés » se nouent entre écoles, et ont une vocation linguistique. Les plus<br />
nombreux associent <strong>de</strong>s écoles françaises et <strong>de</strong>s écoles anglophones, anglaises ou américaines. En se renforçant, ils mobilisent<br />
les communes, et conduisent à la création <strong>de</strong> la « fédération du mon<strong>de</strong> bilingue ».<br />
Après la guerre, sous l’impulsion d’anciens résistants, <strong>de</strong> nouveaux jumelages, inspirés par la volonté <strong>de</strong> restaurer et d’entretenir<br />
la paix lient <strong>de</strong>s villes françaises et alleman<strong>de</strong>s. Pendant la guerre froi<strong>de</strong>, dans le contexte <strong>de</strong> l’appel <strong>de</strong> Stockholm 24 , le jumelage<br />
acquiert un caractère politique, sur les thèmes <strong>de</strong> la paix, du refus <strong>de</strong> la guerre froi<strong>de</strong>, <strong>de</strong> l’amitié entre les peuples. Les villes<br />
gérées par <strong>de</strong>s conseils communistes sont fortement encouragées à se jumeler avec <strong>de</strong>s villes d’Europe <strong>de</strong> l’Est, encore sous<br />
domination soviétique. Le chanoine Kir, maire <strong>de</strong> Dijon, avait ainsi établi un jumelage avec la ville <strong>de</strong> Leningrad, ce qui suscita<br />
la désapprobation à la fois du pape et du Général <strong>de</strong> Gaulle.<br />
La Fédération Mondiale <strong>de</strong>s Villes Jumelées (FMVJ) fut créée en 1957, à Aix les Bains, sur les bases posées par la « fédération<br />
du mon<strong>de</strong> bilingue ». En France, le Gouvernement eut <strong>de</strong>s hésitations sur la position à adopter. Ordres et contre-ordres furent<br />
adressés aux préfets et aux ambassa<strong>de</strong>urs sur la conduite à tenir face aux initiatives <strong>de</strong>s communes.<br />
Parallèlement, dès avant la décolonisation, <strong>de</strong>s jumelages furent établis avec <strong>de</strong>s villes d’Afrique francophone. Le premier,<br />
pendant les années 50, lia la ville <strong>de</strong> Millau et celle <strong>de</strong> Louga, au Sénégal. Beaucoup d’autres apparurent avec les indépendances,<br />
souvent inspirés par le syndicalisme agricole chrétien, sur <strong>de</strong>s thèmes tiers-mondistes et <strong>de</strong> solidarité internationale. Ce saut<br />
qualitatif - du politique au caritatif, ou à l’humanitaire - est à l’origine <strong>de</strong> la coopération décentralisée actuelle.<br />
Cette caractéristique s’est renforcée dans les années 70, lors <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s sècheresses qui affectèrent le Sahel. Ces catastrophes,<br />
les premières à être médiatisées, ont suscité <strong>de</strong>s élans <strong>de</strong> solidarité. Les syndicats agricoles, en particulier, se sont beaucoup<br />
mobilisés, et ont sollicité <strong>de</strong>s ai<strong>de</strong>s financières auprès <strong>de</strong>s communes. Pendant longtemps, la coopération décentralisée a ainsi<br />
plutôt ciblé les zones rurales, avec l’idée d’ai<strong>de</strong>r à maintenir les paysans sur leurs terres, d’endiguer l’exo<strong>de</strong> rural, etc. A la même<br />
époque, la Coopération française était aussi très inspirée par ces thèmes ruralistes.<br />
Quelques villes plus importantes conclurent <strong>de</strong>s jumelages (Angers avec Bamako, Loudun avec Ouagadougou), mais ce furent<br />
<strong>de</strong>s exceptions, liées à <strong>de</strong>s personnalités elles-mêmes exceptionnelles.<br />
Un autre phénomène a favorisé le développement <strong>de</strong> la coopération décentralisée parmi les gran<strong>de</strong>s villes françaises. La longue<br />
domination <strong>de</strong> la droite au niveau national a poussé les personnalités <strong>de</strong> gauche, élus locaux, à développer leurs relations<br />
internationales par d’autres voies. Ainsi, Gaston Defferre avec le partenariat Marseille - Alger), ou Pierre Mauroy avec celui<br />
<strong>de</strong> la région Nord-Pas-<strong>de</strong>-Calais avec la région voisine <strong>de</strong> la Flandre belge). Lorsque la gauche arriva au pouvoir, en 1981, elle<br />
modifia le régime <strong>de</strong>s collectivités territoriales et leur autorisa les relations internationales.<br />
Depuis, la coopération décentralisée, légitimée, s’est professionnalisée. L’intervention <strong>de</strong>s services <strong>de</strong>s collectivités plutôt<br />
que celle <strong>de</strong>s anciennes associations, l’action <strong>de</strong>s intercommunalités et <strong>de</strong>s départements ont favorisé une approche plus<br />
programmatique. Des jumelages fondés sur <strong>de</strong>s relations personnelles, on est passé à une démarche humanitaire et caritative,<br />
caractérisée par <strong>de</strong>s dons à la population ou à la collectivité. Puis sont apparus les projets, inspirés par <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> développement<br />
<strong>de</strong> la solidarité, et orientés vers le renforcement <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> proximité. Des programmes pluriannuels sont élaborés<br />
en commun, privilégiant l’appui institutionnel et le développement économique, et recherchant <strong>de</strong>s avantages réciproques<br />
pour les collectivités partenaires. Le partenariat entre les villes <strong>de</strong> Grenoble et <strong>de</strong> Constantine, par exemple, a donné lieu à <strong>de</strong>s<br />
échanges <strong>de</strong> savoir-faire avec une volonté <strong>de</strong> réciprocité.<br />
Les différentes formes <strong>de</strong> relations entre les villes et les villages cohabitent aujourd’hui : <strong>de</strong>s jumelages traditionnels très vivants,<br />
<strong>de</strong>s coopérations décentralisées, au sens propre, <strong>de</strong> projet et <strong>de</strong> programme, <strong>de</strong>s coopérations trilatérales (Nord-Nord-Sud ou<br />
Nord-Sud-Sud). Cette diversité est une richesse, et elle résiste aux tentatives <strong>de</strong> régulation ou d’homogénéisation.<br />
La coopération décentralisée française transcen<strong>de</strong> les courants politiques, ce qui est sans doute lié au consensus assez large<br />
prévalant, dans la société, sur la politique internationale, et cela ne se retrouve pas dans beaucoup <strong>de</strong> pays. Les crédits <strong>de</strong>stinés à<br />
cette coopération sont généralement votés à l’unanimité 25 et ne constituent pas une variable d’ajustement budgétaire. Lors <strong>de</strong>s<br />
changements <strong>de</strong> majorité au sein <strong>de</strong>s conseils, les liens existants, les projets et programmes sont le plus souvent maintenus.<br />
Le consensus politique se retrouve au sein <strong>de</strong> CUF. Son prési<strong>de</strong>nt fondateur 26 , M. Bernard Stasi, était lui-même élu local, centriste<br />
social-démocrate, d’inspiration chrétienne, humaniste et tiers-mondiste. Son <strong>de</strong>uxième prési<strong>de</strong>nt, M. Charles Josselin,<br />
également élu local, socialiste, a été Ministre délégué chargé <strong>de</strong> la coopération et <strong>de</strong> la francophonie. Il avait alors sensibilisé le<br />
corps diplomatique à la coopération décentralisée, et ainsi favorisé l’évolution <strong>de</strong>s mentalités et <strong>de</strong>s pratiques.<br />
Des élus <strong>de</strong> toutes tendances composent les instances dirigeantes <strong>de</strong> CUF, le conseil national (72 membres) et le bureau<br />
exécutif (30 membres dont <strong>de</strong>ux pour chacune <strong>de</strong>s associations <strong>de</strong> collectivités : l’Association <strong>de</strong>s Maires <strong>de</strong> France - AMF -,<br />
l’Assemblée <strong>de</strong>s départements <strong>de</strong> France - ADF - et l’Association <strong>de</strong>s Régions <strong>de</strong> France - ARF).<br />
24<br />
lancé le 19 mars 1950 contre l’arme atomique par le Mouvement mondial <strong>de</strong>s partisans <strong>de</strong> la paix, d’inspiration communiste,<br />
avec le soutien <strong>de</strong> nombreux intellectuels et artistes<br />
25<br />
Même pour les coopérations importantes, ces crédits sont cependant marginaux dans le budget d’une collectivité locale.<br />
26<br />
Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> 1975 à 2004.<br />
45
Compétences <strong>de</strong> la commune :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
l’état civil<br />
les fonctions électorales : organisation <strong>de</strong>s élections, révision <strong>de</strong>s listes électorales<br />
la protection <strong>de</strong> l’ordre public : pouvoirs <strong>de</strong> police du maire<br />
l’action sociale : gar<strong>de</strong>ries, crèches, foyers <strong>de</strong> personnes âgées<br />
l’école primaire : construction, entretien, équipement <strong>de</strong>s établissements scolaires<br />
la santé : résorption <strong>de</strong> l’insalubrité dans l’habitat, vaccination, <strong>de</strong> lutte contre la tuberculose, la<br />
lèpre, le sida et les infections sexuellement transmissibles<br />
l’entretien <strong>de</strong> la voirie communale<br />
l’aménagement : logement social, zones d’activités, assainissement, protection <strong>de</strong>s sites<br />
l’urbanisme : plan local d’urbanisme, schéma <strong>de</strong> cohérence territoriale<br />
l’action économique : ai<strong>de</strong>s directes ou indirectes (garantie d’emprunt) aux entreprises<br />
le tourisme, les ports <strong>de</strong> plaisance et les aérodromes<br />
le logement<br />
la culture : bibliothèques <strong>de</strong> prêts, musées, conservatoires municipaux, l’enseignement artistique<br />
Compétences du département :<br />
- l’action sociale et sanitaire :<br />
- ensemble <strong>de</strong>s prestations d’ai<strong>de</strong> sociale<br />
- ai<strong>de</strong> sociale à l’enfance<br />
- ai<strong>de</strong> aux handicapés<br />
- ai<strong>de</strong> aux personnes âgées<br />
- insertion sociale et professionnelle<br />
- ai<strong>de</strong> au logement<br />
- protection judiciaire <strong>de</strong> la jeunesse<br />
- protection sanitaire <strong>de</strong> la famille et <strong>de</strong> l’enfance<br />
- l’aménagement <strong>de</strong> l’espace et l’équipement :<br />
- voirie départementale et une partie <strong>de</strong>s routes nationales<br />
- organisation <strong>de</strong>s transports routiers non urbains<br />
- ports maritimes <strong>de</strong> commerce et <strong>de</strong> pêche<br />
- aérodromes civils<br />
- ai<strong>de</strong>s à l’équipement rural<br />
- aménagement, entretien et exploitation <strong>de</strong>s cours d’eau, lacs et plans d’eau domaniaux<br />
- protection, gestion et ouverture au public <strong>de</strong>s espaces naturels sensibles<br />
- l’éducation, la culture et le patrimoine :<br />
- collèges : construction, reconstruction, extension, grosses réparations, équipement et<br />
fonctionnement<br />
- bibliothèques centrales <strong>de</strong> prêt, archives et musées départementaux<br />
- enseignements artistiques<br />
- patrimoine classé ou inscrit<br />
- les actions économiques :<br />
- ai<strong>de</strong>s directes au développement économique<br />
- ai<strong>de</strong>s directes et indirectes aux entreprises<br />
46
Les collectivités territoriales françaises<br />
Fiche 3.1. L’organisation institutionnelle <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises<br />
Compétences <strong>de</strong> la région :<br />
- le développement économique :<br />
- définition du régime <strong>de</strong>s ai<strong>de</strong>s économiques aux entreprises<br />
- élaboration du schéma régional <strong>de</strong> développement économique<br />
- l’aménagement du territoire et la planification :<br />
- schéma régional d’aménagement et <strong>de</strong> développement du territoire (SRADT)<br />
- contrats <strong>de</strong> projets entre l’État et les régions<br />
- aérodromes civils<br />
- ports non autonomes<br />
- schéma régional <strong>de</strong>s infrastructures et <strong>de</strong>s transports<br />
- l’éducation, la formation professionnelle et la culture :<br />
- lycées, établissements d’éducation spéciale et lycées professionnels maritimes : construction,<br />
reconstruction, extension, grosses réparations, équipement et fonctionnement<br />
- formation professionnelle<br />
- participation au financement <strong>de</strong>s établissements universitaires<br />
- musées régionaux, archives régionales<br />
- inventaire général du patrimoine culturel<br />
- enseignement artistique professionnel initial<br />
- la santé :<br />
- équipements sanitaires<br />
- vaccination, <strong>de</strong> lutte contre la tuberculose, la lèpre, le sida et les infections sexuellement<br />
transmissibles.<br />
LES INSTITUTIONS DE<br />
CONCERTATION<br />
Outre la CNCD, déjà mentionnée (voir fiche<br />
1.1.), il existe <strong>de</strong> multiples institutions <strong>de</strong><br />
concertation. Leur objet est <strong>de</strong> permettre<br />
la concertation entre l’Etat et les élus, entre<br />
ceux-ci et les représentants <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong>s<br />
collectivités territoriales.<br />
Le Comité <strong>de</strong>s finances locales (CFL) est<br />
composé <strong>de</strong> représentants <strong>de</strong> l’Etat et d’élus<br />
locaux ; il est consulté sur tout projet ayant une<br />
inci<strong>de</strong>nce sur les finances locales, et donc en<br />
particulier sur le projet <strong>de</strong> loi <strong>de</strong> finances.<br />
Le Conseil supérieur <strong>de</strong> la fonction publique<br />
territoriale (CSFPT) est consulté sur tout projet<br />
<strong>de</strong> texte relatif à la fonction publique territoriale.<br />
La Commission commune <strong>de</strong>s transferts <strong>de</strong><br />
personnels entre l’Etat et les collectivités<br />
territoriales est consultée sur les projets <strong>de</strong><br />
décret relatifs aux transferts <strong>de</strong> personnels liés<br />
à la décentralisation.<br />
Le Conseil national <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong>s<br />
élus locaux (CNFEL) définit les orientations<br />
générales <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong>s élus locaux. Il est<br />
obligatoirement consulté sur toutes les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
présentées par les organismes publics ou<br />
privés désirant dispenser une formation <strong>de</strong>stinée<br />
aux élus locaux.<br />
Le Conseil national <strong>de</strong>s opérations funéraires<br />
(CNOF) est consulté sur tout projet relatif<br />
au cadre législatif et réglementaire du domaine<br />
funéraire.<br />
La commission <strong>de</strong> déontologie <strong>de</strong> la fonction<br />
publique est saisie pour avis lorsqu’une<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> est présentée par un agent <strong>de</strong> la<br />
fonction publique territoriale pour exercer une<br />
activité privée.<br />
La commission consultative sur l’évaluation<br />
<strong>de</strong>s charges (CCEC) a pour mission essentielle<br />
d’assurer le contrôle <strong>de</strong> la compensation financière<br />
allouée aux collectivités territoriales en<br />
contrepartie <strong>de</strong>s transferts <strong>de</strong> compétences.<br />
47
Fiche 3.2. L’organisation financière <strong>de</strong>s collectivités<br />
territoriales françaises<br />
Considérées pendant longtemps comme<br />
marginales dans le bloc <strong>de</strong>s finances publiques,<br />
les finances <strong>de</strong>s collectivités territoriales en<br />
constituent maintenant une part importante, et<br />
tiennent une place croissante dans l’économie<br />
nationale.<br />
LA GESTION BUDGÉTAIRE<br />
Le budget <strong>de</strong> la collectivité est l’acte qui prévoit<br />
et autorise les recettes et les dépenses. Il est<br />
préparé par le maire ou le prési<strong>de</strong>nt, et voté<br />
par l’assemblée délibérante <strong>de</strong> la collectivité<br />
(conseil municipal, général ou régional selon<br />
le cas). En cours d’exercice, un budget supplémentaire<br />
(comparable à une loi <strong>de</strong> finances<br />
rectificative) peut être adopté selon les mêmes<br />
modalités.<br />
Il doit respecter les principes fondamentaux<br />
suivants :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
l’universalité : le budget retrace toutes les<br />
prévisions <strong>de</strong> recettes et <strong>de</strong> dépenses <strong>de</strong><br />
l’année ;<br />
l’annualité : le budget s’applique à une<br />
pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> douze mois ; chaque collectivité<br />
adopte son budget pour l’année suivante<br />
avant le 1 er janvier 27 ; une loi récente 28 assouplit<br />
fortement ce principe en élargissant les<br />
mécanismes <strong>de</strong> pluri-annualité ;<br />
l’équilibre réel : ce principe est celui qui<br />
distingue le plus le budget <strong>de</strong>s collectivités<br />
territoriales <strong>de</strong> celui <strong>de</strong> l’Etat ; le contrôle<br />
<strong>de</strong> l’équilibre (qui passe par l’examen <strong>de</strong> la<br />
« sincérité » <strong>de</strong>s prévisions <strong>de</strong> recettes et<br />
<strong>de</strong> dépenses) peut donner lieu à la saisine<br />
<strong>de</strong> la juridiction financière (voir ci-après), et<br />
entraîner le règlement d’office du budget en<br />
déséquilibre par le préfet.<br />
L’exécution budgétaire est soumise, comme<br />
pour toutes les institutions publiques, aux<br />
règles <strong>de</strong> la comptabilité publique : l’ordonnateur<br />
<strong>de</strong> la collectivité est son organe exécutif<br />
(le maire ou le prési<strong>de</strong>nt du conseil), qui peut<br />
donner délégation à <strong>de</strong>s adjoints ou à <strong>de</strong>s<br />
collaborateurs ; la collectivité est dotée d’un<br />
comptable public (fonctionnaire du Trésor), qui<br />
exécute les ordres <strong>de</strong> recettes et <strong>de</strong> dépenses<br />
et gère la trésorerie. Celle-ci est normalement<br />
déposée au Trésor (sous réserve <strong>de</strong> certaines<br />
exceptions 29 ).<br />
Ce sont également les services <strong>de</strong> l’Etat qui<br />
assurent l’émission <strong>de</strong>s taxes et impôts locaux<br />
(services fiscaux) et leur recouvrement (services<br />
du Trésor). En contrepartie d’un recouvrement<br />
supplémentaire, actuellement fixé à 8 %, l’Etat<br />
prend en charge les restes à recouvrer, et<br />
reverse aux collectivités la totalité du produit<br />
fiscal émis.<br />
Le contrôle budgétaire est exercé par les<br />
chambres régionales <strong>de</strong>s comptes 30 , qui ont<br />
une triple mission :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
le contrôle juridictionnel : le jugement <strong>de</strong>s<br />
comptes <strong>de</strong>s comptables publics locaux est<br />
systématique ; il se conclut par un jugement,<br />
<strong>de</strong> quitus en cas <strong>de</strong> régularité du compte, <strong>de</strong><br />
débet dans le cas contraire ; <strong>de</strong>s recours sont<br />
possibles, en appel <strong>de</strong>vant la Cour <strong>de</strong>s comptes<br />
et en cassation <strong>de</strong>vant le Conseil d’Etat ;<br />
le contrôle administratif, sur saisine du préfet,<br />
en cas <strong>de</strong> vote tardif du budget, <strong>de</strong> déséquilibre<br />
entre les recettes et les dépenses, <strong>de</strong><br />
défaut d’inscription d’une dépense obligatoire,<br />
ou <strong>de</strong> déficit d’exécution supérieur à<br />
un certain seuil 31 ;<br />
le contrôle <strong>de</strong> gestion, exercé a posteriori, à<br />
l’initiative <strong>de</strong> la chambre, et qui porte sur la<br />
gestion <strong>de</strong> l’ordonnateur et sur le bon emploi<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers publics ; ce contrôle se conclut<br />
par <strong>de</strong>s observations (le cas échéant par la<br />
saisine <strong>de</strong>s tribunaux en cas <strong>de</strong> faute pénale<br />
<strong>de</strong> gestion).<br />
27<br />
la loi accor<strong>de</strong> une tolérance jusqu’au 31 mars, voire jusqu’au 15 avril, les années <strong>de</strong> renouvellement <strong>de</strong>s assemblées locales<br />
28<br />
l’ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’aménagement <strong>de</strong>s règles budgétaires et comptables applicables<br />
aux collectivités territoriales<br />
29<br />
Le nouveau statut <strong>de</strong> l’AFD l’autorise à assurer la gestion et le paiement <strong>de</strong> toutes opérations pour le compte <strong>de</strong> collectivités<br />
territoriales d’outre-mer, et, pour les autres collectivités territoriales, la gestion et les paiements associés <strong>de</strong>s seules opérations<br />
s’inscrivant dans le cadre <strong>de</strong> programmes <strong>de</strong> coopération décentralisée.<br />
30<br />
il en existe 26<br />
31<br />
le seuil est <strong>de</strong> 10% <strong>de</strong>s recettes <strong>de</strong> fonctionnement pour les communes <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 20 000 habitants, <strong>de</strong> 5% pour toutes les<br />
autres collectivités<br />
48
Les collectivités territoriales françaises<br />
Fiche 3.2. L’organisation financière <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises<br />
LES RESSOURCES DES<br />
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />
Elles sont regroupées dans les catégories<br />
suivantes :<br />
LES RESSOURCES FISCALES<br />
Elles représentent environ 40 % <strong>de</strong>s recettes<br />
<strong>de</strong>s collectivités. Pour l’essentiel (à hauteur <strong>de</strong><br />
80 %), la fiscalité locale repose sur 4 anciennes<br />
taxes directes : la taxe foncière sur les propriétés<br />
bâties, la taxe foncière sur les propriétés<br />
non bâties, la taxe d’habitation (ces trois taxes<br />
étant imposées aux ménages), et la taxe professionnelle<br />
(pesant sur les activités).<br />
Cette <strong>de</strong>rnière taxe est celle qui engendre les<br />
plus gran<strong>de</strong>s inégalités <strong>de</strong> ressources entre les<br />
collectivités. Pour réduire ces inégalités, un fonds<br />
<strong>de</strong> péréquation a été créé : il est alimenté par<br />
un prélèvement sur les ressources exceptionnellement<br />
élevées <strong>de</strong> taxe professionnelle, et il<br />
subventionne les communes les plus démunies.<br />
Par ailleurs, pour favoriser la coopération intercommunale,<br />
la « taxe professionnelle unique »<br />
est perçue directement au profit <strong>de</strong> certains<br />
<strong>de</strong>s EPCI (voir fiche 3.1.) : son taux est alors<br />
unique pour toutes les communes membres, et<br />
son produit est entièrement affecté à l’EPCI.<br />
La fiscalité locale est un sujet <strong>de</strong> débat ancien et<br />
parfois tendu entre l’Etat et les autorités locales<br />
: le régime <strong>de</strong>s impôts locaux repose sur <strong>de</strong>s<br />
taxes très anciennes ; il est modifié unilatéralement<br />
par l’Etat ; les bases d’imposition <strong>de</strong> celles<br />
qui pèsent sur les ménages sont actualisées,<br />
mais n’ont pas été globalement révisées,et sont<br />
source d’inégalités sociales.<br />
Les collectivités territoriales perçoivent<br />
également <strong>de</strong>s taxes, dites - improprement<br />
- indirectes : la taxe locale d’équipement, le<br />
versement <strong>de</strong>stiné aux transports en commun,<br />
les taxes <strong>de</strong> séjour, les taxes sur la publicité, la<br />
taxe sur les jeux dans les casinos.<br />
LE PRIX DES SERVICES RENDUS<br />
La part <strong>de</strong> ces recettes dans l’alimentation <strong>de</strong>s<br />
budgets locaux est en croissance ; cette augmentation<br />
traduit la volonté politique <strong>de</strong> faire<br />
payer les services rendus par les usagers plutôt<br />
que par les contribuables.<br />
A l’exception <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s transports urbains et<br />
<strong>de</strong>s cantines scolaires, la tarification <strong>de</strong>s services<br />
est libre <strong>de</strong>puis 1987.<br />
LES TRANSFERTS DE L’ETAT<br />
Ils ont été profondément réformés en 1982,<br />
afin <strong>de</strong> les globaliser. Les dotations sont libres<br />
d’emploi, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas affectées<br />
à une dépense précise, et leur obtention<br />
est automatique.<br />
Ils sont constitués <strong>de</strong> trois gran<strong>de</strong>s dotations, à<br />
caractère global, représentant environ le tiers<br />
du volume global <strong>de</strong>s transferts :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
la dotation globale <strong>de</strong> fonctionnement (environ<br />
le tiers) ;<br />
la dotation globale <strong>de</strong> décentralisation<br />
(0,04 %), qui avait pour objet <strong>de</strong> financer les<br />
transferts <strong>de</strong> compétences, mais qui a été en<br />
gran<strong>de</strong> partie intégrée dans la DGF ;<br />
la dotation globale d’investissement (0,02 %) ;<br />
et d’autres versements plus ciblés :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
la compensation d’exonérations et dégrèvements<br />
décidés par l’Etat sur les taxes<br />
locales (plus souvent la taxe professionnelle),<br />
qui représente près <strong>de</strong> 30 % du total <strong>de</strong>s<br />
transferts ;<br />
la « fiscalité transférée » (plus <strong>de</strong> 10 %) ;<br />
le fonds <strong>de</strong> compensation <strong>de</strong> la TVA (environ<br />
7 %), qui « rembourse » (par un mécanisme<br />
complexe) la TVA payée par les collectivités<br />
territoriales sur leurs investissements ;<br />
le fonds <strong>de</strong> péréquation <strong>de</strong> la taxe professionnelle<br />
(environ 1 %) ;<br />
<strong>de</strong>s versements divers (dotation élu local,<br />
répartition <strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>s <strong>de</strong> police).<br />
LES EMPRUNTS<br />
Ils sont librement contractés, mais exclusivement<br />
<strong>de</strong>stinés à financer l’investissement.<br />
Les emprunts constituent la 3 e source <strong>de</strong><br />
recettes, mais leur part, inférieure à 10 %, ne<br />
cesse <strong>de</strong> se réduire <strong>de</strong>puis une dizaine d’années<br />
(globalement pour l’ensemble <strong>de</strong>s collectivités).Les<br />
collectivités privilégient <strong>de</strong> plus en plus<br />
le financement <strong>de</strong> leur équipement sur fonds<br />
propres.<br />
LES FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS<br />
Les collectivités qui en bénéficient sont peu<br />
nombreuses, surtout <strong>de</strong>puis 2007. Mais, pour<br />
les zones bénéficiaires, cette ressource est très<br />
importante. Globalement, les collectivités françaises<br />
perçoivent environ 14 milliards d’Euros<br />
par an.<br />
49
LES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS<br />
LOCALES<br />
Elles se répartissent en dépenses <strong>de</strong> fonctionnement<br />
et dépenses d’investissement. La<br />
répartition entre ces <strong>de</strong>ux budgets varie beaucoup<br />
en fonction <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong>s compétences<br />
exercées par chaque catégorie <strong>de</strong> collectivités.<br />
Ainsi, les régions et les communes investissent<br />
beaucoup plus (respectivement plus <strong>de</strong> 40 %<br />
et environ 35 % <strong>de</strong> leur budget) que les départements<br />
(28 %), en raison <strong>de</strong> la charge <strong>de</strong>s<br />
prestations sociales assurées par ces <strong>de</strong>rniers. Il<br />
est à noter que, lorsqu’une commune appartient<br />
à un groupement à fiscalité propre, le montant<br />
<strong>de</strong> l’investissement par habitant est très supérieur<br />
(889 € contre 676 €, en moyenne, pour<br />
les communes «isolées »).<br />
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT<br />
Elles sont constituées par toutes les dépenses<br />
nécessaires au fonctionnement <strong>de</strong> la collectivité<br />
(charges à caractère général, <strong>de</strong> personnel, <strong>de</strong><br />
gestion courante, intérêts <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte, dotations<br />
aux amortissements, provisions).<br />
Le poste principal, pour les communes, est celui<br />
<strong>de</strong>s charges <strong>de</strong> personnel : le quart du total <strong>de</strong>s<br />
dépenses, et 45 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
Pour les départements et les régions,<br />
cette part est plus réduite : 13 % du total pour<br />
les départements, et seulement 6 % pour les<br />
régions.<br />
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT<br />
Les collectivités territoriales financent près <strong>de</strong><br />
70 % <strong>de</strong> l’investissement public. L’importance<br />
croissante <strong>de</strong> cette part s’explique notamment<br />
par les désengagements successifs <strong>de</strong> l’État<br />
(déclassement <strong>de</strong> voirie, transferts <strong>de</strong> compétences,<br />
etc.).<br />
L’investissement local est principalement<br />
orienté vers le secteur du bâtiment et <strong>de</strong>s<br />
travaux publics, les transports publics, la mise<br />
aux normes et <strong>de</strong> l’environnement, le développement<br />
<strong>de</strong>s nouvelles technologies.<br />
<strong>de</strong> l’Etat pour la même pério<strong>de</strong> sont estimées à<br />
380 milliards d’Euros, et celles <strong>de</strong>s administrations<br />
<strong>de</strong> sécurité sociale à 432 milliards d’Euros.<br />
Sur l’ensemble <strong>de</strong> ces prélèvements, la part <strong>de</strong>s<br />
administrations locales est donc d’un peu plus<br />
<strong>de</strong> 20 %.<br />
Les communes représentent près <strong>de</strong> la moitié<br />
(105 milliards) <strong>de</strong> ce volume, et bien plus si on<br />
y ajoute les budgets <strong>de</strong>s groupements <strong>de</strong> communes<br />
à fiscalité propre (31,2 milliards) ; les<br />
départements (64 milliards), près <strong>de</strong> 30 %, et<br />
les régions (25 milliards), un peu plus <strong>de</strong> 10 %.<br />
En 2007, une commune a dépensé en moyenne<br />
2 170 € par an et par habitant (2 329 si elle<br />
appartient à un groupement à fiscalité propre),<br />
un département, 1 016 €, et une région, 401 €.<br />
La dépense par habitant est inversement proportionnelle<br />
à l’importance <strong>de</strong> la population :<br />
ainsi, en 2005, les 885 communes <strong>de</strong> plus <strong>de</strong><br />
10 000 habitants, hors Paris, avaient dépensé<br />
1 533 € par habitant et les communes <strong>de</strong> moins<br />
<strong>de</strong> 10 000 habitants, 2 807 €. Par contre, la<br />
dépense à Paris (qui est à la fois commune et<br />
département), est <strong>de</strong> 2 593 €<br />
Par comparaison, les ressources communales<br />
moyennes par habitant s’élevaient, dans quelques<br />
pays d’Afrique :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
en Afrique du Nord francophone, pour 2005,<br />
à 250 € en Tunisie (4,6 % <strong>de</strong>s ressources <strong>de</strong><br />
l’Etat), et à 32 € au Maroc (10 % <strong>de</strong>s ressources<br />
<strong>de</strong> l’Etat) ;<br />
en Afrique subsaharienne (pays membres <strong>de</strong><br />
l’UEMOA) 32 : pour 2004, <strong>de</strong> moins d’un Euro<br />
au Bénin à presque 6 au Sénégal, et presque<br />
7 en Côte d’Ivoire ;<br />
également en Afrique subsaharienne, dans<br />
<strong>de</strong>ux pays anglophones dont le PIB/hab est<br />
comparable : pour 2003, 55 $ en Tanzanie et<br />
65 $ en Ouganda.<br />
QUELQUES ÉLÉMENTS<br />
STATISTIQUES<br />
En 2007, le volume budgétaire global <strong>de</strong>s collectivités<br />
territoriales représentait environ 225<br />
milliards d’Euros, en augmentation <strong>de</strong> 6,3 % par<br />
rapport à 2006 . Par comparaison, les recettes<br />
32<br />
source : Africités 2006<br />
50
Les collectivités territoriales françaises<br />
Fiche 3.2. L’organisation financière <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises<br />
DU MONDIAL AU LOCAL<br />
LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS L’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT<br />
La coopération décentralisée aura une assise d’autant plus forte qu’elle sera comprise et partagée par le plus grand<br />
nombre. La coopération décentralisée comme l’éveil citoyen aux enjeux internationaux - <strong>de</strong> l’explication à l’incitation<br />
à agir (éducation au développement) - ne peut être le seul fait <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> la collectivité locale : elle doit s’appuyer<br />
sur les acteurs locaux engagés en solidarité internationale et intéressés <strong>de</strong> son territoire - associations <strong>de</strong> solidarité<br />
internationale et <strong>de</strong> migrants, écoles, clubs sportifs, etc.<br />
Les collectivités locales ont un rôle important à jouer pour répondre aux questions <strong>de</strong>s citoyens dans ce domaine et<br />
apporter, au Nord comme au Sud, <strong>de</strong>s réponses concrètes en termes d’accès aux services essentiels, <strong>de</strong> construction<br />
commune d’un environnement durable et vivable. Leur réseau mondial, Cités et Gouvernements Locaux Unis, a<br />
vocation à mettre en évi<strong>de</strong>nce leur contribution à la réalisation <strong>de</strong>s Objectifs du Millénaire pour le <strong>Développement</strong>.<br />
La réponse aux préoccupations planétaires a besoin d’un ancrage local, concret, et un effort d’explication <strong>de</strong>s liens<br />
existants entre l’action ici et l’action là-bas. Cette action locale concerne tant la maîtrise <strong>de</strong>s ressources disponibles, que<br />
l’analyse <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong>s migrations, ou encore la compréhension <strong>de</strong> la chaîne <strong>de</strong> production et <strong>de</strong> commercialisation<br />
<strong>de</strong> nos produits <strong>de</strong> consommation.<br />
C’est dans cet esprit que Cités Unies France a animé, avec l’AFCCRE et le Comité 21, l’élaboration par un groupe <strong>de</strong><br />
travail <strong>de</strong> collectivités territoriales <strong>de</strong> la Charte <strong>de</strong> la coopération décentralisée pour le développement durable ; elle<br />
réaffirme les valeurs <strong>de</strong> la coopération décentralisée - égalité, solidarité, réciprocité, subsidiarité - en les intégrant<br />
dans une démarche <strong>de</strong> développement durable : précaution, prévention, réversibilité. Une autre manière <strong>de</strong> se rendre<br />
compte que les sociétés et les villes sont confrontées à <strong>de</strong>s problèmes bien similaires, quelle que soit leur localisation.<br />
C’est pourquoi Cités Unies France :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
fait partie du comité <strong>de</strong> pilotage <strong>de</strong> la Semaine <strong>de</strong> la solidarité internationale <strong>de</strong>puis sa première édition pour faire<br />
connaître, partager, expliquer et inciter à l’action ;<br />
est membre à part entière <strong>de</strong> la campagne française - au côté <strong>de</strong>s acteurs <strong>de</strong> la société civile - et internationale - au<br />
sein <strong>de</strong> CGLU - pour l’atteinte <strong>de</strong>s Objectifs du millénaire pour le développement ;<br />
propose à ses membres <strong>de</strong> rejoindre <strong>de</strong>s campagnes d’opinions et <strong>de</strong>s dynamiques collectives telles que AlimenTERRE,<br />
les Journées pour la culture <strong>de</strong> la paix, la participation au collectif Ethique sur l’étiquette, la Commission Diplomatie<br />
<strong>de</strong>s villes <strong>de</strong> CGLU, etc. ;<br />
participe autant que possible à <strong>de</strong>s réunions en régions qui visent à faire connaître la solidarité internationale ;<br />
rédige actuellement, en collaboration avec EDUCASOL, plate-forme nationale pour l’éducation au développement,<br />
un manuel à l’intention <strong>de</strong>s collectivités locales pour s’engager dans l’éducation au développement.<br />
51
Fiche 3.3. L’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises<br />
Le CICID <strong>de</strong> juin 2006 a souligné l’importance<br />
<strong>de</strong> l’action <strong>de</strong> solidarité <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />
et <strong>de</strong>s acteurs publics au niveau local.<br />
Il a prévu leur association à l’élaboration <strong>de</strong> la<br />
politique <strong>de</strong> développement dans le cadre <strong>de</strong><br />
la Commission nationale <strong>de</strong> la coopération<br />
décentralisée (CNCD).<br />
Il a également rappelé « la place particulière<br />
qu’occupent les départements et les collectivités<br />
d’outre-mer dans la mise en œuvre <strong>de</strong> la<br />
politique <strong>de</strong> coopération régionale en direction<br />
<strong>de</strong>s pays situés dans leur voisinage. Les moyens<br />
dont ils disposent avec le fonds <strong>de</strong> coopération<br />
régionale, le fonds Pacifique et les fonds<br />
européens d’INTERREG ont un effet <strong>de</strong> levier<br />
important. »<br />
LE CADRE JURIDIQUE<br />
LES COLLECTIVITÉS DE MÉTROPOLE<br />
La légalité <strong>de</strong>s interventions internationales <strong>de</strong>s<br />
collectivités territoriales a longtemps fait l’objet<br />
<strong>de</strong> débats. La loi du 6 février 1992 avait conféré<br />
une première base juridique aux actions internationales<br />
<strong>de</strong>s collectivités territoriales, leur<br />
offrant <strong>de</strong>s larges possibilités <strong>de</strong> coopération.<br />
Cependant, ces actions <strong>de</strong>vaient, selon la<br />
jurispru<strong>de</strong>nce, répondre à un « intérêt local à<br />
agir ».<br />
Elle est maintenant fixée, grâce à la récente<br />
loi Thiollière 33 , qui a fourni une base juridique<br />
sûre à l’action internationale <strong>de</strong>s collectivités<br />
territoriales 34 et à la coopération décentralisée,<br />
sans référence à l’intérêt local.<br />
Cette loi dispose :<br />
« Les collectivités territoriales et leurs<br />
groupements peuvent, dans le respect <strong>de</strong>s<br />
engagements internationaux <strong>de</strong> la France,<br />
conclure <strong>de</strong>s conventions avec <strong>de</strong>s autorités<br />
locales étrangères pour mener <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong><br />
coopération ou d’ai<strong>de</strong> au développement.<br />
Ces conventions précisent l’objet <strong>de</strong>s actions<br />
envisagées et le montant prévisionnel <strong>de</strong>s engagements<br />
financiers. Elles entrent en vigueur dès<br />
leur transmission au représentant <strong>de</strong> l’Etat (…).<br />
En outre, si l’urgence le justifie, les collectivités<br />
territoriales et leurs groupements peuvent<br />
mettre en œuvre ou financer <strong>de</strong>s actions à<br />
caractère humanitaire. »<br />
La loi lève tous les risques juridiques et<br />
contentieux encourus par les autorités locales<br />
sous l’empire <strong>de</strong> la loi <strong>de</strong> 1992. Elle supprime<br />
toute référence aux compétences <strong>de</strong>s collectivités<br />
territoriales. Et, en employant l’expression<br />
« autorités locales étrangères », plutôt que<br />
celle <strong>de</strong> « collectivités étrangères et leurs<br />
groupements », elle évite les difficultés d’interprétation<br />
du texte <strong>de</strong> 1992 pour les cas où, dans<br />
le pays partenaire, il n’existe pas <strong>de</strong> collectivités<br />
territoriales, au sens français du terme ; dans<br />
ce cas, la convention peut être signée avec une<br />
autorité déconcentrée.<br />
Seulement <strong>de</strong>ux limites à l’autonomie <strong>de</strong>s<br />
collectivités subsistent désormais :<br />
-<br />
-<br />
La signature d’une convention avec un Etat<br />
étranger reste prohibée pour les collectivités<br />
<strong>de</strong> métropole.<br />
La référence au « respect <strong>de</strong>s engagements<br />
internationaux <strong>de</strong> la France » est maintenue.<br />
Le contrôle du respect <strong>de</strong> ces engagements<br />
relève du contrôle <strong>de</strong> droit commun <strong>de</strong>s actes<br />
<strong>de</strong>s collectivités territoriales : les conventions<br />
« entrent en vigueur dès leur transmission au<br />
représentant <strong>de</strong> l’Etat », et elles sont soumises<br />
au contrôle <strong>de</strong> légalité a posteriori et au<br />
contrôle juridictionnel.<br />
LES COLLECTIVITÉS D’OUTRE MER<br />
Ces collectivités - départements, territoires et<br />
collectivités d’outre-mer - ont, <strong>de</strong>puis la loi <strong>de</strong><br />
2000 35 , <strong>de</strong>s compétences très larges.<br />
Les assemblées locales peuvent :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
adresser au gouvernement <strong>de</strong>s propositions<br />
en vue <strong>de</strong> conclure <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> coopération<br />
régionale ;<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r que leurs prési<strong>de</strong>nts soient<br />
autorisés à négocier et signer <strong>de</strong>s accords<br />
internationaux dans leur domaine <strong>de</strong><br />
compétence ;<br />
saisir le gouvernement <strong>de</strong> toute proposition<br />
tendant à l’adhésion <strong>de</strong> la France aux organismes<br />
<strong>de</strong> coopération régionale <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> la<br />
Caraïbe ou <strong>de</strong> l’Océan Indien ;<br />
recourir à <strong>de</strong>s sociétés d’économie mixte<br />
pour la mise en œuvre d’actions engagées<br />
dans le cadre <strong>de</strong>s compétences dévolues en<br />
matière <strong>de</strong> coopération régionale.<br />
33<br />
codifiée à l’article 1115-1 du Co<strong>de</strong> Général <strong>de</strong>s Collectivités Territoriales<br />
34<br />
la loi est applicable aux collectivités <strong>de</strong> métropole et aux collectivités d’outre mer<br />
35<br />
loi d’orientation pour l’outre-mer, n° 2000-1207, du 13 décembre 2000 - voir fiche 1.1.<br />
52
Les collectivités territoriales françaises<br />
Fiche 3.3. L’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises<br />
Dans les domaines <strong>de</strong> compétence <strong>de</strong> l’Etat, les<br />
prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>s conseils régionaux ou généraux<br />
peuvent recevoir délégation pour négocier et<br />
signer <strong>de</strong>s accords avec <strong>de</strong>s Etats, territoires<br />
ou organismes régionaux voisins, ainsi qu’avec<br />
<strong>de</strong>s institutions spécialisées <strong>de</strong>s Nations Unies.<br />
Le Conseil Constitutionnel a estimé 36 que,<br />
dans ces hypothèses, les prési<strong>de</strong>nts concernés<br />
agissent en tant qu’agents <strong>de</strong> l’Etat, et au nom<br />
<strong>de</strong> la République.<br />
Trois ambassa<strong>de</strong>urs suivent, au MAEE, la<br />
coopération régionale <strong>de</strong>s collectivités d’outremer<br />
: l’un pour l’Océan Indien, un autre pour<br />
la Guyane et les Caraïbes, et un autre pour le<br />
Pacifique Sud. Ils organisent chaque année une<br />
conférence, qui réunit tous les acteurs <strong>de</strong> cette<br />
coopération.<br />
LE CADRE FINANCIER<br />
L’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />
pour le développement est financée à près<br />
<strong>de</strong> 90% par les collectivités sur leurs fonds<br />
propres, le reste provenant <strong>de</strong> cofinancements<br />
divers : du ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et<br />
européennes, <strong>de</strong> l’Union Européenne, d’autres<br />
institutions internationales, d’entreprises privées,<br />
etc.<br />
LA LOI OUDIN SANTINI 37<br />
Cette loi permet aux communes et aux<br />
établissements publics <strong>de</strong> coopération<br />
intercommunale 38 <strong>de</strong> mobiliser une ressource<br />
innovante pouvant atteindre 1 % <strong>de</strong>s recettes<br />
<strong>de</strong>s budgets <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’assainissement, pour<br />
financer <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> coopération décentralisée,<br />
d’ai<strong>de</strong> d’urgence ou <strong>de</strong> solidarité, dans les<br />
domaines <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’assainissement.<br />
Une autre loi, <strong>de</strong> décembre 2006, a étendu le<br />
champ d’application <strong>de</strong> ce texte au domaine <strong>de</strong><br />
l‘énergie (électricité et gaz).<br />
Pour 2006, les concours déclarés à l’APD dans<br />
les domaines <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’assainissement<br />
s’étaient élevés à seulement 2,9 M€ 39 . Compte<br />
tenu <strong>de</strong>s programmes engagés, ces montants<br />
se sont nettement accrus en 2007 et atteignent<br />
désormais 5,2 millions.<br />
Les projets dans le domaine <strong>de</strong> l‘énergie s’élèvent<br />
actuellement à environ 1 M€, et sont plus<br />
concentrés (ils émanent pour une gran<strong>de</strong> part<br />
du syndicat <strong>de</strong> l’électricité en Ile <strong>de</strong> France, et<br />
sont principalement <strong>de</strong>stinés à la Russie).<br />
L’APD <strong>de</strong>s collectivités territoriales, qui est<br />
déclarée au CAD <strong>de</strong> l’OCDE au même titre<br />
que celle <strong>de</strong> l’Etat, s’élevait à 50 M€ en 2005,<br />
à 54 M€ en 2006, et à 60 M€ en 2007. Ces<br />
montants, qui sont télédéclarés <strong>de</strong>puis 2006,<br />
sont probablement sous-évalués.<br />
Cette progression s’explique par <strong>de</strong>ux facteurs :<br />
-<br />
-<br />
d’une part, la loi Oudin Santini (voir ci-après);<br />
d’autre part, l’amélioration <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> collecte statistique <strong>de</strong> la Délégation pour<br />
l’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités locales du<br />
ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères (DAECL) et<br />
une plus gran<strong>de</strong> sensibilisation <strong>de</strong>s collectivités<br />
territoriales, qui permettent un recensement<br />
plus complet <strong>de</strong> leur effort financier.<br />
36<br />
Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000<br />
37<br />
loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale <strong>de</strong>s collectivités territoriales, adoptée par le<br />
Parlement en février 2006<br />
38<br />
par délibération <strong>de</strong> leur organe délibérant<br />
39<br />
Ce montant ne tient pas compte <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong>stinées à <strong>de</strong>s pays non éligibles à l’APD<br />
53
Fiche 3.4. La participation <strong>de</strong> plusieurs collectivités à un projet<br />
La coopération entre plusieurs collectivités<br />
françaises (« mutualisation ») est encouragée,<br />
notamment par la DAECL : le premier appel à<br />
projets retenait ce critère, et le nouvel appel à<br />
projets le maintient.<br />
Il existe déjà <strong>de</strong>s exemples <strong>de</strong> coopération, sous<br />
<strong>de</strong>s formes diverses :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
l’IRCOD Alsace, institution qui a précisément<br />
vocation à organiser la coopération internationale<br />
<strong>de</strong> ses membres ;<br />
dans le cadre <strong>de</strong> projets <strong>de</strong> l’AFD (ex : projet<br />
Luang Prabang / ville <strong>de</strong> Chinon / région<br />
Centre) ;<br />
dans le cadre <strong>de</strong>s « programmes concertés »<br />
mis en place par CUF avec le soutien du<br />
MAEE, tel que le programme concerté Niger<br />
ANIYA 40 .<br />
De manière pragmatique, certaines collectivités<br />
ont mis en place <strong>de</strong>s coopérations dans le<br />
cadre <strong>de</strong> projets où leurs compétences sont<br />
complémentaires :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
le Conseil Régional d’Ile-<strong>de</strong>-France sollicite<br />
les villes <strong>de</strong> la région pour apporter <strong>de</strong>s compétences<br />
techniques qui lui manquent pour<br />
<strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> développement urbain ;<br />
le Conseil Régional Provence - Alpes-Côte<br />
d’Azur et la ville <strong>de</strong> Marseille pour un projet<br />
à Alexandrie ;<br />
le Conseil Régional Nord Pas <strong>de</strong> Calais, le<br />
département du Nord et Lille Métropole<br />
pour un projet à Saint-Louis.<br />
Par ailleurs, certaines collectivités françaises<br />
associent leurs partenaires <strong>de</strong> pays émergents<br />
pour <strong>de</strong>s projets auprès <strong>de</strong> collectivités <strong>de</strong><br />
PMA. C’est le cas, par exemple, <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong><br />
Montreuil, qui mobilise ses partenaires vietnamiens,<br />
et prochainement ses partenaires<br />
brésiliens, pour son projet au Mali.<br />
D’autres projets se montent en associant <strong>de</strong>ux<br />
ou plusieurs villes européennes auprès <strong>de</strong> leur<br />
partenaire commun :<br />
-<br />
l’appui à la ville <strong>de</strong> Gaza, qui associe les villes<br />
<strong>de</strong> Dunkerque, Barcelone et Turin ;<br />
LE PROGRAMME CONCERTÉ SANTÉ MALI (PCSM)<br />
Il est géré par un collectif d’ONG maliennes, le « Groupe pivot Santé Population ».<br />
Le comité directeur est doublement paritaire : Mali - France et gouvernemental - non gouvernemental.<br />
80 % <strong>de</strong>s ressources du programme financent <strong>de</strong>s projets que les porteurs <strong>de</strong> projets (associations, ONG<br />
ou collectivités territoriales) déposent auprès du secrétariat du Groupe pivot. Ce <strong>de</strong>rnier est chargé<br />
<strong>de</strong> les instruire en vue <strong>de</strong> leur présentation semestrielle <strong>de</strong>vant le comité directeur du programme.<br />
Les 20 % restant sont affectés aux frais <strong>de</strong> fonctionnement du Groupe pivot.<br />
Ce mécanisme permet le financement <strong>de</strong> projets <strong>de</strong> taille très réduite. Le plafond est établi à 135 000 €<br />
pour un projet triennal mais la plupart <strong>de</strong>s projets se situent bien en-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> cette limite.<br />
Il présente les avantages suivants :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
le PCSM confère à l’Etat malien une maîtrise sur l’orientation <strong>de</strong>s projets non gouvernementaux financés<br />
sur son territoire et permet <strong>de</strong> s’assurer <strong>de</strong> leur conformité avec la politique sectorielle concernée ;<br />
le programme allie financements et réflexion commune ;<br />
sa gestion par un collectif d’ONG permet <strong>de</strong> renforcer les capacités <strong>de</strong> la société civile et <strong>de</strong> l’amener à<br />
discuter <strong>de</strong>s politiques nationales ;<br />
la mise à disposition d’un « fonds » au Groupe pivot santé Mali permet d’espérer que d’autres bailleurs<br />
rejoignent ce processus.<br />
Pour être reproduit, la structure pivot adéquate doit être trouvée et <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong> la société civile<br />
motivés i<strong>de</strong>ntifiés.<br />
40<br />
Voir le site dédié à ce programme, sur lequel se trouvent en particulier une monographie <strong>de</strong> chaque commune nigérienne et<br />
une <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s partenariats existants : www.france-niger.com/<br />
54
Les collectivités territoriales françaises<br />
Fiche 3.4. La participation <strong>de</strong> plusieurs collectivités à un projet<br />
-<br />
le projet, en cours <strong>de</strong> préparation par l’AFD,<br />
d’appui à la ville d’Addis Abeba en partenariat<br />
avec les villes <strong>de</strong> Paris et Berlin.<br />
Ces démarches sont très fructueuses, et doivent<br />
être encouragées.<br />
-<br />
en mettant en place <strong>de</strong>s financements<br />
constituant <strong>de</strong>s appels à projets, dans le cadre<br />
d’un programme d’appui, selon le modèle<br />
du PAD (Programme d’Accompagnement<br />
du Processus <strong>de</strong> Décentralisation au Maroc<br />
- voir encadré ci-après) ;<br />
CUF a un rôle central pour informer les collectivités<br />
territoriales, promouvoir le débat, animer<br />
les réseaux, susciter et organiser ces partenariats,<br />
le cas échéant en inventant <strong>de</strong> nouvelles<br />
formes <strong>de</strong> partenariat. C’est la mission qui lui<br />
est confiée par le MAEE, dans le cadre d’une<br />
convention triennale d’objectifs.<br />
L’AFD elle-même pourrait expérimenter <strong>de</strong>s<br />
mo<strong>de</strong>s d’intervention favorisant l’articulation<br />
<strong>de</strong>s interventions <strong>de</strong> plusieurs collectivités<br />
territoriales :<br />
-<br />
en montant <strong>de</strong>s projets mobilisant plusieurs<br />
collectivités françaises, dans le cadre <strong>de</strong> leur<br />
coopération décentralisée, sur le modèle du<br />
programme concerté Niger ANIYA;<br />
-<br />
en proposant <strong>de</strong>s interventions complémentaires<br />
à un projet d’appui à une politique<br />
sectorielle : par exemple, un projet <strong>de</strong> développement<br />
rural, auquel plusieurs collectivités<br />
(régions, départements) s’associeraient en se<br />
répartissant géographiquement les interventions<br />
auprès <strong>de</strong>s bénéficiaires. Il est intéressant<br />
<strong>de</strong> voir à ce sujet le programme concerté<br />
santé Mali, qui permet aux collectivités territoriales<br />
et aux ONG, françaises et maliennes,<br />
<strong>de</strong> mener <strong>de</strong>s actions en cohérence avec la<br />
politique sectorielle nationale.<br />
LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT DU PROCESSUS DE<br />
DÉCENTRALISATION AU MAROC (PAD MAROC)<br />
Ce programme, issu d’un accord franco-marocain <strong>de</strong> juillet 2004, est doté d’un montant <strong>de</strong> 11 millions<br />
d’Euros, dont 4,6 sur crédits FSP.<br />
Ses objectifs sont les suivants :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
l’amélioration du cadre <strong>de</strong>s relations entre services <strong>de</strong> l’Etat et collectivités locales marocaines ;<br />
l’adaptation <strong>de</strong> l’offre <strong>de</strong> formation <strong>de</strong>s élus et cadres administratifs <strong>de</strong>s collectivités locales marocaines ;<br />
le renforcement <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> maîtrise d’ouvrage <strong>de</strong>s collectivités locales marocaines.<br />
Le projet concerne 5 régions pilotes. La composante « laboratoire <strong>de</strong>s maîtrises d’ouvrages locales », qui<br />
concerne l’ensemble du pays, permet à <strong>de</strong>s collectivités locales françaises et marocaines d’obtenir le financement<br />
<strong>de</strong> projets <strong>de</strong> développement sélectionnés sur appels à projets. Les projets doivent concourir au<br />
développement durable et à la lutte contre la pauvreté, et contribuer <strong>de</strong> manière directe à l’amélioration<br />
<strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s populations (eau et assainissement, transports, habitat insalubre, environnement,<br />
hygiène, jeunesse et culture).<br />
Les projets pluriannuels (au maximum <strong>de</strong> 3 ans) sont favorisés. La priorité est accordée aux projets associant<br />
les sociétés civiles <strong>de</strong> chaque collectivité, et tout particulièrement les populations issues <strong>de</strong> l’immigration<br />
marocaine en France.<br />
Les projets sont subventionnés à hauteur <strong>de</strong> 50 %, dans la limite <strong>de</strong> 300 000 €.<br />
Un fonds d’appui aux initiatives partenariales, doté <strong>de</strong> 2,5 M€ a été créé.<br />
Pour être reproduit, la structure pivot adéquate doit être trouvée et <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong> la société civile<br />
motivés i<strong>de</strong>ntifiés.<br />
55
Fiches pratiques<br />
sur l’AFD<br />
57
Fiche 4.1. La complémentarité <strong>de</strong>s approches<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> capitalisation a souligné la complémentarité<br />
<strong>de</strong>s approches <strong>de</strong> l’AFD et <strong>de</strong>s<br />
collectivités territoriales, bien que leurs logiques<br />
d’intervention diffèrent.<br />
Les autorités locales françaises soulignent la<br />
légitimité <strong>de</strong> leur intervention auprès <strong>de</strong>s collectivités<br />
locales <strong>de</strong>s pays en développement :<br />
à la légitimité politique, s’ajoute celle <strong>de</strong> l’expérience<br />
concrète. L’appui que peut apporter une<br />
collectivité française à une collectivité du Sud<br />
est très spécifique, et ne peut être comparé à<br />
celui qui est apporté par <strong>de</strong>s professionnels <strong>de</strong>s<br />
projets.<br />
Les collectivités territoriales ont une approche<br />
<strong>de</strong> solidarité et d’ouverture au mon<strong>de</strong> : les coopérations<br />
décentralisées sont majoritairement<br />
orientées vers <strong>de</strong>s pays pauvres, et ne sont pas<br />
<strong>de</strong>stinées à procurer <strong>de</strong>s avantages économiques<br />
; elles sont conçues pour être durables ;<br />
elles engagent la population <strong>de</strong>s collectivités du<br />
Nord et du Sud, et ont <strong>de</strong>s répercussions à la<br />
fois sociales et culturelles.<br />
L’AFD, quant à elle, intervient dans un cadre<br />
stratégique défini au plan national, et négocié<br />
avec <strong>de</strong>s partenaires internationaux. Elle a une<br />
approche plus technique, et essentiellement<br />
contractuelle. Elle attend <strong>de</strong>s résultats concrets,<br />
appelés à être évalués, et les échéances <strong>de</strong> ses<br />
projets sont délimitées à l’avance.<br />
Par ailleurs, la durée <strong>de</strong>s projets est différente<br />
pour une collectivité locale et pour une agence<br />
<strong>de</strong> développement telle que l’AFD. La durée<br />
nécessaire à l’i<strong>de</strong>ntification et à la préparation<br />
du projet est assez similaire. En revanche, les<br />
délais d’exécution et plus encore la durée <strong>de</strong>s<br />
engagements et <strong>de</strong>s perspectives <strong>de</strong> partenariat,<br />
sont beaucoup plus longs pour les collectivités<br />
locales que pour l’AFD.<br />
Les contraintes temporelles <strong>de</strong>s collectivités<br />
ne dépen<strong>de</strong>nt ni <strong>de</strong> l’annualité budgétaire (<strong>de</strong>s<br />
conventions pluriannuelles sont signées par la<br />
plupart <strong>de</strong>s collectivités françaises), ni <strong>de</strong> la<br />
durée <strong>de</strong>s mandats (les coopérations se poursuivent<br />
alors même que la majorité d’un organe<br />
délibérant et la couleur politique <strong>de</strong> l’organe<br />
exécutif changent).Cependant, les élus qui<br />
engagent un projet en début <strong>de</strong> mandat souhaitent<br />
en voir au moins un début <strong>de</strong> réalisation<br />
avant la fin <strong>de</strong> leur mandat. Mais, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong><br />
cette contrainte <strong>de</strong> visibilité, la collectivité locale<br />
est en général assez souple, pendant la mise en<br />
œuvre du projet, non seulement sur les délais<br />
d’exécution, mais également sur les modalités,<br />
voire sur le contenu. Par pragmatisme, pour<br />
tenir compte <strong>de</strong> l’évolution du contexte, ou du<br />
changement <strong>de</strong> partenaire, elles adaptent leurs<br />
appuis.<br />
Cependant, à l’expérience, ces démarches se<br />
révèlent complémentaires :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
l’intervention <strong>de</strong> l’AFD donne au projet <strong>de</strong><br />
la collectivité locale française une dimension<br />
financière hors <strong>de</strong> sa portée ;<br />
en contrepartie, le partenariat d’une collectivité<br />
française à un projet <strong>de</strong> l’AFD apporte<br />
une dimension humaine et technique qui ne<br />
pourrait être atteinte par les moyens habituellement<br />
mobilisés par l’AFD (le recours à<br />
une expertise spécialisée) ;<br />
une fois le projet <strong>de</strong> l’AFD (nécessairement<br />
inscrit dans un temps court) achevé, l’appui<br />
<strong>de</strong> la collectivité française se poursuit sur<br />
une longue durée, ce qui permet d’assurer sa<br />
viabilité.<br />
Dans ce contexte, les apports <strong>de</strong>s collectivités<br />
territoriales sont :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
la communauté <strong>de</strong> missions avec les collectivités<br />
du Sud, et la coopération qu’elle suscite<br />
entre les acteurs <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux territoires ;<br />
la durée et la fidélité <strong>de</strong> la relation, qui<br />
favorisent la construction <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
la collectivité du Sud, puis le suivi <strong>de</strong>s actions<br />
entreprises ;<br />
la légitimité, la visibilité, la crédibilité et la<br />
re<strong>de</strong>vabilité <strong>de</strong>s appuis fournis ;<br />
l’appui institutionnel et le renforcement <strong>de</strong>s<br />
compétences en maîtrise d’ouvrage, qui sont<br />
au centre <strong>de</strong>s préoccupations actuelles.<br />
Dans un partenariat avec l’AFD, celle-ci peut<br />
leur apporter :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
sa connaissance <strong>de</strong>s contextes nationaux et<br />
sectoriels ;<br />
la présence <strong>de</strong> son réseau dans une cinquantaine<br />
<strong>de</strong> pays ;<br />
un important effet <strong>de</strong> levier, par le niveau <strong>de</strong>s<br />
financements qu’elle fournit ;<br />
un appui technique, et un transfert <strong>de</strong> savoirfaire,<br />
grâce à ses procédures éprouvées et à ses<br />
outils <strong>de</strong> suivi, qui sont <strong>de</strong>s garanties supplémentaires<br />
d’efficacité et <strong>de</strong> transparence ;<br />
58
Fiches pratiques sur l’AFD<br />
Fiche 4.1. La complémentarité <strong>de</strong>s approches<br />
-<br />
<strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> formation, par l’intermédiaire<br />
du CEFEB.<br />
Dans ce contexte, les partenariats peuvent<br />
s’établir selon <strong>de</strong>s modalités très diverses, dont<br />
certaines ont déjà été expérimentées :<br />
-<br />
-<br />
pour les projets intéressant les gran<strong>de</strong>s collectivités<br />
: la concertation est généralement<br />
précoce, et il est facile d’établir une collaboration<br />
étroite, dès la phase d’i<strong>de</strong>ntification,<br />
pendant la mise en œuvre du projet (avec<br />
une définition claire <strong>de</strong>s responsabilités<br />
respectives <strong>de</strong> chaque partenaire à travers la<br />
convention <strong>de</strong> projet), et jusqu’à l’évaluation<br />
du projet ;<br />
pour les projets <strong>de</strong> plus petite dimension,<br />
bénéficiant d’un concours <strong>de</strong> faible montant<br />
: ils sont conduits <strong>de</strong> manière beaucoup<br />
plus autonome par la collectivité, dès lors<br />
que l’AFD a validé le montage et apporté le<br />
financement.<br />
Cependant, un point doit être souligné : dans<br />
le montage d’un projet financé par l’AFD, le<br />
maître d’ouvrage est le bénéficiaire du financement,<br />
avec lequel est signée la convention <strong>de</strong><br />
financement. La mobilisation <strong>de</strong>s ressources<br />
financières, <strong>de</strong>s appuis <strong>de</strong> la collectivité locale<br />
aux différents titres (appui à maîtrise d’ouvrage,<br />
formations, appuis institutionnels, prestations<br />
<strong>de</strong> services le cas échéant) revient au maître<br />
d’ouvrage local.<br />
59
Fiche 4.2. Le contenu du partenariat AFD - collectivité<br />
française dans le cadre d’un projet<br />
Selon l’expérience <strong>de</strong>s précé<strong>de</strong>nts projets qui<br />
ont associé l’AFD à une ou plusieurs collectivités<br />
françaises, le partenariat peut revêtir <strong>de</strong>s<br />
formes très diverses.<br />
L’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE<br />
À LA COLLECTIVITÉ BÉNÉFICIAIRE.<br />
Ce schéma est le plus fréquent : la collectivité<br />
française apporte une assistance à maîtrise<br />
d’ouvrage à la collectivité bénéficiaire pour la<br />
mise en œuvre du projet, et, généralement,<br />
d’une manière beaucoup plus large.<br />
Cette formule permet un dialogue constructif<br />
et un transfert <strong>de</strong> savoir-faire, puis un appui<br />
prolongé après la fin du projet.<br />
pendant la durée <strong>de</strong> mise en œuvre du projet,<br />
et le projet finance tous les frais liés à la mission<br />
(voyage, frais <strong>de</strong> séjour, autres frais). La rémunération<br />
<strong>de</strong>s agents continue à être assurée par<br />
la collectivité française.<br />
LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS<br />
Il est pratiqué par <strong>de</strong> très nombreuses collectivités<br />
dans le cadre habituel <strong>de</strong> leur coopération<br />
décentralisée. Il prend la forme <strong>de</strong> formations<br />
et <strong>de</strong> stages dans les services <strong>de</strong> la collectivité<br />
française. Il arrive également qu’une collectivité<br />
française finance, au profit <strong>de</strong> cadres <strong>de</strong> la<br />
collectivité partenaire, <strong>de</strong>s formations et/ou<br />
<strong>de</strong>s stages dans d’autres institutions que ses<br />
propres services.<br />
L’APPUI INSTITUTIONNEL<br />
C’est le domaine dans lequel les compétences<br />
spécifiques <strong>de</strong>s collectivités françaises trouvent<br />
le mieux à s’appliquer. L’appui institutionnel,<br />
dans le cadre d’un projet, permet un transfert<br />
<strong>de</strong> savoir faire entre pairs, confrontés aux<br />
mêmes réalités <strong>de</strong> la gestion locale. Il porte sur<br />
l’organisation et la gestion <strong>de</strong>s services, la formation<br />
<strong>de</strong>s élus, l’amélioration <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s et<br />
procédures, etc.<br />
L’AFD recherche tout particulièrement cette<br />
contribution dans les projets qu’elle monte en<br />
partenariat avec les collectivités françaises, ce<br />
qui est illustré par la majorité <strong>de</strong>s projets ayant<br />
fait l’objet <strong>de</strong> la capitalisation.<br />
De même, les appels à propositions du MAEE<br />
privilégient cette thématique, tant dans le<br />
domaine urbain que dans le domaine rural.<br />
L’APPORT D’EXPERTISE<br />
Cette formule est actuellement expérimentée<br />
par l’AFD avec la communauté urbaine <strong>de</strong> Lille<br />
(Lille Métropole). L’expertise, qui se fon<strong>de</strong><br />
sur les compétences spécifiques <strong>de</strong> la collectivité<br />
française, peut être apportée par un ou<br />
plusieurs <strong>de</strong> ses cadres, voire par <strong>de</strong>s cadres<br />
<strong>de</strong> ses partenaires habituels (SEM, agence<br />
d’urbanisme, etc.).<br />
Le montage mis en place est le suivant : la<br />
collectivité met à disposition les agents concernés<br />
pour <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s courtes, mais répétées<br />
LA MISE À DISPOSITION D’ASSISTANCE TECHNIQUE<br />
Il s’agit encore d’une voie nouvelle à explorer.<br />
Cependant, l’AFD expérimente un tel montage<br />
avec la communauté urbaine <strong>de</strong> Lyon (Grand<br />
Lyon), qui met à disposition <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong><br />
Ouagadougou un cadre <strong>de</strong> ses services pendant<br />
toute la durée du projet.<br />
Pour l’avenir, une concertation est engagée,<br />
notamment avec FCI et CUF. Les premières<br />
réflexions font apparaître que, si la coopération<br />
décentralisée s’est progressivement spécialisée<br />
dans le domaine du partage <strong>de</strong> l’expérience<br />
locale et du développement du territoire, l’efficacité<br />
et la valorisation <strong>de</strong> l’action internationale<br />
<strong>de</strong>s collectivités se heurtent à certaines limites.<br />
En particulier, s’agissant <strong>de</strong> la participation<br />
<strong>de</strong> cadres territoriaux à <strong>de</strong>s projets d’autres<br />
acteurs, la mobilité internationale <strong>de</strong>s cadres<br />
territoriaux souffre d’une mauvaise image, et<br />
n’est pas valorisée. Une réflexion est en cours<br />
sur les réponses à apporter à cette question,<br />
qu’elle soit politique (volontarisme <strong>de</strong> la collectivité,<br />
pour encourager ses fonctionnaires à la<br />
mobilité) ou juridique (facilités juridiques pour<br />
la mobilité et garanties <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> retour<br />
dans la collectivité). Par ailleurs, il conviendra<br />
<strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s formations adéquates dans les<br />
centres <strong>de</strong> formation (CNFPT), et <strong>de</strong> prévoir<br />
la capitalisation <strong>de</strong> l’expertise <strong>de</strong>s cadres territoriaux,<br />
dont la forte rotation peut nuire à la<br />
qualité <strong>de</strong> l’expertise.<br />
60
Fiches pratiques sur l’AFD<br />
Fiche 4.2. Le contenu du partenariat AFD - collectivité française dans le cadre d’un projet<br />
LA RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS FINANCÉS PAR L’AFD<br />
Les principes suivants sont applicables aux marchés publics dans le cadre <strong>de</strong>s projets financés par l’AFD :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
la mise en concurrence et le respect <strong>de</strong>s normes internationalement reconnues en la matière et recommandées<br />
par l’OCDE en ce qui concerne l’information et la présélection <strong>de</strong>s fournisseurs potentiels ; le contenu et la<br />
publication <strong>de</strong>s dossiers d’appel d’offres (DAO) ; l’évaluation <strong>de</strong>s offres et l’attribution <strong>de</strong>s marchés ;<br />
l’application <strong>de</strong> la réglementation nationale locale sous la réserve <strong>de</strong>s clauses propres à l’AFD qui découlent <strong>de</strong><br />
ses conditions <strong>de</strong> financement.<br />
Cependant, pour les marchés susceptibles <strong>de</strong> susciter une concurrence internationale, ou si le contexte réglementaire<br />
d’un pays n’est pas stabilisé, ou si la réglementation est insuffisante notamment par rapport au principe<br />
<strong>de</strong> mise en concurrence, on pourra, au moment <strong>de</strong> l’évaluation, faire <strong>de</strong>s recommandations afin <strong>de</strong> conseiller<br />
utilement le maître d’ouvrage : utilisation <strong>de</strong> réglementations <strong>de</strong> bailleurs <strong>de</strong> fonds multilatéraux (Banque mondiale,<br />
Banques régionales <strong>de</strong> développement) que le maître d’ouvrage pratique déjà, utilisation <strong>de</strong> documents<br />
types <strong>de</strong> l’AFD ou <strong>de</strong>s documents harmonisés <strong>de</strong>s bailleurs <strong>de</strong> fonds multilatéraux.<br />
La définition du mo<strong>de</strong> d’attribution <strong>de</strong>s marchés le plus en amont possible, dans le cycle du projet.<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> la préparation du projet, le maître d’ouvrage <strong>de</strong>vra préparer et fournir à l’AFD un programme<br />
<strong>de</strong> passation <strong>de</strong>s marchés acceptable par l’AFD et qui spécifiera : (a) les marchés <strong>de</strong> fournitures, <strong>de</strong> travaux<br />
et/ou <strong>de</strong> services nécessaires pour exécuter le projet pendant la pério<strong>de</strong> initiale d’un minimum <strong>de</strong> 18 mois ; (b)<br />
les métho<strong>de</strong>s proposées pour la passation <strong>de</strong> ces marchés ; et (c) les procédures d’examen <strong>de</strong> l’AFD. Le maître<br />
d’ouvrage <strong>de</strong>vra actualiser ce programme <strong>de</strong> passation <strong>de</strong> marchés tous les ans ou en tant que <strong>de</strong> besoin pendant<br />
la durée du projet. Le maître d’ouvrage <strong>de</strong>vra mettre en œuvre le programme <strong>de</strong> passation <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong> la<br />
manière approuvée par l’AFD.<br />
la responsabilité exclusive du maître d’ouvrage dans la définition et la gestion du processus d’attribution <strong>de</strong>s<br />
marchés, l’intervention <strong>de</strong> l’AFD ne <strong>de</strong>vant donner lieu qu’à <strong>de</strong>s avis <strong>de</strong> non-objection (ANO) aux diverses<br />
étapes du processus.<br />
Toute intervention significative financée par un projet <strong>de</strong>vant faire l’objet d’une mise en concurrence, l’intervention<br />
<strong>de</strong>s opérateurs <strong>de</strong>s collectivités françaises peut être délicate<br />
En revanche, si cette intervention est financée <strong>de</strong> manière significative par la collectivité française, ou a fortiori<br />
par l’opérateur lui-même, dans le cadre <strong>de</strong> leur coopération - le financement <strong>de</strong> l’AFD se limitant par exemple à la<br />
prise en charge <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> voyage et <strong>de</strong> mission -, la règle ne s’applique pas. Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la réglementation<br />
française <strong>de</strong>s marchés, à laquelle la collectivité reste soumise, même pour ses actions internationales, <strong>de</strong>s contrats<br />
peuvent être passés, <strong>de</strong> gré à gré, avec les services et institutions relevant <strong>de</strong> la collectivité (établissement public,<br />
société d’économie mixte), ou toute autre institution qui assure <strong>de</strong> manière régulière certaines prestations pour<br />
son compte. Tel pourrait être le cas d’une agence d’urbanisme ou d’une régie <strong>de</strong>s eaux.<br />
Certaines collectivités sont attachées à l’intervention <strong>de</strong> leurs opérateurs habituels dans leurs projets <strong>de</strong> coopération<br />
décentralisée. Certaines considèrent que l’intervention <strong>de</strong> ces partenaires habituels ne peut se justifier que <strong>de</strong><br />
manière très ponctuelle, pour une expertise ou le transfert d’un savoir-faire spécifique par exemple, et ne doit pas<br />
se substituer à l’expertise locale, que la coopération décentralisée a pour objectif <strong>de</strong> renforcer.<br />
Ce risque <strong>de</strong> substitution à l’expertise locale doit probablement être nuancé, selon les circonstances. Dans certaines<br />
situations, en effet, l’intervention d’un opérateur français peut être déterminante pour faire connaître au partenaire<br />
du Sud certaines évolutions techniques ou métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion, et ainsi stimuler, au plan local, le développement<br />
d’une offre spécifique dans le domaine <strong>de</strong> l’assainissement.<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’AFD, l’intervention durable d’un opérateur français, même justifiée par l’appui fourni dans<br />
le cadre d’une coopération décentralisée, d’une part doit résulter <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> expresse du maître d’ouvrage /<br />
bénéficiaire du projet, d’autre part ne doit pas être engagée selon <strong>de</strong>s règles dérogatoires qui pénaliseraient en<br />
premier lieu les opérateurs locaux.<br />
61
Fiche 4.3. Les conventions AFD - collectivité française<br />
Ces conventions sont assez récentes. Les premières<br />
ont été signées en 2006.<br />
Des conventions <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux types ont été passées<br />
avec les collectivités territoriales françaises :<br />
-<br />
-<br />
<strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> partenariat, <strong>de</strong> portée<br />
générale, avec <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s collectivités : une<br />
douzaine ont été conclues avec <strong>de</strong>s régions,<br />
<strong>de</strong>s départements, et <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s villes ; ces<br />
accords sont <strong>de</strong>s engagements <strong>de</strong> long terme,<br />
et ne se réfèrent pas à <strong>de</strong>s projets précis ; ils<br />
n’ont pas <strong>de</strong> conséquences juridiques.<br />
<strong>de</strong>s conventions <strong>de</strong> projets ; quelques unes<br />
seulement ont été signées ; la convention<br />
porte sur un projet précis, et définit les<br />
engagements réciproques <strong>de</strong> l’AFD et <strong>de</strong> la<br />
collectivité française : les actions du projet<br />
qui seront conduites en partenariat, leur<br />
calendrier et leurs modalités d’exécution et<br />
<strong>de</strong> financement.<br />
La convention <strong>de</strong> financement, qui est signée<br />
avec le maître d’ouvrage du projet, est l’acte<br />
premier <strong>de</strong> l’engagement <strong>de</strong> l’AFD. Cette<br />
convention confie au maître d’ouvrage la<br />
responsabilité <strong>de</strong> l’exécution du projet. La<br />
convention passée ensuite par l’AFD avec la<br />
collectivité française ne peut avoir d’effet sur<br />
la convention <strong>de</strong> financement. En particulier,<br />
l’accord du maître d’ouvrage est nécessaire<br />
pour toute intervention <strong>de</strong> la collectivité française,<br />
a fortiori si une partie <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> cette<br />
intervention est financée par le projet.<br />
L’ACCORD DE PARTENARIAT<br />
L’accord comporte un préambule présentant les<br />
objectifs <strong>de</strong> l’AFD et <strong>de</strong> la collectivité française<br />
en matière d’ai<strong>de</strong> au développement ; il fournit<br />
à la collectivité l’opportunité <strong>de</strong> présenter les<br />
grands axes <strong>de</strong> sa coopération décentralisée.<br />
L’accord lui-même définit :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
les objectifs du partenariat : la promotion <strong>de</strong>s<br />
objectifs communs, par la concertation et la<br />
mise en synergie <strong>de</strong> leurs interventions ;<br />
les domaines du partenariat : ils varient selon<br />
les orientations <strong>de</strong> la collectivité signataire<br />
(accès à l’eau, protection <strong>de</strong> l’environnement,<br />
aménagement urbain, développement<br />
économique et/ou social, etc.)<br />
les modalités du partenariat : l’échange<br />
d’informations, la concertation, la mise en<br />
commun <strong>de</strong>s réflexions dans les domaines du<br />
partenariat ;<br />
la durée du partenariat.<br />
Enfin, l’accord prévoit que chaque projet donnera<br />
lieu à :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
une instruction conjointe ;<br />
la signature d’une convention <strong>de</strong> financement<br />
par l’AFD et le maître d’ouvrage local ;<br />
la signature d’une convention entre les<br />
différents partenaires pour définir les engagements<br />
<strong>de</strong> chaque partie pour la réalisation<br />
du projet.<br />
C’est pourquoi l’AFD a retenu le principe <strong>de</strong><br />
conventions tripartites (bénéficiaire - AFD - collectivité<br />
française). Ce schéma permet à chacun<br />
<strong>de</strong>s intervenants d’être parfaitement informé<br />
<strong>de</strong>s engagements <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux autres parties.<br />
LA CONVENTION DE PROJET<br />
Elle porte sur un projet précis, dont elle définit<br />
les modalités <strong>de</strong> mise en œuvre.<br />
Il est à noter que cette convention tripartite ne<br />
se substitue ni à la convention <strong>de</strong> financement,<br />
ni à la convention qui est généralement passée<br />
entre les <strong>de</strong>ux collectivités, laquelle a le plus<br />
souvent un objet plus large que le projet, et<br />
porte sur un programme d’action et un engagement<br />
politique mutuel.<br />
La convention est signée par l’AFD, le maître<br />
d’ouvrage local, la collectivité française, le cas<br />
échéant les autres intervenants, français ou <strong>de</strong><br />
la nationalité du maître d’ouvrage.<br />
Elle contient :<br />
-<br />
-<br />
une <strong>de</strong>scription précise du projet, tel qu’il a<br />
été défini par la convention <strong>de</strong> financement ;<br />
la <strong>de</strong>scription précise <strong>de</strong>s engagements <strong>de</strong><br />
chacun <strong>de</strong>s signataires, en nature et en délai<br />
<strong>de</strong> mise en œuvre ou <strong>de</strong> mise à disposition ;<br />
62
Fiches pratiques sur l’AFD<br />
Fiche 4.3. Les conventions AFD - collectivité française<br />
LE PROJET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE LILLE - BKASSINE<br />
Un projet <strong>de</strong> réhabilitation <strong>de</strong>s tunnels d’adduction en eau potable a été initié par la communauté<br />
urbaine <strong>de</strong> Lille métropole, qui développe un programme <strong>de</strong> coopération avec<br />
la ville libanaise <strong>de</strong> Bkassine pour la mise en place d’un cycle intégré <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong> l’eau,<br />
programme déjà soutenu par le MAE. Sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Bkassine, l’AFD a accordé<br />
un concours <strong>de</strong> faible montant.<br />
Une convention quadripartite a été signée entre l’AFD, la municipalité <strong>de</strong> Bkassine, Lille<br />
métropole, et une association locale, TWT, assurant la maîtrise d’ouvrage déléguée (suivi<br />
<strong>de</strong>s travaux et coordination <strong>de</strong>s intervenants).<br />
Le financement apporté par l’AFD s’élève à 500 000 €. La contribution <strong>de</strong> Lille métropole<br />
s’élève à 640 000 € <strong>de</strong> subvention, et à un apport en assistance technique valorisé à hauteur<br />
<strong>de</strong> 11 000 €. L’apport propre <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Bkassine est <strong>de</strong> 155 000 €, à laquelle s’ajoute<br />
également une contribution en nature valorisée à 4 000 €.<br />
Au total, le coût du projet est <strong>de</strong> 1,3 M€, à mobiliser sur <strong>de</strong>ux ans (2007 et 2008).<br />
-<br />
-<br />
-<br />
la durée et le calendrier d’exécution ;<br />
les règles <strong>de</strong> gestion financière : les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> financement, la périodicité <strong>de</strong>s versements<br />
<strong>de</strong> fonds, la justification <strong>de</strong>s dépenses, etc.<br />
les modalités juridiques usuelles (révision<br />
et résiliation <strong>de</strong> la convention, juridiction<br />
compétente).<br />
Cette convention <strong>de</strong> projet s’adosse à la<br />
convention <strong>de</strong> financement passée entre l’AFD<br />
et le maître d’ouvrage local qui peut déjà y avoir<br />
associé la collectivité française partenaire. Elle<br />
précise les modalités <strong>de</strong> supervision du projet<br />
par l’AFD et la collectivité.<br />
Les engagements du maître d’ouvrage sont<br />
définis par la convention <strong>de</strong> projet : il est en<br />
particulier chargé d’assurer la coordination<br />
<strong>de</strong>s différents intervenants. Il peut également<br />
être appelé à fournir terrains, locaux, moyens<br />
logistiques.<br />
La contribution <strong>de</strong> la collectivité française est<br />
très diverse, selon la nature du projet : financement,<br />
assistance technique, assistance à maîtrise<br />
d’ouvrage, moyens logistiques, etc.<br />
63
Fiche 4.4. Le financement par l’AFD <strong>de</strong> projets associant <strong>de</strong>s<br />
collectivités territoriales françaises<br />
Le principe est que l’AFD ne finance pas<br />
directement les projets <strong>de</strong> coopération<br />
décentralisée, mais <strong>de</strong>s projets en faveur<br />
d’Etats étrangers (financements souverains)<br />
ou d’entités publiques <strong>de</strong> ces pays (financements<br />
sous-souverains) au profit, en particulier,<br />
<strong>de</strong>s collectivités territoriales.<br />
Le bénéficiaire du financement est le maître<br />
d’ouvrage du projet.<br />
Cependant, <strong>de</strong>s réflexions sont engagées pour<br />
permettre aux collectivités françaises <strong>de</strong> faire<br />
bénéficier la collectivité du Sud partenaire <strong>de</strong><br />
certains financements, en appui à leur coopération<br />
décentralisée.<br />
L’ASSOCIATION D’UNE (OU<br />
PLUSIEURS) COLLECTIVITÉ(S)<br />
FRANÇAISE(S) À UN PROJET<br />
DESTINÉ À UNE (OU PLUSIEURS)<br />
COLLECTIVITÉ(S) DU SUD<br />
C’est le schéma classique, qui a été mis en<br />
œuvre <strong>de</strong>puis une dizaine d’années, sans cadre<br />
formel et avec pragmatisme.<br />
Que l’initiative du projet revienne à l’AFD ou<br />
à la collectivité française, les projets <strong>de</strong> ce type<br />
ont été mis en place <strong>de</strong> manière concertée, mais<br />
distincte, chaque institution préparant et exécutant<br />
son propre projet selon ses procédures<br />
et à son rythme. Les projets plus récents ont été<br />
montés <strong>de</strong> manière plus concertée, et, <strong>de</strong>puis<br />
peu, ils font l’objet d’une convention précisant<br />
les engagements <strong>de</strong> chaque institution (voir<br />
fiche 4.3.)<br />
Dans ce cadre, la collectivité française a le plus<br />
souvent une relation préexistante et souvent<br />
ancienne avec le maître d’ouvrage du projet.<br />
Elle apporte son appui matériel et technique à<br />
son partenaire, selon <strong>de</strong>s valeurs et <strong>de</strong>s priorités<br />
définis d’un commun accord. Dans le cadre<br />
d’un projet bénéficiant d’un financement <strong>de</strong><br />
l’AFD, sa coopération comporte <strong>de</strong>s actions<br />
spécifiques facilitant la mise en œuvre du projet,<br />
ou complétant les actions prévues.<br />
Certains projets mobilisent plusieurs collectivités<br />
françaises, apportant chacune un appui<br />
spécifique.<br />
Des projets plus récents ont introduit <strong>de</strong>s<br />
mécanismes plus sophistiqués, permettant <strong>de</strong><br />
mobiliser <strong>de</strong> manière plus efficace le savoir faire<br />
spécifique et les compétences <strong>de</strong>s collectivités<br />
françaises.<br />
LE PROJET DE DÉSENCLAVEMENT DES QUARTIERS PÉRIPHÉRIQUES<br />
DE OUAGADOUGOU<br />
Ce projet, dont la convention <strong>de</strong> financement a été signée en décembre 2005, prévoit la<br />
mise à disposition, par la communauté urbaine du Grand Lyon, d’un assistant technique<br />
pour la durée du projet. Cet assistant technique est un cadre territorial du Grand Lyon, qui<br />
continue à assurer sa rémunération <strong>de</strong> base. Les coûts supplémentaires, en particulier ceux<br />
qui sont liés à l’expatriation, sont financés par le projet, et remboursés au Grand Lyon.<br />
64
Fiches pratiques sur l’AFD<br />
Fiche 4.4. Le financement par l’AFD <strong>de</strong> projets associant <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises<br />
LE PROGRAMME D’APPUI À L’AGGLOMÉRATION DE COTONOU<br />
(GRAND COTONOU)<br />
La convention <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> ce projet a été signée le 28 juin 2006. Elle prévoit, au<br />
profit du bénéficiaire, l’agglomération <strong>de</strong> Cotonou, <strong>de</strong>s prestations courtes d’assistance<br />
technique (missions d’expertise) qui seront fournies par la communauté urbaine <strong>de</strong> Lille.<br />
Celle-ci a répondu favorablement à la sollicitation <strong>de</strong> l’AFD, bien qu’il n’existe pas <strong>de</strong> lien<br />
préalable <strong>de</strong> coopération décentralisée entre les <strong>de</strong>ux villes. Ces prestations concernent les<br />
domaines <strong>de</strong> la coopération intercommunale et <strong>de</strong>s transports urbains. La rémunération<br />
<strong>de</strong> base <strong>de</strong>s experts qui seront mobilisés sera prise en charge par leur collectivité d’origine,<br />
et le projet financera les coûts engendrés par la mission.<br />
LES CONCOURS LOCAUX DE FAIBLE<br />
MONTANT<br />
Ce nouveau type <strong>de</strong> financement a été mis en<br />
place en 2007 ; il est encore expérimental.<br />
Les concours <strong>de</strong> ce type ne sont pas exclusivement<br />
<strong>de</strong>stinés à <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> coopération<br />
décentralisée. Il s’agit <strong>de</strong> projets d’investissement<br />
autonomes, initiés dans un <strong>de</strong>s secteurs<br />
<strong>de</strong> concentration du DCP du pays concerné.<br />
L’AFD souhaite privilégier les opérations <strong>de</strong><br />
petite taille - au regard <strong>de</strong> ses financements<br />
habituels -, mais ayant un caractère mobilisateur<br />
et innovant, et pouvant avoir un fort impact et<br />
une gran<strong>de</strong> visibilité.<br />
Les institutions qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt un tel financement<br />
doivent assurer l’instruction du projet, et<br />
notamment l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité, que l’AFD ne<br />
prend pas en charge.<br />
Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financement sont instruites<br />
par les agences locales <strong>de</strong> l’AFD, selon un processus<br />
simplifié.<br />
L’avis <strong>de</strong> l’ambassa<strong>de</strong>ur est recueilli dès l’i<strong>de</strong>ntification<br />
du projet.<br />
Cependant, les décisions <strong>de</strong> financement<br />
sont prises au niveau central (département<br />
géographique), afin, d’une part, <strong>de</strong> permettre<br />
la gestion harmonieuse d’un financement<br />
unique pour l’ensemble du réseau, d’autre part<br />
<strong>de</strong> donner l’occasion d’un second examen du<br />
dossier, et d’éviter les pressions locales.<br />
Les opérations ciblées doivent présenter les<br />
caractéristiques suivantes :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
il s’agit <strong>de</strong> projets d’investissement ; les<br />
dépenses <strong>de</strong> fonctionnement non liées à<br />
un projet (voyages d’étu<strong>de</strong>, organisation<br />
ou participation à <strong>de</strong>s conférences, bourses<br />
d’étu<strong>de</strong>s, etc.) ne sont pas éligibles ;<br />
les projets doivent être autonomes : le financement<br />
ne peut venir compléter celui d’un<br />
projet déjà financé ;<br />
la priorité est accordée aux projets s’inscrivant<br />
dans les secteurs <strong>de</strong> concentration du DCP ;<br />
les projets présentés doivent être suffisamment<br />
instruits : ils ne requièrent aucune étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> faisabilité <strong>de</strong> la part <strong>de</strong> l’AFD, mais peuvent<br />
donner lieu, à l’initiative <strong>de</strong> l’AFD, et dans le<br />
cadre <strong>de</strong> l’instruction, à <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s complémentaires<br />
légères, ou à <strong>de</strong>s expertises ;<br />
le coût <strong>de</strong>s projets est compris entre 300 000<br />
et 750 000 €.<br />
Les concours locaux <strong>de</strong> faible montant constituent<br />
une démarche nouvelle pour l’AFD. Sous<br />
réserve d’une instruction allégée, les règles<br />
restent les mêmes que pour les projets ordinaires.<br />
Ils ne sont donc pas conçus comme un outil<br />
spécifique <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> la coopération<br />
décentralisée.<br />
L’AFD envisage, après une expérimentation, et<br />
probablement une vingtaine <strong>de</strong> projets ainsi<br />
financés, <strong>de</strong> faire une évaluation <strong>de</strong> ce dispositif,<br />
afin <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> son maintien, voire <strong>de</strong><br />
son extension, ou <strong>de</strong> sa réforme.<br />
65
LA CRÉATION D’UNE « FACILITÉ »<br />
PERMETTANT LE FINANCEMENT<br />
DIRECT DE PROJETS DE COLLECTIVITÉS<br />
TERRITORIALES FRANÇAISES<br />
L’AFD a décidé <strong>de</strong> mettre en place, en 2008,<br />
à titre expérimental, une facilité <strong>de</strong>stinée à<br />
financer, <strong>de</strong> manière directe, les projets <strong>de</strong>s<br />
collectivités territoriales françaises.<br />
Ces financements seront accordés sous la forme<br />
<strong>de</strong> dons aux collectivités françaises. Plusieurs<br />
pistes sont envisagées pour tirer le meilleur<br />
parti <strong>de</strong> ce nouvel outil :<br />
LE FINANCEMENT D’ACTIONS DE COOPÉRATION<br />
DÉCENTRALISÉE EN COMPLÉMENT D’UN<br />
PROJET FINANCÉ PAR L’AFD<br />
Deux hypothèses peuvent se présenter :<br />
-<br />
-<br />
L’AFD instruit le financement d’un projet au<br />
bénéfice d’une collectivité étrangère qui a<br />
déjà une coopération décentralisée avec une<br />
collectivité française. Une complémentarité<br />
sera recherchée avec les actions déjà prévues<br />
dans ce cadre, ou avec <strong>de</strong>s actions i<strong>de</strong>ntifiées<br />
conjointement à l’occasion <strong>de</strong> la préparation<br />
du projet, justifiant que l’AFD les cofinance.<br />
Grâce à la mise en place <strong>de</strong> la nouvelle facilité,<br />
le financement pourrait porter sur un champ<br />
beaucoup plus étendu, et <strong>de</strong>s actions plus<br />
diversifiées que dans le cadre actuel, et non<br />
seulement sur les frais liés à <strong>de</strong>s expertises<br />
ponctuelles ou à une mission longue d’assistance<br />
technique (comme pour les projets <strong>de</strong><br />
Cotonou et <strong>de</strong> Ouagadougou).<br />
L’AFD instruit le financement d’un projet<br />
au bénéfice d’une collectivité étrangère qui<br />
souhaite bénéficier du concours d’une collectivité<br />
française. L’AFD ai<strong>de</strong>ra la collectivité<br />
étrangère dans sa recherche <strong>de</strong> partenariat.<br />
Une première démarche consistera à consulter<br />
la collectivité française avec laquelle la<br />
collectivité étrangère souhaiterait avoir <strong>de</strong>s<br />
relations. A défaut, ou si cette première collectivité<br />
n’est pas intéressée, ou pas en mesure<br />
<strong>de</strong> répondre à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, une consultation<br />
pourrait être engagée (par exemple par la voie<br />
d’un appel à candidature) pour en i<strong>de</strong>ntifier<br />
une autre qui serait en mesure d’apporter sa<br />
contribution au projet. Celle-ci serait alors<br />
financée, en tout ou en partie, par le biais <strong>de</strong><br />
la nouvelle facilité.<br />
DES APPELS À PROPOSITIONS<br />
L’AFD, qui a déjà <strong>de</strong>s expériences d’appels à<br />
propositions, <strong>de</strong>stinés aux ONG, pourrait en<br />
lancer en direction <strong>de</strong>s collectivités locales qui<br />
s’inscrivent dans une logique <strong>de</strong> partenariat<br />
avec l’AFD.<br />
Ils pourraient être géographiques ou sectoriels<br />
et en particulier avoir pour objet, dans le cadre<br />
<strong>de</strong>s mandats confiés à l’AFD, <strong>de</strong> mettre en<br />
place :<br />
-<br />
-<br />
<strong>de</strong>s incitations pour intervenir dans <strong>de</strong>s pays<br />
émergents (pays à prêts pour l’AFD), où<br />
la présence <strong>de</strong>s collectivités françaises est<br />
encore limitée, pour diverses raisons : la langue,<br />
l’éloignement (Brésil, In<strong>de</strong>), le contexte<br />
politique (Turquie, Afghanistan) ;<br />
<strong>de</strong>s incitations pour intervenir dans certains<br />
secteurs <strong>de</strong> la compétence <strong>de</strong> l’AFD, et dans<br />
lesquels les coopérations décentralisées<br />
pourraient être plus mobilisées (par exemple<br />
le patrimoine naturel ou bâti, l’assainissement,<br />
la gestion <strong>de</strong>s déchets, la mobilité urbaine).<br />
Dans tous les cas, une concertation préalable<br />
sera établie avec le MAEE, afin d’assurer la<br />
cohérence avec les appels à propositions lancés<br />
par la DAECL <strong>de</strong>puis 2006, et avec les gran<strong>de</strong>s<br />
associations <strong>de</strong> collectivités locales françaises<br />
dans le cadre <strong>de</strong> la CNCD.<br />
UN APPUI POUR ACCÉDER AUX<br />
FINANCEMENTS EUROPÉENS<br />
L’AFD a une expérience très positive <strong>de</strong> l’appui<br />
apporté aux ONG pour accé<strong>de</strong>r aux financements<br />
offerts par la « Facilité Eau » <strong>de</strong> l’Union<br />
Européenne. Un appel à propositions avait été<br />
lancé. L’AFD avait retenu 15 propositions, dont 9<br />
ont été finalement acceptées et financées par la<br />
Commission européenne. L’AFD apporte, pour<br />
un montant total d’environ 6 M€, un cofinancement,<br />
à hauteur <strong>de</strong> 25 %, <strong>de</strong> ces projets, dont<br />
le coût total est <strong>de</strong> 25 M€. A travers diverses<br />
associations, certaines collectivités territoriales<br />
ont bénéficié <strong>de</strong> cet appui <strong>de</strong> l’AFD.<br />
Dans le cadre du 10 e FED, qui est mis en<br />
œuvre <strong>de</strong>puis 2008, l’AFD pourrait reproduire<br />
cette opération au bénéfice <strong>de</strong>s collectivités<br />
françaises.<br />
66
Fiches pratiques sur l’AFD<br />
Fiche 4.4. Le financement par l’AFD <strong>de</strong> projets associant <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises<br />
DES « PROJETS STRUCTURÉS »<br />
EAU, ASSAINISSEMENT ET ÉNERGIE<br />
La loi Oudin permet aux collectivités territoriales<br />
<strong>de</strong> mobiliser <strong>de</strong>s financements à affecter à<br />
<strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> coopération décentralisée, dans<br />
le domaine <strong>de</strong> l’eau, <strong>de</strong> l’assainissement, ainsi<br />
que dans le domaine <strong>de</strong> l’énergie.<br />
L’AFD n’a pas vocation à gérer ces financements,<br />
ni à centraliser la coopération décentralisée.<br />
Mais elle peut apporter un appui très concret<br />
aux collectivités territoriales, notamment en<br />
leur fournissant <strong>de</strong>s garanties, pour leurs projets,<br />
sur l’affectation et la bonne utilisation <strong>de</strong><br />
leurs financements.<br />
Ce type <strong>de</strong> montage présente les avantages<br />
suivants :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
la ville y trouve un affichage fort <strong>de</strong> sa<br />
solidarité, même pour un effort financier<br />
limité ; l’effet sera d’autant plus marqué que<br />
la distribution d’eau à <strong>de</strong>s ménages mo<strong>de</strong>stes<br />
a une image extrêmement positive ;<br />
l’AFD, <strong>de</strong> son côté, pourra accroître ses prêts,<br />
corrélativement à la hausse <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
d’eau ;<br />
les ai<strong>de</strong>s françaises, malgré leur diversité,<br />
seront plus cohérentes, et techniquement<br />
beaucoup plus efficaces.<br />
Deux types <strong>de</strong> coopérations décentralisées<br />
peuvent être intéressées par ce mécanisme :<br />
-<br />
-<br />
les plus importantes, qui vont très vite<br />
accumuler <strong>de</strong>s financements importants,<br />
pour lesquels elles disposeraient ainsi d’un<br />
portefeuille <strong>de</strong> projets immédiatement<br />
« décaissables », avec un coût <strong>de</strong> gestion<br />
faible ;<br />
les plus petites, qui n’ont pas les moyens<br />
d’i<strong>de</strong>ntifier <strong>de</strong>s projets et <strong>de</strong> les instruire, et<br />
qui ne souhaitent pas se limiter à subventionner<br />
<strong>de</strong>s projets présentés par <strong>de</strong>s ONG.<br />
L’AFD peut proposer un choix <strong>de</strong> sociétés<br />
d’eau performantes, dans différents pays. Les<br />
collectivités peuvent alors opter pour <strong>de</strong>s pays<br />
d’intervention, <strong>de</strong>s villes, voire <strong>de</strong>s quartiers,<br />
selon leurs propres critères, avec une garantie<br />
<strong>de</strong> bonne fin <strong>de</strong> leurs projets.<br />
LE PROJET D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE PHNOM PENH<br />
A Phnom Penh, l’eau est distribuée par une Régie <strong>de</strong>s Eaux dont les performances sont<br />
reconnues par la communauté internationale. L’AFD, qui lui octroyait <strong>de</strong>s subventions, lui<br />
accor<strong>de</strong> désormais <strong>de</strong>s prêts, ce qui permettra <strong>de</strong> multiplier par <strong>de</strong>ux les financements qui<br />
lui sont proposés. Le Directeur <strong>de</strong> la Régie considère que le coût du branchement initial est<br />
un frein important au développement <strong>de</strong>s abonnements individuels. La ville <strong>de</strong> Paris, qui<br />
a déjà <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> partenariat avec la ville <strong>de</strong> Phnom Penh, a marqué son intérêt pour<br />
intervenir dans ce nouveau domaine. Elle va financer <strong>de</strong>s branchements sociaux, à hauteur<br />
<strong>de</strong> 150 000 € sur trois ans. L’AFD apporte <strong>de</strong>ux garanties très importantes : d’une part la<br />
disponibilité <strong>de</strong> l’eau, quel que soit le nombre <strong>de</strong> nouveaux branchements ; d’autre part la<br />
transparence <strong>de</strong> la comptabilité (pour laquelle l’AFD apporte un appui spécifique à la Régie<br />
<strong>de</strong>s Eaux). Le cas échéant, cet appui à la gestion pourrait comporter un volet permettant <strong>de</strong><br />
mesurer précisément le coût <strong>de</strong>s branchements sociaux subventionnés.<br />
67
Fiche 4.5. Le cycle <strong>de</strong>s projets<br />
A chaque étape du cycle du projet, le maître<br />
d’ouvrage est l’interlocuteur privilégié <strong>de</strong> l’AFD :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financement sont présentées<br />
par le maître d’ouvrage à l’agence locale<br />
<strong>de</strong> l’AFD ;<br />
l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité est engagée par le maître<br />
d’ouvrage ;<br />
l’évaluation <strong>de</strong>s dossiers se fait par un dialogue<br />
permanent entre le maître d’ouvrage et<br />
l’AFD, au siège et à l’agence locale.<br />
Chaque étape comporte un dialogue avec le<br />
futur maître d’ouvrage et la réalisation <strong>de</strong>s diligences<br />
et expertises nécessaires, en particulier<br />
l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité. Celle-ci est engagée par le<br />
maître d’ouvrage, et financée par l’AFD.<br />
Le chef <strong>de</strong> projet est responsable, en étroite articulation<br />
avec l’agence, du pilotage <strong>de</strong>s travaux<br />
d’expertise et <strong>de</strong> la conduite <strong>de</strong>s négociations.<br />
Il apporte son appui technique au maître<br />
d’ouvrage, notamment pour l’élaboration <strong>de</strong>s<br />
termes <strong>de</strong> référence <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité et<br />
pour sa supervision.<br />
LES ÉTAPES DE LA PRÉPARATION ET<br />
DE L’EXÉCUTION DU PROJET<br />
Le cycle <strong>de</strong>s projets comporte 7 étapes :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
l’i<strong>de</strong>ntification du projet ;<br />
la préparation du projet ;<br />
l’évaluation ;<br />
la décision <strong>de</strong> financement ;<br />
la convention <strong>de</strong> financement ;<br />
la mise en œuvre / l’exécution du projet ;<br />
le rapport d’achèvement et l’évaluation finale<br />
du projet.<br />
L’IDENTIFICATION DU PROJET<br />
Au sein <strong>de</strong> l’AFD, elle est matérialisée par une<br />
fiche d’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> projet (FIP), renseignée<br />
et validée par le département géographique<br />
concerné, et plus particulièrement par l’agence<br />
locale <strong>de</strong> l’AFD.<br />
Cette phase a pour objet :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
<strong>de</strong> sélectionner les idées <strong>de</strong> projet conformément<br />
à la stratégie <strong>de</strong> l’AFD ;<br />
<strong>de</strong> définir le cadrage général du projet, en<br />
particulier le montant indicatif du concours<br />
et le produit envisagé ;<br />
d’i<strong>de</strong>ntifier et hiérarchiser les risques et les<br />
enjeux liés au projet, et définir en conséquence<br />
les diligences nécessaires et le mo<strong>de</strong><br />
d’instruction du projet ;<br />
<strong>de</strong> fixer les moyens nécessaires à la poursuite<br />
<strong>de</strong> l’instruction du projet ;<br />
<strong>de</strong> désigner le chef <strong>de</strong> projet et <strong>de</strong> constituer<br />
l’équipe projet ;<br />
<strong>de</strong> recueillir l’avis <strong>de</strong> l’ambassa<strong>de</strong>ur.<br />
L’ÉVALUATION DU PROJET<br />
Si l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité est favorable, une évaluation<br />
est réalisée pour :<br />
-<br />
-<br />
déterminer les conditions financières du<br />
concours <strong>de</strong> l’AFD, les conditionnalités, les<br />
engagements et schémas <strong>de</strong> garantie qui y<br />
sont liés ;<br />
recueillir les avis obligatoires à l’instruction<br />
du projet, en interne et en externe (avis <strong>de</strong><br />
l’ambassa<strong>de</strong>ur).<br />
Le département géographique vali<strong>de</strong> et, le<br />
cas échéant, complète les conclusions et propositions<br />
du chef <strong>de</strong> projet. Les résultats sont<br />
consignés dans un ai<strong>de</strong>-mémoire d’évaluation<br />
envoyé au client.<br />
LA DÉCISION ET LA CONVENTION<br />
DE FINANCEMENT<br />
La décision <strong>de</strong> financement n’est prise que si les<br />
conditions <strong>de</strong> succès du projet apparaissent réunies<br />
et sont acceptées par le maître d’ouvrage.<br />
Le concours financier est accordé par l’instance<br />
compétente <strong>de</strong> l’AFD.<br />
La convention <strong>de</strong> financement est l’acte fondamental<br />
qui a pour objet <strong>de</strong> contractualiser<br />
les engagements réciproques <strong>de</strong> l’AFD et <strong>de</strong>s<br />
bénéficiaires <strong>de</strong> ses concours. Elle peut comporter<br />
<strong>de</strong>s actes annexes et <strong>de</strong>s avenants, ainsi<br />
que, le cas échéant, une ou plusieurs lettres <strong>de</strong><br />
levées <strong>de</strong> conditions suspensives.<br />
La convention <strong>de</strong> financement a pour objet <strong>de</strong><br />
contractualiser les engagements réciproques <strong>de</strong><br />
l’AFD et <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>de</strong> ses concours. Elle<br />
peut comporter <strong>de</strong>s actes annexes et <strong>de</strong>s avenants,<br />
ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs<br />
68
Fiches pratiques sur l’AFD<br />
Fiche 4.5. Le cycle <strong>de</strong>s projets<br />
DANS QUEL DÉLAI ?<br />
Entre l’i<strong>de</strong>ntification du projet et la convention <strong>de</strong> financement, il s’écoule un délai d’environ<br />
un an.<br />
Ce délai dépend surtout <strong>de</strong> la nature du projet et <strong>de</strong> la longueur <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> faisabilité.<br />
Les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> faisabilité sont lancées et supervisées par le maître d’ouvrage local, selon ses<br />
propres procédures. Il lui revient <strong>de</strong> rédiger les termes <strong>de</strong> référence, avec l’appui du chef<br />
<strong>de</strong> projet, <strong>de</strong> constituer le dossier d’appel d’offres, <strong>de</strong> lancer la consultation, <strong>de</strong> passer le<br />
marché, enfin <strong>de</strong> superviser l’étu<strong>de</strong>.<br />
lettres <strong>de</strong> levées <strong>de</strong> conditions suspensives.<br />
Elle est rédigée par le chef <strong>de</strong> projet, en liaison<br />
avec l’agence concernée.<br />
Elle est signée par les représentants <strong>de</strong> l’AFD et<br />
du (ou <strong>de</strong>s) bénéficiaire(s).<br />
LA MISE EN ŒUVRE / L’EXÉCUTION DU PROJET<br />
Au sein <strong>de</strong> l’AFD, l’exécution du projet est<br />
retracée dans un Dossier <strong>de</strong> Suivi <strong>de</strong> Projet<br />
(DSP).<br />
La division technique concernée en est responsable,<br />
cette responsabilité pouvant être<br />
déléguée dès la levée <strong>de</strong>s conditions suspensives<br />
à l’agence lorsque les compétences techniques<br />
y sont présentes.<br />
Le chef <strong>de</strong> projet est responsable <strong>de</strong> la bonne<br />
exécution du projet, dans ses <strong>de</strong>ux volets : suivi<br />
opérationnel et exécution financière du projet.<br />
Les objectifs <strong>de</strong> cette phase sont les suivants :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
mettre à la disposition du bénéficiaire les<br />
moyens financiers prévus dans la convention ;<br />
veiller à la mise en œuvre par le bénéficiaire<br />
<strong>de</strong>s moyens techniques, financiers et institutionnels<br />
nécessaires à l’atteinte <strong>de</strong>s objectifs<br />
économiques, sociaux et environnementaux<br />
du projet ;<br />
convenir avec le bénéficiaire <strong>de</strong>s éventuelles<br />
mesures correctives à adopter en vue d’atteindre<br />
les objectifs du projet ;<br />
en fin <strong>de</strong> projet, dresser un bilan sommaire<br />
<strong>de</strong> ses réalisations et <strong>de</strong> ses résultats en<br />
référence aux objectifs, et procé<strong>de</strong>r à une<br />
première appréciation <strong>de</strong> ses impacts et <strong>de</strong> la<br />
durabilité <strong>de</strong>s résultats obtenus.<br />
LE RAPPORT D’ACHÈVEMENT ET<br />
L’ÉVALUATION DU PROJET<br />
A l’issue du projet, un rapport d’achèvement est<br />
rédigé. Jusqu’à maintenant, seulement certains<br />
projets faisaient en outre l’objet d’une évaluation<br />
rétrospective. Cette évaluation va être<br />
généralisée en 2009 à tous les projets <strong>de</strong> l’AFD.<br />
L’objectif <strong>de</strong> cette évaluation est <strong>de</strong> formuler<br />
une opinion indépendante et motivée sur les<br />
instruments, les projets, les programmes ou<br />
secteurs ayant bénéficié <strong>de</strong> concours <strong>de</strong> l’AFD<br />
sur la base <strong>de</strong> critères préétablis (conformes à<br />
ceux préconisés par le Comité d’ai<strong>de</strong> au développement<br />
<strong>de</strong> l’OCDE) : pertinence, efficacité,<br />
efficience, économie, types d’impact, pérennité<br />
<strong>de</strong>s opérations.<br />
Plus spécifiquement, il s’agit :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
d’examiner si la finalité <strong>de</strong>s opérations était<br />
clairement établie et si elles s’inséraient<br />
dans une programmation sectorielle ou<br />
thématique ;<br />
d’examiner si les objectifs étaient pertinents ;<br />
<strong>de</strong> vérifier si l’ensemble <strong>de</strong>s objectifs a été<br />
atteint avec efficacité et si, au niveau <strong>de</strong><br />
l’instruction et <strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong>s opérations,<br />
les moyens humains et financiers ont été mis<br />
en œuvre avec efficience et économie ;<br />
d’apprécier l’impact <strong>de</strong>s opérations tant au<br />
niveau institutionnel qu’aux niveaux financiers,<br />
économique, social et environnemental ;<br />
d’examiner la pérennité <strong>de</strong>s opérations ;<br />
<strong>de</strong> tirer les enseignements utiles pour :<br />
- élaborer les nouvelles stratégies sectorielles<br />
et thématiques,<br />
- améliorer les performances <strong>de</strong>s opérations<br />
en cours et <strong>de</strong>s futures,<br />
- perfectionner les instruments existants ou<br />
créer <strong>de</strong> nouveaux (ex : fonds <strong>de</strong> garantie,<br />
types <strong>de</strong> concours).<br />
69
En moyenne, un projet dure <strong>de</strong> 4 à 5 ans.<br />
LA DURÉE DU PROJET<br />
Le suivi est assuré par l’agence, et il est continu.<br />
La supervision par le chef <strong>de</strong> projet, au siège, prend la forme d’une ou <strong>de</strong>ux missions<br />
annuelles d’environ une semaine. La collectivité partenaire peut y être associée.<br />
LE RÔLE ET LA COMPOSITION DE<br />
L’ÉQUIPE PROJET<br />
Pour assurer l’instruction <strong>de</strong> chaque projet, est<br />
constituée une équipe projet dont la composition<br />
<strong>de</strong> base est généralement :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
un chef <strong>de</strong> projet<br />
un coordonnateur en agence<br />
le coordonnateur régional<br />
En tant que <strong>de</strong> besoin, tout autre spécialiste<br />
peut être intégré à l’équipe projet en qualité<br />
d’experts (ingénieurs, financiers, juriste,<br />
etc.). La présence obligatoire d’un spécialiste<br />
environnement est fonction du classement<br />
environnemental du projet <strong>de</strong> financement.<br />
L’équipe projet est dirigée par le chef <strong>de</strong> projet.<br />
Il peut, selon la nature du projet, et selon les<br />
compétences disponibles dans l’agence du pays<br />
concerné, être choisi au sein <strong>de</strong> l’agence, ou au<br />
siège.<br />
Le chef <strong>de</strong> projet est l’interlocuteur unique du<br />
projet, nonobstant les négociations techniques<br />
menées par les experts <strong>de</strong> l’équipe projet ou les<br />
relations avec les autorités locales relevant <strong>de</strong><br />
l’agence.<br />
un chargé <strong>de</strong> mission en agence, qui assure la<br />
supervision du secteur d’intervention auquel<br />
appartient le projet.<br />
Le coordonnateur régional intervient à plusieurs<br />
niveaux :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
il est régulièrement informé <strong>de</strong>s étapes et <strong>de</strong>s<br />
événements les plus importants <strong>de</strong> la vie <strong>de</strong>s<br />
opérations par le chef <strong>de</strong> projet ;<br />
il peut participer aux missions <strong>de</strong> l’équipe<br />
projet, sur <strong>de</strong>s opérations stratégiques ou<br />
importantes ;<br />
il fournit les éléments nécessaires et peut<br />
contribuer à la rédaction <strong>de</strong>s documents<br />
(NPP, note au Conseil), pour les aspects<br />
afférents au contexte politique, économique,<br />
à la stratégie <strong>de</strong> l’AFD dans le pays concerné,<br />
et à l’adéquation du projet à cette stratégie ;<br />
quels que soient le projet et la composition <strong>de</strong><br />
l’équipe projet, il est responsable <strong>de</strong> la gestion<br />
du dossier <strong>de</strong> base exigé par la Commission<br />
bancaire et la Cour <strong>de</strong>s Comptes.<br />
Les experts apportent leur avis et leurs<br />
contributions dans le cadre <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntification,<br />
l’instruction et la présentation aux instances <strong>de</strong><br />
décision. Ils sont éventuellement associés à <strong>de</strong>s<br />
missions d’i<strong>de</strong>ntification ou d’évaluation.<br />
Le chef <strong>de</strong> projet vérifie que l’équipe projet<br />
en assure la supervision régulière. Il associe<br />
pendant cette phase toutes les compétences<br />
voulues (agence, supervision externe). Il porte<br />
une attention particulière au respect <strong>de</strong> la<br />
démarche <strong>de</strong> responsabilité sociale et environnementale<br />
(RSE).<br />
Le coordonnateur en agence est chargé <strong>de</strong> la<br />
finalisation en agence <strong>de</strong> la fiche d’i<strong>de</strong>ntification<br />
<strong>de</strong> projet, et participe à la rédaction <strong>de</strong> la<br />
NPP et <strong>de</strong> la note <strong>de</strong> présentation aux instances<br />
<strong>de</strong> décision. Ce rôle est généralement tenu par<br />
70
Fiches pratiques sur l’AFD<br />
Fiche 4.5. Le cycle <strong>de</strong>s projets<br />
CONSEILS <strong>MÉTHODOLOGIQUE</strong>S À L’INTENTION<br />
DES COLLECTIVITÉS FRANÇAISES<br />
Compte tenu <strong>de</strong> la longueur et <strong>de</strong> la rigueur <strong>de</strong> cette démarche, qui garantit la bonne<br />
évaluation préalable d’un projet et sa bonne exécution, la recommandation essentielle est<br />
d’engager la concertation le plus en amont possible. La préparation du projet doit permettre<br />
<strong>de</strong> définir aussi précisément que possible les tâches incombant à chaque partenaire : le<br />
maître d’ouvrage du projet, l’AFD et la collectivité française.<br />
Si le projet est i<strong>de</strong>ntifié par l’AFD, qui propose un partenariat à une collectivité française,<br />
celle-ci <strong>de</strong>vra évaluer <strong>de</strong> manière précise sa capacité à répondre aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s formulées<br />
: capacités techniques, disponibilité <strong>de</strong>s agents qualifiés, engagement sur la durée du<br />
projet.<br />
Si le projet est i<strong>de</strong>ntifié par la collectivité française, ou si elle est saisie par son partenaire du<br />
Sud d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’appui dépassant ses propres capacités, ou requérant un investissement<br />
important, elle gagnera à en informer rapi<strong>de</strong>ment l’ambassa<strong>de</strong> <strong>de</strong> France et l’agence<br />
<strong>de</strong> l’AFD dans le pays concerné.<br />
MAÎTRE D’OUVRAGE<br />
BÉNÉFICIAIRE DU PROJET<br />
L’AGENCE FRANÇAISE DE<br />
DÉVELOPPEMENT<br />
Idée <strong>de</strong> projet<br />
Deman<strong>de</strong> à l’agence <strong>de</strong> l’AFD<br />
I<strong>de</strong>ntification<br />
Réalisation <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité<br />
Financement <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> (cas général)<br />
BUREAUX<br />
D’ÉTUDES<br />
Octroi du concours financier<br />
Signature <strong>de</strong> la convention <strong>de</strong> financement avec le bénéficiaire<br />
Appel d’offres - Signatures <strong>de</strong>s marchés<br />
Levée <strong>de</strong>s conditions suspensives<br />
Exécution du projet<br />
Suivi d’exécution<br />
Évaluation ex-post<br />
71
Informations,<br />
formations et<br />
concertations<br />
proposées<br />
73
Les informations, formations et concertations proposées<br />
Fiche 5.1. L’information fournie par le Ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et européennes (DAECL)<br />
Fiche 5.1. L’information fournie par le Ministère <strong>de</strong>s Affaires<br />
étrangères et européennes (DAECL)<br />
L’information est fournie, d’une part par <strong>de</strong>s<br />
publications, d’autre part par le portail CNCD<br />
du site France Diplomatie<br />
(www.diplomatie.gouv.fr/cncd/).<br />
Ce site est alimenté par la Délégation pour<br />
l’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités locales<br />
(DAECL).<br />
DEUX TÉLÉDÉCLARATIONS<br />
Elles permettent la mise à jour <strong>de</strong> la base <strong>de</strong><br />
données <strong>de</strong>s coopérations décentralisées et<br />
<strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> publique au développement. Les<br />
collectivités territoriales et les groupements<br />
peuvent <strong>de</strong>puis le 25 juin 2007 déclarer en<br />
ligne leur ai<strong>de</strong> publique au développement et<br />
mettre à jour en ligne la base <strong>de</strong> données <strong>de</strong><br />
la Commission Nationale <strong>de</strong> la Coopération<br />
Décentralisée grâce à <strong>de</strong>ux télédéclarations en<br />
ligne sur https://cncd.diplomatie.gouv.fr.<br />
UNE BOURSE-PROJETS DES<br />
COOPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES<br />
Elle recensera dans les pays partenaires <strong>de</strong>s projets<br />
<strong>de</strong> développement précis en cours ou en<br />
vue et qui pourraient intéresser les collectivités<br />
territoriales françaises.<br />
L’animation <strong>de</strong> cette bourse sera assurée par les<br />
ambassa<strong>de</strong>s.<br />
UNE BASE DE DONNÉES SPÉCIFIQUES AUX PAYS<br />
ÉMERGENTS (ENTREPRISES/LABORATOIRES DE<br />
RECHERCHE/COLLECTIVITÉS TERRITORIALES).<br />
La première étape <strong>de</strong> cette base concernera la<br />
Chine et le Chili.<br />
Un lien sera mis en place avec les sites <strong>de</strong>s Fonds<br />
bilatéraux pour la coopération décentralisée<br />
(voir fiche 1.2.).<br />
74<br />
La première permet aux collectivités territoriales<br />
et à leurs groupements <strong>de</strong> déclarer leur APD<br />
en ligne, l’autre leur permet <strong>de</strong> mettre à jour<br />
les informations les concernant dans la base<br />
<strong>de</strong> données <strong>de</strong>s coopérations décentralisées.<br />
Ces nouveaux outils innovants au service <strong>de</strong><br />
la coopération décentralisée faciliteront les<br />
démarches administratives <strong>de</strong>s collectivités territoriales,<br />
permettront <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong> données<br />
plus fiables et contribueront à une meilleure<br />
prise en compte et une plus gran<strong>de</strong> coordination<br />
<strong>de</strong> l’action internationale <strong>de</strong>s collectivités<br />
territoriales.<br />
UNE BASE DE DONNÉES DES COOPÉRATIONS<br />
DÉCENTRALISÉES REFONDUE ET MISE À JOUR<br />
La base <strong>de</strong> données, en ligne sur www.diplomatie.gouv.fr/cncd,<br />
qui recense les coopérations<br />
décentralisées et autres actions extérieures<br />
<strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises avec<br />
leurs homologues étrangères, sera totalement<br />
refondue, améliorée et enrichie : améliorations<br />
graphiques, réorganisation <strong>de</strong> l’information,<br />
ajouts <strong>de</strong> thématiques et <strong>de</strong> sous-thématiques<br />
plus pertinentes, ajout <strong>de</strong> moteurs <strong>de</strong> recherche<br />
plus performants, ajout par coopération et par<br />
projet <strong>de</strong> fiches détaillées. La base <strong>de</strong> données<br />
<strong>de</strong> la CNCD <strong>de</strong>viendra ainsi une véritable baseprojets<br />
très détaillée et mise à jour <strong>de</strong> manière<br />
continue en ligne.<br />
UN EXTRANET (ACCÈS PAR<br />
IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE)<br />
Il permettra selon la cible choisie (ambassa<strong>de</strong>s,<br />
collectivités territoriales, préfectures et grand<br />
public) d’accé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s informations réservées<br />
et à <strong>de</strong>s outils pratiques.<br />
UNE RUBRIQUE RÉNOVÉE ET PLUS<br />
EN LIEN AVEC L’ACTUALITÉ.<br />
La rubrique CNCD <strong>de</strong> France Diplomatie sera<br />
totalement réorganisée et proposera <strong>de</strong> nouvelles<br />
rubriques plus en lien avec l’actualité ainsi<br />
que <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>z-vous mensuels d’information :<br />
témoignages et entretiens, zoom sur un pays<br />
et ses coopérations décentralisées, bonnes<br />
pratiques <strong>de</strong> la coopération décentralisée,<br />
dossiers-pays...<br />
DES SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR UNE<br />
MEILLEURE DIFFUSION DE L’INFORMATION<br />
Des supports <strong>de</strong> communication faciliteront<br />
la diffusion <strong>de</strong> l’information sur ces nouveaux<br />
outils et sur l’actualité <strong>de</strong>s coopérations décentralisées<br />
et <strong>de</strong> la DAECL : lettre d’information<br />
bimensuelle, thématiques et par cible, mini-film<br />
présentant les nouvelles fonctionnalités <strong>de</strong> la<br />
rubrique CNCD, plaquettes d’information.<br />
Complément d’information :<br />
portail CNCD du site France Diplomatie :<br />
www.diplomatie.gouv.fr/cncd/
Les informations, formations et concertations proposées<br />
Fiche 5.2. L’information fournie par Cités Unies France<br />
Fiche 5.2. L’information fournie par Cités Unies France<br />
Cités Unies France (CUF) fournit une information<br />
générale au grand public par le biais <strong>de</strong><br />
son site (www.cites-unies-france.org), « le<br />
portail <strong>de</strong> la coopération décentralisée et <strong>de</strong><br />
l’action internationale <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />
françaises », et <strong>de</strong> son bulletin mensuel,<br />
« La lettre <strong>de</strong> la coopération décentralisée ».<br />
L’information <strong>de</strong> ses membres - et au-<strong>de</strong>là,<br />
<strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />
françaises engagées dans la coopération décentralisée<br />
- est une mission fondamentale <strong>de</strong> CUF.<br />
Cette information emprunte trois principaux<br />
canaux : l’information géographique, l’information<br />
transversale et une communication grand<br />
public.<br />
L’INFORMATION TRANSVERSALE<br />
CUF a récemment fait évoluer son offre <strong>de</strong><br />
formation. Les sessions <strong>de</strong> formation ont<br />
été remplacées par <strong>de</strong>s « Journées <strong>de</strong> la<br />
Coopération décentralisée ». Une journée est<br />
consacrée à un thème transversal ; <strong>de</strong>s intervenants<br />
très spécialisés sont invités, ils présentent<br />
un exposé et répon<strong>de</strong>nt aux questions <strong>de</strong>s<br />
participants. Cette formule remporte un grand<br />
succès. Elle est beaucoup moins coûteuse pour<br />
les collectivités locales.<br />
Ainsi, ont été organisées une journée sur<br />
l’appui institutionnel et trois journées sur les<br />
financements européens (une première portant<br />
sur le cadrage général, une <strong>de</strong>uxième sur<br />
les politiques <strong>de</strong> voisinage, la troisième sur les<br />
interventions dans les pays ACP).<br />
L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE<br />
CUF articule principalement son activité autour<br />
<strong>de</strong>s « groupes-pays », espaces d’échanges<br />
d’expériences qui réunissent <strong>de</strong> manière<br />
régulière les élus et techniciens <strong>de</strong>s collectivités<br />
développant une coopération décentralisée<br />
avec un pays donné. Il existe actuellement 27<br />
groupes-pays. Les responsables géographiques<br />
<strong>de</strong> l’AFD participent, au moins une fois par an,<br />
au groupe-pays du pays relevant <strong>de</strong> leur compétence<br />
à l’AFD.<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> ses activités groupe-pays, CUF<br />
édite :<br />
-<br />
-<br />
la collection « Dossier pays » ; 19 dossiers<br />
analysant les partenariats dans un pays sont<br />
disponibles ; ils sont régulièrement actualisés<br />
(13 <strong>de</strong> ces dossiers ont été publiés en 2006<br />
ou 2007 ; les autres datent <strong>de</strong> 2005, un seul<br />
<strong>de</strong> 2004) ;<br />
la collection « Répertoire <strong>de</strong>s partenariats » ;<br />
20 répertoires, également régulièrement<br />
actualisés sont disponibles ; chacun porte sur<br />
les partenariats <strong>de</strong> coopération décentralisée<br />
avec un pays.<br />
Egalement dans le cadre <strong>de</strong> l’information<br />
transversale, Cités Unies France dispose d’une<br />
collection « Réflexion » ; 7 ouvrages ont été<br />
publiés, sur <strong>de</strong>s thèmes (par exemple « Pauvreté<br />
et inégalité en Afrique subsaharienne », ou « Les<br />
jeunes, la vie locale et l’action internationale »<br />
ou « Migrants et collectivités territoriales - la<br />
coopération décentralisée, une réponse à la<br />
question du codéveloppement ? ») ou <strong>de</strong>s géographies<br />
(« Regards croisés sur la coopération<br />
décentralisée franco-burkinabè »). Récemment,<br />
CUF a lancé une nouvelle collection :<br />
« Référence », avec une première publication,<br />
« La coopération décentralisée change-t-elle <strong>de</strong><br />
sens ? », à la suite d’un colloque organisé à la<br />
Sorbonne pour les trente ans <strong>de</strong> CUF.<br />
Par ailleurs, les réunions <strong>de</strong> groupe-pays donnent<br />
lieu à <strong>de</strong>s compte-rendus.<br />
75
Fiche 5.3. L’information et les formations fournies par l’AFD<br />
L’INFORMATION FOURNIE PAR<br />
L’AFD<br />
L’AFD dispose d’outils <strong>de</strong> communication à<br />
usages interne et externe.<br />
LES OUTILS DE COMMUNICATION EXTERNE<br />
Le site internet : www.afd.fr<br />
Le site internet <strong>de</strong> l’AFD est actualisé au quotidien<br />
pour fournir une information pertinente<br />
et diversifiée. Il est l’outil principal <strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong><br />
au service <strong>de</strong> sa politique <strong>de</strong> transparence et <strong>de</strong><br />
sensibilisation. Toutes les informations relatives<br />
aux activités <strong>de</strong> l’AFD sont accessibles en ligne,<br />
<strong>de</strong> même que la majeure partie <strong>de</strong>s publications.<br />
Les actualités et événements ainsi que leurs<br />
comptes rendus, certaines productions audiovisuelles<br />
sont également disponibles. Des portails<br />
thématiques, sectoriels et géographiques ont<br />
été crées. Le moteur <strong>de</strong> recherche permet <strong>de</strong><br />
réaliser <strong>de</strong>s recherches thématiques ciblées.<br />
LES PUBLICATIONS<br />
L’AFD édite <strong>de</strong> nombreuses publications,<br />
institutionnelles (rapport annuel, document <strong>de</strong><br />
référence, etc.), <strong>de</strong> communication (plaquettes<br />
opérationnelles, paroles d’acteurs, etc.) ou <strong>de</strong><br />
recherche sur le développement (la Lettre <strong>de</strong>s<br />
économistes, Afrique contemporaine, etc.). La<br />
plupart <strong>de</strong> ces publications sont disponibles en<br />
ligne, sur le site <strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong>. Elles sont répertoriées,<br />
pour leur majorité, dans le catalogue du<br />
département <strong>de</strong> la communication :<br />
w w w . a f d . f r / j a h i a / w e b d a v / s i t e /<br />
myjahiasite/users/administrateur/<br />
public/publications/catalogueCOM.pdf<br />
Les essentiels<br />
Tous ces documents sont disponibles en ligne :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Rapport annuel<br />
Rapport annuel Outre-mer<br />
Document <strong>de</strong> référence : rapport financier<br />
<strong>de</strong> l’AFD<br />
Plan d’affaires<br />
La lettre d’information <strong>de</strong> l’AFD<br />
Les séries, revues et autres<br />
La majeure partie <strong>de</strong> ces documents est<br />
disponible en ligne ou, sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, auprès<br />
du département <strong>de</strong> la communication ou du<br />
département <strong>de</strong> la recherche.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Afrique contemporaine : revue trimestrielle<br />
regroupant <strong>de</strong>s articles d’analyse <strong>de</strong> chercheurs<br />
sur les gran<strong>de</strong>s tendances politiques,<br />
économiques et sociales du continent<br />
africain<br />
Documents <strong>de</strong> travail : cette série rend<br />
compte <strong>de</strong> travaux en cours <strong>de</strong> recherche sur<br />
<strong>de</strong>s thèmes divers<br />
Ex-post : note <strong>de</strong> synthèse qui présente <strong>de</strong>s<br />
leçons d’expérience tirées <strong>de</strong> travaux d’évaluation<br />
et <strong>de</strong> capitalisation<br />
Jumbo : prévisions économiques et financières<br />
et étu<strong>de</strong>s thématiques sur les pays <strong>de</strong> la<br />
zone franc<br />
Kaléidoscope : mensuel bibliographique sur<br />
le développement<br />
La Lettre <strong>de</strong>s économistes : revue<br />
bimestrielle d’information, <strong>de</strong> débat, <strong>de</strong><br />
communication et d’analyse économique<br />
Notes et Documents : publication <strong>de</strong> travaux<br />
<strong>de</strong> recherche, visant à faciliter les liens entre<br />
la recherche académique et l’expertise opérationnelle<br />
concernant le développement<br />
Paroles d’acteurs : cette série donne la<br />
parole aux acteurs du développement sur les<br />
gran<strong>de</strong>s thématiques actuelles<br />
Plaquettes opérationnelles<br />
Produitdoc : Fiches trimestrielles <strong>de</strong> conjoncture<br />
sur les marchés <strong>de</strong>s matières premières<br />
réalisées par les documentalistes <strong>de</strong> l’AFD<br />
Publications CEROM : cette série, consacrée<br />
à l’Outre mer, est réalisée en collaboration<br />
avec l’INSEE et les instituts sur les économies<br />
<strong>de</strong> l’Outre mer<br />
Regards sur la Terre<br />
L’audiovisuel<br />
L’AFD produit <strong>de</strong>s mini-films (5mn) <strong>de</strong>stinés à<br />
une large diffusion (Appui au développement<br />
rural au Vietnam, éducation au Sénégal,<br />
micro-crédit à Madagascar…). Ces films sont<br />
accessibles sur le site internet et peuvent être<br />
envoyés sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />
76
Les informations, formations et concertations proposées<br />
Fiche 5.3. L’information et les formations fournies par l’AFD<br />
Evénementiel<br />
L’AFD organise <strong>de</strong> nombreux événements,<br />
notamment internationaux, qui sont l’occasion<br />
<strong>de</strong> rencontres, échanges et débats autour <strong>de</strong>s<br />
problématiques et enjeux du développement.<br />
Ces manifestations permettent à l’<strong>Agence</strong><br />
<strong>de</strong> valoriser sa production intellectuelle,<br />
d’approfondir ses partenariats et <strong>de</strong> renforcer<br />
le dialogue avec l’ensemble <strong>de</strong>s acteurs du<br />
développement. L’AFD privilégie autant que<br />
possible la parole donnée à ses partenaires du<br />
Sud.<br />
Mécénat et images<br />
La participation <strong>de</strong> l’AFD à un certain nombre<br />
d’évènements culturels fait partie <strong>de</strong> son<br />
rayonnement. Soutenir la culture, notamment<br />
celle <strong>de</strong>s pays du Sud, fait partie intégrante <strong>de</strong><br />
notre mission d’appui au développement. Le<br />
Prix Tropiques <strong>de</strong> l’AFD, les expositions photographiques,<br />
l’animation culturelle du siège<br />
sont autant d’événements qui témoignent <strong>de</strong><br />
l’intérêt porté par l’AFD à la culture au sens<br />
large.<br />
LA CONSTITUTION D’UNE BASE DE PROJETS<br />
EN COURS DE PRÉPARATION SUSCEPTIBLES<br />
D’INTÉRESSER DES COLLECTIVITÉS LOCALES<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> son portail coopération<br />
décentralisée, l’AFD fera connaître, aussi<br />
précocement que possible, les projets qu’elle a<br />
i<strong>de</strong>ntifiés, ou auxquels elle réfléchit, pour susciter<br />
l’intérêt <strong>de</strong>s collectivités locales, et faciliter<br />
leur mobilisation en temps utile.<br />
L’information sur les interventions <strong>de</strong> l’AFD<br />
auprès <strong>de</strong> sociétés d’eau et d’assainissement<br />
sera diffusée <strong>de</strong> cette manière.<br />
LES FORMATIONS FOURNIES PAR LE<br />
CEFEB<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> la mise en oeuvre <strong>de</strong>s stratégies<br />
développées par l’AFD, le Département<br />
a diversifié son offre d’ateliers <strong>de</strong> réflexion et<br />
<strong>de</strong> formation à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s collectivités<br />
territoriales.<br />
Dans l’outre-mer français, le CEFEB met à la<br />
disposition <strong>de</strong>s partenaires <strong>de</strong> l’AFD les savoirfaire<br />
et les outils nécessaires à la conduite <strong>de</strong>s<br />
opérations <strong>de</strong> développement, <strong>de</strong> la définition<br />
<strong>de</strong> besoins jusqu’à l’évaluation rétrospective <strong>de</strong><br />
politique et <strong>de</strong> projet. Le CEFEB propose également<br />
un accompagnement méthodologique<br />
personnalisé et adapté à certaines collectivités<br />
pour élaborer leurs stratégies <strong>de</strong> développement<br />
local. Ces différentes actions permettent<br />
la création et l’animation <strong>de</strong> réseaux <strong>de</strong> partenaires<br />
responsables.<br />
Pour les collectivités françaises, le CEFEB<br />
propose <strong>de</strong> renforcer les synergies entre les<br />
activités <strong>de</strong> l’AFD et celles <strong>de</strong> la coopération<br />
décentralisée en :<br />
-<br />
-<br />
favorisant la participation <strong>de</strong>s collectivités<br />
françaises impliquées dans la coopération<br />
décentralisée à la formation « Coopération<br />
et <strong>Développement</strong> » qui réunit chaque année<br />
<strong>de</strong>s professionnels issus <strong>de</strong> différents organismes<br />
ou structures d’ai<strong>de</strong> au développement<br />
(ministères, organismes publics et privés,<br />
associations…) ;<br />
organisant <strong>de</strong>s rencontres régulières entre<br />
les opérationnels <strong>de</strong> l’AFD et <strong>de</strong>s collectivités<br />
françaises, pour mieux faire connaître aux<br />
collectivités françaises les outils et les métho<strong>de</strong>s<br />
d’intervention <strong>de</strong> l’AFD et <strong>de</strong> développer<br />
un langage commun.<br />
Pour les collectivités locales étrangères, le<br />
CEFEB propose <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> renforcement <strong>de</strong><br />
la maîtrise d’ouvrage publique locale, avec :<br />
-<br />
-<br />
l’organisation <strong>de</strong> séminaires techniques et<br />
thématiques à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s collectivités<br />
locales (à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s agences), en<br />
amont ou en accompagnement d’un projet<br />
<strong>de</strong> développement ;<br />
l’appui aux centres <strong>de</strong> formations locaux,<br />
pour développer <strong>de</strong>s formations techniques<br />
pour les cadres et élus locaux.<br />
Avec les associations <strong>de</strong> pouvoirs locaux, le<br />
CEFEB propose <strong>de</strong> mettre en place <strong>de</strong>s partenariats<br />
pour élaborer <strong>de</strong>s formations adaptées<br />
aux besoins <strong>de</strong> leurs adhérents, et favoriser la<br />
formation <strong>de</strong> formateurs pour décupler les<br />
formations.<br />
Complément d’information :<br />
- site <strong>de</strong> l’AFD : www.afd.fr<br />
- publications :<br />
www.afd.fr/jahia/webdav/site/<br />
myjahiasite/users/administrateur/<br />
public/publications/catalogueCOM.pdf<br />
77
CRÉDITS PHOTOS<br />
Photos <strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong> : Guillaume Josse : couverture (droite) et<br />
page 32 ; Olivia Dabbous : pages 8-9 ; Robert <strong>de</strong> La Rochefoucauld : pages 19 et 29 ; Nils<br />
Devernois : pages 22, 35 et 63 ; Thierry <strong>de</strong> Geyer d’Orth : pages 24-25, fiche 6.2., page<br />
1 ; photos pages 31, 56-57, fiche 6.3. page 1. Photos Cités Unies France : pages 2, 7, 14,<br />
72-73, 75, fiche 6.4., page 1. Photos Fonds Français pour l’Environnement Mondial :<br />
pages 22, 38, 39, 59. Photos Région Ile <strong>de</strong> France : pages 34, fiches 6.1., page 2, et 6.4.,<br />
page 2. Photo Région Picardie : fiche 6.1., page 1. Photo AIMF : page 77. Photos Denis<br />
Gérard : page 51. Photos Taoufik Lahlou : pages 36, 50. Fotolia.com : Philippe Devanne :<br />
couverture (gauche) ; Isabelle Esselin : page 44.<br />
NOTES
Fiches amovibles
FICHE<br />
6-1<br />
Principales questions posées par<br />
les collectivités territoriales<br />
L’AFD, peut-elle cofinancer <strong>de</strong>s projets<br />
<strong>de</strong> coopération <strong>de</strong> ma collectivité locale,<br />
comme le fait le ministère <strong>de</strong>s Affaires<br />
étrangères ?<br />
L’AFD n’a pas vocation à financer <strong>de</strong>s<br />
projets <strong>de</strong> coopération décentralisée, mais<br />
<strong>de</strong>s projets en faveur d’Etats étrangers ou<br />
<strong>de</strong> collectivités territoriales étrangères.<br />
Néanmoins, ses projets peuvent associer <strong>de</strong>s<br />
collectivités territoriales françaises, dans le<br />
cadre d’un partenariat, et elle peut même<br />
accor<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s financements spécifiques, sur<br />
appels à propositions.<br />
Voir fiche 4.3.<br />
Le projet <strong>de</strong> coopération <strong>de</strong> ma collectivité<br />
a déjà obtenu un cofinancement<br />
du ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et<br />
européennes (DAECL). L’AFD pourra-telle<br />
abon<strong>de</strong>r ?<br />
Les financements offerts par le MAEE et l’AFD<br />
ne sont pas liés, mais ils sont coordonnés. La<br />
possibilité <strong>de</strong> déboucher sur un partenariat<br />
avec l’AFD est considérée comme un plus pour<br />
l’attribution <strong>de</strong>s cofinancements du MAEE.<br />
Voir fiches 1.1., 1.2. et 4.3.<br />
Les règles <strong>de</strong> cofinancement <strong>de</strong> l’AFD,<br />
sont-elles les mêmes que celles du<br />
ministère (50%, périodicité, montant<br />
minimum) ?<br />
Chaque institution a ses règles propres.<br />
Toutefois, le financement <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong><br />
coopération décentralisée est principalement<br />
accordé par la voie d’appels à propositions.<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> ses partenariats avec les collectivités<br />
territoriales, l’AFD est très ouverte à<br />
la négociation. Les contributions respectives<br />
au financement et à la mise en œuvre du<br />
projet sont définies par convention.<br />
Voir fiches 4.2. et 4.3.<br />
Qu’est-ce que cela signifie pour ma<br />
collectivité <strong>de</strong> mener un projet avec<br />
l’AFD ?<br />
L’AFD conduit ses projets conformément à un<br />
cycle <strong>de</strong> projet, et aux règles définies par son<br />
manuel <strong>de</strong> procédures.<br />
Voir fiches 4.4., 4.5. et 4.6.<br />
J’ai une idée <strong>de</strong> projet, comment abor<strong>de</strong>r<br />
l’AFD ? Qui dois-je rencontrer, le<br />
siège à Paris ou l’agence dans le pays<br />
concerné ?<br />
Si le projet s’inscrit dans le DCP et dans le CIS<br />
<strong>de</strong> l’AFD, les représentants <strong>de</strong> la collectivité<br />
peuvent prendre contact avec l’AFD : soit en<br />
rencontrant l’agence dans le pays d’intervention,<br />
<strong>de</strong> préférence avec les représentants<br />
<strong>de</strong> la collectivité partenaire, soit en prenant<br />
contact avec le coordinateur régional, au siège<br />
<strong>de</strong> l’AFD.<br />
Voir fiche 6.2.<br />
J’ai un projet tout « ficelé », puis-je aller<br />
voir l’AFD ?<br />
Il est préférable <strong>de</strong> prendre contact avec<br />
l’AFD dès l’i<strong>de</strong>ntification du projet : les chances<br />
<strong>de</strong> monter un partenariat sont alors plus<br />
gran<strong>de</strong>s.<br />
Voir fiche 6.2.<br />
J’ai un projet dans le domaine <strong>de</strong> l’éducation<br />
ou <strong>de</strong> la santé. Comment coopérer<br />
avec l’AFD ?<br />
L’AFD intervient dans ces domaines seulement<br />
<strong>de</strong>puis la fin <strong>de</strong>s années 1990. En matière<br />
d’éducation, ses priorités sont l’éducation <strong>de</strong><br />
base et la formation professionnelle. Dans le<br />
domaine <strong>de</strong> la santé, elle est principalement<br />
chargée, dans les pays <strong>de</strong> la ZSP, <strong>de</strong> contribuer<br />
aux OMD, et, hors ZSP, <strong>de</strong> lutter contre les<br />
maladies transmissibles. L’AFD intervient principalement<br />
sous forme d’ai<strong>de</strong>-programme.<br />
De ce fait, la coopération avec les collectivités<br />
françaises ne s’est pas développée dans ces<br />
<strong>de</strong>ux domaines.<br />
Voir fiche 6.2.<br />
1
Je travaille dans un pays hors-ZSP,<br />
qu’est-ce que cela change pour une<br />
relation avec l’AFD ?<br />
Le mandat et les modalités d’intervention <strong>de</strong><br />
l’AFD diffèrent selon les pays. Hors ZSP, sa<br />
mission consiste à préserver les biens publics<br />
mondiaux, dont l’environnement. Dans ces<br />
pays, elle n’accor<strong>de</strong> pas <strong>de</strong> dons mais <strong>de</strong>s prêts.<br />
Cela peut avoir une influence sur les projets<br />
montés en partenariat avec <strong>de</strong>s collectivités<br />
françaises.<br />
Voir fiches 2.3., 2.4. et 4.3.<br />
L’AFD coopère-t-elle avec <strong>de</strong>s collectivités<br />
locales au-<strong>de</strong>là du champ <strong>de</strong> la<br />
coopération décentralisée ?<br />
L’AFD souhaite développer <strong>de</strong>s partenariats<br />
avec les collectivités françaises. Tel est d’ailleurs<br />
l’objet <strong>de</strong> ce gui<strong>de</strong>. Elle souhaite bénéficier <strong>de</strong><br />
l’expertise <strong>de</strong> ces collectivités dans le cadre <strong>de</strong><br />
certains <strong>de</strong> ses projets, même si ses partenaires<br />
français n’ont pas <strong>de</strong> relations <strong>de</strong> coopération<br />
décentralisée avec les collectivités du Sud,<br />
maîtres d’ouvrage <strong>de</strong>s projets.<br />
Voir fiches 2.5., 4.5. et 4.6.<br />
L’AFD peut-elle m’apporter une<br />
information quant aux orientations <strong>de</strong><br />
l’ai<strong>de</strong> française pour le pays dans lequel<br />
j’interviens ?<br />
Les informations générales sur l’ai<strong>de</strong> française<br />
sont fournies par les ambassa<strong>de</strong>s.<br />
Les documents cadres <strong>de</strong> partenariat (DCP)<br />
peuvent être consultés sur le site du Ministère<br />
<strong>de</strong>s Affaires étrangères et européennes. On<br />
trouve sur le site Internet <strong>de</strong> l’AFD <strong>de</strong>s portails<br />
géographiques et thématiques.<br />
Voir fiches 1.1., 5.1. et 5.2.<br />
L’AFD limite-t-elle ses interventions à<br />
certains secteurs ? Si oui, lesquels ?<br />
Les secteurs d’intervention <strong>de</strong> l’AFD sont<br />
fixés par le CICID. Dans les pays <strong>de</strong> la ZSP,<br />
son domaine s’étend aux secteurs suivants :<br />
agriculture et développement rural ; santé<br />
et éducation <strong>de</strong> base ; formation professionnelle<br />
; environnement ; secteur privé ;<br />
infrastructures et développement urbain.<br />
Voir fiches 1.1 et 2.2.<br />
appuis divers, en particulier <strong>de</strong> la formation.<br />
Toutefois, ses interventions financières sont<br />
encadrées par le DCP adopté pour le pays<br />
concerné.<br />
Voir fiches 2.5. et 5.2.<br />
La coopération avec l’AFD nécessitet-elle<br />
pour ma collectivité <strong>de</strong> signer un<br />
accord avec l’AFD ?<br />
Désormais, <strong>de</strong>s conventions sont signées entre<br />
la collectivité bénéficiaire, la collectivité française<br />
et l’AFD. La convention permet <strong>de</strong> bien<br />
définir les engagements <strong>de</strong> chaque partie.<br />
Voir fiche 4.2.<br />
J’ai mené un projet avec l’AFD, celui-ci<br />
s’achève. A quel moment suis-je délié <strong>de</strong><br />
mes responsabilités vis-à-vis <strong>de</strong> l’AFD ?<br />
Quelles sont ces responsabilités ?<br />
Les engagements <strong>de</strong> la collectivité sont définis<br />
par la convention tripartite liant la collectivité<br />
bénéficiaire, la collectivité française et l’AFD.<br />
Voir fiches 4.1., 4.2. et 4.4.<br />
L’agence d’urbanisme <strong>de</strong> ma collectivité,<br />
peut-elle être impliquée dans un<br />
projet mené en partenariat avec l’AFD ?<br />
Dans ce cas, ses frais <strong>de</strong> mission sont-ils<br />
pris en charge ? Qu’en est-il pour ses<br />
honoraires ?<br />
L’intervention d’un opérateur <strong>de</strong> la collectivité<br />
française dans le cadre d’un projet bénéficiant<br />
d’un financement <strong>de</strong> l’AFD est envisageable, et<br />
le financement du projet peut, sous certaines<br />
conditions, faciliter une partie <strong>de</strong> cette intervention.<br />
Cependant, ce montage doit respecter<br />
la réglementation <strong>de</strong>s marchés publics.<br />
Voir fiche 4.1.<br />
Les formations offertes par le CEFEB<br />
sont-elles ouvertes aux cadres <strong>de</strong> ma<br />
collectivité partenaire ou <strong>de</strong> ma propre<br />
collectivité ?<br />
Certaines formations sont dédiées aux cadres <strong>de</strong>s<br />
collectivités territoriales françaises et étrangères.<br />
Voir fiche 5.2.<br />
Notre collectivité locale partenaire,<br />
pourra-t-elle aller voir l’agence <strong>de</strong> l’AFD<br />
sur place pour chercher <strong>de</strong>s soutiens<br />
financiers ou techniques ?<br />
L’AFD souhaite développer ses relations<br />
avec les collectivités locales <strong>de</strong>s pays dans<br />
lesquels elle intervient. Elle peut leur offrir <strong>de</strong>s<br />
2
FICHE<br />
6-2<br />
Les interlocuteurs <strong>de</strong>s collectivités<br />
territoriales à l’AFD<br />
CONTACTS À L’AFD<br />
Les collectivités territoriales ont au sein <strong>de</strong><br />
l’AFD un interlocuteur privilégié :<br />
M Robert <strong>de</strong> La Rochefoucauld, Chargé<br />
<strong>de</strong>s relations avec les collectivités locales<br />
françaises<br />
Département <strong>de</strong>s relations extérieures et<br />
<strong>de</strong> la communication.<br />
Direction <strong>de</strong> la stratégie<br />
La cellule transparence<br />
(transparence@afd.fr) répond à toute<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’information.<br />
Par ailleurs, selon la nature <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>,<br />
les personnes suivantes peuvent être<br />
contactées :<br />
-<br />
pour les DCP, les stratégies régionales<br />
et les politiques pays : <strong>de</strong> préférence<br />
l’<strong>Agence</strong> dans le pays concerné ; à défaut<br />
le coordinateur régional du département<br />
géographique concerné<br />
(la liste <strong>de</strong>s agences figure sur le tableau ci-après,<br />
le coordinateur régional peut être contacté par<br />
l’intermédiaire du standard <strong>de</strong> l’AFD)<br />
-<br />
pour les politiques sectorielles : le département<br />
technique opérationnel (DTO)<br />
(la répartition <strong>de</strong>s attributions <strong>de</strong> chaque division<br />
technique figure sur le tableau ci-après)<br />
-<br />
pour un projet précis : le chef <strong>de</strong> projet.<br />
(le nom du chef <strong>de</strong> projet pourra être communique<br />
par l’agence dans le pays du projet ou par<br />
le coordinateur régional)<br />
ATTRIBUTIONS DES<br />
DÉPARTEMENTS<br />
TECHNIQUES DU SIÈGE<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
division « eau et assainissement » : chargée<br />
du secteur rural comme du secteur<br />
urbain ; cette division a également en<br />
charge les projets « ressource en eau » ;<br />
division « collectivités locales et développement<br />
urbain », adaptée aux besoins <strong>de</strong>s<br />
COM et, pour l’Afrique, au processus <strong>de</strong><br />
décentralisation et d’urbanisation ;<br />
division « équipement et environnement »,<br />
répondant aux objectifs mondiaux en<br />
matière environnementale et, à ce titre,<br />
responsable <strong>de</strong> la stratégie <strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong> en<br />
matière d’énergie et <strong>de</strong> transport ;<br />
division « santé » prend en charge le<br />
thème <strong>de</strong> « l’assurance sociale » et <strong>de</strong> la<br />
« protection sociale » ;<br />
division « éducation » avec le thème<br />
« formation professionnelle » dans une<br />
optique notamment <strong>de</strong> mise à niveau <strong>de</strong>s<br />
entreprises du secteur privé ou public ;<br />
division « développement agricole et<br />
rural » chargée <strong>de</strong>s filières agricoles et du<br />
développement local, mais également <strong>de</strong>s<br />
mécanismes d’atténuation <strong>de</strong>s impacts<br />
liés à la variation <strong>de</strong>s cours, d’assurance<br />
« climat » ou « famine » ;<br />
division « secteur financier et appui au<br />
secteur privé » chargée <strong>de</strong> « l’intermédiation<br />
financière », la « micro-finance »,<br />
la gestion du fonds ARIZ et du PRCC et<br />
<strong>de</strong> nouvelles formes d’intervention dans<br />
la « méso-finance ».<br />
1
CONTROLE PERMANENT<br />
ET DE LA CONFORMITE<br />
FRANCOIS KERHUEL<br />
ADJ. NICOLAS LE TARNEC<br />
VINCENT BERTOMEU<br />
Contrôle <strong>de</strong>s versements (DCV)<br />
PROPARCO<br />
LUC RIGOUZZO (DIRECTEUR GENERAL)<br />
ADJ. LAURENT DEMEY<br />
ADJ. PHILIPPE BASSERY<br />
OPERATIONS (DOP)<br />
LAURENT DEMEY<br />
AMELIE JULY<br />
BANQUES ET MARCHES FINANCIERS<br />
STEPHANIE LANFRANCHI<br />
ENTREPRISES<br />
JEROME-BERTRAND HARDY<br />
INFRASTRUCTURE ET MINES<br />
MARIE-HELENE LOISON<br />
PARTICIPATIONS<br />
ENGAGEMENTS (DEN)<br />
HELENE TEMPLIER<br />
ADMINISTRATION ET FINANCE (DAF)<br />
MARIE SENNEQUIER<br />
JURIDIQUE (DJU)<br />
MARIANNE SIVIGNON-LECOURT<br />
AFRIQUE SUBSAHARIENNE<br />
(AFR)<br />
JEAN-MARC GRAVELLINI<br />
ADJ. GERALD COLLANGE<br />
MEDITERRANEE ET<br />
MOYEN ORIENT (GOC)<br />
ETIENNE VIARD<br />
ADJ. YVES DES RIEUX<br />
OUTRE-MER (GOD)<br />
ODILE LAPIERRE<br />
ADJ. BERTRAND WILLOCQUET<br />
ASIE (GOE)<br />
MARTHA STEIN-SOCHAS<br />
ADJ. ANNE-MARIE CABRIT<br />
FRANCOISE NEUVY<br />
Crédits délégués et<br />
protocoles du Trésor (CDE)<br />
OPÉRATIONS<br />
JACQUES MOINEVILE<br />
ADJ. COLETTE GROSSET<br />
TECHNIQUE OPERATIONNEL<br />
(DTO)<br />
JEAN-YVES GROSCLAUDE<br />
ADJ. DENIS LOYER<br />
Cellule d’appui environnemental<br />
et social (CAES)<br />
MAURICE BERNARD<br />
Eau et assainissement (EAA)<br />
LOUIS-JACQUES VAILLANT<br />
Collectivités locales et<br />
développement urbain (CLD)<br />
ALEXIS BONNEL<br />
Environnement et équipement<br />
(ENE)<br />
MARIE-ODILE WATY<br />
Santé et protection sociale<br />
(SAN)<br />
JEAN-CLAUDE BALMES<br />
Education et formation<br />
professionnelle (EDU)<br />
BERNARD ESNOUF<br />
<strong>Développement</strong> agricole<br />
et rural (DAR)<br />
AUDE FLOGNY-CATRISSE<br />
Secteur financier et appui<br />
au secteur privé (SFP)<br />
INGENIERIE JURIDIQUE ET<br />
FINANCIERE (TJF)<br />
FRED OTTAVY<br />
....<br />
Ingénierie juridique (JUR)<br />
LAURENCE ROUGET-LE CLECH<br />
Ingénierie financière (TJF)<br />
<strong>Agence</strong> Francaise <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AFD<br />
JEAN-MICHEL SEVERINO<br />
Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> PROPARCO<br />
INSPECTION<br />
GÉNÉRALE<br />
CLAUDE RAYMOND<br />
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT<br />
SECRETARIAT DES<br />
JEAN-MICHEL DEBRAT<br />
CONSEILS<br />
CATHERINE CHEVALLIER<br />
DIRECTEUR GÉNÉRAL DELEGUE<br />
MICHEL JACQUIER<br />
(VICE-PRESIDENT DE PROPARCO)<br />
STRATÉGIE<br />
SECRÉTARIAT GENERAL<br />
RESSOURCES HUMAINES<br />
PIERRE JACQUET<br />
ANNE PAUGAM<br />
MARIE-FLORA HAKOUN-MILLELIRI<br />
(CHEF ECONOMISTE)<br />
(SECRÉTAIRE GÉNÉRALE)<br />
ADJ. ANNE-FRANCOISE DAYON<br />
RECHERCHE (RCH) RELATIONS EXTERIEURES FINANCEMENTS (DFR) SYSTEMES D’INFORMATION<br />
RESSOURCES HUMAINES<br />
ROBERT PECCOUD<br />
ET COMMUNICATION (RXC)<br />
GILLES BERGIN<br />
ET ORGANISATION (SIO)<br />
ANNE-FRANCOISE DAYON<br />
HENRY DE CAZOTTE<br />
ADJ. GREGORY CLEMENTE JEAN-FRANCOIS ARNAL<br />
LUDOVIC COCOGNE<br />
Recherche économique<br />
(FONCTION SECONDE OPINION)<br />
ADJ. LYSIANE RICHARD Ressources humaines et emploi (RHE)<br />
NICOLAS MORA<br />
PHILIPPE CHEDANNE<br />
et sociale (REC)<br />
JEAN-PHILIPPE AUBERTEL<br />
Administration (ADM)<br />
VERONIQUE SAUVAT<br />
Relations extérieures (REL) Risques et Gestion <strong>de</strong> bilan<br />
CYRILLE BERTON<br />
PATRICK DECROIX<br />
Appui à la gestion <strong>de</strong>s GUILLAUME DE SAINT-PHALLE<br />
(DRB)<br />
Maîtrise d’ouvrage déléguée<br />
Contrôle <strong>de</strong> gestion sociale<br />
connaissances (AGC)<br />
Communication (CMN)<br />
SYLVIE BOYER<br />
et organisation (MOD)<br />
......<br />
JEAN-DAVID NAUDET<br />
Evaluation et capitalisation (EVA)<br />
JEAN-MARC BELLOT<br />
Traitement comptable (DTC)<br />
HELENE PETITIMBERT<br />
Relations sociales (RSO)<br />
(Bureau <strong>de</strong> représentation)<br />
CECILE COUPRIE<br />
Administration, maintenance<br />
FRANCOIS PARMANTIER<br />
à Bruxelles)<br />
Back Office (DBO)<br />
et support (AMS)<br />
Retraites (RET)<br />
FRANCOIS-XAVIER BELLOCQ<br />
BENOIT LEHANNEUR<br />
BERNARD VEYSSIERE<br />
Analyse macroéconomique<br />
CEFEB<br />
Financements et opérations Technique informatique (DTI)<br />
et Risque pays (AMR)<br />
<strong>de</strong> marché (DFM)<br />
OLIVIER MOREAU<br />
GILLES GENRE-GRANPIERRE<br />
Production informatique (DPI)<br />
PILOTAGE STRATEGIQUE ET<br />
BUDGET ET CONTROLE DE<br />
DIDIER ROBERT<br />
MOYENS ET SERVICES<br />
Administration et<br />
GESTION (DBG)<br />
GENERAUX (DMS)<br />
DE LA PROSPECTIVE (PSP) Communication (ADC)<br />
FREDERIC BONTEMS<br />
PATRICK CHOUTEAU<br />
STEPHANE FOUCAULT<br />
JEAN-FRANCOIS ARNAL (P.I.)<br />
Formation (FOR)<br />
LAURENT DURIEZ<br />
Sécurité du système<br />
Pilotage stratégique (PST) SECRETARIAT DU FONDS<br />
d’information (DMS)<br />
FRANCOISE TISSEYRE<br />
FRANCAIS<br />
ERIC PAUL<br />
Animation et prospective POUR L’ENVIRONNEMENT<br />
Achats (DHA)<br />
(APR)<br />
MONDIAL<br />
SYLVAIN PILLOUD<br />
MARC-ANTOINE MARTIN<br />
Gestion du patrimoine (DGP)<br />
JEAN-BERNARD VERON<br />
Cellule Crises et Conflits RENE-PAUL SPIEGEL<br />
Secrétaire général<br />
Services généraux (SGE)<br />
(CCC)<br />
(FFEM)<br />
du septembre *organigramme régulièrement mis à jour sur le site www.afd.fr<br />
2
FICHE<br />
6-3<br />
Le réseau <strong>de</strong> l’AFD * : agences et<br />
bureaux dans les pays étrangers<br />
Abidjan<br />
CÔTE D’IVOIRE, LIBÉRIA<br />
Tél. : (225) 22 40 70 40<br />
afdabidjan@groupe-afd.org<br />
Abuja<br />
NIGERIA<br />
Tél. : (234) 703B 637 86 62<br />
bonnamourl@groupe-afd.org<br />
Accra<br />
GHANA<br />
Tél. : (233) 21 77 87 55<br />
afdaccra@gh.groupe-afd.org<br />
Addis-Abeba<br />
ÉTHIOPIE, ERYTHREE,<br />
SOUDAN, SOMALIE<br />
Tél. : (251) 11 442 59 01<br />
afdaddisabeba@groupe-afd.org<br />
Alger<br />
ALGÉRIE<br />
Tél. : (213) 21 69 43 00<br />
afdalger@groupe-afd.org<br />
Amman<br />
JORDANIE<br />
Tél. : (962 6) 46 04 702<br />
afdamman@groupe-afd.org<br />
Antananarivo<br />
MADAGASCAR<br />
Tél. : (261) 20 22 200 46<br />
afdantananarivo@groupe-afd.org<br />
Bamako<br />
MALI<br />
Tél. : (223) 221 28 42<br />
afdbamako@groupe-afd.org<br />
Bangkok<br />
THAïLANDE<br />
Tél. : (66) 2 636 12 35<br />
afdbangkok@groupe-afd.org<br />
Bangui<br />
CENTRAFRIQUE<br />
Tél. : (236) 21 61 03 06<br />
afdbangui@groupe-afd.org<br />
Beyrouth<br />
LIBAN<br />
Tél. : (961) 1 420 192<br />
afdbeyrouth@groupe-afd.org<br />
Brasilia<br />
BRESIL<br />
Tél. : (55) 61 33 22 43 20<br />
afdbrasilia@groupe-afd.org<br />
Brazzaville<br />
RÉPUBLIQUE DU CONGO<br />
Tél. : (242) 81 53 30<br />
afdbrazzaville@groupe-afd.org<br />
Bujumbura<br />
BURUNDI<br />
Tél. : (257) 25 59 31<br />
afd-burundi@usean-bu.net<br />
*<br />
Réseau <strong>de</strong>s agences <strong>de</strong> l’AFD régulièrement mis à jour sur le site www.afd.fr<br />
Casablanca<br />
MAROC<br />
Tél. : (212) 22 29 53 97<br />
afdprocasablanca@groupe-afd.org<br />
Cayenne<br />
GUYANE, GUYANA, SURINAM<br />
Tél. : 05 94 29 90 90<br />
afdcayenne@groupe-afd.org<br />
Colombo<br />
SRI LANKA<br />
Tél. : (94) 11 250 23 20<br />
afdcolombo@groupe-afd.org<br />
Conakry<br />
GUINÉE, SIERRA LEONE<br />
Tél. : (224) 30 41 25 69<br />
afdconakry@groupe-afd.org<br />
Cotonou<br />
BÉNIN<br />
Tél. : (229) 21 31 34 53<br />
afdcotonou@groupe-afd.org<br />
Dakar<br />
SÉNÉGAL, CAP-VERT, GAMBIE<br />
GUINÉE-BISSAU<br />
Tél. : (221) 33 849 19 99<br />
afddakar@groupe-afd.org<br />
Djibouti<br />
DJIBOUTI, ÉRYTHRÉE,<br />
SOUDAN, YÉMEN<br />
Tél. : (253) 35 22 97<br />
afddjibouti@groupe-afd.org<br />
1
Hanoï<br />
VIETNAM<br />
Tél. : (844) 4 823 67 64<br />
afdhanoi@groupe-afd.org<br />
Lomé<br />
TOGO<br />
Tél. : (228) 221 04 98<br />
afdlome@groupe-afd.org<br />
Phnom-Penh<br />
CAMBODGE<br />
Tél. : (855) 23 426 360<br />
afdphnompenh@groupe-afd.org<br />
Hô Chi Minh-Ville<br />
VIETNAM<br />
Tél. : (84) 8 824 72 43<br />
afdhochiminhville@groupe-afd.org<br />
Maputo<br />
MOZAMBIQUE<br />
Tél. : (258) 21 30 43 00<br />
afdmaputo@groupe-afd.org<br />
Port-au-Prince<br />
HAïTI<br />
Tél. : (509) 22 45 40 07<br />
afdportauprince@groupe-afd.org<br />
Islamabad<br />
PAKISTAN<br />
Tél. : (92) 51 265 51 96<br />
afdislamabad@groupe-afd.org<br />
Moroni<br />
COMORES<br />
Tél. : (269) 73 29 10<br />
afdmoroni@groupe-afd.org<br />
Port-Louis<br />
MAURICE<br />
Tel. : (230) 213 64 00<br />
afdportLouis@afd-afd.org<br />
Istanbul<br />
TURQUIE<br />
Tél. : (90) 212 283 31 11<br />
afdistanbul@groupe-afd.org<br />
N’Djamena<br />
TCHAD<br />
Tél. : (235) 52 70 71<br />
afdndjamena@groupe-afd.fr<br />
Rabat<br />
MAROC<br />
Tél. : (212) 37 63 23 94<br />
afdrabat@ma.groupe-afd.org<br />
Septembre 2008<br />
Jakarta<br />
INDONÉSIE<br />
Tél. : (62) 21 25 50 23 00<br />
afdjakarta@groupe-afd.org<br />
Jérusalem-est<br />
TERRITOIRES AUTONOMES<br />
PALESTINIENS<br />
Tél. : (972) 2 54 00 423<br />
afdjerusalem@groupe-afd.org<br />
Johannesbourg<br />
AFRIQUE DU SUD, BOTSWANA,<br />
MALAWI, NAMIBIE,<br />
ZIMBABWE, ZAMBIE<br />
Tél. : (27) 11 540 71 00<br />
afdjohannesbourg@groupe-afd.org<br />
Kinshasa<br />
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE<br />
DU CONGO<br />
Tél. : (243) 99 86 82 598<br />
afdkinshasa@groupe-afd.org<br />
Lagos<br />
NIGERIA<br />
Tél. : (234) 1 269 36 96<br />
Le Caire<br />
ÉGYPTE<br />
Tél : (20) 22 735 17 88<br />
afdlecaire@groupe-afd.org<br />
Libreville<br />
GABON, ANGOLA, SAO<br />
TOMÉ ET PRINCIPE<br />
Tél. : (241) 74 33 74<br />
afdlibreville@groupe-afd.org<br />
Nairobi<br />
KENYA, BURUNDI, OUGANDA,<br />
RWANDA, TANZANIE<br />
Tél. : (254) 20 271 84 52<br />
afdnairobi@groupe-afd.org<br />
New Delhi<br />
INDE<br />
Tél. : (91) 11 23 79 37 47<br />
Niamey<br />
NIGER<br />
Tél. : (227) 20 72 33 93<br />
afdniamey@groupe-afd.org<br />
Nouakchott<br />
MAURITANIE<br />
Tél. : (222) 525 25 25<br />
afdnouakchott@groupe-afd.org<br />
Nouméa<br />
NOUVELLE-CALÉDONIE,<br />
VANUATU - ÉTATS INSULAIRES<br />
DU PACIFIQUE-SUD<br />
Tél. : (687) 24 26 00<br />
afdnoumea@groupe-afd.org<br />
Ouagadougou<br />
BURKINA FASO<br />
Tél. : (226) 50 30 60 92<br />
afdouagadougou@bf.groupe-afd.org<br />
Pékin<br />
CHINE<br />
Tél. : (86) 10 84 51 12 00<br />
afdpekin@groupe-afd.org<br />
Saint-Denis<br />
REUNION, SEYCHELLES,<br />
TERRES AUSTRALES ET<br />
ANTARCTIQUES FRANCAISES<br />
Tél. : 02 62 90 00 90<br />
afdst<strong>de</strong>nis@re.groupe-afd.org<br />
Saint-Domingue<br />
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,<br />
BAHAMAS, CUBA, JAMAIQUE<br />
Tél. : (809) 547 12 89<br />
afdstdomingue@groupe-afd.org<br />
Sanaa<br />
YEMEN<br />
Tél. : (967) 712 65 77 93<br />
afddjibouti@groupe-afd.org<br />
Sao Paulo<br />
BRESIL<br />
Tél. : (55) 11 22 46 27 91<br />
Tunis<br />
TUNISIE<br />
Tél. : (216) 71 861 799<br />
afdtunis@afd.fr<br />
Vientiane<br />
LAOS<br />
Tél. : (856) 21 24 32 95<br />
afdvientiane@groupe-afd.org<br />
Yaoundé<br />
CAMEROUN, CENTRAFRIQUE,<br />
GUINEE EQUATORIALE<br />
Tél. : (237) 22 22 00 15<br />
afdyaoun<strong>de</strong>@cm.groupe-afd.org<br />
2
FICHE<br />
6-4<br />
Les adresses utiles <strong>de</strong> la<br />
coopération décentralisée<br />
SITES DES ASSOCIATIONS NATIONALES DE COLLECTIVITÉS<br />
TERRITORIALES :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Association <strong>de</strong>s Maires <strong>de</strong> France (AMF)<br />
www.amf.asso.fr<br />
Assemblée <strong>de</strong>s Départements<br />
<strong>de</strong> France (ADF)<br />
www.<strong>de</strong>partement.org<br />
Association <strong>de</strong>s Régions <strong>de</strong> France (ARF)<br />
www.arf.asso.fr<br />
Association <strong>de</strong>s Maires <strong>de</strong>s Gran<strong>de</strong>s<br />
Villes <strong>de</strong> France (AMGVF)<br />
www.gran<strong>de</strong>svilles.org<br />
Fédération <strong>de</strong>s Maires <strong>de</strong>s<br />
Villes Moyennes (FMVM)<br />
www.villesmoyennes.asso.fr<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Association <strong>de</strong>s Petites Villes<br />
<strong>de</strong> France (APVF)<br />
www.apvf.asso.fr<br />
Association <strong>de</strong>s Maires Ruraux<br />
<strong>de</strong> France (AMRF)<br />
www.amrf.asso.fr<br />
Assemblée <strong>de</strong>s Communautés<br />
<strong>de</strong> France (ADCF)<br />
www.intercommunalites.com<br />
Association <strong>de</strong>s Communautés<br />
Urbaines <strong>de</strong> France<br />
www.communautes-urbaines.com<br />
SITES DES ASSOCIATIONS NATIONALES SPÉCIALISÉES DANS<br />
L’ACTION INTERNATIONALE :<br />
-<br />
-<br />
Cités Unies France (CUF)<br />
www.cites-unies-france.org<br />
Association <strong>Française</strong> du Conseil<br />
<strong>de</strong>s Communes et Régions<br />
d’Europe (AFCCRE)<br />
www.afccre.org<br />
-<br />
-<br />
Association <strong>de</strong>s Responsables <strong>de</strong>s<br />
Relations Internationales et <strong>de</strong><br />
Coopération Décentralisée (ARRICOD)<br />
http://arricod.com<br />
Union Nationale <strong>de</strong>s Acteurs du<br />
<strong>Développement</strong> Local (UNADEL)<br />
www.una<strong>de</strong>l.asso.fr<br />
1
SITES DES ASSOCIATIONS NATIONALES AYANT UNE<br />
ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL :<br />
-<br />
Fédération <strong>de</strong>s Entreprises Publiques<br />
Locales (ex Fédération <strong>de</strong>s SEM)<br />
www.lesepl.fr/<br />
-<br />
Fédération Nationale <strong>de</strong>s Parcs Naturels<br />
Régionaux <strong>de</strong> France (FPNRF)<br />
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/<br />
-<br />
Fédération Nationale <strong>de</strong>s <strong>Agence</strong>s<br />
d’Urbanisme (FNAU)<br />
www.fnau.org/<br />
-<br />
Fédération Nationale <strong>de</strong>s Communes<br />
Forestières <strong>de</strong> France (FNCoFor)<br />
www.fncofor.fr/<br />
SITES DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES :<br />
-<br />
Cities Alliance<br />
www.citiesalliance.org/<br />
-<br />
Local authorities for sustainable<br />
<strong>de</strong>velopment (ICLEI)<br />
www.iclei.org/<br />
-<br />
Organisation Internationale <strong>de</strong> la<br />
Francophonie (OIF)<br />
www.francophonie.org/<br />
-<br />
Eurocities<br />
www.eurocities.org<br />
-<br />
Cités et gouvernements locaux unis<br />
(CGLU)<br />
www.cities-localgovernments.org/uclg/<br />
in<strong>de</strong>x.asp<br />
-<br />
Conseil <strong>de</strong>s communes et <strong>de</strong>s régions<br />
d’Europe (CCRE)<br />
www.ccre.org/homepage.htm<br />
Septembre 2008<br />
2
5 rue Roland Barthes - 75598 Paris ce<strong>de</strong>x 12<br />
Tél : +33 1 53 44 31 31<br />
www.afd.fr<br />
Septembre 2008