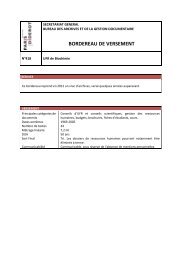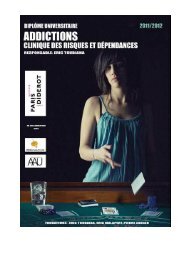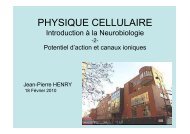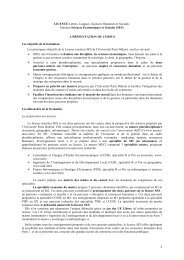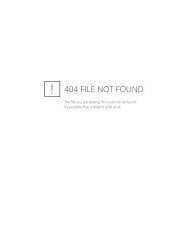Les objets mathématiques selon Platon - Université Paris Diderot ...
Les objets mathématiques selon Platon - Université Paris Diderot ...
Les objets mathématiques selon Platon - Université Paris Diderot ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
attitude de recul et de réflexion, Socrate devrait le dire. Comment se fait-il alors que les<br />
géomètres eux-mêmes sont disposés à rejeter leurs propres discours <br />
Leur double attitude me semble refléter la dualité de leurs <strong>objets</strong>. En effet, dès sa<br />
première description de la géométrie, Socrate a dit que les géomètres parlent des figures<br />
visibles tout en pensant aux <strong>objets</strong> intelligibles. Maintenant nous apprenons ce que disent les<br />
géomètres en construisant, c’est-à-dire qu’ils carrent, appliquent et ajoutent. C’est pour deux<br />
raisons qu’ils ne peuvent s'empêcher d’en parler : il s’agit de communiquer à autrui un savoir<br />
ou bien une hypothèse ; l’auditeur suit les constructions que le discours de celui qui dessine<br />
permet de comprendre comme des séries d’actes organisés qui tendent vers un but. Pourtant,<br />
parce qu'ils cherchent une connaissance conceptuelle d'<strong>objets</strong> intelligibles, les géomètres<br />
sont aussi capables de reconnaître la fonction restreinte de leurs discours pratiques et<br />
d'admettre qu'ils sont parfaitement inappropriés au but cognitif qu'ils poursuivent.<br />
La critique de Socrate, qui frappe les « discours de travail » des géomètres, est donc basée<br />
sur l'opposition entre « en vue de la pratique » et « en vue de la connaissance ». Ce que<br />
signifie « en vue de la pratique », cela se comprend le plus aisément, si l'on pense à<br />
l'enseignement ou à la communication entre collègues : l'un demande à l'autre de suivre les<br />
constructions qu’il exécute ; il parle donc pour amener l'autre à imaginer cette pratique. Du<br />
point de vue d'un observateur naïf, la naissance des figures dans le sable ou sur le tableau<br />
noir est ce que le discours veut expliquer. C'est ridicule dans la mesure où les figures ne sont<br />
qu'un moyen par rapport au véritable but qu'est la connaissance. Mais pourquoi le même<br />
discours n’engendre-t-il pas une connaissance, en décrivant la construction Or, le texte ne<br />
précise pas tout de suite que la connaissance qui est visée porte sur des <strong>objets</strong> imperceptibles.<br />
Par conséquent, on ne comprend le caractère ridicule du discours qu’en supposant que, en<br />
tant que telle, la connaissance ne saurait être le but du discours qui décrit les constructions.<br />
Cela se comprend en pensant aux techniques artisanales ou autres que Socrate ne cesse de<br />
citer comme exemples de pratiques rationnelles : là, le savoir précède et conduit la pratique,<br />
il ne saurait donc être son résultat.<br />
Cependant, si l’on explique ainsi le caractère ridicule du discours des géomètres,<br />
comment peut-on encore comprendre que ce discours est aussi inévitable Comment<br />
servirait-il à la communication d’un savoir ou d’une hypothèse, s’il n’apprend rien à<br />
l’auditeur Le texte ne répond pas à cette question, car, tout en évoquant des discours « en<br />
vue de la pratique » il ne distingue pas les rôles de l’orateur et de l’auditeur. Il faut donc se<br />
contenter d’une hypothèse exégétique. À ce propos, on peut partir de deux prémisses.<br />
12