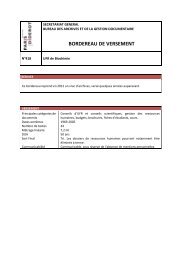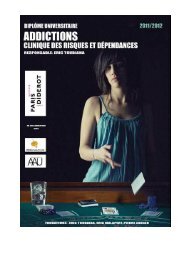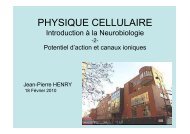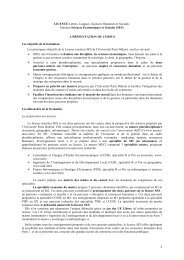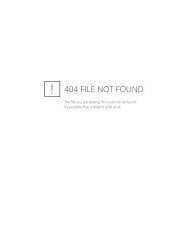Les objets mathématiques selon Platon - Université Paris Diderot ...
Les objets mathématiques selon Platon - Université Paris Diderot ...
Les objets mathématiques selon Platon - Université Paris Diderot ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
valeurs. À la différence des prédicats comme « cheval » et « maison », les prédicats<br />
évaluatifs ne sont pas clairs et souvent controversés, lorsqu'il y a conflit. Socrate explique, en<br />
effet, les conflits, même les guerres, non par des oppositions d'intérêts, mais par des<br />
compréhensions inconciliables de ce qui est juste, admirable et utile (voir Euthyphron 7 b -<br />
8 e). Car ces divergences entraînent des jugements de valeur opposés sur certains faits ou<br />
conditions qui deviennent par là matière de conflit.<br />
Voilà une des configurations dans lesquelles le savoir moral, c'est-à-dire la définition des<br />
termes évaluatifs, est censé apporter une solution. Un autre type de situation est représenté<br />
par la question de savoir si certains exercices militaires rendent courageux : pour en juger, il<br />
faut savoir ce que cela veut dire qu'être courageux. Or, Socrate prend pour acquis qu'on le<br />
sait en définissant le prédicat « courageux » ou le courage et que la même chose vaut pour<br />
les autres prédicats du même ordre. Socrate pense, en effet, que les définitions fonctionnent<br />
comme des critères qui permettent de se rendre compte à propos de chaque objet particulier<br />
s'il satisfait à la définition ou non, si bien qu'il faut affirmer de lui le prédicat défini ou bien<br />
le nier. Cependant, Socrate ne prend pas les définitions pour des règles linguistiques qui<br />
déterminent le bon usage des prédicats, il les prend pour des expressions qui désignent<br />
quelque chose, et il appelle ce quelque chose déjà « idée » ou « forme ». Il utilise donc le<br />
même terme qui revient dans les dialogues de maturité de <strong>Platon</strong>, mais il ne développe pas<br />
encore la conception de ce que sont les idées. Sauf qu'il leur assigne deux fonctions : une<br />
objective qui, dans le cas de l'idée de la piété, par exemple, consiste à être ce grâce à quoi<br />
tout est pieux qui l'est ; une fonction cognitive qui est celle du modèle (paradeigma) que l'on<br />
regarde par le biais de la définition pour appeler ensuite pieux ce qui ressemble au modèle et<br />
pour nier cette propriété à propos de tout ce qui ne lui ressemble pas (Euthyphron 6 d-e).<br />
2. L'hypothèse des idées généralisée<br />
La spécificité de ces idées socratiques réside dans leur caractère moral. Ce caractère rend<br />
compréhensible ce qu'on lira dans les dialogues de maturité, c'est-à-dire que ce n'est pas par<br />
expérience que nous connaissons les idées. Car on peut accepter qu'aucune personne, aucune<br />
action réalise pleinement ce que nous entendons, par exemple, en parlant de « juste » et de<br />
« justice ». <strong>Platon</strong> précise cette idée en faisant remarquer que nous appliquons ces prédicats<br />
toujours dans des contextes particuliers dont les caractéristiques ne sont pas généralisables<br />
pour définir le prédicat. Par exemple, il passe pour juste de rendre à quelqu'un ce qu'il a<br />
prêté, mais si un homme a prêté une arme à un autre, il ne serait pas juste pour ce dernier de<br />
la rendre, lorsque le premier souffre d'un accès de folie et risque de se suicider (République<br />
2