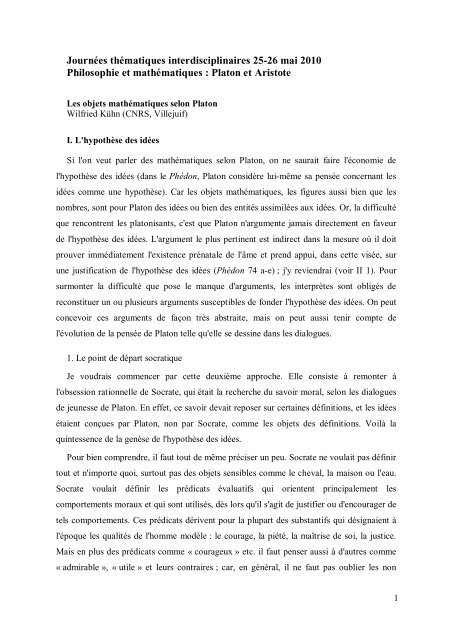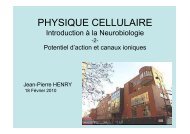Les objets mathématiques selon Platon - Université Paris Diderot ...
Les objets mathématiques selon Platon - Université Paris Diderot ...
Les objets mathématiques selon Platon - Université Paris Diderot ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Journées thématiques interdisciplinaires 25-26 mai 2010<br />
Philosophie et mathématiques : <strong>Platon</strong> et Aristote<br />
<strong>Les</strong> <strong>objets</strong> mathématiques <strong>selon</strong> <strong>Platon</strong><br />
Wilfried Kühn (CNRS, Villejuif)<br />
I. L'hypothèse des idées<br />
Si l'on veut parler des mathématiques <strong>selon</strong> <strong>Platon</strong>, on ne saurait faire l'économie de<br />
l'hypothèse des idées (dans le Phédon, <strong>Platon</strong> considère lui-même sa pensée concernant les<br />
idées comme une hypothèse). Car les <strong>objets</strong> mathématiques, les figures aussi bien que les<br />
nombres, sont pour <strong>Platon</strong> des idées ou bien des entités assimilées aux idées. Or, la difficulté<br />
que rencontrent les platonisants, c'est que <strong>Platon</strong> n'argumente jamais directement en faveur<br />
de l'hypothèse des idées. L'argument le plus pertinent est indirect dans la mesure où il doit<br />
prouver immédiatement l'existence prénatale de l'âme et prend appui, dans cette visée, sur<br />
une justification de l'hypothèse des idées (Phédon 74 a-e) ; j'y reviendrai (voir II 1). Pour<br />
surmonter la difficulté que pose le manque d'arguments, les interprètes sont obligés de<br />
reconstituer un ou plusieurs arguments susceptibles de fonder l'hypothèse des idées. On peut<br />
concevoir ces arguments de façon très abstraite, mais on peut aussi tenir compte de<br />
l'évolution de la pensée de <strong>Platon</strong> telle qu'elle se dessine dans les dialogues.<br />
1. Le point de départ socratique<br />
Je voudrais commencer par cette deuxième approche. Elle consiste à remonter à<br />
l'obsession rationnelle de Socrate, qui était la recherche du savoir moral, <strong>selon</strong> les dialogues<br />
de jeunesse de <strong>Platon</strong>. En effet, ce savoir devait reposer sur certaines définitions, et les idées<br />
étaient conçues par <strong>Platon</strong>, non par Socrate, comme les <strong>objets</strong> des définitions. Voilà la<br />
quintessence de la genèse de l'hypothèse des idées.<br />
Pour bien comprendre, il faut tout de même préciser un peu. Socrate ne voulait pas définir<br />
tout et n'importe quoi, surtout pas des <strong>objets</strong> sensibles comme le cheval, la maison ou l'eau.<br />
Socrate voulait définir les prédicats évaluatifs qui orientent principalement les<br />
comportements moraux et qui sont utilisés, dès lors qu'il s'agit de justifier ou d'encourager de<br />
tels comportements. Ces prédicats dérivent pour la plupart des substantifs qui désignaient à<br />
l'époque les qualités de l'homme modèle : le courage, la piété, la maîtrise de soi, la justice.<br />
Mais en plus des prédicats comme « courageux » etc. il faut penser aussi à d'autres comme<br />
« admirable », « utile » et leurs contraires ; car, en général, il ne faut pas oublier les non<br />
1
valeurs. À la différence des prédicats comme « cheval » et « maison », les prédicats<br />
évaluatifs ne sont pas clairs et souvent controversés, lorsqu'il y a conflit. Socrate explique, en<br />
effet, les conflits, même les guerres, non par des oppositions d'intérêts, mais par des<br />
compréhensions inconciliables de ce qui est juste, admirable et utile (voir Euthyphron 7 b -<br />
8 e). Car ces divergences entraînent des jugements de valeur opposés sur certains faits ou<br />
conditions qui deviennent par là matière de conflit.<br />
Voilà une des configurations dans lesquelles le savoir moral, c'est-à-dire la définition des<br />
termes évaluatifs, est censé apporter une solution. Un autre type de situation est représenté<br />
par la question de savoir si certains exercices militaires rendent courageux : pour en juger, il<br />
faut savoir ce que cela veut dire qu'être courageux. Or, Socrate prend pour acquis qu'on le<br />
sait en définissant le prédicat « courageux » ou le courage et que la même chose vaut pour<br />
les autres prédicats du même ordre. Socrate pense, en effet, que les définitions fonctionnent<br />
comme des critères qui permettent de se rendre compte à propos de chaque objet particulier<br />
s'il satisfait à la définition ou non, si bien qu'il faut affirmer de lui le prédicat défini ou bien<br />
le nier. Cependant, Socrate ne prend pas les définitions pour des règles linguistiques qui<br />
déterminent le bon usage des prédicats, il les prend pour des expressions qui désignent<br />
quelque chose, et il appelle ce quelque chose déjà « idée » ou « forme ». Il utilise donc le<br />
même terme qui revient dans les dialogues de maturité de <strong>Platon</strong>, mais il ne développe pas<br />
encore la conception de ce que sont les idées. Sauf qu'il leur assigne deux fonctions : une<br />
objective qui, dans le cas de l'idée de la piété, par exemple, consiste à être ce grâce à quoi<br />
tout est pieux qui l'est ; une fonction cognitive qui est celle du modèle (paradeigma) que l'on<br />
regarde par le biais de la définition pour appeler ensuite pieux ce qui ressemble au modèle et<br />
pour nier cette propriété à propos de tout ce qui ne lui ressemble pas (Euthyphron 6 d-e).<br />
2. L'hypothèse des idées généralisée<br />
La spécificité de ces idées socratiques réside dans leur caractère moral. Ce caractère rend<br />
compréhensible ce qu'on lira dans les dialogues de maturité, c'est-à-dire que ce n'est pas par<br />
expérience que nous connaissons les idées. Car on peut accepter qu'aucune personne, aucune<br />
action réalise pleinement ce que nous entendons, par exemple, en parlant de « juste » et de<br />
« justice ». <strong>Platon</strong> précise cette idée en faisant remarquer que nous appliquons ces prédicats<br />
toujours dans des contextes particuliers dont les caractéristiques ne sont pas généralisables<br />
pour définir le prédicat. Par exemple, il passe pour juste de rendre à quelqu'un ce qu'il a<br />
prêté, mais si un homme a prêté une arme à un autre, il ne serait pas juste pour ce dernier de<br />
la rendre, lorsque le premier souffre d'un accès de folie et risque de se suicider (République<br />
2
I, 331 c). C'est pourquoi il paraît nécessaire de définir les prédicats moraux hors contexte<br />
empirique.<br />
Pourtant, en développant l'hypothèse des idées, <strong>Platon</strong> ne s'en est pas tenu au domaine<br />
moral. Au contraire, il a supposé une idée correspondant à chaque prédicat, que le prédicat<br />
désigne une chose comme « table » ou bien une qualité des choses comme « égal » ou<br />
« beau » (République X, 596 a). <strong>Platon</strong> généralise donc l'approche de Socrate, si bien qu'elle<br />
porte aussi sur les nombres. C'est pourquoi l'hypothèse des idées invite à l'interprétation plus<br />
abstraite que j'ai déjà annoncée. Or, si les idées sont généralement les signifiés des<br />
définitions, elles le sont aussi en quelque sorte des termes définis, car les définitions<br />
clarifient et rendent cohérent ce que, en prononçant les termes définis, nous entendons dire<br />
sans faire attention au sens précis et à la cohérence de l'usage que nous faisons des différents<br />
termes.<br />
Si, donc, les idées sont, de façon médiate, les signifiés des termes du langage, ce n'est pas<br />
vrai de tous les termes. Car les termes singuliers comme les noms propres ou les mots<br />
déictiques (« celui-là ») désignent des <strong>objets</strong> individuels sensibles. <strong>Les</strong> idées correspondent,<br />
par contre, aux termes génériques qui peuvent servir de prédicats comme « rectangulaire »<br />
ou « cochon » (les verbes comme « marcher » ne sont d'ailleurs pas pris en compte du tout).<br />
Par là, l'hypothèse des idées répond à une question que Socrate ne semble pas s'être posée, à<br />
savoir : qu'est-ce que le signifié des termes génériques ou des prédicats <br />
Cette question fait sens dans la mesure où le signifié de ces termes ne saurait être l'objet<br />
individuel dont ils sont prédiqués à chaque fois, étant donné qu'ils se prédiquent<br />
d'innombrables <strong>objets</strong> individuels, tout en exprimant un seul sens — de toute façon après la<br />
suppression d'éventuelles polysémies, si besoin en est. Au fait qu'un seul terme générique se<br />
prédique d'innombrables <strong>objets</strong>, correspond, <strong>selon</strong> <strong>Platon</strong>, un rapport objectif entre l’unique<br />
signifié du terme générique, c'est-à-dire l'idée, et les multiples choses sensibles dont le terme<br />
générique est prédiqué à chaque fois. En effet, comme on l'a déjà vu, l'idée est ce grâce à<br />
quoi les choses sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire que l'idée de la table est responsable du fait<br />
que certains <strong>objets</strong> sont des tables.<br />
Dans l'histoire de la philosophie, l'hypothèse des idées représente la première proposition<br />
de concevoir le sens des termes génériques : ces termes désignent chacun une seule entité<br />
non sensible, accessible à la seule raison, donc une forme intelligible. Après avoir été rejetée<br />
par Aristote et les autres élèves de <strong>Platon</strong>, cette proposition trouvait une espèce d'écho chez<br />
le mathématicien et logicien Gottlob Frege, au 19 e siècle. Selon Frege, le signifié des<br />
3
prédicats est non pas une idée, mais un concept objectif qu'il conçoit comme une fonction<br />
mathématique en associant la copule au terme nominal. Un tel concept est alors « est<br />
cochon », une fonction à laquelle on donne un argument en disant « celui-là est un<br />
cochon » ; la valeur de ce genre d'expression est alors le vrai ou le faux. Si j'évoque le<br />
concept de Frege, c'est pour faire remarquer que la proposition de <strong>Platon</strong> est moins<br />
extravagante que ne laissent croire ses nombreux détracteurs.<br />
3. Comment les <strong>objets</strong> intelligibles se distinguent-elles des choses sensibles <br />
Pour expliquer que les <strong>objets</strong> des définitions sont non pas les choses individuelles<br />
sensibles mais plutôt les idées, <strong>Platon</strong> argumente non seulement du fait que chaque objet<br />
défini, étant un seul, soit en quelque sorte commune aux multiples choses dont se prédique le<br />
terme générique correspondant. De plus, il établit certains critères que doit remplir l'objet<br />
d'une définition et qu'il attribue aux idées, parce que les choses sensibles ne les remplissent<br />
pas. C'est d'abord le fait d'exister toujours et de ne s'accroître ni ne diminuer, car la définition<br />
classique ne contient de coefficient temporel ni n’indique une évolution. C’est ensuite le fait<br />
d'être simple, c'est-à-dire de ne présenter qu'une seule forme ou caractéristique, celle qui fait<br />
l'objet de la définition. Ce dernier critère distingue les idées des choses particulières, parce<br />
que ces dernières sont ambiguës de deux façons : elles présentent une qualité sous un aspect<br />
et son contraire sous un autre, comme deux ballons se ressemblent en volume mais sont<br />
dissemblables en couleur ; ils présentent une qualité tout en étant autre chose, comme un<br />
visage est beau sans qu'il ne soit rien que beau, car il et aussi visage (Banquet 211 a-b).<br />
Nous ne comprenons pas que cela demande la distinction entre choses sensibles et <strong>objets</strong><br />
simples, parce que nous sommes habitués à distinguer couramment entre la chose et ses<br />
attributs, entre le visage et sa beauté. Mais <strong>Platon</strong>, même s'il fait parfois la différence<br />
abstraite entre la chose (ousia) et l'état (pathos) dans lequel elle se trouve, a coutume<br />
d'appeler une chose belle « le beau » et une chose grande « le grand ». Ces expressions<br />
suggèrent qu'elles désignent des <strong>objets</strong> caractérisés par un seul attribut, mais ce n'est pas<br />
exact, car elles désignent en réalité ce qui est beau ou grand, c’est-à-dire des choses<br />
complexes qui ont bien des attributs et qui, de ce fait, ne se prêtent pas au rôle de l'objet de la<br />
définition d'un seul de ces attributs. C’est ce que <strong>Platon</strong> fait valoir pour distinguer les <strong>objets</strong><br />
de la définition des choses sensibles.<br />
De plus, si nous voulons isoler l’un des attributs d’un objet, nous le désignons par un<br />
terme abstrait comme « beauté » ou « grandeur », tout en pensant qu’il s’agit de<br />
caractéristiques inhérentes à une chose dénotée autrement, comme « la beauté du tableau ».<br />
4
C’est pourquoi nous ne croyons pas qu’il faille concevoir des <strong>objets</strong> intelligibles distincts des<br />
choses sensibles pour comprendre ce qu’est la beauté, par exemple. Quand <strong>Platon</strong>, en<br />
revanche, utilise des termes abstraits comme « la justice », il ne distingue pas leur<br />
signification de celle des termes concrets comme « le juste ». Et lorsqu’il conçoit des<br />
caractéristiques inhérentes à des choses, c’est après avoir fait admettre, au titre d’<strong>objets</strong><br />
intelligibles, les mêmes caractéristiques sous forme d’idées indépendantes. Aussi peut-il<br />
considérer que les multiples instances d’une caractéristique inhérente à nombre d’<strong>objets</strong><br />
concrets, comme la justice de certaines actions, de personnes et de lois, découlent de<br />
l’unique idée — de la justice tout court — qui leur correspond à chaque fois (Phéd. 102 b -<br />
105 b). C’est pourquoi ni les termes abstraits ni les caractéristiques inhérentes aux <strong>objets</strong><br />
concrets n’amènent <strong>Platon</strong> à se demander, comme nous le faisons, s’il faut vraiment<br />
supposer les idées pour donner des <strong>objets</strong> aux définitions — au lieu de se contenter des<br />
caractéristiques inhérentes aux <strong>objets</strong> concrets.<br />
Pour en revenir à l’ensemble des critères qui permettent de distinguer <strong>objets</strong> définis et<br />
<strong>objets</strong> sensibles, il convient de répéter qu’ils sont d'une importance capitale, parce qu'ils<br />
portent l'argument qui justifie l'hypothèse des idées : (1) si, pour qu’il y ait savoir, il faut<br />
supposer des <strong>objets</strong> définis et (2) que les choses sensibles ne s’y prêtent pas, (3) la possibilité<br />
du savoir dépend de l’existence d’autres réalités qui satisfont aux critères du définissable et<br />
que sont les idées. En ce qui concerne le critère de la perpétuité et de l’immuabilité, <strong>Platon</strong><br />
doit prendre pour acquis qu’aucune des choses sensibles n’est perpétuelle et toujours de la<br />
même grandeur, comme doit l’être ce qui entre en ligne de compte comme objet d’une<br />
définition. Mais un interlocuteur de l'époque, Aristote notamment, pourrait contester cette<br />
prémisse en évoquant l'exemple des astres qui, étant perpétuels et immuables en grandeur,<br />
peuvent rivaliser, sous cet angle, avec les idées pour fonder un savoir certain.<br />
Quant au critère de la simplicité, <strong>Platon</strong> argumente d’abord que les <strong>objets</strong> sensibles ou<br />
empiriques ne le satisfont pas, parce qu’ils présentent des attributs contraires ; cela concerne<br />
le caractère relatif de leurs caractéristiques. Par exemple, l'index est long, comparé avec le<br />
pouce, mais il est petit par rapport au majeur (voir Rép. VII, 523 d-e) ; et la restitution de son<br />
arme à quelqu'un devenu fou est juste du fait de remplir un contrat implicite, mais injuste<br />
dans la mesure où l'on ne tient pas compte de l'intérêt du partenaire. À propos de cette<br />
relativité des caractéristiques, il y a lieu de se demander si elle vaut pour tous les attributs<br />
des choses sensibles, en pensant notamment aux nombres comme prédicats : premièrement,<br />
il n'y a pas de contrariété entre eux, si l'on n'insiste pas sur le rapport entre pairs et impairs ;<br />
5
ensuite et surtout, un ensemble n'est pas au nombre de 23 sous un aspect et au nombre de 36<br />
sous un autre (ce qui rendrait l'ensemble, <strong>selon</strong> <strong>Platon</strong>, impair et pair à la fois). En effet, ce<br />
serait alors un autre ensemble, car si les vaches d'un troupeau font 23, elles ne font pas 92<br />
sous un autre aspect, mais ce sont leur jambes qui font 92 (cf. I. Mueller, « Ascending to<br />
problems : astronomy and harmonics in Republic VII, dans : J. P. Anton (éd.), Science and<br />
sciences in Plato, Demar (NY), Caravan Books, 1980, p. 117).<br />
Reste donc l’argument de <strong>Platon</strong> <strong>selon</strong> lequel les choses sensibles ne sont pas simples,<br />
parce que, au lieu de ne présenter qu'une seule forme ou caractéristique, elles sont toujours<br />
autre chose encore, comme « le beau » est un visage, un édifice ou quelque chose d’autre.<br />
Cet argument signifie que les choses connues sous l’angle de leurs attributs sont complexes<br />
et non simples, comme elles devraient l’être en tant qu’<strong>objets</strong> de définitions. Puisque les<br />
nombres qui se prédiquent d'<strong>objets</strong> sensibles sont toujours une sorte d'attributs et que <strong>Platon</strong><br />
ne distingue pas les attributs (« trois ») des choses considérées sous l’angle de ces attributs<br />
(« les trois », c’est-à-dire « les trois choses »), ils tombent sous le coup de ce critère.<br />
De même que le premier des deux arguments évoqués précédemment ne concerne pas<br />
l’ensemble des réalités sensibles et que le deuxième n’est pas vrai de tous les prédicats, le<br />
troisième ne l’est pas non plus, parce que tous ne désignent pas des attributs : par « table »,<br />
« lit », « animal », « terre » et « ciel », pour prendre les exemples du texte platonicien, on<br />
entend non pas des attributs, mais des entités qui ont des attributs. Or, si les attributs ne se<br />
prêtent pas au rôle d'objet défini, parce que <strong>Platon</strong> les identifie aux choses considérées sous<br />
l’angle des attributs, cela n'est pas vrai des choses telles qu'elles sont désignées par les<br />
termes de « table », « animal » etc. Il n'empêche, <strong>Platon</strong> n'a pas exclu les choses ainsi<br />
conçues du verdict qui écarte tout objet sensible du rôle d'objet d'une définition ; c'est<br />
pourquoi il est obligé de supposer des idées aussi des choses ainsi conçues.<br />
Seul Aristote s'est rendu compte que, <strong>selon</strong> le critère de <strong>Platon</strong> lui-même, cette<br />
supposition est inutile, parce qu'un homme, par exemple, bien qu'il soit un individu sensible,<br />
représente exactement ce qu'est l'homme qu'il s'agit de définir. Ainsi, Aristote se croyait<br />
fondé à supprimer les idées, comme l'ont fait aussi les autres élèves de <strong>Platon</strong>, mais tout en<br />
gardant la conception platonicienne <strong>selon</strong> laquelle la définition porte à chaque fois sur un<br />
objet simple qu'il appelle « substance ».<br />
Entre <strong>Platon</strong> et Aristote, on observe donc ce que l'on s'est habitué à appeler, suivant<br />
Thomas Kuhn, un changement de paradigme à propos de l'objet de la définition : alors que<br />
Socrate et <strong>Platon</strong> ont commencé par chercher les définitions d'attributs et à les théoriser,<br />
6
Aristote fait des choses auxquelles appartiennent les attributs les <strong>objets</strong> à définir. Or, aux<br />
deux approches correspondent deux inconvénients suivant une certaine symétrie : alors que<br />
<strong>Platon</strong> ne dispose pas d'argument pour établir les idées de toutes les substances y compris les<br />
astres, Aristote conçoit l'objet de la définition de manière à rendre les attributs<br />
indéfinissables. Car, s'il retient le critère platonicien <strong>selon</strong> lequel l'objet à définir doit être<br />
simple, c'est-à-dire ne pas dépendre de quelque chose d'autre, les attributs qui dépendent des<br />
substances et sont de ce fait complexes ne sauraient faire l'objet de définitions. À ce sujet,<br />
Aristote me semble osciller entre l'exclusion des attributs et l'idée qu'ils se définissent tout de<br />
même en incluant la substance dans la formule définissante; ainsi, on inclura la surface dans<br />
la définition de la couleur et l'animal dans la définition de l'attribut « ailé ».<br />
Ce qui doit nous intéresser, c'est le cas des <strong>objets</strong> mathématiques. D'une part, en effet, ils<br />
ne sauraient se définir en incluant certaines substances dans leurs formules, parce que toutes<br />
les substances corporelles se comptent de façon égale et se mesurent <strong>selon</strong> les mêmes<br />
méthodes. De l'autre, Aristote n'accorde pas aux <strong>objets</strong> mathématiques une existence<br />
indépendante à l'instar des idées platoniciennes. C'est pour ces deux raisons, me semble-t-il,<br />
qu'il ne propose que pour les <strong>objets</strong> mathématiques un procédé préalable aux définitions,<br />
c'est-à-dire l'abstraction de toutes les autres caractéristiques des choses. Par là, la raison est<br />
censée fabriquer les <strong>objets</strong> mathématiques purs, analogues aux idées platoniciennes. <strong>Les</strong><br />
commentateurs d'Aristote appliquaient la notion d'abstraction à la formation de tous les<br />
concepts. Mais Aristote l'a inventée seulement pour sortir de l'impasse dans laquelle il s'était<br />
dirigé en supprimant les idées sans être à même de concevoir les définitions mathématiques<br />
comme celles des autres attributs.<br />
II. <strong>Les</strong> figures géométriques renvoient au domaine intelligible<br />
<strong>Platon</strong> n'a pas besoin d'une opération subjective comme l'est l'abstraction, pour faire<br />
exister hors contexte sensible les <strong>objets</strong> du savoir mathématique. Si l'hypothèse des idées est<br />
vraie, ces <strong>objets</strong> existent indépendamment des choses sensibles et de nos opérations<br />
mentales. Il faut seulement nous convaincre nous-mêmes de leur existence aussi bien que de<br />
celle des autres idées. À ce propos, les figures géométriques et les nombres jouent deux rôles<br />
différents. Cela s'explique éventuellement par les différentes étapes et conditions dans<br />
lesquelles les unes et les autres entrent dans le processus de l'éducation. En effet, on apprend<br />
à compter les choses avant de dessiner des figures géométriques qui ne sont pas les figures<br />
de certaines choses perçues (il n’empêche, <strong>Platon</strong> prévoit, dans son programme d’éducation,<br />
l'initiation ludique au calcul et à la géométrie au même moment, voir Rép. VII, 536 d). De<br />
7
toute façon, à défaut de décrire les choses sensibles, les figures géométriques renvoient<br />
immédiatement à des entités non sensibles, alors que les nombres passent pour des attributs<br />
des choses, si bien qu'il faut à <strong>Platon</strong> un argument pour passer des nombres ainsi entendus<br />
aux nombres en soi.<br />
1. L'utilisation des figures en vue d'une connaissance conceptuelle<br />
Étant donné que <strong>Platon</strong> veut instaurer la connaissance mathématique comme une sorte<br />
d’initiation aux <strong>objets</strong> non sensibles, il convient donc de commencer par la géométrie à<br />
laquelle <strong>Platon</strong> consacre deux passages dans la République (VI, 510 d 5 - 511 a 1 ; VII, 527 a<br />
1 - b 8). Voici le premier :<br />
< Tu sais > donc aussi que les < mathématiciens > utilisent les formes visibles et font leurs<br />
discours à propos d'elles, tout en réfléchissant non pas sur elles, mais sur les < intelligibles ><br />
auxquelles celles-ci ressemblent, tout en faisant leurs discours en vue du carré en soi et de la<br />
diagonale en soi et non en vue de celle qu'ils dessinent, et de même pour le reste : ces<br />
< figures > précisément qu'ils façonnent et dessinent, dont il existe aussi des ombres et des<br />
images dans l'eau, ils utilisent celles-ci comme des images de leur côté en cherchant à voir<br />
celles-là justement que l'on ne verrait pas autrement que par la pensée.<br />
Ce passage s'inscrit dans une des analogies connues de la République, à savoir<br />
« l'analogie de la ligne ». Elle consiste à comparer l'ensemble de la réalité avec quatre<br />
sections d'une droite, inégalement divisée : les deux parties principales figurent les <strong>objets</strong><br />
intelligibles et sensibles, et chacune de ces parties se divise à nouveau <strong>selon</strong> la même<br />
proportion que l'ensemble (VI, 509 d - 511 e). C'est que les <strong>objets</strong> sensibles se divisent en<br />
choses sensibles et leurs ombres et reflets, alors que les <strong>objets</strong> intelligibles ne se laissent<br />
diviser qu'en ayant recours au mode de leur connaissance : ce dernier consiste à se servir<br />
d'<strong>objets</strong> sensibles comme le font les géomètres ou bien à se référer exclusivement aux<br />
formes intelligibles. Comment cette distinction donne-t-elle lieu à deux classes d'<strong>objets</strong><br />
intelligibles Provisoirement, à tout le moins, on peut comprendre que Socrate veut parler<br />
des <strong>objets</strong> des mathématiques courantes et des <strong>objets</strong> du savoir conceptuel qui se fonde<br />
exclusivement sur des définitions et que <strong>Platon</strong> appelle « dialectique ».<br />
Alors, comment procèdent les géomètres Ils dessinent ou façonnent des figures<br />
sensibles et en parlent, mais, dans leur pensée, ils visent autre chose, des <strong>objets</strong> purement<br />
conceptuels dont les figures sensibles seraient des images ou des copies (si l’on se demande<br />
comment on peut parler d’une chose et penser à une autre, il suffit de se rappeler les fables<br />
de la Fontaine). On a généralement compris que les géomètres sont obligés de ne pas faire de<br />
8
leurs dessins les <strong>objets</strong> de leur raisonnement, parce que ces figures manquent inévitablement<br />
de précision. Cette interprétation peut se réclamer du fait que, avant <strong>Platon</strong>, le sophiste<br />
Protagoras attaqua, voire réfuta les géomètres en arguant que, au niveau du dessin, la droite<br />
tangente à un cercle ne le touche pas en un seul point (voir Aristote, Métaphysique III 2, 997<br />
b 35 - 998 a 4). Protagoras articula ainsi la conscience que le dessin passe à côté de ce qu'il<br />
est censé illustrer, sans que l'on apprenne si aussi les géomètres en étaient conscients ou pas.<br />
Or, Protagoras pouvait transformer en réfutation la conscience de l'imprécision du dessin<br />
uniquement en prenant pour acquis que l'objet du prétendu savoir géométrique est le dessin.<br />
Car alors le dessin imprécis devait rendre faux les théorèmes des géomètres. Pour maintenir<br />
la géométrie comme science, il fallait prendre le contre-pied de la prémisse de Protagoras en<br />
soutenant que les géomètres ne réfèrent pas leurs théorèmes aux figures qu'ils dessinent.<br />
<strong>Platon</strong> non seulement procède ainsi dans la République, il confirme aussi l'observation de<br />
Protagoras en disant dans une Lettre (VII, 343 a 5-9) que le cercle dessiné ou fabriqué au<br />
tour touche partout la droite (ce qui signifie qu’il contient des droites, comme il ressort de la<br />
suite du texte).<br />
Il me semble pourtant que ce n'est pas seulement le manque de précision des figures qui<br />
les empêche d'être les <strong>objets</strong> de la géométrie. <strong>Les</strong> textes n'évoquent pas un autre obstacle,<br />
mais nous savons bien que, par exemple, un cercle dessiné représente toute l'espèce, si je<br />
puis dire, indépendamment de la longueur de son diamètre. Si, en revanche, la figure<br />
dessinée était l'objet de la géométrie, il faudrait, dans un premier temps à tout le moins,<br />
établir les théorèmes à propos de chaque cercle tel qu'il se distingue par la longueur de son<br />
diamètre. Ou encore, pour prendre un exemple que suggère le passage de la République qui<br />
précède le texte traduit : si les espèces des angles sont l'angle droit, aigu et obtus, le<br />
géomètre figure un angle aigu en en dessinant un de 15° aussi bien qu'en en dessinant un<br />
autre de 85° ; il est possible que la différence sensible ne signifie rien, parce qu'il est<br />
convenu que les deux dessins ne sont pas des <strong>objets</strong> à examiner en soi, mais doivent<br />
représenter le même type d'angle. Ne disposant pas du terme de « représentation », <strong>Platon</strong><br />
fait dire à Socrate que le dessin est l'image ou la copie de l'objet intelligible.<br />
Il lui fait signaler aussi que les géomètres eux-mêmes sont conscients du fait que leurs<br />
dessins restent en retrait par rapport aux <strong>objets</strong> de leur science. Car Socrate explique que les<br />
géomètres utilisent les figures au titre d'images et cherchent à connaître leurs originaux<br />
intelligibles. <strong>Les</strong> scientifiques ne se laissent pas fourvoyer par le fait que, en tant qu'<strong>objets</strong><br />
physiques, les figures peuvent être les originaux des images qui se forment d'elles dans l'eau<br />
9
ou dans une glace. Cela veut dire que les géomètres ne sont pas pris dans l'expérience que<br />
leur communiquent les sens, mais la relativisent : puisqu'ils savent que leur objet ne<br />
s'identifie pas aux figures qu'ils construisent eux-mêmes dans le domaine sensible, ils sont<br />
capables de considérer ces figures comme des originaux par rapport à leurs ombres et à leurs<br />
reflets, mais, en même temps, comme des copies par rapport aux <strong>objets</strong> scientifiques.<br />
On en arrive à se demander pourquoi, finalement, les géomètres ont besoin de figures —<br />
une question peut-être vaine pour le mathématicien, mais légitime dans un contexte<br />
philosophique. <strong>Platon</strong> n'y répond pas, mais on peut noter que, dans un autre contexte, il<br />
explique que toute connaissance humaine part forcément de perceptions (Phéd. 74 a-e). C'est<br />
le célèbre argument qui consiste à concevoir la connaissance comme une sorte de<br />
réminiscence. En effet, de même que, en voyant le portrait d'une personne qu'on a connue ou<br />
que l'on connaît, on se souvient de la personne, de même, en percevant des <strong>objets</strong> sensibles,<br />
on est amené à penser à autre chose à laquelle ressemblent les <strong>objets</strong> perçus. Lorsque, par<br />
exemple, on voit deux bouts de bois de longueur égale, on est amené à penser l'égalité que<br />
<strong>Platon</strong> appelle aussi « l'égal en soi ». Et, de même que, en voyant le portrait, on se rend<br />
compte que, tout en ressemblant à la personne figurée, il reste en retrait par rapport à elle, de<br />
même, en voyant deux bouts de bois égaux en longueur, nous sommes conscients du fait<br />
qu'ils restent en retrait par rapport à l'égalité (parce qu'ils sont encore autre chose qu'égaux).<br />
En dépit de sa thèse principale que le savoir porte sur des <strong>objets</strong> intelligibles comme<br />
l'égalité et non sur des <strong>objets</strong> sensibles, <strong>Platon</strong> insiste sur le fait que c'est uniquement à partir<br />
de la perception des sensibles que nous prenons conscience des intelligibles (ibid., 75 a).<br />
Voilà le parallèle avec la pratique des géomètres qui ont besoin du dessin pour raisonner à<br />
propos de ce qui est représenté par le dessin de façon imparfaite.<br />
Cependant, pour se rendre compte de l'importance du cas des géomètres, il faut nuancer le<br />
parallèle. En effet, le passage du Phédon décrit non pas une pratique technique voire<br />
scientifique quelconque, mais la cognition élémentaire que l'on exprime en disant « ces deux<br />
tiges sont égales en longueur ». Il n'y est donc pas question d'une connaissance qui se situe<br />
au même niveau que celle des géomètres. Un peu plus loin dans le Phédon (76 a-c), Socrate<br />
confirme que la cognition élémentaire est seulement la première étape du processus qui ne<br />
s'achève par le savoir que lorsqu'on est capable de définir les termes comme « égal » qu'on a<br />
déjà utilisés correctement. Or, en ce qui concerne les géomètres, Socrate constate qu'ils ne<br />
définissent pas leurs termes de base, mais les supposent, comme s'ils étaient connus par tout<br />
le monde (Rép. VI, 510 c 2 - d 1). <strong>Les</strong> géomètres se situent donc à mi-chemin entre la<br />
10
cognition élémentaire et le savoir parfait. Ils se singularisent en visant des <strong>objets</strong><br />
intelligibles — ce qui n'est pas le cas de la cognition élémentaire — tout en se référant aussi<br />
aux figures visibles — ce dont le savoir achevé n’a pas besoin. Ainsi opèrent-ils<br />
constamment le passage de la perception indispensable vers la connaissance conceptuelle et<br />
préfigurent ainsi la théorie platonicienne de la connaissance. Pareille chose ne peut se dire de<br />
l'arithmétique.<br />
2. Le discours des géomètres<br />
Avant de passer à l'arithmétique, il faut tout de même tenir compte d'un problème que<br />
seule la géométrie pose à <strong>Platon</strong>. Le problème vient du fait que les géomètres ne trouvent pas<br />
leurs <strong>objets</strong> sensibles, mais les construisent eux-mêmes. Ils pourraient donc croire qu'ils<br />
fabriquent des <strong>objets</strong> comme le font les peintres, les sculpteurs et les architectes. Mais <strong>Platon</strong><br />
fait à Socrate rejeter toute valorisation du construire comme une sorte de création.<br />
Tous ceux qui ont ne serait-ce qu'un peu d'expérience en géométrie, dis-je, ne nous<br />
contesteront certainement pas ceci à tout le moins : cette science se trouve être aux antipodes<br />
des discours que mènent en elle ceux qui la manient. — Comment cela demanda-t-il. —<br />
D'une certaine façon, leur discours est assez ridicule et inévitable. En effet, comme ils<br />
prononcent tous leurs discours en agissant et en vue de la pratique, ils disent qu'ils carrent,<br />
appliquent et ajoutent, en exprimant tout de la sorte, mais l'étude dans son ensemble est d'une<br />
certaine manière entreprise en vue de la connaissance. — De toute façon, répondit-il. — Faut-il<br />
donc convenir encore de ceci — De quoi — Qu'elle est entreprise en vue de la connaissance<br />
de ce qui existe toujours et non de ce qui devient quelque chose à un certain moment et<br />
disparaît < ensuite >. — C'est indiscutable, répondit-il, car la géométrie est la connaissance de<br />
ce qui existe toujours. (Rép. VII, 527 a 1 - b 8)<br />
Au premier abord, le discours de Socrate rend perplexe, parce qu'il affirme des mêmes<br />
géomètres qu'ils parlent d'une certaine façon de leurs constructions et qu'ils acceptent de<br />
trouver ces discours parfaitement inadéquats à leur science. Selon le commentaire de<br />
F. F. Repellini, Socrate vise deux sortes de géomètres, les praticiens et ceux qui réfléchissent<br />
sur ce qu'est la géométrie (voir «La linea e la caverna », dans : M. Vegetti (éd.), <strong>Platon</strong>e. La<br />
Repubblica, vol. V, Napoli, Bibliopolis, 2003, p. 370-371). Mais Socrate a l’air d’écarter<br />
cette interprétation en se bornant à supposer qu'un minimum d'expérience en géométrie suffit<br />
pour admettre le jugement sur les discours couramment tenus ; s'il y fallait encore une<br />
11
attitude de recul et de réflexion, Socrate devrait le dire. Comment se fait-il alors que les<br />
géomètres eux-mêmes sont disposés à rejeter leurs propres discours <br />
Leur double attitude me semble refléter la dualité de leurs <strong>objets</strong>. En effet, dès sa<br />
première description de la géométrie, Socrate a dit que les géomètres parlent des figures<br />
visibles tout en pensant aux <strong>objets</strong> intelligibles. Maintenant nous apprenons ce que disent les<br />
géomètres en construisant, c’est-à-dire qu’ils carrent, appliquent et ajoutent. C’est pour deux<br />
raisons qu’ils ne peuvent s'empêcher d’en parler : il s’agit de communiquer à autrui un savoir<br />
ou bien une hypothèse ; l’auditeur suit les constructions que le discours de celui qui dessine<br />
permet de comprendre comme des séries d’actes organisés qui tendent vers un but. Pourtant,<br />
parce qu'ils cherchent une connaissance conceptuelle d'<strong>objets</strong> intelligibles, les géomètres<br />
sont aussi capables de reconnaître la fonction restreinte de leurs discours pratiques et<br />
d'admettre qu'ils sont parfaitement inappropriés au but cognitif qu'ils poursuivent.<br />
La critique de Socrate, qui frappe les « discours de travail » des géomètres, est donc basée<br />
sur l'opposition entre « en vue de la pratique » et « en vue de la connaissance ». Ce que<br />
signifie « en vue de la pratique », cela se comprend le plus aisément, si l'on pense à<br />
l'enseignement ou à la communication entre collègues : l'un demande à l'autre de suivre les<br />
constructions qu’il exécute ; il parle donc pour amener l'autre à imaginer cette pratique. Du<br />
point de vue d'un observateur naïf, la naissance des figures dans le sable ou sur le tableau<br />
noir est ce que le discours veut expliquer. C'est ridicule dans la mesure où les figures ne sont<br />
qu'un moyen par rapport au véritable but qu'est la connaissance. Mais pourquoi le même<br />
discours n’engendre-t-il pas une connaissance, en décrivant la construction Or, le texte ne<br />
précise pas tout de suite que la connaissance qui est visée porte sur des <strong>objets</strong> imperceptibles.<br />
Par conséquent, on ne comprend le caractère ridicule du discours qu’en supposant que, en<br />
tant que telle, la connaissance ne saurait être le but du discours qui décrit les constructions.<br />
Cela se comprend en pensant aux techniques artisanales ou autres que Socrate ne cesse de<br />
citer comme exemples de pratiques rationnelles : là, le savoir précède et conduit la pratique,<br />
il ne saurait donc être son résultat.<br />
Cependant, si l’on explique ainsi le caractère ridicule du discours des géomètres,<br />
comment peut-on encore comprendre que ce discours est aussi inévitable Comment<br />
servirait-il à la communication d’un savoir ou d’une hypothèse, s’il n’apprend rien à<br />
l’auditeur Le texte ne répond pas à cette question, car, tout en évoquant des discours « en<br />
vue de la pratique » il ne distingue pas les rôles de l’orateur et de l’auditeur. Il faut donc se<br />
contenter d’une hypothèse exégétique. À ce propos, on peut partir de deux prémisses.<br />
12
Premièrement, le discours n’est pas inévitable pour le dessin de l’orateur, il l’est de toute<br />
façon pour communiquer quelque chose à l’auditeur. Deuxièmement, les géomètres utilisent<br />
les dessins pour arriver à leurs connaissances, autrement dit, ils ne peuvent pas s’en passer<br />
<strong>selon</strong> le premier des textes traduits. On peut donc comprendre l’expression « ils prononcent<br />
tous leurs discours en vue de la pratique » au sens où que l’orateur communique à l’auditeur<br />
uniquement le mode de la construction graphique si bien que l’auditeur sera en mesure de<br />
l’exécuter lui-même. Tandis que cette communication ne véhicule aucune connaissance<br />
théorique, l’auditeur sera capable de cette connaissance, dès lors qu’il dessine lui-même la<br />
figure en question. Une fois cette différence faite entre communication pratique et<br />
connaissance à partir du dessin, on peut éventuellement renoncer à distinguer deux étapes<br />
temporelles de ce processus, si l’on pense que l’auditeur imagine la construction déjà en<br />
écoutant le discours de l’orateur. Quoi qu’il en soit, il semble essentiel que le discours porte<br />
exclusivement sur la pratique, alors que la connaissance présuppose cette pratique et son<br />
résultat au titre de condition nécessaire.<br />
3. <strong>Les</strong> échelons des <strong>objets</strong> géométriques<br />
Par la suite seulement, Socrate évoque l'objet de la connaissance pour se laisser confirmer<br />
qu'il est perpétuel et non passager, comme l'est le produit de la pratique. Que l'interlocuteur<br />
accepte la thèse sans argument, cela se comprend du fait que les philosophes antiques<br />
n'envisageaient pas d'incorporer au savoir des propositions contenant un indicateur temporel.<br />
Par exemple, la phrase « il pleut » devient fausse dès que la pluie cesse, alors que la phrase<br />
« il a plu à <strong>Paris</strong> le six février 2010 de huit heures à dix heures » reste toujours vraie, si elle<br />
le fut à ce moment. Mais, en acceptant comme éléments du savoir uniquement des<br />
propositions du premier type, les Grecs ont créé l'idée des vérités éternelles, plus<br />
précisément, des <strong>objets</strong> perpétuels du savoir qui est défini comme vrai.<br />
Mais quels sont ces <strong>objets</strong> perpétuels À ce sujet, Socrate n'est pas plus prolixe que dans<br />
le premier passage traduit. Le lecteur des dialogues de <strong>Platon</strong> croira que ce sont bien sûr les<br />
idées que représentent les figures visibles (c'est aussi la thèse de P. Pritchard, Plato's<br />
philosophy of mathematics, Sankt Augustin, Academia, 1995, p. 94, à propos de l'analogie<br />
de la ligne). Mais Aristote conteste cette réponse qui semble couler de source, car il rapporte<br />
que, <strong>selon</strong> <strong>Platon</strong>, les <strong>objets</strong> mathématiques formaient une classe d'<strong>objets</strong> à part entre les<br />
choses sensibles et les idées (Métaph. I 6, 987 b 14-18 ; XI 1, 1059 b 6-9). Pourquoi <strong>Platon</strong><br />
13
aurait-il compliqué à ce point la métaphysique La réponse que rapporte Aristote est de<br />
poids : alors que, à un prédicat ou, mieux, à une définition correspond une seule idée, à une<br />
définition mathématique correspondent plusieurs <strong>objets</strong> égaux. Ces <strong>objets</strong> ne se distinguent<br />
donc pas entre eux qualitativement, comme c'est le cas de plusieurs idées, ni ne s'identifient<br />
aux multiples figures visibles du même objet géométrique, qui peuvent aussi être égales.<br />
Je n'ai pas — encore — décelé dans le texte de <strong>Platon</strong> des indices positifs confirmant<br />
qu'il songeait à des <strong>objets</strong> géométriques intermédiaires entre les figures visibles et les idées.<br />
Mais il existe un indice par défaut : <strong>Platon</strong> n'appelle pas « idées » les <strong>objets</strong> mathématiques<br />
en République VI, 510-511. De plus, à propos des nombres qui font bien sûr partie des <strong>objets</strong><br />
en question, il existe un indice textuel pour confirmer le rapport d'Aristote ; j'y reviendrai.<br />
Alors il n'est pas très probable qu'Aristote ait raison à propos des nombres et non à propos<br />
des <strong>objets</strong> géométriques.<br />
À cela s'ajoute une réflexion de R. Hare (« Plato and the mathematicians », dans : R.<br />
Bambrough (éd.), New essays on Plato and Aristotle, London, Routledge & Kegan Paul,<br />
1965, p. 31). En effet, l'expression, qui revient sans cesse dans <strong>Platon</strong>, de « la vision » des<br />
<strong>objets</strong> non sensibles, Hare l'interprète, s'agissant d'<strong>objets</strong> géométriques, au sens où le<br />
mathématicien les imagine. Cela s'accorde avec l'observation de M. Burnyeat, <strong>selon</strong> laquelle,<br />
pour <strong>Platon</strong>, les <strong>objets</strong> géométriques sont, certes, incorporels, mais des figures étendues (voir<br />
« Plato on why mathematics is good for the soul », dans : T. Smiley (éd.), Mathematics and<br />
necessity. Essays in the history of philosophy, Oxford, OUP, 2000, p. 59 et 62). S'il en est<br />
ainsi, je rappelle une observation que j'ai déjà faite : de bien des <strong>objets</strong> de définitions<br />
géométriques, comme de l'angle aigu ou obtus, il y aura un nombre illimité d'exemplaires<br />
imaginables, parce que la définition ne fixe pas leur extension ou bien, dans le cas de<br />
l'exemple, la grandeur de l'angle. Et au cas où plusieurs items partagent une définition, ils<br />
partagent aussi une idée <strong>selon</strong> <strong>Platon</strong>. Cependant, cette distinction entre l'idée une et la<br />
pluralité des <strong>objets</strong> géométriques s'applique-t-elle également au cas où l'objet se définit de<br />
façon complète, comme l'angle droit Comment expliquerait-on alors la pluralité de ces<br />
<strong>objets</strong>-ci <br />
Du rapport d'Aristote résulte en tout cas une métaphysique à trois échelons des <strong>objets</strong><br />
géométriques : puisque les géomètres ne pensent pas (1) les figures qu'ils dessinent, ils<br />
imaginent (2) de multiples <strong>objets</strong> incorporels, sauf, éventuellement, dans les cas comme<br />
celui de l'angle droit qui ne peut s'imaginer que d'une seule façon ; et comme tout ensemble<br />
d'items égaux a une idée en commun, il faut ajouter (3) l'échelon des idées géométriques qui<br />
14
sont à chaque fois une seule par rapport à une définition. Or, la distinction entre le deuxième<br />
et le troisième échelon n'est rien d'autre que celle entre les deux parties intelligibles de<br />
l'analogie de la ligne. En effet, lorsque j'ai interprété le premier texte traduit, je n'étais pas<br />
encore en mesure de déterminer ces deux parties de façon satisfaisante. J'ai dit que les <strong>objets</strong><br />
des mathématiques courantes occupaient l'une de ces parties et les <strong>objets</strong> de la dialectique<br />
philosophique l'autre. Ce qui fait éventuellement la différence entre ces deux types d'<strong>objets</strong><br />
s'est maintenant manifestée à propos des <strong>objets</strong> géométriques.<br />
II. Nombres appliqués et idées de nombres<br />
Dans une première approche à tout le moins, la théorie platonicienne de la géométrie<br />
peut s'interpréter en se bornant à deux questions : quel est le statut métaphysique des <strong>objets</strong><br />
de cette science Comment peut-on les connaître Quant à l'arithmétique, <strong>Platon</strong> soulève<br />
les mêmes questions, mais elles s'accompagnent, dans ce cas, d'une troisième qui est de<br />
savoir ce qu'est le nombre. Est-ce que, dans l'abstrait, cette question est incontournable,<br />
parce que les nombres ne se laissent pas figurer à part comme c'est le cas des entités<br />
géométriques En effet, rien ne nous induit à croire qu'il y ait des nombres qui ne<br />
dénombrent pas quelque chose, autrement dit, qui sont des <strong>objets</strong> et non des fonctions.<br />
Pourtant, en calculant et en établissant certaines classes de nombres, on a l'air de les traiter<br />
comme des <strong>objets</strong>. D'où la question de savoir ce qu'ils sont.<br />
1. La perception pousse à la réflexion sur les nombres<br />
Aux yeux de <strong>Platon</strong>, les nombres, comme tout autre élément de la réalité, ne sauraient<br />
devenir l'objet du savoir qu'à condition d'être simple, non attaché à autre chose au titre<br />
d’attribut. Pour plaider en faveur de cette thèse, Socrate ne renvoie cependant pas à la<br />
pratique des arithméticiens, comme il le fait à l'égard des géomètres. Après avoir expliqué<br />
que les choses sensibles apparaissent tantôt sous un aspect tantôt sous l'aspect contraire et<br />
incitent alors à la réflexion sur les termes contraires, il propose plutôt l'argument suivant à<br />
propos du nombre et de l'un.<br />
Représente-toi la chose seulement à partir de ce qui vient d'être dit, répondis-je. En effet, si<br />
l'un en soi [c'est-à-dire le fait d'être un item] se voit ou se saisit suffisamment par une autre<br />
perception, il ne tire pas < l'âme > vers l'être, comme nous l'avons dit à propos du doigt. Si<br />
toujours, en revanche, on voit simultanément quelque chose de contraire à l'un, si bien que rien<br />
15
ne paraît plutôt un que le contraire, il est besoin d'une instance qui décide alors et,<br />
nécessairement, l'âme est perplexe à l'égard de l'un, se met à la recherche en activant en elle la<br />
pensée < de l'un > et se demande ce qu'est finalement l'un en soi ; et ainsi, l'étude au sujet de<br />
l'un pourrait appartenir à la classe de ce qui guide vers la contemplation de l'être et < nous > y<br />
retourne. — Mais sans aucun doute, dit-il, la vision de l'un possède surtout cette caractéristique,<br />
car nous voyons la même chose comme une et comme une pluralité illimitée. — Si donc cela<br />
concerne l'un, répondis-je, la même chose concerne aussi le nombre dans son ensemble. —<br />
Assurément. (Rép. VII, 524 d 9 - 525 a 8)<br />
Tout comme les passages traduits concernant la géométrie, ce texte fait partie du<br />
programme d'éducation que Socrate suggère pour les gouvernants futurs de la cité. La<br />
formule de base de ce programme consiste à dire qu'il faut substituer à l'orientation par les<br />
sens celle par la raison. À ces deux modes de cognition correspondent deux domaines<br />
d'<strong>objets</strong>. En désignant le domaine des <strong>objets</strong> intelligibles par le terme « être », Socrate laisse<br />
entendre que les <strong>objets</strong> sensibles se caractérisent fondamentalement par le devenir, c'est-àdire<br />
par leur instabilité qui les soustrait au savoir. Mais Socrate ne fait pas fond sur<br />
l'instabilité des <strong>objets</strong> sensibles pour expliquer que l'âme s'en détourne et réfléchit sur ses<br />
impressions. S'il voulait exploiter l'instabilité des <strong>objets</strong> sensibles, Socrates devrait évoquer<br />
la possibilité qu'ils apparaissent tantôt comme une chose tantôt comme plusieurs. Pourtant, il<br />
tient au fait que, si les <strong>objets</strong> sensibles font réfléchir l'âme sur l'un et les nombres, c'est parce<br />
qu'ils apparaissent un et plusieurs à la fois. Par conséquent, l'âme qui ne supporte pas cette<br />
ambiguïté, cherchera des <strong>objets</strong> non ambigus ou non équivoques, mais pas forcément<br />
stables ; puisqu'elle n'est pas présentée comme étant gênée par le devenir, on n'a aucune<br />
raison de penser qu'elle cherche l'être — consciemment. C'est Socrate qui le lui attribue,<br />
parce que lui-même croit savoir que ce qui est non équivoque n'est pas soumis au devenir,<br />
mais relève de l'être.<br />
Socrate ne propose pas ici un argument en faveur de l'hypothèse des idées, il évoque la<br />
condition qui pousse un individu à dépasser l'orientation que donnent les sens et à déterminer<br />
la signification des termes qui servent à décrire les <strong>objets</strong> perçus. Comme dans les premiers<br />
dialogues de <strong>Platon</strong>, Socrate prend pour acquis que, une fois défini le sens de « un », on<br />
saura décider si un objet donné est un ou non ; et il prête cette façon de procéder aussi aux<br />
autres qu'il suppose être dans ladite condition. Elle se caractérise par le fait que les <strong>objets</strong> qui<br />
semblent être des unités sont en même temps perçus comme plusieurs chacun. Que cette<br />
condition soit remplie, ce n'est pas Socrate qui l'affirme, c'est l'interlocuteur, Glaucon, et<br />
Socrate n'a rien a y redire. Il est cependant intéressé non par la conséquence que tout le<br />
16
monde cherche le sens de « un », mais par l'autre qui concerne l'étude de l'un, c'est-à-dire<br />
qu'elle reprend le relais des perceptions ambiguës en guidant vers la connaissance de l'être.<br />
Mais l'étude de l'un ou de l'unité n'est pas connue parmi les sciences. Qu'il ne s'agisse pas<br />
d'en inaugurer une nouvelle, Socrate le confirme en transférant à tous les nombres ce que<br />
Glaucon dit de l'un. L'étude en question est donc l'arithmétique. Pourquoi ne pas s'en<br />
approcher directement par le biais de tous les nombres Est-ce parce qu'il est peu plausible<br />
que cinq pommes, par exemple, soient en même temps le contraire de cinq Mais, s'il en est<br />
ainsi, est-ce que Socrate change la chose en faisant le détour de l'un Ce n'est évidemment<br />
pas le cas. En effet, même si chaque pomme une est aussi plusieurs ayant la peau, la pulpe, le<br />
trognon et les pépins, cinq pommes deviennent ainsi vingt — éléments de pommes —, mais<br />
vingt n'est pas le contraire de cinq. Socrate devrait donc préciser que l'ambiguïté des<br />
nombres appliqués aux <strong>objets</strong> sensibles réside dans le fait qu'ils sont plusieurs pour le même<br />
ensemble d'<strong>objets</strong>.<br />
Que dire de la condition qui pousse à se tourner vers l'arithmétique Même si l'argument<br />
présente la même structure que d'autres invoqués en faveur de l'hypothèse des idées, il s'agit<br />
d'un sophisme dont <strong>Platon</strong> se moque dans certains dialogues plus tardifs et qu'il résout dans<br />
le Parménide (129 c 4 - d 2) : rien n'empêche que je sois un homme parmi sept hommes et en<br />
même temps plusieurs compte tenu des différentes parties de mon corps. Comme le<br />
sophisme était très à la mode, à en croire les autres textes, Socrate arrive à faire l'accepter à<br />
Glaucon. Mais <strong>Platon</strong> ne pouvait croire que la seule perception d'un objet nous suggère qu'il<br />
est simplement un et plusieurs à la fois. Comment pouvait-il ignorer que chacun qui ne se<br />
laisse pas éblouir par le sophisme conçoit l'objet sensible exactement de la façon qu'il<br />
explicitera dans le Parménide : sous l'aspect de sa substance il est un, sous l'aspect de ses<br />
parties ou de ses caractéristiques secondaires il est plusieurs.<br />
À moins qu'il ne se soit rendu compte plus tard seulement du caractère fallacieux de son<br />
argument, <strong>Platon</strong> utilise donc sciemment un sophisme dans la République, pour suggérer<br />
que, sous l'aspect quantitatif, la perception amène les gens à l'étude de l'arithmétique.<br />
Pourquoi ce procédé Je ne crois pas avoir déjà trouvé une réponse satisfaisante, mais je<br />
voudrais noter quelques éléments dont la réponse devrait probablement tenir compte.<br />
Premièrement, l'arithmétique obtient le premier rang parmi les mathématiques qui<br />
englobent encore la géométrie, la stéréométrie, l'astronomie et l'harmonique. Parmi elles,<br />
l'arithmétique est celle qui s'est le plus défait de tout ce qui s'attache aux sens, elle est donc<br />
la mathématique la plus rationnelle. Est-ce pour cette raison que Glaucon dit du calcul,<br />
17
préliminaire par rapport à l'arithmétique, qu'il faut en être capable, si l'on veut être homme<br />
(Rép. VII, 522 e 3-4) <br />
Deuxièmement, Socrate ajoute tout de suite que personne n'utilise de la bonne façon cet<br />
objet d'étude qui est susceptible de nous tirer vers la connaissance de l'être (ibid., 523 a 2).<br />
On ne peut que soupçonner ce qu'il veut dire : les applications au commerce et à des fins<br />
militaires empêchent les gens de se rendre compte de la valeur théorique des nombres (525 c<br />
3-4). L'ignorance de cette valeur contraste avec la chance que comporte le bon usage des<br />
nombres. Mais l'ignorance et l'usage inadéquat font que <strong>Platon</strong> ne peut renvoyer à des<br />
approches déjà en cours, pour faire accepter l'arithmétique théorique dans le programme<br />
d'éducation.<br />
Troisièmement, <strong>Platon</strong> ne peut pas se réclamer non plus d'un consensus des<br />
arithméticiens. En effet, alors qu'il peut prendre à témoin tous les géomètres (527 a 1-2), il<br />
doit faire appel aux avisés parmi les arithméticiens pour se faire confirmer son approche<br />
(525 d 9).<br />
Il paraît donc difficile pour <strong>Platon</strong> de présenter une façon communément reconnue de<br />
traiter les nombres telle qu'il puisse la prendre au titre de point de départ pour son<br />
programme d'éducation, comme il le fait à propos de la pratique géométrique. Je propose<br />
provisoirement d'expliquer le recours au sophisme par cette difficulté.<br />
2. La définition des nombres mathématiques<br />
L'argument fallacieux suggère que la perplexité que déclenche la perception d'un objet<br />
sensible induit à s'interroger sur ce qu'est l'unité et le nombre. Par la suite, Socrate évoque<br />
d'abord, au titre de savoirs concernant le nombre, l'art du calcul (logistikè) et l'arithmétique<br />
comme s'ils devaient répondre aux questions que se posent les déçus de la perception (525 a<br />
9-10). Mais il est hors de doute que calculer ne signifie pas réfléchir sur la nature des<br />
nombres (525 c 2). Par contre, l'arithmétique, dès lors qu'elle ne désigne pas la simple<br />
capacité de compter (522 e 2), a plus de chances d'être « numérologie ». Il n'empêche,<br />
Socrate ne retiendra ensuite que l'art du calcul qui est censé former les futurs gouvernants en<br />
vue aussi bien de la stratégie militaire que de leur conversion vers l'être (525 b 11 - c 6). En<br />
guise d'explication de cette thèse, Socrate distinguera deux usages des nombres, comme si,<br />
du fait de porter sur les nombres, l'étude du calcul avait aussi un potentiel théorique.<br />
Et effectivement, dis-je, étant donné qu'il est question de l'objet d'étude concernant les<br />
nombres, je me rends compte qu'elle est subtile et nous rend service, de multiple façons, en vue<br />
18
de ce que nous voulons, à condition que l'on s'y consacre en vue de la connaissance et non du<br />
commerce. — Comment < cela> alors, demanda-t-il. — C'est ce que nous venons de dire, à<br />
savoir que cette étude conduit avec force l'âme quelque part en haut et l'oblige à discuter des<br />
nombres en soi, sans accepter aucunement que, dans la discussion, on lui propose des nombres<br />
qui ont des corps visibles ou tangibles. En effet, tu sais sans doute que ceux qui sont avisés en<br />
la matière, de leur côté, rient et ne l'acceptent pas quand on tente de scinder l'un en soi par le<br />
discours, mais si tu le fragmentes, ceux-là le multiplient en prenant garde que l'un ne paraisse<br />
jamais non un, mais plusieurs parties. — Absolument vrai, répondit-il, ce que tu dis. — Que<br />
crois-tu donc, Glaucon, qu'ils répondraient, si on leur demandait ceci : « Quel est le genre des<br />
nombres dont vous discutez, admirables gens, et dans lesquels l'un se trouve tel que vous le<br />
préconisez, à savoir chaque un complètement égal à tout < autre >, sans se distinguer ne seraitce<br />
que peu et sans avoir en soi aucune partie » — Selon moi, en tout cas, ils répondraient<br />
qu'ils parlent des nombres que l'on peut seulement penser, alors qu'il n'est aucunement possible<br />
de les manier d'une autre façon. (Rép. 525 c 8 - 526 a 7).<br />
Puisque, dans cette explication, le terme « art du calcul » (logistikè) ne figure plus, mais<br />
se trouve remplacé par « étude concernant les nombres » (to peri tous logismous mathèma),<br />
j’appellerai cette étude « arithmétique » dans mon commentaire. Socrate présente la fonction<br />
éducative de l'arithmétique, comme si elle, à moins d'être étudiée en vue de son application<br />
pratique, exigeait une certaine notion de nombre. On a donc atteint le domaine de la<br />
réflexion que l'ambiguïté des perceptions est censée suggérer. La première exigence de<br />
l'arithmétique est négative : il ne faut pas introduire dans le débat des nombres ayant des<br />
corps sensibles. Quelle est la proposition qui est refusée en ces termes <strong>Les</strong> nombres ayant<br />
des corps sont-ils la même chose que des items corporels comptés, cinq pommes, par<br />
exemples (voir le commentaire de J. Adam, The Republic of Plato, 2 e éd., Cambridge, CUP,<br />
1965) Dans ce cas, on serait retourné à la case départ, car on prétendrait que les nombres<br />
ne sont rien d'autres que précisément ces <strong>objets</strong> quantitativement ambigus qui nous poussent<br />
à la recherche des nombres en soi. Par ailleurs, il s'agirait plutôt de corps ayant des nombres<br />
que de l'inverse. Cette interprétation n'est donc pas probable.<br />
Deux autres exégèses renvoient aux Pythagoriciens. Premièrement, ils ont soutenu, <strong>selon</strong><br />
Aristote, que les corps se composent de nombres (voir Métaph. XIII 6, 1080 b 16-21 ;<br />
chap. 8, 1083 b 8-19 ; XIV 5, 1092 b 19-20). Mais cette doctrine répond à la question de<br />
savoir ce que sont les <strong>objets</strong> corporels — tout en prenant pour acquise la notion de<br />
nombre —, alors que la question à laquelle Socrate fait allusion porte sur le nombre. Je ne<br />
crois donc pas, jusqu'à nouvel ordre, que le discours sur les nombres ayant des corps vise la<br />
19
thèse pythagoricienne sur le caractère numérique de tous les corps. Il me paraît plus probable<br />
que Socrate se réfère à la pratique pythagoricienne qui consiste à figurer l'unité par un point,<br />
le nombre deux par deux points et la droite entre eux, le nombre trois par trois points et le<br />
triangle, le nombre quatre par quatre points qui forment une pyramide (voir Th. Heath, A<br />
history of Greek mathematics, vol. 1, Oxford, Clarendon, 1921, p. 76). À condition que le<br />
triangle soit non pas dessiné, mais formé de trois bâtons, il est un corps aussi bien que la<br />
pyramide et le cube qui devait également représenter un nombre. Ainsi peut s'expliquer le<br />
fait que l'arithmétique, <strong>selon</strong> Socrate, interdit non pas les dessins, mais l'association de corps<br />
aux nombres.<br />
La suite du texte fait comprendre l'interdiction. C'est que les corps qui doivent représenter<br />
les nombres nous suggèrent que les nombres ont les propriétés de leurs représentants. C'est<br />
d'autant plus convaincant que, tels que l'analogie de la caverne nous dépeint, nous sommes<br />
plus habitués à croire nos sens que notre raison. Si cette hypothèse exégétique se vérifie,<br />
l'arithmétique rejette la figuration des nombres par des <strong>objets</strong> corporels pour nous empêcher<br />
de confondre le nombre et ses caractéristiques avec le corps et les siennes. En effet, Socrate<br />
invoque de suite ce genre de confusion à propos de l'unité. Étant donné qu'elle était figurée<br />
non seulement par un point mais aussi par une ligne, on pouvait dire qu'elle était sécable, et<br />
quand elle était représentée par un caillou, on pouvait le casser en prétendant avoir cassé<br />
l'unité. Dans les deux cas, il s'agissait de montrer que l'unité est en réalité composite.<br />
À ce point, Socrate fait intervenir des mathématiciens avisés qui ne sont pas dupes. Ils<br />
considèrent les éclats du caillou non pas comme autant de parties de l'unité, mais comme une<br />
pluralité née du cassage. Par voie de conséquence, l'unité se trouve désormais représentée<br />
par chacun des éclats. <strong>Les</strong> mathématiciens qui déjouent la tromperie sont conscients que le<br />
caillou et les éclats doivent représenter ce qui résiste à toute figuration qui est forcément<br />
spatiale. En effet, comme le dira Socrate tout de suite, les unités sont parfaitement simples.<br />
Or, Glaucon répondra que de tels items ne sont accessibles qu'à la pensée. Ils ne se laissent<br />
donc pas représenter par un objet sensible ou par une image. Voilà ce qu'a rejeté<br />
l'arithmétique théorique dès le début.<br />
Lorsqu'il interroge les mathématiciens avisés, Socrate semble raisonner de la façon<br />
suivante : si vous rejetez la division de l'unité, c'est que vous la savez simple ; mais si vous la<br />
savez simple, vous êtes aussi conscients qu'elle n'a aucune autre caractéristique. Ce<br />
raisonnement sert à définir l'objet de l'arithmétique, auquel Socrate revient maintenant. Il<br />
s'agit d'opposer aux diverses figurations des nombres, que l'arithmétique refuse, une seule<br />
20
notion de nombre. Cette notion se fonde sur celle d'unité que les mathématiciens avisés<br />
supposent, car Socrate va définir le nombre comme ce qui contient des unités qui ne diffèrent<br />
les unes des autres ni ne se composent de parties.<br />
Dans cette définition on distinguera (1) le fait que le nombre est expliqué comme un<br />
ensemble d'unités et (2) la notion de ces unités. Si cette notion associe simplicité et absence<br />
de différence entre les unités, elle suggère que d'éventuelles qualités qui distingueraient les<br />
unités entre elles les rendraient complexes, comme si les qualités équivalaient à des parties.<br />
En fait, Socrate profite de la prémisse des mathématiciens avisés, <strong>selon</strong> laquelle l'unité est<br />
simple, pour conclure à leur indifférence qualitative. Dans la mesure où la simplicité n'est<br />
rien de plus que l'absence de parties spatiales, la conclusion n'est pas justifiée. Car la<br />
complexité qualitative n'entraîne aucune extension spatiale : le sucre est au même endroit<br />
sucré et blanc, comme dira Hegel.<br />
Pourquoi Socrate associe-t-il l'indifférence qualitative à l'absence de parties spatiales La<br />
justification que l'on trouve dans la République remonte au sophisme <strong>selon</strong> lequel le<br />
caractère ambigu des <strong>objets</strong> sensibles, considérés sous l'aspect de leur unité, amène à<br />
réfléchir sur l'un en soi. Cet un, en effet, n'est rien d'autre qu'un, il est conceptuellement<br />
simple comme les idées — et non une entité spatiale simple comme le point qui n'a pas de<br />
parties.<br />
Si Socrate compose le nombre d'unités égales, il suppose un nombre illimité d'unités<br />
(c’est ce que confirme un passage du Philèbe, 56 d 4 - e 4). Par conséquent, ces unités ne<br />
sont pas d'idées, car il ne saurait y avoir qu'une seule par rapport à chaque terme du langage.<br />
C'est donc à propos des unités que <strong>Platon</strong> confirme implicitement le récit d'Aristote suivant<br />
lequel <strong>Platon</strong> établissait des entités mathématiques « entre » les choses sensibles et les idées<br />
(voir Métaph. I 6, 987 b 14-18).<br />
Pour ce qui est de la définition du nombre comme composé d'unités, elle signifie que le<br />
nombre des mathématiciens garde la structure du nombre appliqué à des ensembles de<br />
choses. En effet, si ce dernier détermine la quantité d'un ensemble, il en va de même pour le<br />
nombre mathématique, sauf que les éléments de l'ensemble sont non pas des choses<br />
sensibles, mais des unités indifférentes entre elles. Du fait que le nombre reste celui d'un<br />
ensemble, deux interprètes ont conclus que <strong>Platon</strong> n'est pas arrivé à surmonter la confusion<br />
du nombre avec l'ensemble compté (A. Wedberg, Plato's philosophy of mathematics,<br />
Stockholm, Almquist & Wiksell, 1955, p. 74-75 ; P. Pritchard, l. c., p. 14-15 et 17 ; cf., pour<br />
la théorie arithmétique des Grecs en général, M. Burnyeat, « <strong>Platon</strong>ism and mathematics : a<br />
21
prelude to discussion », dans : A. Graeser (éd.), Mathematics and metaphysics in Aristotle,<br />
Bern-Stuttgart, Haupt, 1987, p. 235). L'expression du texte traduit (Rép. VII, 526 a 2-3),<br />
<strong>selon</strong> laquelle les unités sont dans le nombre, me semble justifier cette observation, car elle<br />
signifie que le nombre se compose d'unités et devient ainsi leur ensemble.<br />
3. <strong>Les</strong> idées des nombres<br />
Étant donné que les unités mathématiques sont plusieurs <strong>selon</strong> la République, elles ne<br />
sont pas d'idées, mais dépendent de l'unique idée de l'unité. Mais ni cette idée ni les idées des<br />
différents nombres ne sont évoquées dans la République. Pour trouver cette notion d'idée, il<br />
faut passer au Phédon, c'est-à-dire dans un contexte très différent. Dans ce dialogue, en effet,<br />
Socrate invoque le nombre deux comme un exemple parmi d'autres qui doivent illustrer les<br />
difficultés que rencontrent certains modes courants d'expliquer des phénomènes plutôt<br />
banals. Et cela dans le but, bien sûr, de montrer que l'hypothèse des idées permet d'éviter les<br />
difficultés.<br />
a) Critique des explications courantes de la naissance de deux choses<br />
Avant d'évoquer le nombre deux, Socrate raconte que, autrefois, il croyait que dix était<br />
plus que huit à cause des deux qui s'y ajoutent et que la longueur de deux coudées était plus<br />
grande que celle d'une coudée, parce qu'elle la dépassait de sa moitié (Phéd. 96 e 1-4).<br />
Mais alors, maintenant, demanda Cébès, qu'en penses-tu — Que je suis loin, par Zeus, de<br />
croire que je connaisse la cause de quelque chose dans ce domaine. Je n'accepte même pas ma<br />
propre opinion que, lorsqu'on ajoute une chose à une autre, (a) soit l'une à laquelle elle était<br />
ajoutée est devenue deux (b) soit la chose ajoutée et celle à laquelle elle était ajoutée sont<br />
devenues deux à cause de l'adjonction de l'une à l'autre. En effet, je me demande avec<br />
étonnement si, lorsque chacune des deux était à l'écart de l'autre, chacune était alors une et elles<br />
n'étaient pas deux, tandis que, lorsqu'elles se sont rapprochées, la cause pour elles de devenir<br />
deux était la rencontre survenue du fait de leur rapprochement réciproque. Je ne peux plus me<br />
persuader davantage que, si l'on coupe une chose, cela soit la cause du fait de devenir deux, la<br />
coupure. Car ce qui était tout à l'heure la cause de la duplication est l'opposé, étant donné que<br />
c'était tout à l'heure le fait de rapprocher les choses l'une de l'autre et d'adjoindre l'une à l'autre,<br />
tandis que maintenant l'une est écartée et séparée de l'autre. Je ne me persuade plus davantage<br />
que je sache ni pourquoi quelque chose devient un ni pourquoi, en un mot, quelque chose<br />
d'autre naît, périt ou existe — suivant cette façon de procéder. Je concocte cependant moi-<br />
22
même une autre façon au hasard, tandis que je n'accepte pas du tout celle-là. (Phéd. 96 e 4 - 97<br />
b 7)<br />
Comme Socrate le rappelle à la fin du passage, il s'agit pour lui de réfuter une façon<br />
traditionnelle d'expliquer toutes sortes de phénomènes à commencer par la vie, la sensation<br />
et le savoir. Ce type d'explication, c'est le recours à des causes physiques, qu'elles soient des<br />
qualités comme la chaleur, des substances comme le sang ou des mouvements comme<br />
l'adjonction. Socrate ne songe pas à remplacer ces causes par d'autres du même genre, il<br />
entend plutôt concevoir « une autre forme de cause » (97 e 5, 100 b3).<br />
Le dernier exemple de l'explication traditionnelle, que cite Socrate, est la production de<br />
deux <strong>objets</strong> par adjonction ou division. On n'apprend pas si sont visés des procédés de la vie<br />
quotidienne comme l'adjonction d'un œuf à un autre et la coupure d'une pomme en deux ou<br />
bien des procédés de démonstration visuelle d'opérations arithmétiques élémentaires. La<br />
deuxième lecture est bien entendu plus intéressante, parce qu'elle signifie que Socrate fait<br />
référence à certaines pratiques et concepts élémentaires des mathématiciens, même sans les<br />
nommer. En fait, l'adjonction d'un ensemble à un autre sera encore pour Euclide le moyen<br />
qui permet d'expliquer ce qu'est la somme des deux ensembles (voir A. Wedberg, l. c.,<br />
p. 69). Quant à la coupure, Socrate peut s'inspirer pour cette idée du cassage des caillous<br />
auquel il fait allusion dans la République. Car, aux yeux des mathématiciens avisés, le<br />
cassage fait naître plusieurs <strong>objets</strong>.<br />
À partir de cela on supposera que, dans le Phédon, Socrate pense que les processus<br />
d'adjonction et de coupure sont censés produire deux choses et non la dualité en soi. En effet,<br />
aussi la contre-proposition qu'il fera concernera non pas l'explication de la dualité, mais<br />
l'explication du fait qu'un objet devienne deux ; ce qui devient deux doit être une chose<br />
sensible.<br />
Socrate avance deux arguments pour discréditer l'explication courante qu'il avait acceptée<br />
autrefois pour la rejeter ensuite. Le premier argument semble avoir la forme d'un dilemme :<br />
ou bien la chose une à laquelle on en adjoint une autre devient deux de ce fait ou bien l'une<br />
et l'autre deviennent deux à cause de leur rapprochement. Socrate n'explique pas pourquoi la<br />
première branche du dilemme n'entre pas en ligne de compte. Mais on peut le comprendre en<br />
observant que, pour dire que quelque chose devienne quoi que ce soit, il faut supposer qu'il<br />
subisse un changement, comme c'est le cas lors de la coupure. Or, l'adjonction d'un<br />
deuxième objet ne fait pas changer le premier. Par conséquent, on ne saurait dire qu'il<br />
devienne deux.<br />
23
En ce qui concerne l'autre branche du dilemme, Socrate s'étonne que le pur<br />
rapprochement d'un objet et d'un autre en fasse deux. En effet, en évoquant un objet et un<br />
autre, on implique déjà qu'ils sont deux, avant de les rapprocher. Socrate a raison de rejeter<br />
l'idée <strong>selon</strong> laquelle la proximité spatiale nous amène à compter les choses, mais il ne<br />
substituera pas à cette idée une autre concernant le critère qui permet de compter. C'est<br />
seulement Aristote qui expliquera que l'on compte toujours les items que l'on subsume sous<br />
un terme commun comme « sept chevaux » ou « vingt animaux » (Métaph. XIV 1, 1088 a 8-<br />
14).<br />
Le second argument de Socrate, pour rejeter l'explication causale, est l'observation que<br />
deux choses peuvent naître aussi de la coupure d'une seule, processus opposé à celui du<br />
rapprochement dans la mesure où la coupure éloigne les parties du corps coupé les unes des<br />
autres. On peut, certes, s'étonner que deux processus de caractère opposé aboutissent au<br />
même résultat, mais cela ne suffit pas pour réfuter les explications qui se fondent sur les<br />
deux processus. Il faut une prémisse supplémentaire que Socrate ne propose pas. Deux me<br />
semblent entrer en ligne de compte.<br />
Premièrement, on peut supposer que la cause soit une condition non seulement suffisante,<br />
mais aussi nécessaire à la production de l'effet ; les idées que Socrate proposera au titre de<br />
causes d'une nouvelle forme possèdent en tout cas ce caractère. Or, il est évident que, étant<br />
donné que l'adjonction et la coupure ne peuvent s'opérer au même temps, elles s'empêchent<br />
mutuellement d'être des conditions nécessaires de la naissance de deux choses. Par<br />
conséquent, aucune d'entre elles n'en est la cause.<br />
Deuxièmement, on peut faire l'hypothèse que Socrate s'inspire d'une certaine notion de<br />
causalité. Elle se repère déjà chez Anaxagore et dominera la philosophie antique en disant<br />
que le rapport entre cause et effet consiste à transmettre une qualité. L'exemple standard est<br />
le feu qui rend chaudes d'autres choses en les chauffant. L'exemple illustre bien le principe<br />
qui a été formulé après <strong>Platon</strong> : le transfert de qualité, de la dualité en l'occurrence, est censé<br />
s'effectuer à partir de ce qui la possède à un degré supérieur (voir Aristote, Seconds<br />
Analytiques I 2, 72 a 29-30). Évidemment cette règle ne saurait s'appliquer à deux réalités de<br />
nature opposée, en l'occurrence l'adjonction et la coupure, à supposer que la qualité à<br />
transmettre dépende de la nature de la cause. Aux yeux de Socrate, cela pouvait plaider<br />
contre une méthode qui admet deux causes opposées du même effet.<br />
b) La naissance de deux choses expliquée par la participation à l'idée de deux<br />
24
Quelles que soient ses raisons précises dans le détail, Socrate estime défaillante<br />
l'explication des phénomènes, qui a recours à des causes physiques. Il propose de remplacer<br />
cette méthode par une autre qui procède essentiellement par hypothèses, c'est-à-dire par<br />
prémisses qui servent de bases à l'argumentation tant qu'elles ne sont pas infirmées soit par<br />
l'incohérence des conclusions qui en découlent soit par l'objection d'un interlocuteur (Phéd.<br />
99 e 4 - 100 a 7, 101 d-e). Pour appliquer cette méthode en matière d'explication, Socrate fait<br />
l'hypothèse de l'existence des idées (ibid., 100 b 5-6). Comment est-ce là une nouvelle<br />
approche de l'explication des phénomènes Socrate confère cette fonction à son hypothèse<br />
en reprenant le concept que l'on a déjà trouvé dans les dialogues de jeunesse : l'idée de F est<br />
ce grâce à quoi est f tout ce qui l'est (100 d 7, e 2-4). L'idée ne se voit tout de même pas<br />
revêtir du rang de cause, ce dernier est plutôt attribué au rapport entre l'idée et ses<br />
représentants ou instanciations.<br />
Le plus souvent, <strong>Platon</strong> exprime ce rapport en disant que les représentants participent de<br />
l'idée, mais il peut aussi dire que l'idée est présente dans ses instanciations, qu'elle est en<br />
communauté avec elles ou que les représentants imitent l'idée (100 d 3-7, Timée 49 a 1).<br />
Comment interpréter cette nouvelle notion de cause Il faut se rappeler ce qu'est la fonction<br />
de l'hypothèse des idées : qui sait définir un prédicat, connaît l'idée objective correspondante<br />
et est de ce fait capable d'affirmer ou de nier le prédicat correctement de n'importe quel sujet.<br />
Mais avant d'affirmer le prédicat, il faut subsumer le sujet sous la définition du prédicat. Si,<br />
par exemple, le courage se définit comme étant le savoir de ce qu'il faut craindre et de ce que<br />
l'on peut risquer (voir Lachès 198 b-c), il faut reconnaître ce savoir dans un homme pour être<br />
fondé à l'appeler « courageux ». Par là, on établit un rapport objectif entre le signifié de la<br />
définition et du sujet. Or, le signifié de la définition est l'idée <strong>selon</strong> <strong>Platon</strong>, le signifié du<br />
sujet est, pour simplifier, une chose sensible. Par conséquent, le rapport de participation ou<br />
de communauté entre les deux signifiés n'est rien d'autre que le pendant objectif de la<br />
subsomption, pendant qui fonde la vérité de la subsomption et, par là, celle de l'énoncé qui<br />
affirme le prédicat par rapport au sujet. Et de même que la subsomption est la « cause » du<br />
fait subjectif que le sujet soit considéré avec vérité conformément au prédicat, de même la<br />
participation est la cause objective du fait que la chose sensible se caractérise suivant l'idée.<br />
Cette conception s'applique aussi aux nombres.<br />
Alors, si une chose était ajoutée à une autre, ne te garderais-tu pas d'affirmer que<br />
l'adjonction ou, si l'une était coupée de l'autre, la coupure est la cause du fait de devenir deux <br />
Et tu crierais à haute voix que, pour chaque chose, tu ne connais aucune autre façon de naître<br />
25
qu'en prenant part à l'être propre de ce à quoi elle prend part à chaque fois. Et que, dans le cas<br />
présent, tu ne connais aucune autre cause du devenir deux que le fait de prendre part à la<br />
dualité. Et que ce qui veut être deux doit y prendre part, alors que doit prendre part à l'unité ce<br />
qui veut être un. Ces coupures-là, en revanche, les adjonctions et les autres finesses de ce genre,<br />
tu les enverrais promener, en laissant le soin de répondre à ceux qui sont plus savants que toi.<br />
(Phéd. 101 b 8 - c 9)<br />
Ce passage ne fait qu'appliquer aux nombres la nouvelle méthode d'explication. Tout en<br />
invoquant l'idée de l'unité, Socrate n'établit pas de lien avec la pluralité d'unités qui servent à<br />
définir le nombre mathématique dans la République et qui demandent précisément cette idée<br />
commune. Quant à l'idée du nombre deux, on n'apprend pas comment elle se rapporte à la<br />
même définition du nombre en général. L'absence des unités et des nombres mathématiques<br />
correspond sans doute à la grande autonomie qui caractérise le cheminement de chaque<br />
dialogue de <strong>Platon</strong>. Quelques pages plus loin on retrouve cependant des nombres pairs et<br />
impairs qui ne sont pas attachés à des ensembles concrets et que l'on voudrait donc tenir pour<br />
des idées. Mais, étant donné que ces nombres doivent être pairs ou impairs, ils sont<br />
forcément divisibles — en deux ensembles égaux ou non égaux —, ce qui est incompatible<br />
avec le principe de la simplicité des idées. Qui plus est, Socrate appelle même le nombre dix<br />
« le double de cinq », ce qui signifie que les nombres en question font l'objet d'opérations<br />
mathématiques (105 a 6-7) ; il s'agit donc de nombres mathématiques et non des idées des<br />
nombres (cf. P. Pritchard, l. c., p. 35). Mais Socrate n'indique pas la différence.<br />
C'est dans le Phédon que <strong>Platon</strong> s'occupe le plus des idées des nombres, mais il n'a pas<br />
l'air de vouloir, par là, contribuer à la théorie de l'arithmétique. L'indice le plus marqué en est<br />
le fait que les idées des nombres apparaissent dans le contexte d'une réflexion sur<br />
l'explication du devenir ; à la différence d'autres exemples (voir Phéd. 100 e 5 - 101 b 8),<br />
dans l'exemple mathématique l'accent est mis sur le fait de devenir deux. Or, cet aspect qui<br />
caractérise les choses sensibles est étranger aux mathématiques. Si <strong>Platon</strong> veut faire<br />
référence aux mathématiciens qui visualisent l'addition en ajoutant un caillou à un autre, la<br />
critique de Socrate est pertinente vis-à-vis de ceux qui confondent l'objet arithmétique avec<br />
sa figuration. Il les avertit que leurs manipulations dépendent de façon non réciproque des<br />
idées de nombres. Est-ce que Socrate critique tacitement aussi les mathématiciens avisés <br />
Tel serait le cas, si ces mathématiciens se prononçaient sur la naissance des unités et des<br />
ensembles dénombrés sensibles en soutenant quelle est due à des processus physiques et non<br />
à la participation aux idées.<br />
26
Ce n'est pas un résultat impressionnant. Que peut-on dire des idées des nombres sur la<br />
base des textes traduits Je crains que cela ne soit qu'une seule chose, importante tout de<br />
même. Étant donné, en effet, que les idées sont indépendantes, non associées à quelqu'autre<br />
entité que ce soit, les idées des nombres ne déterminent la quantité de certains ensembles ni,<br />
a fortiori, ne s'identifient à des ensembles ; par là, elles se distinguent des nombres<br />
mathématiques qu'évoque la République. Par contre, comment se prononcer sur la structure<br />
des idées des nombres, alors que les textes ne nous livrent la définition ni d'un nombre<br />
particulier ni du nombre en général (je veux parler de la définition qui signifie l'idée) Ou<br />
bien faut-il tirer tout de même la définition du nombre en général de la définition du nombre<br />
mathématique, ce qui donnerait quelque chose comme « ensemble d'unités » À ce momentlà,<br />
les définitions des nombres particuliers ne deviendraient-elles pas circulaires, comme<br />
« deux est l'ensemble de deux unités » <br />
Comment trancher entre deux interprétations — tirées, en partie à tout le moins, des récits<br />
aristotéliciens sur <strong>Platon</strong> —, dont l'une dit que les idées des nombres ne sont pas des<br />
ensembles d'unités et l'autre que les idées des nombres sont chacune un certain nombre<br />
d'unités qui sont comparables entre elles dans l'idée d'un nombre précis, mais pas avec les<br />
unités composant l'idée d'un autre nombre (voir A. Wedberg, l. c., p. 65-66 ; M. Burnyeat,<br />
« <strong>Platon</strong>ism and mathematics … », p. 235-236) Comment savoir qui a raison, les exégètes<br />
<strong>selon</strong> lesquels les idées des nombres ne sont rien d'autre que la série des nombres naturels ou<br />
bien ceux qui pensent que cette thèse relève tout simplement d'un anachronisme (voir<br />
P. Pritchard, l. c., p. 35-36) Comment en discuter seulement, tant que l'on ne sait pas si la<br />
définition du nombre contient le concept de succession <br />
27
Études citées<br />
J. Adam, The Republic of Plato, 2 e éd., Cambridge, CUP, 1965.<br />
M. Burnyeat, « <strong>Platon</strong>ism and mathematics : a prelude to discussion », dans : A. Graeser<br />
(éd.), Mathematics and metaphysics in Aristotle, Bern-Stuttgart, Haupt, 1987, p. 213-240.<br />
— « Plato on why mathematics is good for the soul », dans : T. Smiley (éd.), Mathematics<br />
and necessity. Essays in the history of philosophy, Oxford, OUP, 2000, p. 1-81.<br />
R. Hare, « Plato and the mathematicians », dans : R. Bambrough (éd.), New essays on<br />
Plato and Aristotle, London, Routledge & Kegan Paul, 1965, p. 21-38.<br />
Th. Heath, A history of Greek mathematics, vol. 1, Oxford, Clarendon, 1921.<br />
I. Mueller, « Ascending to problems : astronomy and harmonics in Republic VII, dans : J.<br />
P. Anton (éd.), Science and sciences in Plato, Demar (NY), Caravan Books, 1980, p. 103-<br />
122.<br />
P. Pritchard, Plato's philosophy of mathematics, Sankt Augustin, Academia, 1995.<br />
F. F. Repellini, « La linea e la caverna », dans : M. Vegetti (éd.), <strong>Platon</strong>e. La Repubblica,<br />
vol. V, Napoli, Bibliopolis, 2003, p. 355-403.<br />
A. Wedberg, Plato's philosophy of mathematics, Stockholm, Almquist & Wiksell, 1955.<br />
28