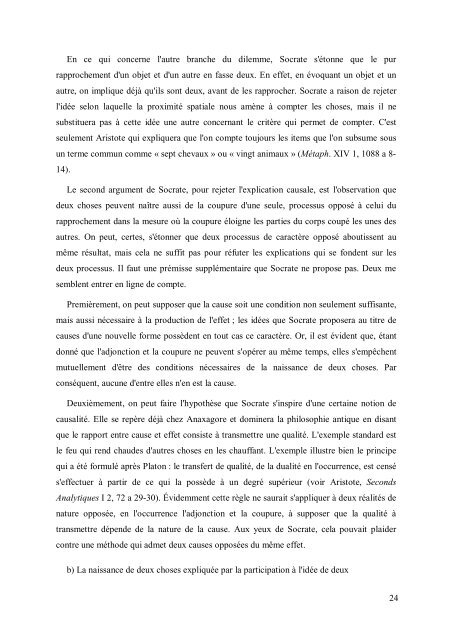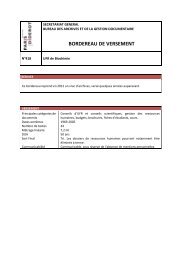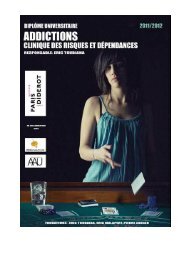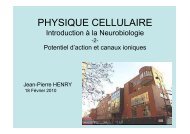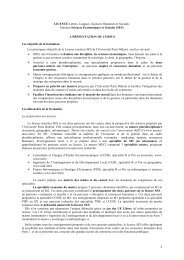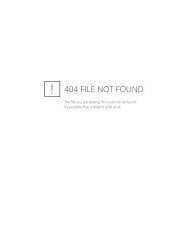Les objets mathématiques selon Platon - Université Paris Diderot ...
Les objets mathématiques selon Platon - Université Paris Diderot ...
Les objets mathématiques selon Platon - Université Paris Diderot ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
En ce qui concerne l'autre branche du dilemme, Socrate s'étonne que le pur<br />
rapprochement d'un objet et d'un autre en fasse deux. En effet, en évoquant un objet et un<br />
autre, on implique déjà qu'ils sont deux, avant de les rapprocher. Socrate a raison de rejeter<br />
l'idée <strong>selon</strong> laquelle la proximité spatiale nous amène à compter les choses, mais il ne<br />
substituera pas à cette idée une autre concernant le critère qui permet de compter. C'est<br />
seulement Aristote qui expliquera que l'on compte toujours les items que l'on subsume sous<br />
un terme commun comme « sept chevaux » ou « vingt animaux » (Métaph. XIV 1, 1088 a 8-<br />
14).<br />
Le second argument de Socrate, pour rejeter l'explication causale, est l'observation que<br />
deux choses peuvent naître aussi de la coupure d'une seule, processus opposé à celui du<br />
rapprochement dans la mesure où la coupure éloigne les parties du corps coupé les unes des<br />
autres. On peut, certes, s'étonner que deux processus de caractère opposé aboutissent au<br />
même résultat, mais cela ne suffit pas pour réfuter les explications qui se fondent sur les<br />
deux processus. Il faut une prémisse supplémentaire que Socrate ne propose pas. Deux me<br />
semblent entrer en ligne de compte.<br />
Premièrement, on peut supposer que la cause soit une condition non seulement suffisante,<br />
mais aussi nécessaire à la production de l'effet ; les idées que Socrate proposera au titre de<br />
causes d'une nouvelle forme possèdent en tout cas ce caractère. Or, il est évident que, étant<br />
donné que l'adjonction et la coupure ne peuvent s'opérer au même temps, elles s'empêchent<br />
mutuellement d'être des conditions nécessaires de la naissance de deux choses. Par<br />
conséquent, aucune d'entre elles n'en est la cause.<br />
Deuxièmement, on peut faire l'hypothèse que Socrate s'inspire d'une certaine notion de<br />
causalité. Elle se repère déjà chez Anaxagore et dominera la philosophie antique en disant<br />
que le rapport entre cause et effet consiste à transmettre une qualité. L'exemple standard est<br />
le feu qui rend chaudes d'autres choses en les chauffant. L'exemple illustre bien le principe<br />
qui a été formulé après <strong>Platon</strong> : le transfert de qualité, de la dualité en l'occurrence, est censé<br />
s'effectuer à partir de ce qui la possède à un degré supérieur (voir Aristote, Seconds<br />
Analytiques I 2, 72 a 29-30). Évidemment cette règle ne saurait s'appliquer à deux réalités de<br />
nature opposée, en l'occurrence l'adjonction et la coupure, à supposer que la qualité à<br />
transmettre dépende de la nature de la cause. Aux yeux de Socrate, cela pouvait plaider<br />
contre une méthode qui admet deux causes opposées du même effet.<br />
b) La naissance de deux choses expliquée par la participation à l'idée de deux<br />
24