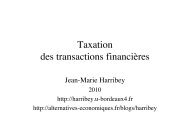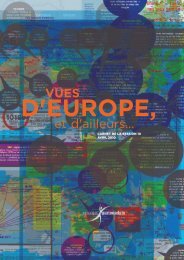Octobre-Novembre 2005 - Ipam
Octobre-Novembre 2005 - Ipam
Octobre-Novembre 2005 - Ipam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
III<br />
L’impasse<br />
De l’autre côté de la fameuse " fracture sociale ", les forces de l’ordre,<br />
flashballs à la main, hurlent et insultent les familles qui sont aux fenêtres ;<br />
humilient et interpellent à tout va mères, enfants et vieillards…<br />
Le ministre de l’Intérieur fait preuve de politesse racailleuse, et le gouvernement<br />
est frappé de myopie politique, frappant du poing sur une table vide,<br />
où il a jusqu’ici toujours refusé de s’asseoir.<br />
La meute.<br />
La crise économique, sociale et politique de la société française est à son comble,<br />
et la violence prend de l’ampleur dans bon nombre de quartiers populaires de France.<br />
Meute et émeute se font face. 38<br />
« La part des islamistes radicaux dans les violences a été nulle ». Pascal Mailhos, directeur central des<br />
Renseignement généraux est catégorique 39 . Les membres du Tabligh, le plus influent des mouvements<br />
islamistes en France 40 , se sont efforcés d’empêcher les jeunes qu’ils influencent de participer aux troubles 41 .<br />
Les mouvements musulmans conservateurs n’ont pas été en reste à commencer par le plus présent d’entre<br />
eux sur le terrain, l’Union des organisations islamiques de France (UOIF) qui a tout de suite dénoncé, dans<br />
une fatwa solennelle, les participants aux événements comme se mettant hors de l’Islam 42 .<br />
Pourtant, nous l’avons vu, sans même parler des « partisans de l’ordre », la majorité des responsables<br />
politiques et associatifs et des observateurs ont cru bon d’invoquer obstinément le péril islamiste. Alain<br />
Lecourieux et Christophe Ramaux que nous citions tout à l’heure parlent par exemple « d’une révolte<br />
sociale, parfaitement légitime à de multiples égards (qui) n’en prend pas moins parfois, à l’instar de<br />
l’exaltation religieuse de certains, une forme foncièrement réactionnaire » 43 . Et si la religion musulmane<br />
n’est pas explicitement visée, elle l’est implicitement à travers les références répétées à la « laïcité » et quasi<br />
obsessionnelle au « communautarisme ».<br />
Avant d’aller plus loin, et d’examiner ensemble ce qui se passe dans les quartiers relégués, arrêtons nous un<br />
peu sur ce concept « trendy » de communautarisme.<br />
Le regroupement des êtres humains en communautés est naturel, et c’est une des conditions pour vivre en<br />
société. A fortiori dans une société démocratique, où les affrontements des passions devraient être régulés<br />
par la confrontation pacifique des intérêts collectivement exprimés, par les uns et les autres, au sein de la<br />
Polis, l’espace politique de la cité. Le fait de construire des lieux pour vivre en commun certaines<br />
particularités communes (des communautés) n’est pas en soi un problème, dès lors que ces communautés<br />
n’affrontent pas les autres (retour de la guerre), ni ne se vivent en sécession d’avec les autres (refus de faire<br />
société commune). Un véritable « communautarisme » (les ignares ajoutent « anglo-saxon ») serait une<br />
philosophie politique qui préconiserait, contre la société commune, la juxtaposition de sociétés différentes,<br />
comme seul moyen de garantir la paix civile. Dans cette conception chacun est assigné à une communauté<br />
qui régit tout l’espace civil pour ces assujettis, sauf les domaines considérés comme commun (par exemple le<br />
devoir de service militaire, le paiement de l’impôt).<br />
La France a pratiqué massivement le communautarisme jusqu’en 1958 44 en distinguant une communauté de<br />
citoyen égaux en droits (les citoyennes, on le sait, n’ont eu accès à cette égalité totale qu’au début des années<br />
1970), régis notamment par le code civil, et des communautés « indigènes », définies par des considérations<br />
ethniques ou religieuses, et ne disposant pas des mêmes droits, y compris ceux du code civil, mais ayant des<br />
devoirs vis-à-vis de la communauté des Français (par exemple le devoir de service militaire). Dans cette<br />
conception française du communautarisme, les « indigènes » n’avaient pas le libre choix de leur<br />
communauté. Une partie du pouvoir civil les concernant était affectée aux juges religieux 45 . Il en reste encore<br />
dans notre pays des traces mentales, et même juridiques, de ce communautarisme colonial. Par ailleurs,<br />
d’autres formes de communautarismes existent dans certains milieux et professions, comme par exemple le<br />
rôle officiel de certains ordres professionnels, etc.<br />
30