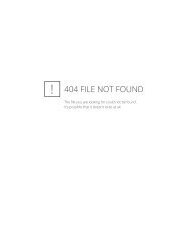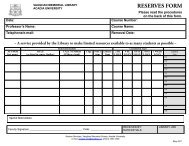ASAC 2004 François Marticotte Québec, QUÉBEC Philippe ...
ASAC 2004 François Marticotte Québec, QUÉBEC Philippe ...
ASAC 2004 François Marticotte Québec, QUÉBEC Philippe ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
personnelles ou de mélange d’énoncés provenant des échelles MKTOR et MARKOR. La variétéd’échelles existantes ne poserait pas de problème si l’échelle n’avait pas d’incidence sur larelation « orientation marché – performance ». Or, une des analyses a montré que ce n’était pas lecas. La signification (ou la non signification) statistique de la relation dépend en partie del’échelle de mesure de l’orientation marché choisie. L’échelle MKTOR augmente l’incidenced’identifier une relation significative, l’échelle MARKOR une relation non significative, et leséchelles personnelles, une relation partiellement validée. Un tel résultat plaide pour l’utilisationd’une échelle standardisée qui n’ajouterait pas un biais en faveur d’un résultat plutôt qu’un autre.Apparemment, les chercheurs ne sont pas encore arrivés à cette solution. Plusieurs études se sonttoutefois penché sur l’identification de la meilleure ou d’une meilleure échelle de mesure sansque ce débat soit résolu (entre autres, Oczkowski & Farrell, 1998 et Harris, 2002). Une analysestatistique liant la date de publication à l’échelle utilisée n’a pas montré de relation significative :le choix de l’échelle sélectionnée est aussi varié ces dernières années qu’il l’a été lors despremières années de l’étude du concept. Choisir une échelle de mesure signifie aussi choisir uneconceptualisation de l’orientation marché. Narver et Slater (1990) considèrent davantagel’orientation marché comme de la collecte de données à l’extérieur de l’entreprise. Jaworski etKohli (1993) la voient comme de la collecte et de la diffusion à l’intérieur des différentsdépartements dans l’entreprise. Leurs échelles de mesure respectives reflètent ces idées. Ces deuxconceptions de base ne nous semblent ni identiques, ni incommensurables. Une entreprise parexemple, très orientée vers la recherche d’information à l’externe, mais qui éprouve de ladifficulté à la faire circuler à l’interne, présentera deux niveaux d’orientation marché différentesselon qu’elle est mesurée par MKTOR ou MARKOR. Cela ne rend pas pour autant une échellemeilleure ou pire que l’autre.Un autre biais associé à l’orientation marché est provoqué par l’unité d’échantillonnagesélectionnée. Puisque l’orientation marché est une philosophie corporative, il sembleconceptuellement difficile de la saisir sans faire appel aux dirigeants de l’entreprise qui sont lespersonnes les plus aptes à y répondre puisqu’elle demande une compréhension des mécanismesinternes. Parce que ces personnes véhiculent le discours officiel de leur entreprise, il est peusurprenant qu’ils aient tendance à surestimer, volontairement ou non, l’intensité de l’orientationmarché de leur organisation (Shapiro, 1988). Les gestionnaires peuvent croire à tort, qu’ils sont àl’écoute réelle de leurs marchés. Ils peuvent aussi prétendre l’être alors qu’ils saventconsciemment que ce n’est pas le cas, question de projeter et/ou de protéger une imagecorporative admirable (et admirée). Réduire la perception « optimiste » des répondants pourraitpasser par l’utilisation de plusieurs unités d’échantillonnage dans une même entreprise pour enfaire une moyenne. Une des analyses a montré que lorsque la collecte des données se fait auprèsde plusieurs unités dans une même entreprise (plutôt qu’une (1) unité par entreprise), laprobabilité d’obtenir une relation non significative est plus faible dans le groupe de l’échantillonde répondants multiples. Loin de confirmer la logique de l’argumentation, nos résultats prouventen fait le contraire. Une explication possible à nos résultats est que l’unité choisie, bien quemultiple dans une entreprise, se situe toujours dans un palier hiérarchique élevé. La solution, pourréduire ce biais potentiel, passerait par des unités oeuvrant non seulement dans des départementsdifférents (ce qui est déjà présent dans plusieurs études), mais surtout, à des paliers décisionnelsdifférents. Les gestionnaires, plus près des activités opérationnelles de l’entreprise, risqueraientd’avoir un point de vue s’éloignant de la version officielle de la haute direction. Encore faudrait-ilque les « subordonnés » perçoivent avoir suffisamment d’information sur leur entreprise et unevision holistique des opérations et de la culture organisationnelle pour saisir l’intensité del’orientation marché de leur employeur.