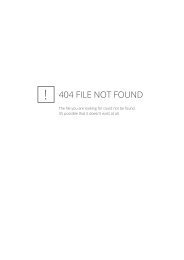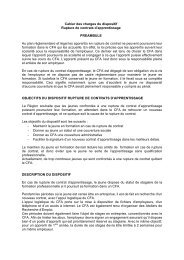JOURNAL DE L’ANNÉE <strong>2000</strong>R a p p o r t s e t é t u d e sdes jeunes, la relation formationemploi,les obstacles à l’insertion professionnelle.➤ La formation professionnelle continuefinancée par les entreprises : exploitationdes déclarations fiscales desemployeurs n° 24-83 - année 1997Elyes Bentabet ; Christelle Gauthier ; MarionLambertCéreq Documents série observatoire, n° 147,mars <strong>2000</strong>, 90 p.Le volume <strong>2000</strong> de “La formationprofessionnelle continue financée parles entreprises” présente la synthèse del’exploitation des déclarations fiscalesdes employeurs n° 24-83 pour l’année1997. Cette synthèse est complétéepar une étude de l’évolution des chiffresde la FPC sur une longue période.On peut retrouver les principaux résultatsissus de ces traitements des déclarationsn° 24-83 sur le site du Céreq(http ://www.cereq.fr).➤ Formation tout au long de la vieAndré Gauron ; Conseil d’analyse économiqueParis : La Documentation française, Dir. desjournaux officiels, <strong>2000</strong>, 168 p. (Coll. Les rapportsdu Conseil d’analyse économique)Réalisé à la demande du secrétariatd’État aux Droits des femmes et à laFormation professionnelle, ce rapportpropose un éclairage sur les enjeux de laformation tout au long de la vie dans sarelation directe à l’emploi : comparaisonavec différents pays industrialisés, analysede la relation formation emploi,apports sur l’innovation et la modernisationdes entreprises, impact en matièred’insertion, le poids du marché de la formation.Cinq propositions sont formuléesvisant à la “refondation” de la formation: renforcer l’articulation entreformation de base et formation en alternanceen direction des jeunes, passerd’une obligation de dépense à une obligationréciproque de formation, créer undroit à la certification des compétencesprofessionnelles, privilégier la formationdes personnes de faible niveau de formation,organiser la transparence dumarché de la formation.➤ Guide pratique du droit du travail :avec mise à jour de la loi sur les35 heures ; édition <strong>2000</strong>-2001Ministère de l’Emploi et de la Solidarité -4 e éditionParis : La Documentation française, <strong>2000</strong>,536 p.Ce guide qui s’adresse à un largepublic s’articule autour des thèmes suivants: contrat de travail, durée du tra-vail, rémunération, santé et conditionsde travail, formation professionnelle,absences et congés, rupture du contratde travail, insertion professionnelle desjeunes, des demandeurs d’emploi, deshandicapés, représentants des salariés.➤ Les métiers de la ville et du développementsocial urbainJean-François Slipp ; Maurice Blanc ; CUCES.<strong>Centre</strong> universitaire de coopération économiqueet socialeNancy : CUCES, mars <strong>2000</strong>, 34 p.Cette analyse est structurée en quatreparties. Les deux premières sont centréessur l’origine des métiers de la villeet les enjeux de la professionnalisation.Les deux dernières parties examinentle statut, l’exercice de l’activité, l’identitéprofessionnelle et les spécificités dessituations de travail. Ce travail s’appuiesur le recensement et l’examen desécrits sur le thème.➤ Mission générale d’insertion del’Éducation nationale : nouvelles chancesMinistère de l’Éducation nationaleParis : Ministère de l’Éducation nationale,<strong>2000</strong>, 12 p.Le programme Nouvelles chances apour objectif de réduire le nombre dessorties sans qualification du systèmeéducatif. Il a été mis en place en1999. Il s’inscrit dans les orientationsde la Mission générale d’insertion del’Éducation nationale. Dans ce cadre,cette brochure propose un état des lieuxsur la Mission nationale d’insertion etdétaille une série de fiches concernantdes mesures, par exemple : le cycled’insertion professionnelle par alternance(CIPPA) ; la formation intégrée(FI) : la formation complémentaired’initiative locale (FCIL).➤ Pour une adaptation et une modernisationdes métiers de l’animation :rapport d’information déposé en applicationde l’article 145 du règlement parla Commission des affaires culturelles,familiales et sociales sur les métiers del’animationPhilippe VuilqueDocuments d’information de l’Assembléenationale, n° 2307, mars <strong>2000</strong>, 39 p.Le ministère de la Jeunesse et desSports et le ministère de l’Emploi etde la Solidarité ont élaboré un projetde dispositif intitulé “Jeune animateurvolontaire stagiaire” (JAVOS), soumisaux partenaires sociaux du secteurde l’animation socioculturelle. Cerapport analyse la portée du projet etformule des propositions.➤ La professionnalisation de l’offre deformation et des relations entre les utilisateurset les organismes : documentpréparatoire à la table ronde organiséepar le secrétariat d’État aux Droits desfemmes et à la Formation professionnelleDGEFP ; Collaboration Céreq ; <strong>Centre</strong> INFFO,Oravep, s.n. mars <strong>2000</strong>, 35 p.Ce document fait le point sur la productionde formation et l’organisationde la profession. L’introduction faitpart de la dépense globale en faveur dela formation professionnelle et del’apprentissage. Les quatre chapitresqui suivent traitent de la branche, dumarché et du secteur de la formationprofessionnelle ; de la qualité de laformation ; de la commande publiquede l’État ; du développement de nouvellesmodalités de formation, plusparticulièrement liées à l’introductiondes technologies dans les systèmesd’apprentissage.➤ Rapport de la mission interministériellede lutte contre les sectes : rapportremis à Lionel Jospin en février <strong>2000</strong>Alain VivienParis : La Documentation française, mars<strong>2000</strong>, 64 p.Ce rapport dresse l’état des relationsde la Mission avec plusieurs départementsministériels particulièrementconcernés par le sectarisme. Il abordeles problèmes actuels posés au planinternational par le développementdes activités illégales des sectes. Il faitun premier constat de la situation quiprévaut dans les départementsd’outre-mer en matière de sectarisme.Il rappelle les problèmes aigus poséspar les tentatives de pénétration desmilieux économiques par le sectarisme.Par ailleurs, le rapport suggèreune définition de la secte telle qu’elleressort à l’examen des comportementssectaires, définition appuyée enmatière juridique par une série d’élémentsde droit positif. Enfin, la Missionsouligne l’urgence d’une politiqueà l’égard de mouvementssectaires.➤ Reconnaissance et validation desacquis en formationMehdi Farzad ; Saeed PaivandiParis : Anthropos, mars <strong>2000</strong>, 213 p.Cet ouvrage propose des repères théoriquessur la reconnaissance et la validationdes acquis, rappelle le contextedans lequel ils se développent, ainsique leurs enjeux. Il évoque les outilset modalités en usage pour leur application.Une attention particulière estportée à la prise en compte des acquisdans le cadre de la formation supérieuredes adultes. Deux expériences sontrelatées, celle du Collège coopératif deParis et celle de Paris VIII.➤ Service central de prévention de lacorruption : rapport 1998-1999SCPCParis : La Documentation française, Dir. desjournaux officiels, <strong>2000</strong>, 145 p.Le chapitre III du rapport annuel duService central de prévention de la corruption(placé sous la responsabilité duGarde des Sceaux) est consacré aux“risques de dérives dans le secteur dela formation professionnelle”. Aprèsun bref rappel des modalités de financementde la FPC, un état des lieuxdes dérives constatées est effectué à partirdes différents protagonistes : stagiaires,organismes de formation, organismescollecteurs, entreprises.➤ Signification, sens, formationSous la responsabilité de Jean-Marie Barbieret Olga GalatanuParis : PUF, <strong>2000</strong>, 192 p. (Coll. Éducation etformation)Cet ouvrage est issu d’une table-rondeorganisée dans le cadre de la quatrièmeBiennale de l’Éducation et de la Formation(1998) et enrichi par d’autrescontributions. Il développe différentesthéories autour de la signification et dusens construits par les acteurs sociauxdans et par leurs pratiques.➤ Les stratégies de l’alternance et lavalidation des acquis professionnelsMinistère de l’Éducation nationale, de laRecherche et de la TechnologiePatrick AvrilParis : CNDCP, mars <strong>2000</strong>, 151 p. (Coll.Pratiques innovantes)Selon les auteurs, il existe une articulationnaturelle entre formation paralternance et validation des acquis professionnels.Sur ce thème, l’ouvrageregroupe des témoignages d’acteurs deterrain et propose une synthèse de leursapports. Ainsi, des récits d’action mettenten lumière ce que les enseignantsréalisent pour optimiser l’alternance enformation ainsi que les prestations enmatière de validation des acquis professionnels.Les seize projets publiésici concernent les formations en alternancesous statut scolaire, de niveauCAP au BAC professionnel, la pédagogiede l’alternance dans le collège,l’ouverture de sections d’apprentis dans26 SUPPLÉMENT INFFO FLASH - JANVIER 2001
JOURNAL DE L’ANNÉE <strong>2000</strong>R a p p o r t s e t é t u d e sun lycée, et vont jusqu’aux situationsd’adultes préparant un diplôme professionnel.avril➤ Analyse des activités : état des lieuxDGEFP, Cellule nationale de professionnalisationdu programme “nouveaux servicesnouveaux emplois”.Paris : DGEFP, avril <strong>2000</strong>, 29 p.Ce premier état des lieux effectué parla Cellule de professionnalisationdonne des indications sur la plus-valuesociale apportée par les services développésdans le cadre du programme“Nouveaux services/nouveaux emplois”.On trouvera, en annexe, unepremière configuration des activités sousforme de fiches de synthèse.➤ Compétence et navigation professionnelleGuy Le Boterf - 3 e éditionParis : Éditions d’organisation, <strong>2000</strong>, 296 p.Dans cet ouvrage, Guy Le Boterf nousdonne une version complètement revueet augmentée des éditions de 1997 et1999. Il y développe trois concepts :le modèle combinatoire, la navigationprofessionnelle, la compétence collective.Selon le modèle de Guy Le Boterf, ildevient nécessaire de mettre en placeun management de la professionnalisationgrâce au développement descompétences dans l’entreprise.➤ Emplois-jeunes, quelle professionnalisation? : dossierCollectif d’auteursFormation emploi, n° 70, avril-juin <strong>2000</strong>,pp. 9-90Le programme “Nouveaux services/emplois jeunes” n’est qu’à mi-parcours.Ce numéro propose un état des lieuxsur la professionnalisation des jeuneset des nouveaux services. ChristopheGuitton nous révèle toute l’originalitéet les enjeux de cette nouvelle politiquepublique. Patrice Adam, pour sa part,en démonte les mécanismes juridiques.Chantal Labruyère développe uneréflexion sur le concept de professionnalisationet ses liens avec la formation.Anne-Marie Charraud expose la difficultéde concilier innovation et validationdes acquis professionnels à traversles diplômes. Jean-Paul Cadet démontrel’importance du rôle des encadrantsdirects des jeunes. Patricia Champy-Remoussenard, Pierre-André Dupuiset François Higele examinent commentles jeunes accèdent à la formation.Enfin, un entretien avec JosianeTessier souligne les enjeux de laprofessionnalisation en pariant sur lapossibilité d’une reconnaissance socialede nouveaux services et de nouveauxprofessionnels.➤ Évaluation des politiques régionalesde formation professionnelle1997-1999 - Volume I : rapportsComité de coordination des programmesrégionaux d’apprentissage et de formationprofessionnelle continue ; Céreq ; LIRHE ;LEST ; IRES ; IRADESParis : La Documentation française, avril<strong>2000</strong>, 337 p.Ce premier volume sur l’évaluationdes politiques régionales de formationprofessionnelle présente les différentsrapports issus des travaux de la secondephase d’évaluation 1997-1999 : lerapport d’évaluation des politiquesrégionales de formation professionnelleadopté par le Comité de coordinationdes programmes régionaux le 20 octobre1999 ; le rapport du Céreq quiprésente de manière synthétiquel’ensemble des travaux techniquescoordonnés par le Céreq ; le rapportde l’OIP et du LIRHE sur laconstruction de l’offre de formation ; lerapport de travail et mobilité et del’IRES sur les relations entre lesrégions et les acteurs économiques etsociaux et le rapport du CERVIL etde l’IRADES sur les dispositifsd’accueil, d’information et d’orientation.➤ Évaluation des politiques régionalesde formation professionnelle1997-1999 - Volume II : portraits statistiquesComité de coordination des programmesrégionaux d’apprentissage et de formationprofessionnelle continue ; Céreq ; Insee ;DPD ; DarésParis : La Documentation française, avril<strong>2000</strong>, 452 p.Ce second volume présente les matériauxstatistiques qui ont été produitsau cours de cette seconde phase d’évaluation1997-1999. Les typologiesdes régions sont établies à partir d’unesélection d’indicateurs sur la place desjeunes dans le contexte démographique,économique et d’emploi, lepoids relatif des principales filières deformation et les modes de formation(apprentissage), l’ampleur des dispositifsde formation pour les jeunes sortisdu système scolaire, et les modali-tés d’insertion dans la vie active. Laseconde partie du document présente26 portraits détaillés à partir d’unebatterie de 141 indicateurs mis aupoint par une coopération entre leCéreq, l’Insee, la Darés et la DPD.➤ Évaluation du dispositif TRACE :rapport d’étudeTERSUD -s.l. : TERSUD, avril <strong>2000</strong>, 43 p.Ce rapport réalisé pour la Darés et laDIJ, Délégation à l’insertion desjeunes, propose une évaluation statistiquedu programme TRACE. Ils’appuie sur l’exploitation de donnéesissues d’un logiciel intitulé “Parcours”.Cet instrument permet auxconseillers des Missions locales etPAIO de gérer quotidiennement lesjeunes accueillis par le réseau. Celogiciel couvre, aujourd’hui, l’ensembledu dispositif Jeunes, del’accueil au suivi des itinérairesjusqu’à l’insertion professionnelle.Ainsi, l’analyse proposée dans cedocument détaille, par exemple : lescaractéristiques des jeunes bénéficiairesdu programme, les spécificités de leursitinéraires, la montée en charge dudispositif et son impact, les servicesproposés aux jeunes en matière d’accompagnementsocial (problèmes desanté, de ressources, de logement).➤ Les histoires de la vie : de l’inventionde soi au projet de formationChristine Delory-MonbergerParis : Anthropos, <strong>2000</strong>, 289 p. (Coll. Explorationinterculturelle et science sociale)Cette étude tente de mettre en relationles formes sous lesquelles l’individutient une parole sur lui-mêmeavec l’état et les conditions de lasociété à laquelle il appartient. Cecijustifie la construction de l’ouvrageen deux parties : de l’antiquité à lafin du XVIII e siècle, la relation dusujet à lui-même passe par desmédiations et des institutions extérieures; au tournant du XVIII e etdu XIX e , le sujet se découvre commeétant à lui-même sa propre origine etsa propre fin, un nouveau regard surl’homme rend possible la naissancedes sciences humaines. Ainsi, lesusages contemporains de l’histoire devie, en particulier ceux des sciencessociales et de la formation, sont resituésdans une histoire qui a vu sesuccéder des configurations plurielleset divergentes de l’identité biographique.➤ Illettrisme et monde du travailCoord. Christine El Hayek ; Ministère del’Emploi et de la Solidarité ; GPLIParis : La Documentation française, Dir. desjournaux officiels, <strong>2000</strong>, 434 p. (Coll. Entoutes lettres)Les problèmes que pose l’illettrismedans les activités professionnelles recouvrentune réalité bien difficile à cerner.Elle est fréquemment niée par lesemployeurs et par les salariés concernés,bien que ces difficultés fragilisentleur emploi et limitent leurs possibilitésd’accès aux formations et auxqualifications. Cet ouvrage rassembleune multiplicité d’approches, socioéconomiques,linguistiques, ergonomiques,pédagogiques, traitant desrelations entre maîtrise des langages etsituations de travail.➤ L’irrésistible ascension du e-learningou comment former dans la nouvelleéconomieArthur Andersen ; Pascal Desbordes ;Gabrielle Lassort-BoucherNeuilly-sur-Seine : Arthur Andersen, avril<strong>2000</strong>, 67 p.La nouvelle économie s’accompagnedu développement de nouvellescompétences et de la mutation de certainsmétiers. Dans ce cadre, lesapproches traditionnelles de la formationprofessionnelle apparaissentbien souvent dépassées. C’est dans cecontexte que le e-learning se développe: la création, le déploiement etla gestion d’actions de formation viainternet ou intranet. Cette étude, réaliséepar le cabinet Arthur Andersenentre janvier et mars <strong>2000</strong>, se basesur une enquête menée auprès de74 entreprises françaises de tailles différenteset représentant l’ensemble dessecteurs d’activités, ainsi que surl’analyse du marché américain.Elle est structurée en cinq parties :le marché du e-learning, les différentessolutions et les avantages due-learning, les différents acteurs, laconduite de projet, les convictionsd’Arthur Andersen pour réussir l’intégrationdu e-learning.➤ Un projet pour l’outre-mer :projet de loi d’orientation pour l’outremerSecrétariat d’État à l’outre-merParis : Secrétariat d’État à l’outre-mer, avril<strong>2000</strong>, 65 p.Après une présentation de la situationéconomique et sociale des DOM-TOM, ce document expose les prin-SUPPLÉMENT INFFO FLASH - JANVIER 2001 27