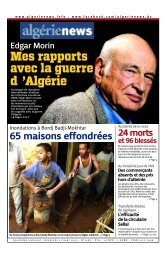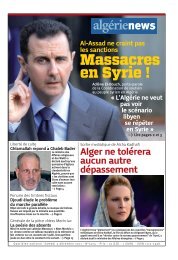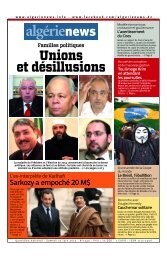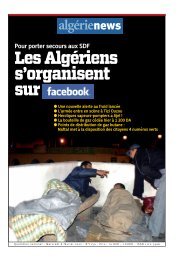Mise en page 1 - Algérie news quotidien national d'information
Mise en page 1 - Algérie news quotidien national d'information
Mise en page 1 - Algérie news quotidien national d'information
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
DébatsSaint Augustin travestiPar Omar MerzougA l'initiative de l'Institutfrançais d'Alger, M.Frédéric Boyer animeune séance sous le titre« Traduire SaintAugustin », le 21septembre à 14h30. Acette occasion, je verseaux débats, cettecritique de sa traductionparue chez POL sous letitre très contesté de« Les aveux ».Après les traductions deR o b e r t A r n a u l dd'Andilly (1649), deLouis Moreau (1840), deP. Janet (1857), aprèsl'intégrale de Poujoulat et de Raulx(1864-73), celle des Etudes augustini<strong>en</strong>nesavec le texte latin <strong>en</strong> regard,n'est-il pas téméraire de livrer aupublic une autre version des« Confessions » ?Alors que l'appr<strong>en</strong>ti latiniste disposedéjà des travaux de P. deLabriolle (1925), de J. Trabucco(1937) et de L. de Mondadon (1947),régulièrem<strong>en</strong>t réédités, une traductionvéritable nouvelle de cet opusmajeur d'Augustin suppose qu'on aitdécouvert des manuscrits inédits,qu'on puisse rétablir l'intégralitéd'une œuvre fragm<strong>en</strong>taire ou mutilée,ou <strong>en</strong>fin que des chercheurs ai<strong>en</strong>ttotalem<strong>en</strong>t révolutionné l'interprétationde l'augustinisme. Ri<strong>en</strong> de tel nes'étant produit, on est <strong>en</strong> droit de sedemander quelle urg<strong>en</strong>ce commandaitl'<strong>en</strong>treprise de Frédéric Boyer, dixIl faut être remarquablem<strong>en</strong>t sûr deson tal<strong>en</strong>t pour oser r<strong>en</strong>ommer untexte dont l'intitulé classique gardetoute sa pertin<strong>en</strong>ce.ans après celle de la bibliothèque de laPléiade (éditions Gallimard) qui sejustifiait dans la mesure où elle mettaità la portée du lecteur, outre « Lesconfessions », d'autres textes del'évêque de Annaba, difficilem<strong>en</strong>taccessibles. Dans ces conditions, dequelle originalité exciperait-on ?Comm<strong>en</strong>t prét<strong>en</strong>dre apporter dunouveau ?Il faut être remarquablem<strong>en</strong>t sûrde son tal<strong>en</strong>t pour oser r<strong>en</strong>ommer untexte dont l'intitulé classique gardetoute sa pertin<strong>en</strong>ce. « Autant quepossible, j'ai évité l'usage des motsconfession et confesser, j'ai préféréaveu, avouer, confier à, se confier à.L'idée est moins de déconfessionnaliserl'œuvre d'Augustin que de faireviol<strong>en</strong>ce aux traditions de sa réception.D'extraire l'œuvre de son langagereçu », précise Frédéric Boyer.S'il est parfois tout à fait fondé debousculer la tradition, de rénover desusages sclérosés, les argum<strong>en</strong>ts invoquéspour justifier ce titre nouveaun'emport<strong>en</strong>t guère la conviction.Le moy<strong>en</strong> de se sortir d'embarrasquand on doit distinguer les nuancesdes mots est consulter les bons dictionnaires.On trouvera dans«Littré», que le terme d'«aveu» « s’appliqueà tout ce qu'on avait le desseinde cacher, bon ou mauvais », et que la« confession ne s'applique qu'au mal,à un tort, à un méchef ». Si on veutbi<strong>en</strong> se reporter au texte d'Augustin,on constatera que tel est bi<strong>en</strong> le cas.Non seulem<strong>en</strong>t Augustin ne se cachaitpas de ses « péchés », mais il s'<strong>en</strong> faisaitgloire. Il <strong>en</strong> tirait fierté et<strong>en</strong> faisait assomption. L'aveune s'accompagne pas derep<strong>en</strong>tir, mais une confessionsans rep<strong>en</strong>tir n'<strong>en</strong> est pas une.Au reste, on n'avoue que sousla contrainte, tout au moinssous influ<strong>en</strong>ce et devant autorité,alors que la confession estspontanée et relève de la seuleconsci<strong>en</strong>ce du sujet. Le termed'« aveu » appelle donc la questionquand celui de « confession » supposel'exercice d'une liberté. C'est pourquoil'on dit fort justem<strong>en</strong>t «arracher ou extorquer des aveux »,mais non des confessions. En écrivantson ouvrage, Augustin n'a subiaucune c<strong>en</strong>sure, ni déféré à l'att<strong>en</strong>ted'aucune autorité. En optant pour letitre « Les aveux », ce n'est pas à la traditionque F. Boyer fait viol<strong>en</strong>cecomme il le croit, mais aux subtilitésde la langue française. Si aucun de sesprédécesseurs ne s'est rallié à«Aveux», ce n'est pas faute d'y avoirsongé, mais parce que de puissantesraisons s'y opposai<strong>en</strong>t.Le mot de « confessions » égare lescontemporains. L'évêque de Annabane raconte pas l'odyssée d'une âmelivrée à ses p<strong>en</strong>chants, à la concupisc<strong>en</strong>ceet qui y tombe de Charybde <strong>en</strong>Scylla. Croire que les confessions del'anci<strong>en</strong> maniché<strong>en</strong> « institu<strong>en</strong>t unepratique d'écriture sur soi », c'estconfondre Augustin avec Jean-JacquesRousseau. Abusé par l'<strong>en</strong>gouem<strong>en</strong>tactuel sur les écritures du Moi,Frédéric Boyer ne voit pas que le rhéteuralgéri<strong>en</strong> ne s'analyse pas pours'ét<strong>en</strong>dre complaisamm<strong>en</strong>t sur sesvil<strong>en</strong>ies. Il ne se propose pas de livrerà la curiosité du lecteur des indiscrétionssur son passé, de le régaler duremugle de son « misérable tas desecrets ». Il est capital que le lecteurd'aujourd'hui compr<strong>en</strong>ne qu'il n'estpas question dans « Les confessions »d'introspection psychologique, maisd'édification ; ce qui importe plus quetout, c'est d'attester la grandeur et lamiséricorde de Dieu. L'une des clefsdes « Confessions » se trouve dans cepassage des « Rétractations » (lib. 2, c6) : « Les treize livres lou<strong>en</strong>t de mesmaux et de mes bi<strong>en</strong>s le Dieu juste etbon, et port<strong>en</strong>t vers Lui l'intellig<strong>en</strong>ceet le cœur de l'homme ». Augustinajoute cette formule qui éclaire tout :« Telle a été du moins leur action surmoi quand je les écrivais, telle elle est<strong>en</strong>core quand je les lis ». Prét<strong>en</strong>dre, àl'instar de Frédéric Boyer, que l'opusd'Augustin r<strong>en</strong>ferme « l'exig<strong>en</strong>ce deformulation d'une vérité sur soi » etqu'il se prés<strong>en</strong>te comme « une inv<strong>en</strong>tionde soi-même à travers les figureslittéraires et religieuses de l'aveu » ressortità une erreur de perspective historique.Il est très fâcheux que la translationsouffre de choix terminologiquesparticulièrem<strong>en</strong>t malheureux. Sansm'appesantir sur les infidélités quivid<strong>en</strong>t le texte de sa substance et lesnombreuses approximations qui <strong>en</strong>grèv<strong>en</strong>t la lisibilité, on peut relever,dès les premières lignes, la confusionde « imm<strong>en</strong>sus » avec « magnus ».C'est dénaturer la phrase « inquietumest cor nostrum, donec requiescat inte » que de la r<strong>en</strong>dre par « notre cœurest las jusqu'à son délassem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> toi»alors qu'elle résume, à elle seule, l'espritdes « Confessions ». En aucunemanière, on ne saurait assimiler « fessus» à « inquietus ». Par ailleurs,interpréter « requiescat » comme undélassem<strong>en</strong>t est inacceptable, ce dernierterme impliquant les valeurs dela distraction et du divertissem<strong>en</strong>t iciparfaitem<strong>en</strong>t intempestifs. La traductionde « misericordia » par « amour» est irrecevable, de « cupiditas » par« <strong>en</strong>vie » est déplacée, de « revolare »par « décoller », dans « Je brûlais de laterre vers toi » (Liv. III, 8), est grotesque.Le lecteur est obligé de consulterl'original latin pour compr<strong>en</strong>dre les<strong>en</strong>s de « je vis mal de moi » (liv. XII,10) qui, <strong>en</strong> français, ne signifie ri<strong>en</strong>.Le traducteur ne respecte pas plus lesfractures et les continuités de la proseaugustini<strong>en</strong>ne qu'il ne r<strong>en</strong>d comptedes vibrations. Pis, il <strong>en</strong> désarticule lespériodes, se révèle sourd à leurs subtilitéset <strong>en</strong> méconnaît le ferme propos.Cet ouvrage, « Les confessions »,qui a eu une influ<strong>en</strong>ce décisive <strong>en</strong>Occid<strong>en</strong>t, méritait assurém<strong>en</strong>t unmeilleur sort. Etait-il chimériqued'exiger une version qui alliât l'exactitudeà la clarté, l'élégance à la fidélité?Pour ce faire, Boyer aurait pu s'inspirerde ses devanciers qui avai<strong>en</strong>taplani le terrain et démêlé les difficultés.Il a choisi de les ignorer, de fairecomme s'il représ<strong>en</strong>tait un comm<strong>en</strong>cem<strong>en</strong>tabsolu <strong>en</strong> vertu de cette détestablearrogance si représ<strong>en</strong>tative dumilieu littéraire parisi<strong>en</strong>. Positiond'autant plus absurde que le texted'Augustin est historiquem<strong>en</strong>t situé.Il suffit pour s'<strong>en</strong> r<strong>en</strong>dre compte depr<strong>en</strong>dre connaissance de l'essaid'H<strong>en</strong>ri-Irénée Marrou, « SaintAugustin et la fin de la cultureantique». Mais s'agissait-il vraim<strong>en</strong>tde donner à lire Augustin ? Le registrede langue d'un relâchem<strong>en</strong>t étonnant,la parataxe qui hache les phrases, leton « branché » font soupçonner qu'iln'<strong>en</strong> est ri<strong>en</strong>. Le ratage était donc prévisibleet il est regrettable qu'il ne sesoit trouvé aucun conseiller charitablepour dissuader Boyer de courir àla débâcle.