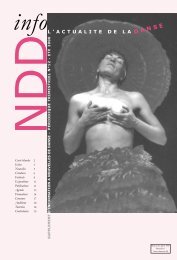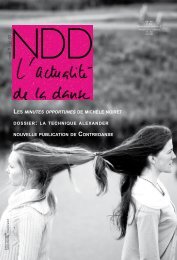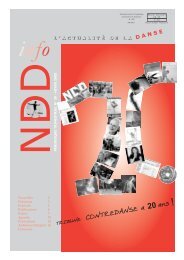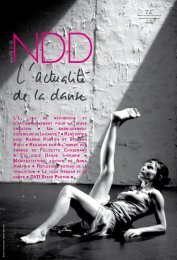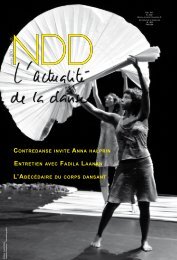27222 ko - Contredanse
27222 ko - Contredanse
27222 ko - Contredanse
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RECHERCHEÊt r e d o c t o r a n t e n d a n s e e n Be l g i q u eLe 16 mai dernier, se déroulait au Centrenational de la danse à Pantin le troisième«atelier des doctorants». Cesjournées consacrées aux chercheursen danse inscrits dans un parcoursuniversitaire leur offrent la possibilité,une fois par an, de se rencontrer et deparler de leur recherche dans un espritd’échange et de questionnement sur laméthodologie et les objectifs poursuivis.Cette heureuse initiative témoigne d’unengouement actuel pour la rechercheen danse. Nous avons voulu par leprésent dossier non seulement luifaire écho mais aussi la prolonger ense penchant plus spécifiquement surce qui se passe du côté des universitébelges.Mais revenons d’abord brièvement surcette journée parisienne pour nousdonner une petite idée de la situationinternationale. Lors des différentesinterventions faites par des doctorants etdes professeurs chevronnés, plusieurschoses sont apparues. D’abord le faitque les chercheurs en danse travaillentdans des départements et filières trèsvariés. Ceci a pour conséquence deles isoler, d’où l’intérêt de ce genrede manifestation. Ceci étant, cettedissémination a aussi un pendantpositif: elle est signe que la danse nese laisse pas facilement enfermer dansun cursus type et qu’elle multiplie lesapproches méthodologiques, ce quine fait qu’enrichir son étude. SusanManning, invitée pour témoigner dela situation doctorale aux États-Unissaluait cela comme une richesse quiinversement, montre aussi les multiplesintérêts que la danse recoupe. LesÉtats-Unis sont sans conteste lepays pionnier en matière de danse àl’université. La danse y a ses propresdépartements depuis l’entre-deuxguerres(on compte plus de 300départements danse dans ce pays, auniveau du BA 1 ), mais ce n’est pas pourautant que la recherche s’y cantonne.Rares en effet sont les universités quioffrent un parcours spécifiquementdanse jusqu’au doctorat. La plupartdes chercheurs travaillent donc dansdes départements parallèles tels quecelui des Arts du spectacle. Une autrecaractéristique des États-Unis, estl’existence de sociétés privées telles quela SDHS 2 et le CORD 3 qui encouragentla recherche. En Europe, ces sociétésexistent aussi en Scandinavie, enAllemagne ou en Grande Bretagne.Quant aux cursus spécifiquementdanse (que ce soit au niveau du BA etMA 4 ), ils se développent à des rythmesdifférents suivant les pays. Le plus prèsde chez nous à proposer un parcourscomplet allant du BA jusqu’au doctoratest celui organisé par l’Université deNice, mentionnée plusieurs fois ciaprès.Qu’en est-il donc de la situation dansles universités belges? Chez nous,que ce soit du côté néerlandophone oufrancophone, aucun cursus spécifiquementdanse n’existe pour le moment.Néanmoins, force est de constater quechaque année de nombreux étudiantsréalisent un mémoire portant d’unemanière ou d’une autre sur la danse(qu’ils soient inscrits en journalismeet communication, en histoire de l’art,en kinésithérapie, en éducation physique,en histoire, en philosophie ou enanthropologie). Et plus loin, des doctorantschoisissent la danse pour sujet dethèse.Première chose à dire: ils ne sontpas faciles à trouver. Nous en avonsdébusqué quelques-uns et avonsdemandé à quatre d’entre eux, liés àdifférentes universités et à des stadesdifférents de recherche, de nous raconterleur parcours. Ils témoignent, commeailleurs dans le monde, de la diversitéd’approches et de motivations liées à larecherche en danse. Un point commun,néanmoins: la recherche universitaireest pour chacun d’eux une manièred’articuler différents centres intérêtset d’activités comme l’enseignement,l’investigation, l’écriture et la pratiqueartistique. Nous avons essayé de savoiraussi quelle était la place relative de lapratique et de la théorie pour chacund’eux de même que leur orientationméthodologique. Ici aussi, les réponsesvarient. Deux des chercheurs interrogéssont praticiennes, une autre a dansépassionnément pendant son enfanceet son adolescence, et le quatrième n’ajamais pratiqué la danse. Nous pensonsque ces différents positionnementpar rapport à la pratique constituentune des clés pour comprendre lesdifférentes méthodologies mises enplace par chacun d’eux. Enfin, chacunnous a également confié ce que luiapporte le cadre universitaire et ce dontil fait défaut dans la poursuite de leurrecherche. Il s’avère ici que l’universitéfournit bien sûr le cadre matériel etle support financier dans le cas desboursiers (ce qui est le cas pour troisd’entre eux), mais pas seulement. Elleoffre aussi visiblement un cadre deréflexion et d’échanges de même qu’uncadre méthodologique (l’approchescientifique) qui pour certains s’avèred’avantage être source de liberté quede contrainte alors que pour d’autresil oblige à terme à sacrifier sa libertéindividuelle. En ce qui concerne laquasi absence de la danse (tant auniveau pratique que théorique) dans lescursus universitaires belges, si elle estregrettée par certains, elle ne semblepas avoir été un obstacle majeur pourles chercheurs interrogés. Chacun ayantdéveloppé ses propres stratégies pourla combler, cela lui assure égalementun gage de liberté.Nous sommes évidemment bienconscients que l’université n’est pas leseul lieu où peut s’épanouir la rechercheen danse. Un chorégraphe en créationn’est-il pas déjà un chercheur? Lesnombreux laboratoires proposés pardes chorégraphes et pédagogues sansdoute également. Sans oublier lesstructures alternatives comme SARMA 5 ,les werkplaatsen ou <strong>Contredanse</strong>qui soutiennent et encourage, d’unemanière ou d’une autre la recherche etsur lesquelles il serait un jour opportunde revenir CDP1. BA: grade de Bachelor, soit trois ans d’études universitaire, correspondant au premier cycle2 . SDHS (Society of Dance History Scholars): société américaine fondée en 1978 qui promeut le champdes études en danse par le biais de publications (Studies in Dance History), de performances et deconférences. Elle décerne aussi chaque année des prix saluant les travaux de recherche remarquables.Elle compte des membres individuels – chercheurs indépendants ou liés à des universités – et desassociations.3.CORD (Congres on Research in Dance): cette autre association américaine encourage également larecherche en danse toutes disciplines confondues par l’organisation d’un colloque international annuel etpar la publication (The Dance Reasearch Journal).4.MA: grade de Master, soit deux ans d’études universitaires correspondant au deuxième cycle.5. SARMA est une projet initié par Myriam Van Imschoot en 2000. Il s’agit d’une base de donnée, un lieud’archive, et d’une plate forme d’échange en ligne. Le but est notamment de donner une nouvelle vie à destextes de chercheurs, critiques et performeurs.Écorces et corps #1 © Anouk MeurrensLa r e c h e r c h e u n i v e r s i ta i r e: u n m o y e n p o u r m i e ux c o m p r e n d r e s a p r at i q u eD’après un entretien avec Marian Del Vallechorégraphe et aspirante au doctorat.Tu viens de terminer le Master enArts du spectacle à l’Université Librede Bruxelles (U.L.B.) dans l’optiquede faire un doctorat. Peux-tu nousdire d’où t’es venu ce désir?Depuis plus d’une dizaine d’années j’ail’envie de faire un doctorat, de menerune recherche approfondie sur uneproblématique liée à la création chorégraphiquecontemporaine. J’ai faitdes études de langue et linguistique àl’U.L.B. avant de me consacrer principalementà la création chorégraphiqueet à la recherche pédagogique. Je voisaujourd’hui le doctorat comme une manièrede combiner différentes expériencesqui m’intéressent et ont jalonné monparcours: la création chorégraphique, larecherche pédagogique et la rechercheacadémique. Il m’a fallu quelques annéesavant de me décider à entreprendreles démarches nécessaires afin deréaliser ce désir. Lorsque j’ai appris quel’U.L.B. proposait un Master en Arts duspectacle, avec la possibilité de suivredes cours dans plusieurs universitéseuropéennes, j’ai vu là une opportunitépour moi de joindre mon parcours dedanse à des études universitaires etd’ainsi commencer les préparatifs dudoctorat.En quoi consistait cette formation?J’ai choisi de faire la formation en un an,ce qu’on appelle le Master accès direct,et suivi l’option «finalité européennespectacle vivant». Le premier semestres’est déroulé à Bruxelles, où j’ai suivides cours de gestion culturelle, desémiologie du théâtre et un cours plusgénéral appelé «l’œuvre dramatique,sa structure et sa représentation».Ensuite, un stage intensif de deuxsemaines qui s’est déroulé à Séville oùdes ateliers pratiques alternaient avecdes cours théoriques. J’ai passé ledeuxième semestre à Paris VIII, où j’aisuivi un séminaire d’ethnoscénologie,une nouvelle discipline intéressante, unséminaire d’esthétique et un séminairesur l’image du corps. Ce dernier a étéle seul cours suivi pendant toute laformation ayant un rapport direct avecla danse.Que t’a apporté cette formation?D’abord la découverte de différentesperspectives disciplinaires ayant pourobjet d’étude les arts du spectacle.Et puis l’occasion de rencontrer deschercheurs-pédagogues qui ontconsacré une bonne partie de leur vieà la recherche dans le domaine desarts vivants, qu’ils soient sémiologues,anthropologues, ethnomusicologuesou autres.Quelles critiques pourrais-tu luifaire?J’aurais aimé avoir l’occasion de plusd’échange avec les autres étudiants etles professeurs. Je trouve aussi quepeu de place était faite au point de vuedes praticiens sur leur propre métier.En outre, la plupart des enseignantsétant prioritairement intéressés parle théâtre, la danse a été presqueabsente de la formation (sauf quelquesdonnées de référence très générales).Une autre chose qui m’a étonnée, c’estle peu de place accordée à l’expériencepratique.Comment se faisait l’articulationthéorie-pratique justement?Pendant la formation que j’ai suivie,le seul moment où la pratique a euun rôle important, c’était pendant lesdeux semaines du stage à Séville.Ensuite, la pratique n’est intervenueque dans le cadre du mémoire de find’études. La section Arts du spectacleoffre en effet le choix entre un mémoirethéorique ou une recherche pratique (lemémoire projet). J’ai choisi un travailen deux temps: d’abord l’élaborationd’un projet artistique et ensuite uneétude plus théorique sur l’expérience.Cependant, malgré la possibilité de15