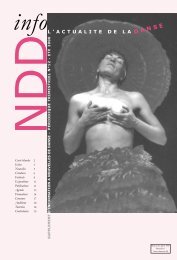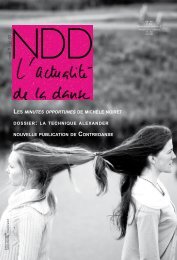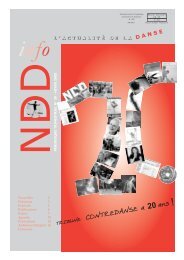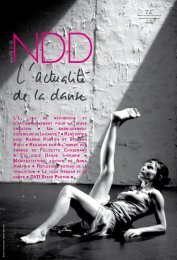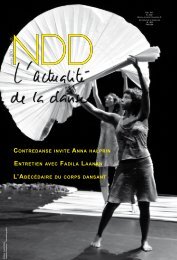27222 ko - Contredanse
27222 ko - Contredanse
27222 ko - Contredanse
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PUBLICATIONSLivresChantal Aubry, Yano, un artiste japonaisà Paris, Coll. Parcours d’artistes,Centre national de la danse,Paris 2008, 380 p.L’auteure livre un portrait extrêmementriche de cet artiste japonais doté d’unepersonnalité complexe, à la croisée dela culture occidentale, qu’il a parfaitementintégrée sous certains aspects, etde la culture orientale, qu’il n’a jamais reniée.Et la fascination ou l’interrogationque Hideyuki Yano a suscitée dans unParis en plein japonisme, à son arrivée,comme le suggère le titre de l’ouvrage,aura certes contribué au mystèrequi l’entoure encore aujourd’hui. C’estd’ailleurs cette place singulière dansle paysage de la danse française queChantal Aubry s’attache à cerner. Touten mettant à mal certains amalgamesqui ont été faits sur l’œuvre de Yano etsur la culture japonaise. Pour ce faire,la journaliste a réalisé un formidabletravail de recherche historique, esthétique,philosophique et anthropologique.Si les premières pièces de Yano crééesau Japon sont ainsi replacées dans lescontextes politique et esthétique, quiles ont vu naître, intimement liés commeon le sait pour le butoh, le rapportdu danseur avec cette danse des ténèbresn’est pas celui que l’on pourraitcroire. Avec cette même volonté de distinguerle vrai du faux, Chantal Aubrycerne l’essence des premières piècesparisiennes, détachées de ce japonismequi a parfois déformé leur propos,voire leur nature. Nô, Bunraku, dansecontemporaine, exotique…, commentcerner une œuvre aussi complexe quecelle de son danseur/chorégraphe.Pour ce faire, Chantal Aubry s’attache àla relation que Yano entretenait avec laculture occidentale et avec celle de sonpays d’origine, fortement marquée parune éducation rigide et l’absence d’unemère. Puis, dans les années septante,c’est la rencontre avec Elsa Wolliaston,la «sœur» africaine, et la fondation dugroupe Mâ avec deux autres danseusesd’exception (Lila Greene, SidonieRochon) et avec lequel Yano élaboredes œuvres à la croisée de l’Orient et del’Occident et dont on avait peu jusqu’icimesuré l’influence. À cette époque, lapresse est avec lui et un certain milieuaussi. Mais l’aventure de ce Mâ originelsera de courte durée et Yano ne serapas suffisamment soutenu par la suite,à un moment où d’autres se voient déjàconfier la direction d’un centre chorégraphique.Pourquoi? Chantal Aubryesquisse des réponses avant d’aborderla seconde partie du parcours de Yano,celle des années 80, pendant laquelleil fréquente davantage la jeune dansefrançaise. Entrée dans l’esprit du Nô,dans trois pièces maîtresses décortiquéeset illustrées par les croquis duchorégraphe. La genèse poussée despièces et du travail à l’œuvre met enévidence le rapport à la lenteur, à l’espace,la préoccupation du sens et dugeste… car Yano était avide de recherche.Période empreinte aussi de spiritualité,voire de mysticisme avec cettenouvelle fascination pour la mort ettoujours ce caractère rituel. Yano étaitaussi pédagogue et, à ce titre, il auramarqué les mémoires. Dans le sillagedes «morts trop jeunes», Yano (1988)a laissé un espace ouvert et éphémèrequi n’autorise pas à parler d’héritage.Ni maître ou plutôt «non» maître, sanshéritier, même si certains chorégraphescomme Françoise Verret ou Karine Saportase sentent marqués par son empreinte,Yano est néanmoins devenu unmythe. Quant à son oeuvre, elle se voitrattachée, à la lumière de cette recherche,«à la voie spiritualiste de la dansecontemporaine, dans une certaine formed’ésotérisme chrétien». Richementdocumenté, cet ouvrage illustré de photosnoir et blanc et de croquis inédit, esttout simplement passionnant. BMStephanie Jordan, Stravinsky Dances.Re-Visions across a Century, DanceBooks, Hampshire, 2007, 603 p.Stravinsky est depuis longtemps considérécomme le «numéro un» des compositeursde ballets au XX e siècle. Parle nombre de ses compositions destinéesà la scène (dix-huit au total), leurqualité (chacune est un moment importantde l’histoire de la musique) etaussi par la fréquence de leur utilisationpar plusieurs générations de chorégraphes.Ce livre est issu d’un travailremarquable entrepris bien en amont:la réalisation d’une base de donnéesStravinsky. The Global Dancer, sous ladirection de l’auteure à l’Université deRoehampton (http://www.roehampton.ac.uk/stravinsky). Cette base de donnéesvise à recenser et référencer toutesles chorégraphies réalisées dansle monde entier sur les musiques ducompositeur russe. Elle en dénombreactuellement plus de mille deux cents.Ce travail a donc fourni une matièresubstantielle alimentant l’affirmation devenuelapalissade de la suprématie ducompositeur dans le monde chorégraphique.Avec cette publication, l’auteurepousse plus loin l’investigation desaffinités entre la musique de Stravinskyet la danse. Elle se penche bien sûr surdeux des plus fameuses collaborationsde l’histoire de la danse comme de lamusique: celles de Stravinsky avecDiaghilev et avec Balanchine, et tented’en dégager les parts de mythes et lesréels intérêts. Sans oublier une troisièmefigure, un peu moins connue: celledu chorégraphe Frederick Ashton qui,s’il n’a chorégraphié que quatre compositionsdu Russe, l’a fait de manière siatypique qu’elles valent la peine d’êtreétudiées en détail. à côté de l’étude deces collaborations de long terme, ellepropose également une étude comparativede différentes versions des deuxpièces qui ont sans aucun doute le plusfasciné les chorégraphes: le Sacre duPrintemps et les Noces. Elles sont l’occasionde visiter l’histoire de la danseoccidentale dans toute sa diversité:de Jérôme Robbins à Anne Teresa DeKeersmaeker, et de Paul Taylor à PinaBausch. Ses analyses reposent essentiellementsur les principes de l’analysemusicale et mettent en regard, de manièretrès détaillée, composition chorégraphiqueet partition musicale. Ainsi,l’auteure se sert de la notion de parallélismeet de contrepoint entre musiqueet danse pour analyser les processusstructurels d’organisation du tempset de l’espace. Ces analyses font évidemmentapparaître les spécificitésdes différentes approches chorégraphiquesmais aussi le potentiel contenudans une seule partition. Non moinsintéressante est la question posée parl’auteure de la transformation de la musiquepar la chorégraphie: comment lavision de différents mouvements et misesen scène peuvent faire percevoir lamusique différemment. Et de poursuivreune réflexion sur l’interdépendancedes formes d’expression, du voir et del’entendre. Comme on le voit, ce livrecombine des modes d’approche analytiques,historiques, esthétiques etpsychologiques. Il est sans contesteune somme sur l’étude des œuvreschorégraphiques de Stravinsky maisaussi un modèle pertinent pour qui s’intéresseaux rapports entre musique etchorégraphie. CDPDominique Dupuy, Danse contemporaine,pratique et théorie, Marsyas,écrits pour la danse, Images EnManœuvres éditions & Le Mas de laDanse, Avignon, 2007, 207 p.Alors que le Mas de la Danse a ferméses portes, son cogéniteur livre l’intégralitédes textes qu’il a écrits pour la revueMarsyas, alors qu’il était en missionpour l’Institut de pédagogie musicale etchorégraphique. Véritable témoignagesur le développement de la rechercheen danse entre 1991 et 1995, l’ouvrageest aussi un témoignage du développementde l’art chorégraphique en France,pendant les années 80-90. Un parcoursquasi historique, mais dont l’auteur nesuit pas la chronologie, préférant inviterle lecteur à y déambuler au gré deses intérêts ou de ses humeurs. Ainsi,le premier chapitre rassemble les textesd’introduction aux dossiers thématiquesde la revue Marsyas qui, faut-il lerappeler est une référence dans le domainede la pédagogie chorégraphiqueet musicale. L’interprétation, le souffle,le corps, autant de textes qui traduisentl’immense culture de Dominique Dupuy,comme le souligne Laurence Louppedans la préface, ainsi que ses qualitésd’auteur. Un auteur qui a par ailleurslargement contribué au développementde l’écriture de la danse. Références,le second chapitre, ouvre ainsi la voieà des écrits sur des textes emblématiquescomme L’âme de la danse dePaul Valéry. Le troisième, Chroniques,propose comptes-rendus et analysescritiques de rencontres, colloques, expositions,publications diverses. Rendantcompte, par exemple, du premiernuméro des Nouvelles de danse et deMouvement, et d’ouvrages de référencecomme à la recherche d’une dansemoderne d’Isabelle Launay. Quant auxcolloques, Dominique Dupuy et sondouble Françoise en ont eux-mêmesorganisés, à l’image de Autres pas en1992, dont le leitmotiv était de mêlerrecherches théoriques et ateliers. à liredonc comme «en marchant». BMThe body eclectic. Evolving Practicesin Dance Training, Edited byMelanie Bales and Rebecca Nettl-Fiol,University of Illinois Press, 2008,264 p.L’entraînement du danseur contemporaina considérablement évolué aucours du siècle dernier. C’est autour dece constat que cette publication collectiveest construite. Les auteurs situentle tournant majeur de cette évolutionà l’époque de la Judson Church, dansles années 1960. Deux attitudes fondamentalesguident à ce moment lesdanseurs et chorégraphes: «la déconstruction»et «le bricolage». Déconstructiondes techniques apprises: toutentraînement passe d’abord par unephase de «désentraînement» ou «désapprentissage»des habitudes et desschémas de mouvements reçus, et viseà retrouver les bases plus essentiellesdu mouvement. Le bricolage quant àlui – qui rejoint l’idée d’éclectisme et ducorps éclectique – se situe au niveaude la multiplicité de choix que chaquedanseur peut/doit faire au cours de saformation. Et ceci pointe une caractéristiqueimportante de l’entraînementdu danseur contemporain: l’autonomie.Le chorégraphe n’est plus celui qui entraînele danseur. Celui-ci doit la plupartdu temps venir échauffé aux répétitionset nourrir la création de son propre matérielde mouvement. Ce que l’on demandeau danseur aujourd’hui consistedonc avant tout à apprendre à devenirlui-même. Et ce notamment par leschoix qu’il fait au niveau de son entraînement.L’éclectisme propre à l’entraînementPost-Judson, comme le qualifientles auteurs est aussi le résultat dela prise de conscience de la nécessité,pour un danseur, de rester ouvert à tousles possibles. à ce niveau, l’entrée despratiques somatiques (Alexander, Body-mindCentering, Feldenkrais, Yoga,Release...) dans la diversité des techniquesà explorer est une donnée essentiellede l’évolution de la formationet de l’entraînement. Ces pratiques demouvement alternatives et de connaissancede soi sont elle-mêmes des méthodesaidant les danseurs à inventerde nouveaux codes et vocabulaires demouvement, qui est une quête permanentede la danse contemporaine. Cepoint vient d’ailleurs souligner un desobjectifs de cette publication: montrerles liens étroits entre formation, entraînementet création. Faisant suite àune dizaine d’articles théoriques, seizeparcours-témoignages sous forme d’interviewsde danseurs américains, telsque Chris Aiken, Janet Panetta ou TereO’Connor, étoffent le propos. Ils donnentainsi vie et chair à ce livre pertinent.CDPDictionnaire de la danse (nouvelle édition),sous la direction de Philippe LeMoal, Larousse, Paris, 2008, 840 p.Parue en 1999, la première édition duseul dictionnaire de synthèse en françaissur la danse était épuisée. De nombreuxamateurs, étudiants, chercheursattendaient sa réédition. C’est chosefaite cette année avec de nombreusesmises à jour. Afin de suivre l’actualitéde la scène chorégraphique en perpétuelmouvement et l’avancée en matièrede recherche, le dictionnaire s’esten effet enrichi de nouvelles entrées eta actualisé les anciennes. Nous avonsainsi repéré le nom du jeune chorégrapheflamand Sidi Larbi Cherkaoui dansla partie Le monde de la danse ou leterme «Interactivité» dans celle consacréeaux «mots de la danse», inexistantsdans la première édition. Certainsarticles ont aussi été complètementrefondus, comme par exemple celuiconsacré à la clog dance, témoignantvraisemblablement de nouvelles recherchesen la matière. Ces exemplesrappellent aussi l’étendue des champsliés à la danse que recouvre l’ouvrage.Oeuvre d’une centaine de collaborateursfrançais et internationaux, il pourradonc à nouveau servir d’outil simpleet efficace à tous ceux qui s’intéressentde près ou de loin à la danse. CDP21