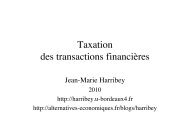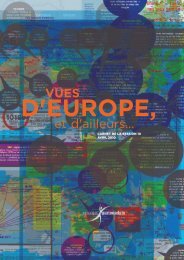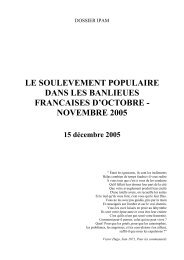Anne-Christine Habbard « De l'illégitimité de la frontière ou ... - Ipam
Anne-Christine Habbard « De l'illégitimité de la frontière ou ... - Ipam
Anne-Christine Habbard « De l'illégitimité de la frontière ou ... - Ipam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
originelle cohérente suppose donc d’être globale, puisque <strong>la</strong> justice distributive, etle principe <strong>de</strong> différence, ne peuvent qu’être v<strong>ou</strong>lus « globalement » : en tant quepersonne libre, rationnelle, et égale aux autres, s<strong>ou</strong>s le voile d’ignorance,j’adopterais un principe <strong>de</strong> différence élevé à l’échelle internationale, au cas où,manque <strong>de</strong> bol, je me retr<strong>ou</strong>ve citoyen bh<strong>ou</strong>tanais et non koweitien en levant levoile. Rawls c<strong>ou</strong>nt<strong>ou</strong>rne <strong>la</strong> difficulté en supposant les Etats autarciques et autosuffisants– mais cette position n’est tenable ni théoriquement ni factuellement.Dès lors, <strong>la</strong> coopération internationale ne saurait être fondée sur un <strong>de</strong>voir <strong>de</strong>charité, mais bien sur une obligation <strong>de</strong> justice : ce qui ne peut être le cas sil’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice distributive <strong>de</strong>meure du domaine réservé <strong>de</strong>s Etatsnations; elle exige une compétence internationale contraignante. Ainsi, uneinstitution juridico-politique cosmopolite est appelée par <strong>la</strong> notion même <strong>de</strong>justice. Il est rationnellement plus cohérent <strong>de</strong> penser à <strong>la</strong> justice politique àl’échelle mondiale plutôt qu’à l’échelle nationale.Rationnellement donc, les arguments en faveur d’une telle institution sont probants. End'autres termes, une théorie normative <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice doit être globale et internationale avantque d’être domestique ; sinon, elle <strong>de</strong>vrait être précédée par une justification <strong>de</strong> <strong>la</strong> domesticité<strong>de</strong> <strong>la</strong> justice. Or il en est t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs allé à l’inverse : on commence par définir <strong>la</strong> justicedomestique, avant <strong>de</strong> passer à <strong>la</strong> justice internationale. « Aye, theres the rub » : car dans cetteséquence-là, <strong>la</strong> justice internationale ne peut plus guère être pensée qu’en termes <strong>de</strong> règles <strong>de</strong>c<strong>ou</strong>rtoisie internationale entre personnes étatiques libres et égales.42. Le naturalisme au fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> <strong>la</strong> frontière nationale (réfutation <strong>de</strong>s argumentsà l’encontre <strong>de</strong> l’Etat mondial)Notre question est donc : p<strong>ou</strong>rquoi pas un contrat social mondial ? P<strong>ou</strong>rquoi penser,lorsque les hommes déci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> sortir <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> nature p<strong>ou</strong>r construire une communautépolitique, qu’ils choisiraient d’en former plusieurs plutôt qu’une seule ? La raison p<strong>ou</strong>r<strong>la</strong>quelle on a accordé une prééminence théorique à l’Etat n’est-elle pas liée au simple faitnaturel <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong> gr<strong>ou</strong>pes « ethnico-culturels » pré-existants ? Le fait <strong>de</strong> <strong>la</strong>communauté restreinte, unie aut<strong>ou</strong>r <strong>de</strong> traditions, <strong>de</strong> valeurs, <strong>de</strong> traits cultures et linguistiquesetc… communs n’a-t-il pas pesé sur notre décision théorique <strong>de</strong> leur accor<strong>de</strong>r une réalitééthique singulière ? Il s’agirait d’une espèce <strong>de</strong> pré-notion : on tient p<strong>ou</strong>r acquisel’appartenance à une communauté d’ordre national, à <strong>la</strong>quelle on accor<strong>de</strong> un statutontologique. Evi<strong>de</strong>nce dont on se <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s’il n’y a pas lieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> remettre en question,singulièrement auj<strong>ou</strong>rd'hui.Si l’on passe en revue les arguments avancés en faveur <strong>de</strong> <strong>la</strong> séparation <strong>de</strong>s Etats, onconstate qu’ils restent insatisfaisants rationnellement, et qu’ils <strong>de</strong>meurent finalementsuspendus à une donnée naturelle intuitivement appréhendée comme inéliminable – <strong>la</strong>sé<strong>de</strong>ntarité –, et donc à un regr<strong>ou</strong>pement jugé inéluctable <strong>de</strong>s personnes en collectivitésdistinctes, partageant un certain <strong>de</strong> nombre <strong>de</strong> traits communs jugés essentiels. Répétons-le, ilne s’agit pas p<strong>ou</strong>r n<strong>ou</strong>s <strong>de</strong> nier l’existence <strong>de</strong> fait <strong>de</strong> telles collectivités, mais d’en évaluer <strong>la</strong>rationalité normative.Les arguments à l’encontre d’un Etat mondial : a) l’impossibilité intrinsèque <strong>de</strong> <strong>la</strong>communauté politique à accueillir <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong> l’humanité et b) une théorisation <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tionsinternationales qui rendrait impossible l’établissement d’une institution cosmopolitique.Considérons les en effet :