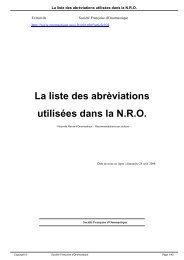Nouvelle Revue d’Onomastique n° 49-50 – 2008propositions hasar<strong>de</strong>u<strong>ses</strong> <strong>et</strong> reconnaît sans hésitation que bon nombre <strong>de</strong> toponymes – <strong>et</strong>notamment les plus anciens, incontestablement ou probablement d’origine préromaine – résistent àl’analyse ; la majorité <strong>de</strong>s formations appartenant aux couches les plus anciennes ainsi qu’uncertain nombre d’autres, sans doute plus récentes, ont ainsi été qualifiées comme étant « d’origineobscure » (cf. p. ex. Allamps [71], Baccarat [81], Bas<strong>lieux</strong> [86], Brin-sur-Seille [105], <strong>et</strong>c.), neserait-ce que parce que l’état actuel <strong>de</strong> la recherche ne perm<strong>et</strong> pas encore <strong>de</strong> les expliquer <strong>de</strong> façonconcluante <strong>et</strong> nécessiterait <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cas longues <strong>et</strong> fastidieu<strong>ses</strong>.Quelques incohérences sont malheureusement à déplorer dans le traitement <strong>de</strong>s toponymesen -ville, -court, -villers, -ménil, <strong>et</strong>c., contenant comme premiers éléments <strong>de</strong>s anthroponymesd’origine germanique. Ce type <strong>de</strong> formations a pour ainsi dire toujours été doté d’une propositionétymologique, mais non seulement, l’antéposition <strong>de</strong> l’épithète est encore attribuée à l’influencegermanique [33] alors que l’intervention du superstrat proprement dit dans la genèse <strong>de</strong> ces formesa été fortement mise en doute durant ces <strong>de</strong>rnières années 15 ; le déterminant est aussi – à juste titre– relié au déterminé par une voyelle <strong>de</strong> liaison correspondant à un cas oblique roman, largementjustifié par la datation tardive <strong>de</strong> ces formations (VI e -IX e /X e s.) 16 . On ne comprend donc paspourquoi ce déterminé est systématiquement indiqué au nominatif latin (p. ex. *Angoino monspour Angomont [73], *Bernardo vicus pour Bénaménil [91], *Bertramno boscus pour Bertrambois[93], *Bertrīko campus pour Bertrichamps [93], *Bertramno mansus pour Bertrameix [93], <strong>et</strong>c.),alors qu’on s’attendrait à une forme romane issue <strong>de</strong> l’accusatif. Le traitement <strong>de</strong>s anthroponymesgermaniques romanisés, pour lesquels l’auteur, qui suit ici une tendance très répandue enlinguistique romane, se contente <strong>de</strong> chercher dans les dictionnaires <strong>de</strong> référence <strong>de</strong>s formesattestées correspondant phonétiquement aux besoins <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>, peut aussi poser <strong>de</strong>s problèmes :on ne comprend pas, p. ex., pourquoi le NP Albald rentrant dans la formation du toponymeAbaucourt [67] a été qualifié <strong>de</strong> « germano-roman », alors que Arnald, postulé comme premierélément dans la formation du NL Arnaville [75], est considéré comme « germ[anique] ».L’hypothèse que <strong>de</strong>s <strong>noms</strong> en -ville ou en -court puissent être forgés sur <strong>de</strong>s adjectifs – cas <strong>de</strong>figure certes rare mais néanmoins possible, notamment sur <strong>de</strong>s terres fiscales où la dénominationdu lieu ne pouvait pas s’inspirer du nom du propriétaire – n’est envisagée qu’en cas d’évi<strong>de</strong>nce.Ainsi, Belleville [91] découle bien <strong>de</strong> *bella vīlla, mais dans le même ordre d’idées, rien nes’oppose à ce que le nom d’Autreville [91], situé tout près, soit ramené à *altera vīlla.D’une manière générale, les rares toponymes dont les étymons sont d’origine francique n’ontpas trouvé d’explication satisfaisante, mais le fait ne saurait en aucun cas être reproché à l’auteurcar la méthodologie actuelle <strong>de</strong> l’onomastique <strong>de</strong> contact germano-romane est encore peu connueen France 17 . Certaines <strong>de</strong> ces formes d’origine francique n’ont d’ailleurs pas été i<strong>de</strong>ntifiées comme14 Cf. PUHL, op. cit., p. 189 ; CHAMBON, Jean-Pierre. 2004. « Zones d’implantation publique au HautMoyen Âge précoce dans le nord <strong>de</strong> la cité <strong>de</strong> Besançon. L’apport <strong>de</strong> l’analyse diachronique <strong>de</strong>s <strong>noms</strong> <strong>de</strong><strong>lieux</strong> ». In : HÄGERMANN, Di<strong>et</strong>er/HAUBRICHS, Wolfgang/JARNUT, Jörg (dir.). Akkulturation. Problemeeiner germanisch-romanischen Kultursynthese in Spätantike und frühem Mittelalter. Berlin/New York : <strong>de</strong>Gruyter, p. 221-256, ici p. 240-242.15 Cf. PITZ, Martina. 2003. « Innovations du centre <strong>et</strong> archaïsmes du Nord-Est : fruit du contact <strong>de</strong>s langues enGaule mérovingienne ? Considérations sur le nord-est du domaine d’oïl dans la perspective d’une linguistique<strong>de</strong> contact. VR 62, p. 86-113, ici p. 102-105.16 Cf. PITZ, Martina. 2002. « Nouvelles données pour l’anthroponymie <strong>de</strong> la Galloromania : les toponymesmérovingiens du type Avricourt ». RLiR 66, p. 421-449.17 Voir à ce suj<strong>et</strong> PITZ, Martina. 2004. « Namen und Siedlung im südöstlichen Vorland <strong>de</strong>s merowingischenKönigssitzes M<strong>et</strong>z. Überlegungen zur Relevanz toponomastischer Zeugnisse als Indikatoren fränkischerSiedlung im Nordosten <strong>de</strong>r Galloromania ». In: DEBUS, Friedhelm (dir.). Namen in sprachlichenKontktgebi<strong>et</strong>en. Hil<strong>de</strong>sheim/Zurich/New York : Olms, p. 127-225, ici p. 142-145.10
Comptes rendustelles. C’est le cas d’Atton (836 Stadonis [77]), expliqué par un NP germanique employé <strong>de</strong> façonabsolue alors qu’il doit s’agir <strong>de</strong> l’appellatif a. frq. stado « rive » qui désigne souvent un lieu où<strong>de</strong>s marchandi<strong>ses</strong> sont chargées pour être acheminées par la voie fluviale 18 . De même, Frouard[152] renferme sans doute un composé forgé à l’ai<strong>de</strong> du déterminé mha. hart « forêt » 19 ; Haroué(1371 Herewey, [169]) pourrait renfermer le frq. *hari-weg « via publica » 20 , mais <strong>de</strong>s recherchescomplémentaires semblent nécessaires pour confirmer c<strong>et</strong>te hypothèse. En ce qui concerne lestoponymes en Han, Ham [166 s.], on ne voit pas comment le gaul. *cambo « courbe, méandre »aurait pu être ici remplacé par germ. *hamma. Il s’agit d’un mot d’emprunt d’origine franciqu<strong>et</strong>rès fréquent en toponymie 21 <strong>et</strong> ne semble pas nécessaire d’établir un rapport concr<strong>et</strong> avec latoponymie d’origine gauloise. L’étymologie <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux toponymes en -ingas inclus dans le corpus[37] – il y en a en réalité d’autres si l’on tient compte les doubl<strong>et</strong>s, fréquents dans le nord dudépartement très proche <strong>de</strong> la frontière linguistique (pour Hussigny [176], on note p. ex. une formeancienne 1249 [cop.] Husingen) – doit également être revue : Godbrange (1404 Go<strong>de</strong>branges[158] ne relève pas <strong>de</strong> *Godbertingas, qui aurait abouti à *Gobertanges ou *Gobr<strong>et</strong>anges, maisd’un NP dont le premier élément (germ. *gŭlþa-) 22 a dû contenir un l antéconsonantiqueprécocement disparu dans les variétés lorraines 23 , alors que le second élément est à rattacher àgerm. *bĕra- 24 . Pour Herserange (1273 Herselange [173]), l’étymologie proposée paraît aussi biencurieuse : le NP Hariso est certes attesté 25 , mais on le voit mal prendre un second suffixe en -l- ;mieux vaut poser *Hersilo (germ. *hersa- « cheval ») 26 .Le corpus ainsi analysé comprend exclusivement les toponymes (<strong>noms</strong> <strong>de</strong> communes, <strong>de</strong>hameaux <strong>et</strong> d’écarts) figurant sur la carte Michelin au 1/200.000 e [10] ; les <strong>noms</strong> <strong>de</strong> villagesdisparus ainsi que les microtoponymes sous-tendant l’existence d’un ancien habitat (les bor<strong>de</strong>s, lesbaraques, les bures, <strong>et</strong>c., <strong>noms</strong> en -ville, -court, -meix, -ménil, <strong>et</strong>c.) n’ont pas été r<strong>et</strong>enus, ce quiimplique le danger <strong>de</strong> rattacher certaines formes anciennes au mauvais obj<strong>et</strong>. En revanche,certains <strong>lieux</strong>-dits figurant sur la carte Michelin déjà citée ont été inclus ; le corpus <strong>de</strong>s <strong>noms</strong> <strong>de</strong><strong>lieux</strong> rassemblé ici comprend donc aussi <strong>de</strong>s <strong>lieux</strong>-dits, sans pour autant viser une collecteexhaustive <strong>de</strong> ces microtoponymes : certaines formes, difficiles à analyser, ont été exclues pour<strong>de</strong>s raisons linguistiques, d’autres (hydronymes, odonymes, <strong>noms</strong> <strong>de</strong> hauteurs <strong>et</strong> d’ouvragesdéfensifs, <strong>et</strong>c.) l’ont été pour <strong>de</strong>s raisons typologiques. Même en tenant compte <strong>de</strong>s souhaitspotentiels d’un public d’amateurs désireux <strong>de</strong> pouvoir s’informer rapi<strong>de</strong>ment sur toutes sortes <strong>de</strong><strong>noms</strong>, il aurait peut-être été préférable <strong>de</strong> reléguer l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ces microtoponymes à un ouvrageultérieur ; en tout cas, la position <strong>de</strong> l’auteur selon laquelle une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la seule macrotoponymie18 STARCK, Taylor/WELLS, John C. 1971. Althoch<strong>de</strong>utsches Glossenwörterbuch (mit Stellennnachweis zusämtlichen gedruckten althoch<strong>de</strong>utschen und verwandten Glossen). Hei<strong>de</strong>lberg : Winter, p. 583.19 LEXER, Matthias. 1872. Mittelhoch<strong>de</strong>utsches Handwörterbuch. 3 vol., Leipzig: Hirzel, I, p. 1189. Il s’agitgénéralement <strong>de</strong> <strong>lieux</strong> situés légèrement en hauteur <strong>et</strong> servant <strong>de</strong> pâture pour les bêtes.20 Cf. LEXER, op. cit., I, p. 1269.21 Cf. aussi TAMINE, Michel. 1993. « Le microtoponyme ar<strong>de</strong>nnais Ham ». In : TAVERDET,Gérard/CHAURAND, Jacques (dir.). Onomastique <strong>et</strong> langues en contact. Actes du colloque tenu àStrasbourg, septembre 1991. Dijon : ABDO, p. 143-162.22 Cf. KAUFMANN, Henning. 1968. Ergänzungsband zu Ernst Förstemann : Personennamen. Munich : Fink,p. 151.23 Cf. PITZ, Martina. 1997. Siedlungsnamen auf -villare (-weiler, -villers) zwischen Mosel, Hunsrück undVogesen. Untersuchungen zu einem germanisch-romanischen Mischtypus <strong>de</strong>r jüngeren Merowinger- und <strong>de</strong>rKarolingerzeit. 2 vol., Sarrebruck: sdv, II, p. 849-851.24 Cf. KAUFMANN, op. cit., p. 57.25 Ibid., p. 175.26 Ibid., p. 183.11
- Page 1 and 2: COMPTES RENDUSWIRTH, Aude. 2004. Le
- Page 3: Comptes rendustexte introductif dev
- Page 7 and 8: Comptes rendusde Nancy contenant de
- Page 9 and 10: Comptes rendusUn tel classement a p
- Page 11 and 12: Comptes rendusAllondrelle), qui sem
- Page 13 and 14: Comptes rendusbilinguisme ? », de
- Page 15 and 16: Comptes rendusDans son ouvrage Le t
- Page 17 and 18: Comptes rendusau fait que Mars, sit
- Page 19 and 20: Comptes rendusT. X, p. 104, Échars
- Page 21 and 22: Comptes rendus(cas des composés),
- Page 23 and 24: Comptes rendusvolume n’est pas se
- Page 25 and 26: Comptes rendusSCHWEICKARD, Wolfgang
- Page 27 and 28: Comptes rendusgéographiques, alors
- Page 29 and 30: Comptes rendussurvivra plus qu’un
- Page 31 and 32: Comptes rendus[118] al Casòtt dal
- Page 33 and 34: Comptes renduspar la présence de c
- Page 35 and 36: Comptes rendusmédiéval, étymolog
- Page 37 and 38: Comptes rendusles archives éditée
- Page 39 and 40: Comptes rendusValromane (comm. de M
- Page 41 and 42: Comptes rendusqu’en France, cette
- Page 43 and 44: Comptes rendusmesure où cette pré
- Page 45 and 46: Comptes rendusbasque des origines
- Page 47 and 48: Comptes rendusl’essentiel de son