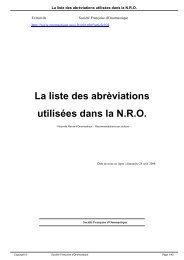Nouvelle Revue d’Onomastique n° 49-50 – 2008universitaire <strong>de</strong>s traducteurs littéraires, alors que Karina van DALEN-OSKAM [184-191] seprononce en faveur d’une approche comparatiste. Katharina LEIBRING [117-125], enfin, insistesur la nécessité d’ouvrir les étu<strong>de</strong>s onomastiques à l’analyse <strong>de</strong> toute catégorie <strong>de</strong> <strong>noms</strong>, y comprisles <strong>noms</strong> d’animaux, les <strong>noms</strong> <strong>de</strong> marques, les pseudonymes sur Intern<strong>et</strong>, <strong>et</strong>c., alors que MilanHARVALIK [55-59] porte une attention particulière aux questions terminologiques car les usagesvarient considérablement d’un pays à l’autre. L’auteur constate la formation fréquente <strong>de</strong>néologismes « extravagants » <strong>et</strong> s’exprime en faveur d’usages plus uniformes <strong>et</strong> d’une impositionprogressive <strong>de</strong> certains internationalismes. Notons enfin que l’une <strong>de</strong>s contributions les plusoriginales, à notre sens, est due au germaniste P<strong>et</strong>er ERNST [37-44] pour qui les points <strong>de</strong>convergence à exploiter en priorité se situeraient surtout du côté <strong>de</strong> la linguistique appliquée <strong>et</strong> <strong>de</strong>stravaux récents sur l’acquisition <strong>de</strong> la langue : comment les <strong>noms</strong> propres s’inscrivent-ils dans lelexique mental <strong>de</strong>s locuteurs, comment font-ils pour les reconnaître <strong>et</strong> se les remémorer ? Les<strong>noms</strong> propres constituent-ils effectivement <strong>de</strong>s signes linguistiques « d’un autre genre », soumis à<strong>de</strong>s règles particulières ?Certes, le concept même qui avait présidé à la réalisation <strong>de</strong> c<strong>et</strong> ouvrage ne perm<strong>et</strong> pasd’exploiter, ni même d’abor<strong>de</strong>r, toutes les potentialités méthodologiques <strong>de</strong> l’onomastique actuellecar les différents auteurs posent finalement plus <strong>de</strong> questions qu’ils n’en résolvent. Il n’en reste pasmoins qu’il s’agit là d’une initiative fort intéressante qui ne <strong>de</strong>man<strong>de</strong> qu’à être complétée par <strong>de</strong>sproj<strong>et</strong>s similaires, notamment pour l’onomastique française qui n’a absolument pas été prise encompte dans c<strong>et</strong>te enquête.Martina PITZGARCÍA GALLARÍN, Consuelo (dir.). 2007. Los nombres <strong>de</strong>l Madrid multicultural,Madrid : Ediciones Parthenon, 346 p.Bien connue pour <strong>ses</strong> travaux sur les pré<strong>noms</strong> espagnols <strong>de</strong>s époques mo<strong>de</strong>rne <strong>et</strong>contemporaine, la coordinatrice <strong>de</strong> c<strong>et</strong> ouvrage a récidivé en lançant une enquête collective sur l<strong>et</strong>hème <strong>de</strong>s pré<strong>noms</strong> actuels dans la ville <strong>et</strong> la communauté urbaine <strong>de</strong> Madrid, portés par leshabitants quel que soit leur âge. Bon nombre ont <strong>de</strong>s origines linguistiques bien éloignées <strong>de</strong>scastillanes : du catalan au japonais en passant par le roumain ou l’hispanoaméricain. <strong>La</strong>prénomination actuelle est à l’image <strong>de</strong>s populations : un brassage linguistique, culturel, social,religieux. [13-15] (Consuelo García Gallarín), “El nombre propio y la construcción <strong>de</strong> lai<strong>de</strong>ntidad”. L’auteur y rappelle notamment la nécessité pour nombre <strong>de</strong> parents <strong>de</strong> « se faire unnom », comme au XVII e s. : le prénom conféré à l’enfant a tendance à le classer quant à <strong>ses</strong>origines (géographiques, sociales…) ; <strong>ses</strong> parents tentent donc, par le prénom <strong>de</strong> naissance, <strong>de</strong> lechanger <strong>de</strong> classe : l’imagination <strong>de</strong> ceux qui rencontrent l’enfant peut alors errer. À l’opposé,l’autre tendance est d’« être soi » : conserver l’i<strong>de</strong>ntité familiale à travers le choix du prénom. [19-42] María <strong>de</strong>l Carmen BRAVO LLATAS, “Descripción estadística <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l padrónmunicipal. Periodo <strong>de</strong> 1996-2006”. L’auteur présente <strong>et</strong> analyse les tableaux <strong>de</strong>s données extraites<strong>de</strong> l’état civil <strong>de</strong> la zone, avec <strong>de</strong>s classements notamment par origines linguistiques (en fonction<strong>de</strong>s pays d’origine), par groupes d’âge. Le plus fort contingent venu <strong>de</strong> l’étranger est équatorien(11,44% du total <strong>de</strong> la population). [43-62] Juan Carlos GALENDE DÍAZ, “Normativa legal <strong>de</strong>lnombre propio”. Dans son historique, l’auteur rappelle la naissance du prénom double à la fin duXVI e siècle. Ensuite, il présente exhaustivement l’historique <strong>de</strong> la législation espagnole sur leprénom, notamment l’interdiction <strong>de</strong>s pré<strong>noms</strong> régionaux sous l’ère franquiste. [65-98] Carlos CidABASOLO, “Nombres vascos en Madrid”. L’auteur dresse un long historique <strong>de</strong> la prénomination50
Comptes rendusbasque <strong>de</strong>s origines à aujourd’hui, <strong>de</strong>s tableaux <strong>de</strong> fréquence actuelle, les étymologies <strong>et</strong> leshypocoristiques, les motivations du choix <strong>de</strong>s pré<strong>noms</strong> (politiques <strong>et</strong> autres). [99-133] ConsueloGARCÍA GALLARÍN, “Tradición e innovación antroponímicas (Madrid, 1996-2006)”. Par unhistorique <strong>de</strong> la prénomination à Madrid tout au long du XX e siècle, l’auteur nous conduit à lapério<strong>de</strong> actuelle par une analyse fine <strong>de</strong>s changements <strong>de</strong>s motivations <strong>et</strong> <strong>de</strong>s évolutionsmigratoires. [135-161] M a Victoria NAVAS SÁNCHEZ-ÉLEZ, “Los nombres <strong>de</strong>l Madridmulticultural : resi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> lengua oficial portuguesa y <strong>de</strong> lengua gallega”. L’auteur analyse lesdonnées en distinguant bien l’origine géographique <strong>de</strong>s lusitanophones : le classement fréquentiel<strong>de</strong>s pré<strong>noms</strong> est extrêmement variable, comme on pouvait s’y attendre. Des rappels historiquesperm<strong>et</strong>tent au lecteur <strong>de</strong> resituer dans le temps l’état actuel <strong>de</strong> la prénomination, <strong>et</strong> <strong>de</strong> relativisercertaines évolutions. [163-178] Juan José ORTEGA ROMÁN, “Nombres catalanes en Madrid”.<strong>La</strong> plupart <strong>de</strong>s <strong>noms</strong> catalans sont typiques, <strong>de</strong> par leur graphie ou leur localisation originelle.Cependant, un certain nombre embarassent qui sont manifestement <strong>de</strong>s formes catalanisées <strong>de</strong><strong>noms</strong> étrangers aux territoires catalan <strong>et</strong> espagnol. L’auteur constate aussi la gran<strong>de</strong> variabilité <strong>de</strong>sgraphies, observable en Espagne (comme en France), <strong>de</strong>puis les années 1980. [181-196] CarlosCID ABASOLO, Arturo RODRÍGUEZ, LÓPEZ, “Nombres eslavos”. Les <strong>noms</strong> slaves, portés par<strong>de</strong>s Slaves, sont d’un nombre limité, mais leurs variantes graphiques <strong>et</strong> phonétiques nombreu<strong>ses</strong>,en fonction <strong>de</strong> l’origine géographique, mais aussi <strong>de</strong> la translittération, voire l’adaptation. Le nomOleksan<strong>de</strong>r est ainsi adapté par <strong>de</strong>s Rus<strong>ses</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong>s Bulgares sous la forme castillane Alejandro(13,2%), mais aussi sous la française Alexandre (7,4%) [190]. Parallèlement, l’adaptationcastillane Pedro ne représente que 2% <strong>de</strong>s formes issues <strong>de</strong> Piotr dans la population slave <strong>de</strong> lacommunauté urbaine [192]. [197-207] Carmen DÍAZ BAUTISTA, “Antroponimiahispanoamericana : la variación generacional”. Les pré<strong>noms</strong> portés par les immigrés d’originehispanoaméricaine sont marqués par une anglicisation certaine en ce qui concerne le choix <strong>de</strong>spré<strong>noms</strong>, <strong>et</strong> une liberté totale quant au choix <strong>de</strong>s variantes graphies. Pour ne prendre qu’unexemple, celui <strong>de</strong> l’anglais Diana, la graphie du prénom chez les adultes est très majoritairementDiana, celle adoptée pour les jeunes oscille entre Diana, Dayana <strong>et</strong> Dahiana [201]. [209-234]Consuelo GARCÍA GALLARÍN, “<strong>La</strong> evolución <strong>de</strong> la antroponimia hispanoamericana”. Histoirecomparée <strong>de</strong> la prénomination en Amérique du Sud <strong>et</strong> en Espagne. À Madrid, les pré<strong>noms</strong> <strong>de</strong>sadultes immigrés sont entachés d’une volonté d’i<strong>de</strong>ntification aux coutumes anthroponymiques <strong>de</strong>leur pays d’origine ; ceux <strong>de</strong> leurs enfants montrent clairement une volonté d’intégration pardifférents moyens que l’auteur analyse (choix du prénom, <strong>de</strong> la graphie, <strong>et</strong>c.). Les ressortissants<strong>de</strong>s pays qui pratiquent le zézaiement choisissent souvent une graphie qui en rend compte.L’article est d’une gran<strong>de</strong> richesse. [235-253] Ángel IGLESIAS OVEJERO, “Nombres <strong>de</strong>ldominio francófono en el Madrid multicultural (1996-2006)”. Ces <strong>noms</strong> concernent <strong>de</strong>sressortissants aussi bien français qu’africains : c’est ainsi que le prénom le plus fréquent estMamadou. L’analyse ne sépare pas les pré<strong>noms</strong> féminins <strong>de</strong>s masculins, ce qui ne favorise guèreles étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fréquence. L’auteur, dans sa gran<strong>de</strong> nomenclature, relève un prénom féminin que lesparents ont voulu significatif : Nancy Lorenna [244] ; ce peut être aussi un simple jeu <strong>de</strong> <strong>noms</strong>. Lefait que <strong>de</strong>s Français aient pu donner à leurs enfants <strong>de</strong>s pré<strong>noms</strong> d’hommes d’État alors aupouvoir est patent [249] : une adhésion politique a joué ; après leur sortie, le rapport entre le choixdu prénom <strong>et</strong> l’homme est douteux ; la nostalgie a pu jouer dans certains cas, mais la motivationfondamentale n’est plus politique. Prenons l’exemple <strong>de</strong> Philippe : prénom <strong>de</strong> plus en plus donné àpartir <strong>de</strong> 1920, sa fréquence augmente régulièrement jusqu’en 1940 ; en 1941, elle explose (<strong>de</strong>uxfois plus qu’en 1939) : c’est l’époque du r<strong>et</strong>our <strong>de</strong>s prisonniers <strong>de</strong> guerre, <strong>de</strong>mandé <strong>et</strong> obtenu par lemaréchal Philippe Pétain ; puis la fréquence décroît jusqu’à atteindre en 1944 le niveau <strong>de</strong> 1937,en 1945 un niveau inférieur à celui <strong>de</strong> 1936 ; dès 1946, la fréquence repart à la hausse avec leniveau <strong>de</strong> 1940, une très forte hausse jusqu’à 1963. En clair, le prénom Philippe a été à la mo<strong>de</strong> <strong>de</strong>51
- Page 1 and 2: COMPTES RENDUSWIRTH, Aude. 2004. Le
- Page 3 and 4: Comptes rendustexte introductif dev
- Page 5 and 6: Comptes rendustelles. C’est le ca
- Page 7 and 8: Comptes rendusde Nancy contenant de
- Page 9 and 10: Comptes rendusUn tel classement a p
- Page 11 and 12: Comptes rendusAllondrelle), qui sem
- Page 13 and 14: Comptes rendusbilinguisme ? », de
- Page 15 and 16: Comptes rendusDans son ouvrage Le t
- Page 17 and 18: Comptes rendusau fait que Mars, sit
- Page 19 and 20: Comptes rendusT. X, p. 104, Échars
- Page 21 and 22: Comptes rendus(cas des composés),
- Page 23 and 24: Comptes rendusvolume n’est pas se
- Page 25 and 26: Comptes rendusSCHWEICKARD, Wolfgang
- Page 27 and 28: Comptes rendusgéographiques, alors
- Page 29 and 30: Comptes rendussurvivra plus qu’un
- Page 31 and 32: Comptes rendus[118] al Casòtt dal
- Page 33 and 34: Comptes renduspar la présence de c
- Page 35 and 36: Comptes rendusmédiéval, étymolog
- Page 37 and 38: Comptes rendusles archives éditée
- Page 39 and 40: Comptes rendusValromane (comm. de M
- Page 41 and 42: Comptes rendusqu’en France, cette
- Page 43: Comptes rendusmesure où cette pré
- Page 47 and 48: Comptes rendusl’essentiel de son